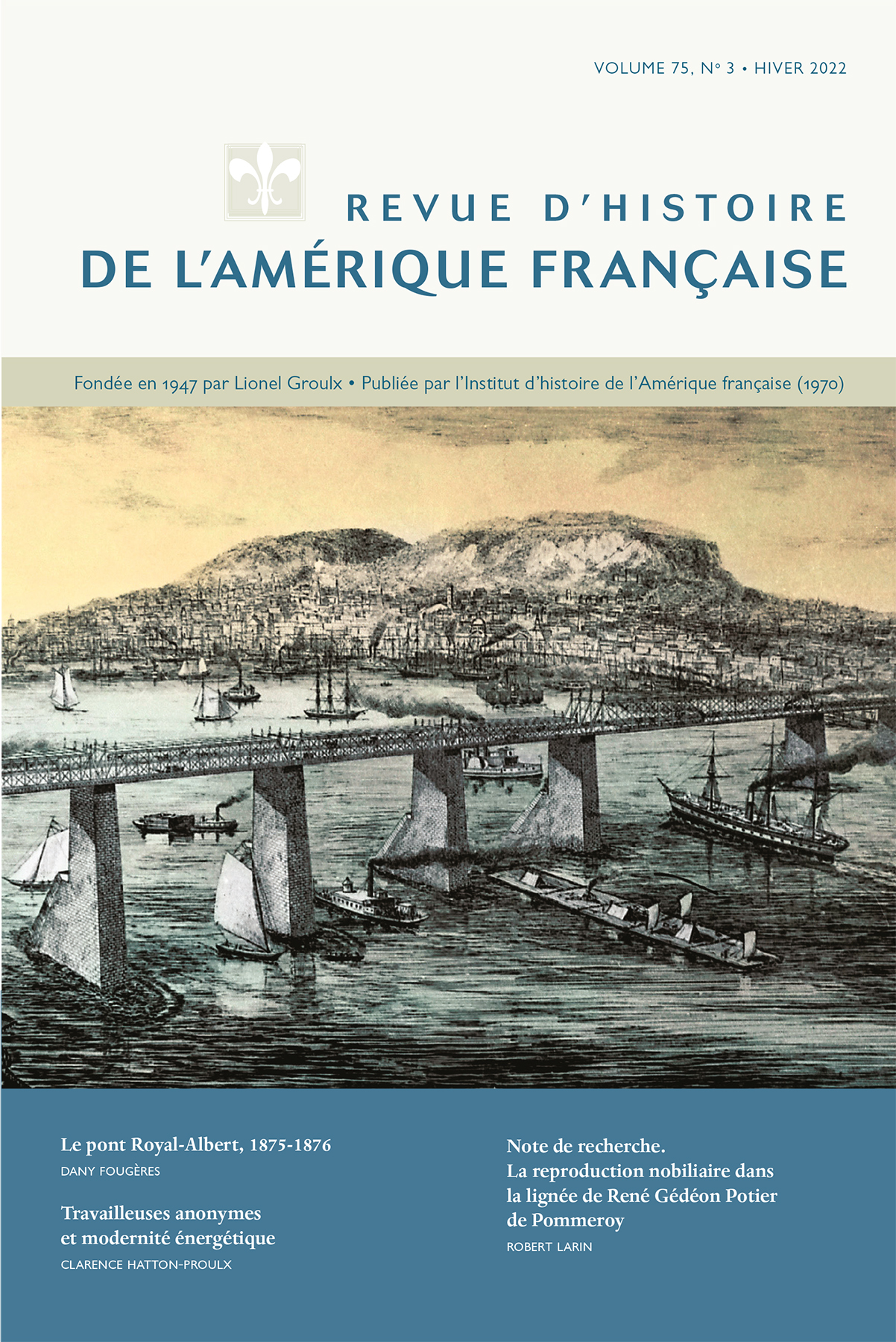Et si notre connaissance du « sujet moderne », tel que saisi non seulement dans son parcours de vie ou son agentivité mais aussi dans ses expériences d’écriture et de lecture, était fragmentaire parce que trop focalisée sur le colon européen ? Et que cette connaissance n’accordait pas assez d’espace aux réalités culturelles contrastées des actrices et des acteurs sur le territoire et à leur interaction à la même époque ? Et si les événements qui se sont produits dans les coins les plus reculés de la colonie française avaient eu des conséquences profondes sur la construction de ce même « sujet moderne » ? Et si, dans l’appréciation de cette construction, on avait sous-estimé l’importance de la répétition de gestes tout simples au fil des décennies, d’un ensemble de petits rituels qui auraient concouru à la genèse de subjectivités à la fois européennes et autochtones ? L’ouvrage de Paul-André Dubois non seulement explore toutes ces questions délicates, mais fait du même coup voler en éclats bon nombre de vieux clichés surannés ou binaires sur l’instruction – et plus largement l’éducation – des peuples autochtones. Le livre séduit dès le départ avec son choix d’échelle. Ainsi, plutôt que de commencer avec une discussion conceptuelle qui prendrait à témoin l’« Amérindien », la « civilisation » ou encore la « Nouvelle-France », l’auteur s’attache plutôt à mettre en scène l’intimité des actrices et des acteurs sociaux alors qu’ils apposent leurs signatures sur des contrats de travail ou à l’occasion d’un mariage. À terme, l’approche invite par défaut à revoir les grandes catégories d’analyse à l’aune des complexes réalités du terrain, telles que révélées par les multiples archives de première main mobilisées par l’auteur. Le portrait qui en découle est tout sauf homogène, interpellant à la fois les multiples réalités autochtones — qui comprennent l’esclavagisme — et une variété de contextes de scolarisation. Un portrait qui force au passage la redéfinition des concepts mêmes d’« éducation », d’« Autochtone » et même d’« Amérique française ». La démonstration démarre avec l’analyse d’une première vague de francisation à la fin du 17e siècle, où des enfants autochtones s’initient d’abord à la lecture et à l’écriture. Un mouvement qui s’étiole toutefois dès le début du 18e siècle, laissant la place au chant et au commerce comme interfaces d’échange et à l’institution du mariage (avec des colons européens) comme valeur-refuge pour les filles. Cette évolution est notamment tributaire d’enjeux culturels – parmi ceux-ci les principes de l’enseignement jésuite –, mais aussi plus généralement des difficiles conditions de vie, rythmées par les guerres et l’instabilité politique. Toutefois, au-delà des témoignages eurocentrés qui soulignent les limites et les insuccès des entreprises de francisation et plus largement d’éducation des Autochtones, l’auteur parvient à dégager l’essence de plusieurs parcours individuels particulièrement instructifs quant à la construction culturelle qui prend tout de même place en silence. Par l’observation des signatures de filles, par exemple, témoignage du legs des mères instrumentalisé ensuite dans le marché des unions ; ou encore par l’analyse du mimétisme vestimentaire, promesse d’une intégration à la société coloniale ; enfin par l’intérêt des protagonistes à profiter du contexte scolaire, sans nécessairement acquérir toutes les compétences langagières dictées par les normes européennes. En explorant cet univers scolaire, l’auteur observe le rôle de la famille, des réseaux de sociabilité et du clientélisme. Il apprécie également l’influence de l’État, qui fait figure à la fois de complice et d’opportuniste dans la récupération de cette « acculturation autochtone » dans le jeu politique. Mais plus fondamentalement, l’un des enseignements les plus percutants de cet ouvrage repose dans sa capacité …