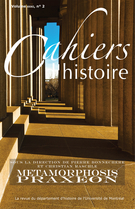Article body
Milton Friedman se faisait gloire d’affirmer que plus une théorie économique est significative, plus ses postulats sont irréalistes. Chantre de la « magie du marché » durant la guerre froide, il ne reprenait en cela qu’une tradition déjà commencée par David Ricardo, le père de la théorie des avantages comparatifs, au coeur de la justification du libre-échange international actuel, qui aurait répondu à un ami lui reprochant que sa théorie ne concordât pas avec les faits : « c’était tant pis pour les faits »[1].
Erik S. Reinert, un des chefs de file en matière d’économie hétérodoxe, dans une oeuvre magistrale combine non seulement l’histoire de la pensée économique, passablement escamotée par l’idéologie libérale d’un Paul Samuelson, et l’histoire des politiques économiques réellement prises par les nations aujourd’hui riches, fort différente de l’histoire mythologique telle que véhiculée par l’orthodoxie néolibérale. En fait, aucune nation aujourd’hui riche n’y est parvenue lors des 500 ans dernières années[2] sans employer une panoplie d’outils pour favoriser les activités économiques plus porteuses de richesse, outils aujourd’hui interdits par des institutions comme le FMI. Bien que l’histoire soit le seul laboratoire d’expériences disponibles à l’économie, la théorie économique actuelle prétend que le contexte et l’histoire importent peu, qu’on peut prescrire la même médecine à toutes les situations, au même titre que le Dr Quesnay, adepte du laissez-faire, préconisait des saignées pour tous ses patients, qu’importe la maladie dont il était atteint…
Sait-on que l’histoire nous apprend que dans les 100 ans suivant les recommandations d’Adam Smith aux Anglais en 1776 de s’ouvrir au libre-échange, l’Angleterre eut des droits de douane plus élevés que la France, pourtant considérée comme bastion du protectionnisme ? Que les États-Unis furent le pays le plus protectionniste de l’histoire au xixe siècle ? Pour Reinert, l’oeuvre Adam Smith loin d’être une percée dans la « science » économique fut au contraire une rétrocession dans la compréhension des mécanismes de la croissance et du développement. En plus, selon Reinert, Smith est à l’origine d’un mythe, celui que les « mercantilistes » auraient été sots au point de confondre l’or avec la richesse dans le but d’ôter toute légitimité à ses prédécesseurs et masquant ainsi les grands efforts, théoriques et pratiques, qui furent nécessaires à la création de la civilisation industrielle et des nations dites aujourd’hui développées.
C’est la guerre froide qui réduisit les modèles économiques à deux utopies dérivant de la même conception ricardienne de la valeur du travail, le libéralisme et le communisme : pour atteindre l’équilibre mythique qui serait par défaut l’état maximum de croissance et de bien-être, l’un laisse les forces « spontanées » du marché agir alors que l’autre remplace le marché par une énorme calculatrice centrale. Pourtant, une tout autre tradition et pratique exista jusqu’alors, celle de l’Autre Canon[3], fondée sur l’expérience plutôt que sur les modélisations mathématiques abstraites si présentent dans nos départements d’économie aujourd’hui. C’est cette tradition que Reinert s’emploie à nous faire découvrir.
De question simple : « pourquoi un barbier péruvien, tout aussi efficace que son collègue norvégien, gagne-t-il 10 fois moins ? », à des plus complexes, « pourquoi les pays se spécialisant dans l’agriculture ont non seulement une agriculture beaucoup moins moderne que celle des pays avancés, mais qui plus est, il y sévit disettes et famines ? » la recherche de Reinert permet d’y répondre. Pour un Von Justi, le plus important économiste allemand du xviiie siècle, il allait de soi qu’une colonie à laquelle on imposait de se spécialiser dans la production de matière première et à qui on interdisait la production des manufactures était condamnée à la pauvreté. Pourtant, les thèses économiques d’Adam Smith et David Ricardo basées sur le troc, et non sur la production et l’innovation comme dans l’Autre Canon, posèrent les fondements moraux de la justification du colonialisme, soit la spécialisation dans la production de matière première. Cela put se faire en éliminant de la théorie économique les différences qualitatives des activités économiques et la dynamique du changement technologique laissant donc croire qu’une nation peut se développer indépendamment de la nature de ce qu’elle produit : vous deviendrez tout aussi riche en vous spécialisant dans l’exportation de bananes que dans la production de voiture. Il est étonnant que bien des professeurs d’économie perdissent leur temps aux études alors qu’ils eurent pu devenir tout aussi riches en étant laveurs de vaisselle…
En ne se concentrant que sur l’échange et le commerce, non seulement la théorie économique actuelle perd des notions clés à la base même de la croissance économique (innovation, rendement croissant, synergie, infrastructure, etc.), elle induit aussi une distorsion de notre vision historique en confondant les périodes de booms économiques dues à une nouvelle technologie avec l’ouverture des marchés, alors qu’en réalité le commerce n’est qu’une courroie de transmission du progrès, son origine étant la nouvelle technologie, elle-même ayant pour origine la faculté créatrice de l’humain. Cette distorsion empêche aussi de découvrir les causes de sous-développement des colonies, formelles ou informelles, à la suite de la « première » mondialisation au début du xxe siècle[4] ou encore l’échec complète des « thérapies de choc » néolibérales aujourd’hui.
Un livre essentiel pour notre époque, autant à l’historien souvent peu au fait des débats économiques qu’aux économistes trop souvent ignorants de l’histoire.
Appendices
Notes
-
[1]
« That’s so much worse for the facts ».
-
[2]
Ceci inclut les nations faussement représentées comme les succès de la « mondialisation » comme la Corée du Sud ou même la Chine, qui en fait n’ont aucunement suivi l’ouverture complète et la dérégulation, mais usèrent et usent de stratégie industrielle volontariste, jadis bien connue en Europe et en Amérique du Nord.
-
[3]
Voir « The Family Tree of The Other Canon » [en ligne], Other Canon, www.othercanon.org/papers/tree.html (page consultée le 15 octobre 2012).
-
[4]
Voir à ce propos Mike Davis, Late Victorian Holocausts : El Niño Famines and the Making of the Third World, Londres, New York, Verso, 2001.