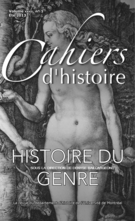Il n’est sans doute pas exagéré de dire que le concept de genre a été au coeur même des bouleversements de la discipline historique depuis une bonne quarantaine d’années. Emprunté à la psychologie, le terme a d’abord été utilisé par les historiennes pour rejeter le déterminisme biologique auquel les femmes étaient constamment renvoyées, et qui servait à justifier les inégalités entre les sexes, pour mieux souligner que la féminité, loin de constituer le reflet de la nature profonde et donc immuable des femmes, était une construction sociale et culturelle visant à légitimer la domination masculine. Dans cette perspective, le genre désignait l’ensemble des caractéristiques et attributs que chaque société, à différentes époques, avait prêtés aux femmes — mais aussi aux hommes — et dont découlaient les rôles et les fonctions que chaque sexe devait assumer, de même que la part de pouvoir revenant à chacun. Faisant écho à la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme : on le devient », cette manière de concevoir le genre supposait que la dimension sociale et idéologique de la différence sexuelle pouvait varier alors que la dimension anatomique demeurait immuable, établissant ainsi une dichotomie un peu factice qui a été contestée par la suite ; mais cette vision avait au moins le mérite de « dénaturaliser » les femmes et leurs activités et, du fait même, de les considérer de plein droit comme sujets de l’histoire. La théorisation du genre comme catégorie d’analyse a pris une nouvelle dimension, tout en suscitant un débat enflammé, en 1986 avec la parution de l’article de l’historienne américaine Joan Scott intitulé « Gender. A Usefull Category of Historical Analysis » dans lequel elle définit le genre de deux façons : comme « un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes » et comme « une manière première de signifier des rapports de pouvoir ». Inspirée des théories poststructuralistes, cette définition à deux volets insistait donc, d’une part, sur l’interdépendance de la construction des identités sexuées (le féminin ne pouvant se comprendre sans considérer le masculin et inversement), les différences présumées entre la féminité et la masculinité étant au fondement des rapports de pouvoir qui les relient, et, d’autre part, sur la dimension genrée de tout rapport de pouvoir (social, politique, économique, etc.), le genre représentant le prisme à travers lequel ces rapports sont construits et appréhendés. En d’autres termes, pour Joan Scott, non seulement le genre est une catégorie d’analyse utile, fondamentale même, pour conceptualiser les identités sexuées et leurs rapports ; il s’avère aussi un outil indispensable en ce qu’il permet d’examiner tous phénomènes et événements historiques dans une perspective renouvelée, c’est-à-dire en considérant que les perceptions de la différence sexuelle « structurent, naturalisent et légitiment non seulement les rapports entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les nations, les empires et leurs colonies, ou, de manière globale, entre les dominants et dominés ». La conceptualisation de Scott a donc transformé l’histoire du genre pour en faire une dimension incontournable du fonctionnement de tous les rapports de pouvoir, élargissant ainsi considérablement son champ d’application ; elle a aussi stimulé les études sur la masculinité, tout comme elle a débouché sur une intense réflexion au sujet de l’imbrication des identités sociales (genre, classe, race, nationalité, âge, orientation sexuelle, etc.). Depuis quelques années, l’approche intersectionnelle, comme on la désigne couramment, a parfois conduit à remettre en question la prééminence de l’identité de genre dans la construction de la subjectivité des individus, tout comme des systèmes d’oppression, mais ces débats, comme ceux qui les ont précédés, …
Le mot de la directrice[Record]
…more information
Denyse Baillargeon
Professeure titulaire, Département d’histoire, Université de Montréal