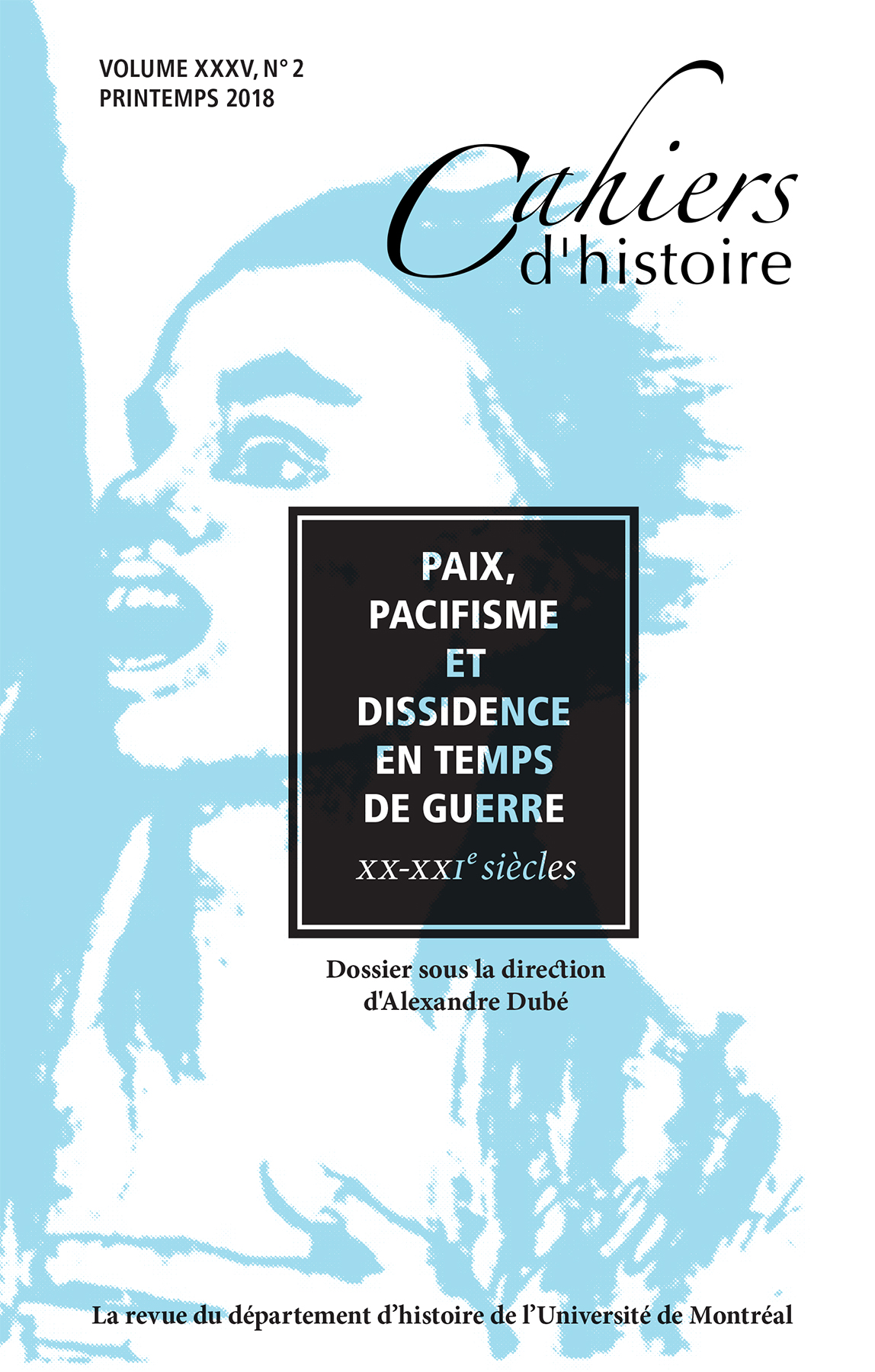Abstracts
Résumé
Cet article aborde l’influence de la Première Guerre mondiale sur la vie philosophique de Bertrand Russell, qui s’insurgea implacablement contre la violence et repensa les conditions nécessaires à une paix durable. La philosophie politique qui en découle, consignée dans les Principes de reconstruction sociale (PRS), est de plusieurs façons une « pensée de l’action » ; elle prend pour objet le domaine de l’activité humaine, mais répond également au besoin criant d’une pensée utile pour agir en temps de crise. Cette pensée est aussi le mode d’action propre du philosophe, donc son plus grand pouvoir sur l’ordre des choses dans le monde.
Article body
D’un point de vue philosophique, la question de la paix—dont l’urgence accompagne une déclaration de guerre—exige une perspective critique qui s’avère délicate pour le penseur. Pris au coeur du conflit, le philosophe est aussi un membre de la société civile et, qu’il le veuille ou non, il appartient à un camp ou à un autre. Dans ces conditions, difficile de prétendre à l’universalité de la réflexion comme pour un problème formel. La philosophie elle-même se trouve mise à l’épreuve autant que le philosophe, car l’idéalité des systèmes risque de se fracasser contre la force chaotique soulevée par les belligérants. En temps de guerre plus que jamais, le fruit du meilleur raisonnement semble impuissant face aux manipulations des politiciens :
Vous pouvez écrire des pages et des pages, des traités entiers sur la liberté, la justice, la paix, l’hospitalité et constater leur absence totale de conséquences sur l’ordre du monde, parce que les décisions [politiques] répondent à une autre logique, parce qu’elles engagent des intérêts et des forces qui donnent lieu à d’autres calculs. La politique, autrement dit, constitue une épreuve pour la philosophie, du simple fait qu’elle l’amène à douter d’elle-même[1].
La Première Guerre mondiale fut un choc particulièrement violent pour la pensée occidentale. Elle servira ici de contexte à une réflexion sur Bertrand Russell[2]. Celui-ci releva l’épreuve qui se présentait à lui comme penseur existant[3], qui doit composer avec les déterminations de son époque. Inscrite dans l’actualité, sa réflexion fut néanmoins assez fondamentale pour avoir aujourd’hui la même pertinence qu’il y a cent ans. Il se distingue ainsi de nombreux intellectuels de son époque, qui ne surent échapper aux lourdeurs du patriotisme, ou dont les idéaux pacifistes ignoraient la complexité du réel.
La guerre fut aussi le prétexte d’une véritable révolution dans la vie du philosophe lui-même, qui se découvrit face aux événements l’énergie d’une nouvelle jeunesse, destinée à combattre la guerre à même son fondement dans la nature humaine. C’est ainsi, d’après John Lewis, qu’il adopta comme philosophe le rôle d’une figure publique, à l’image d’un Socrate ou d’un Mill : « À une époque où la philosophie académique devenait de plus en plus alambiquée et distante, il quitta délibérément l’étude afin de critiquer, exciter et intéresser l’homme ordinaire aux grandes questions confrontant l’humanité »[4].
Cet article abordera l’influence d’une guerre sans précédent sur la vie philosophique de Russell, qui s’insurgea implacablement contre sa violence. Lorsque la paix fut compromise, il disposa aussi du meilleur champ d’observation pour comprendre ce qui l’entrave, car auparavant subsistaient chez lui certains préjugés sur la nature humaine, masqués par les circonstances habituelles de la vie en société. En réponse aux souffrances de l’humanité, sa pensée de l’action porte l’espoir d’un impact à long terme sur le monde. Elle engendra une philosophie politique mûrie au fil de son engagement intellectuel et militant. Présentée lors de conférences en 1916, celle-ci paraîtra la même année sous forme de livre au titre évocateur : les Principes de reconstruction sociale (PRS). Cet ouvrage, concis mais riche en réflexions, examine d’abord les sources de l’action humaine, afin de rendre compte des causes profondes de la Grande Guerre. Il propose enfin des solutions concrètes, à commencer par la modification fondamentale des institutions sociales comme l’État, la propriété, la religion, le mariage et l’éducation. Avant de parcourir le propos des PRS, il est cependant essentiel de comprendre l’originalité de l’auteur par rapport à la majorité des intellectuels de son époque ; le conflit provoqua une rupture sans précédent au sein de sa vie personnelle et intellectuelle, dont l’accent porta dès lors sur la sphère du réel au lieu de l’idéalité des concepts, comme le souligne Francis Jacques :
À l’instar des philosophes-rois de la République, il vint à la philosophie par les mathématiques ; comme eux, il les abandonna pour appliquer son intelligence méthodique à la conduite des affaires humaines. Pourtant, alors que Platon présentait ce retour comme une obligation pénible, Russell ne pouvait se défendre de répondre aux sollicitations les plus intenses du moment.[5]
Bertrand Russell et la Première Guerre mondiale ; une période charnière pour le penseur et sa pensée
Philosophe couronnée de succès, Bertrand Russell fut avant tout reconnu pour son élaboration d’un fondement « logiciste » pour les mathématiques dans les Principia Mathematica, écrits avec A.N. Whitehead[6]. Parus entre 1910 et 1913, les trois tomes de cet ouvrage sont le fruit d’une dizaine d’années de travail visant à édifier les mathématiques pures non plus sur des axiomes, mais sur des concepts définis en termes logiques, conformément au principe d’économie conceptuelle attribué à Guillaume d’Ockham. Maître de conférence au Trinity College de Cambridge, Russell était, avant la guerre, occupé par une philosophie formelle, lorsque son attention se tourna vers la question politique. Il cultivait cependant déjà un intérêt pour les affaires publiques ; son premier ouvrage, basé sur une enquête menée à Berlin, porte sur le socialisme en Allemagne[7].
En 1914, Bertrand Russell était bien implanté dans la vie intellectuelle de son temps. La voix qu’il élèvera pendant la guerre en publiant des tracts, ainsi que des lettres et des articles dans les journaux, sera donc loin d’être anonyme. Elle lui vaudra pourtant quelques ennuis auprès du gouvernement[8], qui voyait d’un mauvais oeil le pacifisme d’un éminent philosophe, issu qui plus est de la noblesse britannique. La fermeté de son engagement tout au long des hostilités en fit une figure à part parmi les penseurs qui vécurent comme lui le début du conflit ; pour beaucoup, la réflexion n’allait pas de pair avec un activisme comparable à celui de ce logicien qui, par la force des choses, devint tout autant un penseur politique qu’un militant. Sur le plan individuel, la guerre fut paradoxalement un remède contre la stérilité qui hantait son travail en logique symbolique, si éloigné de la réalité humaine.
La guerre des intellectuels
En mesurant la réaction de quelques penseurs européens-Husserl, Bergson, Russell et Freud-lors des premiers mois de la guerre, Roger Bruyeron remarque l’aplomb singulier de Russell, qui ne se laissa jamais emporter par la fièvre patriotique : « À l’exception de Russell, farouchement opposé au déclenchement de cette guerre, et cela de bout en bout, […] les philosophes font preuve avant tout du désir, en somme commun, de voir leur pays, sûr de leur bon droit, remporter rapidement et à moindre frais une juste victoire »[9]. Bien qu’une part de lui souhaitât toujours que son camp l’emporte, la véritable allégeance de Russell n’allait pas à sa nation, mais au genre humain, qu’il espérait voir prospérer comme un tout, sans le gouffre imaginaire qui nous sépare de l’ennemi. L’éclatement du conflit rompait avec l’idéal internationaliste qui animait jusqu’alors les échanges culturels en Europe et représentait à ce titre une véritable catastrophe.
Outre Russell, les intellectuels des pays en guerre réagissaient très diversement aux événements et beaucoup mirent leur pensée au service de l’effort militaire. L’exemple le plus flagrant de cette tendance est peut-être l’appel des intellectuels allemands aux nations civilisées dans lequel ils défendent l’honneur de leur patrie face aux accusations d’atrocités commises lors de l’invasion de la Belgique. Ils y protestent solennellement, en six points, de l’innocence et de la légitimité des actions allemandes, mais le contenu du Manifeste des 93, daté du 3 octobre 1914, n’est que secondaire par rapport à la signification du geste comme tel ; ils usent de leur autorité de savants pour justifier la guerre menée par l’Allemagne. Ils introduisent ainsi ce que l’on nomma « les idées de 1914 », décrites ainsi par Jean-Jacques Becker : « l’originalité des intellectuels allemands, en l’occurrence plus chez les écrivains et les philosophes que chez les scientifiques, fut de développer un courant puissant visant à définir la vocation de l’Allemagne en opposition à celle de ses adversaires »[10]. Ces intellectuels pensaient contribuer à l’effort de guerre en tant que « précepteurs de la nation », chargés de définir sa mission particulière, noeud du sentiment d’appartenance au monde allemand.
Il n’y a pas qu’en Allemagne que les intellectuels se mêlèrent aux hostilités. Le Manifeste des 93 suscita de fortes réactions en France, où la population s’insurgea d’un même souffle. La réponse française fut exprimée par les institutions savantes dans un recueil paru en 1915 : les « Déclarations de l’Institut et des Universités de France à propos du manifeste des intellectuels allemands ». Quant aux penseurs singuliers, plusieurs publications de l’époque font preuve du bellicisme des intellectuels non mobilisés, qui défendaient la culture nationale en rejetant sur l’adversaire la culpabilité de la guerre. Louis Dimier exemplifie cette tendance dans sa traduction commentée du Manifeste ; le petit livre réfute non sans dédain l’argumentaire allemand dans une joute intellectuelle adjointe aux efforts militaires. Son but explicite était d’associer le domaine de l’esprit à l’héroïsme des combattants, et ce afin d’assurer la victoire de son camp : « Puisse-t-il, tandis qu’une jeunesse héroïque verse son sang sur les champs de bataille, témoigner, de la part de ceux qui furent ses maîtres, un zèle égal pour la patrie »[11].
Russell comprit très différemment le rôle des intellectuels face à la guerre et n’hésita pas à le faire savoir dans un appel de son cru, adressé à ses homologues de toute l’Europe. Il était horrifié que ceux-ci, malgré leur familiarité avec la pensée rationnelle, adoptent le militarisme nationaliste avec la même ferveur que les masses. En 1915, il publia On Justice in War-Time. An Appeal to the Intellectuals of Europe, où il dénonce leur complaisance pour le biais nationaliste : « Au sein des temps modernes, philosophes, professeurs et intellectuels entreprennent en général volontairement de pourvoir leurs gouvernements respectifs de ces ingénieuses distorsions, et subtiles non-vérités par lesquelles on donne l’impression que toute la bonté est dans un camp et toute la méchanceté dans l’autre »[12]. Leurs propos se contredisent mutuellement, mais ils s’entendent tous pour agir comme si leur devoir était de donner raison à la patrie. Si des figures comme Romain Rolland firent exception à la règle en défendant l’internationalisme, Russell déplorait que beaucoup parmi ceux qui partageaient cette perspective choisirent de garder le silence[13].
Le plus souvent, les penseurs qui affichaient leurs opinions manquaient de détachement intellectuel : « L’allégeance à la nation a balayé du revers l’allégeance à la vérité »[14]. Russell voulut leur rappeler que la vérité est neutre et qu’elle ne saurait être adaptée aux besoins des nations en guerre. Le réel devoir des intellectuels serait plutôt de prêter leur voix à la vérité, que leur vocation habituelle les incite déjà à rechercher. Ils devraient indifféremment relever les vérités et faussetés professées par les deux camps, afin de préparer l’entente commune entre les nations. La paix, si elle doit prendre la forme d’une réconciliation, est à conclure sous l’égide de la vérité dont ils paveraient la voie.
Dans cette guerre mécanisée, même les progrès de la science qui permettent l’amélioration de la condition humaine furent mis au service d’une destruction plus efficace. Russell souligne aussi l’importance des savants comme gardiens du savoir, au nom d’un idéal de poursuite désintéressée de la vérité et de la justice. Afin de prévenir son instrumentalisation néfaste, il faudrait associer au savoir une certaine élévation de l’esprit, qui en ferait l’instrument du progrès au lieu d’accroître les souffrances. L’appel conclut sur une exhortation de circonstance : « Il est temps d’oublier notre soi-disant devoir séparé envers l’Allemagne, l’Autriche, la Russie, la France, ou l’Angleterre, et de se rappeler ce devoir supérieur envers l’humanité dans lequel nous pouvons encore être unis »[15]. Cet texte résume les motivations de Russell lui-même dans ses agissements à compter de 1914, car c’est une conception idéale de son devoir en tant que philosophe qui l’incita à risquer ce que l’on pourrait appeler une « pensée de l’action ».
Penser pour agir : le militantisme de Russell
Cette « pensée de l’action » inspirée par la guerre doit s’entendre en plusieurs sens : en premier lieu, la pensée de Russell vise directement l’action ; il s’agit pour le philosophe de faire face aux événements qui se déroulent sous ses yeux, sans déroger de son idéal éthique et politique. En temps de guerre, la question éthique « que dois-je faire ? » se traduira en actes concrets si le penseur veut être conséquent avec lui-même. À ce titre, l’engagement de Russell dans la Ligue contre la conscription[16] n’est pas sans rappeler ses convictions libérales, car il militait de la sorte pour la liberté individuelle. Pour lui, le service militaire obligatoire représentait un abus de pouvoir de la part de l’État, qui exerçait ainsi une puissance excessive.
Russell défendit aussi la cause des objecteurs de conscience, poursuivis sans trêve par les autorités britanniques. Leur crime était le refus catégorique de participer à l’effort de guerre, au nom de principes moraux plus universels que les exigences insensées du patriotisme. Leur choix était guidé par une véritable réflexion éthique, alors que l’État se parait de moralité pour servir son propre intérêt : « L’État punit à la fois avec une rigueur impartiale, et ceux qui tuent leurs compatriotes et ceux qui refusent de tuer les étrangers »[17]. Les objecteurs de conscience s’interdisaient aussi le service militaire sans combat—offert par le gouvernement à titre d’accommodement—car l’accepter revenait à libérer d’autres hommes pour les tranchées. D’après une lettre de 1916 adressée à Ottoline Morrell[18], Russell admirait le courage de ces pacifistes, dont certains furent même condamnés à mort au nom de leurs convictions : « C’est merveilleux ce que les O. C. ont fait pour la cause de la paix—l’héroïsme n’est plus entièrement du côté de la guerre »[19]. Pour Russell comme pour les objecteurs de conscience, la guerre signifiait qu’il fallait coûte que coûte manifester sa pensée dans sa propre existence.
Agir en pensant : efficacité de la philosophie
Une opposition active à la guerre se présentait donc comme un devoir. Avant celui de la nation, Russell voulait défendre l’honneur de la nature humaine, mais il ne se faisait guère d’illusions quant à l’efficacité de son militantisme. Ce n’est donc pas au moyen de l’action directe qu’il voulut influencer le cours des choses, mais en tant que penseur—forts de cet espoir paraîtront au milieu de la guerre les Principes de reconstruction sociale. Ils sont à distinguer des écrits militants de Russell, qui entreprit dès 1914 de publier dans les journaux ses analyses critiques du conflit. Un virage dans ses aspirations apparaît dans une lettre du 10 février 1916 à Lucy Martin Donnelly[20], avec qui il échangeait sur des questions politiques :
J’ai cessé d’écrire sur la guerre, parce que j’ai dit sur elle ce que j’avais à dire et qu’on ne peut plus rien dire de nouveau.—Mes ambitions sont plus vastes et moins immédiates que celles que mes amis nourrissent pour moi. Je ne recherche pas les applaudissements qu’on obtient quand on dit aux autres ce qu’ils pensent : en réalité ce que je veux, c’est changer les pensées des gens[21].
Il ne fallait plus seulement penser pour agir, mais agir au moyen de la pensée. À cette fin, il conçut dès l’été 1915 les conférences des PRS. Leur succès fut une source d’espoir pour Russell, qui voulait gagner les intellectuels à sa façon de penser la guerre et la politique, ce qui aurait à long terme un impact profond sur la société. Le rôle du philosophe face à la politique serait donc, au-delà de l’aspect critique, une forme indirecte d’action ; une pensée qui se propage affecte les gens, car les convictions des hommes orientent leurs choix.
Russell suivit en un sens le conseil de son frère aîné, Lord Frank Russell, inquiet des représailles du gouvernement contre son cadet :
Ce que le monde attend des intelligences supérieures comme la vôtre, ce n’est pas l’action—pour laquelle le politicien ou le démagogue ordinaire est bien suffisant—mais la pensée, qui est une qualité bien plus rare. Méditez nos problèmes, formulez vos conclusions dans des livres, et laissez-les filtrer lentement à travers les maîtres de la génération prochaine[22].
Lord Russell confond cependant la temporalité du philosophe avec celle de la philosophie ; si les écrits survivent au penseur et cheminent parfois dans le monde des millénaires durant, sa vie fait également office d’oeuvre philosophique. Défendre la vérité de son vivant est aussi le lot du philosophe, dont la réflexion se déploie au sein d’une culture et d’une époque données.
Penser l’action : vers un abandon des préjugés
Si la guerre inspira une pensée de l’action à Bertrand Russell, c’est enfin qu’elle le poussa à s’interroger sur les motifs de l’activité humaine. Cet examen entraîna le rejet de conceptions erronées que les circonstances habituelles de la vie en société pouvaient entretenir. Le penseur subit d’abord une importante désillusion devant l’enthousiasme ambiant lorsque l’Angleterre déclara la guerre à l’Allemagne. Il s’imaginait jusqu’alors que le peuple réprouvait les conflits issus des jeux de pouvoir internationaux. L’emportement irrationnel de ses compatriotes laisse croire qu’un facteur plus profond était en jeu, écrit Russell le 15 août 1914 dans La Nation :
Ceux qui ont vu les foules de Londres, pendant les nuit qui ont précédé la déclaration de la guerre, ont vu toute une population, jusqu’alors humaine et pacifique, précipitée en quelques jours sur la pente raide qui ramène à la barbarie primitive, déchaînant, d’un moment à l’autre, les instances de haine et de sang contre lesquels avait été dressé tout l’édifice de la civilisation[23].
S’il est concevable que des individus belliqueux désirent la perte des Allemands au point de risquer leur vie au combat, cette explication demeure insuffisante pour rendre compte de l’engouement spontané de nations entières pour la guerre—Russell estimait que près de 90 % de la population anglaise s’emballait à l’idée du carnage[24]. La mascarade du patriotisme aurait trompé la plupart des gens sur l’origine de cet emportement, mais le philosophe en cherchera plus loin l’origine.
Leçons sur la nature humaine et source fondamentale de la guerre
Pour découvrir la véritable cause de la guerre, Russell sonda les vues courantes sur le sujet. D’abord, beaucoup parmi les Alliés mettaient le conflit sur le compte du caractère belliqueux des Allemands—trait distinctif présumé de ce peuple que l’on associait au militarisme prussien. Ensuite, bon nombre de pacifistes accusaient plus généralement les gouvernements d’Europe, dont les ambitions d’expansion territoriale et colonialiste ne pouvaient que de susciter des tensions, exacerbées par les diplomates. Russell proposa quant à lui une explication plus essentielle, car elle repose sur l’examen de la nature humaine : « les Allemands et aussi les hommes qui composent les gouvernements sont dans l’ensemble des êtres humains, mus par les mêmes passions que le reste de l’humanité ; ils ne diffèrent que par la suite des circonstances »[25]. S’il explique la guerre à partir de la nature humaine, Russell n’entend pas comme Hobbes que l’état de nature[26] serait un état de guerre de tous contre tous. Il s’agirait plutôt de comprendre comment la nature instinctive de l’homme a pu causer une telle explosion de violence, freinant même le progrès civilisationnel des sociétés européennes[27]. La réponse de Russell touchera au rapport entre l’instinct et la culture qui façonnent ensemble la vie humaine, non sans contradictions ; alors qu’il était peu familier avec la psychanalyse, le philosophe développa une conception des passions et des pulsions qui servira de base pour sa pensée politique.
Entre la raison et l’instinct
À l’époque où Russell écrivit les PRS, la plupart des moralistes traditionnels orientaient l’action en vertu d’une objectivité rationnelle. Par le fait même, ils négligeaient le fond instinctif de l’homme que la culture ne peut entièrement supprimer. En réalité, la plupart des hommes dirigeraient leur vie selon des croyances qui ne doivent rien à la raison, mais tout à la pulsion. Ces croyances donnent un sens a posteriori à l’action, qui jaillit plutôt des couches souterraines de la conscience. La pulsion se drape de pensée, car les hommes veulent croire qu’ils agissent raisonnablement et que leurs motivations peuvent être expliquées. Les justifications qu’ils donnent à la guerre manifestent au plus haut point cette tendance, car un examen véritablement rationnel de ses implications—ce que le philosophe et logicien ne manqua de faire—la présente comme pure folie : « Les croyances sans fondement sont l’hommage que la pulsions rend à la raison ; et ainsi, des croyances opposées mais similaires, font que les hommes, ici aussi bien qu’en Allemagne, considèrent comme un devoir de poursuivre la guerre »[28].
Pour Russell, la Grande Guerre sonne le glas des morales traditionnelles fondées sur un préjugé rationaliste. Une plus grande domination de la raison ne peut rien contre les pulsions guerrières, car elle est une force trop négative pour maîtriser la vie dans toute sa complexité ; à elle seule, la raison ne suffit pas à motiver l’action. La pensée rationnelle ne bride l’agressivité que si elle relève à son tour d’une passion dominante, comme pour certains intellectuels qui éprouvent une réelle passion pour la vérité : « La passion seule peut maîtriser la passion, et seule une pulsion peut contrarier une autre pulsion »[29]. La vie intellectuelle est cependant trop abstraite pour orienter l’action de la plupart des gens ; pour l’homme ordinaire, la faculté rationnelle est plutôt orientée vers la réalisation de buts qui, lorsqu’ils ne sont pas imposés de l’extérieur, relèvent du désir.
Entre désir et pulsion
Si la morale privilégie la rationalité, la philosophie politique connue de Russell concevait l’activité humaine à l’aune du désir. Quand l’imagination se représente un manque à combler, celui-ci devient un but à réaliser, c’est-à-dire un désir. Le satisfaire coûte du temps et des efforts, d’où l’importance de la volonté comme force directrice de l’action, dont la fin est dictée par le désir. Sans en nier l’importance, Russell considère qu’il s’agit de la source la plus consciente et la plus civilisée de l’activité humaine, mais non de la plus fondamentale, ni de la plus puissante. À titre de preuve : même le désir de prospérité économique, qui occupe une place prédominante en politique, n’a pas suffi à désenchanter la population anglaise par rapport à une guerre qui perturberait inévitablement l’économie nationale.
Alors que le désir n’est qu’une source partielle de l’action, la part décisive relèverait des pulsions. Une vie pulsionnelle normale, non contrariée par des circonstances étrangères, vise l’action pour elle-même et non comme un simple moyen. Elle n’implique pas d’intermédiaire comme la volonté, car sa force directrice serait la vitalité instinctive de l’homme. Contrairement au désir, la pulsion ne tient pas compte des résultats ; elle ne cherche qu’à s’épancher. Dans une société gouvernée par des fins—comme la société industrielle moderne, qui valorise le gain et la production de biens—la vie pulsionnelle s’avère problématique, car elle échappe à tout contrôle. Au sein des institutions qui gouvernent cette société, l’homme est traité comme une ressource économique dont il faudrait maximiser l’efficacité au détriment de ses besoins instinctifs. La vie civilisée refoule donc une grande part de la vie pulsionnelle, avec des conséquences désastreuses pour la vitalité des individus et du corps social dans son ensemble.
Société industrielle moderne et répression de la vie pulsionnelle
La pulsion agit sans égard pour les conséquences, mais un homme sain en tire généralement des résultats désirables pour eux-mêmes. Cependant, que l’issue soit avantageuse ou pas, la pulsion garde la même force, car elle provient d’un élan vital qui trouve sa fin en soi. Des conséquences indésirables adviendraient plutôt lorsque son mode primaire de réalisation est perturbé, car la pulsion cherche alors des moyens détournés pour se donner libre cours. Le malaise causé par la répression des pulsions incite à former des désirs secondaires ; ainsi, pour le désir, l’action sert de moyen en vue d’une fin, mais pour la pulsion, c’est le désir qui sert de moyen en vue de l’action. Il se peut toutefois qu’une pulsion soit si bien contenue—par exemple, au moyen de normes sociales qui affectent toute une nation—que la vitalité même s’en trouve atrophiée.
Pour Bertrand Russell, la force vitale des hommes dépend de la santé de leur vie pulsionnelle et, sans elle, la vie perd sa valeur intrinsèque et sa force directrice. La sécurité matérielle ne suffit pas, car la jouissance passive qui en découle ne constitue pas une vie complète. Sans vitalité, même les buts conscients échappent à l’homme, car il ne pourra surmonter les obstacles qui l’en séparent : « Une vie gouvernée par des buts et des désirs, et dont la pulsion serait bannie deviendrait pénible ; elle épuiserait la vitalité et finirait par laisser l’homme indifférent aux buts mêmes qu’il se propose d’atteindre »[30]. Au sein de la civilisation européenne, et particulièrement en Angleterre, berceau de la révolution industrielle, l’industrialisme encourage le contrôle complet des pulsions à l’échelle de la nation, dont la vie est de plus en plus orientée vers des buts extérieurs. Puisqu’elle ne répond à aucune rationalité, la pulsion représente un facteur d’anarchie pour un système ordonné qui favorise les préoccupations économiques. La place qu’on lui accorde est constamment réduite par les stratégies mises en oeuvre pour optimiser la production ; l’industrie mobilise les hommes pour le travail rétribué, selon les heures fixes de la fabrique.
La Révolution industrielle fut source d’importantes transformations sociales qui caractérisent la Modernité, critiquée par Russell selon une logique libérale. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le travail rigoureusement surveillé et organisé de la grande industrie affecta profondément l’ensemble de la société et de ses institutions. D’après Paul Mantoux, les grandes entreprises fonctionnaient comme de petits États industriels, dont la population était soumise à une discipline quasi-militaire, sinon littéralement inhumaine. La production de marchandise n’était plus le seul but de la production, qui devint une façon d’accumuler du capital, source de pouvoir :
Les producteurs se divisent en deux classes : l’une qui donne son travail et ne possède rien d’autre, qui vend la force de ses bras et le temps de sa vie pour un salaire : l’autre qui détient le capital, à qui appartiennent les usines, les matières premières, les machines, et à qui reviennent les profits et bénéfices ; et à sa tête les grands chefs d’entreprise, les capitaines de l’industrie, comme les appelait Carlyle, organisateurs, dominateurs et conquérants[31].
Avant la Révolution industrielle, la production avait souvent lieu à domicile ou dans l’échoppe d’un artisan qui travaillait aux côtés de ses subordonnés. La division extrême du travail—à la fois cause et conséquence du machinisme qui pétrit la société moderne—et la concentration des moyens de production, de plus en plus sophistiqués, entre les mains de capitalistes ont cependant ravi au travailleur son autonomie. Il n’est plus maître de son rythme de travail, qui alliait traditionnellement l’industrie domestique du tissage et l’agriculture, au gré des saisons. L’ouvrier salarié de l’ère industrielle vit dans une telle précarité, menacé de chômage, qu’il en vint à se plier aux exigences croissantes de discipline imposées par la fabrique.
Dans ce cadre, chacun ne peut donner libre cours à sa vie pulsionnelle ; comme le souligne Russell (non sans ironie), on la tolère chez les enfants et chez les artistes, mais non chez l’homme sérieux. Celui-ci doit vivre pour des buts, qui ne sont pas toujours les siens : « Sauf chez quelques individus privilégiés, les activités sérieuses remplissant les heures de travail d’un homme sont principalement dirigées en vue de résultats, et non par des pulsions vers ces activités, parce que la pulsion n’a pas sa place assignée parmi les nécessités d’une existence complète »[32].
Outre une diminution de la force vitale par le contrôle excessif de la vie pulsionnelle, celle-ci peut également ressurgir de façon imprévisible et dangereuse, sous une forme nouvelle qui échappe au contrôle habituel de la volonté. Les pulsions ne sont donc pas immuables, car les circonstances influencent profondément leur manifestation concrète. En effet, une vie pulsionnelle saine a le potentiel de produire ce que l’humanité connaît de plus noble, mais les pulsions peuvent aussi bien tout détruire : « La pulsion aveugle est la source de la guerre : c’est aussi la source de l’art, de la science et de l’amour »[33].
Résurgence de la vie pulsionnelle sous une forme violente
Les pulsions détournées peuvent avoir des effets beaucoup plus dommageables que l’anarchie des pulsions primaires, car elles entraînent la destruction plutôt que la création[34]. On peut comprendre ainsi la violence qui se déchaîna en 1914, car si l’individu soumis à un cadre extrêmement rigide n’a pas l’occasion d’exprimer sa vitalité en créant, il le fera peut-être en détruisant dès que lui en sera donnée l’occasion. En rompant avec le cadre habituel de la vie sociale, la guerre ouvrit une brèche dans laquelle s’engouffrèrent les hommes en mal d’activité instinctive, pour le meilleur ou pour le pire. Puisqu’elle procède de la vie pulsionnelle, les désirs les plus forts ou les raisonnements les plus solides ne sauraient l’arrêter.
Pour enrayer la guerre, il faudrait changer les circonstances de la vie en société afin d’encourager la création au détriment de la possession. C’est pourquoi les PRS proposent une analyse des institutions sociales qui, lorsqu’elles sont basées sur l’autorité et l’injustice comme celles du monde moderne, ne permettent qu’à une minorité d’individus de vivre pleinement. Il serait vain de maîtriser la vie pulsionnelle pour diminuer les chances de la guerre, mais si l’on prend la peine de l’étudier et de reconnaître son importance, on pourrait la diriger vers le développement de la vie plutôt que l’inverse : « La pulsion est la manifestation de la vie, et, quand elle existe, on peut espérer la voir se tourner vers la vie plutôt que vers la mort ; mais l’absence totale de pulsions, c’est la mort, et de la mort, aucune vie nouvelle ne peut surgir »[35].
Transformer les institutions sociales pour mettre fin à la guerre
La paix ne sera donc jamais qu’un sursis entre deux guerres aussi longtemps que la vie pulsionnelle n’est pas transformée en profondeur, car c’est elle qui engendre principalement l’activité humaine. Les PRS suggèrent une voie à suivre pour renforcer les pulsions créatrices au sein de la société afin qu’elles dominent la pulsion guerrière, à l’exemple de certains artistes et intellectuels dont la vie pulsionnelle est la plus élevée selon Russell :
Bien des artistes n’ont pas été atteints par la passion de la guerre, non par atrophie du sentiment, mais parce que l’instinct créateur, la poursuite d’une chimère, les font juger les furieux assauts de la passion nationale, et ils ne subissent pas le mythe dont s’enveloppe la pulsions poussant au combat. Et les quelques hommes chez qui la pulsion scientifique domine ont remarqué que les mythes rivaux des groupes guerriers ont été neutralisés par la compréhension[36].
Ces pulsions raffinées sont trop peu répandues pour faire une différence profonde à grande échelle et Russell s’intéresse davantage aux pulsions communes, qui mobilisent la force populaire. Dans cette optique, des institutions sociales adéquates pourraient favoriser les trois forces vitales qui s’étiolent dans la société industrielle : l’amour, l’instinct de construction et la joie de vivre. Les institutions modernes sont bâties quant à elles sur l’injustice et l’autorité, car elles conservent l’héritage du système féodal. Selon une logique médiévale reprise à nouveau compte par le capitalisme, le succès des uns repose sur l’exploitation des autres, au détriment de la sympathie et des pulsions vitales de la société.
Individu et société : pour un principe d’unité conforme à la justice et à la liberté
L’héritage libéral de Russell transparaît lorsqu’il traite des institutions sociales, auxquelles il assigne un rôle essentiellement négatif. Elles doivent fournir un cadre où chacun pourra développer une vie pulsionnelle positive, sans contrarier celle des autres : « Le maximum que les institutions sociales puissent faire est de laisser à chaque être son épanouissement libre et vigoureux : elles ne peuvent le forcer à se modeler sur un autre individu »[37]. Si la nation a besoin d’unité pour que règne le bon accord, cela ne doit se faire au détriment de la vie instinctive des individus qui la composent ; une telle société serait artificielle et despotique, donc sujette aux explosions de violence. Russell rejoint ici le libéralisme à tendance socialiste de Mill, qui redoute une trop grande domination de l’autorité publique ou du poids de la majorité. Ce dernier fait de la liberté une condition indispensable au progrès humain : « que la nature humaine se trouve un espace de liberté où elle puisse s’épanouir à son gré et aller dans toutes les directions, dans ses pensées comme dans ses actions »[38]. Avec l’appui d’institutions fondées sur la liberté, l’accord devrait advenir volontairement, par la conjonction de sympathies instinctives et de buts communs. Ces facteurs règlent les conditions de manifestation de la vie instinctive dans la sphère sociale : la source en réside toutefois chez l’individu.
La vie pulsionnelle est affectée par les circonstances extérieures, mais son principe appartient au centre intime de chaque être humain. Ce point central de développement donne une cohérence à la vie individuelle car il oriente son mouvement. La nécessité instinctive d’un intellectuel ne sera donc pas la même que celle d’un artisan, mais chacun excellera dans son activité s’il lui est donné de se développer dans ce sens. Russell décrit ce processus grâce à la métaphore de l’arbre, qui grandit en cherchant la lumière selon un mouvement naturel intrinsèque. Pour qu’il prospère, sa direction instinctive doit être respectée : « Les hommes, comme les arbres, ont besoin pour leur croissance, d’un sol propice et d’une certaine liberté d’agir sans être opprimé »[39]. Mais il demeure légitime de discipliner certaines pulsions qui lui sont étrangères, comme pour la consommation de drogues, dira Russell. Le développement général de la société ne doit pas non plus être menacé par les pulsions d’un seul individu, qui peuvent être réprimées au nom de l’intérêt collectif. Toutefois, si le principe central de l’homme est sain—lorsqu’il n’a pas connu d’obstacles importants à son développement—il sera peu enclin à des pulsions nuisibles.
Pour éviter les pulsions destructrices, les institutions sociales doivent autoriser le subtil mouvement de croissance individuel. Partout, afin que la société prospère, le principe suprême doit être le pouvoir créateur, au détriment de la possession :
Pour que la vie individuelle soit intégrée et harmonieuse, il faut qu’elle incarne n’importe quelle pulsion créatrice dont un homme est capable, et que cette pulsion ait été, par l’éducation, fortifiée et encouragée de jaillir. Pour qu’une société soit intégrée et harmonieuse, il faut que les différentes pulsions créatrices des individus travaillent ensemble pour atteindre à une vie commune, un but commun, pas nécessairement conscient, mais où tous les membres de la société trouvent une aide à leur effort personnel[40].
La qualité de la vie sociale dépend des individus qui la composent, mais la vie privée est également modelée par le collectif. Le degré de civilisation et l’amélioration des conditions matérielles complexifient le développement de l’homme, qui interagit avec son entourage. L’état du monde physique aurait cependant moins d’impact à cet égard que l’environnement socio-culturel et psychologique : la vie de la communauté, ses croyances, ses affections, et les occasions d’activité qu’elle engendre.
Des institutions sociales pour un monde moderne
Face à la complexité de l’homme moderne dont les besoins se modifient au gré de la civilisation, des institutions comme l’État et la religion deviennent des obstacles si elles n’évoluent pas au même rythme que ces besoins. L’être humain franchit constamment de nouvelles limites de développement théorique et technique, mais les institutions sont lourdes de leur histoire et possèdent un mouvement propre. Si les perspectives de liberté s’élargissent grâce au progrès, mais que les institutions stagnent, les hommes se sentiront moins libres et se développeront plus difficilement. Il en est particulièrement ainsi lorsque la condition des uns s’améliore au détriment de celle des autres, comme en Angleterre au XVIIIe siècle. Lors de la Révolution industrielle, l’augmentation de la production vint avec la séparation du capital et du travail. Les richesses s’amassèrent du côté du capital, alors que les petits producteurs, réduits à travailler pour autrui, perdirent graduellement leur indépendance. Le bilan dressé par Mantoux laisse présager la violence des passions déclenchées par l’injustice qui traverse le monde moderne :
L’accroissement simultané du nombre et de la richesse, sans que cette richesse paraisse profiter au nombre à proportion de l’effort fourni pour la créer ; l’opposition de deux classes dont l’une augmente tandis que l’autre s’enrichit, dont la première n’est rémunérée d’un travail incessant que par une subsistance précaire, tandis que la seconde jouit de tous les bienfaits d’une civilisation raffinée, se manifestent partout à la fois et partout déterminent un même courant d’idées et de passions[41].
Les institutions critiquées par Russell, fondées sur l’autorité et l’injustice, entretiennent des inégalités sociales comme un système de classes qui favorise les riches. Ceux-ci défendent les traditions qui les avantagent, à l’encontre des revendications de justice et de liberté du reste de la société.
Les PRS penchent vers un certain socialisme, car ils soulignent la désuétude du système de classes et le danger qu’il représente pour la force vitale de la nation et pour la paix. Il génère en effet une lutte entre la tradition et le progrès, qui s’immisce dans les sphères importantes de la vie privée et publique. Dans chacune des institutions où elle s’installe, l’autorité des uns brime la liberté des autres et empêche la coopération entre les partis. Mais dès que l’autorité n’est plus reconnue par les opprimés, la société se désorganise et fomente le conflit. Fidèle à ses convictions libérales, Russell se méfie cependant du trop grand rôle accordé à l’État dans l’esprit du socialisme, car il menace l’initiative individuelle et réduit les hommes à la passivité. Pour le socialisme comme pour l’industrialisme, l’individu aliéné est impuissant face aux vastes organisations comme l’État ou l’entreprise capitaliste. Tous deux imposent des buts extérieurs au lieu de lui permettre d’exprimer son individualité par le travail : « Le travail, dans le monde moderne, est presque pour tous ceux qui en vivent un dur labeur et non la forme extérieure donnée au besoin d’activité »[42].
Les changements que propose Russell n’ont pourtant rien de l’utopie, qui est trop réductrice pour maîtriser la réalité. L’utopie fonde en effet le bonheur humain sur la jouissance passive, mais celle-ci contribue peu au véritable bien-être, car c’est dans les périodes d’activité créatrice que l’homme se développe. De plus, les conditions d’amélioration de la vie sociale varient beaucoup selon les époques, face à quoi l’utopie statique serait inutile dans la pratique. Russell le remarque déjà autour du socialisme allemand : « Les utopies changent d’année en année, selon la fantaisie du moment, et dans tous les cas la réalité ne risque pas de leur ressembler »[43]. Russell propose au contraire de penser le progrès social en fonction d’une direction du mouvement, au lieu de conditions idéales, mais illusoires : « La pensée utile est celle qui indique la direction convenant au temps présent »[44]. Ce principe s’applique aux individus comme aux sociétés, dans le respect et la liberté, pour progresser vers un monde dominé par la vie pulsionnelle créatrice. C’est dans ces conditions seulement que l’on peut envisager une paix réelle.
Le rôle du philosophe et le pouvoir de la pensée
L’exposé des PRS serait incomplet sans un retour sur le rapport du philosophe avec ses écrits. Pour une pensée politique viable en temps de crise, lorsque la réalité s’éloigne des idéaux de la philosophie, Russell dégage deux directives de son expérience. La première consiste à s’armer de courage et de patience, afin d’agir résolument malgré le sentiment d’impuissance qui menace le philosophe. Celui-ci doit renoncer à récolter le fruit de son travail, car c’est à long terme seulement que la pensée exerce son pouvoir sur le monde : « Nos attentes doivent être, non pour demain, mais pour le temps où ce qui est pensé maintenant par un petit nombre, le sera par la majorité »[45]. Dans cette optique, la publication des PRS visait les jeunes intellectuels mobilisés dont certains reviendraient des tranchées pour reconstruire l’Europe[46]. Suivant le psychologue et sociologue français Gustave Le Bon, c’est bien sur eux que le livre aurait la plus grande incidence : « Si les écrits influencent peu les générations vieilles ils peuvent au moins agir sur les générations nouvelles dont les idées ne sont pas cristallisées encore »[47]. La seconde recommandation concerne le philosophe en tant qu’homme, car c’est seulement à titre personnel qu’il aura un impact immédiat sur le monde ; il peut et doit imprégner sa propre vie de la pensée qui lui semble juste et bonne.
Grâce à ces lignes directrices, le philosophe peut agir efficacement, malgré son impuissance à confronter directement l’irrationalité de la politique. Certains progrès majeurs de la civilisation sont apparus dans le monde comme des idées marginales, portées à bout de bras par quelques penseurs. La tolérance religieuse et la démocratie ont fait leur chemin à travers les époques jusqu’à s’imposer dans la plupart des sociétés occidentales : « le pouvoir de la pensée est, à la longue, plus grand qu’aucun autre pouvoir humain. Ceux qui sont capables de penser et qui ont conscience des besoins de l’humanité arriveront probablement tôt ou tard au résultat auquel ils visent, mais ce ne sera pas de leur vivant »[48].
Suite à la Première Guerre mondiale, Bertrand Russell resta fidèle à son devoir de philosophe. Sa vie fut parsemée d’épreuves avec l’arrivée de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide, qui posèrent le problème de l’armement nucléaire. Lors d’une entrevue télévisée avec le journaliste et communicateur Woodrow Wyatt, en 1959[49], Russell montre qu’il est conscient des limites du penseur. La philosophie doit néanmoins s’en accommoder, car les idées demeurent vaines sans un rapport vital avec l’action : « Je pense que le type de philosophie auquel je crois est utile en ce sens : il permet aux gens d’agir avec vigueur lorsqu’ils ne sont pas absolument certains qu’il s’agit de la bonne action »[50]. Si la certitude est impossible pour quiconque projette l’avenir de la société, il faut néanmoins croire en ses idéaux. Cette force de conviction serait même absolument nécessaire pour nourrir le courage du penseur, qui doit sacrifier le présent au nom d’un avenir où le monde connaîtrait la paix et la liberté.
Appendices
Notes
-
[1]
Marc Crépon et Frédéric Worms, La philosophie face à la violence, Paris, Éditions des Équateurs, 2015, p. 20.
-
[2]
Bertrand Russell naquit le 18 mai 1872 à Trelleck dans le pays de Galles en Angleterre, où il décéda également le 2 février 1970, à Penrhyndeudraeth.
-
[3]
Malgré les apparences, l’existence du penseur ne fut pas toujours prise en compte par les philosophes, comme le montra Søren Kierkegaard dans sa critique de la pensée systématique d’inspiration hégélienne. Absorbé par sa quête de vérité objective, l’homme risque d’oublier sa condition d’existant, qui est essentiellement subjective. Par ailleurs, le penseur est confronté au problème de l’action, puisqu’il ne vit pas dans la sphère immuable de l’éternel, mais dans la temporalité où règne le devenir.
-
[4]
John Lewis, Bertrand Russell: Philosopher and Humanist, New York, International Publishers, 1968, p. 10 : « At a time when academic philosophy was becoming increasingly abstruse and remote, he deliberately left the study in order to criticize, excite and interest ordinary men about the great questions facing humanity ».
-
[5]
Francis Jacques, « Bertrand Russell : une vie », Hermès, 7 (1990), p. 247-248.
-
[6]
Maître puis collègue de Russell au Trinity College, Alfred North Whitehead est né le 15 février 1861, à Ramsgate en Angleterre, et mort le 30 décembre 1947 à Cambridge (Massachusetts).
-
[7]
Bertrand Russell, German Social Democracy : Six Lectures, London, Longmans, 1896, 204 p.
-
[8]
Dans la foulée de son pacifisme, Russell subira quelques procès ; en 1916, l’un des ses tracts lui coûta une amende en vertu de la « loi sur la défense du Royaume », ainsi que sa maîtrise de conférences au Trinity College de Cambridge. Il sera même interdit de séjour dans certaines zones stratégiques du pays. De plus, un article intitulé « Les Allemands nous offrent la paix »—publié le 3 janvier 1918 dans Le Tribunal—lui valut quelques mois de prison.
-
[9]
Roger Bruyeron et al. 1914 : L’entrée en guerre de quelques philosophes, Paris, Hermann, 2014, p. 19.
-
[10]
Jean-Jacques Becker, « Les intellectuels et la justification de la guerre en France et en Allemagne au début de la Grande Guerre », Droit et Cultures, vol. 45, no 1 (2003), p. 203.
-
[11]
Louis Dimier, L’Appel…, p. 6.
-
[12]
Bertrand Russell, The collected papers of Bertrand Russell, vol. 13, Londres, Routledge, 2000, p. 170 : « In modern times, philosophers, professors, and intellectuals generally undertake willingly to provide their respective governments with those ingenious distortions and those subtle untruths by which it is made to appear that all good is on one side and all wickedness on the other ».
-
[13]
Romain Rolland se retira également de la prise de parole publique pour quelques temps face à l’hostilité grandissante pour ses position anti-bellicistes.
-
[14]
Bertrand Russell, The collected papers…, p. 171 : « Allegiance to country has sept away allegiance to truth ».
-
[15]
Bertrand Russell, The collected papers…, p. 180 : « It is time to forget our supposed separate duty towards Germany, Austria, Russia, France, or England, and remember that higher duty to mankind is which we can still be one ».
-
[16]
C’est la Ligue contre la conscription qui éditait Le Tribunal, un hebdomadaire auquel Russell contribuait fréquemment et dans lequel il publia notamment l’article pour lequel il fut condamné à la prison.
-
[17]
Bertrand Russell, Principes de reconstruction sociale, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p. 53.
-
[18]
En 1911, Russell fit la rencontre de Lady Ottoline Morrell (1873-1938), qui était une figure importante du monde artistique de Londres. On l’associe au Bloomsbury Group, dont faisait partie Virginia Woolf. Ottoline et son mari, Philip Morrell (avocat et député libéral au Parlement britannique), étaient comme Russell des pacifistes très actifs pendant la Première Guerre mondiale. Le philosophe entretint avec elle une histoire d’amour traversée de réflexions mystiques, comme en témoigne une importante correspondance.
-
[19]
Bertrand Russell, Autobiographie, Paris, Éditions Stock, v. 2, 1968, p. 71.
-
[20]
Lucy Martin Donnelly (1870-1948) était professeur d’Anglais en Pennsylvanie au collège Byrn Mawr, une université d’arts libéraux destinée aux femmes.
-
[21]
Bertrand Russell, Autobiographie…, p. 61.
-
[22]
Ibid., p. 74.
-
[23]
Ibid., p. 38.
-
[24]
Ibid., p. 11.
-
[25]
Bertrand Russell, Principes de reconstruction sociale, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p. 28.
-
[26]
L’état de nature est une fiction méthodologique imaginée par Thomas Hobbes dans le Léviathan (1651), pour décrire les rapports entre les hommes avant la vie en société. Il constitue un règne de la violence au nom de l’appropriation égoïste des ressources.
-
[27]
Voir Bertrand Russell, Autobiographie…, p. 51.
-
[28]
Bertrand Russell, Principes…, p. 28.
-
[29]
Ibid., p. 29.
-
[30]
Ibid., p. 32.
-
[31]
Paul Mantoux, La Révolution industrielle au XVIIe siècle, Paris, Génin, 1959, p. 3.
-
[32]
Bertrand Russell, Principes…, p. 32.
-
[33]
Ibid.
-
[34]
Il y a deux types de pulsions d’après Russell : les pulsions de possession et les pulsions créatrices. Les unes visent à s’approprier quelque chose aux dépens d’autrui et les autres à mettre au monde quelque chose de profitable pour chacun, comme la connaissance et l’art. Russell considère que la vie meilleure est tournée vers la création.
-
[35]
Ibid., p. 35.
-
[36]
Ibid.
-
[37]
Ibid., p. 37.
-
[38]
John Stuart Mill, Sur le socialisme, Paris, Les Belles Lettres, 2016, p. 127.
-
[39]
Bertrand Russell, Principes…, p. 37.
-
[40]
Ibid., p. 181.
-
[41]
Paul Mantoux, La Révolution…, p. 4.
-
[42]
Bertrand Russell, Principes…, p. 84.
-
[43]
Bertrand Russell, German…, p. 164 : « Utopias change from year to year, with the passing fancy of the moment, and in any case the reality is not likely to ever resemble them ».
-
[44]
Bertrand Russell, Principes…, p. 177.
-
[45]
Ibid., p. 176.
-
[46]
Les Principes de reconstruction sociale firent leur chemin jusqu’à la Somme, où le lieutenant Arthur Graeme West écrivit à Russell le 27 décembre 1916 : « Ce que nous redoutions plutôt avant la publication de votre livre, c’était de ne plus trouver en Angleterre personne qui voulût construire avec nous. Sachez donc que l’on peut compter sur nous pour faire deux fois plus après la guerre que pendant la guerre, et que la lecture de votre livre a rendu cette résolution plus déterminée que jamais ». (Bertrand Russell, Autobiographie…, p. 83-84). West est tombé le 3 avril 1917 à l’âge de 25 ans, mais le livre de Russell poursuivit sa route ; la fiancée du malheureux, Dorothy Mackenzie, s’en inspira pour son travail d’institutrice.
-
[47]
Dr. Gustave Le Bon, Psychologie des temps nouveaux, Paris, Flammarion, 1925, p. 16.
-
[48]
Bertrand Russell, Principes…, p. 176-177.
-
[49]
https://www.youtube.com/watch?v=gvOcjzQ32Fw (page consultée le 6 novembre 2016).
-
[50]
Bertrand Russell et Woodrow Wyatt, Bertrand Russell Speaks his Mind, Cleveland, The World Publishing Company, 1960, p. 17 : « I think that the sort of philosophy I believe in is useful in this way: that it enables people to act with vigour when they are not absolutely certain that that is the right action ».