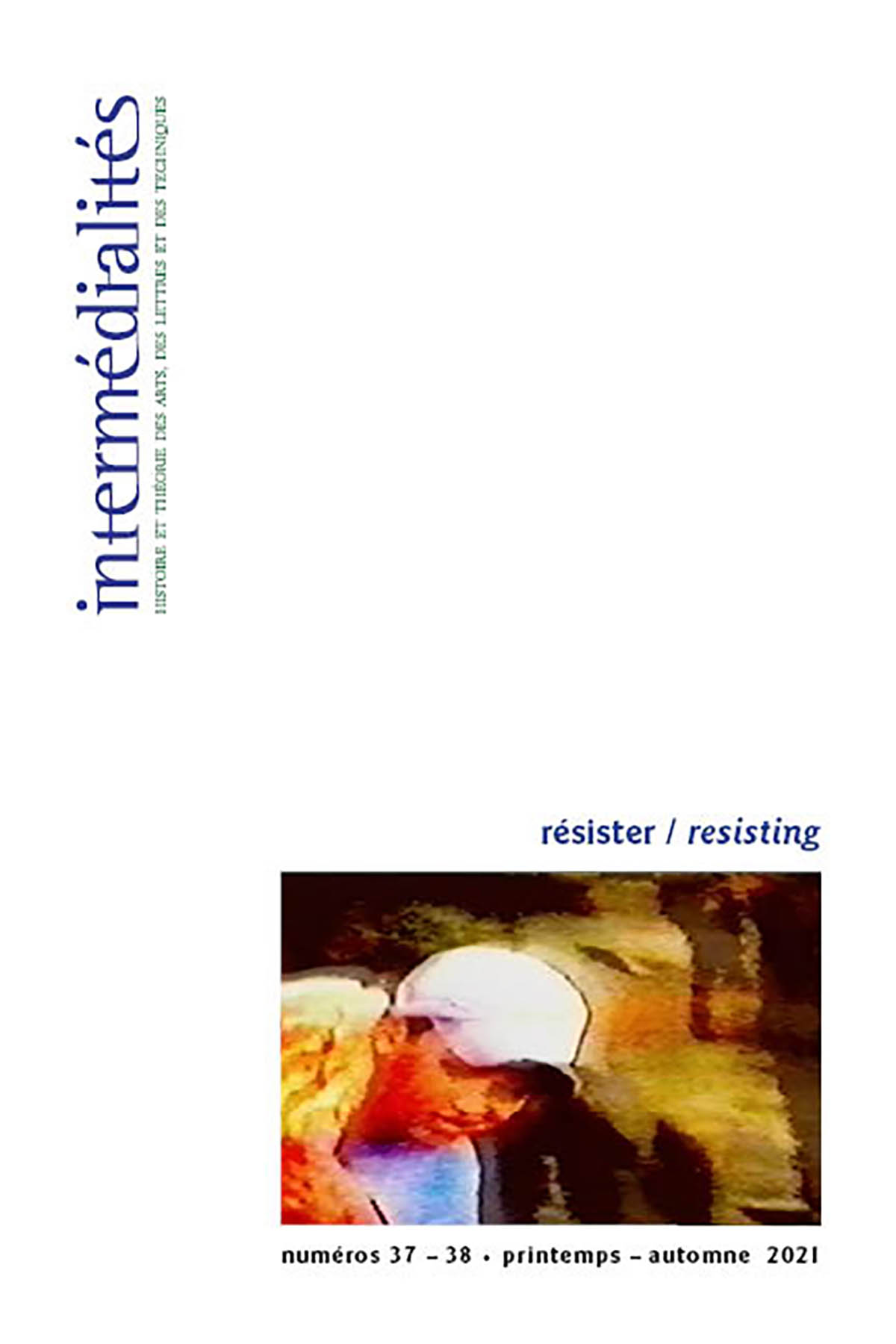Article body
Lo que está en juego en las nuevas sociedades del capitalismo avanzado es el proceso mediante el cual se va a decidir cuáles son y cuáles van a ser los mecanismos y aparatos de subjetivación y socialización que se van a constituir en hegemónicos, cuáles los dispositivos y maquinarias abstractas y molares mediante las que se va a articular la inscripción social de los sujetos, los agenciamientos efectivos mediante los que nos aventuraremos de ahora en adelante al proceso de devenir ciudadanos, miembros de un cuerpo social.
Ce qui est en jeu dans les nouvelles sociétés du capitalisme avancé, c’est le processus par lequel sera décidé quels sont et quels seront les mécanismes et appareils de subjectivation et de socialisation qui vont devenir hégémoniques, quels sont les machines et les appareils abstraits et molaires à travers lesquels s’articulera l’inscription sociale des sujets, les agencements effectifs nous permettant de désormais nous aventurer dans le processus de devenir citoyens, membres d’un corps social.
José Luis Brea, El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural, Murcia, Cendeac, 2008, p. 129
Le devenir hégémonique de la mondialisation peut être compris, à partir de la production automatisée d’images, comme un modèle technique de programmation du sensible (à d’autres occasions, nous avons soutenu que le néolibéralisme est, avant tout, un programme affectif, autrement dit un programme qui prescrit les conditions de la perception)[1]. Comme nous l’avons fait remarquer dans la présentation de ce numéro d’Intermédialités, nous sommes assiégés par des images (textuelles, visuelles, sonores) qui, à la fois, sont produites médialement et édictent les modèles de notre subjectivité. Pour cette raison, nous avons souligné que résister signifie interrompre les flux d’images, au sein même des mécanismes et des dispositifs qui les produisent, permettant ainsi l’émergence d’autres images qui provoqueront des modes de subjectivation collective non prescrits par ces dispositifs. Nous pourrions dire qu’il faut questionner la légitimité des images des médias et insérer une autre image au milieu de ces dernières. Ainsi, l’art pourra s’exprimer en prenant position parmi ces images. C’est-à-dire qu’il sera un art situé : situé en opposition et primant les modèles hégémoniques d’une culture qui globalise notre sensibilité. Face à une culture qui annule les façons de penser les singularités que la mondialisation nous empêche d’exprimer. Donc, l’art devient le lieu où se formule une politique du sensible, au-delà de ce qui est établi comme normal par la machinerie et l’appareil moral.
Les oeuvres de Gabriela Golder (Buenos Aires, 1971) dévoilent le caractère intermédial des appropriations artistiques en tant que résistance politique à la pensée contemporaine. Golder est issue du domaine audiovisuel, et ses travaux s’éloignent rapidement des productions industrielles et trouvent dans la vidéo une manière de remettre en question les conditions techniques de production de sens dans les sociétés contemporaines. Proclamer son appartenance au monde de la vidéo suppose, dans la trajectoire de Gabriela Golder, une première affirmation politique. La vidéo est un média qui, dans le champ audiovisuel, était le lieu d’expérimentations artistiques qui contestait les formes globales de communication de masse et qui permettait, dans les années 1980 et 1990 en Amérique latine, de prendre place à l’intérieur des images pour exécuter un geste de distanciation des lieux communs de la pratique intermédiale. Il y a, dans la vidéo comme média, comme appareil, comme dispositif technique, une puissance d’interruption qui la place entre le cinéma et la télévision, c’est-à-dire dans un entre-deux médiatique eu égard aux grands systèmes de production de la subjectivité. Peut-être qu’en vertu de l’inexistence d’une différence entre ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons (comme le disaient Gilles Deleuze et Félix Guattari), la vidéo se présente pour Golder comme un espace de questionnement politique lui permettant de transgresser les formes prescrites par les médias mondiaux. Ainsi, ses oeuvres s’avèrent des expérimentations qui interrogent la condition médiale dans laquelle ce qui est vu, ce qui est écouté et ce qui est lu est confronté à des modes d’existence que la mondialisation semble vouloir ignorer. Nous ne pensons pas trop nous avancer en affirmant que la pratique de la vidéo, chez Gabriela Golder, présente un « devenir mineur[2] » du monde audiovisuel... et cette recherche, cette expérimentation, se fait dans différentes directions.
Parfois, il s’agit simplement de trouver juste une image[3] parmi toutes celles dont nous sommes saturés par les médias. Dans cette perspective, il suffit de parcourir patiemment les nouvelles pour en extraire une image qui rattrape ce qui échappe au regard. Comme c’est le cas de Vacas (Vaches) ou de La lógica de la supervivencia (La logique de la survie), où l’interruption du flux d’images quotidiennes démontre le pouvoir de quelques secondes arrachées à la frénésie des médias pour exposer, dans la crudité de ce qui se donne à voir, ce qui ne pouvait être regardé. Une manière de prendre position relativement à une réalité qui se perd dans le bombardement anesthésiant d’images du quotidien.
Il importe parfois de retrouver les gestes que la folie du présent a effacés d’une image qui se manifeste comme mémoire inscrite dans les corps. Comme la présence d’un passé qui configure ce que nous sommes par le choc de son absence parmi nous. C’est le cas des gestes des ouvriers qui ont tout perdu à cause de l’impact de la « modernisation » et dont les mouvements s’apparentent à un geste de résistance vis-à-vis de ce qui ne peut plus revenir (tel est le cas de Las partículas elementales [Les particules élémentaires], réalisé à partir de fragments de nouvelles cinématographiques, c’est-à-dire récupérés dans le flux d’images de la mémoire audiovisuelle).
Le même geste peut aussi être répété, distancié, suspendu, ralenti par la caméra, amplifié par le son, permettant de laisser place à cette mémoire collective qui survit dans les corps (comme dans le cas de Doméstico [Domestique]) ou au souvenir d’une présence usurpée par le temps (comme dans Escenas de trabajo[4] [Scènes de travail]).
Disons que le geste assure la survivance de la mémoire collective inscrite dans les corps. Dans ce sens, les oeuvres de Golder mettent puissamment en lumière ces gestes condamnés au néant, à la disparition et à l’oubli, destin auquel ils sont réduits par les attaques destructrices du néolibéralisme. La disparition d’un geste suppose aussi celle d’un monde, d’un lien, d’une relation. Ainsi, accueillir un geste (le recevoir comme image) est une ouverture politique de restitution dans le présent de ce qu’on ne peut se permettre d’oublier (le questionnement de Golder s’approche, en ce sens, de celui d’Aby Warburg[5], Georges Didi Huberman[6] ou Giorgio Agamben[7], qui voient dans le geste la présence survivante d’un passé qui n’est jamais le même).
Il est question, par exemple, de l’interruption de voix enfantines lors de la lecture de textes classiques (Le Manifeste du parti communiste[8], Fragments d’un discours amoureux[9], entre autres). Par cette interruption, l’écriture ouvre à de nouvelles possibilités par la voix d’une enfance qui chasse le caractère canonique des discours et présente une qualité sensible à travers ceux qui se taisent habituellement (l’enfance comme silence, comme expérience de l’inaudible dans le langage). Une voix réduite au silence atteste ce que la voix adulte et programmée ne peut plus dire (mais doit s’efforcer d’expliquer, comme dans Conversation, pièce où une grand-mère essaie de répondre aux questions de ses petites-filles sur la lecture du texte de Marx). Les discussions, conversations, interprétations de ces voix font entendre des densités sonores que l’écriture ne permet plus de percevoir (dans sa codification graphique du langage). Mais ce sont aussi des voix qui énoncent la douleur d’un passé récent par la lecture de lettres de « détenu.e.s disparu.e.s »[10] dans la dernière dictature civico-militaire en Argentine qui nous obligent à penser (re-penser) les formes définitives de résistance à la mort (ce à quoi l’art peut résister, comme disait Deleuze selon la voie ouverte par Malraux[11]).
En terminant (pour ce qui est de cette présentation : il appartient aux lecteurs de ce numéro de se pénétrer des multiples aspects du travail de Gabriela), l’interruption est l’occupation (ou la ré-occupation) de lieux vidés par la poussée dévastatrice du néolibéralisme, cherchant de nouvelles manières de créer une association coopérative et d’amener la vidéo dans les usines où elle sera installée, présentée, rendue présente, récupérant ainsi son propre espace (appartenant à ceux qui jouent dans la vidéo).
Ainsi, l’oeuvre qui est présentée par la vidéo est celle de la vidéo comme expérience dans laquelle le lien est pensé. La vidéo comme pratique collaborative de l’image qui oblige Gabriela à repenser le travail de la vidéo : son travail.
La prise de position se situe dans l’interruption des images qui composent notre présent. L’image qui recouvre les voix entendues pour la première fois au milieu d’un discours. L’image de la colère des servantes. L’image captée à la télévision. L’image du travail collaboratif dans les usines. Si, comme nous l’avons avancé plus haut, la vidéo a un devenir mineur, c’est peut-être parce qu’elle permet, dans les interstices de la pratique audiovisuelle, que s’accomplisse l’expérience par laquelle seule l’image crée un nouveau lien. Un lien par lequel Gabriela s’inscrit dans un exercice plus large, collectif et donc plus concret. Un lien qui donne à l’image vidéo une fonction politique singulière : être le lieu de rencontre de ce qui dans les images n’aurait pas sa place autrement.
Appendices
Notes
-
[1]
Voir, par exemple : Hernán Ulm, Rituales de la percepción. Artes, técnicas, políticas, Buenos Aires, Universidad Nacional de las Artes, 2021.
-
[2]
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Éditions de Minuit, 1975; Giles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Éditions de Minuit, 1980.
-
[3]
Gilles Deleuze, « Trois questions sur Six fois deux (Godard) », Pourparlers (1972-1990), Paris, Éditions de Minuit, 1990, p. 57.
-
[4]
Au moment où nous écrivions ce texte, Gabriela Golder vient de gagner le prix du Salón Nacional de Arte pour son oeuvre Trabajadoras (Travailleuses, 2021).
-
[5]
Aby Warburg, El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo, Madrid, Alianza Editorial, 2005.
-
[6]
Georges Didi-Huberman. Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images, Paris, Éditions de Minuit, 2000.
-
[7]
Giorgio Agamben, « Notes sur le geste », Moyens sans fin. Notes sur la politique, Paris, Payot & Rivages, 2002.
-
[8]
Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, Paris, Flammarion, 1998.
-
[9]
Roland Barthes. Fragments d’un discours amoureux, Paris, Éditions du Seuil, 1977.
-
[10]
C’est le nom donné aux victimes du terrorisme d’État en Amérique latine dans le cadre de la persécution politique des dictatures civico-militaires au cours des années 1970 et 1980. Ces dictatures ont exercé des modes de répression illégale (enlèvements, détentions clandestines, assassinats, appropriation d’enfants nés en captivité) contre des militants opposés à la mise en oeuvre des politiques économiques néolibérales dans la région. La disparition suppose l’absence forcée et permanente d’une personne sans qu’on sache où elle se trouve ou l’endroit où son corps peut être récupéré.
-
[11]
Gilles Deleuze, « Qu’est-ce que l’acte de création? », Deux régimes de fous. Textes et entretiens. 1975-1995, Paris, Éditions de Minuit, 2003.