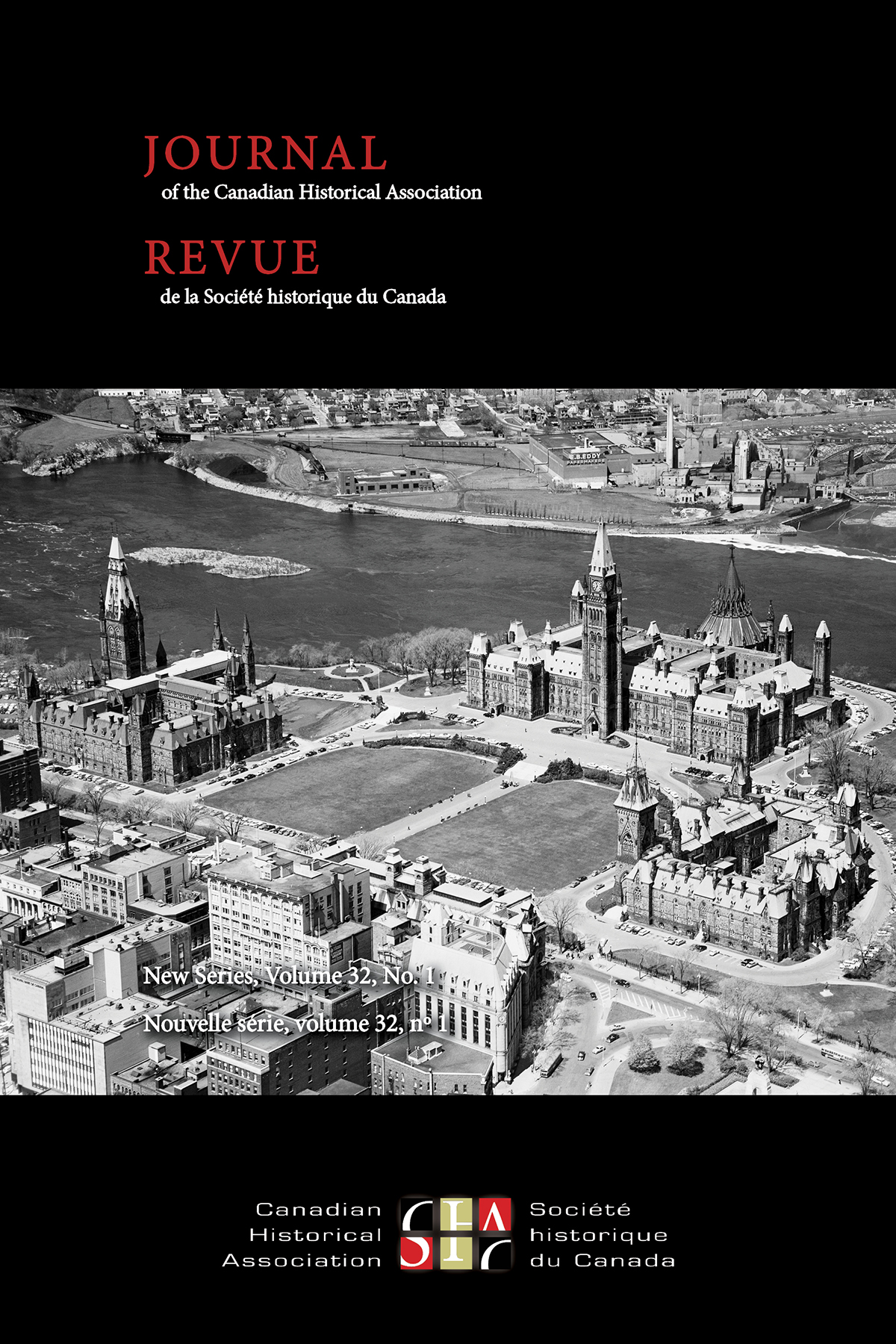Abstracts
Résumé
Dans ce discours présidentiel à la SHC, Penny Bryden examine les façons dont les historiennes et historiens recherchent, écrivent et utilisent l’histoire. Elle affirme que lorsque la structure de notre production change, la façon dont les publics la comprennent change également.
Article body
L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement longue[2]. Si ma présence corporelle est restée, en tant qu’intrus non-invité, sur les territoires traditionnels des peuples WSÁNEĆ, Esquimalt et Lkwungen, mes errances intellectuelles semblent nettement moins ancrées, quoique tout aussi intrusives. Nous avons passé trop de temps dans les mêmes endroits. Nous avons passé trop de temps à vivre dans le chagrin, l’anxiété et l’incertitude. Nous avons passé trop de temps privés des lieux que nous aimons (avec un « a » minuscule) — nos cours, nos bibliothèques et nos archives — et trop longtemps avec les gens que nous aimons (avec un « A » majuscule) — nos partenaires excentriques, nos parents inquiets et préoccupés, nos adolescents railleurs et renfrognés, et nos bébés irritables. Nous avons passé l’année sur des montagnes russes d’émotions, en espérant que le manège prenne bientôt fin. Et si le monde a souffert, et souffre encore, et ce de manière asymétrique, les historiennes et historiens ont porté un fardeau particulier. En effet, nos souffrances savantes ont peut-être été plus grandes que celles de la majorité pendant cette longue année de pandémie, car nous avons été obligés de vivre si résolument dans le présent, alors que nous sommes habitués de vivre, du moins occasionnellement, dans le passé.
Ainsi, je commencerai par m’évader quelques instants dans mon propre passé, et je me rappellerai les ruminations de l’un de mes professeurs qui avait fait valoir l’idée que l’historienne ou l’historien était comparable à quelqu’un muni d’un filet qui attrape les papillons. Mes collègues et moi-même plaisantions sur cette image particulière, et peut-être d’autant plus avec ce professeur particulier, mais il n’empêche qu’elle a trouvé une résonnance. Certes, ce que nous recherchons en tant qu’historiennes et historiens est, comme le papillon, insaisissable, beau, enclin à voltiger dans des trajectoires en apparence chaotiques. Pendant de nombreuses années, j’ai songé à ces papillons. Je les ai traqués, recherchés dans les bibliothèques, les archives et dans les souvenirs des gens, et j’ai constaté que souvent, celui que je pensais vouloir au départ était loin d’être le bon, et je suis restée ébahie devant la splendeur de ceux sur lesquels je suis tombée. Ces papillons nous animent tous. Mais aujourd’hui, je veux parler du filet[3].
Je prétendrai que l’une des plus importantes tâches de l’historienne et l’historien — voire la plus importante — est de tisser ces filets. Nous les emportons avec nous sur le terrain et nous les ressortons. Peu importe que ce soient des filets, des seaux, des boîtes, ou d’autres choses encore, ils sont ce que nous utilisons pour creuser le passé, puis pour exposer les papillons que nos recherches nous ont permis d’identifier. Sans ces récipients, nous nous retrouvons le regard fixé sur un abîme infini, impuissants, incapables de saisir quoi que ce soit, et incapables de le montrer à quelqu’un d’autre.
C’est l’immensité du passé qui confère à ces filets toute leur importance, même si nous ignorons souvent le rôle que nous jouons en les choisissant, en les façonnant et en les réparant. Plutôt que d’imaginer que ce sont le caractère et les circonstances qui constituent les points de départ de l’histoire, ce que je propose aujourd’hui, c’est de commencer par la forme. C’est le filet — quelle que soit la nature des papillons qu’il contient — qui donne une certaine forme au passé ainsi qu’au processus visant à lui donner un sens. La dimension, les contours et les faiblesses de nos filets, qu’il s’agisse des filets que nous utilisons pour recueillir des informations, de ceux que nous utilisons pour présenter le passé ou encore de ceux que nous enroulons autour de nous-mêmes, tous exercent un effet extraordinaire sur le travail que nous produisons. Ces filets déterminent non seulement la manière dont nous comprenons le passé, mais également la manière dont nous nous entretenons avec l’avenir. Ils façonnent la forme que prend notre recherche, notre production et notre savoir. En négligeant ces structures, nous courons des risques.
À bien des égards, il est étonnant que nous accordions si peu d’attention à nos diverses structures disciplinaires, compte tenu de l’attention que nous portons aux structures que nous étudions dans le passé. Nos prétentions à la pertinence, dans un environnement contemporain qui exige la pertinence, sont généralement ancrées dans l’idée selon laquelle le présent doit connaître le passé, et s’y confronter. Les leçons à tirer sont souvent négatives, à savoir ce qu’il ne faut pas répéter, mais le passé recèle aussi de moments d’aspiration. Bien que nous sachions comment le passé peut être utile dans le contexte actuel — le présent des pandémies, des fermetures d’universités, des incertitudes du marché du travail et des politiques gouvernementales — nous avons en quelque sorte oublié de mettre en pratique dans notre propre travail quotidien les leçons du passé concernant l’importance de la forme, de la structure et des filets. Dans notre vaste éventail de travaux — au Canada et ailleurs, dans le passé récent et dans un passé plus lointain, en prêtant une oreille attentive aux silences et aux cris, aux oubliés, aux oubliables et aux oublieux — nous prouvons régulièrement que ce sont les structures en place dans le passé qui façonnent l’expérience du passé. Nous démontrons tout aussi régulièrement que certaines de ces structures ont été construites par accident, que ce soient des murs réels ou des frontières imaginaires.
Les filets utilisés pour circonscrire un espace ou une idée ont toujours été omniprésents. Nos histoires ont notamment révélé le tracé de frontières, la clôture de champs, la construction de prisons, l’aménagement de parcs, le déplacement de villes — la liste est interminable lorsque nous nous penchons sur les filets que les gens du passé ont utilisés pour délimiter, inclure, exclure et définir leurs mondes[4]. Les filets intellectuels étaient tout aussi abondants. Les constitutions ont tracé des frontières entre les juridictions fédérales et provinciales, et les lois entre les entreprises et les syndicats, entre les hommes et les femmes, entre les Autochtones et les colons, entre les personnes nées à l’étranger et celles nées au pays[5]. Dans les religions, des filets ont été tendus autour des adeptes, pour exclure les non-croyants. Le concept de la famille, quant à lui, a dessiné un filet autour d’un groupe de personnes, faisant varier au fil du temps qui serait inclus à l’intérieur, qui serait maintenu à l’extérieur[6]. Le fait de considérer les histoires que nous rédigeons comme une contemplation continue des filets qui ont été déployés revient à reconnaître l’omniprésence de frontières.
Cependant, ces filets revêtent diverses formes et exercent des pressions multiples et contradictoires. Permettez-moi de vous en présenter un seul, avec lequel je suis assez familière, mais vous pourrez sans doute trouver des exemples comparables dans vos propres travaux. Mon filet est le maillage invisible d’un cabinet qui renferme, protège et qui finit éventuellement par faire basculer l’équilibre du pouvoir de manière bien réelle et imprévue. Il constitue à la fois une structure concrète et une idée ; comme les « communautés imaginées » de Benedict Anderson, il est, à bien des égards, un cabinet imaginé.
Le Cabinet du Premier ministre (CPM), que nous reconnaissons aujourd’hui par ses lettres majuscules qui lui confèrent une valeur supérieure à celle de la simple somme de ses mots, était au départ, au XIXe siècle, rien de plus qu’un cabinet — avec un « c » minuscule. Certes, il y avait naturellement des étagères et des chaises, mais l’enceinte créée par les quatre murs était perçue comme étant un cabinet tout simplement. Lorsque le premier ministre s’y trouvait, ce qui était souvent le cas, cette pièce devenait le Cabinet du Premier ministre. Ce ne fut toutefois que lorsque Mackenzie King en fut l’occupant qu’il commença à se transformer en quelque chose de complètement différent.
À compter des années 1920, le cabinet qu’occupait le premier ministre avait plus d’une pièce — le filet s’était donc élargi. Il disposait de gardiens qui surveillaient l’entrée. Ils le faisaient à la fois physiquement, en veillant à la protection de l’entrée, mais aussi sur le plan intellectuel. En tapant les réponses que le premier ministre leur dictait, ils géraient la correspondance ; en gérant son calendrier, ils protégeaient son temps. Là où des changements avaient été apportés au cours des années qui ont suivi la venue du premier occupant de ce cabinet, ils étaient superficiels et définitivement extérieurs. À l’intérieur du filet, la vie continuait sensiblement au même rythme pour son unique occupant. Le récipient était perméable, certes — les ministres du Cabinet et les visiteurs, voire un membre de la famille à l’occasion, rejoignaient le premier ministre pour de brèves périodes, mais le cabinet lui-même continuait d’être le foyer d’une seule personne.
Du moins, jusqu’à ce que Mackenzie King s’y installe. Se considérant non seulement premier ministre, mais également homme de lettre, King consacrait énormément de temps et d’énergie à sa correspondance. À tel point qu’au milieu des années 1920, il éprouvait de la difficulté à se livrer à autre chose que répondre à des lettres. Il avait besoin d’aide. Sans doute avait-il aussi un grand besoin de compagnie. Les hommes qui lui faisaient office de secrétaires étaient systématiquement choisis en raison d’une combinaison quelconque d’intelligence et d’amabilité, les plus fiables d’entre eux l’aidant à tenir son journal intime. Or, ces hommes étaient rarement en poste pour une longue période, King étant un maître d’oeuvre exigeant, enclin à travailler tard le soir et peu attentif aux obligations familiales ou personnelles des autres, étant lui-même dépourvu de telles obligations[7].
En 1927, King était convaincu que la solution à tous ses problèmes reposait sur l’obtention des services de ce qu’il appelait un « sous-ministre ». La signification de ce terme restait toutefois à préciser. King enviait probablement les sous-ministres sur qui les ministres du Cabinet pouvaient s’appuyer pour obtenir de l’aide, mais il calquait définitivement sa vision sur le secrétaire du Cabinet en Grande-Bretagne, Maurice Hankey, qui avait « énormément impressionné » King lors de sa dernière visite à Londres. Hankey n’était toutefois pas un sous-ministre, et son poste ne se limitait pas à répondre aux besoins du premier ministre, contrairement à ce que King désirait manifestement. Hankey avait plutôt établi le secrétariat du Cabinet, et érigé une structure administrative qui desservait non seulement le premier ministre, mais tout l’exécutif du gouvernement. Ce secrétariat veillait à ce que les ordres du jour soient diffusés, que la documentation à l’appui soit disponible, que les procès-verbaux soient rédigés et que les activités du Cabinet soient à la fois coordonnées et enregistrées. Ce n’était pas ce que King avait en tête, mais il persistait à décrire le poste comme étant analogue au rôle que jouait Hankey en Grande-Bretagne[8].
La personne que King avait choisie pour le poste était le directeur de la Hart House de l’Université de Toronto, le fils du chanoine de Canterbury, un Britannique aux relations bien établies, apportant un vernis de gentillesse aux fils des classes montantes du centre du Canada. Burgon Bickersteth disposait, selon King, de « la capacité de connaître les gens et de s’entendre avec eux ». Le premier ministre lui-même ne possédait pas cette faculté. Ainsi, l’intégration d’une telle personne dans le filet du Cabinet du Premier ministre garantirait à King de rester en poste pour les 15 prochaines années. Du moins, c’est ce qu’il prétendait[9].
Or, Bickersteth ne voulait pas du poste. Il ne parvenait pas à en comprendre les paramètres, King étant lui-même peu clair sur les limites de cette fonction. S’il s’agissait d’un filet, il était très vaste. Après mûre réflexion, quelques recherches sur l’organisation des choses en Grande-Bretagne et un examen de conscience, Bickersteth déclina l’offre et King abandonna complètement le sujet[10]. Son cabinet gardait ainsi la forme qu’il arborait depuis un demi-siècle — un cabinet d’affaires bondé de commis et de secrétaires, le sanctuaire d’un seul occupant.
King avait peut-être abandonné l’idée en 1927, mais à son retour au pouvoir dans les années 1930, il continuait de se soucier de la quantité de travail qui lui incombait. En 1935, il prit donc le soin de rédiger un compte rendu détaillé de ses tâches. Rien que pour le bureau, il fallait s’occuper des engagements, des entrevues et de la correspondance ; il fallait également entretenir les relations avec la presse et le public ; il y avait la « préparation de messages spéciaux, d’hommages et d’allocutions », les apparitions publiques, les conférences et les délégations, et enfin, les échanges avec le gouverneur général, une tâche si onéreuse, selon King, qu’elle méritait sa propre ligne. Mais cela ne représentait que le début des responsabilités du premier ministre — outre le Cabinet, il y avait le ministère des Affaires extérieures, qui demeura du ressort du premier ministre jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Parlement, les commissions, la Fédération libérale nationale et ce, sans oublier, la circonscription du premier ministre. Ce survol des responsabilités rattachées au poste illustrait, aux yeux de King, combien il travaillait d’arrache-pied. Par ailleurs, les nombreuses pages de son mémorandum n’avaient même pas fait état du temps requis pour « l’exercice ou les loisirs ... la lecture ... les voyages ... les urgences imprévues ... la rédaction de lettres personnelles ... la tenue de dossiers personnels ... du temps pour la réflexion ou la méditation ... les visites d’amis, les engagements sociaux à l’extérieur, les théâtres, le repos de la fin de semaine ... [ou] les vacances ou jours fériés[11] ». Après avoir passé du temps à décrire en détail toutes ses lourdes responsabilités, King se montra encore plus résolu à accroître la capacité de son cabinet.
Il suivi une stratégie similaire à celle qu’il avait adoptée près de dix ans auparavant. Il consulta des associés, des voisins et des amis. Éventuellement, il jeta son dévolu sur un boursier Rhodes diplômé d’Oxford qui, dans les années 1930, travaillait dans un cabinet d’avocats réputé de Montréal, et qui semblait personnifier les compétences recherchées par le premier ministre. Arnold Heeney était brillant, dévoué et circonspect. Cependant, comme Bickersteth avant lui, il était tout aussi confus quant aux attentes précises du premier ministre. L’invitation de King, à se joindre à son personnel en tant que premier secrétaire, un « poste qui correspondrait en quelque sorte à celui d’un administrateur général d’un département gouvernemental[12] », avait d’ailleurs suscité plus de questions qu’elle n’avait apporté de réponses.
Néanmoins, Heeney manifestait suffisamment d’intérêt pour le poste pour en définir lui-même les contours et, ce faisant, il donna une forme et une structure au Cabinet du Premier ministre que King n’avait fait qu’imaginer. Le filet tendu autour du Cabinet avait notamment été conçu pour répondre aux besoins de King, mais il avait également été tissé de manière à donner à Heeney une porte de sortie. Initialement, Heeney fut « nommé premier secrétaire du premier ministre » et fut chargé, « d’assurer la liaison entre le premier ministre et les autres ministres de la Couronne, d’assister le PM de manière générale et en particulier dans les affaires du Cabinet et d’exercer une supervision générale sur le travail du Cabinet du Premier ministre ». Avant la nouvelle élection, cependant, il reçut une nomination dans la fonction publique où il travailla en tant que greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet[13]. La définition du poste proposée par Heeney — son tracé des frontières — avait satisfait tout le monde à l’époque. King obtenait un secrétaire privé au sein du CPM qui était plus qu’un simple commis, et l’administration générale du gouvernement devenait considérablement plus organisée avec l’introduction de procès-verbaux et d’ordres du jour et autres, tous préparés par le secrétaire du Cabinet.
Toutes ces conversations, négociations et éventuellement les décisions prises en 1938 étaient destinées à définir un nouvel espace, ou peut-être même plusieurs nouveaux espaces. Elles ont mené à la définition des frontières et à l’identification des différents domaines de responsabilités. Elles ont jeté des filets autour de fonctions particulières — le Cabinet du Premier ministre était circonscrit à un ensemble, le travail du Cabinet, à un autre. Il allait y avoir des chevauchements, à coup sûr, mais King, Heeney, Bickersteth, et bien d’autres avant eux, avaient décidé de la structure.
Les décisions prises en 1938 furent motivées par la personnalité. Heeney, par exemple, était le genre de personne qui ressentait un grand besoin d’ordre, de sorte qu’il fixa quelques paramètres. King était égocentrique et solitaire, et agissait de la sorte. Les décisions furent également motivées par un certain manque de compréhension. King avait du mal à comprendre le rôle des fonctionnaires britanniques, et réclamait donc sans cesse quelque chose qu’il ne désirait pas réellement. La forme du Cabinet semble donc être apparue de manière accidentelle, du moins en partie. Or, une fois en place, elle commença à exercer une influence extraordinaire sur la fonction du Cabinet. Ainsi, le filet se mit à agir sur le contenu.
Dans ce cas, Heeney fit ce qu’il avait prévu pour le premier ministre en 1938. Il fit de son mieux pour imposer un certain ordre dans le travail du Cabinet du Premier ministre, il servit d’intermédiaire avec les autres ministres du Cabinet, il apporta ses conseils sur tous les sujets et, figurativement parlant, il tint la main du premier ministre. Puis il quitta le poste[14]. D’autres ont comblé l’espace par la suite, car il y avait désormais un espace. Ils n’étaient pas élus. Ils n’étaient pas fonctionnaires. Ils étaient triés sur le volet par le premier ministre du moment pour remplir les fonctions que Heeney avait définies dans son mémo en 1938. Ils assuraient la liaison, ils assistaient, et ils effectuaient une supervision générale.
Au fil du temps, le filet entourant le Cabinet du Premier ministre s’est agrandi, tout en devenant plus opaque. Le filet fut tissé plus serré. Ceux qui se situaient à l’intérieur exerçaient — et, en effet, exercent toujours — un pouvoir énorme. Ils avaient accès au premier ministre, ils jouissaient de sa confiance et ils en sont venus progressivement à le conseiller sur la politique, sur les politiques, et sur à peu près tous les aspects du document de dix pages que le premier ministre King avait préparé dans les années 1930 pour décrire ses multiples responsabilités.
Une fois l’espace construit, celui-ci en vint à être occupé. La forme dictait la fonction.
Les historiennes et historiens sont des fins observateurs, attentifs à ce genre de développements. Nous découvrons des filets qui sont utilisés, tant au sens littéral que métaphorique, pour protéger, démarquer et singulariser des personnes, des espaces ou des idées. Une grande partie de notre tâche en tant qu’historiennes et historiens consiste par ailleurs à identifier ces filets et à examiner comment les formes qui en résultent influencent ensuite la progression des événements.
Nous ne sommes pas aussi attentifs à nos propres filets, bien que nous les utilisions pour collecter, exposer et organiser notre travail ainsi que notre propre personne. Les filets que nous emportons sur le terrain sont sans doute ceux qui nous sont les plus familiers. Il s’agit de ceux que nous avons choisis consciemment. La décision de mener nos recherches dans des collections précises, ou de parler à des personnes précises, conditionne incontestablement les résultats de nos travaux. Et dans ce monde étrange de la COVID-19, caractérisé par la fermeture des archives et la distanciation sociale, nous sommes tous devenus familiers avec le côté aléatoire de ces décisions. Nous faisons ce que nous pouvons, avec qui nous pouvons. Les collections perdues, les fonds inaccessibles et les documents manquants, les longues demandes d’accès à l’information, les témoins taciturnes, les faux-fuyants et les chasses aux sorcières ont toujours fait partie du lot de l’historien, mais cette année les obstacles se sont multipliés de façon exponentielle[15]. Certes, nous pouvons être munis d’un grand filet au départ, pour ensuite être contraints à le réduire en raison des circonstances et du choix.
Et, naturellement, toutes ces décisions, qu’elles soient prises de façon éclairée ou qu’elles nous soient infligées, détermineront la portée de notre travail. Prenons comme exemple ce cas qui remonte à plus d’un demi-siècle. Pendant les purges communistes des années 1950 aux États-Unis, Natalie Zemon Davis et son mari Chandler Davis se sont fait révoquer leurs passeports. Ce dernier fut emprisonné et licencié de son poste à l’Université du Michigan. Le sort de Natalie Zemon Davis fut tout aussi funeste, quoique moins sévère — elle ne put retourner aux archives à Lyon pour y poursuivre les recherches liées à sa thèse. Son filet de recherche se rétrécit, ce qui façonna inévitablement son produit final — non pas en le réduisant, mais en le transformant. Le résultat ne fut pas celui qu’elle avait initialement imaginé, mais il donna le coup d’envoi à une carrière enrichie par l’examen d’un type particulier de manuscrit[16].
Tous nos filets de recherche prennent forme au gré des circonstances — sans doute pas de façon aussi spectaculaire que celui de Davis, bien que tous les chercheuses et chercheurs actuels restreints par la COVID rêvent peut-être eux aussi d’un Martin Guerre dans leur avenir. Dans nos quêtes, nous choisissons tous d’apporter nos filets dans des lieux bien particuliers, parfois seuls, mais de plus en plus fréquemment accompagnés de collègues qui veulent partager la tâche et utiliser ce filet pour collecter le passé.
Puis, armés d’un filet rempli de murmures nous construisons nos histoires. Ces histoires, bien évidemment, ont une forme. Il s’agit d’une forme qui est, en partie, choisie délibérément, tissée intentionnellement par l’historien mais qui, comme les autres étapes de ce processus désordonné, est également dictée par le hasard. Et, comme les récipients que nous avons évoqués plus tôt, ces formes historiques ont également une incidence sur le résultat.
Ces derniers temps, nous avons surtout prêté attention au support utilisé pour communiquer notre histoire. L’histoire se présente-t-elle dans un livre ou sur un écran ? Est-elle tangible ? Peut-on la franchir, la contourner ou en faire soi-même l’expérience ? Est-elle twittée ou chantée ? Imprimée ou cryptée ? Le virage numérique amorcé par notre profession et par bien d’autres rend ces questions de support plus pressantes que jamais, et nous rappelle la pertinence toujours actuelle de Marshall MacLuhan. Néanmoins, indépendamment des moyens que nous utilisons pour faire connaître l’histoire à nos publics, quels qu’ils soient, la forme de ces histoires est restée remarquablement constante, bien que cela ne soit pas nécessaire.
En décidant de la structure réelle de nos histoires, nous faisons office de copieurs, reproduisant des formules qui nous sont bien connues et utilisant des modèles universels pour contenir les informations que nous proposons. À l’instar d’une méthode scientifique — avec question, hypothèse, méthode, analyse et conclusion — il existe également une démarche historique. À peine aussi rigoureusement définies que celles suivies par nos collègues scientifiques, nos structures ont néanmoins des formes reconnaissables. Mais pourquoi ? Il s’agit sûrement d’une simple question d’habitude plutôt que de réglementation. En fait, notre espace, qui est le produit de notre travail, a été conçu de manière si robuste qu’il ne se modifie que rarement. Qu’il soit livré par la poésie ou la tradition orale, sur papier ou sur film, en beaucoup de mots ou avec peu, notre travail en tant qu’historiennes et historiens est linéaire. Les contours du produit fini — qui annonçent que « ça y est ! Un travail historique ! » — démarquent une piste qui a un début et une fin.
Même sans les règles de la science, la méthode historique a une forme bien identifiable. Il y a une littérature dans laquelle il faut tout situer, une lignée intellectuelle qu’il faut saluer ; il y a le nom central — qu’il soit propre, comme « Montréal » ou « Kishizo Kimura », ou commun, comme « classe », « guerre » ou « baleine » — et son contexte ; il y a le progrès au fil du temps, qu’il soit énorme ou minuscule ; et enfin, il y a le commentaire qui explique les raisons pour lesquelles quelqu’un pourrait s’y intéresser[17]. La démarche historique emprunte un chemin largement, sinon entièrement, chronologique et, en conséquence, elle est principalement, sinon entièrement, linéaire. Tout comme une ligne (ou du moins, un segment de ligne), nos histoires s’étendent d’un point à un autre.
Même les histoires qui prétendent s’affranchir de toute progression chronologique embrassent, dans une certaine mesure, l’idée d’un commencement. Le début peut être celui que fabrique l’historienne ou l’historien en amenant consciemment ses lectrices et lecteurs dans des archives ou des territoires traditionnels. Certaines histoires épousent une forme qui ne se veut pas spécifiquement chronologique, mais qui, en réalité, l’est — telle une vie qui a un début, même s’il s’agit de la vie inanimée d’un mouvement politique ou d’un morceau de technologie[18]. Nous plongeons dans le passé avec nos filets de recherche et nous offrons par la suite les résultats de cette collecte dans une autre sorte de récipient — à savoir un filet de présentation qui regroupe les fragments dans un ordre particulier. Et, avec tous ces divers contenants qui sont manifestement de l’histoire, un résultat est créé. Parfois de manière accidentelle, parfois de manière délibérée, la forme de ce contenant historique détermine — du moins en partie — la manière de le comprendre.
Souhaitions-nous que la forme serve à indiquer qu’il y avait un début, un milieu et une fin au passé ? Parfois, mais sûrement pas toujours. Avions-nous l’intention de sous-entendre l’inévitabilité ? Certainement pas, mais la forme en soi fait en sorte qu’il est difficile pour le public d’arriver à une autre conclusion.
Cela a des incidences sur la façon dont nous comprenons le passé. Si nous le présentons comme étant linéaire, avec un début, un milieu et une fin, alors le résultat en est que l’histoire est quelque chose qui s’est produit. Ainsi, la forme par laquelle nous présentons notre histoire détermine la manière dont elle est comprise. À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique ? Cela ressemble à des programmes scolaires qui négligent l’histoire, ou la considèrent comme étant marginale ou encore se contentent de mettre l’accent sur sa linéarité par le truchement des dates. Cela s’apparente à des politiques publiques qui laissent les leçons du passé dans le passé, en insistant sur le fait que le progrès ne va que de l’avant. Cela ressemble à la marginalisation continuelle du passé comme étant « du passé », et à la valorisation de la science, de la technologie et de l’ingénierie comme étant « du présent ». La présentation du contenu de nos filets en fonction d’une ligne incite les gens à comprendre le passé en tant que séquence, ayant un début mais aussi une fin. Elle encourage à la compréhension de l’histoire comme étant quelque chose qui s’est produit, plutôt que quelque chose que nous vivons tous les jours.
Contrairement à un seau, ce filet que nous brandissons pour afficher les résultats de notre collecte est flexible. Il se gonfle et se replie sur lui-même, se tord et se noue, façonnant et remodelant sans cesse l’espace qu’il recèle. Les papillons que nous attrapons n’ont pas à respecter un ordre particulier à l’intérieur du filet. La démarche historique, quant à elle, n’a pas à être aussi étroitement liée à la notion de commencement et de fin. Si le contenu de ce filet reste le même, les observations de l’historienne et de l’historien peuvent changer considérablement.
Que se passe-t-il lorsque nous éliminons le début et la fin ? Ou, du moins, lorsque nous considérons la possibilité de structurer ces histoires différemment ? Peut-être, comme nous l’a montré l’exemple du passé, si nous modifions la structure, les résultats changeront également. Si nous changeons les structures de nos histoires, peut-être nos publics les liront-ils, les regarderont-ils ou les vivront-ils différemment.
Les chercheuses et chercheurs nous ont déjà présenté diverses manières de remanier les linéarités de nos histoires. Dans son récent livre primé intitulé At the Bridge, Wendy Wickwire nous emmène dans des archives et des cercles de chant, elle introduit des silences et des mystères, elle nous fait découvrir les mauvais virages et les incompréhensions qui ont à la fois entravé et façonné la vie de l’anthropologue James Teit. La vie étant circulaire plutôt que linéaire, la lectrice ou le lecteur se tient à l’intérieur de ce cercle, au niveau du pont Spences et du pont métaphorique entre les colons et les Autochtones, entre le présent et le passé[19]. Certes, il peut y avoir un début et une fin implicites — c’est une vie, après tout — mais la forme de la narration ne suit pas une ligne droite, elle n’est pas linéaire. Elle ne l’est pas non plus dans le récit novateur de la vie et de la mort de Marie-Joseph Angélique rédigé par la poète et historienne, Afua Cooper[20]. En repliant le présent sur le passé, en considérant motifs et marginalisation, témoignages et théorie, Cooper intègre de l’incertitude à son histoire. En fait, l’histoire encercle le récit, amenant les lectrices et lecteurs d’aujourd’hui dans les navires d’esclaves, devant les tribunaux et au-delà.
Les historiennes et historiens n’ont pas à écrire une vie pour jouer avec la forme et expérimenter de nouvelles façons de structurer ce qui est généralement considéré comme étant la ligne droite de l’histoire. Des historiens environnementaux, comme Matthew Evenden et Stéphane Castonguay, ont suivi les rivières le long de sentiers sinueux ; d’autres, comme Sean Kheraj avec les pipelines ou Liza Piper et Heather Green avec les mines de charbon, ont poursuivi des objectifs ostensiblement linéaires tout en permettant à leurs arguments historiques d’évoluer de manières non linéaires[21]. Adele Perry et Mary Jane Logan MacCallum ont pris la mort de Brian Sinclair, seul et ignoré dans un coin du Centre des sciences de la santé de Winnipeg, et ont retracé les nombreuses trajectoires de son histoire vers le passé, puis vers l’avant, encore et encore, arrivant chaque fois dans ce même coin de l’hôpital, tissant ainsi la toile de complicité et de tragédie appartenant aux Structures of Indifférence[22].
La forme qui peut être perturbée n’est pas nécessairement celle du repère disciplinaire principal — le livre, l’exposition ou le documentaire. La récente conversation de Tania Willard et Paige Raibmon, consacrée à cinq histoires Secwépmic, fait ressortir la possibilité de tisser des histoires qui font fi de la chronologie conventionnelle en faveur d’une structure plus fluide par le biais du discours relationnel[23].
Suivre une historienne ou un historien dans le passé est une autre façon de rompre avec les débuts et les fins qui confèrent une forme spécifique à nos recherches, dictant du même coup l’usage que nous en faisons. Cependant, l’historienne ou l’historien doit guider la lectrice et le lecteur à travers les lieux du passé qui, selon la spécialiste en études classiques Mary Beard, nous offrent un « espace sûr » nous permettant de « sortir de nous-mêmes » et de remettre en question certaines de nos présomptions contemporaines[24]. Nombreux sont les historiennes et historiens qui l’ont fait. Il y a longtemps, Viv Nelles nous emmenait dans les archives où il avait vu apparaître un « éclat de couleur inattendu provenant d’un Union Jack et de l’uniforme écarlate et blanc brillant d’un soldat britannique du XVIIIe siècle » au fond d’une boîte d’archives grise, puis dans les salles de réception, les défilés et les salles de conseil qui ont marqué les célébrations entourant le tricentenaire du Québec. Il était là, et nous aussi, à contempler le spectacle se dérouler autour de nous[25]. Écoutez Shirley Tillotson plus récemment, lorsqu’elle nous séduit par une réflexion sur les impôts et la démocratie, en nous disant qu’elle a « été déçue plus d’une fois mais aussi impressionnée plus d’une fois par les actions politiques d’individus » ; qu’elle a « souvent songé à combien les institutions politiques canadiennes étaient maladroites[26] ». Tillotson l’historienne est là, juste à côté de l’histoire, à commenter, à considérer, à convaincre. Ou bien, entrez dans le passé par le biais des sentiments partagés — de trahison, de chagrin et de honte — qui se superposent dans la récente étude d’Eric Reiter sur les émotions et la loi au Québec des XIXe et XXe siècles, et qui laissent ainsi une analyse sans fin du fait que les sentiments continuent de résonner[27]. Le coeur bat toujours ; le présent se replie sur le passé.
Ces historiennes et historiens qui emmènent leurs lectrices et lecteurs, leurs auditrices et auditeurs, ou leurs téléspectatrices et téléspectateurs dans les espaces qu’ils explorent renversent l’idée que l’histoire a un début et une fin. Ce n’est pas tant qu’ils insistent sur le fait qu’il y a des leçons à tirer du passé, ou qu’il y a des parallèles à faire, mais plutôt qu’ils nous les font découvrir. Écrire une histoire en éliminant la linéarité a pour effet de montrer au public que l’histoire se trouve tout autour de nous, et non pas derrière nous. L’histoire demeure la même, mais la forme ou la structure de sa présentation se modifie. L’historienne et l’historien, pour reprendre les mots de Natalie Zemon Davis, ne « regarde plus ses sujets comme des touristes niais », mais « converse avec eux », une approche évoquée implicitement dans le titre de la récente collection éditée Talking Back to the Indian Act[28]. Et en changeant la forme que nous adoptons pour présenter le fruit de nos recherches, nous pouvons changer la façon dont il est utilisé. Nous pouvons en changer la fonction. De la même manière que la création d’un Cabinet du Premier ministre a façonné le pouvoir même du premier ministre, en produisant des histoires qui expérimentent avec la forme — qui plient les débuts et les fins en quelque chose d’autre qu’une ligne droite — nous pouvons faire ressortir différentes utilisations de l’histoire. Non pas l’étude de choses longtemps révolues. Non pas l’étude de choses qui pourraient avoir des parallèles contemporains mais qui, néanmoins, ont déjà connu leur fin. Ni l’étude de choses qui peuvent être ignorées. En déformant nos histoires, en laissant les filets qui ont enserré nos sujets se mouvoir en différentes formations, nous pouvons entamer la construction d’un autre type d’histoire.
De la même façon que nous manions nos filets et que nous les brandissons à la vue du public, nous sommes également enveloppés de notre propre filet — un filet de notre propre création, mais tout aussi capable de façonner nos résultats que les récipients que nous utilisons pour saisir, conserver et afficher le passé. La Société historique du Canada est centenaire, ou sur le point de l’être. Depuis un siècle, le filet qu’elle a tendu autour des historiennes et historiens a un tissage ajouré ; si elle les rassemble, elle le fait momentanément et à l’occasion. Les historiennes et historiens ne sont pas aussi fragiles que les papillons, et beaucoup plus enclins d’aller et venir à leur guise. Il n’en reste pas moins que la dimension et la forme de ce filet exerceent également leur influence sur le rôle des historiennes et historiens, ou sur la compréhension que le monde a de ce rôle. La SHC a toujours eu pour ambition de lancer ce filet au large, avec parfois plus de succès que d’autres. Les « historiennes et historiens » peuvent être difficile à identifier, leurs traits changeant au gré des occasions ; à certains moments, la variété féminine a été difficile à repérer, ou encore, le type qui trouve son habitat naturel dans les musées, l’école secondaire ou les archives d’entreprise s’est montré particulièrement fuyant. Mais au sein d’une structure qui englobe tous ceux qui se disent historiennes et historiens — non seulement certains, mais tous — il y a une occasion de bouleverser les linéarités de notre profession comme nous avons bouleversé la chronologie de nos histoires. La structure de la SHC, loin de représenter une simple progression d’un type d’histoire et d’un type d’historienne ou d’historien vers un autre, permet et encourage les relations entre historiennes et historiens —qui, en effet, ont peu en commun, sinon le fait d’être historiennes et historiens. Ces rapports — qui transcendent les approches historiques, les périodes et les lieux, et qui relient des historiennes et des historiens de toutes sortes et de toutes expériences — jettent les bases à différentes réalisations. Ils rendent possible des histoires vibrantes et surprenantes qui ne se résument pas seulement qu’à une seule chose, mais à de nombreuses autres. La forme a une incidence sur le résultat.
Le monde, je l’espère, s’ouvre. Les cercles que nous avons tracés autour de nous-mêmes, à deux mètres de la personne située à côté de nous, se dissiperont bientôt. Les filets s’ouvriront. Mais, lorsqu’ils le feront, j’espère que nous ne perdrons pas de vue le filet aussi bien que les « étoiles dans l’écume scintillante », afin de reconnaître sa capacité à déterminer la portée de nos recherches, de comprendre comment la forme que nous donnons au passé conditionne la manière dont il est compris, et enfin, d’apprécier notre propre filet — étendu et élastique — et la richesse des découvertes qui en découlent.
Appendices
Note biographique
P. E. BRYDEN est professeure d’histoire à l’Université de Victoria et a été présidente de la Société historique du Canada entre 2019 et 2021. L’une des historiennes politiques prééminentes du Canada, elle a publié de nombreux ouvrages sur l’État providence (Planners and Politicians : Liberal Politics and Social Policy,1957-1968, MQUP 1997 et The Welfare State in Canada: Past, Present and Future, Irwin 1997) ; le fédéralisme (‘A Justifiable Obsession’ : Conservative Ontario’s Relations with Ottawa, 1943-1985, UTP2013 et Framing Canadian Federalism, UTP 2009) et la politique canadienne (Canada : A Political Biography Oxford, 2016). Ses projets actuels incluent une histoire du bureau du premier ministre au Canada et une vaste étude du scandale politique canadien.
Notes
-
[1]
Eugene Field, 1889, Wynken, Blynken, and Nod, Boston, Boston Music : « All night long their nets they threw | to the stars in the twinkling foam – »
-
[2]
Un cas de COVID-19 a été identifié pour la première fois au Canada à la fin du mois de janvier 2020. Je me suis penchée pour la première fois sur les perturbations liées à la COVID-19 dans un article d’Intersections, en commentant l’annulation de la conférence annuelle 2020 de la Société historique du Canada, dans lequel je constatais que « plus de 170 000 personnes ont été infectées par la COVID-19 [et] le coronavirus qui ont déjà pris 7 000 vies », vol. 3, no 1 (2020). Le jour où j’ai prononcé ce discours présidentiel, assise à mon bureau devant une caméra Zoom, le nombre de décès au Canada approchait les 26 000 ; à l’échelle mondiale, il dépassait les 3,5 millions. Voir « COVID-19 Data Explorer », Notre monde en données, en ligne (https://ourworldindata.org/coronavirus-data?country=~OWID_WRL), consulté le 22 avril 2022.
-
[3]
Mon professeur n’était probablement pas le seul à faire cette observation sur les papillons et les filets ; les filets semblaient faire fureur à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Le roman cérébral de Julian Barnes, Le perroquet de Flaubert, était populaire à l’époque, et il comprenait ce commentaire : « Vous pouvez définir un filet de deux façons, selon votre point de vue. Normalement, vous diriez qu’il s’agit d’un instrument à mailles conçu pour attraper des poissons. Mais vous pourriez, sans que cela nuise à la logique, inverser l’image et définir un filet comme le faisait autrefois un lexicographe enjoué, comme étant une collection de trous attachés ensemble avec de la ficelle. Vous pouvez faire de même avec une biographie. Le filet de chalutage se remplit, puis le biographe le remonte, il trie, rejette, stocke, filète et vend. Pourtant, songez à ce qu’il n’attrape pas : il y en a toujours beaucoup plus ... Mais pensez à tout ce qui s’est échappé, qui s’est enfui avec la dernière expiration du sujet de la biographie sur son lit de mort. » Tina Loo a également joué avec cette idée dans son article de 1992, « Dan Cramner’s Potlatch : Law as Coercion, Symbol, and Rhetoric in British Columbia, 1884-1951 », Canadian Historical Review, vol. 73, no 2, p. 125-165. En reconsidérant la notion de Foucault du pouvoir comme étant décentralisé et comme un filet qui entoure plutôt que comme une marchandise qui est contrôlée, Loo présente les implications de considérer ce filet en tant que collection de trous qui révèle que « l’aspect répressif du pouvoir ... est moins qu’absolu » (p. 165, note 106). Merci à Donald Wright et Jordan Stanger-Ross pour le rappel de ces deux références au filet, qui auraient toutes deux circulé dans le monde académique à la même époque où mon professeur ruminait.
-
[4]
La liste est vraiment sans fin, mais pour un aperçu de l’érudition dans le contexte canadien, voir Benjamin Hoy, 2021, A Line of Blood and Dirt : Creating the Canada-United States Border across Indigenous Lands, New York, Oxford University Press ; Joshua MacFadyen, 2018, Flax Americana : A History of the Fibre and Oil that Covered a Continent, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press ; les collaboratrices et collaborateurs de Lyndsay Campbell, Ted McCoy et Mélanie Méthot (dir.), 2020, Canada’s Legal Pasts : Looking Forward, Looking Back, Calgary, University of Calgary Press, illustrent magistralement la manière dont les prisons et le système juridique ont dressé des barrières entre les gens, mais également comment les universitaires ont perpétué certaines de ces barrières. Voir en particulier le chapitre de Ted McCoy, « Writing Penitentiary History » ; Ronald Rudin, 2016, Kouchibouguac : Removal, Resistance and Remembrance at a Canadian National Park, Toronto, University of Toronto Press ; Selena Couture, 2019, Against the Current and into the Light : Performing History and Land in Coast Salish Territories and Vancouver’s Stanley Park, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press ; et Jeff Webb, 2016, Observing the Outports : Describing Newfoundland Culture, 1950-1980, Toronto, University of Toronto Press. Là où je veux en venir, c’est qu’il existe des frontières réelles et imaginaires où que vous regardiez, dans ces livres et à peu près partout ailleurs.
-
[5]
Peter H. Russell, 2017, Canada’s Odyssey : A Country Based on Incomplete Conquests, Toronto, University of Toronto Press ; et John Borrows, 2016, Freedom and Indigenous Constitutionalism, Toronto, University of Toronto Press. Ils considèrent tous deux les divisions constitutionnelles de différentes manières. Le développement des frontières juridiques est examiné dans Philip Girard, Jim Phillips et R. Blake Brown, 2018, A History of Law in Canada, volume I, Toronto, University of Toronto Press.
-
[6]
Tant la religion que la nature de la famille sont abordées dans David Rayside et Clyde Wilcox, 2011, Faith, Politics and Sexual Diversity in Canada and the United States, Vancouver, UBC Press.
-
[7]
H. Blair Neatby, 1963, William Lyon Mackenzie King : The Lonely Heights, 1924-1932, Toronto, University of Toronto Press, p. 230 ; sur le fait qu’il était exigeant envers son personnel de bureau, voir J. W. Pickersgill, 1994, Seeing Canada Whole : A Memoir, Toronto, Fitzhenry and Whiteside, p. 151-6.
-
[8]
Archives de l’Université de Toronto (ci-après UTA), Fonds John Burgon Bickersteth (ci-après Fonds Bickersteth), B2001-0018/001 - Bickersteth B1 03.03.03, mémo, « Private and Confidential », 30 mai 1927. Voir également, John F. Naylor, 1984, A Man and an Institution : Sir Maurice Hankey, the Cabinet Secretariat and the Custody of Cabinet Secrecy, Cambridge, Cambridge University Press.
-
[9]
UTA, Fonds Bickersteth, B2001-0018/001 – Bickersteth B1 03.03.03, mémo, « Private and Confidential », 30 mai 1927.
-
[10]
UTA, Fonds Bickersteth, B2001-0018/001 - Bickersteth B1 03.03.03, note de conversation avec WLM King, 12 et 13 juin 1927 ; Bibliothèque et Archives Canada, papiers de William Lyon Mackenzie King, MG 26 J1, bobine : C-2295, p. 120051-120057, Bickersteth à King, août 1927.
-
[11]
Archives de l’Université Queen’s, papiers John Buchan, dossier vol. 7 : Correspondance, déc. 1935, « Bird’s Eye View : The Prime Minister’s Responsibilities », s.d.
-
[12]
J. L. Granatstein Archives (ci -après JLGA), papiers A.D.P. Heeney, King à Heeney, 13 juillet 1937.
-
[13]
JLGA, papiers A.D.P. Heeney, Heeney à King, 24 August 1938 ; voir aussi J. R. Mallory, juin 1976, « Mackenzie King and the Origins of the Cabinet Secretariat », Canadian Public Administration, vol. 19, no 2, p. 254-266.
-
[14]
Voir A. D. P. Heeney, 1967, « Mackenzie King and the Cabinet Secretariat », Canadian Public Administration/Administration Publique du Canada, vol. 10, no 3, p. 366-375 et 1972, The Things that are Caesar’s : Memoirs of a Canadian Public Servant, Toronto, University of Toronto Press, p. 61-75.
-
[15]
Voir, par exemple, Karen Dubinsky, 2021, « Canada’s public archives are vital. We must reopen them », Toronto Star, 13 octobre ; 2021, « Recent service cuts at Canada’s national archives hindering research, historian says », Globe and Mail, 23 octobre. Cependant, de l’autre côté de la pandémie, nous sommes confrontés à ce que Ian Milligan appelle une « ère d’abondance historique » grâce aux médias sociaux et à la numérisation. Voir son intervention à la réunion annuelle de l’American Historical Association à peine quelques semaines avant le début des perturbations liées à la COVID-19 : Ian Milligan, « AHA Talk : The Promise of WebARChive Files », Ian Milligan : Digital History, Web Archives, and Contemporary History, en ligne (https://ianmilli.wordpress.com/2015/01/29/aha-talk/), consulté le 22 avril 2022 et 2019, History in the Age of Abundance : How the Web is Transforming Historical Research, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press.
-
[16]
Pour connaître l’explication des événements qui ont conduit à la réorientation de la recherche de la thèse de Davis, voir Alison Mackeen et Ben Rogers, 1995, « Tricks of History », The Independent, 5 février ; et Regional Oral History Office, « Natalie Zemon Davis », interview par Ann Lage, 2003, en ligne (https://digitalassets.lib.berkeley.edu/roho/ucb/text/davis_natalie.pdf), consulté le 22 avril 2022, p. 19 ; l’un des nombreux résultats fut, bien sûr, Natalie Zemon Dvais, 1983, The Return of Martin Guerre, Cambridge, MA, Harvard University Press.
-
[17]
Michèle Dagenais, 2011, Montréal et l’eau. Une histoire environnementale, Montréal, Boréal ; Jordan Stanger-Ross, printemps 2014, « Telling a Difficult Past : Kishizo Kimura’s Memoir of Entanglement in Racist Policy », BC Studies, no 181 ; Julie Guard, 2019, Radical Housewives : Price Wars and Food Politics in Mid-twentieth century Canada, Toronto, University of Toronto Press ; Sarah Glassford et Amy Shaw, 2013, A Sisterhood of Suffering and Survice : Women and Girls of Canada and Newfoundland during the First World War, Vancouver, UBC Press ; Jason Colby, « Cetaceans in the City : Orca Captivity, Animal Rights, and Environmental Values in Vancouver », dans Joanna Dean, Darcy Ingram et Christabelle Sethna (dir.), 2017, Animal Metropolis : Histories of Human-Animal Relations in Urban Canada, Calgary, University of Calgary Press, p. 285-308.
-
[18]
Les mémoires récents mélangent souvent les deux — la structure que donne une vie, avec la structure que donne la recherche réelle ou l’acte de découverte. Voir Jesse Wente, 2021, Unreconciled : Family, Truth and Indigenous Resistance, Allen Lane Canada; et Jesse Thistle, 2019, From the Ashes : My Story of Being Metis, Homeless, and Finding My Way, Simon and Schuster Canada. Des innovations comme celles-ci annoncent de nouvelles possibilités passionnantes pour les historiennes et historiens.
-
[19]
Wendy Wickwire, 2019, At the Bridge : James Teit and an Anthropology of Belonging, Vancouver, UBC Press.
-
[20]
Afua Cooper, 2006, The Hanging of Angélique : The Untold Story of Canadian Slavery and the Burning of Old Montréal, Toronto, Harper Perennial.
-
[21]
Matthew Evenden, 2004, Fish versus Power : An Environmental History of the Fraser River, Cambridge, Cambridge University Press ; Stephane Castonguay and Matthew Evenden (dir.), 2012, Urban Rivers : Remaking Rivers, Cities and Space in Europe and North America, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press ; Sean Kheraj, juin 2020, « A History of Oil Spills on Long-Distance Pipelines in Canada », Canadian Historical Review, vol. 101, no 2, p. 161-191 ; Liza Piper et Heather Green, septembre 2017, « A Province Powered by Coal: The Renaissance of Coal-Mining in Late Twentieth Century Alberta », Canadian Historical Review, vol. 98, no 3, p. 532-567.
-
[22]
Adele Perry et Mary Jane Logan McCallum, 2018, Structures of Indifference : An Indigenous Life and Death in a Canadian City, Winnipeg, University of Manitoba Press.
-
[23]
Tania Willard and Paige Raibmon, mars 2021, « A Relational Discourse through Secwépemc Authorship: A Review Conversation », Canadian Historical Review, vol. 102, no 1, p. 152-167.
-
[24]
David Marchese, 2022, « Ancient Rome will never get old. Take it from Mary Beard », New York Times, 31 mai, en ligne (https://www.nytimes.com/interactive/2021/05/31/magazine/mary-beard-rome-interview.html?searchResultPosition=1), consulté le 22 avril 2022.
-
[25]
H. V. Nelles, 1999, The Art of Nation-Building : Pageantry and Spectacle at Quebec’s Tercentenary, Toronto, University of Toronto Press, p. 3.
-
[26]
Shirley Tillotson, 2017, Give and Take : The Citizen-Taxpayer and the Rise of Canadian Democracy, Vancouver, UBC Press, p. 316.
-
[27]
Eric Reiter, 2019, Wounded Feelings : Litigating Emotions in Quebec, 1870–1950, Toronto, University of Toronto Press.
-
[28]
Mackeen et Rogers, « Tricks of History » ; Mary-Ellen Kelm et Keith D. Smith (dir.), 2018, Talking Back to the Indian Act : Critical Readings in Settler Colonial Histories, Toronto, University of Toronto Press.
J’ai bénéficié de décennies de conversations sur le passé et sur le métier d’historien avec des étudiantes et étudiants, et avec des universitaires, jeunes et moins jeunes, et je tiens à remercier chacun d’entre eux pour leur contribution à ce long cheminement intellectuel. Plus récemment, j’ai apprécié un dialogue anonyme avec les trois rédactrices et rédacteurs de cette revue. Je n’ai pas suivi tous leurs conseils, mais cet article est incontestablement plus fort après avoir intégré leurs suggestions. Qui qu’ils soient, ce fut un plaisir de partager un filet avec eux.