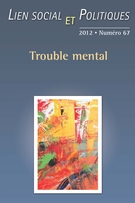Abstracts
Résumé
Depuis une dizaine d’années, la santé publique, notamment par l’intermédiaire des initiatives élaborées au niveau européen, insiste sur le coût économique et existentiel des troubles courants, dépression en tête. Ce contexte est celui d’un remodelage de la catégorie de dépression en tant que maladie « comme une autre ». Les enjeux de ces évolutions ne se limitent pas à l’espace institutionnel. Nous analyserons certaines d’entre elles sur la base de récits individuels. L’accent sera porté sur les négociations que les acteurs opèrent entre une lecture naturalisante de la maladie et une lecture psychologique valorisant le caractère singulier de l’expérience.
Abstract
Over the last 10 years or so, public health authorities, particularly through Europe-wide initiatives, have been drawing attention to the economic and existential cost of common mental health disorders, especially depression. These initiatives are taking place at a time when depression is no longer being classified as “just another illness.” The issues involved in these changes are not limited to the institutional realm. We examine some of the changes from the perspective of individual narratives, with an emphasis on the ongoing debate between a naturalizing interpretation of illness and a psychological interpretation that highlights the unique nature of the experience.
Article body
La santé mentale apparaît comme un champ en pleine extension, se traduisant par la production de la « bonne santé » comme projet social à part entière. Dans ce contexte, un large spectre de troubles psychiques de gravité variable est devenu une cible prioritaire des politiques de santé publique. Ce spectre est néanmoins essentiellement composé des troubles courants considérés comme pouvant « arriver à tous », dont la dépression est devenue exemplaire (Castel, 1981 ; Ehrenberg, 1998). Celle-ci y est désignée comme une pathologie unifiée pour laquelle il existe des traitements efficaces et scientifiquement validés. Parallèlement, le statut et le rôle social du sujet troublé se redéfinissent, avec d’un côté la reconnaissance positive de la figure de victime dans le champ de la santé mentale, et de l’autre le poids de la règle du travail sur soi comme condition d’accès à l’autonomie (Vrancken et Macquet, 2006). Notre objectif ici est de contribuer à la compréhension de cette configuration à partir d’une analyse des usages de la catégorie de dépression et des significations attachées au vécu dépressif. Les discours individuels constituant notre matériau sont porteurs d’une normativité qui se construit autour de ce trouble, ils sont tout autant des productions liées à une certaine expérimentation du monde à laquelle les acteurs tentent de donner un sens unifié. Par conséquent, ils sont traversés par des négociations entre la défense d’intérêts subjectifs et des contraintes socialement données (Jodelet, 2006). À un niveau général, l’interpénétrabilité des évolutions macrosociales et des trajectoires individuelles dévoile un régime de rationalité que nous identifions à un processus poussé de désenchantement de la vie psychique. Il renvoie à l’amplification du contrôle et de la mise en lisibilité de son fonctionnement : idéal de transparence qui se traduit par l’attachement de la santé mentale au champ global de la santé, mais aussi par la consécration des sciences du cerveau et par le développement de leurs applications thérapeutiques (Vidal, Ortega, 2011). La première partie discute la désubjectivisation de l’expérience de la dépression induite par sa définition en tant que maladie comme une autre. Dans la seconde partie, nous analyserons le modèle de travail sur soi qu’elle légitime en mettant l’accent sur les transformations de la demande de psychothérapie.
Une désubjectivisation toute relative de la dépression
Le paradigme de la santé mentale, modelé et promu au niveau européen depuis une dizaine d’années, met particulièrement en avant l’ampleur et la gravité des troubles psychiques courants (Organisation mondiale de la santé, 2001) : la dépression serait l’une des principales « causes d’incapacité dans le monde », devant atteindre le deuxième rang en 2020 pour tous les âges et les deux sexes.
Ce centrage des politiques de santé mentale sur la constellation nouvelle des troubles courants – dépression, anxiété, addictions, troubles alimentaires…– répond à deux grands axes de rationalisation de l’action. Le premier relève d’une rationalité économique : il s’agit de répondre au « fardeau » que représentent les troubles mentaux et d’« investir » dans la santé mentale en dispensant de nouvelles stratégies s’étendant de la prévention au traitement, en passant par la promotion de la « bonne santé mentale » (OMS, 2004). Le second est d’ordre éthique et insiste sur le coût existentiel des troubles. À ce titre, il donne une autre épaisseur à un discours s’appuyant essentiellement sur les données de l’épidémiologie et faisant valoir un athéorisme qui conduit à la distinction de « facteurs » biopsychosociaux plus ou moins protecteurs ou pathogènes (Fassin, 2005). Il recouvre les arguments soutenant que la santé mentale est un « droit fondamental de l’être humain » et qui voient celle-ci comme une capacité à s’intégrer positivement à la communauté, donc, en premier lieu, à être autonome, productif et compétent, mais aussi à se percevoir comme tel.
Le niveau éthique est très investi également par l’appel à la déstigmatisation qui voit converger différents discours d’acteurs institutionnels et sociaux : les individus troublés sont des victimes confrontées à diverses formes de rejet, d’exclusion ou d’ignorance. Or la centralité de tels arguments amenuise la frontière, encore bien visible au sein de l’institution psychiatrique (Velpry, 2008), entre « cas psychologiques » et « cas psychiatriques », au nom d’une expérience commune de la souffrance psychique. Ce brouillage se poursuit par le rapprochement entre les problématiques de la santé mentale et les pathologies somatiques. L’effet de nivellement est renforcé de plus par l’insistance sur la comorbidité des troubles – la dépression serait ainsi un facteur de risque pour le cancer et les maladies cardiaques –, mais également par la qualification des troubles courants parmi les maladies neuropsychiatriques, ou, à tout le moins, par la systématisation de la lecture bio-psycho-environnementale et la légitimation croissante des données neuroscientifiques.
La fabrique des troubles psychiques en santé publique relève par conséquent d’une forme de positivisme qui consiste d’une part à évaluer précisément l’ampleur et le coût de la « mauvaise santé mentale » et, d’autre part, à y répondre en soulignant la disponibilité de ressources et de traitements « efficaces » et « faciles à mettre en place ». L’idée de l’accessibilité de la guérison découle de ce modèle et nous renvoie à la réévaluation de l’idée de responsabilité, ou plutôt à son déplacement. En effet, si les troubles courants sont conçus comme particulièrement graves et touchant tous les groupes sociaux, la possibilité d’y remédier par le recours à une intervention médicale ou psychosociale évaluée apparaît plus forte que jamais. L’évocation de ces axes de rationalisation, éthique et économique, nous permet d’esquisser le cadre général de contraintes dans lequel se déploie le paradigme de la santé mentale. À partir de celui-ci se donne à interroger la construction et la justification du vécu dépressif, entre déspécification de la dépression en tant que trouble psychique singulier et élaboration du sens de la maladie dans la dynamique de construction de soi.
La banalisation de la dépression comme maladie
Les récits du vécu dépressif indiquent que la référence à la dépression comme maladie dûment identifiée et objectivable est passée dans le langage commun. Cette pathologisation de la dépression-symptôme relève aujourd’hui d’une demande de reconnaissance de la gravité de la souffrance psychique et, à ce titre, d’une rupture avec un ensemble de conceptions morales enchâssées dans l’histoire des troubles mentaux.
Lorsque, pour commencer l’entretien, nous demandons aux interviewés de parler de leur dépression en partant de ce qui leur semble « le plus significatif », la plupart d’entre eux évoquent le poids de leur « histoire », le plus souvent « familiale ». Néanmoins, nous avons pu constater que cette expertise sur son propre passé était compatible avec l’identification de la dépression à une maladie presque « comme une autre », donc avec le recours à un modèle exogène qui éloigne les causes de l’individu lui-même. La dissociation de la dépression de « soi », sa désignation comme un « corps » étranger menaçant l’intégrité personnelle, rejoint un modèle explicatif global connu de la maladie où elle est perçue comme venant corrompre un état initialement sain (Herzlich, 1969). En parlant de leur dépression comme d’une authentique « maladie », les acteurs sont conscients qu’ils accèdent à une forme positive de reconnaissance :
Je trouve que c’est quelque part rassurant de définir la dépression comme une maladie ; déjà pour soi, si on a déjà souffert de dépression, mais aussi pour l’entourage et la population en général. C’est en fait une reconnaissance que la dépression est une maladie comme d’autres maladies.
Jeanne, 52 ans, infirmière, Paris
Cela peut même conduire à mettre en concurrence par comparaison les troubles psychiques et les pathologies somatiques, y compris les plus graves comme le cancer, pour souligner le traitement différencié dont ils feraient l’objet :
C’est bien là tout le problème de la vie psychique. J’ai un ami qui a fait une dépression après avoir été dirigeant dans un grand groupe et qui s’est trouvé sur le carreau, et qui a eu énormément de mal à s’en remettre et qui a un cancer maintenant. Et il m’a dit : « je préfère le cancer à la dépression. » Parce qu’on sait qu’on a un cancer, les autres vous aident, le corps médical est très compatissant.
Christian, 57 ans, chef d’entreprise à la retraite
Dans tous les cas est attendue une objectivation de la dépression comme pathologie descriptible, explicable pour tous, démystifiée :
Les documentations, c’est du charabia, c’est pas facile à comprendre si on n’a pas fait médecine, les médecins, ils sont pareils, ils connaissent les termes, mais ils n’arrivent pas forcément bien à localiser et à soigner la maladie
Christian
La chose à laquelle je tiens beaucoup, c’est que la dépression soit banalisée, qu’on puisse en parler […] y a quand même un rejet. On vient pas à votre aide… Alors il faudrait être comprise à demi-mot, c’est complexe, si on se casse la jambe, c’est pas complexe, c’est brut de pomme
Gisèle, 74 ans, archiviste à la retraite, Paris
La demande de banalisation ne renvoie pas expressément à une relativisation de la singularité de l’expérience, mais bien plutôt au refus de se voir tenu fautif de « sa » dépression. Or des forces « culpabilisatrices » sont identifiées. Sont pointés les professionnels rencontrés, considérés comme insuffisamment formés (médecins généralistes) ou comme ayant minoré la plainte exprimée. Mais, au-delà de ces derniers, est très souvent accusée une société de la performance déshumanisée et oppressante :
Jamais un médecin n’a diagnostiqué cela, alors que je faisais régulièrement des prises de sang pour trouver les causes de lourdes fatigues […] J’en veux aux médecins d’avoir eu un positionnement culpabilisant et de refuser de voir que je présentais des symptômes dépressifs, et de les prendre en compte dans le traitement de ma santé. Je crois que la dépression fait peur, est souvent pas comprise comme une maladie mais comme un laisser-aller ; de plus, dans une civilisation où on nous demande sans cesse efficacité et productivité, la dépression est réellement mal perçue, et le malade est culpabilisé.
Célia, 34 ans, sans profession
Il peut être vu dans une lecture centrée sur les symptômes et leur impact sur le déroulement de la vie « normale » une forme de simplification occultant la nature et le sens particuliers des troubles mentaux. Or, a contrario, le raisonnement individuel correspond moins à une tentative de simplification qu’à une renégociation des contraintes propres à chaque lecture explicative. S’ils en exposent les avantages, les acteurs perçoivent aussi la portée potentiellement réductrice de l’inscription de la dépression dans le registre de la maladie, comme le montre leur hésitation parfois à se saisir pleinement du terme :
[…] oui, ce que je trouve bien dans le terme maladie, c’est que ça peut déculpabiliser les gens, ça veut dire que vous ne vous êtes pas vous-même mis dans une situation. C’est encadré, c’est un concept, ça veut dire qu’il y a des gens qui s’en occupent. En même temps, c’est difficile pour soi-même parce que, dans une maladie, les symptômes sont censés se ressembler, alors que dans la dépression les symptômes peuvent être les mêmes mais les causes sont tellement variées… alors que la grippe, voilà, c’est un virus. Ou alors il faudrait inventer un autre mot, mais j’en n’ai pas
Marjanne, 32 ans, informaticienne
Ainsi, les sujets n’extériorisent que partiellement la dépression de la vie subjective, d’autant plus que leur capital social et culturel les dispose à alimenter une identité « réflexive » (Giddens, 1994)[1]. En revanche, le mal est mis à distance raisonnable de soi, restaurant un pouvoir d’action sur celui-ci. La pose du diagnostic de dépression permettra la requalification d’une souffrance diffuse, comme le montre le discours d’Élise qui a cessé d’accuser son seul « tempérament angoissé » :
[…] je sentais toujours que c’était quelque chose à l’intérieur de moi, mais en même temps, c’était extériorisé, si je peux dire. Cet amas incompréhensible que je ressentais en fait pouvait être regardé de l’extérieur et être nommé.
Élise, 33 ans, étudiante
Dès lors, le mal ainsi extériorisé ne constitue plus une menace pour l’intégrité morale du sujet :
C’est pour ça que je peux comprendre aussi la tentation de dire que c’est une maladie, pour dire que c’est quelque chose de vrai, que ça fonctionne comme ça. Tandis que si on ne parle que de circonstances, il y aura toujours la possibilité qu’on dise que c’est de la paresse, de l’émotivité, tout ça.
Élise
La pathologisation de la dépression met en évidence le déplacement des enjeux éthiques et moraux que cette catégorie véhicule. Certes, elle permet la reconnaissance de l’état de victime subissante et signifie le refus de considérer la dépression sous le seul angle moral mettant en jeu l’intentionnalité du sujet. Pour autant, si la « culpabilité » de ce dernier est déconstruite dans les discours individuels et officiels – c’est l’un des pivots de la communication en santé publique –, sa responsabilité quant à la restauration de sa bonne santé mentale reste pleinement engagée. Cette responsabilité suppose un effort de rationalisation du mal dont le prolongement logique sera l’engagement d’un travail sur soi.
La dépression biologisée pour être mieux maîtrisée
Si la dépression représente une défaillance à l’égard de la norme de contrôle de soi, elle n’en justifie que davantage le recours à un modèle d’explication rationnelle que le biologique alimente aujourd’hui de plus en plus largement. Cette logique de rationalisation de la vie psychique et de ses troubles est en outre renforcée par la définition de la santé mentale comme « capacité ».
En l’assimilant – ne serait-ce que partiellement – à un dysfonctionnement biologique, les acteurs peuvent lui donner sens à l’appui d’une philosophie optimiste pour laquelle la santé est un équilibre naturel qui se cultive en agissant sur ses dispositions physiques et psychiques. C’est le cas de Thomas qui identifie « deux causes » à sa dépression. Grâce à la thérapie qu’il a suivie, « une analyse, je ne sais pas bien, peu importe », il dit avoir découvert « plein de schémas, plein de problèmes avec mes parents qui faisaient que j’avais pas confiance en moi et que je m’imposais plein de choses, et que tout ça avait pu m’amener à faire une dépression ». Mais s’il voit dans « ses névroses » et le décès d’un proche le « déclencheur psychologique », il y ajoute un processus de « dérèglement hormonal » :
C’est à partir du moment où j’ai compris cette histoire de dérèglement hormonal sur lequel le corps médical pouvait agir que j’ai compris que c’était une maladie : c’était une façon de mieux l’accepter et de plus facilement le dire et de pas être… que ça soit pas de ma faute, en fait
Thomas, 35 ans, cuisinier
Reconsidérant le statut et la responsabilité des « malades », la lecture biologique légitime en outre l’institution d’une différence de nature entre la « déprime » ou autre « mal-être » passager et la « vraie » dépression. La référence à l’intensité d’une souffrance inscrite dans le corps y est centrale :
Quand je suis en phase dépressive grave, c’est vraiment physique, cette sensation de pas y arriver, d’être fatiguée en permanence, de pleurer pour un rien. Donc à partir du moment où c’est dans le corps… c’est vrai que cette distinction, elle a pas lieu d’être. Donc, c’est une maladie
Coralie, 36 ans, professeure de lettres, Paris
D’ailleurs, les acteurs estiment souvent que les mécanismes réels de la dépression, qui impliqueraient des interactions beaucoup plus étroites entre l’esprit et le corps, seraient encore insuffisamment connus. Et c’est la « science » dont il est attendu qu’elle les mette à jour, comme l’exprime ici Marion, qui pourtant a été très investie dans sa « psychanalyse » :
[…] de toute façon, je suis persuadée qu’il y a une interaction corps-esprit. Je pense qu’on n’a pas exploré encore à fond cet aspect-là. Il y a des scientifiques qui commencent à avancer des choses mais… l’interaction est très forte pour moi.
Marion, 46 ans, travailleuse sociale
On peut questionner, avec la fragilisation de la lecture exclusivement « psychologique » de la dépression, ce qu’il en est alors du statut des médicaments : classiquement, le recours aux psychotropes est l’un des objets autour desquels se cristallise le conflit entre les partisans de l’approche psychodynamique et les promoteurs d’une lecture biologique des troubles psychiques (Collin, Otero et Monnais, 2006). Si, comme nous le verrons, le recours à la psychothérapie reste très valorisé, la conception du mode d’action et de l’efficacité des psychotropes révèle ce modèle de la maladie replaçant la vie psychique dans le corps :
Oui, je pense qu’un médecin m’a dit ça. À partir du moment où j’ai pris des antidépresseurs, là, j’ai senti que c’était vraiment une dépression, parce que j’étais au plus bas, j’étais au plus mal, et j’ai senti que oui, c’était une dépression.
Paul, 38 ans, infographiste, Paris
La référence au « cerveau » et l’éloignement de la lecture du sujet marquée par la psychanalyse et les sciences humaines poussent ainsi la logique de matérialisation de la dépression :
Ben, une maladie c’est… c’est quand même un organe qui est atteint. Là, c’est le cerveau, et puis les médicaments agissent sur, je crois que c’est la sérotonine. Parce qu’il y a quelque chose de chimique qui se fait dans le cerveau, alors après…
Paul
Ainsi plusieurs interviewés s’autorisent-ils à dire qu’ils ont bien souffert de dépression en renvoyant au fait qu’ils se sont vu prescrire des antidépresseurs. On retrouve cette logique, y compris dans des cas où l’expérience du mal-être et les motifs de consultation qui nous sont décrits a posteriori s’inscrivent dans un autre registre que celui de la dépression. Ainsi C. commence-t-elle par parler de son « angoisse » et de ses accès « phobiques » avant de déclarer :
J’ai eu deux épisodes de dépression, en tout cas à la suite desquels j’ai été sous traitement antidépresseurs, etc. […] je ne pense pas qu’on me l’ait dit [que je souffrais de dépression]. Je pense que ça a été le fait de prendre des antidépresseurs, parce que forcément c’est qu’il y a une dépression.
Anna, 33 ans, consultante, Paris
Ici, l’usage de la catégorie de dépression correspond à une logique de concrétisation et de circonscription de la souffrance dans le temps, suggérant qu’il s’agit bien d’un trouble remédiable :
Heu… Ben, moi je me suis sentie malade le moment de la dépression. Après, aujourd’hui, je m’estime pas malade, pourtant je sais aussi que dans certains contextes je peux me retrouver à flancher et à repartir dans cet état-là. Donc est-ce que c’est une maladie qui se redéclenche ? Je sais pas trop… mais au sens large, oui.
Anna
Bien entendu, la dépression n’est pas toujours ramenée à une période bien déterminée de l’existence, quand elle est reconnue chronique ou estimée avoir « toujours été là », rendant complexe l’identification de ses causes et éléments déclencheurs. Toutefois, l’éprouver sur le mode de la maladie, même récurrente, permet de poser une frontière nette entre son état psychique « normal » et l’état pathologique qu’elle constituerait. Une tendance consiste alors à traduire cet état comme relevant d’un déficit ou d’une carence, interprétation qui prend pour preuve l’action spécifique qu’auraient les antidépresseurs :
Sur moi, les médicaments ont une vraie action… C’est en ça que je me dis qu’il y a quand même quelque chose qui est de l’ordre de la physiologie. Allez, on donne un petit coup de sérotonine et ça va mieux
Coralie
Quand les gens me demandaient, je leur expliquais que c’était une carence en sérotonine et que j’avais un recapturateur de sérotonine comme traitement, et c’était une façon de maîtriser et de comprendre.
Thomas
C’est évident qu’il y a des aspects médicaux ou chimiques. Moi, je pense que c’est des réactions chimiques qui ne se faisaient plus. Moi, je sentais que mon cerveau ne fonctionnait plus bien. J’avais des douleurs physiques dans le cerveau, que je n’ai plus eu après, avec les médicaments.
Valérie, 43 ans, enseignante dans le secondaire
L’accent porté sur la chimie de la dépression conduit ici à une relativisation de sa dimension mentale, de sorte que la prise de psychotropes est justifiée comme le serait le traitement d’une maladie somatique chronique, rejoignant une argumentation mobilisée en faveur de la déstigmatisation.
Mais les antidépresseurs, voilà c’est comme ça, il y a des diabétiques, eh bien, ils prennent de l’insuline.
Coralie, 36 ans, professeure de lettres
Cependant, les psychotropes continuent de faire l’objet de représentations particulières par rapport aux autres familles de médicaments, traduisant un lien spécifique entre « soi, son corps, et le produit » (Fainzang, 2001 : 78). La conception de l’utilité et de l’efficacité des antidépresseurs est ainsi très variable, de même d’ailleurs que leur prescription répond à des pathologies et des troubles anxiodépressifs de diverse gravité, notamment en médecine générale (Le Moigne, 2009). Quoiqu’il en soit, les psychotropes ne sont jamais considérés comme traitement suffisant ou satisfaisant en soi, ni pris pour anodins. La peur commune dont ils font l’objet, en particulier celle de la « dépendance », indique que ces médicaments sont vus particulièrement « puissants », et exigeraient un haut niveau de compétence du professionnel qui les délivre :
Oui, ça aide, malgré tout. Mais il faut que ce soit dosé ; enfin, je pense qu’il faut des psychiatres très compétents qui savent manier les médicaments. En tout cas, moi, ça me fait peur, je n’aime pas beaucoup, alors je les prends en reculant tout en me disant que ça apporte une aide.
Gisèle, 74 ans, archiviste à la retraite, Paris
La méfiance exprimée quant à l’action des psychotropes peut se traduire ainsi par la crainte que ceux-ci n’agissent sur la « personnalité » du sujet à son insu, et cela semble d’autant plus fort que ces transformations sont comprises comme des modifications du fonctionnement du « cerveau ». Marjanne a décidé elle-même d’arrêter de prendre « après deux, trois mois » les antidépresseurs que lui avait « tout de suite prescrit » un psychiatre :
Mais les médicaments, ça me stresse énormément en fait, je suis pas tranquille avec l’idée qu’on touche à la chimie de mon cerveau, ça me pose un problème, ça me fait peur en fait. Que ça entraîne des modifications de la personnalité, je sais pas…
On voit ici que la perception des effets possiblement délétères des médicaments est liée au souci de préservation de l’authenticité et de l’intégrité personnelles. Même conçue comme une maladie, la dépression reste une maladie du « soi », ce que contribue à expliquer la méfiance à l’égard de sa médication dans la mesure où celle-ci n’agirait pas simplement sur une série de symptômes strictement physiques. La représentation de l’insuffisance ou du danger du traitement psychotrope vient ainsi donner toute sa légitimité à une démarche introspective.
La règle persistante mais revisitée du travail sur soi
Si l’on peut considérer que l’on assiste à partir des années 1970, avec la constitution de la « culture psychologique » (Castel, 1981), à une forme de démocratisation de l’introspection personnelle, il faut souligner que le « travail sur soi » est devenu la condition par laquelle le sujet est reconnu dans sa capacité à « produire sa vie » (Vrancken et Macquet, 2006 : 9).
La France se distingue par le poids particulier qu’a longtemps eu la psychanalyse, y compris dans son influence sur les autres psychothérapies. Dans les années 1990, cette donne, visiblement, change. Pour notre propos, nous soulignerons quatre tendances marquant ce changement et se répondant entre elles : la valorisation d’un modèle empirico-scientifique pluraliste ; la disqualification des lectures interprétatives systématiques ; l’éclectisme des pratiques et, enfin, l’affirmation de la supériorité de la fin (le mieux-être, la guérison) sur les moyens (les modalités psychothérapeutiques). La représentation d’une pluralité de causes possibles – et souvent entremêlées – à la dépression est évoquée par tous les interviewés : elle peut selon nous constituer une équivalence dans le langage commun du modèle bio-psycho-environnemental prédominant en santé publique. Une certaine égalisation s’opère ainsi entre ces différents niveaux :
[…] j’ai un ami profondément dépressif qui est sous médicaments et je discutais avec lui et il dit qu’il est comme ça depuis qu’il est né, et apparemment il y a une vraie carence dans les neurotransmetteurs […] il y a des gens pour qui ce n’est pas des traumatismes ou des choses psychologiques, mais qu’il y a des vrais problèmes de constitution. Je pense qu’il y a les deux, je n’aime pas forcément l’idée de trancher.
Anna
Peut-être que pour certains c’est plus la chimie du cerveau qui joue et pour d’autres c’est plus les circonstances… j’aurais du mal à mettre un mot et dire que ça s’applique pour tout le monde.
Élise
Toute la légitimité est par conséquent donnée à l’extension des réponses thérapeutiques, bien au-delà du champ de la médecine et de celui des psychothérapies classiques, afin de répondre aux besoins spécifiques des individus :
Après, il y en a aussi qui s’en sortent par le sport ou par d’autres méthodes alternatives, et pas forcément par la psychothérapie, il faut que chacun y trouve son compte aussi et trouve ce qui lui va.
Anna
Dans cette optique, les approches théoriques qui proposent une lecture systématique ou idéologique du fonctionnement psychique perdent leur crédibilité. On ne peut ici rendre compte de l’ensemble des phénomènes significatifs du retrait de la psychanalyse comme premier pilier d’une « grammaire de la vie intérieure » qui se constitue depuis les années 1960 (Ehrenberg, 1998 : 125). En revanche, les récits individuels mettent en évidence certains des réseaux de significations à partir desquels s’élabore la critique sociale. Ils peuvent consister tout d’abord en une méfiance à l’égard d’éléments de pratique et de discours représentatifs dans l’opinion d’une psychanalyse « pure », comme le montre la remise en cause de théories emblématiques, qui ont été des vecteurs de son ancrage dans le savoir commun. Tel est le cas par exemple du « complexe d’Oedipe » dont parle ici Franck, engagé dans une psychothérapie humaniste, mais ayant d’emblée refusé le recours à la psychanalyse, qui, bien qu’elle ait représenté selon lui une « avancée dans la connaissance de l’humanité, se rendre compte qu’il y avait un inconscient », reste « très dogmatique » :
[…] cette histoire de complexe d’Oedipe, j’ai toujours senti ça comme étant… si vous dites ça à un psychanalyste, il vous dira que justement il faut travailler là-dessus, parce que vous avez un problème, quoi ! On peut pas rentrer dans une discussion, c’est une vérité pour eux, et si vous la croyez pas, c’est que vous avez un problème, donc, bon, moi j’ai un peu de mal avec ça
Franck, 54 ans, ingénieur
Ce type de critique n’est donc pas fortuit, car il vient pointer le décalage entre le modèle anthropologique émanant de la psychanalyse et des normes caractérisant la personnalité contemporaine. Un point d’achoppement majeur étant le voile de suspicion que la psychanalyse jette sur les motivations profondes du sujet, et donc l’irréductible ambivalence de celui-ci, tandis qu’est désormais prégnante l’idée que l’individu troublé est d’abord une victime et que la poursuite du bonheur « ici et maintenant » ne peut qu’être entravée par le sentiment de culpabilité. À cet égard, il est étonnant de constater que, si les modalités psychothérapeutiques, comme la spécificité des professionnels qui les pratiquent, restent le plus souvent indifférenciées et méconnues, la psychanalyse peut venir incarner un contre-modèle à la conception que les individus se font d’une prise en charge globale de leur mal. Elle seule peut faire l’objet d’une véritable critique discutant non seulement son efficacité, mais aussi le caractère doloriste de la cure analytique. Les propos de Stéphane en rendent compte, dont l’expérience d’une dépression chronique l’a finalement conduit à se former par des stages à plusieurs méthodes, puis à s’installer en tant que psychothérapeute :
Je dirais que je suis comme le livre brûlot de la psychanalyse, là, pour moi c’est une quasi-aberration […] La peur, la souffrance, voilà on vit avec, mais comme c’est agréable de s’en débarrasser ! Je vois pas l’intérêt d’aller se faire mal avec des trucs du passé, et de ne jamais amener le fait d’aller mieux [….] La prise en charge thérapeutique pour moi doit autonomiser le patient ou le client. Et ce que je vois de l’analyse, c’est une sacrée dépendance ! Faire une thérapie orientée solutions, c’est tellement mieux !
Stéphane, 47 ans, praticien en psychothérapie
Mais c’est aussi beaucoup en référence aux bienfaits d’un travail sur le corps et les émotions, procurant un mieux-être immédiat, que sont pointées les insuffisances de la psychanalyse « pure » :
Celle [la thérapeute] que je vois actuellement, c’est beaucoup plus moderne. Enfin… c’est d’inspiration analytique, mais elle inclut un travail corporel, il y a un travail de groupe […] je peux être allongée des fois, il y a de la relaxation, y a des jeux de rôles, y a de la visualisation, plein de choses…
Gisèle
[La dépression] c’est une grande souffrance physique, parce que j’ai des symptômes au niveau respiratoire, on se resserre, les énergies ne circulent plus. À un moment, j’étais suivie par une acupunctrice pour que j’aie plus de fluides, et j’ai beaucoup regretté qu’on n’ait pas répondu à ces demandes quand j’étais en analyse. J’ai souvent été en demande d’une aide par rapport à cette souffrance physique, de relaxation, de quelque chose au niveau du corps, de prendre en compte mon corps, voilà.
Bien que la psychanalyse soit toujours influente, l’esprit des critiques qui lui sont adressées, tant dans les débats médiatiques et intellectuels que dans les récits individuels, indique le sens des évolutions des règles du travail sur soi. Avec le retrait de l’anthropologie analytique, Gauchet notait ainsi que déclinaient « la visée d’élucidation » et la « valeur de vérité » ; il ne s’agirait plus d’« être au clair avec soi-même » de manière à « agir avec volonté et liberté intérieure », mais « de ne pas être entravé, consciemment ou inconsciemment, dans la saisie des opportunités qui se présentent au-dehors » (Gauchet, 2002 : 254-255). Évolution qui n’est donc pas étrangère à la reconsidération des missions de la psychothérapie à laquelle travaillent les politiques de santé publique. Les deux niveaux soutiennent en effet un modèle de thérapie psychologique déterminé par la « négociation avec les symptômes et l’efficacité comportementale » (ibid.). Dès lors, le statut du « psy » s’en trouve, lui aussi, réévalué. Si ces professionnels sont de plus en plus appelés par les nouvelles politiques de santé mentale à appliquer des protocoles thérapeutiques, menacés de devenir alors de simples techniciens, la qualité de la « relation » reste privilégiée par les individus. « Le courant doit passer », affirment-ils tous, en même temps qu’est redit le refus des « interprétations rigides » :
C’est la personne [qui compte]. Mon choix, c’est simple, ça colle ou ça colle pas, la méthode, je m’en fous. Sauf la psychanalyse, parce que ça veut dire que quelque part il aura intégré une pensée dogmatique. Pour moi, c’est figé et c’est quelqu’un qui aura du mal à changer et à adapter son point de vue. La psychiatre que je voyais, j’ai senti que ça coincerait avec moi, donc j’ai pas insisté. Enfin, il faut vraiment un contact qui se passe avec la personne.
Franck, 54 ans, ingénieur
Se voulant ouverts sur la question des modalités et méthodes thérapeutiques, les individus attendent surtout du « psy » qu’il soit un « guide » se situant d’égal à égal avec son patient. Thomas a trouvé la personne avec laquelle il se « sentait à l’aise » et s’« entendait bien » dans un centre de « psychothérapie organique[2] » qui lui avait été conseillé par un proche, faisant le lien « entre des émotions corporelles et notre intellectuel, entre le corps et l’esprit » :
En fait, elle n’a jamais de prétention, c’est-à-dire qu’elle n’a jamais dit c’est comme ça ou c’est à cause de ça, etc., elle m’a toujours fait des propositions en me disant surtout qu’elle ne détenait pas la vérité et qu’on allait plutôt la trouver ensemble. Elle m’a plutôt accompagné dans ma réflexion que dirigé réellement. C’est moi qui donnais les directions, et elle qui me disait si c’était les bonnes.
Il est attendu que le thérapeute montre son implication en engageant sa propre subjectivité. Ainsi Coralie apprécie-t-elle que sa thérapeute actuelle n’adopte pas la « neutralité bienveillante » des psychanalystes précédemment consultés :
[…] ce qui m’avait bouleversée, c’était pendant la 1re séance, je parle de moi et j’ai vu dans ses yeux qu’elle était touchée et elle m’a dit “ça me touche beaucoup, ce que vous dites”. Jamais c’était arrivé avant, la thérapeute avant me donnait pas ses opinions et encore moins ses émotions. Là, j’ai une personne en face de moi et ça change tout quoi, ça a rien à voir.
La capacité du thérapeute à mobiliser différentes méthodes est interprétée comme un gage supplémentaire de son ouverture, de son accessibilité, en d’autres termes de sa capacité à proposer une thérapie psychologique sur mesure. L’utilisation de techniques psychocorporelles facilite la perception d’un tel ajustement. Il n’est à cet égard guère étonnant que la relaxation, la respiration, la méditation et autres exercices identifiables aux traditions orientales prospèrent au-delà des psychothérapies humanistes « alternatives[3] » et soient aujourd’hui utilisés par les thérapies cognitives comportementales (TCC) de « troisième génération » (Garnoussi, 2011) :
J’ai tâté de la psychiatrie comportementale, peu, mais ce psychiatre qui me faisait des séances de relaxation, il était en fait dans cette voie. La relaxation, ça m’avait bien aidée. Je travaille aujourd’hui sur la respiration, parce que de toute façon j’ai toujours ce problème, dès que je me mets en état de stress.
Gisèle
Si le façonnage social actuel de la santé mentale se montre favorable au développement d’une médecine psychologique dont participent des techniques dérivées des neurosciences, certains ingrédients des psychothérapies classiques restent déterminants : tel est le cas de la « relation » qui s’établit avec le thérapeute, des vertus libératoires prêtées à la « parole » et à l’« échange », ainsi que de l’investigation de l’« histoire » personnelle et de la mémoire familiale. Cela limitant de fait l’autorité des réponses strictement médicales et « asubjectives » :
C’est ça que ma psy m’a expliqué, il y a un vrai mécanisme de dépression, qui n’est pas le même pour tout le monde, mais il y a quand même quelque chose qui est commun, alors que vous, vous avez l’impression que c’est que vous. Du coup, le diagnostic, c’est comme s’il était inadapté, en fait. Votre dépression, c’est pas « La » dépression, c’est autre chose.
Marjanne
La revendication de la singularité du vécu dépressif légitime ainsi la diversification des pratiques pour le travail sur soi. Non simple accident qu’un traitement efficace pourra rapidement faire oublier, les acteurs intègrent pleinement « leur » dépression à leur parcours biographique. Cela est d’autant plus vrai lorsque la psychothérapie est perçue comme une démarche d’exception concourant de façon essentielle à la construction personnelle. Et s’ils sont nombreux à décrire un état de « fragilité » psychique avec lequel ils auraient à vivre « pour toujours », ils évoquent souvent un horizon de progrès par rapport auquel les épreuves existentielles gagnent une valeur en termes d’apprentissage et de renforcement de l’intériorité. Est alors mis en évidence un paradoxe constitutif de l’individualité contemporaine, réflexive et incertaine. Comme incapacité à agir, la dépression constitue une réponse négative à l’injonction de performance (Ehrenberg, 1998). Mais elle est également conditionnée par les normes de l’individualisme positif, voulant que l’individu dépasse ses limites et se transforme, ce dont la sortie de la « maladie » peut témoigner si elle s’est accompagnée de réaménagements visibles :
C’est une phase de vie qui est intense, parce que la dépression, c’est intense, même si ça ressemble à du vide, finalement, c’est un vide d’une intensité folle […] Et pour moi, c’est quelque chose de l’ordre de la remise en cause, de ce qu’on est, de ses valeurs, de ses croyances, de sa vie, c’est un moment où tout s’effondre, mais ce que j’ai vécu est quelque chose qui m’a changé fondamentalement. Quand je serai sorti de ça, je ne serai plus, et c’est déjà le cas, je ne suis plus celui que j’étais avant .
Franck
Conclusion
La rationalisation du vécu dépressif est un analyseur des nouveaux schèmes sociaux par lesquels sont appréhendés les troubles psychiques courants. Ces troubles, inscrits désormais dans la vie sociale ordinaire, viennent traduire et organiser des expressions d’une souffrance psychique diffuse qui brouille la logique distinguant la détresse psychologique « normale » de l’affliction « pathologique ». La tendance à instituer un continuum entre ces différents états peut être vue comme relevant d’une psychologisation-psychiatrisation du social, thèse qui marque le débat autour des « nouveaux symptômes » (Demailly, 2011) et que l’on peut étendre à la relation à soi. En revanche, ce durcissement du sens des troubles courants qui s’observe également dans les évolutions des offres thérapeutiques avec la montée des TCC (Pilgrim, 2011) ne réduit pas la diversité des raisons et des formes de souffrance et de mal-être que la dépression canalise. Peut-être est-ce là l’une des explications à la démultiplication problématique des dénominations pathologiques, comme autant d’offres de traduction, dans le langage socialement légitime de la maladie, de ce qui se joue dans les fors intérieurs.
Appendices
Notes
-
[1]
Selon A. Giddens, « la construction du moi en tant que projet réflexif », qu’il considère comme un « constituant fondamental de la réflexivité de la modernité », implique que l’individu « doit trouver son identité parmi des stratégies et des options fournies par des systèmes abstraits » (Giddens, 1994 : 130).
-
[2]
Thérapie psychocorporelle qui se veut au croisement de la psychanalyse, de la psychologie humaniste et d’un travail sur les «énergies» et les émotions.
-
[3]
Issues de la psychologie humaniste formée à la fin des années 1950 aux États-Unis. Diversifiées, elles visent le développement du potentiel humain et proposent une approche holiste qui intègre un travail de type spirituel, puisant en particulier dans les traditions orientales.
Bibliographie
- Berger, Peter et Thomas Luckmann. 1986. La construction sociale de la réalité. Paris, Méridiens, Klincksieck.
- CASTEL, Robert.1981. La gestion des risques. Paris, Minuit.
- Champion, Françoise (dir.). 2008. Psychothérapie et société. Paris, Armand Colin.
- CLAIN, Olivier. 2007. « Les mots des maux. Les discours contemporains sur la souffrance », Aporia. Paris : 14-21.
- DEMAILLY, Lise. 2011. Sociologie des troubles mentaux. Paris, La Découverte.
- Dorvil, Henri. 2006. « Prise de médicaments et désinstitutionnalisation », dans Johanne Collin, Marcelo Otero et Laurence Monnais (dir.). Le médicament au coeur de la socialité contemporaine : regards croisés sur un objet complexe. Montréal, PUQ.
- Ehrenberg, Alain. 2004. « Les changements de la relation normal-pathologique. À propos de la souffrance psychique et de la santé mentale », Esprit, mai, 133-156.
- Ehrenberg, Alain. 1998. La fatigue d’être soi. Dépression et société. Paris, Odile Jacob.
- Fainzang, Sylvie. 2001. Médicaments et société. Paris, PUF.
- Fassin, Didier. 2005. Faire de la santé publique. Rennes, Éditions ENSP.
- GARNOUSSI, Nadia. 2011. « Le Mindfulness ou la méditation pour la guérison et la croissance personnelle : des bricolages psychospirituels dans la médecine mentale », Sociologie, 3, 2 : 259-275.
- Gauchet, Marcel. 2002. La démocratie contre elle-même. Paris, Gallimard.
- Giddens, Anthony. 1994. Les conséquences de la modernité. Paris, L’Harmattan.
- Herzlich, Claudine. 1969. Santé et maladie. Analyse d’une représentation sociale. Paris, Mouton.
- Jodelet, Denise. 2006. « Place de l’expérience vécue dans le processus de formation des représentations sociales », dans Valérie Hass (dir.). Les savoirs du quotidien. Transmission, appropriations, représentations : 235-255.
- Le Moigne, Philippe. 2009. « Entre maladie et mal-être : la prescription des médicaments psychotropes en médecine générale », Sociologie Santé, 30 : 243-265.
- MISSA, Jean-Noël. 2006. Naissance de la psychiatrie biologique. Histoire des traitements des maladies mentales au XXe siècle. Paris, PUF.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. 2004. Investir dans la santé mentale. Genève, OMS.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. 2001. Rapport sur la santé dans le monde : La santé mentale : nouvelles conceptions, nouveaux espoirs. Genève, OMS.
- Pilgrim, David. 2011. « The hegemony of cognitive-behaviour therapy in modern mental health care », Health Sociology Review, 20, 2 : 120-132.
- Thurin, Jean-Michel. 2010. « Psychanalyse et psychothérapie », EMC (Elsevier Masson SAS), Psychiatrie, 37-810-F-50.
- VELPRY, Livia. 2008. Le quotidien de la psychiatrie. Sociologie de la maladie mentale. Paris, Armand Colin.
- Vidal, Fernando et Francisco Ortega. 2011. Neurocultures. Glimpses into an Expanding Universe. Frankfurt, Peter Lang.
- VRANCKEN, Didier et Claude MACQUET. 2006. Le travail sur soi. Vers une psychologisation de la société ? Paris, Belin.
- WEBER, Max. 1971 (1922). Économie et société, 1. Paris, Plon.