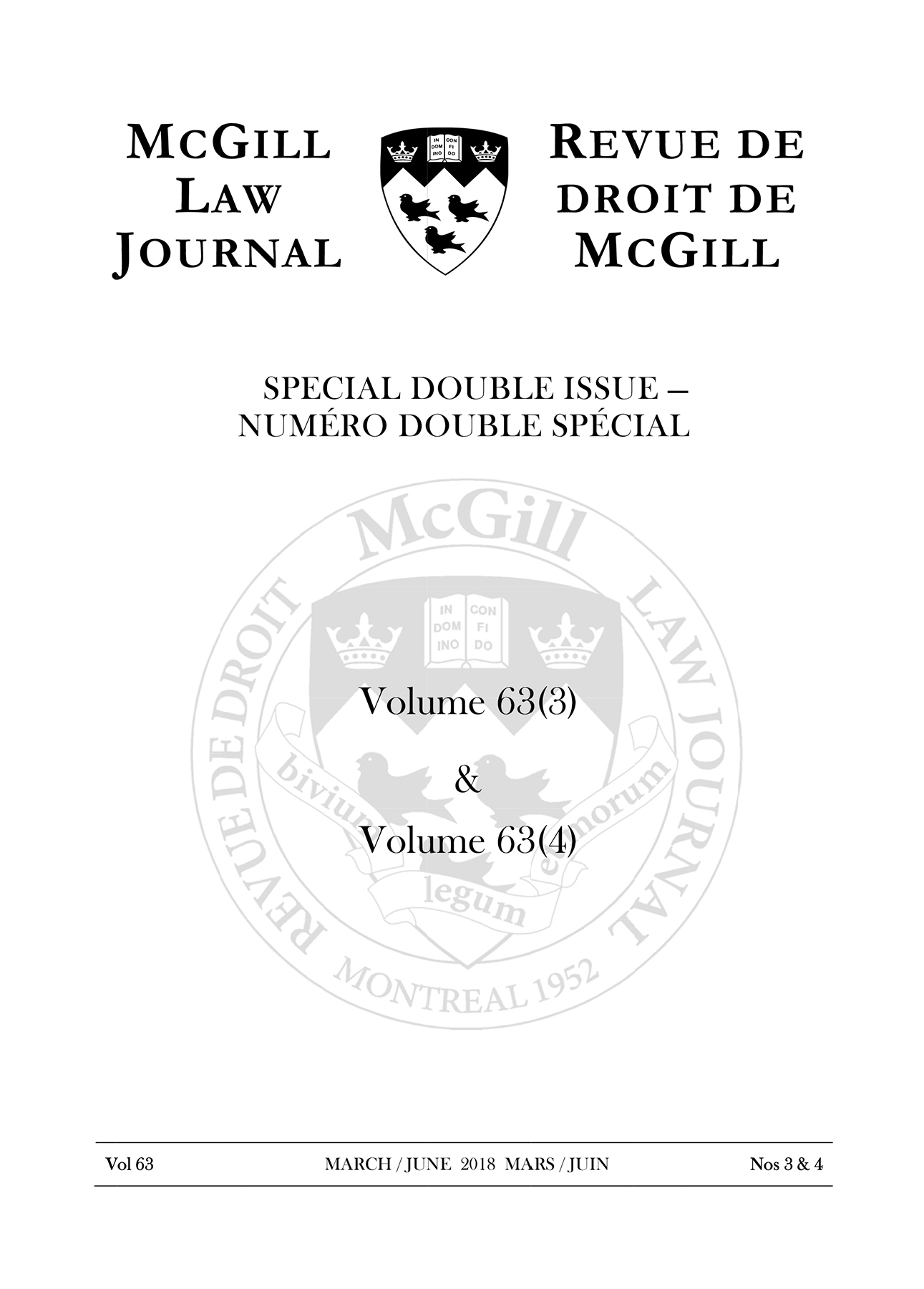Abstracts
Résumé
Quand des couples pratiquants juifs ou musulmans se marient dans des pays occidentaux, les cérémonies comprennent souvent un aspect civil et un aspect religieux, ce qui les place à la fois dans un espace culturel et juridique unique. Selon les lois religieuses, les époux et les épouses ont généralement des droits et des responsabilités distincts au sein du mariage. Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que la littérature abonde au sujet des effets différenciés selon le sexe du droit de la famille religieux dans les pays occidentaux. Il serait pertinent de voir quelle est la réalité vécue par les femmes dans le cas d’un mariage ou d’un divorce, qu’il soit civil ou religieux. Est-ce que les règles dictées par la religion interagissent avec le droit civil de manière à permettre aux femmes d’accéder à des recours juridiques? Ou leur imposent-elles davantage de restrictions?
Cet article vise à examiner le rôle réel des règles religieuses dans la vie sociale des sujets de droit et à évaluer leur interaction avec le droit civil dans un contexte comparatif et transnational. Pour ce faire, j’ai rassemblé des témoignages de femmes qui ont vécu des divorces civils et religieux en tant qu’actrices sociales. Si le droit et la culture sont des espaces sociaux contestés, ces réalités peuvent tout de même coexister et permettre aux femmes de minorités religieuses de tirer certains avantages, y compris dans un contexte laïque. En se basant sur des enquêtes sociojuridiques menées sur le terrain auprès de femmes juives et musulmanes qui ont vécu des divorces religieux et civils, en Angleterre et en France, cet article utilise le vocabulaire et les fondements théoriques du droit comparatif et des théories du transsystémisme pour mettre en lumière le pouvoir et la connaissance des femmes en lien avec le divorce. Ce texte, au regard critique, a pour objectif d’amener les nations occidentales à réfléchir et à participer à l’élaboration de politiques plus légitimes et uniformes que celles qui existent à l’heure actuelle.
Abstract
When Jewish or Muslim practicing couples marry in Western countries, the ceremonies are often comprised of civil aspect and religious elements, which places them in both a unique cultural and legal space. According to religious laws, husbands and wives generally have distinct rights and responsibilities within the marriage. In this context, it is hardly surprising that the literature abounds about the gender-differentiated effects of religious family law in Western countries. It would be relevant to see what is the reality experienced by women in the case of a marriage or divorce, whether civil or religious. Do the rules dictated by religion interact with the civil law so as to allow women to have access to legal remedies? Or do they impose more restrictions on them?
This article aims to examine the real role of religious rules in the social life of legal subjects and to assess their interaction with civil law in a comparative and transnational context. To do this, I collected testimonials from women who have experienced civil and religious divorces as social actors. If law and culture are contested social spaces, these realities can still coexist and allow women of religious minorities to reap some benefits, including in a secular context. Based on on-the-ground, socio-legal surveys of Jewish and Muslim women who have experienced religious and civil divorces in England and France, this article uses the vocabulary and theoretical underpinnings of comparative law and theories of transsystemia to highlight the power and knowledge of women in connection with divorce. This text, with a critical eye, aims to have Western nations reflect on and participate in the development of more legitimate and uniform policies than those that currently exist.
Article body
Nous sommes à un moment où le monde s’éprouve [...] moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau. Peut-être pourrait-on dire que certains des conflits idéologiques qui animent les polémiques d’aujourd’hui se déroulent entre les pieux descendants du temps et les habitants acharnés de l’espace[1].
Introduction
En Angleterre, le droit de la famille juif est reconnu par l’État dans la loi de 1949 sur le mariage (Marriage Act, 1949[2]). En revanche, le droit de la famille musulman ne l’est pas encore : un projet de loi pour modifier le Marriage Act, 1949, et visant à reconnaître la validité — sous certaines conditions de forme — de mariages religieux sans égard à la confession, est à l’examen depuis le 10 juillet 2017 devant la Chambre des lords britanniques[3]. En attendant que ces changements soient entérinés, les musulmans doivent « se marier deux fois » pour obtenir la reconnaissance de l’État : avec une cérémonie laïque au civil pour enregistrer le mariage, d’une part, et avec une cérémonie religieuse ou traditionnelle selon les rites de la communauté, d’autre part[4]. Les tribunaux anglais ont toujours été réticents à l’idée de s’immiscer dans l’arbitrage de disputes au sein de groupes religieux, une pratique qui peut être considérée comme découlant d’un principe de non-ingérence[5]. Cette asymétrie influence de manière importante le rapport que les femmes issues de ces deux groupes religieux entretiennent avec la société civile et elle nous offre également une belle occasion de vérifier quels sont les effets d’une reconnaissance juridique de la culture pour les femmes juives et musulmanes.
En France, la laïcité a donné lieu à des débats interminables et très médiatisés sur les frontières entre l’Église et l’État. Elle est d’ailleurs sans cesse invoquée par les intellectuels de toute allégeance politique pour justifier des projets juridiques et politiques controversés. Plus précisément, la laïcité est au coeur de deux débats qui sont étroitement liés : celui de la place de la religion dans un État laïque et celui de l’effet des normes religieuses sur l’égalité des droits des femmes. À la base, on considère que la laïcité signifie qu’il y a neutralité religieuse et non-établissement d’une religion[6], des caractéristiques qu’elle partage avec ce qu’on appelle le « sécularisme » dans d’autres pays[7]. Cependant, depuis une dizaine d’années, on a tendance à considérer que la laïcité exige de la religion qu’elle relève uniquement de la sphère privée des croyances personnelles, à l’extérieur du « domaine public »[8], qui doit être neutre et universel. En vertu de cette approche, les croyances religieuses sont (et doivent être) subjectives et privées, tandis que la citoyenneté et le droit sont les ancrages objectifs d’une universalité qui regroupe les individus[9]. Dans cet esprit, la laïcité s’articule autour de l’idée que la religion ne doit surtout pas s’ériger sous forme de règles ou de normes sociales reconnues et légitimées par l’État.
Quand des couples pratiquants juifs ou musulmans se marient dans des pays occidentaux, les cérémonies comprennent souvent un aspect civil et un aspect religieux, ce qui les place à la fois dans un espace culturel[10] et juridique. Selon les lois religieuses, les maris et les femmes ont des droits et des responsabilités distincts au sein du mariage. Quand un mariage se brise, l’accès au divorce religieux est très différent selon le sexe de la personne[11]. La vulnérabilité des femmes attribuable au droit de la famille traditionnel ou religieux a d’ailleurs été soulevée et analysée par de nombreux auteurs[12]. Les chercheurs ont remarqué que les femmes qui font partie de communautés religieuses « subissent davantage de restrictions quant au droit au mariage, au droit de transmettre leur nationalité ou leur appartenance à leurs enfants, à l’accès au divorce, à la situation financière et à la possibilité d’obtenir la garde de leurs enfants » [notre traduction][13].
Dans le droit de la famille musulman, les femmes peuvent avoir recours au divorce khul ou faskh, mais pas au divorce talaq[14]. La femme peut faire une demande de divorce khul devant un juge, mais ce faisant elle acquitte le mari de l’obligation de payer le montant différé du mahr, montant que le mari doit laisser à sa femme au moment du divorce[15]. Le divorce faskh est un divorce pour faute, demandé par la femme devant un tribunal islamique, et il est limité à des motifs très restreints[16]. Le divorce talaq (répudiation), quant à lui, est un acte unilatéral qui dissout le contrat de mariage par la seule déclaration du mari[17].
Le droit de la famille juif comporte aussi des désavantages pour les femmes. Pour qu’un mariage juif soit conforme à la Halakha[18], il ne peut se défaire qu’au moment de la mort d’un des époux ou si le mari accorde le divorce (get)[19] et que sa femme l’accepte[20]. Ainsi, le mari est le seul à avoir le droit d’accorder le get[21]. Si une femme juive veut recourir au get, mais que le mari refuse de le lui octroyer, elle sera considérée comme une agunah (pl. agunot)[22]; littéralement, une femme « enchaînée » ou « ancrée »[23]. Si une femme agunah se marie civilement, la relation sera considérée comme adultère selon la loi juive[24]. Elle ne pourra donc jamais conclure de mariage religieux avec son nouveau conjoint[25]. De plus, un enfant né de cette nouvelle union sera considéré comme un mamzer (pl. mamzerin)[26]. Ces enfants illégitimes sont « exclus de fait du judaïsme organisé » [notre traduction][27] et ne pourront se marier qu’avec un autre mamzer.
Ces derniers temps, la littérature abonde sur la question des effets différenciés selon le sexe du droit de la famille religieux dans les pays occidentaux[28]. Il est intéressant de voir quelle est la réalité vécue par les femmes dans le cas d’un mariage ou d’un divorce, qu’il soit civil ou religieux. Est-ce que les règles dictées par la religion interagissent avec le droit civil de manière à donner aux femmes accès à des recours juridiques? Ou leur imposent-elles davantage de restrictions? Dans le but de dresser un tableau le plus complet et exact possible, nous présenterons dans cet article des femmes qui ont vécu des divorces civils et religieux en tant qu’actrices sociales[29]. Nous démontrerons ainsi que le droit et la culture sont des espaces sociaux contestés qui, lorsqu’ils entrent en interaction, peuvent être — et le sont d’ailleurs parfois — manipulés par les femmes religieuses à leur avantage, y compris dans un contexte laïque. En se basant sur des enquêtes sociojuridiques menées sur le terrain auprès de femmes juives et musulmanes qui ont vécu des divorces religieux et civils, en Angleterre et en France, cet article utilise le vocabulaire et les fondements théoriques du droit comparatif pour mettre en lumière le pouvoir et la connaissance des femmes en lien avec le divorce.
De manière plus spécifique, cet article vise à examiner le rôle réel des règles religieuses dans la vie sociale des sujets de droit et à évaluer leur interaction avec le droit civil dans un contexte comparatif et transnational. Pour ce faire, nous présentons des données issues de recherches et d’entrevues menées sur le terrain en France et en Angleterre auprès de femmes juives et musulmanes, de 2011 à 2013. Nous présentons une analyse comparative dans laquelle la culture et le droit sont mutuellement constitutifs et où ils façonnent le bien-être économique et les positions de négociation des parties. L’étude de femmes juives et musulmanes en Angleterre offre la possibilité de vérifier l’hypothèse selon laquelle dès lors que la religion et le droit civil sont en interaction, on arrive à une meilleure légalisation des normes religieuses grâce à la reconnaissance par l’État et le dialogue juridique internormatif. Cette idée se trouve mieux étayée lorsque l’on établit une comparaison avec la France, où les mariages religieux sont reconnus par l’État pour autant qu’ils soient précédés d’une cérémonie civile. Il est évident que la culture devient plus contestable, souple et légaliste quand il y a reconnaissance. Nous allons démontrer comment, lorsque l’État laïque légalise, dans une certaine mesure, l’interaction entre les coutumes et les droits religieux et civils, les avantages et les protections qu’en retirent les femmes de minorités religieuses leur permettent d’améliorer leur bien-être économique et leur position de négociation.
Dans la première partie, nous allons situer cet article dans la littérature sur le pluralisme juridique. Nous allons adopter la méthodologie « pluraliste juridique critique » qui tend à décentrer le concept du droit de manière à prendre en compte ses effets sur la constitution d’un sujet et son ouverture à la transformation par les sujets de droit. De plus, nous nous intéressons dans cette étude au rôle distributif du droit et de la culture et nous y conceptualisons à la fois le droit étatique et les normes culturelles en tant que règles d’arrière-plan de la négociation socio-économique.
Dans la deuxième partie, nous présentons les résultats de la recherche sur le terrain et, grâce au parallèle entre, d’une part, la reconnaissance du mariage juif en Angleterre et la reconnaissance civile des mariages juifs et musulmans en France et, d’autre part, la non-reconnaissance du mariage musulman par le droit anglais, nous élaborons l’hypothèse que la reconnaissance du mariage religieux entraîne des conséquences tant sur la subjectivité des femmes de ces religions que sur les effets distributifs du droit. La recherche sur le terrain me permet d’explorer la reconnaissance du droit religieux par l’État, en mettant l’accent sur la dimension juridique de la religion et en présentant une vision de la religion/culture comme étant réceptive aux stratégies, aux recours et aux autres négociations individuelles que l’on associe habituellement au droit civil. À l’inverse, la non-reconnaissance des normes religieuses et le fait de les limiter à la sphère privée et non juridique semblent renforcer l’idée (erronée) de la religion comme étant réduite au statut, à la soumission et à une identité figée, phénomène qui occasionne des conséquences distributives négatives pour les femmes.
Ma recherche sur le terrain a clairement démontré que, pour les participantes, les droits religieux et civil peuvent s’avérer tous deux désavantageux lorsque compris et vécus de manière séparée. Nous allons par ailleurs établir que s’il y a interaction entre les deux systèmes, cela a pour effet de redonner du pouvoir aux femmes de minorités religieuses. En fait, il semble que la religion crée davantage d’autonomie lorsqu’elle évolue en collaboration avec le droit civil et que celui-ci l’influence[30]. Cette hypothèse est issue d’une évaluation comparative des communautés juive et musulmane d’Angleterre dont les normes juridiques sont considérées de manière très différente par le droit civil anglais. Si le droit familial judaïque est reconnu par l’État anglais, le droit musulman ne l’est pas, ayant pour conséquence que les communautés et les femmes musulmanes se trouvent à l’écart de la sphère civile. L’expérience vécue par les femmes juives et musulmanes en France, où les mariages religieux sont criminalisés s’il n’y a pas eu d’abord de mariage civil, vient étayer cette thèse.
Nous examinons les répercussions de ce phénomène sur (1) les perceptions subjectives de la religion, (2) les stratégies concrètes adoptées par les femmes en ce qui concerne une argumentation juridique substantielle, (3) les décisions des autorités religieuses (si elles tiennent compte, par exemple, des conséquences sur le plan civil et si elles veillent à l’application des dispositions financières religieuses) et, finalement, (4) les conséquences économiques qui découlent de l’interaction de la culture et du droit. Nous allons conclure en soulignant le fait que, pour les groupes de femmes religieuses, une interaction entre les normes sociales laïques et religieuses et les traditions est ce qui est le plus à leur avantage et ce qui leur apporte le soutien et les recours dont elles ont besoin à une époque difficile sur le plan religieux et économique.
Nous tenons à préciser dès le départ que notre recherche ne vise en aucune façon à démontrer que la religion musulmane est inférieure à la religion juive. Les résultats de nos entrevues avec des femmes de ces deux groupes religieux ont fait ressortir toutefois une inégalité dans ce qui est ressenti et vécu découlant de la non-reconnaissance juridique inscrite dans la tradition contractuelle du mariage. Nous souhaitons mettre en lumière cette inégalité dans l’espoir que cela mènera les nations occidentales, qui ne savent pas encore comment inclure les normes laïques et les traditions religieuses dans un dialogue social qui mène à la cohésion, à l’élaboration de politiques plus légitimes et uniformes que celles qui existent à l’heure actuelle.
I. Nouvelle approche de l’étude du droit et de la culture
Cet article utilise le pluralisme juridique critique comme cadre méthodologique et théorique pour mettre l’accent sur la construction subjective du droit par les sujets de droit[31]. Le pluralisme juridique est très utile pour bien saisir la complexité des interactions des femmes de minorités religieuses avec la « culture ». Le pluralisme juridique critique affirme que le droit inclut « la façon dont les sujets de droit se perçoivent eux-mêmes et perçoivent le droit » [notre traduction][32]. Pour les pluralistes juridiques critiques, « le droit provient de tous, appartient à tous et répond à tous »[33], et l’on ne doit pas comprendre le droit uniquement par le biais des outils ontologiques de « l’évangélisme juridique », qui « engendre un assujettissement aux rituels, au catéchisme et aux principes des institutions officielles qui s’attachent aux mots (plus particulièrement aux déclarations sans appel du tribunal qui trône au sommet d’une hiérarchie institutionnelle) » [notre traduction][34].
Roderick A. Macdonald, un pionnier de la théorie du pluralisme juridique au Québec, explique que l’intérêt du pluralisme réside précisément dans la façon dont cette approche révèle l’influence des divers ordres juridiques autonomes et concurrentiels qui informent notre environnement social. En relativisant l’ordre juridique étatique, l’hypothèse du pluralisme nous permet de voir comment celui-ci cache à première vue les autres ordres juridiques concurrents[35]. Ce faisant, on est à même de constater que tout ordre juridique est constitué d’abord par la praxis du sujet et, ensuite, que l’expérience de la coercition n’épuise pas le phénomène juridique[36].
Le pluralisme juridique critique de Macdonald repose donc sur deux postulats centraux: premièrement, le sujet est créateur de l’espace de droit; deuxièmement, ce premier postulat nous amène à constater que le droit n’est pas qu’un donné positif. Cette analyse a pour but de remettre en cause les thèses qui réduisent le droit à la production positive de lois émanant d’un seul sujet — l’État. Le pluralisme juridique opère à cet égard un véritable renversement copernicien, remettant le sujet au centre de l’analyse, en montrant « que le sujet de droit est celui qui rend possible le fonctionnement de toutes les institutions juridiques — étatiques ou autres — en leur accordant leur légitimité »[37].
Dans ses recherches sur le pluralisme juridique, Macdonald observe que le sujet constitue un outil plus riche et plus ancré dans le réel pour examiner les institutions, à plus forte raison le droit. Les sujets — individus, institutions, groupes et familles — sont sources et récepteurs de normativité, et leurs interactions doivent être examinées afin de comprendre comment ces différents ordres influencent l’ordre civil. Macdonald souligne à cet égard : « Cette approche ne permet pas des distinctions nettes entre la normativité (en fait nous devrions dire les normativités) de l’État et les normativités de la société civile. Le pluralisme conçoit toutes ces normativités comme des ordres juridiques »[38]. De ce point de vue, les sujets de droit façonnent et construisent le droit tout autant que le Parlement par leur créativité constructive et leurs relations interpersonnelles normative[39]. Comme l’expliquent Kleinhans et Macdonald :
Les sujets de droit ne sont pas entièrement déterminés; ils possèdent une capacité de transformation qui leur permet de produire de la connaissance juridique et de façonner les structures du droit qui contribuent à construire leur subjectivité juridique. Cette capacité de transformation est directement liée à leur particularité substantielle. Cela confère aux sujets de droit la responsabilité de participer aux différentes communautés normatives par le biais desquelles ils reconnaissent et construisent leur subjectivité juridique [notre traduction][40].
Non seulement le sujet n’est pas passif devant la création du droit, il est aussi fondamentalement pluridimensionnel. Comme le souligne Macdonald : « Le sujet juridique est à la fois un être qui s’identifie de multiples façons et qui est identifié par d’autres de multiples façons »[41]. L’acteur juridique se définit par ses interactions, qui sont multiples; ses relations avec les autres, sa famille, ses amis, son milieu de travail, sa communauté, son voisinage, et les différentes institutions qui le gouvernent sont constitutives, nous dit Macdonald, d’un soi et conditionnent de manière radicale sa capacité à imaginer — et donc connaître le réel[42]. Ainsi,
le soi (sujet) est inévitablement multiple; ni l’une ni l’autre des multiples personnes que nous sommes ne prédomine sur les autres en toute occasion. Au contraire, notre vécu nous permet précisément d’exprimer l’une ou l’autre de ces personnes selon les circonstances. Dans nos rapports avec les autres, nous choisissons constamment laquelle de nos identités nous voulons privilégier, tout comme les autres nous assignent également les identités qu’ils veulent privilégier. Nous faisons appel à des critères de cohérence pour nous autoévaluer dans le contexte des diverses possibilités qui nous sont ouvertes, et pour choisir l’ordre juridique qui nous convient davantage à un moment donné. Ce processus d’auto-évaluation se déroule comme la médiation entre nos identités multiples.[43]
Le sujet de droit — de par son caractère caléidoscopique — choisit son appartenance, mais ne le fait pas seul. L’Autre participe de cette catégorisation, à laquelle est soumis le sujet de droit. Pensons par exemple au fait que toute personne est qualifiée de personne juridique par l’État. Cet exposé, auquel nous ont accoutumés les thèses monistes, n’est cependant pas la fin de l’histoire. Pour Macdonald, cette qualification par l’autre est seulement le point de départ pour comprendre le droit; une fois reçues, ces catégories — et les institutions qui les émettent — sont façonnées par l’interprétation qu’en font les sujets. Le sujet est dès lors toujours voué à réviser le sens que les autres et lui-même assignent à ces identités. Parfaitement aligné avec un modèle deweyen de reconnaissance, le soi n’est pas un donné fixe, mais une entité en mouvement qui se définit dans le processus de ses interactions qui le transforment en même temps qu’il transforme l’autre et son environnement.[44] Macdonald nous dira que le droit ne fait pas exception à ce phénomène, d’où l’importance de l’examiner à partir d’une hypothèse qui nous permet de le voir dans son plein déploiement[45].
Comprendre le droit de cette manière porte à conséquence sur la façon dont on vient à percevoir le rôle des institutions. Ainsi, l’État n’est plus seul producteur de normes : « le droit étatique lui-même n’est que le produit d’une construction réciproque — une médiation constante — entre les sujets du droit et les sujets qui exercent un rôle institutionnel »[46]. Une exposition pluraliste critique du droit se doit donc de placer les choses en ordre : comprendre un phénomène juridique ne passe pas que par le donné positif des lois et de leur application. Le rôle des institutions dans la création du droit est donc mis en perspective. Ce faisant, Macdonald désontologise le droit, c’est-à-dire qu’il abandonne l’idée selon laquelle le droit serait une entité réelle, indépendante des acteurs qui la constituent et le façonnent[47].
Cette approche a l’avantage qu’elle permet d’interroger le droit à travers les perceptions et connaissances de toutes ces personnes qui y participent, plutôt que de se limiter à l’examen positif des normes juridiques. Chacun des sujets de droit expérimente, influence et interprète les normes de droit qui s’appliquent à lui et « [p]ar cette notion dynamique du droit construit réciproquement par les sujets et les institutions officielles du droit, le pluralisme juridique donne une légitimité aux interprétations autres que celles des magistrats ou des élites de ces communautés culturelles »[48]. Le récit, comme objet d’étude, présente une richesse inégalable pour celui qui s’y intéresse. C’est d’ailleurs pour cette raison que Macdonald affirmait que « l’idée du pluralisme [...] est une pratique émancipatrice. Le droit vit dans l’âme de tous les membres d’une société »[49]. Non seulement le sujet d’étude est situé, ancré et contextualisé, mais il se révèle lui-même dans son agentivité créatrice de normativité. Macdonald l’avait bien vu : « parce que seul le sujet possède l’autorité de raconter authentiquement l’interprétation de sa vie normative, en la racontant constamment, il sert à engager, à éduquer et à influencer l’imagination interprétative des autres »[50].
L’héritage de Macdonald m’a amenée à analyser le droit religieux du point de vue et à partir du récit des femmes dont le positionnement en tant que sujet est différent, l’éventail allant d’individualités autonomes à celles qui ont besoin de s’insérer dans des réseaux familiaux pour faire référence à elles-mêmes[51]. Évidemment, ces rencontres mettent en lumière « la pertinence des récits personnels [...] pour arriver à une vision plus complète du droit » [notre traduction][52]. Les récits collectés, conservés dans leur forme originale, me permettent d’analyser comment ces femmes appréhendent les mécanismes juridiques pluriels de leur culture, et comment elles naviguent et adaptent les structures dans lesquelles elles se trouvent.
Pour notre part, nous nous éloignons de la philosophie et de la méthodologie du pluralisme juridique critique dans sa vision de la « culture » en tant que droit non étatique. Des pluralistes juridiques importants ont cherché à démontrer par leurs travaux que, contrairement à ce que propose le dogme positiviste, le droit n’est pas séparé de la culture et fait partie du tissu culturel de la société[53]. Par conséquent, le droit est influencé par la constante redéfinition sémiotique dont parle l’anthropologue Clifford Geertz dans sa célèbre théorie interprétative de la culture[54]. En d’autres termes, le droit est la culture[55]. Sans vouloir contredire cette approche, nous tenons à mettre l’accent sur un autre aspect du croisement entre le droit et la culture : le fait que les mécanismes culturels, parmi lesquels les processus normatifs décentralisés dont parlent les pluralistes juridiques, servent aussi de normes qui font autorité et d’atouts de négociation socio-économique, d’une manière semblable au droit étatique. Pour les femmes dont les normes familiales sont dictées par la religion, cela signifie que les coutumes religieuses et les processus d’attribution de sens ont également des conséquences distributives dans la structure juridique des communautés religieuses.
Cet aspect de ma recherche emprunte à la pensée transsystémique, qui complète sur ce point l’approche des théories pluralistes critiques. Alors que le pluralisme juridique décrit la multiplication des sources de droit, le transsystémisme les déclare potentiellement illimitées et indéterminées. Harry Arthurs énonçait ce précepte de manière limpide, argumentant qu’il ne s’agit pas seulement de faire interagir des systèmes juridiques reconnus, mais « d’explorer l’univers normatif parallèle qui existe au côté du droit tel que conventionnellement conçu par les avocats » [56]. La pensée transsystémique permet de révéler le rôle réel des règles normatives — ici religieuses — dans la vie sociale des sujets de droit. Le transsystémisme est donc une description de la complexité (du latin complexus : contenir, englober)[57] de l’identité de l’individu et de la collectivité.
Il paraît cependant nécessaire de souligner que nous appréhendons le transsystémisme non pas selon une approche comparative, mais plutôt selon une approche dialogique ou interactive. Il s’agit de conceptualiser le droit comme étant composé d’alliages et de superpositions de normes, plutôt que de mises en parallèle[58]. Comme l’énonçait Jean-Guy Belley : « Le pluralisme juridique est [...] le constat descriptif et l’idéologie prescriptive qui s’accordent le mieux avec la dynamique de la régulation juridique »[59]. Associé à une vision pluraliste du droit, le transsystémisme permet donc de mieux apercevoir le métissage des normes mises à la disposition et réappropriées par les sujets de droit dans leur quotidien. C’est en ce sens que nous inscrivons la pensée transsystémique dans la lignée du pluralisme juridique critique de Macdonald, qui met l’accent sur la construction subjective du droit, par les sujets de droit eux-mêmes.
Cet article met en pratique les théories de Macdonald sur le pluralisme juridique critique, à partir d’une approche que l’on a qualifiée de transsystémique. Plutôt que de regarder l’ordre normatif religieux comme un donné, j’ai examiné la façon dont les agents utilisent la culture et comment cette dernière influence leur subjectivité et leurs possibilités de négociation. Plutôt que d’opposer les sphères civiles et religieuses en revendiquant en termes absolus les mérites de la laïcité ou du multiculturalisme, une vision transsystémique et pluraliste critique du droit reconnaît plutôt la légitimité de chaque sphère, ainsi que leur interaction constante. Comme le démontrent nos recherches de terrain, l’espace juridique individuel est marqué par des rattachements multiples qui se chevauchent et qui sont fonction, entre autres, du sexe de l’individu, de sa nationalité, de sa religion, de sa communauté, de sa situation familiale, de son bagage culturel et de son expérience subjective[60]. Ainsi, nous suggérons qu’une approche transsystémique ne peut omettre de s’intéresser à la réalité religieuse des individus et à leurs interactions avec le sacré à partir de leur propre perspective — c’est-à-dire en tenant compte de l’hétérogénéité de leurs interactions avec les normes environnantes.
II. Le droit et la culture se rencontrent : légalisation de la religion
Les pages qui suivent présentent le résultat de la recherche sur le terrain menée auprès de femmes juives et musulmanes pratiquantes en Angleterre et en France. L’essentiel de ma recherche en Angleterre a été mené dans le Grand Londres et comprend des entrevues avec huit femmes qui étaient en procédure de divorce ou avaient déjà obtenu un divorce religieux ou civil en Angleterre. J’ai pris contact avec ces femmes par l’intermédiaire d’autorités religieuses, d’avocat.e.s, de chercheur.e.s, d’organisations non gouvernementales et de réseaux au sein des communautés religieuses[61]. Chaque entrevue a duré environ une heure et demie et était axée sur leur expérience du mariage et du divorce civil et religieux. Il y était aussi question de foi et de pratiques religieuses, de l’effet du mariage et du divorce sur le bien-être des femmes, de l’intervention de la communauté religieuse et des stratégies adoptées par les femmes pour influencer l’issue du divorce sur les plans religieux et civil. Les participantes avaient fait des études et occupaient des emplois, elles étaient nées en Grande-Bretagne ou étaient immigrantes, elles étaient âgées de 29 à 72 ans, et leurs conditions socio-économiques et familiales étaient très diverses[62]. Les identités culturelles étaient très variées, elles incluaient plusieurs formes de pratiques religieuses et culturelles : les participantes juives faisaient partie ou avaient fait partie de groupes juifs orthodoxes et provenaient de communautés ashkénazes ou sépharades. Les participantes musulmanes appartenaient à la secte sunnite et étaient d’origine ou de descendance bangladaise, autrichienne et pakistanaise[63].
Pour la recherche sur le terrain en France, nous avons mené des entrevues avec neuf femmes juives et musulmanes qui avaient utilisé une procédure de divorce religieuse et civile. Nous sommes entrées en contact avec les femmes de manière indirecte, comme ça a été le cas pour les femmes anglaises et selon les mêmes méthodes approuvées par l’Université d’Ottawa : par des autorités religieuses, des organisations non gouvernementales et des contacts au sein des communautés religieuses. Comme pour les entrevues en Angleterre, ces entrevues ont duré environ une heure et demie; elles comprenaient des questions entre autres sur le mariage et le divorce religieux et civil, leur effet sur le bien-être des femmes, l’intervention de la communauté religieuse et les stratégies adoptées par les femmes pour influencer l’issue du divorce sur les plans religieux et civil. C’est une recherche de terrain qualitative qui vise à élaborer des hypothèses sur la nature de la relation entre le droit civil et religieux.
À cause de la taille de notre échantillon dans les deux cas, nous ne prétendons pas établir ici une conclusion pertinente d’un point de vue quantitatif. Nos entrevues révèlent néanmoins plusieurs phénomènes que n’explique pas le discours normatif traditionnel sur l’interaction entre la religion et les procédures civiles et celui sur la non-reconnaissance et la laïcité, qu’il faudra approfondir encore.
A. Jargon juridique, discorde religieuse : la loi sur le mariage en Angleterre
Le Marriage Act 1949, qui régit la célébration des mariages en Angleterre et au Pays de Galles, énonce des règles détaillées sur l’endroit où le mariage peut avoir lieu, l’identité du célébrant, le moment de la journée où le mariage doit avoir lieu et la nature de la célébration[64]. Selon l’article 26(I), un mariage autre que ceux qui sont célébrés selon les rites de l’Église d’Angleterre, les us et coutumes de la Société religieuse des Amis (les quakers), ou « un mariage entre deux personnes de confession juive selon les us et coutumes des Juifs » [notre traduction][65] doit être célébré dans un bureau de l’officier d’état civil ou dans un édifice enregistré, entre 8 heures et 18 heures, en présence d’un officier de l’état civil ou d’une « personne autorisée » et du couple qui échange des voeux selon une formule standard contenant des mots dictés par la loi[66].
Des amendements ont été adoptés dans les années 1990 pour tenir compte du fait que les gens peuvent souhaiter différentes formes de mariage. Ainsi, dans le Marriage (Registration of Buildings) Act 1990, on a retiré l’obligation que le lieu de culte enregistré soit un édifice distinct. Le Marriage Act 1994 a autorisé l’enregistrement de locaux agréés qui ne sont ni des édifices religieux ni des bureaux d’enregistrement de l’administration locale, mais il y est également précisé qu’« aucun service religieux ne doit être célébré lors d’un mariage dans les lieux qui ont été agréés »[67]. Ces amendements permettent d’accommoder de plus en plus de formes de célébrations de mariage laïques tout en continuant de rejeter les pratiques des minorités religieuses en matière de mariage.
Les mariages musulmans qui ont été célébrés en Angleterre et au Pays de Galles sont donc considérés comme valides s’ils se sont déroulés dans une mosquée qui a été dûment enregistrée en tant que lieu de culte où l’on peut célébrer des mariages. De plus, il faut qu’une personne autorisée en vertu du Marriage Act 1949 enregistre le mariage. Comme le droit islamique autorise qu’un mariage soit célébré uniquement en présence de témoins sans aucune autre formalité[68], les conséquences de cette législation sont lourdes. Différentes sources considèrent qu’un nombre important et croissant de mariages musulmans ne sont pas reconnus par le droit civil en Angleterre[69]. Selon une avocate musulmane célèbre : « Le problème (des mariages musulmans non enregistrés) est une tendance lourde — sa croissance est rapide, surtout au sein des gens de moins de 30 ans. D’après mon expérience avec mes clients, 80 % des mariages musulmans ne sont pas enregistrés, et ce pourcentage est en hausse » [notre traduction][70]. Même si les musulmans représentaient 2,78 % de la population anglaise en 2001, il n’y a eu que 163 mariages officiels dans des mosquées enregistrées[71]. Cela semble très peu, surtout si on compare ce nombre avec les mariages officiels dans la communauté sikhe, qui représente 0,59 % de la population, et au sein de laquelle il y a eu 1 008 mariages enregistrés civilement au cours de la même période[72].
Le droit de la famille anglais considère les musulmanes dont le mariage n’a pas été reconnu juridiquement comme si elles vivaient en union libre. Ainsi, elles ne peuvent tirer profit d’une procédure civile en divorce et de plusieurs autres protections juridiques et avantages économiques issus du droit civil[73]. La situation s’est détériorée depuis que des changements apportés récemment à l’aide juridique ont pour effet qu’elle ne couvre plus le droit de la famille, y compris le divorce et la garde des enfants[74]. Il risque d’y avoir un nombre croissant de musulmanes qui consultent les conseils de la charia pour la dissolution de leur mariage si le droit civil ne leur offre pas un niveau de protection comparable[75]. Cependant, aucun tribunal religieux n’a obtenu de statut juridique en Angleterre. Par conséquent, l’autorité des conseils de la charia « ne s’étend qu’à ceux qui choisissent de s’y soumettre » [notre traduction][76].
À l’heure actuelle, les tensions sociales sont exacerbées à cause de la discrimination que subissent les musulmans[77]. Leur mise à l’écart de l’ensemble de la société britannique est le fruit d’une crainte généralisée nourrie par l’augmentation de la migration transnationale, par les liens que les musulmans entretiennent avec leurs pays d’origine et leurs réseaux familiaux et, surtout, par les pratiques que l’on associe communément à la religion musulmane, telles que le mariage arrangé[78], le mariage forcé[79] et la polygamie[80], qui heurtent la sensibilité britannique. La reconnaissance juridique des pratiques matrimoniales des communautés religieuses minoritaires se fait lentement et est influencée par le système de valeurs britannique qui repose sur la foi chrétienne ainsi que par la laïcisation de la société, mais c’est précisément l’apparition de l’égalité des sexes dans une société laïque qui mène à considérer que la non-reconnaissance des mariages musulmans mine sérieusement la protection du consentement éclairé des femmes au mariage et leur pouvoir de négociation au moment de la dissolution de l’union.
En ce qui concerne le divorce, la reconnaissance du divorce religieux n’est accordée pour aucune religion. Le divorce civil est accordé uniquement par un décret ou une ordonnance d’un tribunal britannique de juridiction civile au motif que le mariage est irrémédiablement brisé[81]. Cependant, la communauté juive possède un élément de « reconnaissance », qu’il serait sans doute plus juste de décrire comme une « considération » du droit religieux de la part des tribunaux civils : The Divorce (Religious Marriages) Act 2002 (ci-après 2002 Act)[82]. Cette loi autorise les tribunaux civils à « donner l’ordre que le décret de divorce civil ne soit pas définitif tant que les deux parties n’auront pas certifié devant la cour que les procédures nécessaires pour dissoudre le mariage ont été accomplies en accord avec [...](i) les coutumes des Juifs ou (ii) toute autre coutume religieuse prescrite » [notre traduction][83].
Le 2002 Act fait ici référence au divorce religieux et vise à répondre au problème de l’agunah en donnant aux tribunaux civils les moyens de mettre la pression sur le mari pour qu’il accorde le get en suspendant la procédure civile de divorce[84]. S’il est possible, selon le 2002 Act, que des membres d’autres religions utilisent cette disposition, les juifs ont été les seuls à s’en prévaloir jusqu’ici[85]. Si les musulmans n’ont pas eu recours au 2002 Act, cela peut être lié au fait qu’il y est question du refus de divorcer, un problème qui semble moins répandu chez les musulmans que chez les juifs. En effet, si le mari peut refuser le divorce talaq, les femmes musulmanes peuvent avoir recours au khul ou au divorce pour faute, le fashk. De plus, les imams en Europe de l’Ouest sont réputés aller dans le sens d’une réforme du droit familial qui permette aux femmes d’obtenir le divorce de manière unilatérale[86]. Quoi qu’il en soit, ce rapport asymétrique au droit civil semble avoir un impact sur la subjectivité des femmes de minorités religieuses et constituer la sphère religieuse de manière très différente pour les juifs et les musulmans.
B. Qu’en est-il des Français?
De manière beaucoup plus simple, l’État français accorde à son droit civil le monopole sur la règlementation du mariage et du divorce[87]. Ce monopole est renforcé par l’article 433-21 du Code pénal français, qui considère comme une infraction criminelle pour tout ministre d’un culte de procéder « de manière habituelle » à des cérémonies religieuses de mariage avant la tenue d’un mariage civil. Il est intéressant de noter que les manifestations religieuses publiques, que les partisans de la laïcité distinguent de la foi privée, ont parfois été définies de façon vaste et équivoque. Cette tendance est apparue clairement dans deux causes juridiques distincts où l’interprétation de la doctrine du droit civil peut sembler avoir été influencée par le droit religieux. Le premier exemple concerne la décision d’un tribunal de Lille d’annuler le mariage d’un couple de musulmans français parce que le mari s’était plaint de la non-virginité de sa femme, affirmant que celle-ci avait menti sur un élément important du contrat de mariage, invalidant de ce fait son consentement[88]. Pour les partisans de la laïcité, l’application par le tribunal lillois de la nullité du mariage pour erreur est un cas d’intégration des « lois religieuses » au sein des « lois laïques de la République »[89]. Dans le deuxième cas, célèbre sous le nom de décision « Baby Loup », la Cour de cassation française (une cour suprême de dernier ressort) a statué que le licenciement d’une employée d’une crèche portant le voile était discriminatoire[90]. Ici, les partisans de la laïcité ont déclaré qu’une interprétation particulière des principes de non-discrimination et de liberté de religion équivalait à une acceptation par les autorités laïques du droit musulman[91]. Que ce soit ou non une acceptation, dans ces deux cas, les dispositions légales semblent démontrer une volonté de considérer les traditions religieuses comme une force légitime au sein d’une société de droit laïque.
Des lois qui procurent des mesures de reconnaissance des mariages religieux existent au sein d’un État laïque et s’inscrivent dans un climat social et politique en pleine évolution, tant en Angleterre qu’en France. Les événements qui se sont produits depuis les attentats du 11 septembre, incluant ceux-ci, ont influencé négativement l’opinion publique envers la nouvelle immigration musulmane en Angleterre[92], avec une opinion publique et politique[93] qui perçoit la culture islamique comme étant archaïque, homogène, résistante au changement et dont les membres sont clairement « autres »[94]. Ces mêmes tragédies ont nourri chez beaucoup de Français un mépris envers les musulmans, qui vivent une ghettoïsation et ont beaucoup de difficulté à s’intégrer à la société française[95]. D’ailleurs, les deux pays sont aux prises avec des actes de terrorisme perpétrés en réplique à des lois réactives et, en France, de grandes manifestations ont fait ressortir les disparités économiques qui affectent différents groupes ethniques du pays. S’il existe déjà une forte tension entre le religieux et le laïc, le climat politique et l’opinion sociale exacerbés font en sorte qu’il devient presque impossible pour les décideurs de reconnaître publiquement les dilemmes auxquels font face les femmes religieuses qui cherchent la reconnaissance d’un État laïque pour augmenter leur pouvoir de négociation lors de la dissolution de leur mariage, ainsi que celles qui sont des fantômes pour le système : non reconnues et, par le fait même, perdantes. Cependant, comme nous allons le démontrer, l’introduction de la religion dans un paysage séculier est inévitable, et les décideurs et leurs partisans qui ont brandi l’égalité des sexes pour justifier plusieurs lois répressives édictées au nom de la laïcité et de la lutte contre le terrorisme devraient considérer la possibilité qu’une forme de reconnaissance puisse offrir davantage de droits et de protection aux femmes de minorités religieuses[96].
C. Isolement et inégalité
En examinant notre recherche sur le terrain, il m’est apparu clairement qu’il était difficile de déterminer quels étaient les effets socio-économiques du droit civil et du droit religieux. En Angleterre, pour certaines femmes de minorités religieuses, la sphère civile n’est pas l’élément libérateur que les défenseurs de la laïcité voudraient qu’elle soit[97]. Le travail sur le terrain en Europe[98] et au Canada[99] donne des résultats comparables. En fait, certaines participantes percevaient le droit civil comme étant hostile et coûteux, ce qui se traduisait par un désavantage socio-économique :
Participante no 2 :
Je ne décidais pas. Je ne dirigeais pas les choses. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. [...] Et je ne crois pas que l’avocat [laïque] a bien fait les choses. Je pense qu’il en a trop fait. [...] Quelle perte de temps et d’argent ridicule. Et ça a créé plus d’hostilité que nécessaire. Je tiens les avocats [laïques] responsables de ça.
Participante no 4 :
Ouais, toute cette requête ne me plaisait pas, et qui va payer pour les frais de qui? [...] Le processus juridique est interminable. Toutes les audiences, tout ceci et cela.
Ces plaintes au sujet des lacunes du droit civil trouvent écho dans la littérature, qui atteste également du manque d’accès à la justice pour les femmes des minorités religieuses et ethniques en Europe[100].
Il n’est pas étonnant de voir que si les femmes sont souvent désavantagées par le droit civil, ce peut aussi être le cas avec le droit religieux :
Participante no 6 :
Je n’ai jamais été très impliquée dans ma communauté religieuse. Je la détestais. Je détestais... toute ma vie, j’ai été en lutte contre un milieu dominé par les hommes. [...] Ma culture a besoin d’éducation. [...] Je passe mon temps à le dire à mes amies. J’ai des amies qui sont allées à l’école avec moi et qui sont maintenant coincées dans leur routine, à faire la cuisine, le ménage. Je leur dis de tout laisser ça.
Participante no 2 :
Je sentais que je n’aimais pas comment fonctionnait le système laïque. Je ressentais la même chose au sujet du système religieux. Avec le droit religieux — bon Dieu — il y aurait tellement de changements à apporter [...] Mais avec la procédure qui existe, et ce qui devrait se passer, il faut qu’il y ait une réinterprétation de la loi, parce que tout repose entre les mains des hommes, il n’y a que le mari qui compte, qui peut donner le get, et il faut que ce soit interprété autrement.
Participante no 1 :
[Pause] On ne peut pas changer les choses. C’est comme ça. La seule chose qu’on pourrait changer, c’est la façon dont l’autorité de délivrance se comporte avec la personne, et ça, ce serait déjà une grosse différence... Pour ça, il faudrait qu’on forme les gens du beth din... J’aimerais que les choses puissent changer, mais je n’y crois plus. Parce que... les rabbins ont peut-être apporté des changements il y a longtemps, et ce qu’ils ont changé, on l’accepte aujourd’hui, mais plus personne ne veut faire de changements maintenant.
Participante no 3 :
Le beth din de Londres doit changer son attitude générale envers les femmes et sa façon de les traiter. Mais ce changement ne se produit pas. Les membres de la Campagne Agunah ont voulu apporter des changements en essayant de se rapprocher du beth din de Londres, mais ça n’a pas fonctionné, après, c’est devenu encore plus difficile de parler contre le beth din ou de le critiquer.
Participante no 5 :
Je ne crois pas qu’on puisse changer ça [la cérémonie du get]. On ne peut pas déconner avec la religion. [...] Elle n’est pas souple. Elle ne changera pas. Mais j’aimerais que ce soit moins douloureux. C’est déjà assez difficile, si c’était un peu plus efficace, ce serait bien.
D. L’expérience de la religion : femmes musulmanes en Angleterre et en France
Dans les deux cas, il a été important de comprendre comment les participantes voyaient leur religion et comment elles existaient au sein de celle-ci. Dans les cas des femmes musulmanes en Angleterre, ce qui revenait souvent, c’était que la religion était une sphère « culturelle » fondée sur le statut et la soumission à des règles proclamées et sacrées.
Participante no 8 :
Je ne savais rien ni du mariage ni du divorce religieux. Je savais qu’il y avait un nikah, et qu’il y avait des témoins de présents au nikah. Mais personne n’en parlait — j’étais issue d’une culture plutôt conservatrice —, et on ne parlait pas de ces choses aux filles avant leur mariage. [...] Au moment de mon mariage, je ne savais rien de tout ça. Je ne crois même pas avoir vu mon nikahnama [contrat de mariage].
Participante no 6 :
Pour le mariage, on est allés à la mosquée. J’étais élégante, ma famille était là, sa famille était là. C’était une très belle cérémonie. Nous étions 30 en tout, je crois. Je n’ai rien signé. Je ne me rappelle même pas avoir dit oui. Mais j’imagine que j’ai dit « kabul ». Ensuite, il y a eu l’échange des alliances, nous avons partagé des desserts, et c’était terminé. [...] Je n’ai jamais vu mon contrat. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas ce qui y est écrit. Je ne sais même pas ce qu’il y a dans mon mahr. Je l’ai laissé à ma famille parce que je pense que c’est ici que la culture est intervenue. Je croyais que c’était ainsi qu’il fallait faire les choses. Il ne faut pas remettre en question ces choses-là.
Lorsqu’on compare ces femmes avec les musulmanes de France, on voit que les participantes d’Angleterre ont davantage mis l’accent sur le rôle règlementaire et souvent « juridique » de la religion dans leur vie. Cela semble avoir été le cas tant pour les participantes plus pratiquantes que pour les femmes moins pieuses et plus à l’écart de la communauté religieuse[101]. Même si elles insistaient pour dire que le mariage et le divorce religieux étaient plus importants que leurs équivalents civils, et que le mariage civil n’était qu’une exigence purement bureaucratique, il est intéressant de remarquer qu’elles ont toutes mentionné le fait que les procédures civiles étaient juridiquement contraignantes, un peu comme si cela représentait une base solide pour les cérémonies religieuses.
Participante no 1 :
Je souhaitais les deux [divorce civil et religieux], évidemment, sur le papier. Mais le plus important, c’est le mariage religieux. Là, je suis libre. [...] Le divorce civil, c’était plus... pour le voir dans les papiers comme quoi je suis vraiment divorcée; si je veux me marier après, j’ai le droit. Mais [ce qui comptait le plus], c’est le divorce religieux.
Participante no 3 :
[Le mariage religieux représentait beaucoup pour moi], parce que je suis musulmane, donc, c’est tout à fait normal, quoi. [...] C’est comme n’importe quelle religion qui se marie. [...] [C’était important d’avoir aussi un mariage civil], parce qu’on est obligés de faire ça.
Même si certaines participantes avaient des réserves au sujet de leur religion[102], les liens sociaux que celles-ci créaient dans leur vie familiale et communautaire faisaient en sorte que l’obtention d’un divorce religieux était importante pour elles, même si elles insistaient sur le fait que les procédures civiles demeuraient nécessaires :
Participante no 2 :
Pour moi, de toute façon, ce qui importe, c’est le divorce civil, comme je t’ai dit. [...] C’est vrai que ça [ne pas avoir de divorce religieux] n’aurait pas été bien. [...] Le fait qu’il [avait prononcé le divorce talaq], ça m’a soulagée parce que c’est très important par rapport à la religion qu’un homme dise, « Voilà, je ne veux plus de toi. » Comme ça, dans ma tête, je serai tranquille. Voilà, pour moi, je serai divorcée religieusement et civilement.
Participante no 5 :
[S]ymboliquement, [le divorce religieux] c’est important dans la mesure où ça a pris de la place dans notre mariage, que ça faisait partie d’une condition sine qua non [de notre mariage]. [...] Je veux que ce soit très clair, et dans ma tête, et dans la sienne, et celle des enfants. Je crois qu’il faut défaire tous les liens qui nous ont unis, y compris les religieux. [...] [S’il avait refusé d’accorder le get,] j’aurais vu ça comme un acte de guerre.
E. Réalités différentes : reconnaissance et non-reconnaissance
Nous avons pu voir, tant pour les participantes de l’Angleterre que pour celles de France, que la religion est présente sous forme de règles et de normes qui exercent une influence pour ce qui relève de la règlementation, et ce, pas seulement au moment du divorce, mais aussi dans le cadre du mariage et, jusqu’à un certain point, dans tous les aspects de la vie de tous les jours. C’est ce qui explique pourquoi les participantes insistaient sur le fait que le mariage religieux créait des liens sociaux complexes qu’il fallait dénouer avec les procédures religieuses appropriées. Cependant, en comparant la façon dont les participantes d’Angleterre et celles de France parlaient de leur relation avec la religion et de l’importance du divorce religieux et civil, il ressort que la non-reconnaissance du mariage musulman et la mise à l’écart des musulmans de la sphère civile qui en résulte renforcent l’idée que la religion est perçue comme reposant sur un statut et non sur un contrat.
Cet effet constitutif est encore plus intéressant dans la mesure où les femmes juives d’Angleterre qui ont à traiter avec le droit civil en plus du droit religieux ont une vision très différente de la religion. Ces participantes considéraient que les normes religieuses pouvaient être contestées, légalisées et que des recours étaient possibles. Elles utilisaient des mots comme « contrat d’affaires » et « légalistes » pour décrire le même type de règles que les musulmanes d’Angleterre décrivaient comme « issues de Dieu » et « culturelles ». En effet, on demande aux musulmans de croire en ce qui est « prévu, prescrit, destiné, préordonné » [notre traduction][103], c’est-à-dire les écrits ou Maktub, laissant peu — ou pas — de place à la négociation et aux tractations et menant, jusqu’à un certain point, à la soumission intrinsèque à Dieu. Par opposition, la foi juive accepte une négociation personnelle avec Dieu, ce qui permet à l’espace religieux de devenir contractuel et ce qui ouvre la porte à la capacité d’action. Les femmes juives décrivent aussi le droit religieux comme étant parsemé de vides juridiques, ce qui permet l’élaboration de stratégies et la mise en litige du get :
Participante no 1 :
Le ketubah est un contrat. On y parle des articles de maison que la mariée doit apporter dans le ménage. [...] C’est un contrat d’affaires!
Participante no 2 :
Le judaïsme possède un important côté légaliste, avec ce qu’on appelle la Halakha, la loi juive.
Participante no 3 :
Les discussions avec le beth din de Londres (la Synagogue unie) qui ont eu lieu grâce à la Campagne Agunah[104] m’ont fait une forte impression. Il y a eu beaucoup d’échanges entre le beth din de Londres et moi et mon mari quand on essayait de régler mon statut d’agunah. On a exploré différents vides juridiques dans le droit rabbinique et on a essayé de tenir compte de chaque suggestion proposée par le beth din. Au bout du compte, chaque vide juridique a été écarté, et tout le processus m’a laissée désillusionnée. Un exemple, c’est que nous avons essayé de voir si mon mari avait réellement acheté l’alliance qu’il m’a donnée. S’il ne l’avait pas fait, il y avait une possibilité que le mariage soit annulé puisque la loi rabbinique ordonne que le mari achète lui-même l’alliance et ne délègue pas cette responsabilité. J’étais en contact avec mon ex-beau-père, et il était prêt à me soutenir en témoignant par écrit ou en personne du fait qu’il avait donné à mon ex-mari l’argent pour acheter l’alliance afin qu’on puisse utiliser ce vide juridique. Finalement, les rabbins ont changé d’avis et ont décidé que cela ne suffisait pas.
Pour ces participantes, la religion ne se réduit pas à un statut, et elle offre beaucoup de recours contractuels et de possibilités d’arrangements et de négociations privés. Par conséquent, elles utilisaient parfois comme stratégie de donner aux normes religieuses la forme d’un contrat civil qui contraint le mari à remplir certains devoirs religieux comme celui d’accorder le get juif.
C’était aussi évident en France, où mon travail sur le terrain a démontré que la nature contestable des règles et des normes religieuses est fort probablement influencée par deux éléments-clés : la reconnaissance du mariage religieux par l’État et des ordonnances qui forcent la tenue d’une cérémonie civile avant qu’une cérémonie religieuse puisse être célébrée. Ainsi, le droit religieux traditionnel, qui est mis en application indépendamment de la législation nationale et est souvent « figé » dans le temps[105], peut être mis de côté pour conférer une légitimité à de nouvelles pratiques religieuses novatrices nées sur le sol français. Le cas du divorce islamique illustre bien ce phénomène. Tel que mentionné déjà, selon le droit islamique traditionnel, une femme ne peut obtenir le divorce par sa volonté, sauf dans le cas du divorce faskh, qui est décrété par un tribunal islamique pour des raisons précises comme des mauvais traitements physiques ou mentaux, le manque de piété ou l’impuissance[106]. Les seules autres possibilités qui existent sont les divorces khul et talaq, pour lesquels le consentement du mari est requis.[107] Malgré cela, deux participantes musulmanes ont pu obtenir qu’un imam prononce le divorce contre la volonté du mari, et ce, même si aucune des conditions du divorce faskh n’était présente :
Participante no 4 :
[Si le mari refuse le divorce], le couple peut retourner voir la personne qui les a mariés, et la femme expose son problème. Et l’imam qui les a mariés a le droit de juger qu’il la divorce de cet homme. Même si [l’homme] ne veut pas, il dit « Je te divorce de lui », et elle est divorcée. [...] Et moi, je ne savais pas, à l’époque.
Participante no 1 :
Au début, il n’a pas accepté [d’accorder le divorce religieux], et c’est l’imam qui lui a dit [...] : « Vous avez tort de la traiter de cette façon », et tout. « Là, elle veut le divorce ». Au début, il n’a pas accepté, puis il a dit : « Moi, j’ai beaucoup de femmes, c’est pas qu’à elle que je m’accroche. Elle me rend les clés de mon appartement, et je lui donne le divorce ». [...] Et donc, j’ai donné les clés à l’imam [...]. Et quand [l’imam] lui a donné les clés, il lui a dit : « Signez un papier comme quoi vous avez pris les clés ». Il a refusé de signer, et l’imam n’a pas donné les clés. Et après, il est allé faire une plainte comme quoi j’ai donné les clés à d’autres personnes, que j’ai voulu le voler. Et l’imam, il a vu que c’est une personne dangereuse, et donc, il m’a donné le divorce.
Les participantes françaises ont aussi fait remarquer que les autorités religieuses adoptent des pratiques incohérentes lorsqu’il est question de reconnaître la validité religieuse d’un mariage civil, idée que l’on trouve aussi dans la littérature académique[108]. Ces changements pourraient indiquer que les imams français sont sensibles aux questions liées à l’égalité des sexes et qu’ils essaient d’adapter les règles inégalitaires du droit islamique traditionnel au droit civil occidental, où la femme a le droit d’obtenir le divorce sans le consentement de son mari, ou encore, qu’ils souhaitent réformer les interprétations plus conservatrices du droit religieux en ouvrant la voie à l’ijtihad[109]. Cette inconstance est assurément liée à la diversité des sources religieuses auxquelles les juges peuvent se référer pour justifier leurs décisions ainsi qu’à la reconnaissance civile, qui ajoute une importante dimension d’exigences et de responsabilités. Cela laisse plusieurs pistes de négociation possibles pour les femmes qui souhaitent obtenir un divorce religieux rapidement et facilement. La participante no 4 a affirmé : « Il y a des imams qui disent que quand tu divorces civilement, automatiquement, tu es divorcée religieusement. [...] Il y en a [des imams] qui l’approuvent, il y en a qui ne l’approuvent pas ».
Certaines participantes ont décrit leur rapport au droit religieux en mettant l’accent sur les notions d’autonomie, d’autodétermination et d’individualisme qu’on associe généralement au droit civil contractuel[110]. Pour ces participantes, la religion ne peut être réduite à un statut ou être affaire de soumission, elle offre au contraire une multitude de recours contractuels et de possibilités d’entente et de négociation privées.
Participante no 7 :
R : Je ne fais pas de différence majeure entre la manière dont le mariage est traité par la religion et la manière dont le mariage est traité par la société civile. [...]
Q : Et si votre mari vous avait refusé le get...
R : On peut l’obtenir aujourd’hui, il n’y a pas de refus qui tienne. Ça aurait pris un peu plus longtemps. Et au bout de je sais pas combien d’années [...], il est obligé de vous le donner, point barre.
Participante no 4 :
Il faut connaître sa religion. Il faut connaître ses droits. Il faut connaître qu’est-ce que c’est que cette religion, qu’est-ce qu’on doit y faire. [...] Et s’il y a des problèmes, quels sont les recours, qu’est-ce que... Comme dans un contrat, comme quand on rentre dans un boulot : « C’est quoi mon horaire, c’est quoi si j’ai un problème? » Il y a des articles, il y a des... il y a tout ça; il faut chercher.
En harmonie avec le principe d’un régime juridique contractuel global, des participantes ont mis en lumière l’existence de recours religieux, de procédures et de règles allant au-delà de simples normes religieuses proclamées et imposées. Ces participantes ont illustré le fait que le mariage islamique[111] comme le mariage juif[112] ont un caractère profondément contractuel et qu’ils sont, en fait, structurés autour de la négociation, de tractations et de mécanismes d’application[113].
Par conséquent, certaines participantes ont aussi utilisé comme stratégie de donner aux normes religieuses la forme d’un contrat civil, contraignant ainsi le mari à remplir certains devoirs religieux, comme d’accorder le get juif ou de payer le mahr, terme qui signifie « compensation » (ajr) et « cadeau nuptial » (sadaqa) et qui est utilisé par le droit de la famille islamique pour désigner le « paiement auquel une femme a droit de la part de son mari lors du mariage » [notre traduction][114], un premier montant lui étant remis au moment du mariage et un autre au moment du divorce. Par cette procédure, la religion acquiert une place encore plus officielle, plus « publique ». Pour ces participantes, le droit religieux n’a pas eu besoin d’être appliqué par des tribunaux civils pour avoir un effet persuasif sur leur mari. Une simple formalisation dans un contrat a suffi pour octroyer un pouvoir de négociation à ces participantes françaises et percevoir la religion comme un droit socio-juridique :
Participante no 3 :
R : On fait un contrat, on signe, c’est là que c’est un mariage religieux [...]. J’ai fait un contrat et signé [...]. [L’imam était présent] [...]. Il y avait des témoins, il y avait mon père, il faut qu’il soit là, il faut qu’il signe le contrat. [...] Je me rappelle [mon mari] a donné l’argent.
Q : Ça, c’est la dot, en fait?
R : Voilà. [...] Avec cet argent-là, je peux organiser un mariage ou m’acheter ce que je veux, voilà, c’est comme ça.
Participante no 5 :
C’est quelque chose que nous avons écrit entre nous, en seing privé, avant d’aller chez le notaire, [...] parce qu’en fait, on avait pris chacun un avocat. On n’était pas en bons termes à ce moment-là. [...] On a fait une petite négociation, et dans le cadre de cette négociation, nous avons écrit un document [...] qui nous engageait moralement l’un et l’autre. Et c’était surtout dans le but de ne pas oublier des choses. [...] Dans ce papier-là, on avait mis qu’il me rassurait en me disant : « Je ne ferai aucune opposition à l’obtention du get ».
Ces procédures contractuelles privées sont légitimées par le droit civil français, qui a reconnu que le mahr islamique comme le get juif engendraient des obligations civiles. Les tribunaux civils français ont appliqué le mahr en vertu de la doctrine de la « condition contractuelle du mariage »[115] et considèrent que le refus d’accorder le get peut constituer une faute, un délit qui génère la responsabilité civile[116]. Ainsi, même si les participantes n’ont pas évoqué les normes religieuses lors de procédures civiles, l’existence sociale du droit religieux se trouve légitimée par le droit civil. Cette interaction juridique s’est avérée plutôt avantageuse pour les participantes, au même titre que la contractualisation socio-juridique religieuse qui s’est déployée à l’ombre du droit civil[117]. Mon travail sur le terrain suggère que la religion n’opprime pas systématiquement les femmes et qu’elle génère, en fait, de nombreux outils de négociation dans le contexte d’interactions contextuelles entre la sphère civile et la dynamique sociale de la vie en communauté en France. Le droit civil, pour sa part, offre à ces femmes davantage de pouvoir de négociation dans le domaine religieux.
Pour les participantes juives vivant en Angleterre, les stratégies incluent l’utilisation de la loi 2002 Act pour mettre la pression sur le mari afin qu’il accorde le get. Nos participantes ont confirmé que c’était un outil de négociation efficace pour les femmes[118]. La Participante no 1 explique :
Je ne sais pas si vous êtes au courant de toute la publicité qu’il y a eu en Angleterre à cause de l’agunah. [...] Les gens sont devenus beaucoup plus conscients. En fait, j’ai fait un truc en dix points, une entente, qui a rendu ça parfaitement clair : je veux le get. [...] Quand on a eu l’audience à la Haute Cour, le juge lui a demandé pourquoi il ne m’avait pas accordé le get. Le juge en a fait une condition pour le jugement de divorce. [...] Le juge lui a dit qu’il fallait qu’il s’occupe de l’entente rapidement, et c’est ce qu’il a fait.
Dans ces scénarios, les femmes considèrent la culture et la religion comme source de stratégies et d’affirmation. Les participantes des deux groupes (les femmes juives d’Angleterre et les femmes juives et musulmanes de France) cherchaient des façons novatrices de résoudre leurs disputes religieuses et étaient prêtes à remettre en question les décisions religieuses afin d’obtenir une meilleure vie pour elles et leurs enfants. Leurs démarches sont appuyées par la reconnaissance et la protection que leur offre le droit civil sur lequel, tel que démontré par notre recherche sur le terrain, ces femmes se reposent. Cette forme d’autonomisation se traduit aussi par le désir d’avoir recours au soutien des autorités religieuses et de la collectivité, à la fois religieuse et laïque, pour améliorer son pouvoir de négociation.
Ce portrait tranche avec la description qu’ont faite les participantes musulmanes d’Angleterre d’un partenariat religieux dans lequel elles se sentent coincées et isolées :
Participante no 6 :
Je voulais en finir. [...] Je n’avais même pas de contrat, je ne savais même pas où trouver le gars qui avait célébré mon nikah. L’islam institutionnel — la mosquée — qui existe, je ne suis pas d’accord avec, et je ne savais juste pas par où commencer. Je ne pouvais pas aller voir ma famille, parce que franchement, ils ne me soutenaient pas beaucoup. [...] Ils ne faisaient que me renvoyer à mes beaux-parents. J’étais seule.
Participante no 8 :
Quatre-vingt-dix pour cent du temps, on considère que c’est la faute de la femme. Même quand les gens sont au courant des détails, on pense que la femme aurait dû céder, en faire plus, se conformer, se changer. Je trouve que c’est très cruel pour les femmes. [...] On n’accepte pas les femmes divorcées. On les perçoit comme des parias, des exclues ou des déviantes sociales.
Khola Hasan[119] :
Je crois que la plus grosse barrière est culturelle. « Comment oses-tu penser à ça [au divorce]! Reste dans ton mariage malheureux; s’il te bat, ne t’en fais pas. » [...] Parfois, c’est leur famille, leurs parents qui disent « Ne nous fais pas honte. » [...] Alors, les gens perçoivent l’Islam comme n’approuvant pas le divorce. [...].
En plus d’accorder le divorce religieux ou de superviser le processus, les tribunaux religieux se prononcent souvent sur le soutien financier qui découle du droit religieux. Comme nous l’avons vu précédemment, les droits de la famille musulman et juif mentionnent plusieurs obligations financières entre les époux. Un point important est l’application des dispositions financières de la ketubah, le contrat de mariage juif qui est au centre de la célébration du mariage[120]. La ketubah est souvent présentée comme offrant une protection à la femme, puisqu’il y est écrit que le mari doit remettre à sa femme une somme d’argent s’il divorce sans raison ou s’il meurt[121]. Selon la littérature, les tribunaux rabbiniques demandent le paiement du montant prévu dans la ketubah, alors que ce n’est en général pas le cas des tribunaux civils[122]. Là encore, le droit civil influence la façon dont le droit religieux est appliqué et conceptualisé. Il semble que lorsque le mariage religieux n’est pas reconnu par la sphère civile, les dispositions financières religieuses ne sont pas appliquées, surtout dans le cas du mahr islamique. Il y a deux explications possibles à cela : soit elles n’ont pas été conçues pour être appliquées, soit les femmes ne se sentent pas habilitées à en réclamer l’application aux autorités religieuses, comme l’expliquent ces participantes musulmanes qui vivent en Angleterre :
Khola Hasan :
Par exemple, le mahr, un droit des femmes [...]. Nous ne pouvons pas l’appliquer, nous ne pouvons pas veiller à ce qu’il soit appliqué, nous ne pouvons pas dire à la police de l’appliquer. [...] Alors, nous ne pouvons que nous fier à la bonne volonté des gens.
Participante no 6 :
Tout ça a fait que j’ai fini par me dire : Alors, qu’est-ce que ça change si on divorce? Il n’a pas accepté le nikah, on n’est pas enregistrés à l’état civil, alors, aux yeux de la loi, je suis célibataire et je vis en concubinage. Tout était séparé. Il s’en était assuré. Même quand il a acheté la maison, il a utilisé mon argent pour verser l’acompte, mais mon nom n’a jamais été inscrit au contrat. J’étais tellement naïve. Je l’ai laissé faire parce que je me disais : « Il faut que je lui fasse confiance. » Je lui ai même donné l’or que j’avais reçu pour mon mahr parce qu’il en avait besoin. Je tenais tellement à lui.
À l’inverse, certaines participantes juives ont indiqué que les beth din appliquent la ketubah et, plus étonnant encore, qu’ils statuent sur les mesures financières accessoires au divorce. Que ces femmes aient raison ou pas en ce qui concerne les actes posés par le beth din ou le fait que ses ordonnances sont appliquées de façon adéquate n’est sans doute pas aussi important que le simple fait que ces femmes perçoivent le domaine de la culture comme intrinsèquement judiciarisé et permettant la négociation :
Participante no 2 :
Q : Alors, la ketubah, est-ce qu’elle est applicable selon la loi juive?
R : Eh bien oui, parce que c’est un document en bonne et due forme.
Participante no 4 :
On peut aller voir le rabbin, et au lieu de régler le cas au civil, disons, par exemple, que je veux que l’entente m’accorde 20 000 £, alors, on va s’asseoir devant le rabbin et on va s’entendre sur les conditions générales et tout ça.
Des attitudes aussi différentes mènent probablement à des résultats différents. Il n’est pas étonnant de voir que les participantes musulmanes d’Angleterre, qui avaient une vision moins contractuelle de la sphère religieuse, aient obtenu des résultats nettement moins favorables que les participantes juives d’Angleterre, qui ont décrit la sphère religieuse comme une entité juridique. Comme le démontre mon enquête sur le terrain, les femmes musulmanes d’Angleterre, en plus de ne pas pouvoir profiter des avantages accordés par le droit civil, ont souvent très peu de pouvoir de négociation dans la sphère religieuse, ce qui se traduit par des pertes financières :
Participante no 8 :
Dans mon cas, personne n’a négocié, même pas mes parents. À un moment donné, c’est moi qui l’ai fait. Je lui ai dit au téléphone : « J’ai besoin de garanties que tu vas bien te comporter. Comme garantie, donne-moi la maison ». Et il a explosé. J’ai dit : « OK, je n’ai aucune garantie que tu ne vas pas encore mal te conduire ». Et ça a été fini. Ça a été la seule négociation, et ça a été fait sans grande motivation. [...] Mes enfants se portent bien, et ils ont tout mon soutien, et celui de mes parents. Et il n’a contribué à rien. Ni financièrement, ni émotionnellement, ni d’aucune façon. Ils portent son nom, et c’est à peu près tout.
Khola Hasan :
Je parlais à une autre femme de Tower Hamlets, et elle me racontait où elle en était avec son divorce. Malheureusement, au bout du compte, quand ils ont obtenu leur divorce religieux, il y a eu un problème autour de la division des biens, et elle n’a rien pu réclamer, parce qu’elle n’avait pas la protection du droit civil, et donc, elle n’a pas pu avoir de médiation pour ces choses. Lui, c’était quelqu’un de bien, et elle n’avait aucune rancoeur envers lui, mais la répartition des biens ne s’est pas faite de façon équitable. Malheureusement, elle n’a rien pu récupérer et a dû s’en aller.
Ces récits contrastent nettement avec ceux des participantes juives d’Angleterre, comme celui présenté ci-dessous, dans lequel la participante décrit les avantages économiques qu’elle a obtenus grâce au droit civil :
Participante no 1 :
Eh bien, [...] j’ai obtenu 46 %, je pense que c’était 46 % parce que ça avait été un long mariage. Et je pense que c’est tout à fait correct de penser qu’une personne qui a été mariée longtemps a apporté sa contribution, une contribution équivalente en s’occupant de la famille, et des autres tâches, même si elle n’a pas eu d’emploi.
Si la légalisation des normes religieuses est mise à profit dans le cas des participantes juives qui souhaitent avoir un divorce religieux, la non-reconnaissance du mariage musulman cause des problèmes aux femmes musulmanes qui veulent divorcer, surtout si elles n’ont pas eu de mariage civil. En réalité, le droit civil considère qu’elles sont dans une relation de concubinage. Par conséquent, elles doivent avoir recours à un processus complexe de reformulation culturelle et religieuse par le biais d’un conseil de la charia afin d’obtenir le divorce si le mari n’a pas demandé la dissolution du mariage. Après que la femme ait décidé de quitter son mari, il arrive souvent que sa famille ou sa belle-famille fasse office de médiateur informel et tente des démarches pour réconcilier le couple. Le conseil de la charia devient alors un prolongement de cet effort de réconciliation :
[I]l est apparu clairement que les femmes n’ont d’autre choix que de s’adresser au conseil de la charia pour obtenir un divorce religieux lorsque leur mari refuse de leur accorder un divorce unilatéral. Il est aussi manifeste qu’elles doivent souvent se battre contre la prévalence de visions conservatrices qu’on trouve fréquemment dans ce genre d’organismes. Elles ont parlé de la confusion qu’engendrent les différentes interprétations du divorce islamique adoptées par les conseils et qui a mené à des décisions délicates en lien avec la validité des certificats de divorce [notre traduction][123].
À tous les niveaux, les rapports de force définissent les options auxquelles les femmes de minorités religieuses ont accès. Si les femmes juives doivent chercher, comme les musulmanes, parmi différentes voies celle qui leur permettra d’obtenir le divorce, la non-reconnaissance du mariage musulman en Angleterre et le fait qu’un grand nombre de mariages musulmans ne sont pas enregistrés[124] crée un écart entre la réalité des femmes musulmanes et leur capacité de négociation et celles des femmes juives. Cela est mis en lumière par la ressemblance qui existe entre les récits des femmes musulmanes et juives de France sur leur expérience du mariage et du divorce religieux et les récits des femmes juives d’Angleterre : la contestation des interprétations culturelles du droit religieux est possible et est directement influencée par le pouvoir de négociation que les femmes ont sur le plan tant civil que religieux. Comme nous avons pu le voir dans cette partie, la reconnaissance ou la non-reconnaissance juridique du mariage dans le cadre d’une tradition contractuelle influence la possibilité de la femme d’élaborer une stratégie en vue d’obtenir la dissolution de son mariage. Lorsqu’il n’y a pas de reconnaissance juridique, les conséquences sur les plans religieux et économique sont souvent au désavantage des femmes, ce qui contraste avec l’appui que ressentent les femmes qui peuvent naviguer entre les contrats religieux, civil et économique afin d’avoir différentes possibilités de recours lorsqu’elles s’engagent sur la voie tumultueuse du divorce.
Conclusion
Le travail d’un intellectuel n’est pas de modeler la volonté politique des autres; il est par les analyses qu’il fait dans les domaines qui sont les siens, de réinterroger les évidences et les postulats, de secouer les habitudes, les manières de faire et de penser, de dissiper les familiarités admises, de reprendre la mesure des règles et des institutions, et à partir de cette reproblématisation (où il joue son métier spécifique d’intellectuel) participer à la formation d’une volonté politique (où il a son rôle de citoyen à jouer)[125].
Nos résultats, même s’ils ne sont pas suffisants sur le plan quantitatif pour que des conclusions générales s’en dégagent, offrent une appréciation qualitative pertinente des expériences et des perceptions que les femmes de minorités religieuses ont en commun, que ce soit en Angleterre ou en France. Ils rendent compte de l’utilisation que font les femmes des normes qui existent afin d’atteindre leurs intérêts personnels, si ces normes leur sont accessibles. Ce fait est mis en évidence par le contraste frappant qui existe entre, d’un côté, les femmes juives qui semblent être plus à même d’utiliser stratégiquement la régulation civile de leur tradition religieuse et, de l’autre, les femmes musulmanes qui éprouvent plus de difficulté à s’approprier les normes civiles et qui sont souvent déroutées par la non-reconnaissance de leurs pratiques religieuses par l’État anglais, ce qui contribue à les restreindre dans leur recherche de solutions. Évidemment, la conclusion qui se dégage de mon enquête sur le terrain selon laquelle les femmes musulmanes d’Angleterre ont moins de marge de manoeuvre pour négocier leurs normes religieuses que les femmes juives en raison de la non-reconnaissance de leur mariage et de leur isolement sur le plan culturel ne signifie en rien que cette rigidité soit inhérente à la religion islamique. D’ailleurs, la recherche sur le terrain menée au sein de communautés musulmanes de France, du Canada et d’Allemagne semble démontrer que l’existence d’une plus grande interaction entre le civil et le religieux dans ces pays ait donné lieu à une négociation contractuelle et juridique semblable à celle qui existe dans les communautés juives d’Angleterre[126]. De plus, les doctrines religieuses qui encadrent le mariage musulman et le mariage juif ont une nature intrinsèquement contractuelle : elles sont, d’entrée de jeu, structurées autour de la négociation, du marchandage et de mécanismes d’application[127].
Étant donné que les deux doctrines religieuses offrent beaucoup de possibilités de négociation contractuelle et juridique, il est possible d’interpréter l’asymétrie observée entre la réalité des communautés juive et musulmane d’Angleterre comme un accident historique. Cette situation pourrait bientôt être révolue grâce à la lutte que mènent des femmes de minorités religieuses, des militants et des avocat.e.s contre les interprétations conservatrices du droit religieux; ce faisant, elles nous font comprendre que la culture est liée beaucoup plus intimement au droit qu’on voudrait nous le faire croire. La recherche portant sur le fonctionnement des normes religieuses présentée ici appuie l’opinion de Susan Weiss selon laquelle le droit juif « n’est pas un assemblage de règles strictes et uniformes, mais [...] regroupe des voix diverses et contradictoires, [et que le] résultat d’un cas précis dépend de l’autorité rabbinique consultée, des “faits” sur lesquels il considère devoir mettre l’accent et des voix dont il choisit de tenir compte » [notre traduction][128]. Cette analyse peut aussi s’appliquer au droit de la famille musulman, proposition qui appuie fortement le plaidoyer pour une reconnaissance de celui-ci par le droit civil. En fait, les interactions entre le droit civil et la religion ne peuvent qu’améliorer la malléabilité du droit si bien décrite par Susan Weiss, car elles permettent aux femmes de considérer la culture comme étant liée au droit. Cela constitue, avons-nous fait valoir, une manière fructueuse et prometteuse d’améliorer le contexte de négociation actuel des femmes issues de minorités et qui fait écho au volume croissant de recherches féministes qui réinterprètent les doctrines juridiques inhérentes au droit juif[129] et au droit islamique[130]. Cette conclusion est corroborée par l’enquête comparative sur le terrain présentant des participantes juives et musulmanes de France, où la légitimité civile permet aux femmes de ces deux religions d’obtenir de l’assistance et du soutien et une mise en application de leurs engagements religieux.
Les procédures du mariage et du divorce religieux sont, essentiellement, de nature juridique, et le pouvoir règlementaire, qui va du mariage jusqu’au divorce, se fonde sur les règles religieuses. Même si les participantes françaises se sont plaintes du manque de ressources et d’accès à la justice inhérents au droit civil, elles ont été plusieurs à affirmer que l’égalité formelle que procure le droit civil leur avait donné de l’assurance, en raison des issues possibles, mais aussi parce que cela avait un effet incitatif pour le mari ou l’autorité religieuse à proposer une interprétation plus progressive de la loi religieuse. Par ailleurs, elles ont aussi mentionné que la voie la plus avantageuse était celle où le droit civil prenait en considération les normes religieuses et les intégrait ou les orientait de manière à rendre possibles des issues favorables.
Le but de cet article n’est pas de présenter un portrait exhaustif de la relation complexe et changeante qui existe entre les femmes pratiquantes et le droit civil et religieux. En effet, bien que mon analyse élucide certaines stratégies adoptées par ces femmes afin de manier les contrastes entre le religieux et le civil dans leurs vies quotidiennes, son objectif principal est de cerner l’impact réel des normes religieuses dans la vie sociale de ces sujets de droit et d’examiner, par l’intermédiaire d’une enquête de terrain comparative et transnationale, l’interaction de ces normes avec le droit civil. Les éléments de preuve présentés ci-dessus mènent à une variété de conclusions transitoires qui, nous l’espèrons, inciteront les théoriciens de la laïcité à réévaluer leurs positions sur l’interaction entre le droit civil et religieux et sur la législation des normes religieuses à travers la reconnaissance étatique et le dialogue juridique internormatif.
D’abord, l’enquête sur le terrain permet de constater que le droit civil occupe un rôle important — et même déterminant — pour ces femmes pratiquantes à travers le soutien qu’il leur offre dans l’obtention du statut de divorce. Tel qu’observé lors des entrevues, certaines femmes adoptent la stratégie consistant à contractualiser les normes religieuses dans des accords civils qui se trouvent en dehors de la juridiction du religieux. Ces accords leur permettent de contraindre leurs maris à accomplir certains devoirs religieux et, de ce fait, elles acquièrent un pouvoir de négociation face à ceux-ci. Par contraste, d’autres participantes se servent de dispositions se trouvant dans le droit civil lui-même et portant sur le droit religieux afin de concrétiser les droits qui leur sont garantis par ce dernier, soit par exemple l’utilisation par les femmes juives d’Angleterre de la loi 2002 Act. Un troisième groupe, quant à lui, opte entièrement pour le divorce civil et celui-ci a alors préséance sur les restrictions de leurs normes religieuses. Ainsi, les résultats sur le terrain soutiennent l’hypothèse selon laquelle le processus de « double navigation » et d’interaction entre les normes religieuses et le droit civil est susceptible de favoriser les femmes pratiquantes en leur accordant une plus grande autonomie ainsi qu’une variété de ressources pour obtenir les résultats souhaités. Ce qu’il importe de souligner, c’est que l’existence même du droit civil, renforcée par son interaction avec le droit religieux, offre à ces femmes des avantages et des protections dont elles ne pourraient autrement se prévaloir. Ainsi, bien que les participantes aux entrevues ne se caractérisent pas comme étant des femmes « laïques », elles ont néanmoins pu bénéficier de politiques d’État qui sont communément considérées comme des politiques séculières.
Ceci m’amène à un deuxième constat pouvant être extrapolé à partir de la recherche sur le terrain. Les femmes interrogées dans le cadre de cette étude, loin d’être des victimes résignées, sont des agentes qui cherchent activement à contester les interprétations conservatrices du droit religieux lorsque celui-ci est appliqué aux dépens de leurs intérêts personnels. À travers une réinterprétation de la doctrine et une réappropriation des normes religieuses, ces femmes pratiquantes affichent leur capacité à formuler une critique, non de la religion en soi, mais plutôt de ce qu’elles perçoivent comme étant des applications incohérentes et illégitimes des préceptes religieux. Cette approche revêt une importance cruciale, car elle ouvre la voie à des réformes potentielles et donne suite aux recherches féministes qui s’engagent à réinterpréter les doctrines inhérentes au droit juif et islamique. Par ailleurs, il importe de souligner que la reconnaissance du droit religieux par l’État laïque et son interaction avec le droit civil peuvent servir de support considérable pour ces femmes pratiquantes engagées à réinterpréter les normes de leurs religions respectives.
Appendices
Notes
-
[1]
Michel Foucault, « Des espaces autres » (2004) 54:2 Empan 12 à la p 12.
-
[2]
(R-U), 12 & 13 Geo VI, c 76.
-
[3]
Voir Bill 45, Marriage Act 1949 (Amendment) Bill [HL], sess 2017–2018, 2017 (1re lecture 7 octobre 2017).
-
[4]
Voir RELIGARE Project, Challenges of Religious Accommodation in Family Law, Labour Law and Legal Regulation of Public Space and Public Funding: United Kingdom Socio-Legal Research Report, par Ashraf-ul Hoque et Prakash Shah, à la p 28, en ligne : <patternsofgoverningreligion.weebly.com/uploads/2/7/0/3/27037565/religare_project_challenges_of_religious_accommodation_uk.pdf>, archivé à https://perma.cc/3WL6-NC5N.
-
[5]
Effectivement, on considère que les tribunaux anglais n’interviennent dans les disputes religieuses que s’il y a des questions financières en jeu et seulement en lien avec la cession et l’administration de biens (voir Gillian Douglas et al, Social Cohesion and Civil Law: Marriage, Divorce and Religious Courts, Cardiff (R-U), Cardiff University, 2011 aux pp 10–11 [Douglas et al, Social Cohesion and Civil Law]). Cela peut avoir des conséquences désastreuses pour les femmes musulmanes, qui font partie d’un groupe religieux (l’Islam) qui n’a pas beaucoup de lieux de culte habilités à enregistrer des mariages, et qui préfèrent s’en tenir à une cérémonie religieuse selon leur tradition. Voir R-U, Office for National Statistics, Marriage, divorce and adoption statistics (Series FM2 no 35) 2010, tableau 3.43 [ONS, Marriage, divorce and adoption].
-
[6]
Voir Jean Baubérot, « Liberté, laïcité, diversité : la France multiculturelle » dans Paul Eid et al, dir, avec la collaboration de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, Appartenances religieuses, appartenance citoyenne : un équilibre en tension, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, 13 à la p 14.
-
[7]
Voir Jacques Berlinerblau, How to Be Secular: A Call to Arms for Religious Freedom, New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2012 à la p xvi.
-
[8]
Voir Régis Debray, Ce que nous voile le voile : la République et le sacré, Paris, Gallimard, 2004 aux pp 26–32; Catherine Kintzler, Qu’est-ce que la laïcité ?, Paris, Vrin, 2007 à la p 13; Henri Pena-Ruiz, Qu’est-ce que la laïcité ?, Paris, Gallimard, 2003.
-
[9]
Voir Henri Pena-Ruiz, « Laïcité : l’émancipation par l’universel » (2009) 31:1 Le Philosophoire 63 aux pp 82–83.
-
[10]
Pour les perspectives analytiques de cet article, le mot « culture » fait référence à un éventail de « pratiques et de processus qui s’entrecroisent et qui émergent à l’intérieur et au-delà de ses frontières » [notre traduction] (Naomi Mezey, « Law as Culture » dans Austin Sarat et Jonathan Simon, dir, Cultural Analysis, Cultural Studies, and the Law: Moving Beyond Legal Realism, Durham, Duke University Press, 2003, 37 à la p 43).
-
[11]
Voir Ann Laquer Estin, « Unofficial Family Law » (2009) 94:2 Iowa L Rev 449 à la p 464; Haideh Moghissi, Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis, New York, Zed Books, 1999 aux pp 20–21.
-
[12]
Voir par ex Radhika Coomaraswamy, « Identity Within: Cultural Relativism, Minority Rights and the Empowerment of Women » (2002) 34:3 Geo Wash Int’l L Rev 483 à la p 483 (où on avance que l’identité fondée sur le groupe « crée des obstacles à la réalisation de l’égalité » [notre traduction]). Voir aussi Martha C Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 à la p 7 (où on encourage une pensée politique et économique internationale qui s’interroge sur les questions de justice pour les femmes en situation d’appauvrissement).
-
[13]
Ann Laquer Estin, « Embracing Tradition: Pluralism in American Family Law » (2004) 63:3 Md L Rev 540 à la p 600. Voir aussi Asifa Quraishi et Najeeba Syeed-Miller, « No Altars: a Survey of Islamic Family Law in the United States » dans Lynn Welchman, dir, Women’s Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform, New York, Zed Books, 2004, 177 (sur les figures d’autorité et le divorce sur demande unilatérale du mari, ou faskh, dont il est question plus loin dans le texte).
-
[14]
Sauf si le droit au divorce talaq a été spécifié dans le contrat de mariage (talaq al-tawfid) : voir Kathleen A Portuan Miller, « Who Says Muslim Women Don’t Have the Right to Divorce?: A Comparison Between Anglo-American Law and Islamic law » (2009) 22:1 NY Int’l L Rev 201 aux pp 218–25.
-
[15]
Voir ibid (qui définit et explique les différents types de divorce en Islam); Dawoud El Alami et Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World, Londres, Kluwer Law International, 1996 aux pp 27–28; Abdal-Rehim Abdal-Rahman Abdal-Rehim, « The Family and Gender Laws in Egypt During the Ottoman Period » dans Amira El Azhary Sonbol, dir, Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History, Syracuse, Syracuse University Press, 1996, 96 à la p 105.
-
[16]
Voir Abdal-Rehim, supra note 15 à la p 105 (indiquant que les femmes peuvent initier les procédures de divorce et expliquer la faute de leur mari devant la cour). Voir aussi David Pearl et Werner Menski, Muslim Family Law, 3e éd, Londres (R-U), Sweet & Maxwell, 1998 à la p 285.
-
[17]
Voir par ex El Alami et Hinchcliffe, supra note 15 à la p 22.
-
[18]
La Halakha est l’ensemble des textes du droit juif, inspirés de la Torah, qui présente les doctrines et les coutumes rabbiniques (voir « Halakhah » dans Encyclopaedia Judaica, vol 7, Jérusalem, Keter, 1971 aux pp 1156–57).
-
[19]
Voir Irwin H Haut, Divorce in Jewish Law and Life, New York, Sepher-Hermon, 1983 à la p 18 (« C’est un principe fondamental du droit judaïque qui stipule que le mari est le seul à pouvoir accorder le get » [notre traduction]).
-
[20]
Voir Ayelet Blecher-Prigat et Benjamin Shmueli, « The Interplay Between Tort Law and Religious Family Law: The Israeli Case » (2009) 26:2 Ariz J Int’l & Comp L 279 à la p 281; Karin Carmit Yefet, « Unchaining the Agunot: Enlisting the Israeli Constitution in the Service of Women’s Marital Freedom » (2009) 20 Yale JL & Feminism 441 aux pp 444–45.
-
[21]
On trouve l’origine biblique de cette prérogative dans le Deutéronome 24:1 : « [Lorsqu’un homme aura pris et épousé une femme qui] viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu’il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main propre, il la renverra de sa maison. » [notre traduction], cité dans Yehiel S Kaplan, « Enforcement of Divorce Judgments by Imprisonment: Principles of Jewish Law » (2004) 15 Jewish L Annual 57 à la p 61. L’interprétation que l’on donne à ce passage est que l’on accorde à l’époux le privilège exclusif d’engager les procédures du divorce (ibid).
-
[22]
La situation de l’agunah n’est mentionnée qu’une fois dans la Bible, à Ruth 1:13 (voir La Sainte Bible : Ancien Testament, Lausanne, Georges Bridel, 1861, Livre de Ruth, 1:13, 94). Cependant, la Mishna et le Talmud y font régulièrement référence, tout comme les écrits qui en ont découlé (voir Aviad Hacohen, The Tears of the Oppressed: An Examination of the Agunah Problem: Background and Halakhic Sources, Jersey City (NJ), KTAV, 2004). À l’origine, ce terme était réservé aux femmes dont le mari avait disparu. Si une femme n’avait aucune preuve de la mort de son mari, elle ne pouvait se remarier religieusement (voir Michelle Greenberg-Kobrin, « Civil Enforceability of Religious Prenuptial Agreements » (1999) 32 Colum JL & Soc Probs 359 à la p 359). Cependant, le problème moderne de l’agunah est davantage lié à des maris récalcitrants qu’à des maris disparus (voir Michael J Broyde, Marriage, Divorce, and the Abandoned Wife in Jewish Law: A Conceptual Understanding of the Agunah Problems in America, Hoboken (NJ), KTAV, 2001 aux pp 3, 8).
-
[23]
Greenberg-Kobrin, supra note 22 à la p 360. Une femme peut, en théorie, refuser un get demandé par son mari; cependant, dans la pratique, les conséquences pour l’homme ne sont pas aussi graves et n’ont pas une aussi grande portée que pour l’agunah. Comme l’explique Nichols, « [u]n homme qui se remarie sans avoir obtenu de divorce juif n’a pas commis d’adultère, mais seulement violé un décret rabbinique qui exige la monogamie; il est néanmoins considéré comme marié à sa seconde épouse, et ses enfants sont légitimes » [notre traduction, note omise] (Joel A Nichols, « Multi-Tiered Marriage: Ideas and Influences from New York and Louisiana to the International Community » (2007) 40:1 Vand J Transnat’l L 135 à la p 155).
-
[24]
Voir Nichols, supra note 23.
-
[25]
Voir Margit Cohn, « Women, Religious Law and Religious Courts in Israel: — The Jewish Case » (2004) 27:4 Retfaerd (Nordic JL & Justice) 57 à la p 66.
-
[26]
Voir ibid.
-
[27]
Nichols, supra note 23 à la p 155.
-
[28]
Voir Pascale Fournier, Muslim Marriage in Western Courts: Lost in Transplantation, Farnham (R-U), Ashgate, 2010 [Fournier, Muslim Marriage]; Maleiha Malik, Minority Legal Orders in the UK: Minorities, Pluralism and the Law, Londres (R-U), British Academy, 2012; Ayelet Shachar, Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women’s Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; Ayelet Shachar, « Religion, State, and the Problem of Gender: New Modes of Citizenship and Governance in Diverse Societies » (2005) 50:1 RD McGill 49; Ayelet Shachar, « Privatizing Diversity: A Cautionary Tale from Religious Arbitration in Family Law » (2008) 9:2 Theor Inq L 573; Werner Menski, « Governance and governability in South Asian family laws and in diaspora » (2013) 45:1 J Leg Pluralism & Unofficial L 42; Sherene Razack, Casting Out: The Eviction of Muslims From Western Law and Politics, Toronto, University of Toronto Press, 2007; Leah Bassel, « Intersectional Politics at the Boundaries of the Nation State » (2010) 10:2 Ethnicities 155; Lila Abu-Lughod, « Against Universals: The Dialects of (Women’s) Human Rights and Human Capabilities » dans J Michelle Molina et Donald K Swearer, dir, Rethinking the Human, Cambridge (Mass), Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School, Harvard University Press, 2010, 69.
-
[29]
Sur le sujet de la libre-action ou pouvoir d’agence des femmes musulmanes, voir Anna C Korteweg, « The Sharia Debate in Ontario: Gender, Islam, and Representations of Muslim Women’s Agency » (2008) 22:4 Gender & Society 434 à la p 444 (où elle développe le concept de « la capacité d’action [...] intégrée dans la religion »).
-
[30]
L’auteure a conscience que pour renforcer son allégation, il faudrait davantage d’études empiriques portant sur les pratiques réelles des autorités religieuses des deux communautés et sur la justification de ces pratiques. Des entrevues avec des rabbins et des imams, par exemple, pourraient s’avérer pertinentes.
-
[31]
Pour une généalogie du pluralisme juridique, voir John Griffiths, « What is Legal Pluralism? » (1986) 24 J Leg Pluralism & Unofficial L 1; Sally Engle Merry, « Legal Pluralism » (1988) 22:5 Law & Soc’y Rev 869; Franz von Benda-Beckmann et Keebet von Benda-Beckmann, « The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders » (2006) 53 J Leg Pluralism & Unofficial L 1. Voir aussi Angela Campbell, « Wives’ Tales: Reflecting on Research in Bountiful » (2008) 23:1-2 CJLS 121 aux pp 130–32 (où elle applique une approche pluraliste juridique critique à une étude empirique sur la polygamie).
-
[32]
Martha-Marie Kleinhans et Roderick A Macdonald, « What is a Critical Legal Pluralism? » (1997) 12:2 CJLS 25 à la p 36.
-
[33]
Roderick Alexander Macdonald, Le droit au quotidien, Montréal, Presses universitaires McGill-Queen’s, 2002 à la p 9.
-
[34]
Roderick A Macdonald, « Custom Made: For a Non-chirographic Critical Legal Pluralism » (2011) 26:2 CJLS 301 à la p 306.
-
[35]
Voir Roderick A Macdonald, « L’hypothèse du pluralisme juridique dans les sociétés démocratiques avancées » (2002-03) 33:1-2 RDUS 133 à la p 140 [Macdonald, « L’hypothèse du pluralisme juridique »]. Voir aussi Roderick A Macdonald, « Les Vieilles Gardes : hypothèses sur l’émergence des normes, l’internormativité et le désordre à travers une typologie des institutions normatives » dans Jean-Guy Belley, dir, Le droit soluble : contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, Paris, LGDJ, 1996.
-
[36]
Voir Macdonald, « L’hypothèse du pluralisme juridique », supra note 35 à la p 140.
-
[37]
Ibid à la p 135.
-
[38]
Ibid aux pp 138–39.
-
[39]
Pour une étude empirique des interactions de tous les jours qui sont génératrices de normes, voir Patricia Ewick et Susan S Silbey, The Commonplace of Law: Stories from Everyday Life, Chicago, University of Chicago Press, 1998. Voir aussi Austin Sarat et Thomas R Kearns, « Beyond the Great Divide: Forms of Legal Scholarship and Everyday Life » dans Austin Sarat et Thomas R Kearns, dir, Law in Everyday Life, Ann Arbor (Mich), University of Michigan Press, 1995, 21; Sally Engle Merry, « Everyday Understandings of the Law in Working-Class America » (1986) 13:2 Am Ethnologist 253; Austin Sarat, « ”...The Law Is All Over”: Power, Resistance and the Legal Consciousness of the Welfare Poor » (1990) 2 Yale JL & Human 343.
-
[40]
Kleinhans et Macdonald, supra note 32 à la p 38.
-
[41]
Macdonald, « L’hypothèse du pluralisme juridique », supra note 35 à la p 142.
-
[42]
Voir ibid à la p 141.
-
[43]
Ibid.
-
[44]
Voir John Dewey, The Later Works, 1925–1953, vol 12 par Jo Ann Boydston, Canondale, Southern Illinois University Press, 1986 à la p 152; John Dewey, The Later Works, 1925–1953, vol 5 par Jo Ann Boydston, Canondale, Southern Illinois University Press, 1984 à la p 220; John Dewey, Art as Experience, Penguin, New York, 2005 à la p 45; Richard Shusterman, « Dewey’s Somatic Philosophy » [2008] 3 R intl philosophie 293 à la p 299, n 6.
-
[45]
Voir ibid aux pp 142–43.
-
[46]
Ibid à la p 143.
-
[47]
Voir ibid à la p 151.
-
[48]
Ibid à la p 152.
-
[49]
Ibid.
-
[50]
Ibid à la p 144.
-
[51]
Cet article s’inspire de la « theory of agency » développée par Deniz Kandiyoti en examinant les stratégies d’adaptation et les choix de mode de vie des femmes dans des sociétés patriarcales : « Ces compromis patriarcaux ont une grande influence sur la formation de la subjectivité des femmes liée au genre et déterminent la nature de l’idéologie du genre dans différents contextes. Ils influencent aussi à la fois la possibilité d’une résistance active ou passive déployée par les femmes et les formes particulières qu’elle prendra » [notre traduction] (Deniz Kandiyoti, « Bargaining with Patriarchy » (1988) 2:3 Gender & Society 274 à la p 275).
-
[52]
Angela Campbell, « Bountiful Voices » (2009) 47:2 Osgoode Hall LJ 183 à la p 191.
-
[53]
Voir par ex Benjamin L Berger, « The Cultural Limits of Legal Tolerance » (2008) 21:2 Can JL & Jur 245; Jeremy Webber, « Legal Pluralism and Human Agency » (2006) 44:1 Osgoode Hall LJ 167; Bernard S Jackson, Making Sense in Law: Linguistic, Psychological and Semiotic Perspectives, Liverpool (R-U), Deborah Charles, 1995 à la p 7.
-
[54]
Voir Clifford Geertz, « Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture » dans The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York, Basic Books, 1973, 3.
-
[55]
Voir Prakash Shah, « Shari’a in the West: Colonial Consciousness in a Context of Normative Competition » dans Elisa Giunchi, dir, Muslim Family Law in Western Courts, Abingdon (R-U), Routledge, 2014, 14 à la p 18, pour une présentation de la façon dont les tribunaux occidentaux sont influencés par « l’incompatibilité qui existe entre les valeurs européennes et islamiques » [notre traduction], plus particulièrement en lien avec l’arrivée et l’intégration de l’égalité des sexes [Shah, « Shari’a in the West »].
-
[56]
Harry W Arthurs, « Law and Learning in an Era of Globalization » (2009) 10:7 German LJ 629. Voir aussi Harry Arthurs, « Madly Off in One Direction: McGill’s New Integrated, Polyjural, Transsystemic Law Programme » (2005) 50:4 RD McGill 707.
-
[57]
Voir Dicolatin, sub verbo « complexus », en ligne : <www.dicolatin.com/XY/LAK/0/COMPLEXUS/index.htm>, archivé à https://perma.cc/BP63-JATT.
-
[58]
Voir notamment Daniel Jutras, « Énoncer l’indicible : le droit entre langues et traditions » (2000) 52:4 RIDC 781.
-
[59]
Jean-Guy Belley, « Le pluralisme juridique comme orthodoxie de la science du droit » (2011) 26:2 RCDS 257 à la p 257.
-
[60]
Voir notamment Jutras, supra note 58.
-
[61]
Cette méthode a été approuvée par le Bureau d’éthique et d’intégrité de la recherche de l’Université d’Ottawa.
-
[62]
Il peut être important de noter qu’il ressort du récent rapport de la University of Manchester et du Runnymede Trust sur les inégalités ethniques locales que les femmes de 25 ans et plus originaires du Bangladesh, du Pakistan et de la région subsaharienne ont eu le plus haut taux de chômage an Angleterre et dans le Pays de Galles, de 2001 à 2011. Voir Nissa Finney et Kitty Lymperopoulou, « Local Ethnic Inequalities: Ethnic Differences in Education, Employment, Health and Housing in Districts of England and Wales, 2001-2011 », rapport de la University of Manchester et du Runnymede Trust, en ligne : <www.runnymedetrust.org/uploads/Inequalities%20report-final%20v2.pdf>, archivé à https://perma.cc/7FF8-42YV à la p 5. En Grande-Bretagne, 50 % des musulmans proviennent de la communauté pakistanaise (Entrevue de Khola Hasan (23 janvier 2012) Islamic Sharia Council, Londres (R-U) [Hasan, Entrevue]), et ce haut taux de chômage pourrait affaiblir leur pouvoir de négociation économique dans le cadre d’une procédure de divorce non reconnue par l’État.
-
[63]
Nous devons dire qu’il a été beaucoup plus difficile de trouver des femmes musulmanes disposées à participer à la recherche et qui correspondaient aux critères définis que des candidates juives. C’est ce qui explique la petite taille de l’échantillon retenu. Un travail supplémentaire, qui comprend la création de réseaux et l’utilisation d’une variété de sources, a été nécessaire pour soutenir la recherche, d’autant plus qu’il était important d’éviter de tirer des conclusions en se basant sur un seul groupe culturel ou linguistique. Comme on peut le voir dans la recherche présentée tout au long de cet article, il s’est avéré très difficile de trouver des femmes musulmanes dont le mariage ou le divorce était enregistré, et malgré l’utilisation de différentes pistes, nous n’avons pu entrer en contact qu’avec des femmes musulmanes qui n’avaient pas de mariage enregistré. De nombreux chercheurs ont cité la prévalence des mariages non enregistrés : Hasan, Entrevue, supra note 62; Samia Bano, « Muslim Family Justice and Human Rights: The Experience of British Muslim Women » (2007) 2:2 J Comparative L 38 [Bano, « Muslim Family Justice »]; Sonia Nûrîn Shah-Kazemi, Untying the Knot : Muslim Women, Divorce and the Shariah, London, Nuffield Foundation, 2001 à la p 31; Malik, supra note 28 à la p 47. Il a donc fallu assouplir les exigences de départ, qui stipulaient que les candidates devaient avoir enregistré leur mariage ou leur divorce, pour inclure des femmes qui étaient sur le point d’enregistrer un contrat.
-
[64]
Voir Sebastian Poulter, Ethnicity, Law and Human Rights: The English Experience, Oxford, Oxford University Press, 1998 à la p 205 [Poulter, Ethnicity, Law and Human Rights].
-
[65]
Marriage Act, 1949, supra note 2, art 26(1)(c)–(e).
-
[66]
Ibid, arts 4, 26(1)(a)–(b), 44(2)–(3), 45(1).
-
[67]
Les Directives publiées par le registraire général pour le Marriage Act 1994 précisent que les mariages « qui ont lieu dans des endroits agréés peuvent être suivis d’une célébration, d’une commémoration ou d’une bénédiction choisie par le couple, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une cérémonie religieuse de mariage et que cela soit distinct de la cérémonie civile. S’il s’avérait que l’on procédait régulièrement à une bénédiction de type religieux à la suite des cérémonies de mariage dans un lieu en particulier, ou que celle-ci était considérée comme faisant partie du service offert dans cet endroit, il se pourrait que l’existence d’un lien religieux contrevienne aux exigences et mène les autorités locales à révoquer leur autorisation » [notre traduction] (Directives citées dans Surrey County Council, « Terms and conditions for granting a licence for civil ceremonies », Birth, Death and Ceremonies, en ligne : <www.surreycc.gov.uk/birth-death-and-ceremonies/marriage-and-civil-partnerships/licence-premises-for-ceremonies/terms-and-conditions-for-granting-a-licence-for-civil-ceremonies>, archivé à https://perma.cc/8MC9-T4FB).
-
[68]
Il est intéressant de noter que Ziba Mir-Hosseini affirme que les juristes classiques considèrent que le contrat de mariage a pour but de rendre légales les relations sexuelles entre un homme et une femme. Elle affirme que les juristes considèrent que les droits et obligations juridiques liés au mariage comprennent l’accès sexuel et la compensation, matérialisés par les concepts de tamkin (obéissance, définie en termes de soumission sexuelle) et de nafaqa (entretien, défini en termes de protection, nourriture et habillement) : Ziba Mir-Hosseini, « Vers une égalité de genre : Les lois familiales musulmanes et la Charia » dans Zainah Anwar, dir, Avis de recherche : Égalité et justice dans les familles musulmanes, Petaling Jaya (Malaisie), Musawah, 2010 aux pp 29, 32. Voir aussi Lynn Welchman, « A Husband’s Authority: Emerging Formulations in Muslim Family Laws » (2011) 25:1 Int’l JL Pol’y & Fam 1.
-
[69]
Khola Hasan est la porte-parole du Islamic Sharia Council. Nous l’avons interviewée le 23 janvier 2012, au Islamic Sharia Council, dans Londres-Est : « La mosquée située dans Londres-Est qui est affiliée avec l’Islamic Sharia Council a rapporté que deux mariages y avaient été célébrés durant les cinq années où la mosquée a été un édifice enregistré où il est possible de célébrer des mariages officiels. » (Hasan, Entrevue, supra note 62). Voir aussi R-U, Ministry of Justice, Muslim Marriage: Report of Working Group (Submission), 11 octobre 2012, en ligne : <www.whatdotheyknow.com/request/179578/response/444442/attach/7/MMWG%20SUBMISSION%20AND%20FINAL%20REPORT%2011.10.12.pdf>, archivé à https://perma.cc/C7AL-6SCQ; Shah-Kazemi, supra note 63 à la p 31; Kathryn O’Sullivan & Leyla Jackson, « Muslim Marriage (Non) Recognition: Implications and Possible Solutions » (2017) 39:1 J Social Welfare and Family L 22 aux pp 22–23.
-
[70]
« Aina Khan and Baroness Warsi kickstart Muslim Marriage Project » (14 janvier 2014), Duncan Lewis Solicitors, en ligne : <www.duncanlewis.co.uk/news/Aina_Khan_and_Baroness_Warsi_kickstart_Muslim_Marriage_Project_(14_January_2014).html>, archivé à https://perma.cc/35PT-FQBY.
-
[71]
R-U, Office for National Statistics, Focus on Religion, Londres, octobre 2004 à la p 2 [ONS, Focus on Religion]; ONS, Marriage, divorce and adoption, supra note 5, tableau 3.40, « Marriages (numbers and percentages): type of ceremony, denomination and day of occurrence, 2001 » à la p 8.
-
[72]
Voir ONS, Focus on Religion, supra note 71 à la p 2. Voir aussi Douglas et al, Social Cohesion and Civil Law, supra note 5 à la p 13, n 45 : « Parmi les 40 405 édifices enregistrés en Angleterre et au Pays de Galle en 2007, 164 étaient musulmans, 161 étaient sikhs et 281 étaient identifiés “autres”; il n’y a pas de chiffres concernant les temples hindous » [notre traduction].
-
[73]
Les protections juridiques et les avantages économiques issus du droit civil comprennent, entre autres, l’établissement d’une prestation sous forme de capital ou de rente lors de la rupture de l’union, la mise en disposition d’un capital lorsqu’il y a un ou des enfants à charge, la succession sans testament et l’allocation familiale en cas de décès, et la provision sur succession. Pour pareilles protections, voir par ex Married Women’s Property Act, 1882 (R-U), 45 & 46 Vict, c 75; Matrimonial Causes Act 1973 (R-U), c 18 [Matrimonial Causes Act]; Fatal Accidents Act 1976 (R-U), c 30; Domestic Proceedings and Magistrates’ Courts Act 1978 (R-U), c 22; Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975, constituant l’art 146 du Capital Transfer Tax Act 1984 (R-U), c 51; Children Act 1989 (R-U), c 41; Family Law Act 1996 (R-U), c 27; Civil Partnership Act 2004 (R-U), c 33. Voir aussi R-U, Law Commission, Cohabitation: The Financial Consequences of Relationship Breakdown (Law Com no 307), Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 2007; « Ending a Relationship » Citizens Advice, en ligne : <www.citizensadvice.org.uk/family/ending-a-relationship/>, archivé à https://perma.cc/EAD7-VYY6.
-
[74]
Voir Polly Curtis, « Legal Aid Cuts Will Hit Women the Hardest, Says Justice Department », The Guardian (26 décembre 2010), en ligne : <www.theguardian.com/law/2010/dec/26/legal-aid-cuts-hit-women-justice> , archivé à https://perma.cc/WN9T-HU2R: « Les cas liés au droit de la famille, y compris ceux de divorce et de résidence des enfants, ne ser[ont] plus éligibles à l’aide juridique sauf s’il a été prouvé qu’il y a eu violence familiale, mariage forcé ou enlèvement international d’enfant » [notre traduction]. Voir aussi Emily Dugan, « Courts Becoming Clogged as Legal Aid Cuts Affect Separating Couples Seeking Mediation », The Independent (13 janvier 2014), en ligne : <www.independent.co.uk/news/uk/politics/courts-becoming-clogged-as-legal-aid-cuts-affect-separating-couples-voirking-mediation-9057133.html>, archivé à https://perma.cc/3CD8-4YZT; « Government’s Legal Aid Cuts Will Harm Women and Children, Says National Meeting of Family Barristers », Family Law Week (19 septembre 2011), en ligne : <www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed86242>, archivé à https://perma.cc/XB53-TFN2.
-
[75]
Voir Douglas et al, Social Cohesion and Civil Law, supra note 5 à la p 29 :
Les conseils de la charia servent de structures alternatives de résolution des conflits; ils appliquent les principes juridiques et éthiques musulmans ainsi que les normes culturelles de leur collectivité. Les conseils de la charia ont trois rôles principaux : réconciliation et médiation; délivrance de certificats de divorce; et publication d’opinions de spécialistes sur le droit de la famille musulman et sa pratique [notre traduction, notes omises].
Voir aussi Ministry of Justice, supra note 69, annexe B à la p 2.
-
[76]
Douglas et al, Social Cohesion and Civil Law, supra note 5 à la p 44.
-
[77]
Pour plus de détails sur les problèmes sociaux en Grande-Bretagne (y compris en Angleterre) et sur la façon dont ils sont perçus par le peuple britannique, voir les rapports thématiques du NatCen Social Research, en ligne : <www.natcen.ac.uk/our-research/>, archivé à https://perma.cc/5GMT-P5W5. Voir notamment NatCen Social Research, British Social Attitude 29 (2012), par Alison Park et al, dir, Londres (R-U), 2012, NCSR, en ligne : <www.bsa.natcen.ac.uk/media/38852/bsa29_full_report.pdf>, archivé à https://perma.cc/987R-MR5R; NatCen Social Research, British Social Attitudes 2013: Attitudes to Immigration, Londres, NCSR, 2013, en ligne : <www.natcen.ac.uk/media/205573/immigration-bsa31.pdf>, archivé à https://perma.cc/44B6-GTNR; R-U, Home Office, Social and Public Service Impacts of International Migration at the Local Level (Research Report 72) par Sarah Poppleton et al, Londres, Home Office, 2013, en ligne : <www.gov.uk/government/publications/social-and-public-service-impacts-of-international-migration-at-the-local-level>, archivé à https://perma.cc/238X-TT2J.
-
[78]
Voir R-U, House of Commons Library, Forced Marriage (Standard Note SN/HA/1003) par Oonagh Gay, Londres, House of Commons Library, 2015 à la p 1 [House of Commons Library, Forced Marriage] (un mariage est considéré comme arrangé quand « les deux parties consentent pleinement et librement au mariage, malgré que les familles aient joué un rôle prépondérant dans le choix du conjoint » [notre traduction]). Voir aussi PR Jones et S Shah, « Arranged Marriages: A Sample Survey of the Asian Case » (1980) 8:3 New Community 339; Prakash Shah, « Inconvenient marriages, or what happens when ethnic minorities marry trans-jurisdictionally » (2010) 6:2 Utrecht L Rev 17.
-
[79]
Voir House of Commons Library, Forced Marriage, supra note 78 à la p 1 : un mariage est considéré comme forcé lorsque « il a été décidé sans le consentement valide des deux personnes, lorsqu’il y a eu pression ou violence » [notre traduction]. Voir aussi Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 (R-U), c 20; R-U, GOV.UK, « Forced Marriage », en ligne : <www.gov.uk/stop-forced-marriage>, archivé à https://perma.cc/SLV9-9UBC; Anne Phillips et Moira Dustin, « UK Initiatives on Forced Marriage: Regulation, Dialogue and Exit » (2004) 52:3 Political Studies 531; Sundari Anitha et Aisha Gill, « Coercion, Consent and the Forced Marriage Debate in the UK » (2009) 17:2 Fem Leg Stud 165.
-
[80]
Voir Pearl et Menski, Muslim Family Law, supra note 16 à la p 273; Sebastian Poulter, English Law and Ethnic Minority Customs, Londres (R-U), Butterworths, 1986 à la p 45.
-
[81]
Voir Poulter, Ethnicity, Law and Human Rights, supra note 64 aux pp 207–08.
-
[82]
Divorce (Religious Marriages) Act 2002, (R-U), c 27, art 10A.
-
[83]
Ibid, arts 10A(1) et (2).
-
[84]
Douglas et al, Social Cohesion and Civil Law, supra note 5 à la p 14. Douglas affirme clairement que l’État ne reconnaît pas ainsi le divorce religieux, mais il retarde le divorce afin de s’assurer que la situation des parties est protégée, de la même manière qu’il peut le faire pour s’assurer que les arrangements qui concernent les enfants, ou les questions financières, ont été réglés de manière satisfaisante.
-
[85]
Voir ibid.
-
[86]
Voir Fournier, « Secular Portraits and Religious Shadows: An Empirical Study of Religious Women in France » dans Jacques Berlinerblau, Sarah Fainberg et Aurora Nou, dir, Secularism on the Edge: Rethinking Church–State Relations in the United States, France, and Israel, New York, Palgrave Macmillan, 2014, 219 à la p 227 [Fournier, « Secular Portraits »]; Pascale Fournier et Pascal McDougall, « False Jurisdictions?: A Revisionist Take on Customary (Religious) Law in Germany » (2013) 48:3 Texas Int’l LJ 435 aux pp 440, 454. Sur le même genre de démarches par le Birmingham Sharia Council au Royaume-Uni, voir Gillian Douglas et al, « Accommodating Religious Divorce in the Secular-State: A Case Study Analysis », dans Mavis Maclean et John Eekelaar, dir, Managing Family Justice in Diverse Societies, Oxford, Hart, 2013, 185 à la p 193.
-
[87]
Ce monopole n’est valide que pour les citoyens français. Ainsi, les non-ressortissants, peu importe depuis combien de temps ils vivent en France, seront jugés selon des lois étrangères (souvent religieuses) par des tribunaux français dans les cas de disputes familiales (voir Sami Aldeeb et Andrea Bonomi, Le droit musulman de la famille et des successions à l’epreuve des ordres juridiques occidentaux, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1999 à la p 340).
-
[88]
Voir Trib gr inst Lille, 1 avril 2008, (2008) D 1389, no 07-08458; Philippe Malaurie, « Mensonge sur la virginité et nullité du mariage » (2008) 26 JCP 440. La décision a été infirmée en appel, où l’élément religieux (le fait de mentir sur sa virginité) a été rejeté comme élément essentiel du contrat de mariage en droit civil (CA Douai, 17 novembre 2008, (2008) D 2938, no 08-03786).
-
[89]
Judith Surkis, « Hymenal Politics: Marriage, Secularism, and French Sovereignty » (2010) 22:3 Public Culture 531 à la p 532.
-
[90]
Cass soc 19 mars 2013, (2013) Bull civ V 77, no 11-28.845. Cette décision a été récemment annulée par la Cour d’appel de Paris, qui a statué que le licenciement de la femme voilée n’était pas discriminatoire (CA Paris, 27 novembre 2013, [2014] 7 Gaz Pal 22 (note Joël Colonna et Virginie Renaux-Personnic), no 13/02981.
-
[91]
Voir par ex Malika Sorel, Claude Sicard et Haoues Seniguer, « La France a un incroyable aveuglement... sur l’islam : le débat public est-il totalement décalé de la perception qu’en ont les Français au quotidien ? », Atlantico (21 mars 2013), en ligne : <www.atlantico.fr/decryptage/decalage-entre-notre-reflexion-integration-musulmans-et-perception-moyenne-francais-malika-sorel-claude-sicard-et-haoues-675602.html>, archivé à https://perma.cc/8H8A-EVCU.
-
[92]
Pour en savoir plus sur l’expérience d’immigration des musulmans en Grande-Bretagne, voir Tahir Abbas, Islamic Radicalism and Multicultural Politics: The British Experience, London, Routledge, 2011 aux pp 44–46, et sur l’opinion publique, l’islamophobie et « l’altérisation » des musulmans, aux pp 85–106. Voir aussi Waqar IU Ahmad et Ziauddin Sardar, dir, Muslims in Britain: Making social and political space, New York, Routledge, 2012.
-
[93]
Voir Shah, « Shari’a in the West », supra note 55 à la p 18.
-
[94]
Sur la montée en Angleterre de la vision des musulmans comme étant « autres » et l’interaction possible au sein d’une culture publique commune, voir Samia Bano, « Islamic Family Arbitration, Justice and Human Rights in Britain » (2007) 1 L Social Justice & Global Development à la p 4, en ligne : <warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2007_1/bano>, archivé à https://perma.cc/NYE2-TJSY [Bano, « Islamic Family Arbitration »].
-
[95]
L’expérience de vie en ghetto des musulmans français a été amplement décrite dans la littérature, et, dans le cas des filles et des femmes musulmanes, de manière très pertinente par Trica Danielle Keaton, Muslim Girls and the Other France: Race, Identity Politics, & Social Exclusion, Bloomington (Ind), Indiana University Press, 2006, particulièrement à la p 67. Voir aussi Amikam Nachmani, Europe and its Muslim Minorities: Aspects of Conflict, Attempts at Accord, Eastborne (R-U), Sussex Academic Press, 2009 à la p 117, où Nachmani se réfère à la déclaration de Ben-Simon sur « le processus impitoyable et même cruel de la ghettoïsation. Il décrit la fureur et la violence qui explosent par intermittence » [notre traduction].
-
[96]
Voici ce qu’affirme Roger Ballard dans l’article de Bano, « Islamic Family Arbitration », supra note 94 à la p 5 :
L’utilisation continue du point de référence de l’homme raisonnable ne permet pas de reconnaître de manière adéquate les codes culturels et comportementaux des plaideurs, ce qui affecte l’administration de la justice en Angleterre. Par conséquent, le droit anglais demeure restrictif et peine à comprendre les cadres religieux et culturel qu’utilisent les plaideurs de minorités ethniques pour résoudre leurs différends [notre traduction].
-
[97]
Voir par ex Ihsan Yilmaz, « Law as Chameleon: The Question of Incorporation of Muslim Personal Law into the English Law » (2001) 21:2 J Muslim Minority Affairs 297 à la p 298.
-
[98]
Voir par ex Mathias Rohe, « On the Applicability of Islamic Rules in Germany and Europe » (2003–2004) 3 European Yearbook of Minority Issues 181 à la p 187.
-
[99]
Voir par ex Pascale Fournier, « Calculating Claims: Jewish and Muslim Women Navigating Religion, Economics and Law in Canada » (2012) 8:1 Intl JL in Context 47 aux pp 60–62 [Fournier, « Calculating Claims »]; Farrah Ahmed, « Personal Autonomy and the Option of Religious Law » (2010) 24:2 Int’l JL Pol’y & Fam 222 aux pp 229–30; Sonia N Lawrence, « Cultural (in)Sensitivity: The Dangers of a Simplistic Approach to Culture in the Courtroom » (2001) 13:1 CJWL 107 à la p 119 (indiquant que la mise en oeuvre de multiples préjugés peut entraîner l’exclusion des voix des femmes sur des questions de cultures « Autres »); Sherene H Razack, « The ‘Sharia Law Debate’ in Ontario: The Modernity/Premodernity Distinction in Legal Efforts to Protect Women from Culture » (2007) 15:1 Fem Leg Stud 3 à la p 29 (indiquant que les femmes musulmanes peuvent se trouver face à des juges patriarcaux et racistes dans les cours séculaires).
-
[100]
Voir par ex Conseil de l’Europe, Stratégie du Conseil de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les hommes, « Garantir aux femmes l’égalité d’accès à la justice » (2016) à la p 4, en ligne : <rm.coe.int/168066d6ee>, archivé à https://perma.cc/PH2X-CAJH.
-
[101]
Voir Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani et Jana Rumminger, dir, Men in Charge?: Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition, Londres (R-U), Oneworld, 2015 sur la façon dont les femmes musulmanes de certains États vivent et négocient avec les interprétations religieuses et les normes sociojuridiques qui façonnent leur vie.
-
[102]
C’était le cas pour la participante no 4, une catholique française qui s’était convertie à l’Islam et n’avait aucun lien avec la communauté musulmane par sa famille d’origine, et la participante no 5, une juive qui se considérait comme non-croyante. D’autres femmes étaient encore plus critiques envers le droit religieux, comme la participante no 2.
-
[103]
M Piamenta, Islam in Everyday Arabic Speech, Leyde (Pays-Bas), EJ Brill, 1979 à la p 192.
-
[104]
L’Agunot Campaign est un organisme qui se consacre à remédier à l’injustice dont souffrent les femmes juives à qui les maris refusent le divorce religieux (appelé get) après qu’il y ait eu une rupture irrémédiable du mariage.
-
[105]
Voir NJ Coulson, « The State and the Individual in Islamic Law » (1957) 6:1 ICLQ 49 à la p 60; Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years, Londres, Pluto Press, 1994 à la p 36 et s.
-
[106]
Voir Abdal-Rehim, supra note 15 à la p 105.
-
[107]
Voir El Alami et Hinchcliffe, supra note 15 aux pp 22, 27.
-
[108]
Voir par ex Jørgen S Nielsen, « Islam and secular values in Europe: from canon to chaos? » dans Peter Cumper et Tom Lewis, dir, Religion, Rights and Secular Society: European Perspectives, Cheltenham (R-U), Edward Elgar, 2012, 271 à la p 286.
-
[109]
L’Ijtihad, qui signifie « réflexion ou interprétation personnelle », est un processus qui vise à créer de nouvelles règles juridiques pour représenter des principes religieux abstraits. Ce concept est souvent mis de l’avant par des spécialistes libéraux du droit islamique qui, contrairement aux plus traditionalistes, mettent l’accent sur la nécessité de changer et de faire évoluer les règles du droit islamique, tout en demeurant conforme à l’esprit des sources religieuses de l’Islam (voir Tariq Ramadan, « Itjihad and Maslaha: The Foundations of Governance » dans MA Muqtedar Khan, dir, Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspectives, Lanham, Lexington Books, 2006, 3 aux pp 3–20). Pour un récent appel à « ouvrir les portes de l’ijtihad » afin de réformer la pensée juridique islamique, voir Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, « Viewpoint: Door of Ijtihad is Open » (12 avril 2005), The Islamic Supreme Council of America, en ligne : <www.islamicsupremecouncil.org/publications/articles/45-viewpoint-door-of-ijtihad-is-open.html>, archivé à https://perma.cc/P6F6-3ZBZ.
-
[110]
Voir généralement Duncan Kennedy, « Form and Substance in Private Law Adjudication » (1976) 89:8 Harv L Rev 1685.
-
[111]
Voir Lama Abu-Odeh, « Modernizing Muslim Family Law: The Case of Egypt » (2004) 37:4 Vand J Transnat’l L 1043 aux pp 1063–64.
-
[112]
Voir Louis M Epstein, The Jewish Marriage Contract: A Study in the Status of the Woman in Jewish Law, Clark (NJ), Lawbook Exchange, 2004 aux pp 162–63.
-
[113]
Voir Fournier, « Calculating Claims », supra note 99 aux pp 50–57.
-
[114]
John L Esposito et Natana J DeLong-Bas, Women in Muslim Family Law, 2e éd, Syracuse, Syracuse University Press, 2001 à la p 23.
-
[115]
Fournier, Muslim Marriage, supra note 28 à la p 87.
-
[116]
Voir Gabrielle Atlan, Les Juifs et le divorce : Droit, histoire et sociologie du divorce religieux, Berne, Peter Lang, 2002 aux pp 231–34.
-
[117]
Cela va dans le même sens que Prakash Shah, qui parle de « [...] l’émergence d’une pression de la base vers les autorités de certains groupes de la population musulmane au fur et à mesure qu’ils rebâtissent leurs univers juridiques dans les pays occidentaux. Ce mouvement va de pair avec les mécanismes officiels en place qui visent à reconnaître, ou à rejeter, les règles de la charia » [notre traduction] (Shah, « Shari’a in the West », supra note 55 à la p 19).
-
[118]
Il faut mettre un bémol ici. Tel que mentionné par Douglas et al dans Social Cohesion and Civil Law, supra note 5 à la p 48 : « Ce remède n’est pas efficace si le mari ne souhaite pas lui-même pouvoir se remarier selon la loi civile, puisque dans ce cas, l’obtention d’un divorce civil ne lui importera pas. Le beth din de Londres considère toutefois que la législation avait réduit le nombre d’agunot » [notre traduction].
-
[119]
Hasan, Entrevue, supra note 62.
-
[120]
Voir Linda S Kahan, « Jewish Divorce and Secular Courts: The Promise of Avitzur » (1984) 73:1 Geo LJ 193 à la p 193, n 2 : les dispositions financières prévues par la ketubah sont applicables en Israël, mais pas dans les pays occidentaux comme les États-Unis. Voir aussi Jonathan Reiss et Michael J Broyde, « Prenuptial Agreements in Talmudic, Medieval, and Modern Jewish Thought » dans Michael J Broyde et Michael Ausubel, dir, Marriage, Sex, and Family in Judaism, Oxford, Rowman & Littlefield, 2005, 192 aux pp 202–03.
-
[121]
Voir Susan Metzger Weiss, « Sign at Your Own Risk: The “RCA” Prenuptial May Prejudice the Fairness of Your Future Divorce Settlement » (1999) 6 Cardozo Women’s LJ 49 à la p 54; Epstein, supra note 112 à la p 163; Deborah Greniman, « The Origins of the Ketubah: Deferred Payment or Cash Up Front? » (2001) 4 Nashim: J Jewish Women’s Studies & Gender Issues 84 à la p 109
-
[122]
Voir Ruth Halperin-Kaddari, Women in Israel: A State of their Own, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2004 à la p 252.
-
[123]
Bano, « Muslim Family Justice », supra note 63 à la p 53.
-
[124]
Voir Maleiha Malik, supra note 28 à la p 47. Des conclusions semblables ont été reconnues par le Ministère de la Justice : « Des chiffres issus de groupes communautaires démontrent que de tels cas [de mariages non enregistrés] constituent une forte proportion de leur travail, et que leur nombre était en progression. » [notre traduction] (Ministry of Justice, supra note 69, annexe B à la p 1). Dans une étude publiée en 2007 auprès de femmes musulmanes d’origine pakistanaise en Grande-Bretagne, on a rapporté que moins de la moitié des participantes qui avaient un mari en Angleterre avaient eu un mariage enregistré (voir Bano, « Muslim Family Justice », supra note 63 à la p 51).
-
[125]
Entrevue de Michel Foucault par François Ewald, dans « Le souci de la vérité », Magazine littéraire no 207 (mai 1984), 18 à la p 22.
-
[126]
Voir Fournier, « Secular Portraits », supra note 86; Fournier, « Calculating Claims », supra note 99; Fournier et McDougall, supra note 86. Là encore, l’auteure est consciente qu’il faudrait davantage d’études empiriques en lien avec les pratiques en vigueur des autorités religieuses de ces deux communautés, et la justification de ces pratiques, pour renforcer cette affirmation.
-
[127]
Voir Fournier, « Calculating Claims », supra note 99 aux pp 50–57. Selon le droit de la famille islamique, le mariage instaure un système de réciprocité dans lequel chaque partie se voit attribuer un ensemble de droits et de devoirs contractuels envers l’autre partie (voir Abu-Odeh, supra note 111 aux pp 1063–64). Un contrat de mariage islamique ne peut être conclu que par les mécanismes de l’offre (ijab) et de l’acceptation (qabul) par les parties ou leurs mandataires (voir généralement Jamal J Nasir, The Islamic Law of Personal Status, 3e éd, La Haye, Kluwer Law International, 2002 à la p 45). Le mariage assure au mari le droit à l’obéissance de sa femme ainsi que le droit de restreindre ses déplacements à l’extérieur de la demeure conjugale. La femme acquiert le droit au mahr et le droit à l’entretien. Nafaqa est la « première obligation de l’époux » envers sa femme et « inclut la nourriture, les vêtements et le logement » [notre traduction] (Esposito et DeLong-Bas, supra note 114 à la p 25). Voir aussi Dr M Afzal Wani, The Islamic Law on Maintenance of Women, Children, Parents & Other Relatives: Classical Principles and Modern Legislations in India and Muslim Countries, Noonamy (Cachemire), Upright Study Home, 1995 aux pp 194–95). Comme le mariage musulman, le mariage juif est conclu selon des principes contractuels. Les parties exécutent un contrat de mariage (un ketubah, pl.: ketubot), souvent écrit en araméen, où sont énumérés les devoirs de chaque époux. Voir Jodi M Solovy, « Civil Enforcement of Jewish Marriage and Divorce: Constitutional Accommodation of a Religious Mandate » (1996) 45:2 DePaul L Rev 493 aux pp 495–96. Contrairement au contrat de mariage musulman, qui est négocié entre les deux parties et qui est, par le fait même, unique à chaque couple, le ketubah est plutôt un contrat type. Comme l’expliquent Elliot N Dorff et Arthur Rosett, « [l]es parties peuvent déterminer par contrat uniquement les éléments de la relation que le droit les autorise à choisir » [notre traduction] (Arthur Rosett, A Living Tree: The Roots and Growth of Jewish Law, Albany (NY), State University of New York Press, 1988 à la p 453). Fondé sur ce que dit la Torah au sujet des devoirs du mari envers sa femme, ce contrat inclut pour le mari l’obligation de fournir la nourriture, les vêtements, le logement et d’avoir des relations sexuelles régulières ainsi que le paiement d’un montant d’argent à sa femme en cas de divorce ou de mort. Voir aussi Epstein, supra note 112 aux pp 162–63.
-
[128]
Susan Weiss, « Israeli Divorce Law: The Maldistribution of Power, its Abuses, and the “Status” of Jewish Women » dans Rachel Elior, dir, Men and Women: Gender, Judaism and Democracy, Jérusalem, Urim pour le Van Leer Jerusalem Institute, 2004, 53 à la p 63. Voir aussi Philippa Strum, « Women and the Politics of Religion in Israel » (1989) 11:4 Hum Rts Q 483 à la p 496 (« Le problème n’est pas la halakha, [...] mais la personne qui l’interprète » [notre traduction]).
-
[129]
Voir par ex Naomi Graetz, Unlocking the Garden: A Feminist Jewish Look at the Bible, Midrash and God, Piscataway (NJ), Gorgias Press, 2005 à la p 4 (« [C]omme le féminisme est inséparable de notre orientation religieuse et est considéré comme faisant partie de notre conception de la spiritualité et du sacré, ses enseignements devraient être intégrés. Nous lisons ces textes en posant des questions de notre époque et cherchons à découvrir des sens [...] qui se rapportent à ces questions » [notre traduction]); Tamar Ross, Expanding the Palace of Torah: Orthodoxy and Feminism, Waltham (Mass), Brandeis University Press, 2004 à la p xvi (« [L]e féminisme doit être vu comme une menace pour le judaïsme traditionnel. » [notre traduction]); Esther Fuchs, « Jewish Feminist Scholarship: A Critical Perspective » dans Leonard J Greenspoon, Ronald A Simkins et Jean Axelrad Cahan, dir, Studies in Jewish Civilization: Women and Judaism, vol 14, Omaha (Nebr), Creighton University Press, 2003, 225 à la p 225 (on y décrit la recherche sur le féminisme juif comme étant « un nouveau champ d’étude » [notre traduction]); Judith Hauptman, « Feminist Perspectives on Rabbinic Texts » dans Lynn Davidman et Shelly Tenenbaum, dir, Feminist Perspectives on Jewish Studies, New Haven (Conn), Yale University Press, 1994, 40 à la p 43 (« [I]l y a eu dernièrement une explosion du nombre d’ouvrages de vulgarisation sur le féminisme et le judaïsme » [notre traduction]); Norma Baumel Joseph, « Jewish Law and Gender » dans Rosemary Skinner Keller et Rosemary Radford Ruether, dir, Encyclopedia of Women and Religion in North America, vol 1, Bloomington (Ind), Indiana University Press, 2006, 576 à la p 588 (« Étant donné que le système juridique se veut adaptable, une bonne partie de ce qui constitue le [droit juif] peut être traité en utilisant le langage et le vocabulaire d’aujourd’hui, en utilisant l’expérience des femmes pour en forcer l’ouverture » [notre traduction]). Voir aussi Laura Levitt, Jews and Feminism: The Ambivalent Search for Home, New York, Routledge, 1997 à la p 128 (où l’auteure raconte son expérience d’acceptation du féminisme et sa libération en tant que femme juive); Isaac Sassoon, The Status of Women in Jewish Tradition, New York, Cambridge University Press, 2011 à la p vii (« [L]a présence de recherche féministe dans la religion est en hausse parce qu’il y a plus en jeu qu’une simple étude universitaire » [notre traduction]).
-
[130]
Voir par ex Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New Haven (Conn), Yale University Press, 1992 à la p 63 (où l’on avance que la voix de l’islam peut être « opiniâtrement égalitariste » [notre traduction]); Asma Barlas, “Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an, Austin, University of Texas Press, 2002 à la p 2 (où l’on avance que « l’épistémologie du Coran est intrinsèquement antipatriarcale » [notre traduction]); Amina Wadud, Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, New York, Oxford University Press, 1999 aux pp 79–80 (on y met l’accent sur le fait que les femmes peuvent bénéficier d’une « sagesse coranique plus vaste qui vise à une réconciliation harmonieuse » [notre traduction]); Fatima Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society, Bloomington (Ind), Indiana University Press, 1987 à la p 52 (où l’on avance que le talaq est une tradition arabe que le Prophète lui-même ne respectait pas). Voir aussi Barbara Stowasser, « Gender Issues and Contemporary Qur’an Interpretation », dans Yvonne Yazbeck Haddad et John L Esposito, dir, Islam, Gender, & Social Change, New York, Oxford University Press, 1998, 30 à la p 34 (où l’on discute de l’école moderniste et de son esprit réformiste).