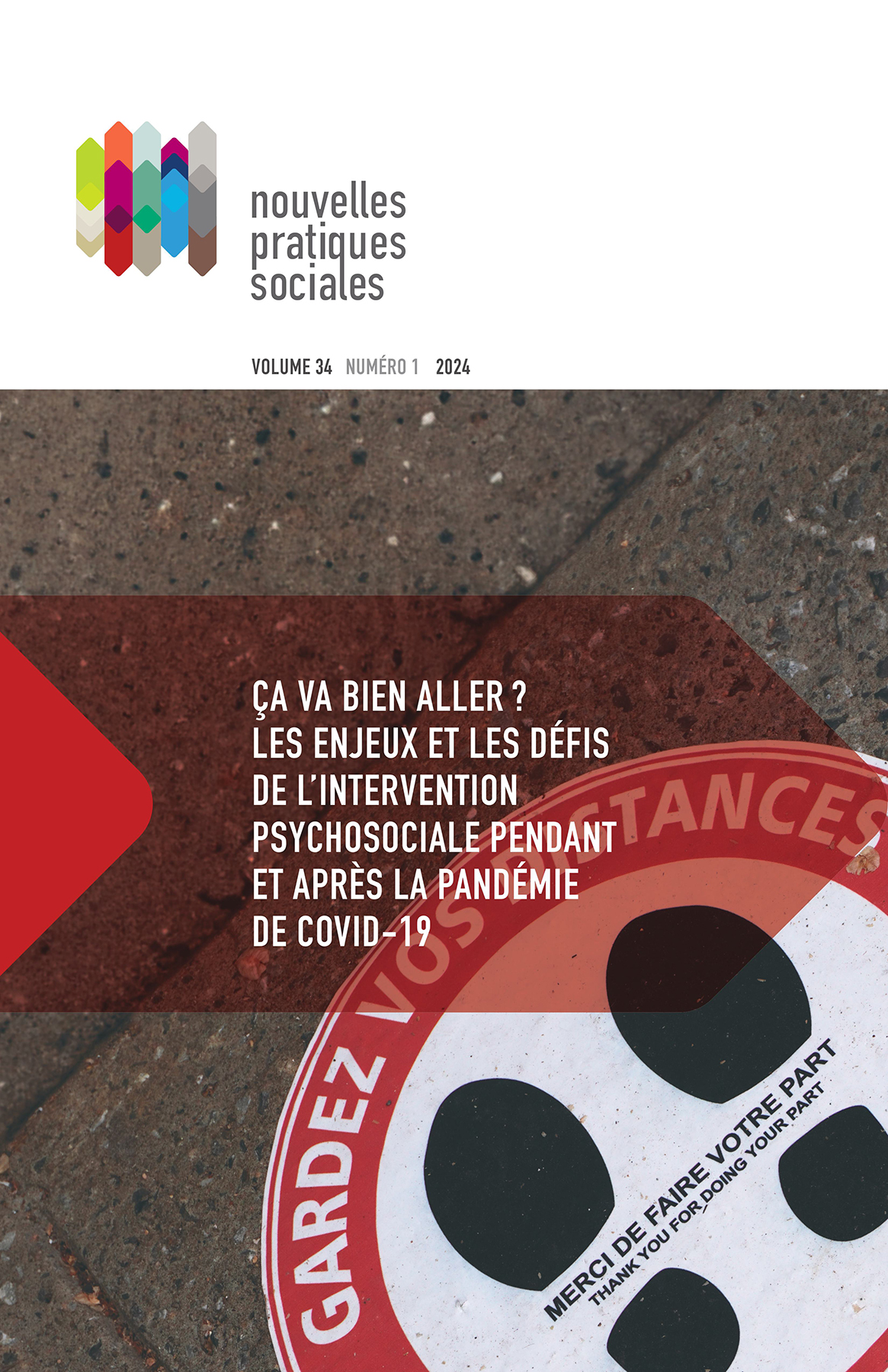L’ouvrage Messy Ethics in Human Rights Work ne suit pas le modèle traditionnel des livres universitaires. Le livre se veut un espace inclusif des différentes sources de savoirs et cherche à bousculer les normes du monde de la recherche afin de faire davantage de place à une pluralité de voix. Chaque chapitre (tous écrits à la première personne) narre un épisode vécu par un collaborateur.trice à l’occasion duquel un défi éthique est survenu : s’ensuit une explication quant au processus et à la réflexion qui ont précédé sa prise de décision, quant à ses sentiments vis-à-vis de la situation et quant à sa décision finale. Étant donné la richesse et la diversité des parcours des collaborateur.trice.s, les chapitres ne suivent pas un modèle précis. En réunissant une variété d’histoires, l’ouvrage vise à créer des liens et à générer des échanges et des introspections sur le domaine des droits humains. Ici, l’expérience est considérée comme une source légitime de savoir. Le livre s’articule autour du fait que le travail dans le domaine des droits humains ne peut être enfermé dans un lieu ou une période fixe et que, par conséquent, les dilemmes éthiques sont nombreux, récurrents et peuvent prendre toutes sortes de formes. Qu’on soit journalistes, chercheur.euse.s, artistes, bénévoles, travailleur.euses.s humanitaires ou qu’on participe à la création de nouvelles politiques, il arrive d’être confrontés à des incompatibilités entre nos valeurs, les procédures et nos responsabilités liées à notre poste. L’ouvrage étant constitué de 13 situations plus différentes les unes que les autres, il serait impossible de les résumer toutes ici; des exemples seront cependant présentés dans le but d’illustrer avec plus de précision les fils conducteurs susmentionnés. J’ai tenté de diversifier les exemples, c’est-à-dire de prendre des situations issues de différents milieux, et non uniquement du milieu de la recherche. Cependant, deux fils conducteurs se dessinent à travers l’ouvrage et permettent de distinguer deux catégories distinctes de cas : 1) les dilemmes éthiques qui surgissent du respect des règles telles qu’établies par les institutions ; et 2) les dilemmes éthiques qui apparaissent lorsqu’on s’éloigne des règles établies en adoptant une approche distincte. La première partie du livre – Dilemmes éthiques lorsqu'on suit les règles – nous force à reconnaître que les institutions occupent une place importante dans la gestion des dilemmes éthiques. Cependant, le fonctionnement, les mesures et les règles des institutions ne sont pas toujours exempts d’éléments non éthiques : parfois, ces éléments ne sont clairement pas éthiques (par exemple, lorsque l’institution s’appuie sur le colonialisme, le nationalisme, le patriarcat, bref des systèmes d’oppression). Parfois, ces éléments sont ambigus éthiquement parlant. Parmi les exemples les plus marquants, notons celui de Maritza Felices-Luna, criminologue et professeure agrégée à l’Université d’Ottawa. Dans le cadre d’une demande de subvention pour financer un projet de recherche, la professeure devait établir le budget détaillé du projet. Le dilemme éthique est apparu lorsqu’est venu le temps de déterminer le salaire de l’assistant de recherche congolais (le projet prévoyait d’embaucher deux assistants : un Canadien et un Congolais). Trois options s’offraient à elle : 1) verser le même salaire aux deux assistants, 2) verser à l’assistant congolais un salaire proportionnellement équivalent à celui de l’assistant canadien dans le but de lui fournir un pouvoir d’achat semblable ou 3) verser à l’assistant congolais un salaire correspondant aux normes locales. Cependant, aucune des trois options ne lui semblait idéale. Les options 2) et 3) créaient une grande inégalité entre les deux assistants. La première option comptait elle aussi son lot de zones grises, car payer l’assistant congolais selon les normes canadiennes signifiait que l’assistant congolais allait se voir verser …
Appendices
Bibliographie
- Plaut, S., Bilotta, N., Rosenoff Gauvin, L., Clark-Kazak, C. et Felices-Luna, M (dir.). (2023). Messy Ethics in Human Rights Work. Vancouver : University of British Columbia Press.