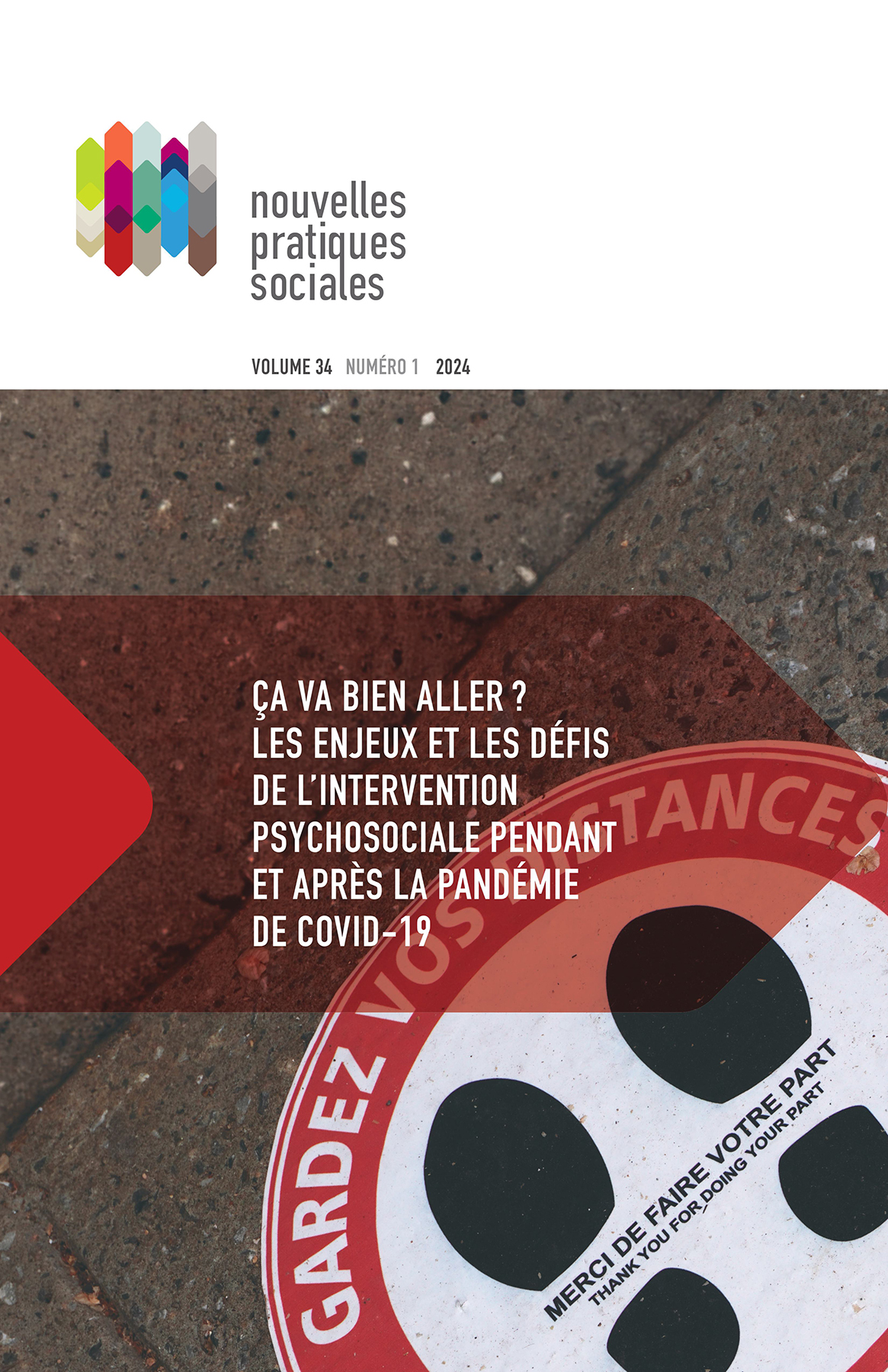Auteur de plusieurs articles et d’une dizaine de livres, Jean-Luc Prades est docteur en sociologie clinique et sociopsychanalyste. Après La démocratie sclérosée, l’auteur poursuit ses réflexions cliniques et politiques avec cet ouvrage traitant des formes de servitude qui s’imposent actuellement dans la société et qui compromettent les pratiques démocratiques y compris dans nos institutions. Cette fois-ci, il nous invite urgemment à penser au pire pour espérer le meilleur. Fidèle aux repères sociopsychanalytiques de sa critique, il nous propose un détour historique sur des enjeux psychosociaux ayant permis les génocides, les meurtres de masse et l’usage des technologies de surveillance associées à ce qui est qualifié « d’intelligence artificielle ». Cette stratégie d’analyse s’avère heuristique, car elle lui permet d’enrichir la compréhension des transformations des rapports d’autorité qui tendent à s’imposer dans les organisations actuelles. La structure de l’ouvrage est composée principalement d’extraits d’articles déjà publiés composant autant de chapitres lui permettant de tracer un fil conducteur de son analyse au long cours. Les 6 premiers chapitres du livre présentent 28 idées simples (mais non simplistes) ponctuant le raisonnement de l’auteur sur l’actualité des formes de servitude dans la société actuelle et les organisations. L’ouvrage se termine en montrant qu’il est encore possible de faire autrement pour favoriser des liens sociaux démocratiques malgré la chape de plomb néolibérale qui s’est abattue depuis une quarantaine d’années sur tous les pays occidentaux. Même si les organisations étudiées par l’auteur sont situées en France, ces exemples rejoignent pleinement les réalités québécoises ; mondialisation des « bonnes pratiques » oblige. Évoquons quelques-unes des idées balisant la réflexion de Jean-Luc Prades sur la soumission. Pour l’auteur, nos sociétés divisées favoriseraient des rapports sociaux de servitude dont l’aliénation reposerait sur la dialectique maître-esclave où l’obéissance est contrainte ou volontaire. L’héritage des Lumières ne nous aurait pas libérés de cette dynamique de pouvoir asymétrique, pensons seulement aux millions d’êtres humains sacrifiés pendant les deux guerres mondiales, les régimes fascistes et l’instauration progressive du taylorisme avec ses prolongements actuels et la « perte de sens objective du travail ». Le modèle technologique imposé comme le néotaylorisme actuel de la Nouvelle Gestion publique constituerait une nouvelle forme d’aliénation adaptée aux aspirations hyperindividualistes de réalisation de soi. Il s’agit d’une forme de servitude volontaire moderne exigeant « l’implication contrainte » et la subordination de l’implication subjective du salarié. Le salariat a toujours été dans une relation de subordination, mais le travail moderne et la logique d’accumulation du capital mobiliseraient l’engagement subjectif et l’implication contrainte des individus. Si la soumission est moins brutale dans les régimes démocratiques, l’histoire des génocides nous montre que l’oubli et le mensonge permettent de détourner le regard de ce que l’on ne veut pas savoir. Conjugué à l’hyperindividualisme ambiant, ce phénomène psychosocial de déni entretiendrait l’illusion d’une liberté « où l’on est libre de réussir en exécutant au mieux ce que l’on n’a pas décidé soi-même » (p. 50). Jean-Luc Prades ajoute que la primauté de soi sur le bien commun favoriserait la déliaison entre les êtres et l’ensemble commun. L’illusion de l’autonomie de soi permet de masquer le fait que celle-ci est inscrite dans une logique marchande confondant ainsi l’émancipation avec l’aliénation. C’est ce que Prades appelle, en s’inspirant de Gérard Mendel : « l’auto-autorité à distance » dont la figure idéaltypique serait l’opérateur de drone armé. C’est d’ailleurs sous la forme de l’injonction paradoxale que ce rapport d’autorité s’imposerait dans les organisations de services publics. Pour Prades, si cette liberté sous contrainte est « consentie » par bon nombre de professionnel.le.s du travail social, malgré ses effets néfastes sur le plan de l’autonomie professionnelle, …
Appendices
Bibliographie
- Parazelli, M. et Ruelland, I. (2017). Autorité et gestion de l’intervention sociale : entre servitude et actepouvoir. Québec : Presses de l’Université du Québec.
- Prades, J.-L. (2015). Sociopsychanalyse et psychofamilialisme. sortir de la psychologisation du social. Nouvelle revue de psychosociologie, 20(2), 213-232 https://doi.org/10.3917/nrp.020.0213
- Prades, J.-L. (2023). Variations sur les formes de servitude : essai sociopsychanalytique sur la soumission et l’actepouvoir. Paris : l’Harmattan.
- Rueff-Escoubès, C. (2008). La sociopsychanalyse de Gérard Mendel. Autorité, pouvoirs et démocratie dans le travail. Paris : La Découverte.