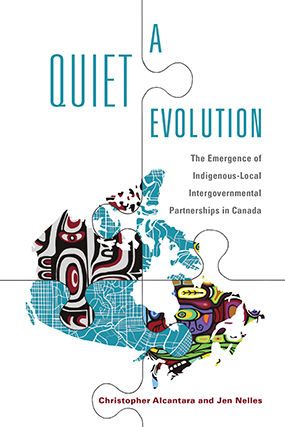Article body
Cet ouvrage s’intéresse aux partenariats entre gouvernements locaux et communautés autochtones au Canada, un sujet qui, à ce jour, a fait l’objet de très peu d’écrits, contrairement aux relations intergouvernementales aux niveaux fédéral et provincial. Les auteurs y examinent les ententes formelles conclues entre des conseils de bande et les conseils de municipalités voisines et développent ensuite quatre études de cas de façon à éprouver leur modèle conceptuel pour expliquer l’émergence de telles ententes.
La collecte des ententes posait en soi tout un défi. Après avoir contacté 2262 municipalités dans les dix provinces et trois territoires canadiens et obtenu un taux de réponse de 80 %, Alcantara et Nelles ont récolté 332 ententes couvrant la période de 1950 à 2014. L’analyse repose sur quatre types d’ententes qu’ils avaient identifiés en 2011 dans leur étude des 93 ententes alors publiquement disponibles en Colombie-Britannique (C.-B.). Il s’agit 1) d’ententes de services, avec ici une nouvelle distinction entre des ententes de fourniture de services tarifés et des ententes de cogestion de services ; 2) des ententes de développement de relations en vue de collaborations futures, qui peuvent être interprétées comme la manifestation d’un intérêt partagé envers l’ensemble des citoyens ; 3) des ententes de décolonisation, qui impliquent la reconnaissance des droits historiques des autochtones et la volonté de développer des relations respectueuses et d’égal à égal; 4) des ententes de développement des capacités impliquant un transfert de connaissances.
Plusieurs constats sont posés ici. Les ententes formelles augmentent en nombre avec les années, la majorité ayant été conclues après 2000. Elles se diversifient avec le temps, les ententes de services étant à peu près les seules qui ont été finalisées avant 2000. Bien que ces dernières continuent de dominer après 2000, les ententes de développement de relations sont maintenant tout aussi nombreuses en Colombie-Britannique. C’est là que le plus grand nombre d’ententes a été collecté (118), puis en Ontario (81), en Saskatchewan (47), au Québec (28), au Yukon (18) et en Nouvelle-Écosse (14), les autres provinces et territoires ayant conclu beaucoup moins d’ententes. Dans l’ensemble, seulement quelques villes fournissent le gros des ententes. Diverses hypothèses sont présentées pour expliquer la distribution des ententes selon la province ou le territoire (proximité des bandes autochtones des centres de populations allochtones, encouragement de la Province, etc.), mais aucune ne satisfait vraiment les auteurs, qui croient que ce sont d’abord des facteurs locaux qui en expliquent l’émergence.
Pour analyser ces facteurs locaux, les auteurs reprennent le cadre conceptuel qu’ils avaient développé en 2014, où la capacité et la volonté politiques étaient vues comme des déterminants de la coopération qui sont eux-mêmes modulés par l’interaction entre six facteurs, soit le cadre institutionnel qui détermine les règles et normes qui gouvernent les processus de prise de décision du côté local et du côté autochtone ; les ressources financières, humaines et matérielles respectives ; les interventions directes et indirectes des paliers de gouvernement supérieurs ; l’histoire des relations entre les communautés et les événements polarisants; l’urgence pour l’une ou l’autre partie ; le capital communautaire, soit le degré d’intégration des communautés, les liens entre leurs leaders et le partage d’une identité civique. C’est à travers quatre études de cas qu’ils viennent valider ce cadre conceptuel.
Les cas sont choisis pour représenter quatre grands types de relations définis par le croisement du niveau d’engagement des partenaires – soit la fréquence des communications afin de régler des enjeux d’intérêt commun – et de l’intensité des partenariats conclus, définie selon le degré d’autonomie sacrifiée pour l’atteinte de buts communs. On parle soit de « grande synergie », si l’engagement et l’intensité sont élevés, ce qui implique un partenariat fortement institutionnalisé; soit de « rapports usuels » s’ils sont faibles, c’est-à-dire qu’on s’en tient à des relations d’affaires sans plus ; de rapports « centrés sur des ententes » si l’engagement est faible mais l’intensité élevée ; ou de « rapports en développement » dans la situation inverse. Cette typologie ne m’a pas semblé très convaincante en grande partie parce que les deux variables en jeu sont sous-définies. Disons qu’elle permet aux auteurs de choisir des cas différents.
Je passe rapidement sur les études de cas pour m’en tenir aux types de relations mis en évidence. Sault-Ste-Marie et les deux Premières Nations voisines, Garden River et Batchewana, illustrent des « rapports usuels », où il y a communications et éventuellement ententes sur des questions prioritaires, mais autrement les habitudes du chacun pour soi dominent. Le racisme à l’égard des autochtones et une histoire de relations tumultueuses incarnées par des personnages toujours en poste ont nui à la formation d’un capital communautaire. À l’autre extrême, le village de Teslin et la Première Nation Teslin Tlingit, au Yukon, sont en « forte synergie », adhérant à des projets communs dont ils partagent les coûts, parfois même si les avantages sont principalement au bénéfice d’une seule des communautés. Les deux communautés sont depuis longtemps intégrées par l’absence de frontière vécue entre leur territoire respectif et par une longue histoire de collaboration. Un deuxième cas au Yukon, celui du village de Haines Junction et des Premières Nations de Champagne et Aishihik, est qualifié de « partenariat en construction », car les communications entre les deux communautés sont excellentes et fréquentes, mais elles n’ont pas encore trouvé une manière d’aligner leurs priorités, principalement parce que la communauté autochtone dessert quatre territoires dont un seul est à proximité de Haines Junction. Enfin, le quatrième cas, celui de la Première Nation Malécite de Viger et de la MRC Les Basques, est présenté comme un « partenariat centré sur une entente ». Il s’agit ici de la promotion commune du Parc régional Inter-Nations situé en terres publiques sur le territoire de la MRC et revendiqué par les Malécites de Viger comme partie du territoire ancestral. L’entente formelle entre les deux parties est partagée à coût égal et elle renforce la position de la MRC qui veut récupérer les droits de chasse et de pêche appartenant toujours au Club privé Appalaches même si le territoire est constitué de terres publiques.
Il n’est pas simple de tirer des conclusions de cas aussi différents, ne serait-ce que par le contexte sociodémographique et géographique. Les auteurs mentionnent toutefois la confirmation de l’intérêt des facteurs que leur modèle conceptuel a identifiés, qui ont tous joué, négativement ou positivement, dans presque tous les cas, sauf celui de Sault-Ste-Marie. Les deux facteurs qui sont les plus généralisés sont le capital communautaire et la nécessité, ce qui s’accorde avec une autre conclusion des auteurs, à savoir que la volonté de coopération joue de manière beaucoup plus importante que les capacités des acteurs, contrairement à ce qui est mis en lumière dans une grande partie de la littérature. En conclusion, Alcantara et Nelles reviennent sur la position neutre sur le plan normatif à laquelle ils ont adhéré, soit de décrire et d’expliquer les types de relations entre communautés sans porter de jugement sur la coopération comme outil stratégique. En somme, la coopération n’est pas nécessairement une voie appropriée pour toutes les situations ; tout dépend du contexte et des préférences de chaque communauté.
J’ai voulu attirer l’attention sur ce court ouvrage parce qu’en commençant à travailler sur le même sujet, j’ai été surprise de la quasi-absence de travaux sur les collaborations entre municipalités et communautés autochtones au Québec. Pourtant, comme ailleurs au Canada, de nombreuses communautés autochtones entretiennent divers rapports avec les villes avoisinantes. En outre, plusieurs sous-régions sont, comme le Yukon, maintenant dominées démographiquement par la population autochtone, ou en voie de l’être, ce qui devrait stimuler un intérêt pour les collaborations.
Un bref survol de la situation m’a indiqué qu’il y a au Québec beaucoup plus que les vingt-huit ententes formelles entre communautés autochtones et gouvernements locaux récupérées par les auteurs ; juste les ententes concernant les infrastructures et services publics sont très nombreuses. Malheureusement, même si en principe toutes les ententes de ce type doivent être approuvées par décret en vertu de la Loi sur ministère du Conseil exécutif, il n’existe pas encore au Québec de compilation systématique et accessible de ce type de documents. On note aussi la faible représentation des communautés québécoises dans les projets pilotes de la Fédération canadienne des municipalités sur le soutien au partenariat (Initiative de développement économique communautaire et Programme de partenariat en infrastructures communautaires Premières Nations-Municipalités) et il faut dire que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et les deux fédérations de municipalités du Québec, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, ont tardé à s’intéresser à cette question. Pourtant, il y a sans aucun doute, au Québec, de nombreuses expériences de collaborations et de partenariat qui méritent qu’on s’y intéresse. Le livre d’Alcantara et Nelles nous offre à cette fin de belles pistes de travail.
Appendices
Références
- FCM (Fédération canadienne des municipalités), s.d. : « Initiative de développement économique communautaire Premières Nations-municipalités ». https://fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire.htm (consulté le 15 décembre 2017).
- FCM (Fédération canadienne des municipalités), s.d. : « Projet de partenariats en infrastructures communautaires ». https://fcm.ca/accueil/programmes/projet-de-partenariats-en-infrastructures-communautaires.htm (consulté le 15 décembre 2017).
- NELLES, Jan, et Christopher ALCANTARA, 2011 : « Strengthening the ties that bind? An analysis of aboriginal-municipal inter-governmental agreements in British Columbia ». Canadian Public Administration /Administration publique du Canada 54(3) : 315-334.
- NELLES, Jan, et Christopher ALCANTARA, 2014 : « Explaining the emergence of indigenous-local intergovernmental relations in settler societies: A theoretical framework ». Urban Affairs Review 50(5) : 599-622.