Article body
Le système des pensionnats indiens du Canada fut l’outil d’une assimilation culturelle forcée et le théâtre d’abus physiques et sexuels perpétrés à l’encontre des enfants autochtones. La Commission de Vérité et Réconciliation (CVR) fut donc mise en place – dans le cadre du règlement de l’un des plus grands recours collectifs intentés au Canada – pour accorder une voix aux victimes et faire la lumière sur ce passé honteux. Grâce à la CVR et à la plateforme qu’elle a offerte aux victimes, le grand public a pu découvrir l’ampleur des atrocités perpétrées. Nombre d’auteurs se sont penchés sur la question des pensionnats indiens au cours des vingt dernières années, notamment depuis la création de la CVR en 2008 (voir, entre autres, Loiselle et al. 2011 ; Tremblay 2008 ; Morantz 2002 ; Reynaud 2017).
Dans son ouvrage, Henri Goulet se donne quant à lui pour mission d’analyser la particularité québécoise dans l’histoire des pensionnats indiens canadiens et ce, en se basant (presque exclusivement) sur les archives des prêtres responsables de ces pensionnats. Il veut ainsi relater l’histoire des quatre pensionnats indiens que l’Ordre des Oblats de Marie-Immaculée administrait au Québec : dans la communauté crie de Fort George (maintenant Chisasibi) à la Baie-James à partir de 1930 ; en campagne près d’Amos en Abitibi à partir de 1955 ; dans la réserve innue de Pointe-Bleue (Mashteuiatsh) au Lac-St-Jean à partir de 1960 ; et dans la réserve innue de Maliotenam, près de Sept-Îles sur la Côte-Nord à partir de 1952. L’oeuvre des Oblats a commencé son déclin lorsque l’administration des pensionnats a été transférée des Églises au gouvernement fédéral, à partir de 1966, et lorsque les fonctions de résidence et d’école sont devenues distinctes, après 1968. Alors sous administration fédérale, la dernière résidence en opération au Québec fut Pointe-Bleue, fermée en 1991 (CVR 2015, I[2] : 9, 50, 88-90).
Cette histoire particulière des pensionnats indiens au Québec inclurait notamment, selon l’auteur, des inscriptions volontaires de leurs enfants dans les pensionnats, par les parents autochtones, et le respect de la culture autochtone par les Oblats.
Nous diviserons donc en trois parties l’analyse critique de cet ouvrage : a) la particularité québécoise ; b) la notion de participation volontaire ; et c) le silence de l’auteur concernant les abus et les limites des archives des Oblats.
Particularité québécoise
La thèse de l’auteur, qui porte sur la singularité québécoise (179), est fondée sur le fait incontestable que la construction de pensionnats au Québec a commencé des décennies plus tard que dans les provinces à l’ouest : trois pensionnats oblats sur quatre ont été construits dans les années 1950 à une époque où le gouvernement fédéral et les Églises protestantes songeaient déjà à en fermer. Même si Goulet insiste sur « le rôle déterminant des pères oblats » dans leur création tardive, l’explication est peu convaincante puisque l’Église anglicane elle-même a ajouté plus tard un pensionnat à La Tuque en 1963 (CVR 2015, I[2] : 48, 50).
Or, à cette thèse de l’auteur nous pouvons opposer certains faits qu’il a omis. Commençons avec la dernière des omissions : le reste du Canada. La notion d’une singularité québécoise est sensiblement réduite si l’on considère le réseau dans son ensemble car, même sans pensionnat dans la province, les enfants autochtones n’ont pas été épargnés. Goulet ne mentionne pas que, dès le début du xxe siècle, les enfants mohawks de Kahnawake et de Kanesatake étaient envoyés au pensionnat jésuite de Spanish en Ontario (Pouliot-Thisdale 2016 ; Tremblay 2008 : 314-317, 325) et que les enfants mi’gmaqs étaient envoyés à Shubenacadie en Nouvelle-Écosse, pensionnat ouvert en 1930 (CVR 2015, I[1] : 268-269 ; Walls 2010 : 382, n. 54). Alors qu’il relègue ce phénomène à une seule note de bas de page (18) disant que les enfants cris du Québec allaient en grand nombre dans les pensionnats protestants en Ontario (Morantz 2002 : 213-215), Goulet ne mentionne pas les Algonquins catholiques envoyés à Spanish (Reynaud 2017 : 21). L’expérience, au Québec, ne s’est donc jamais limitée aux frontières de la province.
De plus, dans son analyse, Goulet fait abstraction du travail des Oblats ailleurs au Canada lorsqu’il prétend qu’en créant les derniers pensionnats au Québec « on applique le seul modèle existant – le collège classique » (28). Sa description des faits rappelle plutôt que l’Ordre opérait déjà ailleurs des dizaines de pensionnats (49) et que le pensionnat de Sept-Îles fut fondé sur la recommandation de l’ancien directeur du pensionnat oblat de Fort Albany en Ontario (94). Goulet finit par constater que, puisque les Oblats « ont une longue expérience en la matière… ils appliquent le même modèle partout » (100).
En effet, au Québec les pensionnats oblats faisaient partie d’une oeuvre nationale : un frère pouvait être transféré d’un pensionnat en Colombie-Britannique jusqu’à celui de Nouvelle-Écosse (CVR 2015, I[2] : 184), ou de Fort Albany en Ontario à celui de Fort George au Québec (Tremblay 2008 : 50, 241-243). Les autorités nationales et même le Vatican étaient par ailleurs informés des religieux abuseurs, comme le démontre un incident qui a eu lieu en 1955 au pensionnat de Lower-Post dans le nord de la Colombie-Britannique, à la suite duquel le frère abuseur partit en Europe (NCTR 2005). Plusieurs autres Oblats accusés d’abus sexuels furent aussi mutés en Europe, dont notamment le père Edmond Brouillard qui fut jugé coupable d’abus lorsqu’il était missionnaire à Lac-Simon et à Kitcisakik au Québec (Dupuis 2016 ; Tremblay 2008 : 181), et certains arrivèrent même à échapper ainsi à la justice (Lapointe 2017).
Le travail des Oblats ne se limitait pas non plus aux pensionnats. Ils ont fourni le plus grand nombre de missionnaires catholiques auprès des autochtones depuis les années 1840 (51), et les relations sexuelles entre missionnaires oblats et jeunes autochtones sont connues depuis l’Arctique, au xixe siècle, jusqu’au Labrador dans les années 1980 (CVR 2015, I[1] : 170 ; Sampson 2003).
Au début de son livre, l’auteur propose l’absence de traités comme explication de la particularité québécoise (25, 179), puis il abandonne cette hypothèse à la vue du nombre de pensionnats, au Yukon et en Colombie-Britannique, où il n’y avait pas non plus de traités. Par ailleurs, il omet de constater que les Cris du Québec qui n’avaient adhéré à aucun traité étaient placés dans le même pensionnat (Moose Factory) que les Cris de l’Ontario qui avaient adhéré au Traité no 9 (Morantz 2002 : 213-215, 221).
Goulet explique finalement la création tardive des pensionnats au Québec par une participation de la province à la création de nouvelles réserves indiennes à partir de 1941, en combinaison avec l’adoption par la province de la fréquentation scolaire obligatoire en 1943 (26-28). Cette hypothèse aurait dû être validée par une consultation des documents du gouvernement fédéral mais, quoi qu’il en soit, elle est vite démontée.
Goulet n’explique pas comment l’imposition de la fréquentation scolaire, rendue obligatoire au Québec en 1943 par une loi provinciale, aurait provoqué, presque une décennie plus tard, un changement si important de la part du gouvernement fédéral – qui avait déjà fait le même changement dans la Loi sur les Indiens en 1920 (27). Les changements législatifs n’aident pas non plus à comprendre pourquoi les écoles de jour demeuraient la règle, et le pensionnat, l’exception chez les Mi’gmaq (CVR 2015, I[2] : 314). Les lois aident encore moins à comprendre pourquoi ce fut le gouvernement fédéral qui construisit des foyers pour élèves inuits alors que ceux-ci n’étaient même pas visés par sa Loi sur les Indiens (Lévesque et al. 2016 : 147-148).
Quant à la loi provinciale sur la création de réserves adoptée en 1941, Goulet admet qu’elle reprenait le texte d’une loi de 1922 (26) ; elle peut donc difficilement expliquer les décisions du fédéral dans les années 1950. De plus, Goulet se trompe sur les événements : par exemple, il insiste sur la création formelle de réserves après 1941 sans constater que des villages occupaient les terres en question pendant des décennies ou même des siècles auparavant (Opitciwan depuis les années 1920 ou Kanesatake depuis les années 1720) ; il en arrive même à affirmer que les Naskapis ont obtenu en 1960 une réserve à Kawawachikamach – où ils n’ont pourtant emménagé qu’en 1984.
La notion de participation volontaire
À la particularité québécoise s’ajoute, selon l’auteur, la « notion de participation volontaire », soit l’envoi volontaire par les parents autochtones, au Québec, de leurs enfants aux pensionnats. Or, au Québec, ce sont les missionnaires dans les communautés qui convainquirent les parents d’envoyer leurs enfants aux pensionnats ou aidèrent à contraindre les enfants à y aller (135), dont notamment le père Brouillard qui ordonnait aux enfants algonquins d’aller à Amos (Dupuis 2016 : 181).
Les Oblats participaient volontiers à ce régime arbitraire. Goulet présente un document de 1942 comme la preuve que l’Ordre voulait maintenir la langue et la culture autochtones (183). Même si cela était vrai, le document démontre que les Oblats et les fonctionnaires fédéraux étaient néanmoins d’accord sur le fait que, chez les Indiens, le milieu familial était « inférieur à la famille civilisée », que les parents « éduquent mal » leurs enfants « sous bien des rapports » et que, face à ces problèmes, « le pensionnat est le meilleur correctif » (206).
La décision d’ouvrir un pensionnat à Maliotenam en 1952 s’inscrit dans cette vision. À l’époque, une seule communauté innue sur la Côte-Nord bénéficiait d’une école de jour : celle de Betsiamites, où les Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil offraient l’école de mai jusqu’en octobre afin d’accommoder le départ des familles vers l’intérieur des terres pour la chasse et le piégeage (101). Loin de prendre cette école comme modèle, les Oblats ont rejeté la notion d’école de jour parce que l’année scolaire serait alors trop courte et sous prétexte que, si le gouvernement fédéral construisait des écoles dans les réserves et admettait les familles au programme d’allocations familiales (créé en 1944), les familles seraient divisées puisque les mères cesseraient alors de monter vers les territoires de chasse avec leurs maris. Les Oblats auraient voulu que le gouvernement fédéral change la loi pour verser les allocations familiales aux parents même lorsque les enfants étaient au pensionnat, mais par ailleurs ils vantaient l’économie qui serait réalisée par le gouvernement si les enfants allaient au pensionnat et que l’allocation n’était pas payée à leurs parents pendant ces dix mois de l’année (44-45).
La question des allocations familiales préoccupe par ailleurs Goulet : si les faits suggèrent qu’elles étaient suspendues sur fréquentation obligatoire d’un pensionnat, il en conclut que « c’est la preuve que les parents sont tout à fait conscients de ce qu’ils font en apposant leur signature sur les formulaires d’inscription, malgré la pénalité financière » (184). Cette affirmation ne renvoie à aucun document, et Goulet semble ignorer que dans ces formulaires les parents reconnaissaient que leurs enfants resteraient « aussi longtemps que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le juge nécessaire » et que les formulaires pouvaient être signés en blanc par le directeur de l’école, ou carrément falsifiés (CVR 2015, I[2] : 68, 73, 246). Enfin, il semble ignorer le vaste pouvoir discrétionnaire détenu par l’agent des Indiens concernant l’octroi des allocations familiales (Satzewich et Mahood 1995 : 62) qui rend les généralisations difficiles, et il ne constate pas que, si les parents avaient refusé le pensionnat, ils n’auraient eu ni éducation pour leurs enfants, ni allocation familiale pour les nourrir et ce, dans l’hypothèse où les enfants ne leur étaient pas pris de force, quoi qu’il en soit.
Plus fondamentalement, Goulet n’inclut pas dans son analyse les effets d’un pensionnat comme celui de Maliotenam sur les Innus qui le fréquentaient. Sur le plan juridique, les parents étaient privés du droit aux allocations familiales dont bénéficiaient toutes les autres familles canadiennes. Sur le plan familial, les parents devaient vivre sans leurs enfants puisque les enfants devaient vivre au pensionnat dès un très jeune âge. Sur le plan culturel, les enfants ont arrêté d’apprendre comment vivre sur le territoire. Le chanteur innu Florent Vollant, par exemple, avait quatre ans lorsqu’il a été amené au pensionnat de Maliotenam, à 500 kilomètres de sa famille qui vivait sur une ligne de trappe au Labrador. Il évoque son désarroi, ses parents désemparés et la rupture entre eux : « Nous, on parlait de chiffres et de français, eux, ils parlaient de chasse » (Montpetit 2013 ; Bousquet 2006 : 11-14).
Si ce contexte est absent de l’oeuvre de Goulet, c’est parce que les abus sont une omission parmi plusieurs dans son histoire des pensionnats. Les rapports de pouvoir – la contrainte juridique exercée pour placer les enfants et le régime imposé au pensionnat – sont rarement évoqués. Les nations autochtones dont sont issus les enfants envoyés aux pensionnats des Oblats au Québec – Cris, Algonquins, Atikamekw et Innus surtout – ne sont pas mentionnées ni l’histoire propre à chacune. Enfin, l’histoire des pensionnats et l’oeuvre des Oblats dans le reste du Canada sont évoquées de manière aléatoire.
Par ailleurs, une autre omission majeure dans l’oeuvre de Goulet est la diversité et les particularités des nations autochtones elles-mêmes. La question n’est pas de savoir pourquoi trois sur quatre pensionnats oblats au Québec furent construits seulement dans les années 1950, mais plutôt de savoir ce qui a amené le gouvernement fédéral à obliger soudainement certaines nations à y envoyer leurs enfants, après les en avoir épargnées si longtemps.
L’explication se trouve dans les relations de chaque nation avec la société euro-canadienne. La CRV a constaté que le Moyen-Nord québécois connaissait dans les années 1950 une croissance de la population non autochtone et un développement minier et forestier, exerçant une forte pression sur les Algonquins, Atikamekw et Innus qui vivaient encore de la chasse et du piégeage. Les derniers pensionnats furent donc un instrument de sédentarisation et d’assimilation, ce qui concorde, selon la CVR, « entièrement avec une tradition canadienne bien plus ancienne » qui cherche à « exercer le contrôle sur une colonie interne, en prévision de l’intensification de l’exploitation économique de cette région » (CVR 2015, I(2) : 43-48). De la même façon, les foyers pour enfants inuits furent mis en place dans les années 1950, lorsque le gouvernement fédéral adopta une politique d’assimilation dans le marché du travail rémunéré (McLean 2016 : 12-14).
L’omission des particularités de chaque nation dans l’oeuvre de Goulet va de pair avec l’absence d’analyse des facteurs économiques. Pour les nations autochtones du Québec qui étaient encore semi-nomades jusqu’aux années 1950 (Cris, Algonquins, Atikamekw et Innus), il devenait de plus en plus difficile de vivre de la chasse et du piégeage (Morantz 2002 : 171, 199-204). L’envoi des enfants aux pensionnats pouvait donc être une stratégie de survie pour certaines familles, tel que constaté ailleurs (Satzewich et Mahood 1995 : 63-64). Un survivant algonquin se souvient que le pensionnat d’Amos l’a « sauvé » d’une pauvreté si extrême qu’il avait passé une semaine sans manger et avait dû « fouiller dans les poubelles des camps de bûcherons » pour se nourrir (CSSSPNQL 2013 : 75).
Enfin, l’omission cruciale de Goulet concerne les rapports de pouvoir qui ont permis le système des pensionnats : la dominance exercée par l’État et l’Église, due à l’inégalité économique et aux vastes pouvoirs que la loi leur accordait. La règle de base dans la Loi sur les Indiens voulait que tout enfant indien soit tenu de fréquenter l’école que le Ministre désignait et que, si l’enfant était absent de l’école sans droit, un agent de surveillance – y compris tout membre de la Gendarmerie royale du Canada – pouvait arrêter ses parents et conduire l’enfant à l’école « en employant autant de force que l’exigent les circonstances » (Loi sur les Indiens 1951 : art. 119). Selon une survivante du pensionnat de Sept-Îles : « Ils sont allés chercher des enfants dans les bois. Ils les ont arrachés à leurs parents. Ils l’ont fait avec ma soeur. » (Élisabeth Ashini, citée dans Duchaine Ashini 2015 ; Tremblay 2008 : 21-22) Et selon une survivante du pensionnat d’Amos : « Les parents avaient entendu dire que la police viendra chercher les enfants. C’est pour ça que mes parents m’envoyaient. » (Loiselle et al. 2011 : 28)
Les Oblats exerçaient aussi leur dominance à l’intérieur des pensionnats, décrits par deux survivantes d’Amos comme un « régime militaire » (ibid. : 31). Par ailleurs, selon tous les répondants interviewés pour une étude savante, la première raison pour être puni au pensionnat d’Amos était « le fait de parler l’algonquin » (ibid. : 33 ; CSSSPNQL 2013 : 33). À Maliotenam, selon Élisabeth Ashini : « Si on ne parlait pas en français, c’était les coups de règle » (cité dans Duchaine 2015). Toutefois, c’est précisément cet aspect de l’histoire racontée par les survivants que Goulet veut contester : s’il convient que les survivants témoignent majoritairement qu’il leur était défendu de parler leur langue (104, 182), il veut « relativiser partiellement » cette version des faits parce qu’il constate que les écrits des pères oblats prônaient le maintien de la langue chez les élèves (182) en vue de faciliter l’évangélisation de leurs familles (105).
Le silence sur les abus et les limites des archives des Oblats
L’auteur se fonde sur les documents qu’il a consultés dans les archives des Oblats, mais il reconnaît ne pas avoir consulté les archives du ministère des Affaires indiennes, lequel avait mandaté les Oblats pour gérer les pensionnats. Alors que sa bibliographie comprend une littérature dans laquelle figurent les témoignages des survivants, ces derniers sont peu cités. Il convient qu’il faudrait « bien évidemment, confronter les données avec les témoignages précis des ex-pensionnaires » (183) mais la confrontation entre le discours officiel et la réalité vécue ne fait pas partie de son oeuvre : les bonnes intentions des Oblats consignées sur papier sont privilégiées.
La question des abus contre les élèves n’est donc presque pas abordée, et Goulet en appelle « à une certaine réserve sur la qualité des témoignages entendus » devant la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) « et par conséquent, sur la véritable histoire de ces institutions » (19). Il insiste sur l’absence de témoignages devant la CVR par les anciens employés de l’Église sans mentionner qu’ils avaient le même droit d’être entendus que les survivants. S’il avait voulu offrir des points de vue divergents, Goulet aurait pu citer l’important livre sur les pensionnats au Québec publié en 2008 par le journaliste Daniel Tremblay – livre injustement méconnu donnant le meilleur aperçu disponible de l’histoire des pensionnats au Québec – où l’auteur avait pris la peine d’interviewer survivants et religieux (Tremblay 2008 : c. XI et XII), mais cette oeuvre ne figure pas dans sa bibliographie.
Goulet publie néanmoins son ouvrage vingt ans après que la Commission royale sur les peuples autochtones eut dénoncé « la réalité des pensionnats – la négligence, les mauvais traitements et la violence culturelle » révélée par « le dévoilement du secret le mieux gardé de tous : l’exploitation sexuelle des enfants dans ces écoles » (CRPA 1996 : 409). Au Québec les enfants ont souffert d’abus autant que dans les autres provinces, selon les données de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2006 : au Québec le nombre de réclamations fondées sur les abus sexuels ou physiques et admises au Processus d’évaluation indépendant (PEI) était proportionnel au nombre de survivants qui ont demandé le Paiement d’expérience commune (PEC) auquel ils étaient tous admissibles. En fait, au Québec près d’un tiers des survivants ont déposé une demande distincte de compensation pour abus (CVR 2015, I[2] : tableau 41.8).
Comment expliquer un réseau scolaire où un tiers des élèves allègue des abus sexuels et physiques ? Selon la Commission du droit du Canada, les sévices dans les pensionnats autochtones et autres établissements similaires de la même époque avaient trois traits en commun : enfants appartenant à des groupes marginalisés ; un « énorme déséquilibre des pouvoirs » entre les enfants placés et la direction des organismes gestionnaires ; et le caractère d’« un monde différent » qui était isolé alors qu’il aurait dû être surveillé (Commission du droit du Canada 2000 : 5-7). Elle a conclu que ce contexte « était une invite à des abus de pouvoir par des prédateurs » (Commission du droit du Canada 2000 : 6) .
En écartant les témoignages des victimes et en se fiant uniquement aux documents contemporains des Oblats, Goulet maintient un silence troublant sur les pensionnats dont il veut précisément présenter l’histoire. Il mentionne par exemple un grand rassemblement tenu à Maliotenam en 2012 (montré dans le récent film Innu Nikamu : Chanter la résistance) pour démolir le seul vestige restant du pensionnat qui était la cordonnerie (119), mais sans mentionner qu’il s’agissait du lieu où, selon un grand nombre des témoins, des abus avaient souvent lieu (Montpetit 2013). Il se permet de préciser que la fabrication des souliers sur place faisait économiser de l’argent aux Oblats (113), mais il passe sous silence le fait que des survivants ont déclaré y avoir été victimes d’attouchements par le père responsable de la cordonnerie (Élisabeth Ashini, citée dans Duchaine 2015).
Il n’est pas justifiable, de la part de Goulet, de s’être appuyé exclusivement sur les archives des Oblats pour écrire l’histoire des pensionnats que les Oblats ont gérés au Québec. Il s’agit d’une erreur méthodologique majeure.
En excluant toute comparaison des positions officielles contemporaines des Oblats aux déclarations ultérieures faites par les personnes qui avaient été placées dans leurs pensionnats lorsqu’ils étaient enfants, Goulet pose aussi un choix politique : il choisit de laisser les autochtones silencieux et de n’accorder une voix qu’aux religieux qui ont pu les dominer. On aurait pensé que l’ère d’une telle approche était révolue.
Appendices
Ouvrages cités
- Bousquet, Marie-Pierre, 2006 : « A Generation in Politics: The Alumni of the Saint-Marc-de-Figuery Residential School », in H.C. Wolfart, ed., Papers of the Thirty-Seventh Algonquian Conference. University of Manitoba, Winnipeg. https://ojs.library.carleton.ca/index.php/ALGQP/article/download/1135/1016/
- Commission du droit du Canada, 2000 : La dignité retrouvée : la réparation des sévices infligés aux enfants dans des établissements canadiens. Ottawa, ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/lcc-cdc/JL2-7-2000-2F.pdf
- CRPA (Commission royale sur les peuples autochtones), 1996 : « Un passé, un avenir », in Rapport, vol. 1. Ottawa, ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
- CSSSPNQL (Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador), 2013 : Recueil d’histoires de vie des survivants des pensionnats indiens du Québec. http://www.cssspnql.com/docs/centre-de-documentation/fr-cssspnql-recueil-pensionnats-r%C3%A9impression.pdf?sfvrsn=2
- CVR (Commission de vérité et réconciliation du Canada), 2015 : « Pensionnats du Canada : L’histoire, I : des origines à 1939 », in Rapport final, vol. 1. Montréal, McGill-Queen’s University Press. http://www.myrobust.com/websites/trcinstitution/File/Reports/French/French_Volume_1_History_Part_1_Web.pdf
- CVR (Commission de vérité et réconciliation du Canada), 2015 : « Pensionnats du Canada : L’histoire, II, de 1939 à 2000 », in Rapport final, vol. 1. Montréal, McGill-Queen’s University Press. http://www.myrobust.com/websites/trcinstitution/File/Reports/French/French_Volume_1_History_Part_2_Web.pdf
- Duchaine, Gabrielle, 2015 : « Commission de vérité et réconciliation du Canada : Hantée par la honte ». La Presse+, 16 décembre. http://plus.lapresse.ca/screens/e22e869b-4169-41b0-832d-78366d4d6994__7C__Z~wC625xz0hP.html
- Dupuis, Josée, 2016 : « Fuir et résister, l’histoire méconnue des pensionnats ». Radio-Canada, 27 octobre. http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/10/pensionnats-autochtones-resistance-histoire-meconnue-abitibi/index.html
- Lapointe, Magalie, 2017 : « Un prêtre pédophile caché par les Oblats pendant 16 ans ». Journal de Montréal, 26 mars. https://www.journaldemontreal.com/2018/03/26/un-pretre-pedophile-cache-par-les-oblats-pendant-16-ans
- Lévesque, Francis, Mylène Jubinville et Thierry Rodon, 2016 : « En compétition pour construire des écoles : l’éducation des Inuits du Nunavik de 1939 à 1976 ». Recherches amérindiennes au Québec 46(2-3) : 145-163.
- Loiselle, Marguerite, Lyne Legault et Micheline Potvin, 2011 : Recueil des récits de vie des aînés de Pikogan et des ex-pensionnaires de Saint-Marc-de-Figuery couvrant la période de 1931 à 1975. Chaire de recherche en développement des petites collectivités, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. https://uqat.ca/chairedesjardins/medias/uploads/misc/Loiselle_Recits_vie_Pikogan_2011.pdf
- Loi sur les Indiens, L.C. 1951, c. 29
- McLEAN, Scott, 2016 : « From Cultural Deprivation to Individual Deficits: A Genealogy of Deficiency in Inuit Adult Education ». Revue canadienne de l’éducation 39(4) : 1-28. http://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/2288/1889
- Montpetit, Caroline, 2013 : « Survivre aux pensionnats autochtones ». Le Devoir, 24 janvier. https://www.ledevoir.com/societe/369118/survivre-aux-pensionnats-autochtones
- Morantz, Toby, 2002 : The White Man’s Gonna Getcha: The Colonial Challenge to the Crees of Quebec, Montréal, McGill-Queen’s University Press.
- NCTR (National Centre for Truth and Reconciliation), 2005 : « Lower Post IRS School Narrative ». 31 mars. https://nctr.ca/School%20narratives/BC/LOWER%20POST.pdf
- POULIOT-Thisdale, Eric, 2016: « Our History: Inventory of Spanish Residential School Explored ». The Eastern Door, 27 juin. https://www.easterndoor.com/2016/06/27/our-history-inventory-of-spanish-residential-school-explored/ (consulté le 8 février 2019).
- Reynaud, Anne-Marie, 2017 : Emotions, Remembering and Feeling Better : Dealing with the Indian Residential SchoolsSettlement Agreement in Canada, Bielefeld, Transcript Verlag.
- Sampson, Colin J., 2003: « Sexual Abuse and Assimilation: Oblates, teachers and the Innu of Labrador ». Sexualities 6(1) : 47-54.
- Satzewich, Vic, et Linda Mahood, 1995 : « Indian agents and the residential school system in Canada, 1946-1970 ». Revue d’histoire de l’éducation 7(1) : 45-69. http://historicalstudiesineducation.ca/index.php/edu_hse-rhe/article/view/1367/1505
- Tremblay, Daniel, 2008 : L’éveil des survivants : Récits des abus sexuels dans les pensionnats amérindiens du Québec, Montréal, Michel Brûlé.
- Walls, Martha, 2010 : « “Part of that Whole System”: Maritime Day and Residential Schooling and Federal Culpability ». Canadian Journal of Native Studies 30(2) : 361. http://www3.brandonu.ca/cjns/30.2/07walls.pdf



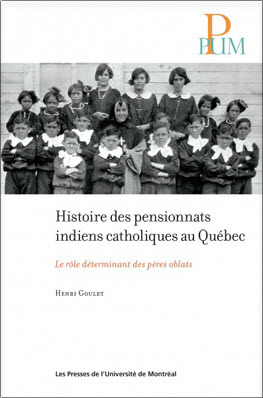
 10.7202/1040442ar
10.7202/1040442ar