Abstracts
Résumé
Cet article a pour but de mettre en question les corps dans les situations de rencontre entre missionnaires et Nord-Amérindiens. Ce contexte de rencontre sera considéré, non pas comme étant limité à la période coloniale historique, mais plutôt comme se poursuivant jusqu’au xxe siècle. À partir d’archives et de discours de religieuses missionnaires recueillis lors d’enquêtes de terrain, l’auteure examine la fabrication des corps dans ce contexte et analyse les moyens par lesquels les rapports à l’altérité se construisent à travers les corps, de part et d’autre, entre situations de confrontation, de mise en conformité et de persistance.
Mots-clés :
- corps,
- identité,
- missions catholiques,
- religieuses,
- Canada
Abstract
This article proposes to examine the body in encounters between missionaries and northern Amerindians. The context of this encounter will not be limited to the historical colonial period, but continues until the 20th century. Based on archives and speeches of missionary nuns collected during field research, this contribution proposes to examine the construction of bodies in this context and to analyze the ways in which relationships to otherness are built through bodies, on both sides, in situations of confrontation, compliance and persistence.
Keywords:
- bodies,
- identity,
- Catholic missions,
- religious sisters,
- Canada
Resumen
Este trabajo pretende cuestionar los cuerpos en situaciones de encuentro entre misioneros e indígenas norteamericanos. Este contexto de encuentro se considerará, no sólo limitado al período histórico colonial, sino que en su continuidad en el siglo XX. A partir de archivos y discursos de religiosas misioneras registrados durante el trabajo de campo, la autora examina la construcción de los cuerpos en este contexto y analiza las formas en que las relaciones con la alteridad, por ambos lados, se construyen a través de los cuerpos, entre situaciones de confrontación, conformidad y persistencia.
Palabras clave:
- cuerpo,
- identidad,
- misiones católicas,
- religiosas,
- Canadá
Article body
Au Canada, depuis l’époque coloniale avec, entre autres, le choc microbien, jusqu’au xxe siècle où religieuses et religieux missionnaires sont toujours présents dans les milieux autochtones, les thèmes liés au corps parcourent les relations entre missionnaires et autochtones. Le corps a constamment pesé dans les relations entre Amérindiens et Européens, puis entre eux et la société dominante nord-américaine. L’« hospitalité sexuelle » des Amérindiennes, par exemple, est une donnée récurrente dans les sources historiques (Havard 2016 : 635-661), mais un corps n’est pas seulement « sexuel » et encore moins « naturel » lorsqu’on prend en considération la multitude de façons de « fabriquer » les corps dans les différentes cultures (Breton 2006). Le corps n’est pas que substances, il est culturellement façonné et se modifie au contact de l’altérité : il est en première ligne dans les processus d’interaction entre deux cultures[1].
Ces corps, que ce soient ceux des missionnaires ou ceux des autochtones d’Amérique du Nord, sont porteurs d’identités qui se confrontent dans cette « rencontre des deux mondes » (Delâge et Trudel 1991). Cette expression, mise en valeur dans plusieurs travaux de Denys Delâge, sera ici reprise pour rendre compte du biais néo-culturaliste de l’étude proposée où deux méga-aires culturelles (Désveaux 2007) – européenne et nord-amérindienne – se rencontrent et se confrontent dans le contexte des missions d’évangélisation. Ce contexte de rencontre de deux mondes sera considéré ici comme non limité à la période coloniale au temps des premières rencontres, mais se poursuivant jusqu’au xxe siècle. D. Delâge a ouvert la voie à de nombreuses études sur les phénomènes relatifs à la rencontre interculturelle[2]. Entre diverses thématiques, il aborde à partir des mythes celle des corps engagés dans l’interaction ritualisée lors de la Grande Paix de Montréal de 1701 pour mettre en discussion la conception qu’ont les Amérindiens de l’altérité (Delâge 2014a). Rapports à l’altérité, interactions culturelles, transferts culturels et processus d’adaptation sont autant de phénomènes où le corps joue un rôle particulier, et non uniquement en filigrane. Le corps « n’est pas un fait en soi, mais une projection sociale et culturelle […] le corps est l’observatoire idéal d’un contexte social » (Le Breton 1988 : 15-16) et c’est en ce sens qu’il convient de s’emparer ici de cette thématique.
Cet article propose de saisir les questions du corps dans le cadre de rencontres entre missionnaires et Amérindiens sous l’angle du genre, puisqu’il veut analyser le discours de religieuses missionnaires. Répondant à l’appel formulé par D. Delâge dans un entretien vidéo, en 2014, concernant l’urgence de recueillir des témoignages de religieux et religieuses qui ont passé leur vie avec les autochtones (Delâge 2014b : 44), notre propos s’articulera autour de ceux de religieuses canadiennes missionnaires dans les territoires autochtones de l’Ouest canadien entre les années 1950 et 1980, portions de vies recueillies lors d’enquêtes de terrain[3]. Les thèmes des corps et des interactions physiques au sein des missions d’évangélisation, et particulièrement dans le contexte des pensionnats, sont des sujets houleux, difficiles à aborder et déjà largement soulevés par la Commission de vérité et réconciliation (CVR). Dans le cadre de la CVR, il a été demandé aux congrégations de religieuses de mettre à notre disposition l’ensemble de leurs documents d’archives relatifs aux pensionnats. Pour notre part, nous avons proposé aux religieuses qui le souhaitaient un espace d’expression. Menés sur un mode libre, les entretiens avaient pour objectif de recueillir des fragments de mémoire de leurs années passées en territoires autochtones, et non uniquement dans les écoles résidentielles. Ce corpus de récits de vie, ou plus exactement de brèves de vie, témoigne des phénomènes de rencontres du point de vue individuel. Si la CVR a offert un espace d’expression aux autochtones, nous avons essayé, à notre échelle, de recueillir les témoignages de religieuses en nous préservant de toute forme d’ethnocentrisme face aux « rapports entre les sociétés autochtones et les populations d’origines européennes » et donc d’agir de la façon la « plus neutre » possible (Delâge et Trudel 1991 : 6), dans une « éthique de la responsabilité » (Turgeon, Delâge et Ouellet 1996). De ce corpus, nous avons extrait ici les mentions relatives aux corps afin de proposer une esquisse d’anthropologie du corps sur la base de ces discours. Pour ce faire, nous prendrons principalement appui sur deux propositions théoriques en socio-anthropologie du corps.
À la suite de Marcel Mauss considérant qu’« acte technique, acte physique, acte magico-religieux sont confondus pour l’agent » (Mauss 1936), les travaux sur le corps se sont multipliés et l’on constate une véritable émergence de propositions théoriques et méthodologiques sur le sujet, et ce particulièrement dans les années 1980 (voir Collingham 2001 ; Ballantyne et Burton 2005 ; Stoler 2013 ; Guillemot et Larcher-Goscha 2014). Jean-Michel Berthelot propose en 1983 des pistes de réflexion pour une sociologie du corps et des pratiques corporelles conçues dans des « situations de mise en jeu du corps » (Berthelot 1983). Selon l’auteur « toute pratique sociale est mise en jeu du corps […] Cette mise en jeu social est, simultanément, production du corps, c’est-à-dire constitution de l’organisme comme être-là concret, inscription dans l’univers des possibles corporels d’une norme, d’un ordre, d’un sens » (ibid. : 120-121). En d’autres termes, toujours selon l’auteur, le corps doit être conçu comme une « réalité sociale globale » et ne peut être perçu qu’à travers ses modalités et situations de mise en jeu : « Le corps ne développe ses pouvoirs sociaux, sa multidimensionnalité et sa polysémie qu’au sein de situations qui précisément le constituent comme support de ces pouvoirs et lieu d’inscription de ces significations » (ibid. : 126). Berthelot propose alors de distinguer trois « niveaux d’actions sur le corps, c’est-à-dire les modalités de la production sociale du corps à travers les situations de sa mise en jeu ». Le premier est celui de « la ritualisation des corps », soit « les pratiques de marquage qui produisent l’apparence corporelle comme signe » ; le deuxième réfère aux pratiques de l’entretien du corps et de reproduction du corps appelées « pratiques de perpétuation » par l’auteur ; enfin un troisième niveau, structurel, celui du « mode de production », où le corps est lui-même producteur d’une forme corporelle déterminée. Dans le cadre de ce dernier niveau d’analyse, « la question n’est plus ici “quel corps pour quelle société ?” mais “quel corps par quelle société ?” » (ibid. : 127-128). Dans cette perspective, il apparaît que le contexte de la rencontre entre religieuses missionnaires et Amérindiens, ainsi que la politique assimilationniste qui persiste au Canada au xxe siècle, fournissent un cadre d’analyse propice pour explorer l’articulation des différents niveaux de production sociale du corps.
Poursuivant avec le concept de « mise en jeu du corps », David Le Breton propose en 1988 un essai de sociologie et d’anthropologie du corps dans lequel il réaffirme la dimension sociale du corps, disposant de et fabriquant une symbolique sociale marquant l’appartenance culturelle (Le Breton 1988). Il y aurait ainsi « une sorte de continuité entre le corps et le monde, et la connivence peut se prolonger tant que le sujet ne se trouve pas confronté à un environnement social ou simplement écologique étranger à ses repères coutumier » (ibid. 27-28). Par de nombreux exemples, l’auteur démontre qu’en cas de modification de l’environnement, ou de rencontres, le corps s’adapte, se transforme. Prenant en considération le facteur de la variabilité culturelle, Le Breton postule et argumente que, dans les sociétés traditionnelles, contrairement au monde occidental, le corps n’est pas séparable du sujet. Pour ces sociétés, le corps serait « en prise sur le monde, une parcelle non détachée de l’univers et non isolable de l’homme auquel il donne un visage » (ibid. : 186). Partant de cet argument, Le Breton fait glisser son argumentation vers le champ des croyances, de l’animisme et du chamanisme, soit celui de « l’efficacité symbolique » où le corps est pleinement mis en oeuvre. Une argumentation qui retiendra particulièrement notre attention lorsqu’il s’agira de commenter les discours de religieuses infirmières relatifs au fait religieux autochtone.
Cet article prend alors ses assises théoriques et méthodologiques dans cette même veine. Explorant les situations de mise en jeu du corps dans le contexte de la rencontre entre femmes missionnaires catholiques et Amérindiens, on postulera ici que le corps contribue à la fabrication de l’identité de chacun des acteurs de la rencontre : une identité autodéterminée, mais aussi construite par le regard de l’autre. Il s’agit alors d’interroger les situations et les modalités de mise en jeu du corps par l’analyse des moyens par lesquels les corps participent de la situation de rencontre et de la confrontation interculturelle, et ce à travers les discours de femmes missionnaires ayant passé tout ou une partie de leur obédience auprès des autochtones canadiens. Nous proposons ainsi de lire la « rencontre des deux mondes » dans un double prisme, celui du genre et celui du corps. Faisant le choix de s’engager comme missionnaires et allant évangéliser dans les contrées lointaines du Grand Ouest canadien, les femmes missionnaires n’y trouveront pas que des âmes. Dans un premier temps, elles seront confrontées à des corps, à des individus physiques, des corps autochtones qu’elles mettront à l’épreuve en les transformant pour une mise en conformité dans le cadre d’une assimilation souhaitée par le gouvernement, avant que ceux-ci mêmes ne ressurgissent, résistants et résilients, et à leur tour mettent à l’épreuve les corps missionnaires.
Le temps de la confrontation
Dans toute rencontre, la première étape est celle de la confrontation : ce moment où les missionnaires entrent en contact avec les populations autochtones. Ces premiers contacts se répètent pour chaque missionnaire qui découvre son milieu d’évangélisation. Cette mise en contact engendre une confrontation non seulement des techniques du corps, mais également de la symbolique sociale du corps, pour reprendre les termes de D. Le Breton : « …le centre de gravité de l’expérience corporelle se situe en effet au sein de la symbolique sociale bien plus que dans la volonté du sujet qui ignore le plus souvent qu’il obéit spontanément à une logique sociale » (Le Breton 1988 : 25).
Au Canada, au xxe siècle, la majorité des femmes missionnaires dans les territoires autochtones sont canadiennes. Certaines ont côtoyé le monde autochtone dans leur jeunesse, avant même d’entrer dans les ordres. C’est le cas d’une religieuse qui a enseigné dans une école résidentielle près de McIntosh (Ontario) dans les années 1950 :
J’ai été élevé au Manitoba, ma maison est au Manitoba. Et nous étions tout près d’une réserve. Roseau. Des Saulteaux. [...] Ils étaient très humbles. Nous autres, on les prenait pour du monde étrange, avec lesquels on ne pouvait pas beaucoup se fier. On n’avait pas vraiment confiance. Et puis c’était du monde qui vivait de la chasse et de la pêche. On ne les voyait pas beaucoup, mais quand ils arrivaient on avait un petit peu peur, parce qu’on pensait qu’on ne pouvait pas se fier à eux. C’est triste quand même, parce que c’est une opinion générale, ça. C’est juste pour te dire où on était avec eux. On était vraiment..., on ne les considérait pas beaucoup.
S. Marie-Anne, m.o., 2/07/2013, Winnipeg [MB][4]
Avant même la mise en contact dans le contexte d’une mission d’évangélisation, des préjugés semblent prévaloir. Ceux-ci peuvent être le résultat d’une expérience personnelle, comme le témoignage ci-haut évoqué, mais souvent ils sont également le fruit d’une longue tradition du corps amérindien dont l’image est construite par les explorateurs, les missionnaires et les colons depuis le xviie siècle. Outre des moeurs sexuelles considérées comme débridées, l’Amérindien est envisagé comme oisif, au corps inactif. La paresse de l’autochtone est une caractéristique constante qui se retrouve à travers les siècles (Havard 2003 : 540). Oisiveté et paresse se justifient, dans les discours, par le fait que les autochtones n’ont pas d’activités de production économique autres que celles liées à la survie (Delâge et Warren 2017 : 301-305). Le témoignage de la religieuse enseignante cité précédemment est en ce sens évocateur. Décrivant le sentiment général des colons face à la communauté amérindienne de la réserve voisine, elle justifie le manque de confiance et la peur envers les autochtones en glissant : « Et puis c’était du monde qui vivaient de la chasse et de la pêche. » Le corps amérindien n’est pas assez actif – dans le sens de productif selon les règles économiques de la société dominante. Les activités de subsistance uniques sont encore des marques de sauvagerie. Les corps autochtones sont ainsi dépréciés sur la base de préjugés et d’un imaginaire construit de longue date.
Ce corps amérindien paresseux est de surcroît un corps considéré comme sale, souillé par son environnement et son mode de vie. La question de la propreté des Amérindiens a toujours été une grande préoccupation pour les missionnaires[5]. La société occidentale, figée dans la dichotomie substantielle du pur et de l’impur, a reporté cette préoccupation auprès des autochtones. Laver les enfants autochtones, au xviie comme au xxe siècle, est d’une certaine façon le premier moyen pour les sortir de la sauvagerie. Une fois propre et habillé, le corps autochtone se rapproche progressivement du corps occidental socialement admis, celui des colons et des missionnaires. Les emplois du temps des journaliers des écoles résidentielles de la fin du xixe siècle mentionnent ainsi une inspection des jeunes élèves chaque matin. À l’école résidentielle de High River (Alberta), en 1887, à 6 h 30 « les élèves font leur lit et leur toilette pour l’inspection » ; à l’école résidentielle de Qu’Appelle (Saskatchewan), en 1893, une « [i]nspection des élèves dans les salles de classe pour voir s’ils sont propres et convenablement habillés, leur condition, santé, etc. » est prévue dans l’emploi du temps de 7 h 15 à 7 h 30 (Commission de vérité et réconciliation du Canada 2015 : 328-333). Aux soins et à l’entretien du corps se mêle l’habillement qui engage nettement une symbolique de l’appartenance culturelle.
Lors de leur retour à l’école, après les vacances dans leur famille de Kuper Island, certaines filles ont été grondées pour avoir des cheveux sales et non peignés. Quand la soeur a demandé aux filles quelle était la cause de leur malpropreté, elles ont répondu qu’elles n’avaient pas de savon ou de peignes dans la réserve. Pour les vacances suivantes, les filles ont reçu ces articles pour la toilette, mais à leur retour à l’école, elles avaient de nouveau les cheveux non entretenus. Cette fois, lorsqu’on leur a demandé quelles étaient les raisons, elles ont simplement répondu : « Les vieux Indiens se moquent de nous et nous disent que nous sommes blancs. »
Sister Mary Theodore, s.s.a, [v. 1930], cité dans [ASSA] S106-2 C.A. Lowery, notre trad.
Le corps est porteur de traces définissant l’identité : du côté autochtone, une coiffure trop entretenue fait référence au monde des Blancs, le monde des dominants ; alors que du point de vue de ces derniers, le milieu autochtone rend les jeunes filles sales, sauvages. Par l’hygiène et l’apparence physique, deux modèles se définissent par opposition. C’est ainsi que le regard de la société dominante participe à la construction d’un monde autochtone qui ne répond pas aux normes d’hygiène promues. La chevelure autochtone sera au coeur de la refonte du corps amérindien pour sa mise en conformité selon les désirs d’assimilation qui rythment la pensée politique et missionnaire de la première moitié du xxe siècle. Dans ce contexte d’assimilation favorisé par les écoles résidentielles, les pratiques quotidiennes de l’entretien du corps correspondent bien aux « pratiques de perpétuation » telles que définies par J.-M. Berthelot comme l’un des trois niveaux de modalité de la production sociale du corps. Dans ces lieux que sont les écoles pensionnats, il est dès lors possible de constater qu’un second niveau s’entremêle au premier, celui de la « ritualisation du corps », au sein duquel l’apparence physique et l’habillement sont des signes, des marqueurs d’appartenance.
Ces thèmes de la propreté et du soin du corps reviennent de façon récurrente dans les discours recueillis auprès de religieuses ayant travaillé avec des populations autochtones dans la seconde moitié du xxe siècle. Ces thématiques sont généralement abordées pour marquer l’écart culturel entre elles-mêmes et les populations qu’elles ont pour mission d’évangéliser et d’assimiler. Une religieuse, infirmière dans les Territoires du Nord-Ouest de 1950 à 1996, mentionne de manière anecdotique et pourtant révélatrice :
Quand ils ont eu des baignoires qu’est-ce qu’ils y ont mis dans les baignoires ? Ils y ont mis de la terre. On a essayé graduellement. Ils me disaient des fois, ma soeur, tu vas user ma peau à me laver. […] quand ils ont eu des maisons […] ils n’aiment pas avoir chacun leur chambre à coucher comme nous autres. Il y a une chambre et puis tout le monde couchait là. On allait dans la chambre là et puis il y avait le papa, la maman et toutes les petites têtes autour du lit. Ils couchent ensemble, c’est leur façon à eux autres.
S. Agnès, s.g.m., le 13/06/2013, Montréal [QC]
Dans cette confrontation interculturelle, l’incompréhension mutuelle semble régner. Pourtant, le corps en commun n’est pas inhabituel pour les religieuses missionnaires, pour qui la vie communautaire est une règle. Mais la proximité des corps autochtones fait référence à un discours acquis de longue date, indissociable d’une sexualité jugée inconvenante. Les mariages entre cousins croisés, que les ethnologues ont longtemps souligné comme préférentiels dans ces régions (p. ex. Flannery 1938 ; Hallowell 1937), tout comme la polygamie, sont considérés comme un obstacle à l’assimilation (Servais 2014). Décrire les corps et les pratiques du corps permet à la société dominante, missionnaires compris, de construire une différence, une distanciation avec l’altérité autochtone.
En effet, ces discours doivent être mis au regard du corps des religieuses : un corps référentiel particulier, en adéquation avec leur statut de religieuses qui se dévouent à l’autre. Face à ces corps autochtones, jugés comme oisifs, sales et ouverts à une sexualité douteuse, se trouvent les corps des religieux missionnaires, les corps de celles et ceux venus pour montrer l’exemple. Les corps des femmes missionnaires peuvent être considérés dans une ambivalence : à la fois individuels et communautaires. Les femmes en mission, contrairement à leurs homologues masculins, sont toujours en groupes. Elles partent en mission en petits groupes (de trois à six en moyenne) et vivent en communauté en leur lieu de mission dans une maison qui leur est réservée. Les modèles des religieuses en mission, à l’instar de toutes les religieuses, sont les femmes saintes dont la perfection résulte d’un équilibre entre restriction et façonnage du corps, d’une part, et discipline de l’âme, d’autre part. Le fait d’être femmes en mission permet d’ajouter à ce modèle la possibilité de s’accomplir par l’action directe auprès de la collectivité, c’est-à-dire par un engagement des corps de chaque individualité missionnaire. La religieuse missionnaire, en tant que religieuse active, s’inscrit physiquement et individuellement dans le monde commun par ses activités de soin, d’enseignement ou encore d’animation pastorale (Voyé 1996 ; Robinaud 2017). Ces actions auprès de tous nécessitent un vis-à-vis et l’établissement d’une relation à l’altérité, ce qui implique une interaction et une adaptation individuelle et locale, et donc nécessairement une interaction entre les corps.
Mais le corps de la religieuse missionnaire n’est pas un corps commun. L’une des caractéristiques du clergé catholique est le voeu de chasteté (Laurin 1999). Le corps des religieuses est en ce sens un corps fermé, ce qui l’opposerait alors aux corps autochtones conçus comme ouverts. Malgré ce détachement de toute corporalité inhérent au statut des religieuses, le genre féminin de ces femmes missionnaires les conduit vers ce qu’il est possible de nommer « polymaternalité » (Robinaud 2017). Par ses fonctions et en tant que femme, la religieuse missionnaire prend soin de tous. Sa vocation à se soucier de l’autre fait d’elle une mère pour tous qui se doit ainsi d’en former les corps et les esprits. Dans les écoles résidentielles, les religieuses se substituent totalement à la communauté de naissance des enfants autochtones. Répondant au projet d’assimilation souhaité par le gouvernement canadien, les Églises, par l’intermédiaire de leur personnel (en l’occurrence, entre autres, les religieuses missionnaires, pour l’Église catholique), fournissent logement, nourriture et vêtements aux enfants autochtones.
Dans ce mécanisme d’assimilation, les religieuses deviennent mères. Une religieuse surveillante en école résidentielle à partir de la fin des années 1960, puis animatrice pastorale dans les Territoires du Nord-Ouest durant une vingtaine d’années, a décrit sa première activité en ces termes : « Mon rôle, c’était comme une mère de groupe. On avait les élèves quand ils n’étaient pas à l’école. Donc on avait à assumer le rôle de parents. » (S. Cécile, s.g.m., le 13/06/2013, Montréal [QC])
Assumer la fonction de parent lorsqu’on est une religieuse ayant fait voeu de chasteté peut sembler contradictoire. Cependant, la contradiction s’efface en précisant qu’il ne s’agit pas ici de maternité, mais plus exactement de maternalité : non pas la capacité naturelle des femmes à enfanter (maternité), mais les attributs culturels consécutifs à cette capacité et qui correspondent donc aux pratiques de la prise en charge du soin de l’enfant. C’est alors une maternalité de substitution, qui prend la forme d’une polymaternalité, qui se met place dans ces écoles-pensionnats où les religieuses sont responsables de plusieurs enfants : plus d’une dizaine d’enfants par religieuse (S. Marie-Anne, m.o., le 2/07/2013, Winnipeg [MB]). La relation maternelle que les religieuses entretiennent avec leurs ouailles n’est pas uniquement spirituelle (« mères de tous »), mais également physique et matérielle : celle d’une maternalité. La religieuse n’est pas mère, sa position se situe au-delà de ces considérations qui entraîneraient son corps dans un parti pris trop important et qui lui est proscrit pour conserver son statut. Pour autant, après ces premières réflexions, il ne fait aucun doute que la mission entraîne un engagement des religieuses qui passe à travers leurs corps.
Positionner la focale sur les femmes missionnaires est alors particulièrement intéressant dans le contexte des écoles résidentielles où elles sont omniprésentes et indispensables au bon fonctionnement du pensionnat. Les religieuses infirmières pourraient également être prises ici en exemple : des femmes s’engageant physiquement dans le soin des corps de l’altérité. Mais nous faisons le choix de conserver les discours des infirmières pour un point ultérieur de notre argumentation. S’il est possible de décrire la façon dont le personnel missionnaire conçoit les corps autochtones sous la forme d’archétypes (paresseux, sales et lubriques) qui s’opposeraient de manière franche à la société dominante, il est également possible de penser le corps missionnaire lui aussi construit et façonné pour marquer une distance entre le monde commun et le monde du religieux. La confrontation entre autochtones et femmes missionnaires au xxe siècle prend alors la forme d’un redoublement de la distanciation : l’autochtone reste à part, encore du côté de la sauvagerie (sinon il n’y aurait pas besoin des missionnaires et d’une politique assimilatrice), tandis que les missionnaires se situent pour leur part à l’opposé, au-delà du monde commun qui serait pour ainsi dire un palier intermédiaire[6].
Après ce temps de confrontation qui permet de préciser les constructions identitaires à l’oeuvre de part et d’autre – très généralement individuelles, teintées de préjugés et d’archétypes –, vient le temps de la mise en conformité des corps autochtones. En effet, si l’assimilation doit passer par la civilisation et donc l’évangélisation, les corps sont la première marque, celle qui est visible, du changement qui doit s’opérer.
Mise en conformité des corps autochtones
Les politiques d’assimilation du xxe siècle, qui ont débuté dès le xixe siècle, ont pour objectif de transformer les autochtones afin qu’ils deviennent semblables à la société dominante. C’est alors l’ensemble du champ symbolique relatif au corps qui se trouve chamboulé face à une nouvelle expérience corporelle par immersion dans un nouveau champ symbolique. Le corps est un « phénomène social [considéré comme tel] grâce à l’effet conjuré de l’éducation qu’il a reçue et des identifications qui l’ont porté à assimiler les comportements de son entourage » (Le Breton 1988 : 46). Les missions, et tout particulièrement les écoles résidentielles requièrent des corps autochtones un (ré-)apprentissage. Ces établissements pensionnats ont pour objectif de soustraire les enfants autochtones de leur environnement social et symbolique traditionnel pour en substituer un nouveau : celui de la société dominante. Les corps autochtones, initialement considérés comme différents et caricaturés comme tels, sont soumis à processus de façonnage qui se met d’abord en oeuvre par la déconstruction du corps traditionnel : c’est par la modification des corps et du champ symbolique associé que les missionnaires espèrent modifier les pratiques culturelles.
Selon les discours dominants, la sédentarisation devrait permettre la culture des terres et ainsi mettre les corps en activité toute l’année pour contrer l’oisiveté soi-disant inhérente à la culture autochtone. Mais outre les transformations des pratiques de subsistance, au xxe siècle le contrôle des corps se fait également par une régulation des naissances :
Les écoles sont pleines partout. À Fort Chip. [Chipewyan], diminution depuis 3 ans de la nativité. Fond du Lac, stationnaire. À Black Lake, la pilule se trouve sur le chemin – aucun effet – la stérilisation dépend plus du docteur ou nurse que du patient.
[ASGM] L032 D2*05
Fait désormais connu, les provinces de l’Ouest canadien ont encouragé une politique de stérilisation forcée des femmes autochtones à partir de la fin des années 1920 (Boyer et Bartlett 2007 : 7-8). Les congrégations de missionnaires en ont été témoins, comme l’atteste l’extrait de rapport susmentionné. Même si ces pratiques médicales visaient avant tout à répondre à des considérations économiques, c’est bien sur les corps qu’on voulait agir. Les considérations économiques – dans ce cas comme dans celui du processus de sédentarisation, visant, rappelons-le, à être plus productives – engendrent de conséquentes modifications des situations de mise en jeu des corps.
Par ailleurs, les corps sales et souillés par leur environnement évoqués plus haut doivent également se réformer dans un nouveau réseau de significations.
Les vêtements des filles, poussées dans un nouveau mode de vie, ont été changés ; elles ont reçu de nouvelles règles sociales et ont été obligées d’adopter des méthodes européennes d’ordre et de propreté. La coupe des cheveux des jeunes filles et le port de vêtements à la mode des Blancs devaient créer l’illusion qu’une transformation culturelle avait eu lieu. Bon nombre d’archives d’écoles décrivent les difficultés à garder les jeunes filles coiffées.
[ASSA] S106-2, notre trad.
Ce discours rétrospectif montre l’importance de l’apparence physique dans cette politique assimilationniste. Le corps doit marquer la transformation culturelle en cours, même de façon « illusoire » : l’objectif de transformer les corps avant même de modifier en profondeur les pratiques culturelles est ici explicite. Dans ce contexte de mise en conformité, « la ritualisation des corps » et « les pratiques de perpétuation » s’entremêlent de nouveau. Mais le troisième niveau de production sociale du corps souligné par Berthelot (« mode de production ») surgit : celui du corps façonné par une société, ici extérieure (Berthelot 1983 : 127-128). Les religieuses, par leur rôle d’enseignantes, mais également de surveillantes dans les écoles résidentielles, sont les agentes principales de cette mise en conformité du corps autochtone. Une religieuse déjà mentionnée, surveillante en école résidentielle à partir de la fin des années 1960 dans les Territoires du Nord-Ouest, puis animatrice de pastorale, raconte :
En début d’année, on regardait les catalogues de Sears, les grands catalogues, et puis les filles avaient le droit de choisir, c’est la fête parce que fallait avoir... Parce que tout était fourni à l’école, t’arrivais avec un sac, et puis après ça tout était fourni.
S. Cécile, s.g.m, le 13/06/2013, Montréal [QC]
La transformation des corps par une détribalisation est attestée. Les discours des religieuses ne le cachent pas, l’enjeu des écoles résidentielles était bien là. C’est en ces lieux que les corps autochtones sont le plus mis à l’épreuve : les écoles pensionnats sont sans aucun doute une forme particulièrement corporelle et matérielle des missions auprès des autochtones.
La mise en conformité des corps autochtones au regard de ceux de la société dominante est également explicite par l’observation de la division sexuée des tâches transmise dans ces établissements scolaires. Marqué dès la seconde moitié du xixe siècle lors de l’institutionnalisation des premières écoles pensionnats, l’apprentissage d’une division des tâches et des activités en fonction des sexes se poursuit au xxe siècle. Les récits oraux recueillis auprès de religieuses retraitées ne sont pas sans détails à ce sujet. La première religieuse citée dans ce texte, celle qui avait un fort a priori envers les autochtones qu’elle a côtoyés dans sa jeunesse, éclaire le propos. Devenue enseignante et surveillante en Ontario dans une école résidentielle durant plus de dix ans (entre la fin des années 1940 et les années 1950), elle raconte :
Les enfants allaient à l’école juste une demi-journée, l’autre temps de la journée ils faisaient de la cuisine, ils faisaient de la couture, ils aidaient à la boulangerie. Et puis les travaux de la maison. Alors ces filles-là, elles ont appris à garder une maison, comment tenir une maison. Et puis surtout comment être cuisinière. Ces femmes-là sont devenues de bonnes cuisinières, de vraies bonnes cuisinières. Les garçons, eux autres, ils travaillaient le bois, ils travaillaient dehors. Il y avait toutes sortes de travail.
S. Marie-Anne m.o., le 2/07/2013, Winnipeg [MB]
À chaque sexe ses activités : les jeunes filles apprennent la couture, la cuisine et les tâches domestiques, alors que les garçons apprennent la menuiserie, la charpente et de nombreux autres exercices qui se déroulent en extérieur. Le champ symbolique de l’expérience corporelle dans la société dominante occidentale implique une forte distinction genrée : une division sexuelle des activités qui est reproduite au sein des pensionnats. S’il existe bien un partage des activités en fonction des sexes dans les sociétés autochtones nord-amérindiennes traditionnelles, il ne correspond pas à celui souhaité dans le cadre d’une assimilation et doit donc être modifié. Masculin, féminin, tout comme leurs relations également culturellement construites, doivent se conformer aux façons de faire des Blancs. Alors indissociables des corps dans la pensée missionnaire, les genres autochtones sont refaçonnés pour reproduire, dans les communautés autochtones, la société dominante où le féminin s’occupe de ce qui a trait au domestique, et le masculin, de ce qui se déroule à l’extérieur.
Si les religieuses jouent un rôle dans la transformation des corps autochtones, cela ne les empêche pas de porter un regard critique sur ces pratiques. Ainsi poursuit une religieuse précédemment mentionnée :
Quand c’était la question des baptêmes, bah ! c’était à la manière des Blancs. […] Je trouvais ça horrible quand le temps était venu de faire la première communion. Tu sais, les enfants, ils auraient pu avoir des beaux habits à l’indienne, mais là ils faisaient venir des robes de première communion, puis il fallait qu’ils soient habillés, avec toutes les affaires...
S. Cécile, s.g.m, le 13/06/2013, Montréal [QC]
Grâce à cette double fonction, surveillante dans une école résidentielle puis animatrice de pastorale, cette religieuse est en mesure de porter un regard distancié sur les pratiques relatives au façonnage des corps dans ces établissements. Une autre religieuse, enseignante en Alberta dans une école de jour entre 1964 et 1968, narre un épisode de son expérience en territoire cri allant dans ce même sens. En parlant d’une autochtone rencontrée dans un centre social pour femmes, elle décrit :
Elle avait un tout petit à côté d’elle, moi je pensais que c’était une fille, mais c’était un garçon qui avait ses grandes tresses [...] Dès qu’on voit ça, des tresses, des fois on se dit qu’ils sont plus proches de la tradition. C’est correct, ça fait partie d’eux autres.
S. Aurore, op-dma., le 18/06/2013 à Beauport [QC]
Faisant preuve de relativisme culturel, et admettant que son propre référentiel symbolique culturel diffère de celui du monde autochtone, cette religieuse accepte ce qu’elle considère comme un trait corporel « traditionnel » autochtone, sans pour autant vouloir le transformer. Dans ce discours, les cheveux longs sont caractéristiques du monde nord-amérindien, marqueurs d’une identité culturelle[7]. C’est pourquoi l’une des premières modifications corporelles des jeunes autochtones arrivant à l’école résidentielle était la coupe des cheveux longs.
Le Breton synthétisant la place du corps dans la vie sociale au quotidien permet de saisir l’importance des corps et de leur transformation dans le contexte d’un processus d’assimilation. « Le corps doit passer inaperçu dans les échanges entre les acteurs, même si la situation implique fortement sa présence, il doit se résorber dans les codes en vigueur et chacun doit pouvoir retrouver, comme dans un miroir, ses propres attitudes corporelles chez l’autre. » (Le Breton 1988 : 133) Les religieuses sont alors prises en étau entre deux façons de concevoir l’altérité autochtone, et une forme de « schizophrénie » missionnaire se ressent (Servais 2014). D’un côté, elles doivent se conformer au discours assimilateur visant à transformer les corps autochtones, ce pour quoi elles sont présentes auprès de ces communautés. D’un autre côté, l’expérience de la pratique du terrain missionnaire, hors des écoles résidentielles, conduit les religieuses à prendre en considération les différences culturelles. Le regard porté sur le monde autochtone se fait alors individuel et personnel et permet à certaines religieuses de relever les marqueurs culturels et identitaires qui se donnent à voir à travers les corporalités.
Genre et corps sont alors des marqueurs d’une identité et, dans cette rencontre de deux mondes, l’un s’impose à l’autre afin de se conformer aux « symbolismes partagés par une communauté humaine donnée » (Le Breton 1988 : 60) – ici ceux imposés par la société dominante. L’assimilation dans ce contexte est un « lent travail d’érosion, d’effacement, de fragilisation du corps de l’enfant », en vue d’« ébranler [ses] perceptions premières », soit ses expériences corporelles acquises dans sa communauté de naissance (ibid. : 61). Dans cette phase de mise en conformité, qui passe peut-être avant tout par le (re-)façonnage des corps autochtones, les missionnaires ont le rôle d’« artisans-potiers ». Ce sont eux qui ont la charge de transformer les corps mous, oisifs et sales des autochtones en corps denses, actifs et propres, à l’image des corporalités de la société dominante. Mais cela était sans compter sur la variabilité culturelle de l’expérience corporelle : là où les missionnaires et l’épistémè occidentale proposent une disjonction entre corps et âme, d’autres sociétés quant à elles conçoivent une corporalité inséparable du sujet où corps et âme ne font qu’un.
Persistances autochtones
David Le Breton, dans son essai de sociologie et d’anthropologie du corps, a bien saisi les différentes modalités culturelles de mise en relation des corps dans leur environnement. Une problématique de type ontologique au sujet des « sociétés traditionnelles », pour lesquelles l’individu est un « être-en-relation » (Le Breton 1988 : 15). Précisant cet argument, l’auteur développe un principe d’efficacité symbolique : « Dans la “communauté de tout ce qui vit”, le corps ne saurait être décrit de façon isolé ou autonome, les significations qui le traversent ont déjà une existence extérieure. » (ibid. : 193) Ce principe est mis en exemple par l’auteur à travers les pratiques chamaniques et c’est à partir de cette particularité – que le monde nord-amérindien partage avec d’autres sociétés – que nous désirons souligner, toujours en nous appuyant sur des discours de religieuses, la persistance de cette part d’efficacité symbolique sur les corps (voir Delâge 2014a et Laugrand 2013). Il ne s’agit pas là de démontrer des formes de résistance de la part des religieuses, mais bien de persistance de l’expérience corporelle autochtone dans sa relation à son environnement à travers les discours de celles-ci. Il faut pour cela sortir des écoles résidentielles et se tourner vers les religieuses infirmières qui, par leur apport de soins dans les régions isolées, proposent une forme également particulièrement corporelle de la mission.
Les religieuses missionnaires infirmières comprennent très rapidement, par l’expérience sur le terrain, qu’elles vont devoir faire avec la composante animiste[8] du monde autochtone. Les interrelations avec les chamanes locaux (medicine men ou medicine women) reviennent souvent dans les discours. Les exemples narrés par une Soeur Grise de Montréal présente dans la région de Fort Rae (Territoires du Nord-Ouest) entre 1971 et 1989 sont explicites :
Une fois, j’ai eu un homme, d’une quarantaine d’années, couvert de marques. Il avait été admis à l’hôpital et on lui faisait des pansements, des traitements, et puis tout ça. Mais sa prescription comportait une autre chose. Tous les après-midi, il allait voir une sage-femme. Nous autres, ce qu’on appelle une sage-femme ça fait penser à quelqu’un qui délivre les bébés, mais ce n’est pas ça. C’est une femme du pays qui est une sage, une medicine woman. Il allait la voir parce que lui, il faisait de l’eczéma, une réaction épouvantable parce qu’il pensait que son voisin d’en face lui jetait des sorts.
Sr. Juliette, s.g.m., le 12/06/2013, Montréal [QC]
Cet exemple permet de notifier l’enchevêtrement important qui s’exerce dans la pensée autochtone entre les corporalités humaines et les forces animistes (le sort jeté par le voisin a des répercussions physiques sur le patient de l’infirmière). L’efficacité symbolique se déploie pleinement. À propos d’une aînée autochtone septuagénaire, cette même religieuse infirmière poursuit :
La madame était tout en transpiration puis [...] un drôle de vomissement. Elle n’avait pas de douleurs particulières. [Après examen et administration d’un médicament] quand je suis sortie, le petit-fils dit : « Vous savez ma soeur, je pense bien que ce n’est pas ça. Le problème c’est qu’il y a deux jours, on est allés à la chasse et à la pêche. […] on a tué un ours. Grand-maman Adèle pense que le poisson qu’elle a mangé a touché à la viande de l’ours. » Et là j’ai pensé : « Ah ! mon dieu, si c’est comme ça, va falloir aller voir le medicine men. » Mais le bon medicine men, il n’est pas dans le village, il est parti à Yellowknife. Il y en a un autre, mais il nous faisait des mauvais sorts, c’est le vieux Rouny. Ça je me souviens, il n’avait pas une bonne réputation […] Ils se sont finalement décidés à aller voir le vieux Rouny. Ils l’ont payé et puis lui il a fait des « caracarabolopatsi », et puis elle était correcte le lendemain matin. Et fallait... il faut y croire.
Sr. Juliette s.g.m, le 12/06/2013, Montréal [QC]
L’ours est un aliment tabou dans le groupe de cette femme, grand-maman Adèle, la religieuse le sait et n’a d’autre choix que de constater (et d’accepter) que les croyances locales, ancrées dans le champ social, sont dotées d’un pouvoir d’action conséquent (Le Breton 1988 : 188). La religieuse infirmière ayant passé près de vingt ans dans les Territoires du Nord-Ouest multiplie les exemples :
Et quelque chose d’assez spécial, il ne fallait pas qu’une femme qui était menstruée passe sur le terrain, sur le chemin d’un chasseur, ça enlevait la chance. Il fallait qu’elle passe à côté, dans la neige. Et il ne fallait pas que, dans un bateau, elle passe au-dessus des nasses de pêche. Toutes ces affaires-là, ce n’est pas croyable. Mais en général ils n’avaient pas tendance à dire beaucoup de ces choses-là. C’était plutôt caché. Elles ne voulaient pas trop nous dire pourquoi.
S. Juliette, s.g.m., le 12/06/2013, Montréal [QC]
Il s’agit là de nouveau de la description d’un monde global où croyances, champ social et corps s’articulent. Les religieuses, par leur sexe féminin, sont peut-être les plus à même de saisir cet entrelacs. Leur statut de femmes leur permet d’accéder à certains types de connaissances, comme celles qui concernent les prescriptions menstruelles ici évoquées. Mais aussi, et peut-être surtout, les activités qui leur sont réservées dans les missions en qualité de femmes – éducation des plus jeunes enfants et soins infirmiers – leur donnent un accès privilégié à certains pans de la corporalité autochtone.
Un autre exemple, issu de deux entretiens avec deux religieuses qui étaient en mission ensemble dans les Territoires du Nord-Ouest dans les années 1970 et qui narrent le même épisode, permet de continuer au sujet de ce monde animiste qu’elles découvrent. La première, alors animatrice de pastorale, a vécu auprès d’une famille dogrib une expérience assez rare pour une religieuse missionnaire :
J’ai été privilégiée, j’ai fait la chasse au caribou dans le barren land avec une famille pendant six semaines. […] Je me rappelle, en partant j’avais des hiking boots, tu sais des bonnes bottes en cuir pour marcher, et il [le père de famille] me regarde et me dit « c’est de la peau de vache ». On ne devait pas emmener ça. Ça serait insulter les caribous, ça serait insulter les…
S. Cécile, s.g.m, le 13/06/2013, Montréal [QC]
La seconde religieuse, l’infirmière précédemment mentionnée, est témoin de cet épisode du départ. Me racontant des exemples de l’animisme qui rythme la vie dans ces régions du Nord, elle précise :
Par exemple, tu ne vas pas à la chasse avec des bottes autres que de caribou. Parce que c’est de la chasse au caribou. […] Elle [la religieuse ci-haut évoquée] s’y en allait […] et elle est arrivée avec des bottines de vache, des grosses bottines. Non, non, non ! Elle est revenue et elle a pris mes mocassins [en peaux de caribou]. Il ne faut pas insulter.
S. Juliette, s.g.m., le 12/06/2013, Montréal [QC]
Nouvel exemple d’efficacité symbolique, mais qui s’applique ici à la religieuse de terrain qui doit se plier aux injonctions du monde nord-amérindien. On se rapproche ici d’une expérience de mission renversée (Peelman 2004). Dans cet exemple, c’est le corps de la religieuse qui doit être conforme, à travers son habillement. Là où, dans les écoles résidentielles, ce sont les jeunes autochtones qui doivent se conformer à la société dominante, dans le barren land, en territoire autochtone, c’est aux missionnaires de s’adapter et de s’ajuster aux règles locales.
La persistance du chamanisme sur l’ensemble du continent américain, Nord comme Sud, s’exprime par la persistance de ce régime animiste (Bousquet et Crépeau 2012 ; Laugrand et Oosten 2007) et de son efficacité symbolique sur les corps. Cette constante, à laquelle les missionnaires ont dû s’accommoder, met en lumière une forme de survivance d’une période que l’on pourrait croire passée : une persistance qui passe sans aucun doute par la corporalité (Bousquet 2005 ; Garrait-Bourrier 2006 ; Rostkowski 2001 ; Wallace 1956). Si les corps autochtones ont été mis à l’épreuve par les missionnaires, agents de terrain de la politique assimilationniste, ils sont aujourd’hui sur le devant de la scène, porteurs d’une identité culturelle. Des corps résilients, marqueurs de la persistance autochtone et promoteurs d’une identité nord-amérindienne, dont l’ancrage dans le monde animiste met à l’épreuve, à leur tour, les missionnaires.
Conclusion
Depuis les premiers contacts avec les Européens jusqu’à ce début de xxie siècle où le monde autochtone est entré dans une nouvelle phase dans ses rapports avec la société canadienne, les corps, marqueurs de l’identité, ont été le lieu de tous les enjeux. En temps de confrontation, les écarts sont volontairement creusés, marqués, affirmés. Les discours missionnaires, et plus généralement ceux de la société dominante, décrivent un monde autochtone à l’opposé du leur. Le Blanc se définit par opposition à l’Autochtone, et l’Autochtone est défini par ses caractéristiques inverses de celles des Blancs. À l’opposé de l’Autochtone, pour sa part encore du côté de la sauvagerie, se situe, non pas la société dominante dans son ensemble, mais, poussant le curseur au maximum, la figure des missionnaires, ces individus chastes dont le féminin se met service de tous dans une polymaternalité, tout en maintenant une corporalité inaliénable. Cependant, cette différence des corps se doit d’être amoindrie selon les principes de la politique d’assimilation des autochtones du Canada mise en place depuis la seconde moitité du xixe siècle. Vient alors le temps de la mise en conformité où s’entremêlent les trois niveaux de production sociale du corps définis par Berthelot. Le corps autochtone, tel que défini par la société dominante, doit s’oublier pour être oublié, pour se fondre dans une société qui n’aurait alors plus aucune raison d’être dominante. C’est un corps idéal qui est mis en lumière, un corps uniformisé sous une coupe de cheveux, sous une robe, pour les filles, et sous un ensemble pantalon-chemise pour les garçons. Un corps qui, selon son sexe, doit se conformer à certaines activités et façons de faire. Le corps est le marqueur de la transformation et doit être mis en conformité avant même les pratiques culturelles. Transformer les corps devait permettre une transformation consécutive des pratiques culturelles, mais certaines individualités missionnaires s’interrogent. Prises entre deux feux : celui de l’assimilation, projet pour lequel elles sont présentes en territoires autochtones, et celui du relativisme culturel questionnant, bien avant que ne le propose Vatican II, la part de particularismes culturels de ces sociétés autochtones qu’elles ont pour devoir de transformer. Enfin vient le temps de marquer la persistance, signe de la résistance nord-amérindienne. Malgré tout, et manifestement depuis les années 1960, les corps autochtones sont toujours présents sur la place publique. Dans un processus d’autodétermination à la fois identitaire et culturelle, le corps autochtone s’exprime dans une efficacité symbolique révélant un principe animiste constant que les missionnaires n’ont pas d’autre choix que d’accepter. Les écarts se creusent de nouveau.
Les religieuses portent un regard et proposent un discours sur le corps amérindien en fonction de leur propre corps et de leur propre statut de religieuses missionnaires. Se dessine alors en creux leur propre système culturel référentiel. Le corps de l’autre, celui de l’autochtone, se donne à voir à travers l’expérience personnelle des religieuses, que celle-ci se soit déroulée dans les écoles résidentielles ou dans les missions par l’apport d’une offre de soins infirmiers, offrant ainsi un autre volet de la rencontre, au plus proche du corps de l’altérité. En qualité de surveillantes dans les pensionnats, les religieuses contribuent quotidiennement au travail d’érosion de l’identité corporelle autochtone ; en qualité d’infirmières, les religieuses témoignent d’une rencontre avec un monde où corps, croyances et champ social sont indissociables. Les discours des religieuses missionnaires nous entraînent alors dans des situations de mise en jeu du corps amérindien relevant d’une rencontre interculturelle complexe et prenant des formes diverses.
Aujourd’hui encore, dans une période que l’on aime à considérer comme postcoloniale et où la Commission de vérité et réconciliation vient de rendre ses rapports et conclusions, les corps sont toujours au coeur des préoccupations. Les accusations de violences corporelles envers les enfants scolarisés dans les écoles résidentielles ne cessent d’agiter le débat public. La parole autochtone se libère et met ainsi à mal l’inaliénable corporalité des missionnaires. Dans cette « rencontre des deux mondes », les corps, de part et d’autre, ont beaucoup à exprimer.
Appendices
Remerciements
Je remercie les lecteurs anonymes pour leurs commentaires qui m’ont permis d’étayer mon propos. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude aux coordinateurs de ce numéro, ainsi qu’à Denys Delâge, dont les travaux influencent grandement l’ensemble de mes recherches.
Note biographique
Marion Robinaud, Ph.D. en anthropologie sociale et ethnologie (École des hautes études en sciences sociales, Paris, 2017), chercheuse associée au Centre d’études nord-américaines (CENA - Mondes Américains). Sa thèse, intitulée Religieuses au coeur des communautés indiennes : Mémoires féminines des missions de l’Ouest canadien, contribue à l’étude des mémoires et des congrégations féminines en Amérique du Nord autochtone et propose d’interroger les processus d’adaptation à l’altérité ainsi que la construction culturelle du genre féminin. Les réflexions de la thèse ouvraient sur des sujets variés, tels que les phénomènes d’adaptation et d’appropriation, la mémoire, les nomenclatures de parenté, les pratiques religieuses et l’identité contemporaine des Amérindiens. Depuis 2012, elle a réalisé plusieurs recherches de terrain au Canada, tant auprès de religieuses désormais retraitées qu’auprès de communautés Premières Nations en Alberta et Colombie-Britannique. Parmi ses publications récentes, mentionnons « Pour une anthropologie des missions catholiques féminines dans les mondes autochtones canadiens (xixe-xxie siècles) », Études canadiennes / Canadian Studies 90 : 161-181, 2021) et Religieuses et Amérindiens. Anthropologie d’une rencontre dans l’Ouest canadien (Presses universitaires de Rennes, 2020).
Notes
-
[1]
En témoignent, au temps de la Nouvelle-France, les phénomènes d’appropriation de l’altérité par imitation, lorsque les Amérindiens reproduisaient dans une performance mimétique les codes sociaux occidentaux (Havard 2007).
-
[2]
Nous pensons, entre autres publications, aux travaux des coordinnateurs de ce numéro, mais aussi, pour rester dans les rapports entre missionnaires et populations nord-amérindiennes, à ceux d’Allan Greer au sujet de Catherine Tekakwitha (Greer 2007), ou encore ceux d’Olivier Servais (2005). Nous nous inscrivons volontiers, s’ils le permettent, dans cette même filiation.
-
[3]
Dans le cadre de mes recherches, je me suis entretenue avec une vingtaine de religieuses canadiennes, désormais retraitées, qui ont passé leur carrière en mission auprès des Premières Nations de l’ouest du Canada et/ou des Inuvialuit (Inuit de l’Arctique de l’Ouest canadien). Ces témoignages ont été recueillis lors d’enquêtes de terrain réalisées entre 2012 et 2015 (avec la participation financière de la bourse Aires culturelles de l’EHESS, de la Commission de scolarité de l’EHESS, ainsi qu’avec la contribution du laboratoire LIAS-IMM [EHESS/CNRS]).
-
[4]
Une majeure partie des religieuses interrogées ont souhaité rester anonymes. Pour cette raison, les noms de celles qui sont citées dans ce texte ont été modifiés.
-
[5]
Déjà, en 1640, Marie de l’Incarnation décrivait « à une dame de qualité » la nudité et la « saleté insupportable » des jeunes filles autochtones pour justifier les dépenses réalisées et demander le maintien d’un soutien financier et matériel. (Voir [ICMH] 94216, Lettre XIII du 3 sept. 1640)
-
[6]
Soulignons ici que les corps missionnaires s’engagent parfois de façon très explicite dans le monde amérindien. Plusieurs exemples de missionnaires qui « s’amérindianisent » par l’abolition de certaines frontières corporelles pourraient être évoqués. Mais il ne faut pas oublier de remettre ces exemples dans le contexte des stratégies missionnaires : le corps missionnaire doit s’adapter à ceux qu’il veut évangéliser pour mener sa tâche à bien.
-
[7]
Au xviie siècle, Marie de l’Incarnation se trouvait, elle aussi, face à cette difficulté à distinguer filles et garçons. ([ICMH] 94216, Lettre XIII du 26 août 1644)
-
[8]
Philippe Descola propose de décrire le principe animiste sous l’équation d’une ressemblance des intentionnalités dans le monde humain et dans le monde non humain et d’une divergence des physicalités entre ces deux mêmes mondes. Intentionnalité et physicalité sont donc comme les deux faces d’une pièce de monnaie : indissociables pour décrire ce phénomène ontologique de nature religieuse (Descola 2005).
Archives
- ASGM (Archives des Soeurs Grises de Montréal, Maison d’Youville, Montréal [Québec]), L032 D2*05 : Grandes lignes du rapport de la zone du Lac Athabasca pour le conseil de pastorale de mai 1972.
- ASGM (Archives des Soeurs Grises de Montréal, Maison d’Youville, Montréal [Québec]), L022 A3*01 : Contrat intervenu entre les RR. Pères Oblats de Marie-Immaculée Province Alberta-Saskatchewan et la Communauté des Soeurs Grises de Montréal, pour la plus grande gloire de Dieu et l’apostolat des Indiens, concernant les écoles de Blue Quill S. Paul, Ste-Marie Cardston et du Sacré-Coeur Brocket, 1950.
- ASSA (Archives of Sisters of Saint Ann, Victoria [Colombie-Britannique]), S106-2 : C. A. Lowery, Education of Native girls in BC, sans date, ap. 1991.
- ICMH (Institut Canadien de Micro-reproductions Historiques), Collection de microfiches (monographie) n° 94216, 1994. Marie de l’Incarnation, 1681 : Lettres de la vénérable mère Marie de l’Incarnation, première supérieure des Ursulines de la Nouvelle-France. Imprimé chez Louis Billaine, Paris.
Médiagraphie
- Ballantyne, Tony et Antoinette Burton. 2005. Bodies in Contact: Rethinking Colonial Encounters in World History. Durham : Duke University Press.
- Berthelot, Jean-Michel. 1983. « Corps et société : Problèmes méthodologiques posés par une approche sociologique du corps ». Cahiers internationaux de sociologie 74 : 119-31.
- Bousquet, Marie-Pierre. 2005. « La spiritualité amérindienne sur la place publique : à la recherche d’un statut ». Dans La religion dans la sphère publique. Sous la direction de Solange Lefebvre, 171-96. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.
- Bousquet, Marie-Pierre et Robert Crépeau, dir. 2012. Dynamiques religieuses des autochtones des Amériques. Religious dynamics of indigenous people of the Americas. Paris : Karthala.
- Boyer, Yvonne et Judith Bartlett. 2017. Tubal Ligation in the Saskatoon Health Region: The Lived Experience of Aboriginal Women. https://www.saskatoonhealthregion.ca/DocumentsInternal/Tubal_Ligation_intheSaskatoonHealthRegion_the_Lived_Experience_of_Aboriginal_Women_BoyerandBartlett_July_22_2017.pdf (consulté le 20 septembre 2019).
- Breton, Stéphane. 2006. Qu’est-ce qu’un corps ? : Afrique de l’ouest/Europe occidentale/Nouvelle-Guinée/Amazonie. Paris : Musée du quai Branly.
- Collingham, Elizabeth M. 2001. Imperial Bodies: Physical Experience of the Raj (c.1800-1947). Cambridge : Polity Press.
- Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR). 2015. Pensionnats du Canada : La réconciliation. Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, vol. 1. Montréal : McGill et Queen’s University Press.
- Delâge, Denys. 2014a. « Des poils pubiens aux perles, de la chair au corps : essai sur la Grande Paix de Montréal de 1701 ». Dans Éros et tabou : sexualité et genre chez les Amérindiens et les Inuit. Sous la direction de Gilles Havard et Frédéric Laugrand, 45-96. Québec : Septentrion.
- Delâge, Denys. 2014b. Denys Delâge. Livre 5. Propos sur Tocqueville, les Amérindiens, le métissage et l’éthique de la recherche. Les possédés et leurs mondes, Anthropologie et Sociétés. https://www.anthropologie-societes.ant.ulaval.ca/denys-delage-livre-5-propos-sur-tocqueville-les-amerindiens-le-metissage-et-lethique-de-la-recherche (consulté le 20 septembre 2019).
- Delâge, Denys et François Trudel. 1991. « Introduction. La rencontre des deux mondes ». Anthropologie et Sociétés 15(1) : 5-12.
- Delâge, Denys et Jean-Philippe Warren. 2017. Le piège de la liberté : les peuples autochtones dans l’engrenage des régimes coloniaux. Montréal : Boréal.
- Descola, Philippe. 2005. Par-delà nature et culture. Paris : Gallimard.
- Désveaux, Emmanuel. 2007. Spectres de l’anthropologie. Suite nord-américaine. Montreuil : Aux lieux d’être.
- Flannery, Regina. 1938. « Cross-cousin marriage among the Cree and Montagnais of James Bay ». Primitive Man 11 (2) : 29- 33.
- Garrait-Bourrier, Anne. 2006. « Spiritualité et fois amérindiennes : Résurgence d’une identité perdue ». Cercles 15 : 68-95.
- Greer, Allan. 2007. Catherine Tekakwitha et les Jésuites. La rencontre de deux mondes. Montréal : Boréal.
- Guillemot, François et Agathe Larcher-Goscha. dir. 2014. La colonisation des corps : de l’Indochine au Viet Nam. Paris :Vendémiaire.
- Hallowell, A. Irving. 1937. « Cross-Cousin Marriage in the Lake Winnipeg Area». Publications of the Philadelphia Anthropological Society 1: 95- 110.
- Havard, Gilles. 2003. Empire et Métissages: Indiens et Français Dans Le Pays d’en Haut, 1660-1715. Sillery et Paris : Septentrion et Presses de l’Université Paris-Sorbonne.
- Havard, Gilles. 2007. « Le rire des jésuites Une archéologie du mimétisme dans la rencontre franco-amérindienne (xviie - xviiie siècle) ». Annales Histoire, Sciences Sociales 62(3) : 539-73.
- Havard, Gilles. 2016. Histoire des coureurs des bois : Amerique du Nord 1600-1840. Paris : Les Indes savantes.
- ICMH (Institut Canadien de Micro-reproductions Historiques). 1681. Lettres de la vénérable mère Marie de l’Incarnation, première supérieure des Ursulines de la Nouvelle-France. Collection de microfiches (monographie), dossier 94216 1994 : Imprimé chez Louis Billaine, Paris.
- Laugrand, Frédéric. 2013. « Pour en finir avec la spiritualité : l’esprit du corps dans les cosmologies autochtones du Québec ». Dans Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord. Sous la direction d’Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon, 212-32. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.
- Laugrand, Frédéric et Jarich. G Oosten, dir. 2007. La nature des esprits dans les cosmologies autochtones. Québec : Presses de l’Université Laval.
- Laurin, Nicole. 1999. « Le sacrifice de soi. Une analyse du discours sur la chasteté dans les communautés religieuses de femmes au Québec, de 1900 à 1970 ». Société 20(2) : 213-51.
- Le Breton, David. 1988. Corps et sociétés : essai de sociologie et d’anthropologie du corps. Paris : Méridiens-Klincksieck.
- Mauss, Marcel. 1936. « Les techniques du corps ». Journal de psychologie 32(3-4). http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/6_Techniques_corps/Techniques_corps.html (consulté le 20 sept. 2019).
- Peelman, Achiel. 2004. L’esprit est amérindien. Quand la religion amérindienne rencontre le christianisme. Montréal : Médiaspaul.
- Robinaud, Marion. 2017. « Religieuses au coeur des communautés indiennes. Mémoires féminines des missions de l’Ouest canadien ». Thèse de doctorat, anthropologie sociale – ethnologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
- Rostkowski, Joëlle. 2001. Le renouveau indien aux États-Unis : un siècle de reconquêtes. Paris : Albin Michel.
- Servais, Olivier. 2005. Des jésuites chez les Amérindiens ojibwas : histoire et ethnologie d’une rencontre, xviie-xxe siècles. Paris : Karthala.
- Servais, Olivier. 2014 : « Sexualité et moeurs des Ojibwés selon les missionnaires jésuites du XIXe siècle (1842-1900) ». Dans Éros et tabou : sexualité et genre chez les Amérindiens et les Inuit. Sous la direction de Gilles Havard et Frédéric Laugrand, 431-60. Québec : Septentrion.
- Stoler, Ann Laura. 2013. La chair de l’empire : savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial. Paris : La Découverte.
- Turgeon, Laurier, Denys Delâge et Réal Ouellet, dir. 1996. Transferts culturels et métissages Amérique/Europe, xvie-xxe siècle. Cultural transfer, America and Europe: 500 years of interculturation. Paris et Sainte-Foy : L’Harmattan et Presses de l’Université Laval.
- Voyé, Liliane. 1996. « Femmes et Église catholique. Une histoire de contradictions et d’ambiguïtés ». Archives de sciences sociales des religions 95 : 11-28.
- Wallace, Anthony F.C. 1956. « Revitalization Movements ». American Anthropologist 58(2) : 264-281.

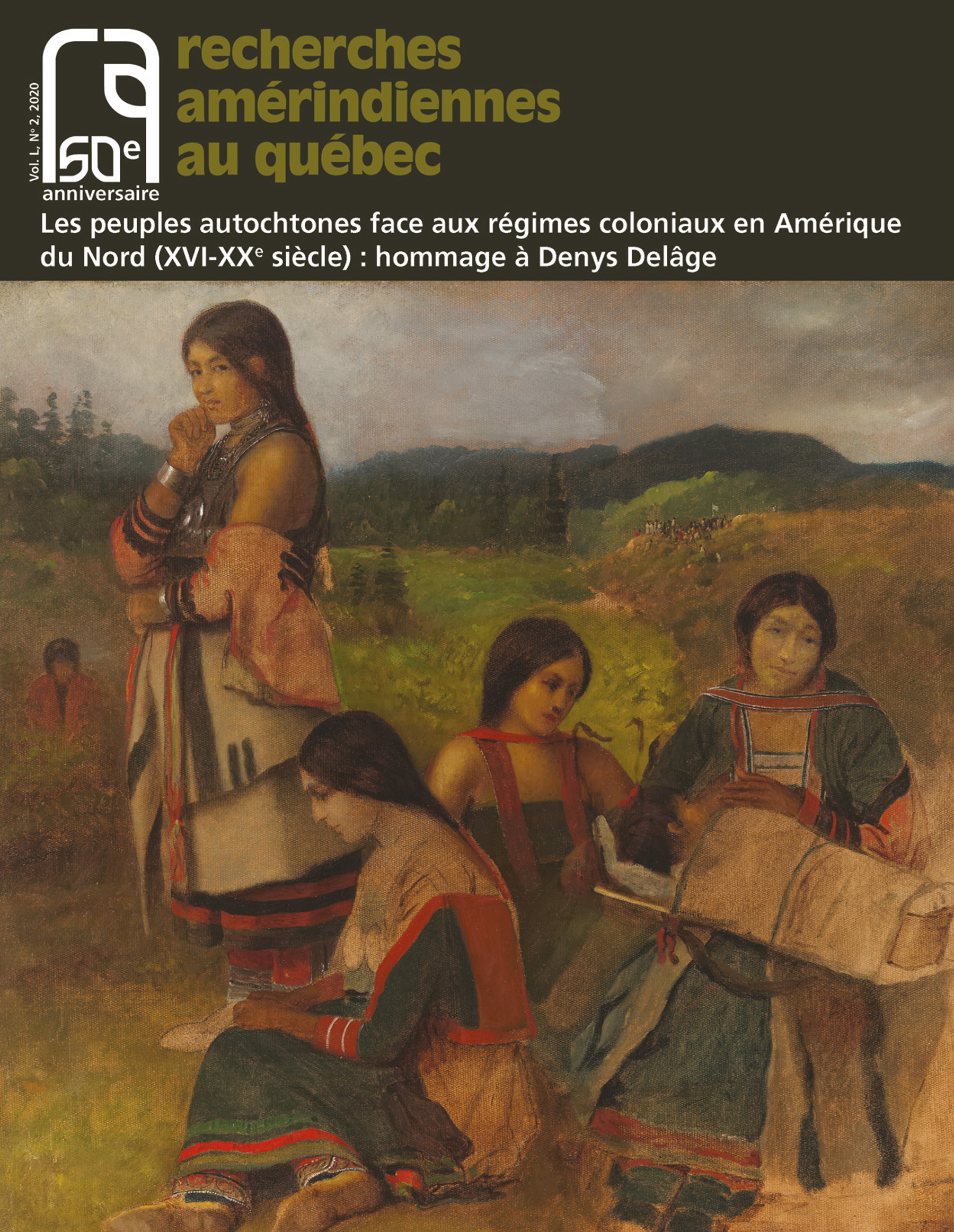
 10.7202/015155ar
10.7202/015155ar