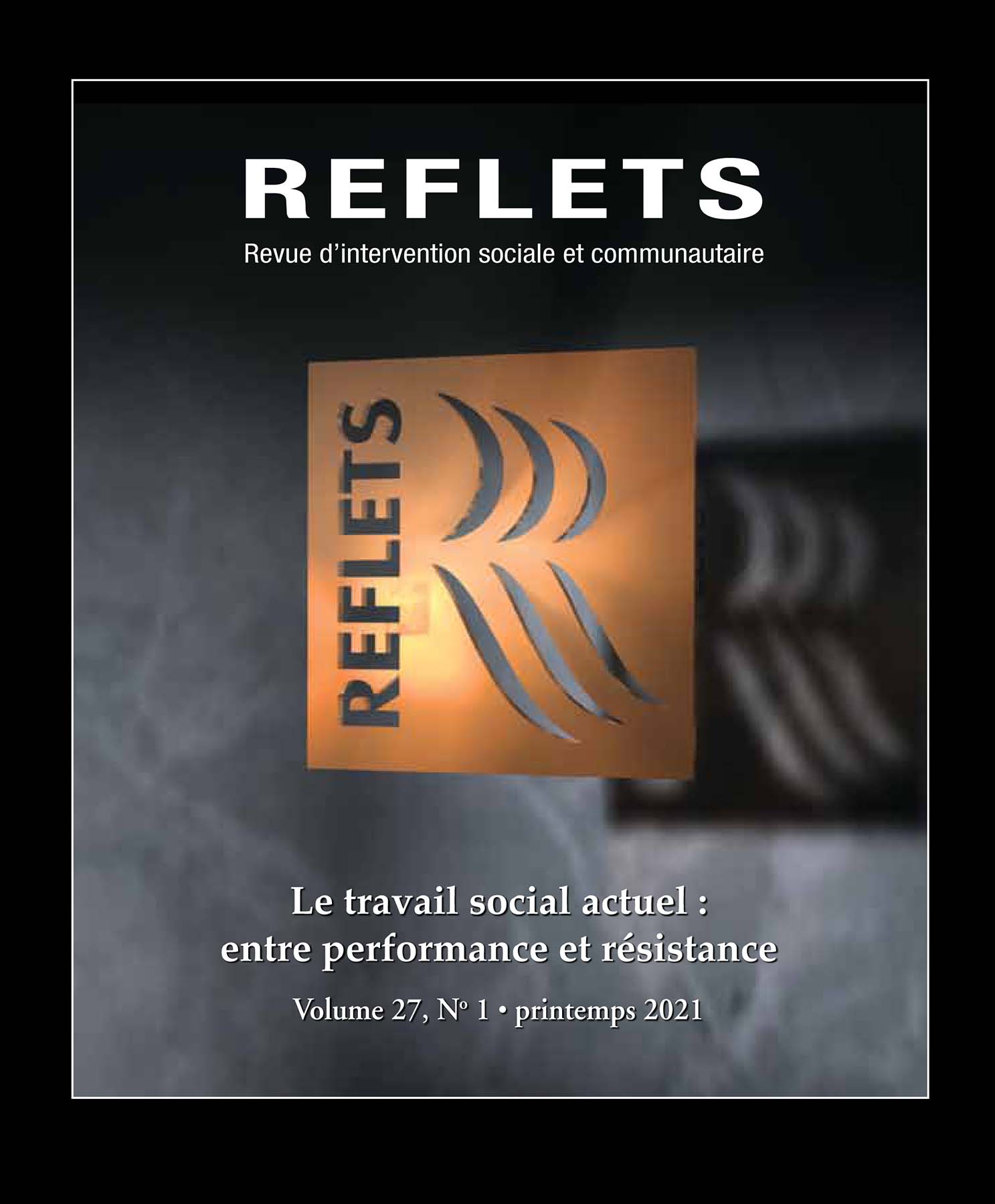Abstracts
Résumé
Les résultats d’une recherche collaborative menée dans le nord de la France entre 2012 et 2017 auprès de professionnels de la santé et du travail social (N = 52) attestent du sentiment de perte ou d’affaiblissement de leur pouvoir d’action, sentiment induit par la dégradation de leurs conditions de travail et de leurs ressources budgétaires, temporelles et symboliques. La charge émotionnelle de ces épreuves de professionnalité peut exercer de véritables effets de sidération psychique. Néanmoins, ces professionnels « font face » à ces situations, ils « se battent » et déploient plusieurs stratégies de résistance, à travers leurs capacités à déconstruire des rhétoriques instituées, à mettre en place des alliances ou encore en investissant des groupes d’analyse de pratiques. Marginalisés, épuisés, certains professionnels empruntent des voies de défection temporaires (comme la formation) ou plus radicales (turn-over, démission).
Mots-clés :
- pouvoir d’action,
- subjectivation,
- épreuve émotionnelle de professionnalité,
- sidération psychique,
- recherche collaborative,
- habitus,
- stratégie de défense,
- résistance créatrice
Abstract
The findings of a collaborative research conducted in the north of France between 2012 and 2017 among health care professionals and social workers (N = 52) highlight the feeling of loss or lessening of their power to act, impacted by the deterioration of their working conditions and their budgetary, temporal and symbolic resources. The emotional charge of these hardships of professionalism can have real effects of psychic numbing. Nevertheless, professionals cope with these situations, struggling with varying strategies of resistance, through their capacities to deconstruct established rhetorics, to set up alliances or even by investing groups analyzing practices. Marginalized, exhausted, some professionals take temporary defection paths (such as vocational training) or more radical (turnover, resignation).
Keywords:
- power to act,
- subjectivation,
- emotional hardship of professionalism,
- psychic numbing,
- collaborative research,
- habitus,
- defense strategy,
- creative resistance
Article body
Introduction
Les recherches collaboratives que j’ai menées depuis plusieurs années en France avec des professionnels des métiers de la relation (Doucet et Viviers, 2016), essentiellement des travailleurs sociaux situés en première ligne ou occupant des fonctions d’encadrement, m’ont conduit à questionner le sens qu’ils donnent à leur travail, ce qu’ils éprouvent dans l’exercice de leur métier ainsi que le pouvoir qu’ils ont sur leurs actes professionnels et, corrélativement, celui qu’exercent leurs actes professionnels (Mendel, 1998). Mon cadre théorique de référence est celui de la recherche clinique en sciences sociales (De Gaulejac, Giust-Desprairies et Massa, 2013) qui s’attache à saisir le vécu des professionnels, la façon dont ils sont mis à l’épreuve dans l’exercice de leur métier (Périlleux, 2005), en les accompagnant dans l’expression, l’éprouvé et la conceptualisation de ce vécu professionnel (Hanique, 2012) que je qualifie ici, dans la continuité des travaux de Bertrand Ravon, d’« épreuves émotionnelles de professionnalité » (Ravon, 2009 ; Ravon et Vidal-Naquet, 2016 et 2018). Le dispositif même de la recherche et l’adoption d’une posture compréhensive et clinique durant les entretiens collectifs (Fugier, 2010) permettant aux professionnels de « mettre en récit » et de « mettre au travail » (en réflexivité) les épreuves auxquelles ils font face et qui constituent de véritables « défis » dans l’exercice de leur professionnalité et leurs capacités de résistance (Martuccelli, 2015).
Ces professionnels sont engagés dans des métiers de la relation « malmenés » (Cifali et Périlleux, 2012), marqués par des changements organisationnels et institutionnels permanents et par l’introduction d’une idéologie gestionnaire et managériale (De Gaulejac, 2005). La subjectivation des professionnels (leurs capacités à donner du sens ou à faire émerger de nouvelles significations à leur travail) de même que leurs marges de manoeuvre et résistances « créatrices » (Lhuilier et Roche, 2009) s’en trouvent durement mises à l’épreuve, notamment parce qu’ils ne parviennent pas à entretenir et cultiver leur « répertoire de ressources » (Bertrand, 2018) et que la charge émotionnelle de ces épreuves exerce de véritables « effets de sidération » (Giust-Desprairies, 2008). Tels sont les résultats de recherche que je souhaite exposer dans cette contribution fondée sur une recherche collaborative qui s’est déroulée pendant cinq années (2012-2017) dans le nord de la France[1].
Dans un premier temps, je reviendrai sur le dispositif méthodologique de cette recherche, centré sur la co-animation de plusieurs entretiens collectifs (focus groups). Puis je rendrai compte de l’évolution de leurs capacités d’action, en me focalisant sur la réduction de leurs ressources budgétaires, temporelles et symboliques (de sens). Les entretiens collectifs permettent aussi de resituer la réduction vécue de leur pouvoir d’action dans un contexte institutionnel marqué par une organisation post-taylorienne de leur travail et un management « désincarné » (Dujarier, 2015). Je pourrai néanmoins, dans un dernier temps, rendre compte des leviers d’action et des résistances que peuvent déployer les professionnels, sous la forme d’un engagement idéologique, en mobilisant leur capital social ou encore en s’impliquant dans des espaces institués (tels que les groupes d’analyse des pratiques). Diverses stratégies de résistance apparaissent (Hirschman, 2011), prenant la forme de prises de parole situées à contre-courant (voice) ou empruntant des voies de défection (exit).
Cadre méthodologique de la recherche
Cette recherche a pour objet d’interroger les conditions d’exercice des métiers du soin et du travail social dans le nord de la France, en incluant l’expérience et le regard que peuvent y porter des personnes accompagnées par ces professionnels. Ses principaux objectifs étant de mieux saisir, avec les professionnels, les liens entre ce qu’ils vivent au travail et les changements institutionnels, et plus largement sociétaux, qui traversent les situations qu’ils rencontrent et auxquelles ils font face. Il s’agit autrement dit de confronter les expériences individuelles (les « épreuves ») et les contextes institutionnels (les « enjeux »).
Le caractère collaboratif de cette recherche (Les chercheurs ignorants, 2015) se manifeste tout d’abord dans la composition de son comité de pilotage, associant des chercheurs universitaires, des cadres et des travailleurs sociaux des secteurs social et sanitaire ainsi que des cadres pédagogiques d’un Institut de formation de travailleurs sociaux. L’ensemble des membres de cette équipe multiprofessionnelle a participé aux différentes phases de cette recherche.
Le corpus de données que je mobilise dans cet article comprend les entretiens collectifs au sein de focus groups composés de professionnels du social et du soin. Neuf groupes ont été constitués. Ils forment en tout un échantillon de 57 professionnels, soit un total de près de 700 pages de transcriptions d’entretiens collectifs. L’ensemble de ce corpus a fait l’objet d’une analyse thématique à l’aide d’une grille d’enquête utilisée en amont de la conduite des entretiens et réajustée en aval, après leur conduite, les thèmes principaux se dégageant de chaque entretien collectif étant l’objet d’une analyse transversale pour dégager la singularité ou à l’inverse les résonances entre chaque focus group. L’analyse de contenu a été notamment menée à l’aide d’un logiciel d’analyse lexicale (Tropes).
Réunis durant trois à cinq rencontres, ces groupes comprennent des soignants ou travailleurs sociaux exerçant en première ligne ou occupant des fonctions d’encadrement dans divers domaines d’intervention et établissements. L’échantillon de professionnels se compose de cadres de secteur et de cadres pédagogiques de formation, membres du comité de pilotage de la recherche. Les principales stratégies de recrutement consistent à assurer une homogénéité d’appartenance associative, territoriale ou du public accompagné (ils interviennent dans la même association et/ou sur le même territoire et/ou auprès des mêmes publics), tout en privilégiant une certaine hétérogénéité dans la composition statutaire des membres au sein d’un même groupe (afin de favoriser en particulier la circulation et mise en dialogue des pratiques et savoirs des professionnels en front office et en back office).
Ainsi, le premier groupe réunit des professionnels membres d’une même fédération, mais aux fonctions différentes : il est composé d’un chef de service d’un centre d’hébergement, un éducateur et une éducatrice de ce centre d’hébergement, une éducatrice exerçant dans une association de prévention, un éducateur et président d’une association d’aide à domicile, le directeur de cette dernière, et enfin une assistante sociale. De la même manière, des groupes rassemblent des professionnels situés sur un même territoire d’intervention, mais exerçant des fonctions différentes : un second groupe comprend une assistante sociale, la directrice d’une association d’aide à domicile, une coordinatrice jeunesse, un responsable de la Maison des Droits de l’Homme, une chargée de mission dans un centre d’action sociale et une médiatrice familiale. Un troisième groupe compte deux assistantes sociales, trois cadres socio-éducatifs, deux assistants socio-éducatifs, un cadre de secteur et la directrice adjointe d’un centre social. Le quatrième groupe réunit des chefs de service et des assistantes sociales. Le cinquième est le plus homogène puisqu’il rassemble quatre techniciennes d’intervention sociale (TISF) auxquelles est venue se joindre leur chef de service ; il en est de même pour le sixième groupe, composé d’auxiliaires de vie sociale et de TISF, auxquelles est venue se joindre leur coordinatrice. Le septième groupe contient des professionnels soignants, paramédicaux et éducatifs (une cadre de santé, une kinésithérapeute, une ergothérapeute, une animatrice sportive et une aide-soignante). Le huitième groupe doit son homogénéité au fait de ne réunir que des élus à une instance représentative du personnel (CHSCT), mais occupant des fonctions professionnelles différentes (coordinateur, éducateur spécialisé, chef de service, assistante sociale). Enfin, le neuvième groupe comprend d’une part des aides-soignantes à domicile et d’autre part des auxiliaires de vie sociale qui interviennent à domicile.
Un dispositif en trois temps a été mis en place dans chacun de ces focus groups, comprenant : des temps de récits de vie ; des temps d’analyse de pratiques et situations professionnelles ; enfin, des temps de restitution des données collectées et de discussion des hypothèses et analyses proposées. L’objectif de la recherche spécifique à ces groupes était de favoriser l’implication des participants en articulant un niveau narratif, c’est-à-dire l’expression descriptive d’un vécu singulier, avec un niveau réflexif et analytique plus collectif visant à la coproduction d’hypothèses étayées sur l’analyse croisée de facteurs psychosociologiques. C’est pourquoi la principale méthodologie à laquelle J’ai eu recours est la conduite de récits de vie, invitant chaque participant, notamment à l’aide du support narratif de la ligne de vie, à inscrire ses expériences de travail dans son contexte sociohistorique d’émergence. Une des limites méthodologiques qu’on peut toutefois évoquer ici est de ne pas avoir joint à cette méthodologie la conduite d’observations directe et participante, qui aurait permis de confronter les niveaux narratifs et praxéologique des acteurs (ceci n’a été qu’exploré dans le cadre d’une restitution de la recherche prenant la forme d’un théâtre forum qui a permis de confronter les professionnels à la mise en scène d’une situation/d’une épreuve à laquelle étaient confrontées des professionnelles de l’intervention à domicile).
Enfin, concernant le cadre éthique de cette recherche, une charte a été transmise à chaque personne concernée précisant ce à quoi s’engage chaque partie prenante[2]. Un contrat était signé par les participants de chaque groupe et stipulait notamment le respect de la confidentialité des données et de l’anonymat.
Plusieurs articles déjà parus traitent des résultats de recherche qui se dégagent des focusgroups réunissant des « usagers » (Niewiadomski, Brassart et Autes, 2015) ainsi que des intervenants à domicile (Fugier, 2016 ; Bercal et Herbaut, 2018). Cette présente contribution se concentre sur quatre autres focus groups, réunissant au total 28 professionnels. Je n’ai pas retenu les focus groups composés de personnes concernées et de professionnels du champ de la santé, pour me concentrer sur ceux réunissant des travailleurs sociaux. La composition de ces quatre groupes demeure hétérogène, puisqu’ils réunissent des professionnels en front office d’une part (assistant de service social, éducateur spécialisé, technicienne d’intervention sociale, assistante socio-éducative) et des professionnels en back office d’autre part (coordinatrice, chef de service, cadre socio-éducatif). Enfin, un de ces groupes a la particularité de réunir des membres élus de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les professionnels du travail social qui composent cette instance représentative du personnel constituent une zone d’ombre dans la littérature académique consacrée aux CHSCT[3]. Cet article présente donc l’intérêt de donner à voir leur lecture de l’évolution des conditions de travail, ressources et leviers d’action des professionnels du social.
Des professionnels du social en mal de ressources
Entre précarité salariale et précarisation subjective
Un des constats que livre la majorité des professionnels du social est que les ressources dont ils disposent pour effectuer un travail de qualité (Clot, 2008) sont de plus en plus insuffisantes ou inadéquates : la hausse des restrictions budgétaires ; des choix budgétaires qui privilégient la communication externe au fonctionnement quotidien de l’établissement ; le climat organisationnel conflictuel empêchant le travail d’équipe ; le manque de partenariat ; le sentiment de solitude ; la méconnaissance du public et de son évolution ; le sentiment d’être moins considéré, écouté et que ses compétences sont disqualifiées… Si une part grandissante de travailleurs sociaux souffre de précarité salariale (Marchal, 2018), j’y reviens plus bas, c’est l’ensemble des professionnels du social qui est aujourd’hui mis « à l’épreuve de la précarisation subjective », « se [sentant] en permanence sur le fil du rasoir » (Bertrand, 2018, p. 45).
Plusieurs professionnels interrogés sont notamment revenus sur la « politique du précariat » (Cingolani, 2014) que semblent mener des établissements, dont la gestion de la pénurie du personnel consiste à remplacer les salariés par des travailleurs précaires. Beaucoup d’entre eux finissent d’ailleurs par « lâcher », noyés dans l’incertitude et le caractère peu motivant de leur précariat. L’instabilité (turn-over) et le sous-effectif permanent des établissements fragilisent et insécurisent les salariés (encore) établis, tout en mettant en tension et sous pression les équipes et services.
Quand ils s’estiment ainsi dépossédés de leur pouvoir d’action et du sens de leur travail, les professionnels du social tendent à vivre leur rapport au travail comme une relation de sujétion. Ils y réagissent et y résistent toutefois, par diverses tactiques, ruses et bricolages qu’ils inventent au quotidien, seuls ou en groupe, afin de demeurer des sujets « auteurs » plutôt que soumis à d’autres (à leur direction, aux financeurs, aux élus politiques, aux collègues, aux personnes concernées…).
L’humain d’abord ?
Si les professionnels confirment cette tendance structurelle à l’effritement de leurs supports sociaux, c’est avant tout la réduction et la non-pérennisation de leur budget de fonctionnement qui constitue selon eux un des facteurs les plus contraignants dans l’exercice et le développement de leur pouvoir d’action. Reviennent de façon récurrente dans leurs discours les « restrictions budgétaires », les impératifs de « rentabilité », de « rationalisation des dépenses », « avec une visée d’entreprise ». Parmi les métaphores les plus utilisées concernant l’évolution de leurs capacités budgétaires, je retiendrai celle du robinet : auparavant ouvert, le robinet coule désormais avec un débit réduit et sous certaines conditions : « Avant, on ouvrait le robinet, ça coulait et puis c’était un budget global. On avait besoin d’autant, alors le budget c’était autant » (Sylvie, assistante socio-éducative).
Plusieurs professionnels me parlent de la perte de leur indépendance financière et de leur soumission au dictat de l’économie, avec le sentiment que le social passe désormais au second plan par rapport à l’économique. Lesly, éducatrice dans une association de prévention, évoque le basculement à travers lequel le choix de leurs projets et activités se trouve désormais soumis aux choix budgétaires effectués en amont : « On est en train de créer une forme de profit du social. On a des enveloppes de l’État sur telle ou telle thématique et on va faire des choses parce qu’il y a de l’argent à prendre ».
Si on peut bien évidemment y voir la marque du New Management Public (Bellot, Bresson et Jetté, 2013 ; Molina, 2014) et de la chalandisation des métiers du social (Chauvière, 2008), certains professionnels perçoivent dans ces restrictions budgétaires et dans cet impératif de rentabilité les effets de la crise de l’État-providence en France, la remise en question de ses principes, de ses valeurs et du rôle central donné à l’État dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens les plus vulnérables.
Des professionnels à la recherche du temps perdu
Lié au thème de la réduction des ressources budgétaires, celui de la réduction des ressources temporelles est évoqué de façon systématique parmi les groupes de professionnels : ils estiment ne plus avoir le temps de réaliser un travail de qualité, effectuant un métier dans lequel, précisément, le temps est une donnée déterminante. Est aussi relevée la hausse du rythme de travail, des cadences et des dépassements horaires.
Parmi les professionnelles et les professionnels qui sont quotidiennement confrontés à un manque de temps, j’évoquerai le cas des techniciennes d’intervention sociale et familiale (TISF). La façon dont elles font face à cette contrainte ne les conduit pas tant à éliminer telle ou telle action, mais plutôt à prendre tout de même un/leur temps. Cela les conduit à dépasser leur temps d’intervention (rester 3/4 d’heure plutôt que 30 minutes auprès d’un.e bénéficiaire), quitte à le faire bénévolement et arriver plus tôt chez cette personne (anticiper sur les temps d›accompagnement prolongés) ou, à l’inverse, arriver en retard chez la prochaine (et par conséquent chez elles, en fin de journée).
On peut entrevoir ici les résistances que peuvent mettre en place ces professionnelles dans le quotidien de leur métier pour faire face à l’injonction à travailler vite et dans l’urgence : quand elles constatent qu’elles sont en train de prendre du retard sur le temps imparti, plutôt que se dépêcher, certaines vont garder le même rythme, en se disant « tant pis, je dépasserai ». Parce que « c’est un être humain, ce n’est pas objet » ; « s’il faut se dépêcher, il fallait aller travailler à la chaîne ». Elles ne veulent pas « pas se mettre dans l’urgence », malgré la cadence impérative des tournées. Je rejoins sur ce point les travaux de Solène Billaud et Jingyue Xing (2016), rendant compte, dans le cas des aides-soignantes en EHPAD, des « bricolages » et « arrangements » que ces dernières opèrent avec les règles et comportements prescrits, afin de réduire l’écart entre leur temps « idéal » (vécu comme un temps « interne » et correspondant au temps souhaité auprès des patients) et le temps « réel » (vécu comme un temps « externe », correspondant au calendrier imposé par l’organisation du travail). Ainsi, les travailleurs sociaux en front office de notre échantillon d’étude mettent en place plusieurs stratégies pour faire face à une organisation du travail jugée insatisfaisante en augmentant, par exemple, leur temps de travail non rémunéré, mais aussi en pratiquant l’entraide entre collègues, ou encore en choisissant de hiérarchiser et d’abréger certaines tâches.
On peut relever un des effets pervers de la logique gestionnaire dans laquelle s’inscrivent les établissements sociaux et qui vise à faire gagner du temps au personnel à travers l’usage grandissant de l’informatique. La bureaucratisation apparaît comme un facteur différant la relation d’aide et d’accompagnement. « Avant », pour répondre à un besoin, les professionnels avaient la capacité de mobiliser « sur-le-champ » une aide, leur réseau de relations interpersonnelles, par « un coup de fil », sans se soumettre à une procédure ou à un protocole. Désormais, les relations de travail sont devenues à la fois plus impersonnelles et différées. On constate donc une désynchronisation grandissante entre l’urgence des situations des bénéficiaires, qui exigent une réaction « sur-le-champ », et les réponses de plus en plus différées par la lourdeur et la temporalité propres aux démarches administratives et aux procédures bureaucratiques.
Pour reprendre les néologismes empruntés à Vincent de Gaulejac dans son analyse critique de l’idéologie gestionnaire (De Gaulejac, 2011), les travailleurs sociaux donnent à voir comment leurs capacités d’action et d’innovations sont touchées par les folies de la « prescriptophrénie » (il faut tout noter, tout classer, tout catégoriser) et de la « quantophrénie » (il faut tout chiffrer, tout compter). Leurs capacités peuvent ainsi être réduites par « une complexification des démarches et une difficulté à prendre des initiatives pour être innovant » (Sébastien, cadre socio-éducatif dans un service d’accompagnement à la vie sociale). Les professionnels du social évoquent des courriels de 50 pages pour une erreur de calcul et le sentiment d’être sous l’emprise de logiciels, par exemple dans la gestion des retards et absences du personnel. Avec un usage aussi systématique de la technique, l’humain tend à devenir l’objet de la technologie (Heidegger, 1958).
Des liens apparaissent aussi entre l’informatisation du métier et le sentiment d’augmentation du contrôle social de son activité, sa normalisation, avec la réduction de ses capacités d’innovation et de l’éventail des pratiques possibles. Une logique de contrôle vient ici se nouer à la logique gestionnaire.
Un capital symbolique dévalorisé
Cela m’amène à insister sur une troisième ressource jugée insuffisante bien que déterminante par les professionnels pour maintenir et développer leurs capacités d’action : leurs ressources symboliques, qui renvoient au besoin de sens et de reconnaissance des professionnels. La perte de leur « capital symbolique de reconnaissance » (Bourdieu, 1997, p. 223) signifie que leurs autres formes de capital (économique, culturel et relationnel) n’exercent plus les mêmes effets symboliques qu’auparavant. Or, comme le souligne Pierre Bourdieu:
[…] le capital symbolique [est] précisément ce crédit (donc cette accréditation collective) que l’individu détient auprès de ses pairs ou ce prestige qu’il obtient et accumule au gré de ses échanges sociaux, et qui en quelque sorte légitime les autres capitaux qu’il détient — capital social, capital économique, capital culturel pour l’essentiel […] »
Dubois, Durand et Winkin, 2013
Le manque de reconnaissance de la valeur de leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être, et le déficit de leurs ressources sont d’autant plus mal vécus quand cela est gommé dans la communication externe de l’établissement et que les dirigeants recourent au « as if management », « qui fait comme si tout allait bien, qui ignore les problèmes et ne veut les aborder » (Feynie, 2012, p. 8), en mettant en scène une image publique de l’établissement en net décalage avec ses coulisses et les affres du quotidien. Ce sont les membres élus de CHSCT qui, comme Valérie, questionnent le plus vivement le « décalage qu’il peut y avoir entre une présentation d’un directeur d’établissement qui trouve que tout va bien et des salariés qui ont le sentiment de vivre quelque chose de maltraitant ». Dans ces mises en scène, ce sont bien le mal-être au travail et la « violence ordinaire dans les organisations » (Herreros, 2012) qui se trouvent déniés.
Cela dit, comme le pondère Sofia (une autre élue CHSCT), ce discours institué prétendant que « tout va bien » peut être lié à l’instabilité des financements dont sont dépendants les établissements et structures. Afin d’assurer leur maintien, la publicité que les professionnels qualifient de mensongère concernant la bonne gestion de l’organisation est préférée à la reconnaissance publique de ses difficultés :
Il faut peut-être avoir un discours qui, on l’imagine, va rassurer le financeur. J’imagine un cadre qui va dire aux partenaires qui envoient les demandes d’admission que les salariés sont inquiets, que c’est compliqué, ils ont peur qu’ils aillent voir alors ailleurs, donc il y a deux niveaux de vitesse : entre ce qu’on défend de l’image et ce qui se joue réellement dans l’établissement, et dont peut très bien avoir conscience le responsable.
Cette nuance apportée par cette cheffe de service témoigne de l’intérêt d’avoir mis en place des groupes hétérogènes de professionnels dans le cadre de ces focus groups, les propos de Valérie, émis depuis sa position d’éducatrice spécialisée, étant remis en perspective, sans être récusés pour autant, par ceux tenus par Sofia, depuis sa position de cheffe de service. Valérie, « emboîte le pas » à Sofia pour à son tour proposer une remise en perspective à même de saisir toute la complexité du thème traité, en associant à la crainte des dirigeants de mettre à mal l’image de l’association aux yeux des financeurs celle des professionnels. En effet, ces derniers sont eux aussi tentés d’invisibiliser les agressions commises par certains bénéficiaires, de crainte que la mise en oeuvre d’une procédure se retourne contre le travailleur social et que la procédure vienne « déterrer » certains dossiers « secrets » de l’organisation.
Si les professionnels élus CHSCT évoquent la « maltraitance » et la violence symbolique que peuvent exercer des cadres et dirigeants auprès de certains salariés, en recourant par exemple au chantage de « l’armée de réserve » afin qu’ils se résignent à accepter leur situation pourtant vécue comme inacceptable (« c’est ça ou le chômage, il y a une liste d’attente… »), la résignation des salariés semble aussi nourrie par le fait que les instances représentatives du personnel, forme instituée de leur capital symbolique, sont elles aussi maltraitées : « dans l’association dans laquelle je bosse, les instances sont malmenées, maltraitées, pas respectées, et du coup les salariés le sentent et se disent “si eux ne sont pas respectés, encore moins moi, je ne vais rien dire…” » (Valérie, élue CHSCT).
Des capacités d’action malmenées par une organisation du travail sidérante et un management désincarné
Des professionnels mis en état de sidération
Si les professionnels qui ont participé à ces focus groups, particulièrement à celui composé de membres élus au CHSCT, insistent sur l’intensité et l’augmentation de la souffrance au travail des professionnels du social, je souhaite souligner la récurrence d’un terme dans leurs discours, révélateur de la crise symbolique à laquelle sont confrontés ces professionnels : celui de sidération. Cela m’amène à appréhender un type d’épreuves de professionnalité mis en évidence par Bertrand Ravon et Pierre Vidal-Naquet (2018) : les épreuves émotionnelles de professionnalité. Toutefois, si les sociologues les identifient avant tout comme des expériences de débordement émotionnel dans la relation d’aide, il s’agit ici plutôt d’évoquer des expériences « insupportables », dont la charge émotionnelle est telle qu’elle laisse les professionnels « sans mots », exerçant un effet de sidération que je peux définir comme une « sorte de paralysie de la pensée qui ne permet plus à l’imaginaire ainsi réifié d’exercer ses fonctions créatives pour la pensée » (Giust-Desprairies, 2008, p. 21).
Cette paralysie, les professionnels élus au CHSCT la constatent dans le fait de devoir de plus en plus « aller chercher » les salariés, dont l’apparente passivité semble induite par un contexte organisationnel de changement permanent. Le fait que « ça change tout le temps » exercerait de tels effets de sidération en privant les salariés de leurs capacités de verbalisation de leur éprouvé et d’élaboration de leur vécu au travail. Ce manque de symbolisation peut conduire des professionnels à des passages à l’acte impulsifs et violents :
Il y a une certaine passivité. Alors c’est aussi le fait que ça change tout le temps, il y a tout le temps du mouvement, ils ne savent plus où ils en sont, un effet de sidération, ils n’interviennent plus, ils ne parlent plus. Et je trouve qu’ils ont des situations de plus en plus de souffrance au travail. C’est très, très inquiétant. Il y a quelques situations qui sont… des gens qui évoquent des idées suicidaires, des choses que je n’avais jamais entendues »
Valérie, éducatrice spécialisée en ITEP, secrétaire élue au CHSCT
D’autres expériences vécues comme « insupportables » et susceptibles d’exercer de tels effets de sidération peuvent être mises en avant. Ainsi, la révision brutale du sens donné à ses missions peut générer une crise identitaire (Gaulejac, 2002, p. 174-180), à travers la mise en tension entre son identité professionnelle « héritée » (reçue en héritage, durant le parcours de formation, et qu’on a vocation à faire perdurer), son identité professionnelle nouvellement « acquise » (à travers la réorientation subite de ses missions professionnelles) et son identité professionnelle « espérée » (renvoyant à ses rêves, utopies et idéaux professionnels). Je propose à des fins illustratives cet extrait de Claire (assistante de service social, élue au CHSCT), évoquant le mal-être de travailleurs sociaux intervenant dans le champ de la protection de l’enfance traversé par d’importantes réformes ces dernières années (cf. la loi du 5 mars 2007) :
[L] es gens ont été recrutés comme travailleurs sociaux pour faire un accompagnement de majeurs protégés, et avec la réforme, ils questionnent leur accompagnement, et là il y a des deuils à faire… les gens disent « moi j’ai fait cette formation pour être dans l’accompagnement », et ça apparaît très fort dans le service majeur. Donc toute la question repose aussi sur le sens du travail, sur ce qu’on leur demande et ce qu’ils ont envie de faire, donc tout un mal-être. C’est violent… avec des gens tout en incompréhension, disant « mais enfin si j’ai été embauché comme travailleur social et que j’ai ce savoir-là, c’est ce que j’ai envie de faire », et la direction de répondre « oui tu as été embauché, mais bon, aujourd’hui ce n’est pas ce que je te demande, fais ce que je te demande et si ça ne te va pas, la porte est grande ouverte. Vous êtes là pour gérer les gens », crûment […] Et ça, c’est insupportable. Pour les gens c’est insupportable.
Enfin, on peut évoquer les effets de sidération qu’exercent la crise et la souffrance systémique : le fait que le mal-être au travail ne touche pas uniquement une équipe ou un service, mais soit perçu comme un phénomène qui se généralise à l’échelle de l’ensemble des établissements et caractérise donc leur état ordinaire exerce aussi un effet de sidération. Cela occasionne un sentiment de fatalité (personne ne peut y réchapper, du salarié exécutant au chef de service et directeur de pôle). Sentiment de fatalité qui peut se transmuer en nihilisme (« à quoi bon ? »), voire en cynisme (jouir de l’état pathologique des organisations), comme le résume Gilles (éducateur spécialisé dans un ITEP, élu en CHSCT) :
Concernant la sidération, avant, il pouvait y avoir un service, un établissement, qui ne fonctionnait pas bien, on entendait parler de la faute d’un directeur, d’un chef de service, et il y avait une résolution, avec au pire la fermeture du service. Aujourd’hui, on a l’impression que ce sont tous les services, tous les établissements qui sont impactés, qui sont pris là-dedans. La sidération est liée au sentiment que ça peut toucher tout un chacun, le salarié éducateur, l’ASS et le cadre. […] Donc la sidération vient du fait que “tu me demandes d’aller au bout d’une démarche revendicative, mais tu ne t’en rends pas compte, le chef de service ne tient pas la route, le directeur, même le directeur de pôle, qu’est-ce que tu vas demander à moi d’avoir une quelconque influence sur ce qu’il a mis en place ?”
Finalement, les entretiens collectifs menés auprès des professionnels en disent long sur leur mal-être au travail, mais aussi sur leurs inquiétudes et leur pessimisme concernant leur avenir professionnel et plus largement le devenir de leur métier. Cette vision pessimiste, parfois catastrophiste du futur, aggrave d’autant plus la crise symbolique que connaissent les professionnels des métiers du social et du soin : dans leur quête de ressources symboliques, ils n’ont pas plus de sens à trouver dans leur avenir que leur présent. Ce n’est pas « seulement » une dégradation des conditions de leur travail, mais la régression de leur métier, de leur institution dont ils me font part, notamment à travers le sentiment d’un « retour en arrière » et « qu’on arrive au bout de la boucle ».
Dans le récit de leur quotidien, les professionnels relèvent le manque de temps pour investir des espaces de réflexivité et leurs difficultés à « se poser » pour se confronter aux situations complexes. Le manque d’espaces de discussion, de débats, au profit d’un rapport bureaucratique, formel et pratico-pratique du métier, fait défaillir la réflexivité professionnelle et de l’organisation (Herreros, 2012). Trop souvent, il s’agit d’« agir avant de réfléchir », il y a « moins de pensées qui circulent », « de bouillonnement », ce qui génère un « appauvrissement du métier ».
Une organisation du travail post-taylorienne sidérante
« L’exécutant » est un mot qui revient à plusieurs reprises durant les entretiens collectifs, afin de signifier la façon dont de plus en plus de travailleurs sociaux perçoivent leur rôle professionnel. Se trouve ainsi réactualisée l’opposition taylorienne entre l’exécution du geste professionnel et sa conception, et qu’on tend a priori à réserver au monde de l’industrie et aux employés de commerce :
L’exécutant est un mot qui revient de plus en plus souvent. On ne demande plus au salarié de réfléchir, même à des choses comme la couleur de son bureau. Tout est pensé ailleurs. Il y a un peu une scission entre ceux qui pensent et qui donnent des ordres à ceux-là pour exécuter ce qui a été pensé ailleurs. […] Ça se traduit notamment au niveau technologique : les ordres arrivent par boîte mail. Il n’y a plus vraiment de cadre intermédiaire, de chef de service, on perd tout ce qui est dans la relation, l’échange. C’est la boîte mail et puis ça tombe : des notes de service, il faut faire comme ci, comme ça.
Valérie, éducatrice spécialisée en ITEP, élue en CHSCT
La survivance d’une organisation du travail taylorienne dans le travail social y met à mal la mise en place d’une démocratie participative. Réduit au rôle d’exécutant, le travailleur social a le sentiment de ne pas (plus) être écouté et de ne pas (plus) être capable de « faire remonter » à la hiérarchie les besoins réels des personnes concernées, qui semblent de plus en plus en décalage avec les enjeux d’ordre politique et financier auxquels est soumise la direction des établissements. Le sentiment de perdre le contrôle sur le sens donné à leur métier face à un discours gestionnaire dénué d’états d’âme exerce là encore des effets de sidération, qu’évoque Valérie :
Moi j’entends beaucoup de salariés qui disent que “avant” ils étaient consultés, que les projets partaient des salariés, de ce qu’ils pouvaient dire du besoin des publics, alors que maintenant ce sont des choses “qui tombent” et qui n’ont plus aucun sens, ou qui n’ont qu’un seul sens : soit politique, soit financier. Et ça pour eux… Donc ils restent comme ça, complètement sidérés. […] Ils ont l’impression qu’ils [les dirigeants] ne peuvent pas faire pire et si, finalement, ça empire encore. Ils se disent à chaque fois “non, mais ce n’est pas possible, ils ne vont pas faire ça”, et si.
Valérie, éducatrice spécialisée en ITEP, secrétaire élue en CHSCT
Plusieurs professionnels expriment aussi le besoin de renforcer la démocratie entrepreneuriale dans leur établissement : en consolidant les collectifs de travail et le droit d’expression collective des salariés, et pas seulement les droits individuels ; en aménageant davantage d’espaces de discussions sur les conditions de travail au sein desquels ils bénéficient d’un véritable pouvoir décisionnaire et dans des instances où s’exerce effectivement le pouvoir décisionnaire. Or, la réalité semble s’éloigner d’une telle conception de la démocratie participative, inspirée des Lois Auroux (1982). La démocratie entrepreneuriale tend plutôt à se restreindre au fait d’informer les salariés et de ne les associer sur le plan décisionnaire que pour des questions de modalités (comment on fait) et non pour des questions de finalités (pourquoi on le fait). Le sujet au travail apparaît plus « managé » que « ménagé », tandis que certaines directions font fi du droit à l’expression des salariés ou le remettent en question, comme en témoigne Claire (assistante de service social, élue au CHSCT) :
il y a un service par exemple qui a utilisé le droit d’expression, ce qui n’a pas du tout plu au DG, il a trouvé que la réaction était irrespectueuse, que les gens n’avaient pas le droit alors qu’on est dans le cadre du droit d’expression. Ce qui amène encore plus de souffrance.
Un management désincarné
Une des principales contradictions organisationnelles qui traverse actuellement le travail social est que le pouvoir paraît à la fois délégué au local (à travers les lois de décentralisation et la promotion du management de proximité) et avoir un foyer qui se situe bien au-delà du « terrain » des travailleurs sociaux, dans les plus hautes sphères politique et économique. Loin de disparaître et d’être partagé par l’ensemble de la force de travail d’exécution et d’encadrement, le pouvoir décisionnaire semble surtout abstrait, invisible, lointain. Il se dépersonnalise. On n’obéit plus tant à un chef qu’à un ensemble de normes et de procédures, désincarnées.
On peut d’ailleurs souligner que les professionnels interrogés désignent rarement des personnes au sein de leur service ou établissement comme les responsables et les auteurs de ces injonctions de rentabilité, de productivité, de performance : « on » leur demande d’être plus efficace, « il faut » faire des économies… Leurs critiques et désarrois s’adressent à un ensemble de normes plus que de personnes (c’est la « loi de 2002 » qui par exemple les oblige à mettre en oeuvre un processus de démarche qualité). Aussi, leurs responsables hiérarchiques sont davantage investis les relais de ces normes plutôt que leurs auteurs . Leur question serait plutôt de savoir « qui pilote véritablement l’avion » du travail social ? On peut citer ici les échanges entre deux assistants sociaux (Sophie et Michel) :
Au niveau national, est-ce qu’il y a quelque chose qui coordonne tout ça ? Il y a des instances ? » (Sophie) ; « Je ne sais pas, c’est trop grand. De ma place je serais incapable de répondre. Même au niveau régional c’est trop grand, on a 3000 salariés on est à 50 km du siège, on ne voit pas ce qui se passe. On sent qu’on n’a pas la maîtrise sur les choses. Des fois on a un peu l’impression quand même d’être un petit pantin qui doit faire son petit truc dans son coin. » (Michel) ; « Moi j’ai souvent entendu ça par des travailleurs sociaux qui sont victimes de décisions qui sont prises dans les instances (Sophie).
De même, les fusions et regroupements de services et établissements peuvent confronter des professionnels à une nouvelle équipe dirigeante qui n’est pas issue du métier, mais qui a plutôt un parcours de formation et d’expériences professionnelles dans le management et la direction dans le secteur privé marchand. Cela peut générer un choc des cultures professionnelles : « j’ai vécu la fusion entre deux associations, c’est compliqué on ne parle pas le même langage. […] On a une direction plus cadrée, on a affaire à des gens qui ne connaissent pas le terrain » (Lesly, une éducatrice dans une association de prévention).
La logique de regroupement et de fusion des établissements fait surgir une nouvelle figure managériale : les « planeurs ». C’est par ce terme que la sociologue clinicienne Marie-Anne Dujarier désigne les managers mandatés pour améliorer la performance des entreprises et des services publics au moyen de plans abstraits, élaborés bien loin de ceux et de ce qu’ils encadrent (Dujarier, 2015). Sans être forcément des « planeurs », certains directeurs d’établissement apparaissent peu à l’écoute de leurs salariés. Ainsi, quand on leur demande ce qui est le plus contraignant dans l’exercice de leur profession, plusieurs cadres intermédiaires évoquent leur relation avec la direction, avec le sentiment de se répéter en vain, de faire remonter en vain les problèmes, de ne pas être écoutés. Par conséquent, ils courent le risque de s’épuiser, de se lasser, mais aussi de « péter les plomb » sous la forme de contestations collectives les associant au restant du personnel.
Quels leviers d’action et résistances pour les professionnels du soin et du social ?
Notre propos jusqu’à ici peut sembler assez consternant. Du point de vue des professionnels, l’exercice de leur métier est vécu sous le signe du déclin de leurs capacités d’action. À la baisse et remise en question de leur acte-pouvoir fait écho le sentiment d’être dépossédé du sens de leur travail. Pour autant, ces mêmes professionnels m’ont aussi fait part de la façon dont ils tentent de faire face à l’emprise qu’exerce la logique gestionnaire sur leurs pratiques professionnelles. C’est une « emprise de la gestion » (Pagès et al., 1979) qui déshumanise les accompagnements qu’ils mènent dans leur quotidien professionnel. Ils m’ont parlé de leurs luttes, leur engagement, mais aussi leurs stratégies de dégagement, ruses et autres bricolages pour défendre les activités qu’ils jugent au centre de leur métier, proposer un travail de qualité et développer de nouvelles pratiques professionnelles.
La persistance de l’habitus militant des travailleurs sociaux
Un des combustibles de l’action des professionnels reste la défense de ce qui est au centre de leur métier. Ils résistent, luttent et défendent avec obstination des idées qui apparaissent à contre-courant :
Ce qu’on propose, ce sont des idées nouvelles, qui ne coûtent pas forcément cher. Après il faut les porter, il faut avoir la volonté de les défendre. Et puis il faut être à ce moment-là revendicatif, car en face ils vont dire « non… ça ne sert à rien ». Bon. C’est là où on a un esprit militant.
Juliette, coordinatrice d’un pôle ressources jeunesse dans une mairie
C’est notamment avec l’appui des ressources de leur habitus militant que des professionnels s’appliquent à déconstruire l’idéologie managériale dominante dans leur métier et à lutter contre l’ère du temps, « l’ère de la gestion » (Lionel, éducateur spécialisé dans un centre d’hébergement). On peut prendre l’exemple de la rhétorique de « l’usager au centre », au coeur des réformes et textes législatifs depuis les années 2000, déconstruite par Sophie (assistante sociale) et Nicole (cadre de secteur) : « Il n’y a jamais eu autant de chartes aux usagers, partout, à l’hôpital…, on parle de l’usager. Mais pourquoi faut-il autant l’écrire ? Pourquoi il ne faut pas appeler les patients par leur prénom, pourquoi il ne faut pas les tutoyer et c’est écrit partout, dans tous les services de l’hôpital » (Sophie) ; « Ça devient un alibi. L’usager devient un alibi » (Nicole). Transparaît ici la capacité des professionnels à tenir un propos paradoxal, au sens littéral du terme (un propos qui va à l’encontre des allants de soi et du discours institué). D’autres professionnels s’attellent à une même entreprise de déconstruction de certains « mots clés » de l’idéologie dominante, en remettant en question l’usage et le sens donné aux notions de performance ou de management :
Comme dans le marketing, on parle de performance, il y a des termes comme ça qui paraissent anodins, mais on ne parle jamais de créativité, on ne parle jamais des gens qui ont le sens humain, qui pourraient inventer des projets qui ne coûteraient pas chers, mais on ne les écoute pas, ils ne font pas dans les normes, ce n’est pas noté ! La norme c’est qu’on nous demande combien de personnes sont venues, on ne nous demande pas si les personnes sont bien accueillies, on s’en fout de ça. […] Nous on se bat au niveau syndical pour dire, on va arrêter de parler de management, on va parler d’encadrement, on va parler d’autres choses, des mots qui ne sont pas standardisés et qui deviennent le fil conducteur de toute cette société.
Juliette, coordinatrice d’un pôle ressources jeunesse dans une mairie
Parmi les autres « mots-valises » de la novlangue managériale (Bihr, 2007) questionnés et déconstruits par certains professionnels, on peut ajouter celui de « polyvalence » : en exigeant de chaque professionnel qu’il soit de plus en plus polyvalent, en étant prêt « sur-le-champ » à passer d’un domaine d’intervention à un autre, ou encore d’un public à un autre, la complexité du métier et propre à chaque champ d’intervention s’en trouve refoulée, c’est-à-dire mise à l’écart. Valérie critique ainsi
cette fameuse mobilité interne argumentée comme quelque chose qui permet d’éviter l’usure professionnelle. Les mutations sont parfois imposées, avec des salariés en souffrance, de par le changement brutal. Là, en tant que CHSCT, on interpelle en disant « attention à ces salariés-là, parce qu’on leur demande un grand écart qui va susciter de la souffrance, des tensions ». Et là ce n’est pas un discours audible, parce qu’aujourd’hui l’éducateur doit être quelqu’un de polyvalent, qui doit tout faire.
Des stratégies de défense oscillant entre défection et prise de parole
Je peux me référer aux travaux d’Albert Hirschman pour entrevoir parmi les ressorts des actions individuelles et collectives des professionnels des stratégies de défense qui relèvent de la prise de parole (Voice) ou de la défection (Exit : la fuite, la démission).
Certains vont donc affirmer la nécessité de se battre contre leur propre organisation ou leur employeur : « Il faut se battre sinon ça ne vaut plus la peine d’être militant. » (Véronique, cadre socio-éducatif dans un centre hospitalier) ; « il faut se battre contre sa propre organisation » (Angélique, cadre socio-éducatif dans une Maison départementale des solidarités). En s’identifiant à des « rebelles », « contestataires », « militants » (sans se rattacher nécessairement à une cause syndicale), les professionnels n’adoptent pas une vision consensuelle du travail, mais définissent les relations professionnelles comme des rapports de force et d’alliance dans lesquels ils sont prêts à s’engager.
« Se battre » suppose notamment de s’entourer : si la lutte au quotidien des travailleurs sociaux ne prend pas la forme de mouvements sociaux, ils se battent, résistent, en s’appuyant et développant leur capital social. Il peut s’agir par exemple de contourner le procédurier et de jouer avec « les règles du jeu » en utilisant son « réseau », à l’instar de Michel (assistant social), à propos de l’établissement d’un dossier d’admission pour la reconnaissance du statut de travailleur handicapé d’une personne qu’il accompagne : « On crée nos petits réseaux à l’interne et avec la Maison départementale, j’ai sa ligne directe. Si elle veut passer un dossier, voilà. Pour les établissements, familles d’accueil, on a un petit réseau à l’interne sans appeler les services officiels. »
Pour mener à bien leur combat « militant », les professionnels peuvent faire appel à la force du collectif, composé de leurs pairs, mais aussi d’alliés qui disposent de ressources, notamment symboliques, qui leur paraissent manquantes, en cherchant par exemple l’appui de leur supérieur hiérarchique (chef de service), de leurs partenaires extérieurs ou encore d’experts et médecins.
Parmi les ressources que peuvent mobiliser les professionnels dans leur prise de parole, peut s’ajouter la force symbolique du Droit, institué sous la forme de textes de loi, circulaires, règlements… Les propos de Valérie (éducatrice spécialisée dans un ITEP, secrétaire élue au CHSCT) sont particulièrement évocateurs du rôle stratégique que peut jouer le droit institué dans le rapport de force constant dans lequel elle demeure :
Alors moi, actuellement mon point d’appui ce sont les textes de loi, c’est rappeler constamment les prérogatives des CHSCT, les textes, les réglementations, ce qu’on y fait, pourquoi, à quoi ça sert […] on arrive un peu à négocier en sortant des textes de loi sur la table et on arrive à ce qu’il lâche un petit peu sur certains trucs parce qu’au bout d’un moment ils sont un peu coincés quoi. Mais c’est continuellement le rapport de forces.
Parmi leurs marges de manoeuvre, on peut aussi évoquer leur implication dans le développement de liens partenariaux, qu’on peut entendre comme le désir de s’ouvrir sur l’extérieur, pour y trouver tant des sources d’inspiration que des appuis institutionnels. Ils peuvent aussi chercher l’appui du pouvoir médiatique, à travers l’émergence de médias alternatifs, critiques, qui médiatisent certaines réalités et problématiques (à l’instar de Mediapart).
Les groupes d’échange et d’analyse de pratiques peuvent se présenter comme des espaces d’analyse réflexive et critique, participant à une prise de recul du professionnel, à son enrichissement personnel et donnant lieu à des propositions d’action. Des professionnels marquent notamment leur intérêt pour les GAP pluridisciplinaires :
Je suis moi-même allée dans un groupe sur la pratique professionnelle, où le hasard a fait que je me retrouve avec des cadres techniques du territoire, avec 3 médecins de PMI, 7 chefs de service ; et on a travaillé sur nos pratiques par site et sur nos pratiques sur les sites. Donc, ça a été un enrichissement assez conséquent parce que ça nous a permis de prendre du recul, de voir que les questionnements de l’une étaient les questionnements de l’autre.
Angélique, cadre socio-éducatif
Le dispositif même de cette recherche collaborative a aussi été investi comme un espace d’expression, de réflexivité et d’élaboration de savoirs d’action. Une fonction similaire peut être décernée aux instances représentatives du personnel, comme les comités d’entreprise et les CHSCT. Ces derniers peuvent constituer un des rares espaces réflexifs qui permet aux membres élus du CHSCT de comprendre et de prendre du recul sur le travail et leur organisation professionnelle. Cela peut aussi les amener (notamment quand ils occupent alors la fonction de chef de service) à « [se] remettre en cause par rapport à l’organisation des équipes, les conditions de travail, etc. ». Se dessine le fait que le CHSCT constitue un collectif de travail qui permet de maintenir et restaurer les relations de travail et l’intelligence au travail : « travailler sur le travail » (Dujarier, 2020), autrement dit. Aussi constitue-t-il un espace de socialisation professionnelle, où peuvent se croiser leurs savoirs d’expérience et pratiques avec des savoirs plus académiques : « c’est riche en apprentissages », « la connaissance, j’apprends énormément en CHSCT. À chaque fois qu’une question se pose, c’est une recherche, c’est très, très formateur ». En lien avec le point précédent, l’engagement des autres membres du CHSCT peut constituer un des facteurs du maintien de leur propre engagement (« moi ce qui me permet de tenir au CHSCT c’est le militantisme des collègues »), le CHSCT étant loué dans sa capacité à générer du lien social, des sociabilités (y « faire des rencontres ») et à nourrir un sentiment d’appartenance collective (« ce sont des gens qui se rencontrent via le CHSCT, qui ont des sensibilités identiques »).
Le regret qu’éprouvent plusieurs travailleurs sociaux élus au CHSCT est que cette instance constitue un espace trop souvent délaissé par les salariés, au profit d’espaces interstitiels de résistance plus informels et donc moins institués. En effet, si les actions collectives peinent à exister, cela ne signifie pas qu’il n’existe aucune contestation de la part des salariés. Seulement, elles demeurent confidentielles et se situent dans les espaces informels que sont la machine à café ou le couloir. Paul Fustier (2012) qualifie ces espaces d’interstitiels, regroupant les espaces investis par les individus, bien que considérés a priori comme sans importance, voire négligés, comme du temps « volé au travail ». Le problème est donc que ces débats ne se déplacent pas dans des lieux et instances qui leur donneraient un caractère public et, de ce fait, un certain poids politique.
Si la mobilisation et l’augmentation de leur capital social peuvent être visées pour retrouver ou obtenir un plus grand pouvoir décisionnaire, des professionnels recourent aussi à des stratégies d’ascension professionnelle, en essayant d’obtenir des postes d’encadrement ou de direction, et ainsi re-devenir acteurs et influents. Certains l’expriment comme la volonté de changer leur monde professionnel et la société plus globalement « de l’intérieur », en occupant des postes stratégiques. Il peut s’agir de retrouver certaines marges de manoeuvre, en tant que chef de service par exemple, en visant un changement dans l’organisation du travail, le climat, le travail d’équipe.
Si des professionnels empruntent la voie syndicale et l’action individuelle ou collective contestatrice, face à la direction et à leurs financeurs, d’autres utilisent davantage la voie du compromis. Ils ne sont pas dans la contestation, mais plutôt dans le jeu, le compromis avec l’institué, incarné par le « oui, mais » de Juliette :
On peut dire non. Mais j’ai appris qu’avec la Loi, on peut dire « oui, mais ». On ne dit jamais, on ne dit jamais « non », ce n’est pas bien, mais « oui, mais » on ne peut pas nous le reprocher. « Oui je suis d’accord avec vous, mais, cependant… »
Juliette, coordinatrice d’un pôle ressources jeunesse dans une mairie
Travailleurs sociaux et cadres font donc parfois de « la gymnastique » et investissent une position « d’équilibriste ».
Disqualifiés, marginalisés, usés, résignés, à bout, des professionnels désinvestissent le ressort des prises de parole (voice) et utilisent des voies de défection (exit) qui les conduisent à changer de service, d’établissement, mais aussi parfois de métier. Ils peuvent aussi emprunter des voies temporaires de défection en recourant à l’espace des formations continues. Comme la recherche, la formation peut constituer un espace de réflexivité et de questionnement sur le sens qu’ils donnent à leur travail. Mais la formation peut aussi être investie comme une sorte de « parenthèse », qui permet de « souffler », de se refaire une santé psychique avant de retourner « se battre » sur le ring de son service ou établissement. Enfin, la formation continue constitue aussi un moyen d’augmenter ses ressources (relationnelles, cognitives et réflexives), et donc ses capacités d’action. Il s’agit d’être mieux préparé et mieux armé pour se confronter aux différents enjeux du métier.
Conclusion
Si des travailleurs sociaux s’efforcent de « nager à contre-courant », luttant contre l’emprise grandissante de l’idéologie managériale dans le secteur, l’usure liée à leurs résistances et au sentiment de ne pas (plus) avoir sa place dans un métier devenu incompréhensible peut anéantir leur désir de travail (Arnaud, 2013) et les anéantir, jusqu’à générer une certaine morbidité (des désirs de destruction et d’autodestruction). À l’inverse, les salariés qui optent pour un rapport utilitariste au travail et qui réduisent leur investissement (libidinal) dans l’objet « travail », tout en adhérant ou en simulant leur adhésion vis-à-vis des réformes en cours, peuvent sembler davantage réchapper à ces effets de sidération (si leur double jeu/je ne génère pas un clivage du moi…). C’est du moins la conclusion que je peux en tirer, en reprenant de nouveau les propos de Valérie :
Moi je dirais que les anciens sont ceux qui souffrent le plus. On sent qu’ils sont en burn-out, à saturation. Ce sont ceux qui ont une autre culture, une formation sur une autre base, qui sont dans une incompréhension et aujourd’hui qui disent « moi j’arrête le social », parce que je ne m’y retrouve plus. Et qui recherchent même d’autres secteurs parce qu’ils ne veulent plus travailler là-dedans. Et après, on a un autre type de salariés que moi je trouve plus jeunes, qui vont trouver un peu leur compte, prendre beaucoup de recul, ne pas s’investir parce que c’est trop dangereux, une espèce d’automatisme, « je fais mes heures et puis je repars », pas forcément de motivation, une espèce de ronronnement. Que moi j’identifie comme étant peut-être une protection, « puisque si je veux continuer dans ce truc-là, il faut bien que je m’adapte ». Moi je vois deux choses : ceux qui vont aller au front en disant « je ne suis pas d’accord, je ne suis pas d’accord », mais par contre ils vont droit dans le mur, en souffrir et ça termine mal. Et ceux qui vont encaisser sans forcément adhérer.
Voici à nouveau les stratégies de défense que sont la prise de parole, la défection et la loyauté, dont on peut se demander si les deux dernières vont finir par éliminer les prises de parole qui peinent à résister. Ce qui m’amène à formuler une question qui me préoccupe au plus haut point en tant que chercheur, à l’issue d’une dizaine d’années de travaux menés dans les métiers de la relation, mais aussi en tant que parent et citoyen : jusqu’à quand ? Jusqu’à quand les professionnels du social et du soin, de première et seconde ligne, vont tenir (Gaspar, 2012) ?
Appendices
Notes
-
[1]
Recherche collaborative menée dans le cadre du programme « chercheurs-citoyens », sous la responsabilité de C. Niewiadomski et avec pour laboratoire d’adossement le CIREL. Elle a pour intitulé « Travail, santé et précarité. Interroger l’expérience des usagers et les conditions contemporaines d’exercice des métiers du soin et du travail social en région Nord–Pas-de-Calais ».
-
[2]
Il est à préciser que dans cette recherche, comme dans la majorité des recherches en sciences sociales menées en France, aucun numéro de certificat n’est exigé et décerné par l’institution dans le cadre de l’approbation éthique de la recherche comme ce serait le cas au Canada.
-
[3]
Si quelques articles sont consacrés à cette instance représentative du personnel en France, étudiant leur rôle et leur impact sur la santé des salariés, leur bien-être ou encore la prévention des risques professionnels (Coutrot, 2009 ; Litim et Castejon, 2010 ; Pietri, 2010 ; Litim, Zittoun et Briec, 2012 ; Bouville, 2016 ; Verkindt, 2016), les données collectées ne concernent pas des élus CHST d’établissement sociaux.
Bibliographie
- Arnaud, G. (2013). Qu’est-ce que le désir de travail ? RIMEFI. Research in Management Economics and Finance. 1, 15-19.
- Bellot C., Bresson M. et Jetté C. (dir.) (2013). Le travail social et la nouvelle gestion publique. Québec : Presses de l’Université du Québec.
- Bercal, B. et Herbaut, V. (2018). Paroles d’intervenants à domicile dans l’ex-bassin minier du Pas-de-Calais : une mutation identitaire. Le sociographe. 63(3), 119-130.
- Bertrand, D. (2018). Une éducatrice spécialisée à l’épreuve de la précarisation subjective. Le sociographe. 64, 45-58.
- Billaud, S. et Xing, J. (2016). « On n’est pas si mauvaises ! » Les arrangements des aides soignantes en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) face aux épreuves de professionnalité. SociologieS [En ligne] http://journals.openedition.org/sociologies/5372; https://doi.org/10.4000/sociologies.5372
- Bihr (2007). La novlangue managériale. La rhétorique du fétichisme capitaliste. Lausanne : Page deux.
- Bourdieu, P. (1997). Méditations pascaliennes. Paris, Seuil.
- Bouville, G. (2016). L’influence des CHSCT sur le bien-être des salariés et sur les accidents du travail. Une étude exploratoire. Revue de gestion des ressources humaines, 101(3), 25-43.
- Chauvière, M. (2008). Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation. Paris : La Découverte.
- Cifali M. et Périlleux T. (dir.) (2012). Les métiers de la relation malmenés. Répliques cliniques. Paris : L’Harmattan.
- Cingolani, P. (2014). Révolutions précaires. Essai sur l’avenir de l’émancipation. Paris : La Découverte.
- Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir. Paris : PUF.
- Coutrot, T. (2009). Le rôle des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en France: Une analyse empirique. Travail et emploi, 117(1), 25-38.
- de Gaulejac, V. (2002). Identité. Dans J. Barus-Michel, E. Enriquez et A. Lévy (dir.). Vocabulaire de psychosociologie (p. 174-180). Toulouse : Erès.
- de Gaulejac V. (2005). La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social. Paris : Seuil.
- de Gaulejac V. (2011). Travail, les raisons de la colère. Paris : Seuil.
- de Gaulejac, V., Giust-Desprairies, F. et Massa, A. (dir.). (2013). La recherche clinique en sciences sociales. Toulouse : Erès.
- Doucet M-C. et Viviers S. (dir.) (2016). Métiers de la relation, nouvelles logiques et nouvelles épreuves du travail. Presses universitaires : Laval.
- Dubois, J., Durand, P. et Winkin, Y. (2013). Aspects du symbolique dans la sociologie de Pierre Bourdieu, COnTEXTES, Revue de sociologie de la littérature. http://journals.openedition.org/contextes/5661
- Dujarier, M-A. (2015). Le management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail. Paris : La Découverte.
- Dujarier, M-A. (dir.) (2020). Travailler sur le travail. Paris : L’Harmattan.
- Feynie, M. (2012). Le «as if» management. Regard sur le mal-être au travail. Le Bord de l’eau.
- Fugier, P. (2010). Les approches compréhensives et cliniques des entretiens sociologiques. ¿Interrogations?, 11, 98-107. http://www.revue-interrogations.org/Les-approches-comprehensives-et
- Fugier, P. (2016). Accueillir les besoins et désirs singuliers de l’autre. La posture à contre-courant des auxiliaires de vie sociale et aides-soignantes à domicile. Le sujet dans la cité, 7(2), 151-162.
- Fustier, P. (2012). L’interstitiel et la fabrique de l’équipe. Nouvelle revue de psychosociologie, 14(2), 85-96.
- Gaspar, J.-F. (2012). Tenir ! Les raisons d’être des travailleurs sociaux. Paris : La Découverte.
- Giust-Desprairies, F. (2008). Significations sociales et enjeux culturels d’une parole adressée en groupe. Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 50(1), 19-31.
- Hanique F. (2012). De la sociologie compréhensive à la sociologie clinique. Dans V. de Gaulejac, F. Hanique et P. Roche (dir.), La sociologie clinique. Enjeux théoriques et méthodologiques (p. 105-130). Toulouse : Erès, 2007.
- Heidegger, M. (2014). Essais et conférences (traduit par André Péreau). Paris : Gallimard (publication originale en 1958).
- Herreros, G. (2012). La violence ordinaire dans les organisations. Plaidoyer pour des organisations réflexives. Toulouse : Erès.
- Hirschman, A. (2011). Exit, voice, loyalty. Défection et prise de parole. Bruxelles : Éditions de l›Université de Bruxelles.
- Les chercheurs ignorants. (dir.). (2015). Les recherches-actions collaboratives. Une révolution de la connaissance. Rennes : Presses de l’EHESP.
- Lhuilier, D. et Roche, P. (dir.). (2009). La résistance créatrice. Nouvelle revue de psychosociologie, 7.
- Litim, M. et Castejon, C. (2010). Protéger la santé des travailleurs : pour que la mission du chsct ne devienne pas impossible. Nouvelle revue de psychosociologie, 10(2), 139-150.
- Litim, M., Zittoun, M. et Briec, C. (2012). L’intervention au-delà de l’expertise CHSCT : entre action et instrument d’action. Bulletin de psychologie, 519(3), 227-237.
- Marchal, J. (2018). Question sociale et précariat. Histoire et contextualisation d’un processus de précarisation. Le sociographe, 64(4), 11-22.
- Martuccelli, D. (2015). Les deux voies de la notion d’épreuve en sociologie. Sociologie, 6, 43-60.
- Mendel, G. (1998). L’Acte est une aventure. Du sujet métaphysique au sujet de l’actepouvoir. Paris : La Découverte.
- Molina, Y. (2014). Nouvelle gestion publique et recomposition professionnelle dans le secteur social. Pensée plurielle, 36(2), 55-66.
- Niewiadomski, C., Brassart, J. et Autès, M. (2015). Funestes destins collectifs ? La « grande claque » des années 80 dans le Nord-Pas-de-Calais. Le sujet dans la Cité - Revue internationale de recherche biographique, 4(1), 151-163.
- Pagès, M., Bonetti, M., Gaulejac V. de et Descendre, D. (2009). L’emprise de l’organisation. Paris : PUF (version originale en 1979).
- Périlleux, T. (2005). Être à l’épreuve dans le travail. Dans M. de Nanteuil-Miribel et al. (dir.). La société flexible (p. 111-136). Toulouse : Erès.
- Ravon, B. (2009). Repenser l’usure professionnelle des travailleurs sociaux. Informations sociales. 152, 60-68.
- Ravon, B. et Vidal-Naquet, P. (2016). L’épreuve de professionnalité : de la dynamique d’usure à la dynamique réflexive. SociologieS. http://journals.openedition.org/sociologies/5363
- Ravon, B. et Vidal-Naquet, P. (2018). Les épreuves de professionnalité, entre auto-mandat et délibération collective. L’exemple du travail social. Rhizome. 67, 74-81.