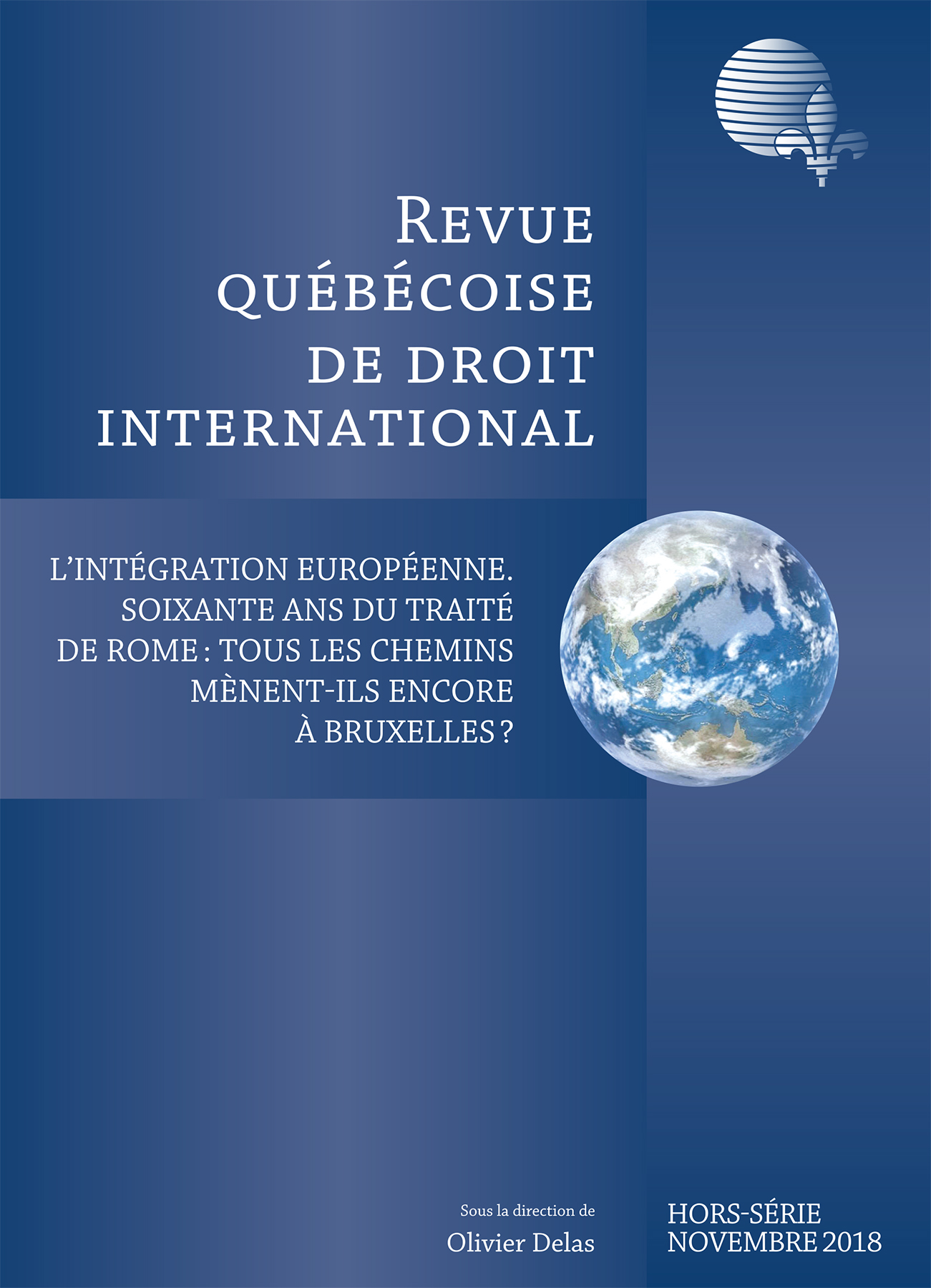Abstracts
Résumé
Au commencement de la construction européenne, le droit des communautés européennes apparaissait largement anthropocentré. La protection de l’environnement ne figurait en effet pas dans les traités qui étaient essentiellement tournés vers l’objectif d’assurer les libertés de circulation et, au-delà, de la réalisation d’un marché intérieur. Depuis, face à l’anthropocène, les fondements éthiques du législateur de l’Union européenne ont évolué en ce qu’il retranscrit, aujourd’hui, en droit, des considérations propres à une éthique pathocentrée, en protégeant le « bien-être animal », voire écocentrée en luttant contre la disparition des espèces et de leurs habitats menacés. Force est toutefois de constater que, tant les règlementations européennes que la jurisprudence qui en est issue, continuent à largement sacrifier les intérêts des entités naturelles au profit des intérêts humains lorsque, immanquablement, se produisent des conflits d’intérêts. Le droit de l’Union européenne est ainsi encore très éloigné des avancées réalisées dans de nombreuses régions du monde, notamment dans certains États d’Amérique latine, dans lesquelles une refondation écocentrée du droit de l’environnement semble être en cours de réalisation. La nature n’y est en effet plus considérée comme un objet de droit, mais a été érigée, quelquefois dans des textes de valeur constitutionnelle, en sujet de droit.
Abstract
At the start of the European construction, the law of the European communities appeared largely anthropocentric. Indeed, environmental protection didn’t appear in treaties, which were essentially directed towards the objective of ensuring freedom of movement and, beyond that, the construction of a domestic market. Since then, faced with the Anthropocene, the ethical foundations of the European Union legislator have evolved inasmuch as they transcribe in law the considerations related to a pathocentric ethos, by protecting “animal welfare,” or even an ecocentric one, through fighting against the disappearance of endangered species and of their habitats. However, it must be said that both European regulations and case law emanating from them continue to sacrifice the interests of natural entities in favor of the human interests in cases where, inevitably, conflicts of interests arise. European Union law is therefore still very far from the progress that can be witnessed in numerous regions of the world, namely within certain states in Latin America, in which an ecocentric rebuilding of environmental law appears to be underway. Indeed, under such reforms, nature isn’t considered as an object of law, but rather has been erected, even at times in texts of a constitutional value, as a subject of law.
Resumen
A principios de la construcción europea, el derecho de las comunidades europeas ampliamente parecía antropocéntrico. En efecto, la protección medioambiental no figuraba en los tratados que fueron esencialmente orientados hacia el objetivo de asegurar las libertades de circulación y, más allá, de la realización de un mercado nacional. Después, frente al antropoceno, los fundamentos éticos del legislador de la Unión Europea evolucionaron en lo que retranscribe, hoy, en derecho, consideraciones limpias de una ética patocéntrica, protegiendo el “bienestar animal”, incluso ecocéntrica, luchando contra la desaparición de las especies y de sus hábitats amenazados. Comprobamos que, tanto las reglamentaciones europeas como la jurisprudencia que se deriva de ellas continúan sacrificando ampliamente los intereses de las entidades naturales en provecho de los intereses humanos cuando, inevitablemente, se producen conflictos de intereses. El derecho de la Unión Europea está muy alejado de los avances realizados en numerosas regiones del mundo, particularmente en ciertos Estados de América latina, en las cuales una refundación ecocéntrica del derecho del medio ambiente parece estar realizándose. En efecto, la naturaleza ya no está más considerada como un objeto de derecho, sino que ha sido erigida, en ciertos textos de valor constitucional, en sujeto de derecho.
Article body
À l’origine de la construction européenne, le Traité de Rome ne contenait aucune disposition expresse relative à la protection de l’environnement. Ce n’est que pour assurer le bon fonctionnement du marché commun que la Communauté s’est initialement emparée de cette question. Depuis, une politique spécifique pour l’environnement a été instituée par les traités (articles 191 à 193 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)) et plus de 250 directives sur l’eau, l’air, le bruit, les déchets, les substances dangereuses ou la biodiversité ont été adoptées.
Toutefois, face à ce que l’on appelle dorénavant l’anthropocène, à savoir la période géologique actuelle qui se caractérise par la prédominance des activités humaines, l’efficience du droit européen de l’environnement est largement contestée.
Il est, d’une part, reproché au droit européen de l’environnement d’être tout entier fondé sur le paradigme cartésien de la modernité. Ce dernier implique que l’homme doit dominer une nature à laquelle il n’appartient pas, doit la maîtriser, s’en extirper à l’aide de la connaissance et de la technique. Cet humanisme des Lumières débouche, en droit, sur un humanisme juridique selon lequel on ne peut reconnaître de dignité qu’à l’être humain[1]. Il implique par conséquent de strictement séparer, comme le fait la structure cartésienne du droit moderne, les objets de droit, parmi lesquels les êtres naturels, et les sujets de droit. Il est, d’autre part, souvent souligné que cette conception instrumentale de la nature conduit à raisonner en termes exclusivement économiques. Or, suivant cette logique, la protection de l’environnement étant, par définition, uniquement assurée dans le souci des intérêts de l’humanité, elle n’est qu’une forme d’usage, élaborée et prudente, de la nature. Cet esprit utilitaire ne pourrait dès lors que favoriser le développement technologique et industriel en conduisant les pouvoirs publics à poursuivre une stratégie de compromis avec les acteurs économiques, comme l’illustre la logique du principe de développement durable, et, par suite, qu’échouer à assurer la conservation des ressources et la limitation de la croissance.
Le développement unilatéral de la pensée moderne a été remis en question, aux États-Unis, dès le 19e siècle, notamment à travers les travaux d’Henry David Thoreau ou encore d’Élisée Reclus. Surtout, il se heurte, depuis les années 1970, au renouveau d’une philosophie naturaliste protéiforme qui propose de reconsidérer la manière dont la nature a été instrumentalisée. Au-delà de leurs nombreuses oppositions, ses partisans se fondent sur une éthique écocentrée, à savoir une éthique qui, d’une part, affirme la valeur intrinsèque de l’ensemble des entités naturelles et qui, d’autre part, se focalise sur l’interconnexion et l’équilibre des formes de vie au sein d’un tout complexe et harmonieux. Dans ce cadre, l’intervention humaine est possible si tant est qu’elle reste raisonnée : l’être humain appartenant à la nature au même titre que les autres espèces, il peut y laisser son empreinte pourvu qu’elle ne nuise pas à l’équilibre de son écosystème donc, en définitive, à lui-même. Ce faisant, l’homme agit en effet dans son propre intérêt en ce que son épanouissement dépend de l’épanouissement du tout dont il est une partie constitutive et auquel il doit s’identifier[2].
Dans une perspective plus juridique, Michel Serres invite l’homme à passer un contrat avec la nature en ce qu’elle « se conduit comme un sujet[3] ». De même, Klaus Meyer Abich estime que les États, qui ne sont pas seulement des États sociaux, mais aussi des États naturels (Naturstaat), doivent consacrer, dans leur constitution, l’existence d’une « communauté juridique naturelle » (natürliche Rechtsgemeinschaft) et par-là même reconnaître des droits à chacun de ses membres[4].
Ne plus considérer la nature comme un objet de protection, mais comme une personne juridique s’oppose à la tradition de l’humanisme juridique occidental. Les penseurs naturalistes estiment toutefois que la plus-value d’une telle révolution juridique serait seule susceptible de permettre une protection adéquate de la nature en s’écartant de la logique anthropocentrée du droit positif[5]. C’est dans cette perspective que la communauté morale s’est peu à peu élargie à d’autres êtres naturels que les seuls êtres humains.
Le renouvellement du questionnement éthique et métaphysique sur le statut des entités naturelles s’est d’abord produit au bénéfice des animaux en raison de leur proximité avérée avec l’homme. Leur statut juridique a ainsi été progressivement redessiné pour les appréhender comme des « êtres sensibles » et protéger leur « bien-être ». Le droit de l’Union européenne a notamment modifié ses législations relatives à l’agriculture ou encore à l’expérimentation animale pour éviter toute souffrance inutile aux animaux. Bien au-delà, certains États (la Nouvelle-Zélande, l’Inde, l’Équateur, la Bolivie, certaines collectivités locales américaines) ont révolutionné les fondements éthiques et philosophiques du droit de l’environnement en affirmant des droits au profit de la nature. Pour l’instant, le droit de l’Union européenne semble avoir été peu affecté par cette véritable révolution juridique, mais les défis écologiques auxquels l’Union est confrontée ont toutefois déjà entrainé quelques changements notables. Il demeure ainsi, malgré une évolution pathocentrée (II), très largement fondé sur une tradition anthropocentrée (I). La révolution écocentrée du droit de l’environnement, malgré quelques timides références symboliques présentes dans de rares textes de droit dérivé, ne semble ainsi pas être en oeuvre dans l’Union européenne (III).
I. Une tradition anthropocentrée
L’anthropocentrisme moral est la posture éthique la plus répandue. D’un point de vue éthique, la tradition anthropocentrée implique de ne considérer moralement que les seuls êtres humains parce qu’ils sont à jamais hors de l’Univers naturel (A). D’un point de vue juridique, elle conduit l’homme à assimiler les entités naturelles à de simples objets de propriété (B).
A. L’argument anthropocentré : « l’homme est la mesure de toutes choses[6] »
La particularité de l’argument anthropocentré réside dans le fait que seuls les humains peuvent se voir reconnaître le statut de patient moral pour trois raisons principales.
Une première raison renvoie à la culture chrétienne latine qui dissocie la nature et l’homme parce que seul ce dernier a été créé à l’image d’un Dieu – lui-même transcendant au monde – qui lui assigne, pour cette raison, d’en devenir le maître[7]. Cette conception est, du reste, plus proche d’un théocentrisme[8] que d’un anthropocentrisme moral.
Une deuxième raison mobilise des critères phylogénétiques comme l’appartenance à l’espèce Homo sapiens. C’est la théorie spéciste qui se traduit par une considération morale supérieure accordée par l’homme à sa propre espèce et qui justifie le traitement discriminatoire réservé aux autres entités naturelles.
Une troisième raison mobilise des critères d’ordre cognitif et principalement la raison qui, selon la fameuse théorie de Descartes sur l’animal-machine[9], constitue le propre de l’homme. Le propre de l’homme a également pu être recherché, y compris par des philosophes contemporains, à travers une multiplicité d’autres critères de différentes natures tels que la conscience de soi, le langage, la culture, la morale, etc.[10] Quels qu’en soient les critères, la distanciation qu’ils opèrent entre l’homme et la nature est essentielle en ce qu’elle justifie, conformément à la philosophie kantienne[11], que seul l’homme est capable d’évaluer[12] et, par conséquent, que « seuls les sujets humains, qui confèrent des valeurs, et indiquent la fin autour de laquelle le monde peut s’organiser, sont eux-mêmes des valeurs[13] ». Kant ne reconnait en effet de valeur intrinsèque qu’aux êtres humains parce qu’ils sont les seuls, dans la nature, à être des fins en soi[14].
Cette argumentation est contestée par les tenants d’une éthique non anthropocentrée pour trois séries de raisons.
En premier lieu, le critère moral de l’appartenance à l’espèce, le spécisme, est souvent associé au racisme ou au sexisme : « considérer un être parce qu’il est un membre de l’espèce humaine est tout aussi arbitraire que de le considérer sur la base de ses organes génitaux ou de sa couleur de peau[15] ». La pertinence de la référence à l’espèce humaine est en outre remise en cause par des tenants de l’anthropocentrisme moral qui, dans leurs travaux, prennent pour référence la sous-famille des homininés, la famille des hominidés ou la super famille des hominoïdés.
En second lieu, le recours à des critères d’ordre cognitif semble, selon la formule du philosophe Dale Jamieson, « exiger trop et ne pas exiger assez[16] ». Cette objection soulève la question des cas limites. D’une part, certains humains n’ont ni la raison ni la conscience d’eux-mêmes à l’instar d’un bébé ou d’un adulte souffrant d’un grave handicap mental ou comateux[17]. D’autre part, les grands singes anthropoïdes, voire d’autres mammifères comme l’éléphant ou le dauphin, sont conscients d’eux-mêmes[18]. Plus globalement, de plus en plus d’études d’éthologie et de biologie évolutionniste démontrent que les compétences cognitives des animaux sont bien plus étendues qu’on ne le soupçonnait encore récemment[19].
En dernier lieu, plusieurs philosophes contemporains ont appliqué le schéma kantien à des entités naturelles non humaines[20]. Ils affirment ainsi que, au-delà des êtres humains, les animaux, les plantes, les autres organismes, voire toute la nature, manifestent une sorte de finalité, a minima immanente, et revêtent ainsi une valeur intrinsèque. Ils abandonnent pour ce faire, notamment en se fondant sur la question des cas limites développée par Dale Jamieson, l’adéquation que Kant établissait entre moralité et humanité à partir d’un principe de réciprocité selon lequel il faut pouvoir reconnaître les autres comme des fins en soi pour mériter le respect dû à la dignité de la personne morale[21].
Au-delà de la pertinence de l’argument de l’anthropocentrisme moral, la question de savoir si cette posture morale peut suffire à établir, alors même qu’elle ne vise que la satisfaction des besoins humains, des obligations morales puis juridiques efficientes de protection de la nature est prégnante. A priori, puisque seuls les êtres humains sont revêtus d’une valeur intrinsèque, l’anthropocentrisme moral ne peut aboutir à l’élaboration de règlementations octroyant à la nature une protection adéquate. Et, en effet, conformément à l’argument de l’anthropocentrisme moral, le droit assimile les entités naturelles à des choses, à des objets de propriété, qui peuvent être utilisées à loisir ou aliénées.
Pour autant, l’anthropocentrisme moral n’exclut pas que l’homme décide, pour son propre épanouissement, de protéger la biodiversité. Suivant les différents courants de l’anthropocentrisme moral, les justifications peuvent être diverses[22]. L’expérience esthétique de la nature, d’une part, qui amène à protéger les beautés de la nature parce que l’homme y trouve un intérêt moral[23]. La nécessité, d’autre part, pour l’homme de vivre dans un environnement sain auquel la biodiversité contribue[24]. L’intérêt, enfin, que l’homme peut porter à la nature en tant qu’elle évoque l’humain, par exemple, la souffrance animale qui renverrait l’homme à l’idée de liberté[25].
De nombreux philosophes, opposés à la posture de l’anthropocentrisme moral, ont souligné la faiblesse de ces arguments. Elle réside, selon eux, dans la reconnaissance par l’homme, dans le cadre d’une éthique anthropocentrée, d’une simple valeur relationnelle à la nature : elle n’est qu’un moyen pour réaliser une fin (valeur instrumentale, d’usage ou de non-usage) ou ne dispose que de la valeur que l’homme lui accorde en vertu de propriétés qu’il projette sur elle (valeur inhérente qui peut être affective, esthétique ou morale). Ainsi, d’une part, les entités naturelles peuvent perdre toute valeur dès l’instant où elles ne remplissent plus leur rôle d’instrument et/ou la fonction qui intéressait l’homme, ou lorsque ce dernier conteste la valeur qu’il leur avait accordée[26]. De tels fondements semblent, dès lors, bien insuffisants pour bâtir une véritable philosophie de l’environnement, « une éthique de l’environnement[27] ». D’autre part, la prise en considération du seul point de vue humain dans la définition du « bon usage[28] » que l’homme doit faire de la nature ne peut consécutivement aboutir qu’à systématiquement sacrifier les intérêts des entités naturelles au profit des intérêts humains. Ce constat est au fondement de la fameuse distinction, opérée par Arne Naess, entre la shallow ecology, qui renvoie à une conception gestionnaire de la nature et la deep ecology. Ce mouvement affirme la valeur intrinsèque de la nature, à savoir une valeur indépendante d’une autre fin ou d’une fin motivée par les intérêts humains[29], parce qu’elle manifeste une finalité immanente[30]. Or, selon une majorité de ses courants, le concept de valeur intrinsèque est indispensable à une éthique de la nature digne de ce nom[31] et le seul à même de justifier une refondation du droit de l’environnement[32].
B. Les implications juridiques : le droit du développement durable
Au commencement des communautés, l’objectif fondamental était d’assurer la libre circulation des marchandises, des travailleurs, des services et des capitaux. Aussi la protection de l’environnement ne figurait-elle pas parmi les objectifs des traités. Il est toutefois rapidement apparu que les législations environnementales nationales, souvent divergentes, pouvaient entraver la libre circulation des marchandises. En effet, si l’article 36 TFUE ne prévoit pas comme justification possible d’une entrave à la libre circulation des marchandises « la protection de l’environnement », la Cour de justice a considéré, dans son arrêt Bouteilles danoises[33] que la protection de l’environnement faisait partie des exigences essentielles susceptibles de justifier de telles entraves. Elle exige toutefois que les mesures nationales concernées soient non discriminatoires et soient proportionnées, c’est-à-dire n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif.
Les premiers textes de droit communautaire de l’environnement, adoptés dans les années 1960 et 1970, ont par conséquent cherché à harmoniser les diverses normes nationales en y substituant une norme environnementale commune[34]. La Communauté a ensuite élargi son champ d’action et agi, depuis trente-cinq ans, pour la protection de l’environnement lorsqu’elle considère qu’une action transnationale sera plus efficace que des actions isolées de ses États membres. Actuellement, le droit de l’environnement de l’Union européenne forme un ensemble hétérogène de plus de deux cents actes dont la principale faiblesse est leur mauvaise application dans les États membres[35].
Au-delà des textes de droit dérivé, le Traité sur l’Union européenne (TUE) ne mentionne pas directement la protection de l’environnement. L’article 3 TUE dispose en effet que l’Union se donne notamment pour objectif d’oeuvrer « pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social ». Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait en revanche référence à la promotion d’un « niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement » et consacre son Titre XX (art. 191 à 193 TFUE) à l’environnement.
La Charte des droits fondamentaux, proclamée à Nice en décembre 2000 et dotée d’une valeur juridique par le Traité de Lisbonne, révèle, quant à elle, une conception anthropocentrée et utilitariste de la nature[36]. Selon l’expression de Guy Braibant, l’environnement y apparait comme l’un de ses « parents pauvres ». Il explique en effet qu’il a été décidé, lors des travaux relatifs à son élaboration, que, si la Charte devait contenir un article sur l’environnement, ce dernier serait aussi vague et peu contraignant que possible et ne prendrait la forme que d’un énoncé d’objectifs et non de droits à proprement parler[37]. Cette feuille de route semble avoir été respectée puisque l’article 37 de la Charte indique qu’« un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable ». Il ressort également des travaux d’élaboration de la Charte qu’elle vise prioritairement à protéger l’environnement pour l’homme, ce qui renvoie essentiellement au droit à la protection de la santé de l’homme contre les atteintes à l’environnement. Ce n’est, conformément à cette visée, que dans certains cas, extrêmement réduits et limités, que le droit de l’Union européenne étend sa protection aux écosystèmes ou à la diversité biologique[38].
L’ensemble de ces dispositions de droit originaire n’évoquent la nature que tournée vers l’homme, utile à l’homme, et ne prenant du sens qu’en relation avec lui. Le principe de développement durable, plusieurs fois réaffirmé, illustre parfaitement, pour les partisans d’une meilleure protection des entités naturelles, cet État de fait. Ce principe a été consacré, en juin 1972, lors la Conférence de Stockholm qui, dans sa Déclaration, insiste sur les liens entre environnement et développement. En juin 1992, la Conférence de Rio va faire de ce principe le centre de la Déclaration et de l’Agenda 21, à tel point qu’il sera ensuite repris par nombre de conventions internationales et de législations nationales. Il consiste à affirmer que le développement économique doit être respectueux de la « santé et de l’intégrité de l’écosystème terrestre » tant pour des considérations environnementales que pour permettre un « progrès économique à long terme ». Nombre d’auteurs y voient, en pratique, le triomphe des intérêts économiques qui sont et seront toujours plus puissants que les exigences environnementales parce qu’ils sont beaucoup mieux ancrés, liés à des intérêts immédiats très bien représentés, et sont soutenus par des acteurs financiers, économiques et politiques puissants.
Si c’est le développement et non l’environnement qu’il s’agit de rendre durable, on a affaire à une mystification. Si durable veut dire préserver l’environnement, alors c’est incompatible avec la logique économique […]. Le « développementisme » manifeste la logique techno-économique dans toute sa rigueur. Il n’y a pas de place dans ce « paradigme » pour le respect de la nature réclamé par les écologistes […]. Le développement durable est comme l’enfer, il est pavé de bonnes intentions. Les exemples de compatibilité entre développement et environnement qui lui donnent créance ne manquent pas. Il ne faut pas se leurrer pour autant. Ce n’est pas l’environnement qu’il s’agit de préserver, mais avant tout le développement. Là réside le piège[39].
Face aux insuffisances du droit de l’environnement, c’est le statut des animaux qui a fait l’objet des plus nombreuses critiques. Initialement exclusivement fondées sur une conception anthropocentrée de la nature qui, dans sa traduction juridique, était sacrificielle de leurs intérêts, les références éthiques du législateur de l’Union ont progressivement évolué pour insérer les animaux dans la communauté morale et protéger leur « bien-être ».
II. Une évolution pathocentrée
Dès l’antiquité, les hommes se sont interrogés sur le statut moral de l’animal par le biais de sa nature raisonnable, de la sympathie qu’il inspire à l’homme ou encore de sa sensibilité. La prise en compte de ce dernier critère a été déterminante dans l’éclosion, au début des années soixante-dix, d’une éthique pathocentrée qui inclut, pour cette raison, l’animal au sein de la communauté morale (A) et implique de protéger juridiquement son « bien-être » (B).
A. L’argument pathocentré : « La question n’est pas : "Peuvent-ils raisonner ?" ni "Peuvent-ils parler ?", mais "Peuvent-ils souffrir ?"[40] »
La racine grecque pathos du mot « pathocentrisme » signifie l’affection, donc ce que l’on éprouve comme bien ou mal et qui affecte le corps ou l’âme. Le pathocentrisme est ainsi la posture morale qui fait dépendre la considération morale d’un être naturel d’une forme de sensibilité manifestée par la souffrance ou la non-souffrance. Et, si la souffrance est le critère moral décisif, tous les êtres susceptibles d’éprouver de la douleur sont des patients moraux. Ils sont ainsi valorisés pour eux-mêmes, de manière intrinsèque, ce qui s’oppose à la valeur instrumentale reconnue aux animaux dans le cadre de la posture anthropocentrée[41].
Le pathocentrisme repose sur la doctrine utilitariste que Jeremy Bentham avait, dès le 18e siècle, appliquée aux animaux. Elle analyse la vertu des actions et fonde les devoirs sur le calcul des biens qui en résultent. Et, les animaux, parce qu’ils sont susceptibles de ressentir le plaisir et la douleur, doivent tout naturellement être pris en compte dans l’établissement des droits et des devoirs[42]. On retrouve cette approche tout au long du 20e siècle jusque chez Peter Singer, l’un des plus célèbres défenseurs de la cause animale[43], et l’on constate que les plus grandes avancées dans la protection des animaux sont assurément dues aux différentes doctrines utilitaristes.
L’immense critique soulevée à l’encontre de l’argument pathocentriste vise à mettre en exergue qu’il demeure, en définitive, largement anthropocentré. Le postulat du pathocentrisme, selon lequel la sensibilité est un critère moralement pertinent, relève davantage de l’anthropomorphisme que de l’analyse rationnelle. D’une part, les sciences naturelles attestent que la douleur est un moyen pour certains organismes de s’adapter à leur environnement en vue d’atteindre leurs fins propres : elle doit par conséquent être interprétée comme une information, un signal, qui a permis à des êtres vivants de préserver leur intégrité biologique[44]. Chercher à la réduire n’a dès lors aucun sens du point de vue écologique[45]. D’autre part, l’argument pathocentré est largement anthropomorphique : « si les hommes privilégient moralement la sensibilité, c’est parce qu’il s’agit du point de vue à partir duquel ils sont d’ordinaire en contact avec le monde[46] ».
Plus avant, le pathocentrisme n’est pas sans lien avec l’anthropocentrisme moral parce qu’être doué de sensibilité implique de disposer de compétences cognitives (avoir des croyances, des désirs, un sens du futur…) ou de « capabilités » (viser la santé, rechercher la vie sociale, éprouver des émotions). Or, selon Peter Singer, s’il faut considérer de manière égale la souffrance, au regard des différences entre les espèces quant à ces caractéristiques, la qualité de la souffrance diffère et, par conséquent, certaines vies valent plus d’être vécues que d’autres[47]. Cette éthique peut dès lors conduire à préconiser des décisions hautement sacrificielles des intérêts de quelques-uns — notamment de ceux dont la vie est la moins riche en émotion, donc des animaux — pour le plus grand bien des autres — notamment ceux dont la vie est la plus riche en émotion, donc les humains[48].
B. Les implications juridiques : la protection du « bien-être » animal
Sur le fondement de l’argument pathocentré, un nombre croissant de règlementations nationales et d’actes internationaux a été adopté pour sanctionner les actes de cruauté et promouvoir le « bien-être » des animaux. Ainsi, dans le cadre de l’Union européenne, certaines pratiques, telles que l’expérimentation, le transport des animaux ou leurs conditions de mise à mort, sont dorénavant encadrées pour limiter la souffrance animale.
Le concept de « bien-être animal » est apparu, en droit communautaire, via la soft-law du Conseil de l’Europe avant de se développer dans des actes de hard-law. Dans la recommandation 287 relative aux transports internationaux d’animaux, adoptée le 22 septembre 1961 par l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe, il est ainsi affirmé « que le traitement humain des animaux constitue l’une des caractéristiques de la civilisation occidentale, mais que, même dans les États membres du Conseil de l’Europe, les normes nécessaires ne sont pas toujours observées ». L’Assemblée y a par conséquent recommandé au Comité des Ministres « d’élaborer une Convention relative à la réglementation des transports internationaux d’animaux ».
En droit communautaire, la préoccupation d’éviter « toute souffrance inutile » aux animaux apparaitra dans la Directive 74/577/CEE du Conseil, adoptée le 18 novembre 1974 et relative à l’étourdissement des animaux avant leur abattage. La Directive 77/489/CEE du Conseil, du 18 juillet 1977, relative à la protection des animaux en transport international reprendra en outre la convention du Conseil de l’Europe du 13 décembre 1968 en utilisant, pour la première fois, le concept de « bien-être » animal.
Par la suite, cette notion a pris une ampleur considérable puisque plus de deux cents actes, y compris des accords internationaux, s’y réfèrent explicitement. La consécration de l’animal dans le droit originaire de l’Union européenne a, quant à elle, été opérée par un protocole annexé au Traité d’Amsterdam avant d’être insérée à l’article 13 TFUE, selon lequel « lorsqu’ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l’Union […] l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du « bien-être » des animaux en tant qu’êtres sensibles […] ».
L’existence même de ces règles démontre que l’animal n’est pas considéré comme un bien quelconque. Nombre d’auteurs affirment toutefois que ces avancées demeurent largement symboliques[49]. D’ailleurs, si le « bien-être » animal est un marqueur de l’axiologie européenne, il n’est pas pleinement consacré. D’une part, le « bien-être » animal n’est pas une valeur de l’Union au sens de l’article 2 TUE. D’autre part, la Cour de justice a refusé d’ériger le « bien-être » animal en principe général du droit de l’Union européenne[50].
Surtout, la protection accordée aux animaux par le biais de ce type de règlementations varie suivant leur utilité pour l’homme et selon leur proximité avec lui.l’homme. La notion de « bien-être » diffère en effet selon les catégories d’animal telles que l’homme les conçoit. Les mieux protégés sont ainsi les animaux domestiques, qui sont dans une relation affective avec l’homme, puis les animaux de production, qui sont dans une relation économique avec l’homme, et enfin les animaux sauvages, qui sont dans une simple proximité environnementale avec l’homme et parmi lesquels se trouvent des animaux nuisibles que l’homme éradique dans son propre intérêt[51].
Le droit de l’Union européenne illustre parfaitement cette situation : la notion de « bien-être » animal n’est, par exemple, promue que pour limiter les méfaits de l’industrialisation de l’agriculture, « elle en est donc le corolaire et non le contraire »[52]. Le « bien-être » animal est, en définitive, appréhendé comme ne devant pas mettre en danger le bon fonctionnement de l’économie.
La Directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage, comme le Règlement 1099/2009/CE du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort font ainsi apparaitre, alors même que les animaux sont considérés comme des êtres sensibles, qu’ils peuvent toujours être mis à mort pour satisfaire les besoins humains. Ils demeurent conçus comme étant au service de l’homme et l’encadrement de l’abattage, comme l’ensemble de la législation relative au « bien-être » animal, ne change pas le rapport instrumental entre l’animal et l’homme, mais vient simplement en atténuer les conséquences les plus « inhumaines ».
En outre, le primat de l’économie et donc, d’une certaine manière, de l’homme, transparait également dans le Règlement 1099/2009/CE. Ainsi le paragraphe 6 des motifs concède-t-il que
les recommandations afférentes à l’abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et des bains d’eau pour l’étourdissement des volailles ne sont pas retenues dans le présent règlement, l’analyse d’impact ayant révélé que ces recommandations n’étaient pas économiquement viables, à l’heure actuelle, dans l’Union européenne […].
Face au constat des insuffisances des arguments de l’anthropocentrisme moral et du pathocentrisme, de nombreux penseurs ont conclu à la nécessité d’opérer un revirement éthique en se référant, pour refonder le droit de l’environnement, à une éthique qui ne soit plus anthropocentrée, mais écocentrée.
III. Une révolution écocentrée ?
Les éthiques écocentrées récusent l’argument de l’anthropocentrisme moral qui conduit, selon ses partisans, à un « humanisme prométhéen[53] » dans lequel l’homme est érigé en maître de la nature. Toutes les éthiques écocentrées convergent au contraire pour affirmer que la nature possède, non pas une valeur relationnelle, mais une valeur intrinsèque et pour inclure l’homme dans la communauté biotique (A). Ce constat les conduit à dénoncer la shallow ecology et à plaider pour l’affirmation de droit au profit de la nature (B).
A. L’argument écocentré : « L’Homme n’est pas un empire dans un empire[54] »
Les principaux paradigmes des éthiques écocentrées, aujourd’hui relayées par les différents courants de la deep ecology, sont, d’une part, le monisme immanent de la nature qui, d’autre part, implique son auto-organisation fondée sur une propension de tout ce qui existe à s’accomplir en plénitude. La nature, possède dès lors une valeur intrinsèque, à savoir une valeur indépendante d’une autre fin ou d’une fin motivée par les intérêts humains[55], parce qu’elle manifeste une finalité immanente[56]. Or, selon une majorité de ces courants, l’affirmation de la valeur intrinsèque de la nature constitue la prémisse indispensable à la refondation du statut éthique et juridique de la nature[57].
L’argument écocentré repose sur des spiritualités diverses (telles que le paganisme, l’hindouisme, le taoïsme, le mysticisme chrétien, mais aussi très largement l’ontologie animiste[58]), sur une philosophie naturaliste de l’affirmation[59] et aussi, de manière décisive[60], sur les travaux de différentes équipes de « scientifiques de la terre[61] ».
La deep ecology se réfère, en premier lieu, à un corpus philosophique naturaliste dans lequel la nature est « cause de soi », ce qui interdit qu’elle puisse répondre à de quelconques causes surnaturelles. Dans la philosophie spinoziste, qui constitue une référence incontournable en la matière, la réalité ultime est ainsi entièrement d’une « substance[62] » unique, indivisible et infinie. Aussi, pour Spinoza, tout ce qui existe, excepté la substance elle-même, doit être conçu comme un « mode[63] » de la substance, c’est-à-dire comme une modification ou une affectation interne de la substance. Cette thèse est explicitement reprise par Arne Naess sous le terme de « holisme métaphysique ». Selon ce dernier, il n’existe pas de coupure ontologique dans les champs de l’existence et il convient par conséquent de rejeter les approches qui conçoivent l’existence d’entités différentes les unes des autres dans le monde.
La physique spinoziste se caractérise également, grâce au concept de conatus[64], par la propension de tout ce qui existe à s’accomplir en plénitude. L’essence de la Natura Naturans, que Spinoza appelle également « Dieu[65] », comme celle de tous ses modes (Natura Naturata[66]), est ainsi de s’affirmer, c’est-à-dire d’exprimer immédiatement son essence sur le plan de l’existence, ce qui peut être assimilé à une finalité immanente[67].
La deep ecology s’appuie, en second lieu, de manière décisive, sur un courant scientifique qui reconnait que la Terre se comporte comme un système holistique autorégulé[68]. Au regard de l’avancée de la science, le monisme immanent de la nature est corroboré par la thèse du « monisme énergétique[69] » selon laquelle l’énergie est le fondement ultime du réel. En effet, après que Faraday et Maxwell ont montré que l’espace n’était pas un milieu inerte, mais un champ d’énergie, Einstein a démontré que la matière est un réservoir d’énergie[70]. Cette thèse du « monisme énergétique » aboutit à une « identification complète de tous les phénomènes physiques, psychiques et intellectuels […] aux activités de la matière[71] ».
La science confirme en outre qu’une chose naturelle est une entité réelle en état de devenir et, par conséquent, la vision d’une nature processuelle et dynamique :
Que sont les écosystèmes en tant qu’objets scientifiques ? Ils paraissent ontologiquement flous et de manière ambiguë […]. L’idée que la Nature est d’une certaine manière stable […] est dépassée. La Nature est dynamique. Elle est du reste chaotique, imprédictible […]. L’État normal de la Nature est la perturbation […][72].
Dans ce cadre, l’homme doit prendre conscience du lien qui l’unit à la nature et du fait que son épanouissement dépende de l’épanouissement de la nature dont il est une partie constitutive. Chez Spinoza, la nature est ainsi perfection et l’homme, pour atteindre la béatitude, doit se perfectionner par la compréhension de son unité avec la réalité totale et infinie qu’elle représente[73]. Cette nouvelle exigence éthique permet à l’écocentrisme de justifier le devoir et l’utilité pour l’homme de restreindre au maximum son impact sur la nature et sur toutes ses composantes. Arne Naess se fonde sur cette démonstration dans son ouvrage Écologie, communauté et style de vie pour élaborer une éthique de la nature. Il y indique que « la notion de réalisation de Soi par le biais de l’identification [relie] l’épanouissement humain à celui de la planète toute entière[74] ». En la transposant à notre époque, il affirme que le « problème de la crise environnementale a pour origine le fait que les êtres humains n’ont pas encore pris conscience du potentiel qu’ils ont de vivre des expériences variées dans la nature[75] ». Aussi indique-t-il que tant que l’homme se percevra comme étant disjoint de la nature, il continuera à la détruire sans s’apercevoir qu’il se détruit lui-même[76]. Au-delà de l’identification du bien de l’homme au bien du tout, ce courant insiste en effet sur le fait qu’une perturbation anormale des écosystèmes pourrait aboutir à un nouvel équilibre de l’écosystème Terre duquel l’espèce humaine serait exclue…
Deux objections sont constamment formulées à l’encontre des écocentrismes de type holiste. Une première objection vise à amalgamer écocentrisme avec « écofascisme » en soutenant que le bien de la totalité implique, à l’occasion, de sacrifier le bien des individus, à commencer par celui des humains[77]. La notion de conatus qui est attaché à « toute chose », donc aux humains, justifie toutefois que ces derniers aient un impact écologique. En effet, il ne saurait y avoir de bien du tout sans se référer simultanément au bien des individus qui en sont une émanation[78]. Une seconde objection est d’affirmer que l’écocentrisme conduit à diviniser la nature[79]. Cet argument est largement démenti par la philosophie naturaliste qui est toute entière fondée sur une conception immanente de la nature. Elle écarte ainsi toute forme de transcendance, toute idée d’un au-delà qui surpasse le réel et qui est d’un autre ordre. De même, Spinoza[80] ou Arne Naess[81] nient expressément que la nature soit bienveillante ou poursuive une finalité transcendante : elle est sans but ni fin sauf celle, immanente, de l’affirmation de son essence qui est une puissance infinie de création. Reste que si la posture écocentrée apparait en définitive être cohérente, y adhérer remet totalement en question le mode de vie occidental. La deep ecology, telle que notamment développée par Arne Naess, implique en effet de renoncer à la croissance économique ou encore aux avancées technologiques pour renouer avec la nature[82].
B. Les implications juridiques : l’affirmation des droits de la nature
L’écocentrisme affirme la valeur intrinsèque d’entités naturelles autres que l’homme et impose, par conséquent, qu’elles disposent d’une protection juridique adéquate. Le législateur de l’Union européenne, lorsqu’il élabore le droit de l’Union européenne, ne se réfère nullement à de tels fondements axiologiques. L’Union s’emploie toutefois à lutter contre la disparition des espèces et des habitats menacés. Dans ce domaine, le texte fondateur est la convention de Berne « relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel » signée en 1979 dans le cadre du Conseil de l’Europe. Ont suivi, dans le cadre de l’Union européenne, la Directive « Oiseaux » qui date de la même année et la Directive « Habitats » qui, adoptée en 1992, est contemporaine de la Convention sur la diversité biologique qui a mobilisé un nombre important d’États. Or, s’il est possible de considérer que ces textes ne traduisent qu’un souci scientifique ou esthétique de protection d’objets menacés[83], il est également possible d’y déceler, comme le fait notamment Marie-Angèle Hermitte, l’acceptation du partage de la terre et des mers avec des non-humains, l’idée selon laquelle les espèces et les habitats protégés font partie du projet politique européen humain au même titre que les autres objectifs de l’Union européenne[84].
Reste que cette évolution progressive des fondements éthiques du droit européen de l’environnement demeure largement symbolique au regard de la mise en oeuvre de ces textes qui trahit le maintien d’une nette hiérarchisation entre l’homme et la nature. Ils s’appliquent en effet « en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales » et contribuent à « l’objectif général d’un développement durable[85] ». Une analyse de la jurisprudence révèle, qui plus est, que, lorsque sont confrontés des intérêts humains et environnementaux, le juge tranche quasi exclusivement en faveur des intérêts humains : il autorise ainsi systématiquement des projets d’aménagement des sites protégés sous la condition d’adopter des mesures compensatoires souvent peu adaptées[86]. Et quand le juge tranche en faveur des intérêts écologiques, force est de constater que ces derniers se conjuguent à des intérêts humains[87]. Il s’agit, dans la plupart des hypothèses, d’une menace de pollution qui pourrait nuire à la santé humaine[88].
L’Union demeure ainsi très loin de reconnaitre des droits et une personnalité juridique à la nature. Cette question est pourtant débattue, aujourd’hui, dans de nombreux États.
Elle a fait l’objet, dès 1972, d’un arrêt de la Cour Suprême des États-Unis, Sierra Club v. Morton[89]. Par quatre voix contre trois, les juges avaient alors refusé de reconnaître un droit d’action en justice aux arbres de la Mineral King Valley. Mais, dans une opinion dissidente, le juge Douglas exposait que
the critical question of "standing" would be simplified and also put neatly in focus if we fashioned a federal rule that allowed environmental issues to be litigated before federal agencies or federal courts in the name of the inanimate object about to be despoiled, defaced, or invaded by roads and bulldozers and where injury is the subject of public outrage. Contemporary public concern for protecting nature’s ecological equilibrium should lead to the conferral of standing upon environmental objects to sue for their own preservation[90]
d’autant que la personnalité juridique est une fiction déjà très largement attribuée à des objets inanimés[91].
Depuis, l’idée est restée d’actualité puisqu’on en trouve des traces notamment dans le principe 7 de la Déclaration de Rio[92] ou, plus anciennement, dans la Charte mondiale de la nature de 1982[93]. Surtout, en 2008, l’Équateur est devenu le premier État au Monde à consacrer les droits de la nature dans sa Constitution. L’article 10 la Constitution équatorienne reconnait ainsi que la nature est un sujet de droits. Ses droits fondamentaux sont ensuite explicités notamment par le biais de l’article 71 qui en développe trois sur les quatre qui lui sont attribués :
La Nature ou Pachamama, où la vie existe et se perpétue, a le droit à l’existence, au maintien et à la régénération de ces cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nation peut faire appel aux pouvoirs publics afin de faire respecter les droits de la Nature. [Notre traduction].
L’article 72 reconnait le quatrième droit fondamental de la nature : « La nature a le droit à la restauration. Cette restauration intégrale est indépendante de l’obligation qu’ont l’État et les personnes physiques ou morales d’indemniser les individus et les communautés qui dépendent de systèmes naturels affectés ». [Notre traduction]. Enfin, les articles 73 et 74 établissent la responsabilité de l’État et des individus qui doivent exiger le respect de ces droits et empêcher les activités qui mènent à leur violation.
La Constitution de l’Équateur ne comprend toutefois pas les mécanismes d’application de ces droits et reconnait en outre à l’État la possibilité de les interpréter pour sauvegarder les intérêts nationaux. Par conséquent, l’efficacité de ces dispositions est largement dépendante de la bonne volonté du gouvernement[94]... Il existe néanmoins un certain nombre de jurisprudences remarquables. Ainsi, dans un arrêt rendu le 30 mars 2011, une juridiction équatorienne a pu condamner les pouvoirs publics, pour violation des droits de la nature tels que reconnus à l’article 71 de la Constitution, à remettre un site naturel en état parce qu’ils n’avaient pas réussi à démontrer que l’élargissement d’une route n’affecterait pas l’écosystème d’un fleuve[95].
Au-delà de l’affirmation des droits de la nature, ce type de législation conduit à un recours plus efficace aux principes de précaution et de prévention pour mettre un terme aux activités qui pourraient nuire à la nature. Elle implique également de dispenser l’application de ces principes d’exigences procédurales qui entraveraient la protection de la nature ou qui retarderaient la mise en oeuvre de mesures efficaces pour prévenir ou corriger les atteintes à l’environnement[96]. Ce type de législation tend actuellement à se multiplier comme cela a notamment été le cas, avec des succès divers, en Bolivie, en Inde, en Nouvelle-Zélande et dans certaines collectivités locales américaines.
***
Le renouvellement du questionnement éthique sur le statut des entités naturelles est progressivement en train d’aboutir à la redéfinition de leur statut juridique. Néanmoins, les outils juridiques protecteurs actuels demeurent construits sur des fondements éthiques qui restent largement anthropocentrés et s’avèrent par conséquent toujours sacrificiels de leurs intérêts. En effet, même si les différentes postures éthiques anthropocentrées permettent d’établir certaines obligations morales vis-à-vis de la nature, la valeur relationnelle qu’elles lui reconnaissent ne permet pas de complètement s’extraire du point de vue humain pour trancher de manière équitable les conflits d’intérêts.
Au regard de cette aporie, seule une éthique écocentrée semble à même de conduire à une véritable révolution éthique invitant à repenser en profondeur les limites du droit tel que le conçoit la tradition européenne. Dans le système spinoziste, la recherche de « l’utile » est en effet au fondement de la vertu et de l’accomplissement éthique[97]. Or, la connaissance de la nature, qui ne peut être atteinte que par une communion entre l’homme et la nature, est « l’ultime souverain de l’âme […] [son] souverain bien[98] ». Cette philosophie est au fondement des éthiques écocentrées actuelles et notamment de la deep ecology, telle que théorisée par Arne Naess, qui insiste sur « l’interconnexion entre soi-même et la nature[99] », entre l’épanouissement de l’homme et celui de la nature. Ce faisant, en conjuguant le devoir moral et l’utilité pour l’homme de s’inscrire harmonieusement dans la nature, les éthiques écocentrées se démarquent de toutes les autres éthiques environnementales et constituent en cela un puissant terreau pour refonder le droit de l’environnement.
Appendices
Notes
-
[1]
Olivier Reboul, « La dignité humaine chez Kant » (1970) 2 R Métaphysique & Morale 189 à la p 189.
-
[2]
« La notion de réalisation de Soi par le biais de l’identification, [relie] ainsi l’épanouissement humain à celui de la planète toute entière ». Arne Naess, Ecologie, communauté et style de vie, Bellevaux, Dehors, 2013 à la p 262.
-
[3]
Michel Serres, Le contrat naturel, Paris, Flammarion, 2009 à la p 64.
-
[4]
Gérard Hess, Éthiques de la nature. Éthique et philosophie morale, Paris, Presses Universitaires de France, 2013 à la p 166 et s.
-
[5]
Voir notamment Serge Gutwirth, « Trente ans de droit de l’environnement : concepts et opinions » (2001) 26 Environnement & Société 5 à la p 5.
-
[6]
Voir Socrate citant Protagoras, dans Platon, « Théétète », -394, en ligne : Remacle <remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/theetetefr.htm>.
-
[7]
Voir notamment Roland Quilliot, « Crise et retour de l’idée de nature » dans Roland Quillot, dir, La nature, Paris, Ellipses, 2000 à la p 13.
-
[8]
Voir Hess, supra note 4 à la p 116 et s.
-
[9]
René Descartes, Principes de la philosophie, 1644, IV, §203 et s. Pour de plus amples précisions voir Pierre Guenancia, « Descartes. La nature objet de science et la nature source de sens » dans Rolland Quilliot, dir, La nature, Paris, Ellipses, 2000 à la p 65 et s.
-
[10]
Yves Christen, L’animal est-il une personne?, Paris, Flammarion, 2011 à la p 455 et s.
-
[11]
Immanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Aubier, 1995 à la p 1247.
-
[12]
Bryan G. Norton, « L’éthique environnementale et l’anthropocentrisme faible », dans Hicham-Stéphane Afeissa, Ethique de l’environnement, Paris, Vrin, 2007, à la p 251.
-
[13]
Catherine Larrère, Les philosophies de l’environnement, Paris, Presses de l'Université de France, 2017 à la p 24.
-
[14]
Immanuel Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, IIe section, tome 2, Paris, Gallimard, 1985 à la p 294.
-
[15]
Gérard Hess, supra note 4 à la p 130.
-
[16]
Dale Jamieson, Ethics and the Environment. An Introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 2008 à la p 104.
-
[17]
Hess, supra note 4 à la p 131.
-
[18]
Christen, supra note 10 à la p 225 et s.
-
[19]
Ibid à la p 47 et s.
-
[20]
Voir notamment Paul W. Taylor, « L’éthique du respect de la nature » et Holmes Rolston III, « La valeur de la nature et la nature de la valeur » dans Hicham-Stéphane Afeissa, dir, Éthique de l'environnement, Paris, J. Vrin, 2007 à la p 95 et s; Voir également Hans Jonas, Le principe responsabilité, Paris, Flammarion, 2013 à la p 157 et s.
-
[21]
Larrère, supra note 13 à la p 24.
-
[22]
Pour une étude synthétique de ces justifications, voir Hess, supra note 4 à la p 173 et s.
-
[23]
Voir notamment cet argument chez Martin Seel, Eine Ästhetik der Natur, Frankfort, Suhrkamp, 1996.
-
[24]
Voir notamment cet argument chez John Arthur Passmore, Man’s Responsability for nature. Ecological Problems and Western Traditions, Londres, Duckworth, 1980.
-
[25]
La beauté de la nature évoquerait, par exemple, l’art et la souffrance animale, la liberté. Voir Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Paris, Grasset, 1992.
-
[26]
Sur l’ensemble de ces développements voir Andreas Brenner, Manuel d’éthique de l’environnement, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2010 à la p 51.
-
[27]
Tom Regan, « The Nature and Possibility of an Environmental Ethic » (1981) 19 Environmental Ethics à la p 34.
-
[28]
Catherine Larrère et Raphaël Larrère, Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Paris, Flammarion, 2009.
-
[29]
Sur cette controverse voir Hess, supra note 4 à la p 61 et s.
-
[30]
Voir infra, note 58 et s.
-
[31]
Voir infra, note 58 et s. Sur ce débat voir notamment John Baird Callicott, Ethique de la terre, Paris, Wildproject, 2010 à la p 109 et s; Larrère, supra note 13 à la p 18 et s; Taylor et Rolston III, supra note 20 et J. Baird Callicott, « La valeur intrinsèque dans la nature : une analyse métaéthique » dans Hicham-Stéphane Afeissa, dir, Éthique de l'environnement, Paris, J. Vrin, 2007 à la p 95 et s.
-
[32]
Arne Naess, « Le mouvement d’écologie superficielle et le mouvement d’écologie profonde de longue portée. Une présentation » dans Hicham-Stéphane Afeissa, dir, Ethique de l’environnement. Nature, valeur, respect, Paris, Vrin, 2007 à la p 51.
-
[33]
Commission c Danemark, C-302/86, [1988] ECR I-4607.
-
[34]
En l’absence de base juridique spécifique à la protection de l’environnement, se fonder sur l’article 100 TCE (115 TFUE) relatif à l’harmonisation des législations nationales et sur l’article 235 TCE (352 TFUE) relatif aux compétences subsidiaires de l’Union.
-
[35]
Pour une étude sur l’évolution du droit de l’environnement de l’Union européenne, voir Florence Simonetti, « Le droit européen de l’environnement » (2008) 4:127 Pouvoirs 67 à la p 67 et s.
-
[36]
Voir Henri Smets, « Une charte des droits fondamentaux sans droit à l’environnement » (2001) 4 R Eur Dr Environnement 383 à la p 383.
-
[37]
Guy Braibant, « L’environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (2004) 14 Cahiers Conseil constitutionnel.
-
[38]
Ibid.
-
[39]
Serge Latouche, « Développement durable, un concept alibi » (1994) 35:137 Tiers-Monde 77.
-
[40]
Jeremy Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation, Paris, Vrin, 2011 à la p 325.
-
[41]
Voir notamment Virginie Maris, La protection de la biodiversité : entre science, éthique et politique, thèse de doctorat en philosophie, Université de Montréal, 2006 [non publié].
-
[42]
Voir notamment Philippe Kellerson, « Question bête(s) : quelle philosophie du droit au fondement des statuts juridiques de l’animal? » (2012) 2 R Semestrielle Dr Animalier 385 à la p 406.
-
[43]
Peter Singer, La libération animale, Paris, Grasset, 1993.
-
[44]
Hess, supra note 4 à la p 136.
-
[45]
Maris, supra note 41 à la p 185 et s.
-
[46]
Hess, supra note 4 à la p 137.
-
[47]
Singer, supra note 43 à la p 48 et s.
-
[48]
Estiva Reus, « Utilitarisme et anti-utilitarisme dans l’éthique contemporaine de l’égalité animale » (2010) 32 Cahiers antispécistes 1 à la p 5.
-
[49]
Voir notamment le débat, en France, autour du nouvel article 515-4 du Code civil; S. Delrieu, « Réflexions sur la condition juridique de l’animal domestique — Si un chat est un chat, qu’est l’animal domestique : une chose appropriable, un être sensible ou les deux? » dans Florence Jean et Claude Saint-Didier, dirs, Mélanges en hommage à Jean-Yves Coppolani, Paris, L’Harmattan, 2018; Olivier Le Bot, « La qualification juridique et le statut de l’animal, questions de droit positif » (2014) 2 R Semestrielle Dr Animalier 385 à la p 388.
-
[50]
Sur cet aspect et plus globalement pour une analyse de la législation de l’Union européenne relative au « bien-être » animal, voir Olivier Dubos, « L’Union européenne peut-elle écouter le "silence des bêtes" ? » (2017) 1 R Affaires Européennes 13 à la p 13 et s.
-
[51]
Le Bot, supra note 49 à la p 388.
-
[52]
Voir notamment Dubos, supra note 50.
-
[53]
Voir Pierre Hadot, Le voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de Nature, Paris, Gallimard, 2004 à la p 112.
-
[54]
Baruch Spinoza, Éthique, 1677, Partie III, Préface.
-
[55]
Sur cette controverse voir Hess, supra note 4 à la p 61 et s.
-
[56]
Voir infra note 67 et s.
-
[57]
Voir infra. Sur ce débat voir notamment Callicott, supra note 31 à la p 109 et s; Larrère, supra note 13 à la p 18 et s; Taylor, Rolston III et Callicott, supra note 31 à la p 95 et s.
-
[58]
Olivier Clerc, « Dépassement du dualisme Homme-Nature et émergence de la deep ecology. L’exemple de la renaissance de l’ontologie animiste chez les peuples amérindiens » dans Le rôle involontaire des « systèmes-monde » dans la construction des identités premières, nationales et politiques : regards croisés de formes de Pays Renversés, Paris, L’Harmattan, à paraître.
-
[59]
Olivier Clerc, « Héraclite, Epicure et Spinoza aux fondements d’une philosophie naturaliste de l’affirmation », dans Florence Jean et Claude Saint-Didier, dirs, Mélanges en hommage à Jean-Yves Coppolani, Paris, Mémoire du Droit, 2019.
-
[60]
Pour une analyse de ce fondement, voir François Ost, La nature hors la loi, Paris, La Découverte, 2003 à la p 191 et s.
-
[61]
Pour un aperçu de ce courant scientifique de la deep ecology, voir Pablo Solon, « Les Droits de la Terre Mère » dans Samanta Novella, dir, Des droits pour la Nature, Paris, Utopia, 2016 à la p 63.
-
[62]
Spinoza, supra note 54, Partie I, D3.
-
[63]
Ibid, Partie I, D5.
-
[64]
« Aucune chose n’a en soi rien qui puisse la détruire, rien qui supprime son existence. Au contraire, elle est opposée à tout ce qui peut détruire son existence, et par conséquent, elle s’efforce, autant qu’il est en elle, de persévérer dans son être », ibid, Partie III, Proposition VI.
-
[65]
C’est la fameuse formule « Deus sive Natura », ibid, Partie IV, Préface et Partie IV, P4, Démonstration; Pour de plus amples développements, voir notamment Victor Brochard, Le Dieu de Spinoza, Paris, Manucius, 2013.
-
[66]
Baruch Spinoza, Court traité de Dieu, de l'homme et de la béatitude, 1660, Partie I, chap VIII et IX.
-
[67]
Sur cette question, voir notamment Renée Bouveresse, Spinoza et Leibniz. L’idée d’animisme Universel, Paris, Vrin, 1992 à la p 157 et s.
-
[68]
Voir notamment James Lovelock, La Terre est un être vivant : l’hypothèse Gaia, Paris, Flammarion, 2010. Plus largement, différentes équipes de « scientifiques de la Terre » soutiennent aujourd’hui que la Terre se comporte comme un système autorégulé aux composantes physiques, chimiques, biologiques et humaines.
-
[69]
Désiré Nys, « Le monisme » (1912) 19:76 R néo-scolastique philosophie 515 à la p 515.
-
[70]
Albert Einstein et Léopold Infeld, L’évolution des idées en physique, Paris, Flammarion, 1983 à la p 228; Toutefois, si matière et champ, matière et espace ne sont pas de nature différente, ils résultent de ces travaux qu’il est pour l’instant impossible d’unifier toute la physique en la fondant sur le seul concept d’énergie (voir Arnaud Macé, La matière, Paris, Flammarion, 2013 à la p 214).
-
[71]
Nys, supra note 69. La vie est alors appréhendée comme étant une propriété émergente de la physico-chimie des organismes vivants et la conscience comme une propriété émergente de la matière qui se différencie de la matière.
-
[72]
John Baird Callicott, « Do Deconstructive Ecology and Sociobiology Undermine Leopold Land Ethic? » (1996) 18 Environmental Ethics 352.
-
[73]
Sur l’ensemble de ce développement, voir Baruch Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, 1677.
-
[74]
Naess, supra note 2 à la p 262.
-
[75]
Ibid à la p 52.
-
[76]
Ibid à la p 262.
-
[77]
Voir notamment Ferry, supra note 25 aux pp 147-168.
-
[78]
Voir notamment Hess, supra note 4 à la p 150.
-
[79]
Voir par ex Fréféric Paul Piguet et Édouard Dommen, Approches spirituelles de l’écologie, Paris, Charles Léopold Mayer, 2003 à la p 93.
-
[80]
Spinoza, supra note 54, Partie I, Appendice.
-
[81]
Naess, supra note 2 à la p 287.
-
[82]
Ibid à la p 151 et s.
-
[83]
La posture morale au fondement de cette règlementation serait alors celle de l’anthropocentrisme moral qui n’exclut pas que l’homme décide, pour son propre épanouissement, de protéger la biodiversité.
-
[84]
Marie-Angèle Hermitte, « La Nature, sujet de droit? » (2011) 66:1 Annales. Histoire, Sciences Sociales 173 à la p 189 et s.
-
[85]
CE, Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, [1992] JO, L 206.
-
[86]
Hermitte, supra note 84 à la p 193.
-
[87]
Dans une affaire archétypale de cet état de fait, le tribunal administratif de Pau avait à juger d’un litige relatif à un permis de construire de quatre-vingt-un logements dans une zone Nature 2000. Les requérants demandaient la suspension du permis au nom de l’habitat du crapaud accoucheur, le lotissement aboutissant à la suppression d’un corridor utile à ses déplacements. Dans son ordonnance de référé, le juge répond que la « noue paysagère [...] est en contact direct avec le fossé de la rue de Chaloche, site de reproduction maintenu, situé à la bordure-est du terrain, vers lequel les crapauds nichés dans les jardins de la partie-est de la rue de Caparits et dans ceux de la rue de Chaloche, lieux déjà urbanisés, ont toujours su se déplacer, malgré la circulation automobile ». Le caractère absurde du considérant, qui semble attribuer aux crapauds une connaissance poussée du Code de la route et des aptitudes particulières à éviter les voitures a suscité les moqueries de la doctrine, certains allant jusqu’à évoquer « l’intelligence comparée du crapaud et du conseiller de TA ». Voir Olivier Dubos, « De l’intelligence comparée du crapaud et du conseiller de TA » (2009) 2 R Semestrielle Dr Animalier 11 à la p 11.
-
[88]
Hermitte, supra note 84 à la p 191 et s.
-
[89]
Sierra Club v Morton, 405 US 727 (1972).
-
[90]
Opinion dissidente du juge Douglas, Sierra Club v Morton, 405 US 727 (1972).
-
[91]
« Inanimate objects are sometimes parties in litigation. A ship has a legal personality, a fiction found useful for maritime purposes. The corporation sole - a creature of ecclesiastical law - is an acceptable adversary and large fortunes ride on its cases. The ordinary corporation is a "person" for purposes of the adjudicatory processes, whether it represents proprietary, spiritual, aesthetic, or charitable causes », ibid.
-
[92]
« Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre » dans Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, Doc off AG NU, 1992, Doc A/CONF.151/26 (Vol.1), Principe 7 [Déclaration de Rio].
-
[93]
« Toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme et, afin de reconnaître aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque, l’homme doit se guider sur un code moral d’action » dans Charte mondiale de la nature, Rés AG A/RES/37/7, 37e sess, Doc off AG NU (1982).
-
[94]
Natalia Greene, « Les cas des constitutions équatorienne et bolivienne » dans Samanta Novella, dir, Des droits pour la Nature, Paris, Utopia, 2016 à la p 76.
-
[95]
Corte provincial de justicia de Loja, sala penal, 30 mars 2011, juicio n° 1112-2011-0010.
-
[96]
Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain, Paris, Seuil, 2004; Corrine Lepage et François Guéry, La politique de précaution, Paris, Presses Universitaires de France, 2001; Olivier Godard, « Le principe de précaution, une nouvelle logique de l’action entre science et démocratie » (2000) 11 Philosophie politique 17; Jonas, supra note 20.
-
[97]
Charles Ramond, Le vocabulaire de Spinoza, Paris, Ellipses, 1999 à la p 55.
-
[98]
Spinoza, supra note 54, Partie IV, P28, Démonstration.
-
[99]
Naess, supra note 2 à la p 31.