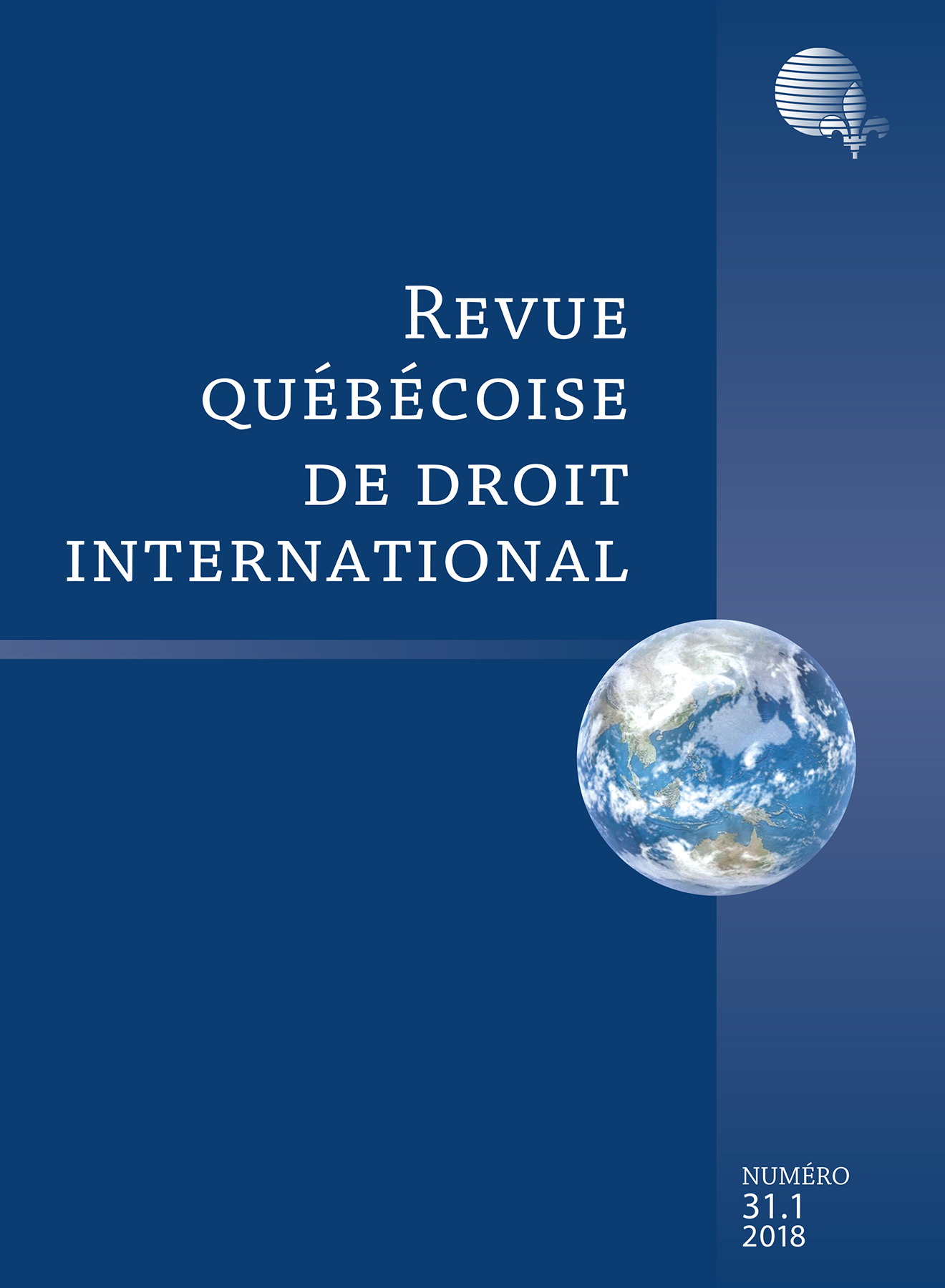Abstracts
Résumé
Le principe de « consentement libre, préalable et éclairé » (CLPE) a, depuis son émergence, vécu une évolution bipolarisée, partant d’un « contrôle d’entrée » de produits dangereux, pour devenir un outil de « contrôle de sortie » pour les ressources biologiques comme culturelles des communautés avec l’adoption du Protocole de Nagoya à la Convention sur la diversité biologique. Cette évolution a rejoint l’apparition de la notion de patrimoine culturel immatériel avec la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui a, elle aussi, pour mission de garantir une protection juridique en droit international aux communautés. Néanmoins, dans ce processus de protection du patrimoine culturel immatériel, en particulier lors de la collecte des données, les communautés n’échappent toujours pas au danger de voir leur parole ignorée. Elles doivent parfois se confronter à une rhétorique officielle sur leur culture à laquelle elles n’adhèrent pas, d’une part, et aux collectes numérisées des données qui peuvent poser des problèmes de sensibilité culturelle, d’autre part. Dans cette circonstance, le principe de CLPE peut proposer une protection aux communautés, réduire les risques d’utilisation déformante et culturellement offensante, et à un certain degré éviter la divulgation de secrets culturels, parfois susceptible aussi d’être secrets commerciaux. De même, les États peuvent aussi bénéficier de ce principe pour diminuer les risques d’ingérence dans l’exercice de leur mission de protection du patrimoine. Aujourd’hui, devant la tension du droit à l’autodétermination, le recours à des dispositions législatives internes semble encore le moyen à privilégier pour la mise en oeuvre du principe de CLPE dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Pour mieux appliquer la surveillance de « sortie » que ce principe de CLPE propose, les États devraient, à travers un processus « descendant » en droit international, définir les procédures et conditions claires de dévoilement d’information, et instaurer le CLPE en tant qu’obligation de résultat dans leurs législations internes.
Abstract
The principle of “free, prior and informed consent” (FPIC) has gone through a polarized evolution since its emergence, from the entry control of dangerous products to a tool for exit control of biological resources, such as communities’ cultural resources, with the adoption of the Convention on Biological Diversity’s Nagoya Protocol. This evolution is consistent with the emergence of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’s notion of intangible cultural heritage, for which the objective is also to guarantee a legal protection for communities based in international law. However, within this process for the protection of intangible cultural heritage, in particular as concerns data collection, communities do not always escape the danger of seeing their voices be ignored. Sometimes, they are confronted, on the one hand, to an official rhetoric on their culture to which they do not adhere, and on the other hand, to digitized data collection that may lead to cultural sensitivity problems. In this context, the FPIC principle can offer a protection to these communities, reduce the risks of a distorted and culturally offensive use, and to a certain degree, avoid the disclosure of cultural secrets, at times also possibly constituting commercial secrets. Furthermore, states can also benefit from this principle to decrease the risks of interference in the accomplishment of their heritage protection mission. Today, considering the tension surrounding the right to self-determination, recourse to national legislative provisions still appears as the preferred mean for the implementation of the FPIC principle in the field of intangible cultural heritage. To better implement the “exit” control this principle offers, states should define clear procedures and conditions for the unveiling of information, through a “top-down” process in international law, and establish the FPIC principle as an obligation of result within their national legislations.
Resumen
El principio de “consentimiento libre, previo e informado” (CLPI) ha vivido, desde su aparición, una evolución bipolarizada, a partir de un “control de entrada” de productos peligrosos, hasta convertirse en una herramienta de “control de salida” para los recursos biológicos y culturales de las comunidades con la adopción del Protocolo de Nagoya al Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este desarrollo se ha unido al surgimiento de la noción de patrimonio cultural inmaterial con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que también tiene la misión de garantizarles a las comunidades la protección legal del derecho internacional. Sin embargo, en este proceso de protección del patrimonio cultural intangible, especialmente durante la recopilación de datos, las comunidades aún no escapan al peligro de ver su palabra ignorada. Es posible que tengan que enfrentarse a la retórica oficial sobre su cultura a la que no adhieren, por un lado, y las colecciones de datos digitalizados que pueden causar problemas de sensibilidad cultural, por el otro. En esta circunstancia, el principio de CLPI puede ofrecer protección a las comunidades, reducir el riesgo de distorsión y uso culturalmente ofensivo y, en cierta medida, evitar la divulgación de secretos culturales, que a veces también pueden ser secretos comerciales. Los Estados también pueden beneficiarse de este principio para reducir el riesgo de interferencia en el ejercicio de su misión de protección del patrimonio. En la actualidad, ante la tensión del derecho a la libre determinación, el recurso a la legislación nacional sigue siendo el medio preferido para la aplicación del principio de CLPI en el campo del patrimonio cultural inmaterial. Para aplicar mejor la vigilancia de “salida” que este principio de CLPI propone, los Estados deben, a través de un proceso “descendente” en el derecho internacional, definir procedimientos y condiciones de divulgación claros y establecer el CLPI como obligación de resultado en su legislación interna.
Article body
Depuis l’entrée en vigueur en avril 2006 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel[1] (Convention de 2003), de nombreux pays ont réalisé des inventaires nationaux ou un recensement national du patrimoine culturel immatériel (PCI) en application de ses articles 2, 11 et 12 qui imposent aux États membres d’identifier et de documenter leur PCI. En effet, ces « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel[2] » sont confrontés aux « graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction » en raison des « processus de mondialisation et de transformation sociale[3] ». L’identification des éléments et l’inventorisation sont donc considérées comme des moyens privilégiés de sauvegarde. Selon un rapport réalisé par le secrétariat de la Convention de 2003[4], l’inventaire du PCI apparait comme la priorité la plus citée par une large majorité d’États parties, et constitue aussi un des résultats les plus visibles de la mise en oeuvre de cette Convention de 2003.
Néanmoins, un certain nombre de communautés, groupes ou particuliers détenteurs et praticiens du PCI, et parfois aussi des chercheurs, ont une attitude plus sceptique voire méfiante face aux collectes des données de PCI nécessaires à ce processus d’inventorisation ou de recensement, et cela pour des raisons diverses. Certains contestent la fixation à un support matériel du PCI, pourtant « vivant » et en permanente évolution, sur un support matériel en raison de collectes numérisées, en particulier concernant les éléments cultuellement sensibles ou secrets, tels que les rituels. À d’autres moments, les communautés contestent non pas la fixation, mais la possibilité de divulgation. Avec la facilité de transmission et de publication des données aujourd’hui largement numérisées, les éléments culturels sont donc exposés au risque de divulgation, d’utilisation incontrôlée, voire d’altération[5]. Certaines communautés autochtones contestent aussi la propriété de certaines données, considérées comme étant divulguées illégalement à l’époque de la colonisation; ou bien la manière dont ces données collectées sont présentées au public, car l’image qu’elles reflètent ne correspond pas à leur identité culturelle et ce qu’elles veulent démontrer au monde[6]. Ainsi, les travaux de collecte de données de PCI auraient entrainé « l’anxiété[7] » chez les communautés et groupes détenteurs de PCI, dont la volonté doit être mieux prise en compte dans la préservation du PCI, en raison de leur connexion naturelle avec leur patrimoine.
En effet, lorsque l’on retrace l’histoire de la notion juridique de « PCI », il faut reconnaître que la plupart des communautés traditionnelles ont été prises en otage par la vague de l’économie du savoir mondialisée et industrialisée, tel que la représente le prédécesseur du concept de « PCI » qui était, lorsque la Bolivie l’a présenté à l’UNESCO en 1973, « folklore[8] ». Depuis, les communautés doivent souvent envisager le processus de reconstruction de leur patrimoine, via lequel l’État filtre, remanie et reconditionne leurs pratiques culturelles pour en faire une « culture publique », une « identité culturelle nationale » et une rhétorique officielle de la culture les concernant. Dans ce processus de patrimonialisation, la parole des communautés est encore une fois ignorée. Ainsi, ces dernières doivent faire face non seulement à la déperdition des ressources culturelles et naturelles, mais aussi à l’absence de leur propre discours sur leur identité.
Certaines parmi elles ont pu exprimer leur volonté de réclamer le pouvoir de parole, de mettre un terme à la collecte et à l’utilisation non autorisées ou irrespectueuses de leur culture, ou de demander le partage des retombées économiques. Cet appel doit nécessairement être entendu dans les travaux de collecte du PCI. Si les communautés ne se contentent pas de se laisser emporter par ces vagues dans une direction inconnue et incontrôlée, elles doivent clairement se positionner parallèlement à la protection du patrimoine par l’État, envisager directement la configuration complexe du pouvoir et le partage des intérêts, et réclamer leur intérêt au plus large, tout en restant dans le fonctionnement de l’État souverain dans lequel elles se trouvent. Parmi les réclamations, la première à considérer selon la logique temporelle, et aussi le préalable pour toutes les autres, est de « demander son accord » avant de procéder à la collecte, ou de mettre à la disposition du public les données collectées. Pour ce faire, le principe de « consentement libre, préalable et éclairé » en droit international peut jouer un rôle important.
Ce prince de « consentement libre, préalable et éclairé » (CLPE), élaboré dans les années 1980, est aujourd’hui intégré dans deux textes les plus fondamentaux concernant le PCI, la Convention de 2003, et aussi le Protocole de Nagoya[9] qui couvrent une partie du PCI – les connaissances traditionnelles associées aux ressources naturelles détenues par les communautés autochtones et locales. Dans cette étude, nous allons, après avoir récapitulé l’évolution de ce principe dans le domaine du PCI (I), examiner comment il est appliqué dans les instruments internationaux (II), et aussi par les États (III) et institutions culturelles (IV), parfois en l’absence d’une législation claire définissant ce principe. Après l’analyse de ces applications, on doit admettre que le principe de CLPE, bien qu’encore sous la tension de la souveraineté d’État, apporte aux communautés la possibilité de se faire entendre. Aujourd’hui, dans le contexte d’une collecte numérisée de PCI de plus en plus répandue – et donc un risque de plus en plus élevé de violation de prérogatives et droits des communautés détentrices de PCI, le principe de CLPE semble d’autant plus important pour proposer une défense en amont.
I. L’évolution du principe de CLPE en droit international mise en rapport avec le patrimoine culturel immatériel
A. La genèse de la doctrine de CLPE et son évolution bipolarisée
Bien que ses intentions et extensions ne soient pas encore clairement définies, le principe de CLPE est aujourd’hui une notion acceptée en droit international. Né d’abord dans le domaine du droit de l’environnement en rapport avec le contrôle de mouvement des produits chimiques et biologiques, le principe de CLPE attribue un droit d’être informé pour les pays importateurs de ces produits avant leur entrée sur le territoire national[10]. Plus tard, ce principe s’est diffusé progressivement dans d’autres domaines du droit international. On devrait même dire que le concept a reçu un meilleur accueil dans le domaine des droits des autochtones et indigènes, dans la Convention (n°169) relative aux peuples indigènes et tribaux[11], comme dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones[12].
Mais l’évolution la plus importante de ce principe de CLPE a eu lieu avec l’adoption de la Convention sur la diversité biologique de 1992 (dite Convention « biodiversité »)[13]. Cette fois-ci le principe apparaît dans un instrument juridique international très largement accepté. L’article 15 de la Convention « biodiversité » énonce : « L’accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources[14] ». La Convention a donc une position très claire concernant l’obligation d’obtenir le consentement avant d’utiliser les ressources génétiques, en réponse aux phénomènes de « biopiraterie[15] ». Plus tard, en 2010, les Parties de la Convention ont adopté le Protocole de Nagoya[16] qui a étendu la sphère de discussion aux « connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales ». Ici, les « connaissances traditionnelles » (concernant l’utilité des ressources génétiques) font partie de la notion de PCI, récemment acceptée par le droit international[17]. Les articles 6 et 7 de ce Protocole définissent clairement le « consentement préalable », « accord » ou « participation » des communautés comme condition d’accès aux ressources naturelles et culturelles des communautés[18].
Jusque-là, on observe une transformation du principe de CLPE. Il était parti d’un outil de contrôle d’entrée pour les produits dangereux en droit international de l’environnement, pour devenir un outil de contrôle de sortie pour les ressources génétiques ainsi que les connaissances traditionnelles qui y sont associées. Ce contrôle de sortie est d’autant plus important, puisqu’il s’agit, pour les pays et communautés à l’origine des ressources biologiques et culturelles, d’affirmer leur pouvoir sur ces ressources qui leur appartiennent. L’évolution du principe de CLPE « à sens inverse » paraît inévitable : elle représente l’éveil des communautés traditionnelles concernant leurs ressources biologiques et culturelles, et reflète aussi le développement du concept des droits des autochtones et indigènes.
En effet, on peut constater sur un plan plus large que le principe de CLPE a évolué parallèlement à la notion de PCI en droit international durant les années 1980 à 2000, qui se préoccupe de donner une place aux communautés de s’exprimer concernant l’utilisation des ressources culturelles qu’elles détiennent. Néanmoins, par souci de consensus, ce principe de CLPE se manifeste dans la Convention de 2003 seulement par un droit de « participation » des communautés[19], sans mentionner le terme « consentement » qui pourrait être interprété par certains États comme problématique au regard de leur relation avec les communautés.
Ainsi, aujourd’hui, même s’il existe des interprétations différentes de ce qu’est le « consentement » – s’agit-il d’un droit de veto ou simplement d’un droit d’être informé et droit de participation[20], on peut admettre que le principe de CLPE est applicable non seulement aux « connaissances traditionnelles » dans le sens de la Convention « biodiversité » et son Protocole de Nagoya, mais aussi à la notion plus large de « PCI » comme le mentionne la Convention de 2003.
Aujourd’hui, même si la qualification du principe de CLPE en tant que droit de l’homme est encore discutée[21], et que la plupart des communautés ne peuvent obtenir l’autodétermination dans sa dimension extérieure, leurs prérogatives envers leurs ressources biologiques comme culturelles sont largement reconnues. Bien entendu, dans la « vraie vie », les relations entre les communautés traditionnelles et les promoteurs/industriels sont rarement équitables. Face à cette situation, le « consentement » se désigne comme un outil pour restaurer la balance des pouvoirs. C’est dans ce sens que le professeur Michel Pimbert parle de la « fonction d’équilibrateur de pouvoir » du principe de CLPE, et qualifie la participation des communautés dans les décisions d’utilisation comme étant « émancipatoire et démocratique[22] ».
B. Les composantes du CLPE analysées au regard du patrimoine culturel immatériel
Dans ses discussions sur l’exploitation industrielle des ressources biologiques et des savoirs et savoir-faire traditionnels, professeur Nijar[23] argumente l’importance du CLPE, en le définissant comme « donné librement et volontairement, fondé sur une divulgation totale des informations pouvant influencer la décision finale ». En effet, c’est d’un accord commun que le consentement implique toujours ces trois conditions « libre, préalable (à l’exploitation) et éclairé[24] ». Il est néanmoins nécessaire d’évaluer plus en détail ces trois conditions.
D’abord, le terme « consentement » en tant que notion juridique, évoque de manière intrinsèque la condition « libre ». Un consentement qui est légal est aussi obligatoirement sans contrainte, incitation ou coercition, ou d’autres circonstances qui peuvent entrainer la nullité d’un engagement. Nijar analyse que cela explique l’absence du qualificatif « libre » dans la Convention « biodiversité » et son Protocole de Nagoya : car un « consentement » qui n’est pas libre n’est pas un consentement. Mais le terme « libre » n’est pas complètement dénué de sens. Sur cette question, le juge Dillard de la Cour internationale de justice, dans son opinion concernant l’affaire du Sahara occidental, avait argumenté que : « l’autodétermination se caractérise par un libre choix et non pas par une conséquence particulière de ce choix ou par un mode particulier de l’exercice du choix lui-même[25] ». Partant de cette logique, on doit considérer que, lorsque les communautés envisagent une demande extérieure de collecte et d’utilisation de leurs PCI, elles sont non seulement libres d’accepter ou ne pas accepter les conditions proposées, et aussi libres de négocier avec les demandeurs d’accès concernant les conditions précises pour atteindre un résultat qui leur convient, quelle que soit la méthode employée. Le Protocole de Nagoya par exemple, demande la « concertation » pour aboutir aux conditions concernant l’accès aux connaissances traditionnelles ainsi que le partage des avantages[26].
Ensuite, le qualificatif « préalable » implique que le consentement soit demandé suffisamment à l’avance devant quelconque activité de collecte ou d’exploitation de PCI, et que les acteurs concernés garantissent un temps nécessaire pour que la communauté en question puisse examiner et réfléchir avant de prendre leur décision[27]. Il faut aussi prendre en compte des coutumes des communautés en ce qui concerne le temps nécessaire de consultation interne.
Enfin, le qualificatif « éclairé » signifie que la communauté doit recevoir des informations et renseignements suffisants concernant le projet de collecte et d’exploitation de leurs PCI, tels que la nature juridique, l’ampleur, l’impact sur l’environnement, sur le cadre économique et social et sur leur vie quotidienne, l’investissement prévu, ainsi que la réversibilité[28]. Ces renseignements doivent non seulement être exacts et précis, mais aussi être compréhensibles et interprétables pour les communautés. Par exemple, les informations doivent être données en langues utilisées par les communautés concernées. En raison de la position sociale généralement faible des communautés traditionnelles, l’obligation d’informer doit être interprétée comme une obligation de résultat et non pas une obligation d’agir. Dans la version française, l’article 7 du Protocole de Nagoya (« Accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ») emploie le qualificatif « en connaissance de cause », ce qui met en avant la nature d’une obligation de résultat.
En tant que mécanisme d’application de la Convention « biodiversité » et de ses protocoles, la loi australienne Environment Protection Biodiversity Conservation Regulations 2000 a mis en place une évaluation du résultat d’information et de renseignement[29]. Afin de vérifier l’existence d’un consentement, les critères suivants sont évalués : le détenteur de ressources a-t-il suffisamment de connaissance de la loi concernant l’accès et le partage des avantages; a-t-il la capacité de négocier avec les demandeurs d’accès; dispose-t-il de suffisamment de temps à discuter et réfléchir avant de prendre sa décision; a-t-il reçu de l’aide juridique adéquate. La loi australienne mérite d’être citée, car elle met en avant l’importance que les informations doivent être réellement assimilées par les communautés. En effet, la révélation des informations n’équivaut ni à leur compréhension, ni à ce que les communautés puissent prendre une décision éclairée.
C. Le rôle du CLPE dans la collecte numérisée du patrimoine culturel immatériel
Certains chercheurs estiment que, compte tenu du rôle aujourd’hui indispensable d’internet et de la technologie numérique dans le développement économique et les relations sociales, les communautés devraient activement participer au développement des infrastructures digitales et obtenir un contrôle sur ces dernières. Cette vision de « décider de son propre destin via la maîtrise de l’infrastructure et de la technologie informatiques » est nommée « l’autodétermination digitale[30] ». En effet, un grand nombre de communautés traditionnelles, indépendantes politiquement ou pas, sont toujours exposées au risque de voir leurs ressources culturelles et naturelles collectées puis exploitées illégalement ou injustement. La numérisation à grande échelle du PCI et la création des bases de données font augmenter ce risque de manière considérable. La décontextualisation est l’un des risques le plus importants. Par exemple pour les Maoris, l’association des objets sacrés avec la nourriture est vue comme offensante. Si dans les institutions muséales, cette sensibilité est généralement respectée, une fois que l’objet est numérisé et mis en ligne, l’opérateur des bases de données, comme le peuple maori, perd le contrôle de l’image de l’objet et ne peut vérifier si un visiteur est en train de croquer une pomme alors qu’il visualise une image d’un objet sacré maori[31]. Dans une autre hypothèse plus « mondaine », des savoir-faire locaux peuvent, en raison de la diffusion numérique, être exposés aux risques de « tomber dans le domaine public[32] ». Ainsi, les communautés ont tout intérêt de participer activement dans la numérisation de leur patrimoine, afin d’éviter la perte du contrôle sur ce dernier.
En discutant de la place d’une « route informatique de l’Amazonie » dans la protection du patrimoine culturel des indigènes de la région, les chercheurs estiment que pour atteindre à « l’autodétermination digitale », l’État doit faire un effort nécessaire pour que les communautés soient suffisamment informées du cadre juridique pour la protection de leur patrimoine, des technologies utilisées, ainsi que des risques qui y sont liés[33]. Cela pourrait permettre aux communautés de discerner les risques face aux exploitations commerciales. Dans cette circonstance, le principe de CLPE propose un soutien doctrinal et une solution pratique aux communautés. L’État et ses institutions, lors de la collecte numérisée et de la réalisation des bases de données de PCI, doivent donc respecter la réclamation de l’autodétermination digitale et garantir le droit de CLPE des communautés.
Enfin, il faut souligner qu’ici, il s’agit toujours de « l’autodétermination » dans sa dimension interne; dans le cadre du droit international actuel, la réclamation du CLPE des communautés ne peut certainement pas porter atteinte à la souveraineté de l’État dans lequel elles se retrouvent.
II. Méthode d’obtention de consentement selon les principaux instruments internationaux
A. Règles de CLPE selon la Convention de l’UNESCO de 2003
1. Condition légale de CLPE pour les deux listes de la Convention
Pour faciliter son application, l’Assemblée générale de la Convention de 2003 a approuvé un document intitulé Directives opérationnelles pour la mise en oeuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel[34] préparé par son organe exécutif, le Comité intergouvernemental de sauvegarde du PCI (Comité intergouvernemental). Ce document a soulevé à multiples reprises le principe de CLPE, même si cela se limite à une demande d’inscription sur les deux listes de PCI établies par la Convention, l’une « représentative » et l’autre de « sauvegarde urgente[35] ».
À l’examen des documents préparatoires de ces Directives, on constate que l’opinion majoritaire des experts consultés pour les critères d’inscription des deux listes était d’intégrer le principe de CLPE des détenteurs de PCI[36]. Cette idée a été soutenue par la plupart des États membres, mais certains ont exprimé leur réserve. Le Japon par exemple, argumentait que le consentement est important, mais il reste à déterminer comment identifier l’existence d’un consentement; en raison de la diversité des réponses à cette question selon le contexte culturel, les Directives opérationnelles ne devraient pas exiger un consentement écrit, mais devraient permettre aux communautés de décider selon leurs propres normes culturelles. La France et la Chine, d’un autre côté, estimaient que l’on doit attendre que les États obtiennent un consensus général sur la notion de « communauté » et sur la question de représentation des communautés, avant d’intégrer cette obligation de CLPE dans le texte des Directives opérationnelles[37]. Mais finalement, la majorité des États se sont mis d’accord pour intégrer le principe de CLPE dans les Directives opérationnelles.
Ainsi, dans l’article I.1 de ces Directives opérationnelles (critères pour l’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente) comme dans l’article I.2 (critères pour l’inscription sur la Liste « représentative »), on trouve ce même critère demandant que l’élément soit « soumis au terme de la participation la plus large que possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé ». Selon ces deux articles, tout État demandeur d’une inscription sur la Liste « représentative » ou la Liste sauvegarde urgente doit, dans son dossier de candidature, expliquer comment les communautés ont participé à la candidature, et déposer des preuves écrites de son CLPE[38].
Si les États étaient encore en désaccord concernant la documentation minimale requise comme preuve du CLPE, l’Organe subsidiaire du Comité intergouvernemental chargé de l’examen des candidatures en vue de leur inscription a considéré le consentement des communautés comme un aspect « essentiel » du dossier, car « déterminant leur implication dans le processus de sauvegarde[39] ». L’Organe consultatif du Comité intergouvernemental souligne également « l’importance de décrire clairement quels mécanismes ont été utilisés lors […] d’une demande pour impliquer pleinement les communautés, et la nécessité – en particulier pour la Liste de sauvegarde urgente – de fournir une preuve claire et précise de leur consentement libre, préalable et éclairé[40] ». Ainsi, on peut considérer que le CLPE, en tant que condition obligatoire de l’inscription aux deux Listes de la Convention de 2003, donne réellement le droit de veto aux communautés.
Dans la pratique, le consentement se présente sous forme d’une déclaration écrite des membres représentants d’une communauté, avec les signatures, sceaux et/ou empreintes digitales des personnes ou organisations concernées. Il est demandé que le consentement soit fourni en langue utilisée par la communauté si elle est autre que l’anglais ou le français, accompagné d’une note expliquant comment le consentement a été obtenu[41]. En raison de la nature non commerciale des deux listes de l’UNESCO, ces consentements se limitent généralement aux mesures de sauvegarde et de protection, et restent sans engagement particulier. Étant donné que le dossier de candidature ne demande pas de description détaillée sur l’élément[42], la question de secret ou de sensibilité culturelle est relativement peu posée. Parmi les dossiers de candidature retenus[43], les déclarations de consentement dépassent rarement une page A4 et restent très générales.
On doit en conclure ainsi que ce droit de veto imposé par la Convention de 2003 n’a pas pour mission de protéger les droits des personnes interviewées pour le dossier d’inscription, ni de prévenir l’exploitation commerciale, mais de donner un droit de refus aux communautés. Souvent, dans ce processus de patrimonialisation, les communautés doivent envisager une reconstruction de leur patrimoine, via lequel l’État filtre, remanie et reconditionne leurs pratiques culturelles pour en faire une « identité culturelle » nationale ou communautaire et une rhétorique officielle de la culture les concernant. Les communautés doivent alors envisager non seulement la déperdition des ressources culturelles, mais aussi l’absence de leur propre discours sur leur identité. Ce consentement imposé leur donne donc un recours quant à la présentation de leur image sur la scène internationale.
2. Condition légale de CLPE pour les recensements nationaux du patrimoine culturel immatériel
Outre sur les deux listes, les Directives opérationnelles n’ont pas mentionné clairement le principe CLPE ailleurs. Néanmoins, ce texte a posé certaines limites de manière tacite aux États parties concernant cette question, en particulier concernant les articles 11 (obligation de recensement) et 12 (obligation des inventaires nationaux) de la Convention, les rares obligations de résultat qu’impose la Convention. Selon l’article 11, il appartient à chaque État partie : « d’identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes. » (Notre italique)
Dans le même sens, les Directives opérationnelles mettent l’accent encore une fois sur le rôle des communautés dans l’application des articles 11 et 12. Dans le paragraphe 80 des Directives opérationnelles, les États parties sont « encouragés » à créer un organisme consultatif ou un mécanisme de coordination qui permettrait de faciliter la participation des communautés, notamment dans le recensement et la réalisation d’inventaires. Lus ensemble, ces textes devront être interprétés comme l’intention des rédacteurs de la Convention de 2003 de garantir le droit de participation des communautés – une des manières d’exprimer son consentement – concernant le recensement et l’inventaire du PCI au niveau national. Cependant, étant donné que la notion de « communauté » est souvent fort sensible chez les États multiethniques, si la Convention de 2003 impose clairement l’obligation de CLPE dans toute opération en rapport avec le PCI, sa valeur universelle sera certainement atteinte, certains États n’auraient pas voulu signer le texte. C’est sans doute pour cela que la Convention et ses Directives opérationnelles, au lieu de mentionner clairement le CLPE comme principe général, a choisi d’employer une expression plutôt souple de « participation des communautés » dans l’article 11, et a utilisé la formule « encourager » dans les Directives opérationnelles.
En conclusion, la Convention de 2003 n’a pas imposé l’obligation de CLPE de manière généralisée. La seule circonstance où le CLPE est obligatoire est l’inscription d’un élément sur la Liste « représentative » et la Liste de sauvegarde urgente. Malgré cela, il convient de noter que la Convention s’efforce à appliquer ce principe de CLPE dans l’ensemble de ses travaux, bien qu’il ne puisse être imposé partout en raison d’une grande diversité de forme des activités et de l’absence d’un consensus des États. Dans les pratiques de l’UNESCO, on observe donc le sens double du terme « consentement » : pour intégrer les deux listes de la Convention de 2003, il s’agit d’un véritable droit de veto de la part des communautés, afin de garantir que leur image reflétée sur la scène internationale soit en accord avec leur propre vision; alors pour le recensement et inventaire interne, les communautés n’ont pas le droit de refuser que leur PCI soit collecté lors des recensements au sein de l’État souverain dans lequel elles se trouvent, mais ont le droit de participer à ces collectes, afin de faire entendre leur voix sur leur propre patrimoine.
3. En cas d’absence de consentement
Bien que la notion de « communauté » reste encore imprécise en droit international, il est généralement reconnu que le PCI est détenu et pratiqué par les communautés ou groupes de personnes. Or, il est souvent difficile de mesurer ce qu’est le « consentement » au sein d’un groupe de personnes. Dans la pratique, si une partie de la communauté exprime son désaccord, quelle que soit la raison, cela peut-il menacer la reconnaissance d’un « consentement » ? Dans quelle mesure peut-on juger que le consentement est donc absent en raison de désaccords ?
En août 2014, le ministère chinois de la Culture a mis au ban public la proposition de la quatrième proclamation à la liste nationale du PCI. Sur cette liste se trouve une école de Taïchi dite « de Zhang Sanfeng »; ce dernier, étant un personnage mythique de la littérature populaire connu pour être un grand maître de Taïchi, est honoré par des écoles de Taïchi en tant que leur « maître fondateur ». Très vite, des représentants de l’école de Taïchi « Chen », inscrite à la liste nationale lors de la première proclamation, se sont manifestés pour questionner l’identité réelle du « maître Zhang » ainsi que ses véritables contributions à cet art martial. Finalement, dans la proclamation à la liste nationale faite par le gouvernement central en novembre cette année, « Taïchi de l’école Zhang » fut retiré, compte tenu d’un désaccord important de la communauté pratiquante de Taïchi[44].
Dans un autre exemple, cette fois-ci en France pour la Grande troménie de Locronan (département Finistère), le dossier d’inscription à la liste nationale, préparé et proposé au ministère français de la Culture par un ethnologue fonctionnaire travaillant à Locronan, fut suspendu en raison du refus des villageois, en particulier propriétaires fonciers des terrains par lesquels passe habituellement la procession, « par crainte d’un tourisme de masse et en raison d’un sentiment de dépossession » (de leur tradition culturelle)[45]. Comme dans l’exemple chinois, il s’agit de l’absence du consentement au sein de la communauté pour l’inscription à une liste nationale.
Néanmoins, toutes les contestations n’ont pas abouti aux mêmes résultats. Dans la pratique de l’UNESCO, il existe des cas où le consentement est contesté, mais sans entraver l’inscription. En 2010, l’Arménie a déposé un dossier d’inscription à la liste représentative de l’UNESCO intitulé « Symbolisme et savoir-faire des Khachkars, croix de pierre arméniennes ». Lors des discussions sur ce dossier à la cinquième session du comité intergouvernemental du PCI, une lettre au nom du chef du Bureau national de la propriété intellectuelle de l’Azerbaïdjan a circulé, demandant de ne pas inclure l’élément dans la liste représentative, car « cela peut constituer une violation de la propriété intellectuelle de la communauté oudine d’Azerbaïdjan, et d’une manière générale, du peuple azerbaïdjanais[46] ». La lettre a suscité un débat vif lors des discussions du comité. En effet, l’art de sculpter des croix de pierre est aussi pratiqué en Azerbaïdjan, et celui-ci considérait qu’il s’agissait d’un art traditionnel originaire des Oudis. Compte tenu des relations historiques et politiques particulières entre ces communautés en question, la contestation de l’Azerbaïdjan a pris un tournant largement politisé. Finalement, le comité du PCI a décidé d’inscrire le dossier à la liste de l’UNESCO, mais avec les deux parties de son nom inversées, devenu « L’art des croix de pierre arméniennes. Symbolisme et savoir-faire des Khachkars », afin de mettre en avant les caractéristiques spécifiques de cette pratique en Arménie, et de justifier ainsi sa distinction à l’égard des pratiques similaires des pays voisins[47].
Un autre exemple est le dossier de « La diète méditerranéenne ». Après le dépôt de ce dossier de candidature par sept pays méditerranéens, des associations folkloriques de la Grèce (Crète) ont déposé une lettre de contestation au Comité intergouvernemental. Les organisations signataires estimaient que l’idée de « régime méditerranéen » était un concept très récent découlant au départ d’études médicales et exploité par la suite à des fins commerciales, et que les similitudes entre les produits alimentaires ne suffisaient pas à justifier « une culture alimentaire commune », et concluaient ainsi que l’inscription de l’élément ne contribuerait pas à promouvoir le respect de la diversité culturelle fondé sur l’égalité et le respect mutuel. En déclarant cela, ces associations remettaient en question l’existence même d’une « communauté » de pratique alimentaire[48].
Un troisième exemple concerne la pratique de la fauconnerie. Ce dossier a été proposé en 2010 par 13 pays à travers l’Europe, l’Asie centrale et l’Asie de l’Est. Lors de la discussion au Comité intergouvernemental, deux associations venant de Belgique, pays candidat pour l’élément, faisaient valoir que la fauconnerie n’était nullement un élément identitaire des communautés française et flamande de Belgique, mais plutôt une activité marginale, souvent un privilège des riches et ignorée par, voire interdite à la grande majorité de la population. Ainsi, cette candidature n’impliquait pas la pleine participation des communautés de Belgique et ne bénéficiait pas de leur assentiment. Les signataires soulignaient également que l’inscription pourrait avoir des conséquences néfastes pour l’environnement en encourageant le plus ample développement de la fauconnerie[49].
Si aucune de ces trois contestations n’a été retenue pour des raisons différentes, d’une manière générale, on constate que pour l’UNESCO, le « consensus absolu » au sein de la communauté n’est pas une condition obligatoire pour que la condition de CLPE soit considérée remplie. En réalité, pour n’importe quelle communauté à grande population et/ou transfrontalière, un « consensus absolu » est impossible à obtenir techniquement. Cependant, la voix du « contre » est plus facile à saisir et apprécier. C’est pour cela que les Directives opérationnelles permettent aux communautés de s’exprimer lors de l’inscription, et si la protestation est suffisamment convaincante, elle peut influencer l’inscription, tel est le cas de la croix arménienne. D’un autre côté, bien qu’il n’existe pas d’obligation internationale, les expériences démontrent que les États peuvent aussi prendre en considération dans leur décision l’absence d’un consentement suffisamment large, comme les cas des listes nationales chinoise et française, même s’il s’agit de cas particuliers et non d’une règle systématisée.
B. Règles de CLPE dans le droit international de l’environnement et des ressources naturelles
Comme étudié auparavant, le principe de CLPE a fait un tournant en droit international de l’environnement à cause des phénomènes de « biopiraterie » dans les années 1970-80. Certains pays atteints par ces phénomènes ont cherché à protéger l’accès à leur patrimoine biologique ainsi que les connaissances traditionnelles qui y sont associées, et réclamé le partage des bénéfices en cas d’exploitation commerciale, tant par leurs législations domestiques que par le droit international[50]. C’est donc par l’article 8 (j) de la Convention « biodiversité[51] » que l’on constate une manifeste adhésion au principe de CLPE (avec les termes « accord et la participation des dépositaires ») en ce qui concerne l’accès aux connaissances traditionnelles, une partie du PCI[52] des communautés qui les détiennent et pratiquent.
Néanmoins, l’expression « sous réserve des dispositions de sa législation nationale » employée par l’article 8 (j) suggère que les États disposent toujours du pouvoir de décision; l’article n’accorde pas de droit de veto aux communautés en ce qui concerne la collecte et l’utilisation de leur patrimoine, mais juste un droit de participation[53]. C’est aussi la raison pour laquelle certains considèrent que la Convention « biodiversité » est un document pour déterminer « qui a le droit d’exploiter les ressources naturelles génétiques et les savoirs traditionnels », et non pas uniquement dédié à protéger la diversité biologique[54].
Ainsi, des efforts ont été déployés afin de renforcer l’application du principe de CLPE introduit par l’article 8 (j). Après une première tentative – les Lignes directrices de Bonn[55] qui n’ont pas été une véritable solution en absence de forces contraignantes, l’Assemblée générale de la convention a adopté, le 29 octobre 2010, le Protocole de Nagoya (Protocole) sur l’accès et le partage des avantages[56]. Entré en vigueur le 12 octobre 2014, le Protocole compte déjà cent deux membres en mars 2018[57], ce qui démontre l’importance des intérêts qu’il représente pour les pays. Concernant les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques des communautés autochtones et locales, l’article 7 du Protocole, avec un langage très clair, exige que l’accès soit soumis au « consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation » des communautés, et que des conditions convenues d’un commun accord soient établies[58]. Le texte de l’article 7 doit être considéré comme ayant établi un droit de veto pour les communautés détentrices de connaissances traditionnelles, même s’il reste aux États de trouver les « mesures appropriées » pour garantir l’exercice de ce droit dans l’ordre interne. Par ailleurs, les parties doivent aussi tenir compte du droit coutumier des communautés autochtones et locales ainsi que de leurs protocoles et procédures, pour tout ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques (article 12). Plus important encore, ce texte n’exclut pas les connaissances et informations qui se trouvent déjà dans le « domaine public » en sens de la propriété intellectuelle, ce qui donne la possibilité pour les États d’exiger, via leur droit domestique, le CLPE aussi pour les connaissances traditionnelles qui ne sont pas protégées par la propriété intellectuelle. Le Protocole de Nagoya représente une étape importante en reconnaissant le pouvoir des communautés traditionnelles de gérer leur propre savoir[59].
Même si l’on doit admettre que la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles règne encore et toujours en droit international, il faut aussi reconnaître que les règles du Protocole de Nagoya appliquent le principe de CLPE de manière certaine, en donnant le droit de veto aux communautés sur l’accès, donc sur la possibilité de collecter et d’exploiter des connaissances traditionnelles, à condition, bien entendu, que ces droits restent dans le cadre de l’ordre interne des États souverains. En effet, que ce soit pour la Convention « biodiversité » et son Protocole ou encore pour la Convention de 2003, la véritable application du principe de CLPE est encore soumise au bon vouloir des États pour élaborer les mécanismes de droit interne.
III. Pratiques nationales de CLPE
Parmi les pratiques nationales de collecte du PCI observées, on peut récapituler deux catégories de pratiques de CLPE : donné au nom d’un particulier, ou donné au nom d’une communauté. Ces deux catégories correspondent aussi aux narratives de la Convention de 2003 : les PCI sont détenus et pratiqués par les « communautés, groupes ou particuliers ». En même temps, ces deux catégories de pratiques doivent envisager chacune ses propres difficultés.
A. Consentement donné par un particulier : Question de délimitation des droits du particulier
Dans de nombreux cas, le consentement exigé par les recensements nationaux se manifeste par l’accord donné par un particulier d’enquêté pour réaliser la collecte de donnée (appelé « informant » selon le terme de l’anthropologie), c’est le cas par exemple de la France, de la Chine et de l’Italie. Cet accord est généralement consenti oralement, après une explication de l’enquêteur concernant le renoncement aux droits financiers, notamment les droits d’interprète en propriété intellectuelle, et au droit à l’image. En Chine, il s’agit d’une obligation légale : la Loi sur le patrimoine culturel immatériel[60] demande aux enquêteurs, dans son article 16, « d’obtenir l’accord de la personne enquêtée, de respecter les coutumes qui lui sont applicables ainsi que ses droits et intérêts ».
En principe, les communautés, en raison de leur « sentiment d’identité et de continuité » attaché à leur PCI, sont les détentrices des droits les plus qualifiées; il semble donc aussi que le consentement de collecte, d’accès ou d’utilisation d’un élément de PCI doive être donné par la communauté détentrice. Néanmoins, l’acte de donner le consentement, comme la pratique même d’un élément culturel, est toujours véhiculé et expressément affirmé par une personne physique. Pour la communauté, la question hautement sensible de légitimité se pose donc, pour savoir « qui peut représenter la communauté[61] » : une question largement plus universelle que les autres dans le domaine du PCI.
1. Le consentement donné par un particulier peut porter atteinte aux droits de la communauté
Pour les communautés qui ont une vie sociale hautement organisée, telles que les communautés tribales ou religieuses, la question de légitimité reste relativement simple en raison de l’existence d’un mécanisme de décision, une solution coutumière et un porte-parole. Mais pour les communautés qui s’attachent avant tout à des pratiques communes et moins marquées par une organisation sociale interne, la question devient plus complexe. En 2016, la chaine de télévision centrale de Chine a diffusé une émission de culture culinaire; les participants arrivaient avec une recette et démontraient leurs arts dans le but de chercher soit un emploi, soit un investissement, ou de vendre la recette. Une jeune femme du groupe ethnique minoritaire Miao, après avoir présenté une recette traditionnelle Miao, a clarifié sa motivation : elle ne pouvait pas vendre la recette, car cette dernière est une tradition culturelle et appartient donc à l’ensemble de sa communauté. Il s’agit là d’une question de représentativité : cette jeune femme considérait qu’elle n’avait pas l’autorisation de sa communauté à disposer de ce bien (une information qui peut être commercialisée); ce dont elle pouvait disposer, était uniquement la mise en pratique de cette information qu’elle maîtrisait, ainsi que les bénéfices financiers qui pouvaient lui revenir en raison de sa mise en pratique.
On en revient ici à une question juridique d’ordre général : seul le titulaire du droit peut disposer de ce droit. Un particulier ne peut disposer uniquement d’un bien ou d’un droit dont il est lui-même détenteur, et dans notre sphère de discussion, uniquement les droits et intérêts engendrés par ses propres pratiques d’un élément de PCI. Ainsi, s’agissant de la collecte et de l’accès du PCI, quelle est la valeur juridique d’un consentement donné par un particulier au regard de l’ensemble de la communauté ? Cela nécessite encore davantage de discussion.
Sur cette question, l’une des plus anciennes bases de données de PCI, le Honey Bee Network a proposé un prototype de document de CLPE méritant une étude approfondie. Le Honey Bee Network est fondé par le National Innovation Foundation, une fondation publique gérée par le ministère indien de la Science et des technologies. C’est une base de données de connaissances et savoir-faire traditionnels dont l’objectif n’est pas uniquement la préservation, mais avant tout d’encourager la création et l’innovation fondées sur les connaissances et savoir-faire anciens, ainsi que d’aider les communautés traditionnelles de recevoir des bénéfices sur les créations inspirées par leurs traditions. Plus concrètement, les particuliers « informants », parfois se réclamant représentant de leur communauté, déposent soit une connaissance ou un savoir-faire traditionnel, soit une innovation fondée sur ces derniers, et proposent à l’industrie de le mettre en valeur commercialement. D’un autre côté, cette base de données vise aussi à mettre volontairement certaines informations dans le domaine public, et ainsi de prévenir l’obtention de brevets par autrui par un effet de « vaccin », puisque la publication via la base de données construit un « état de la technique existante » qui empêchera la qualification de la nouveauté. Le Honey Bee Network est considéré comme étant la première tentative d’imposer un CLPE lors de l’utilisation d’un savoir traditionnel par un industriel[62].
Le Formulaire de consentement[63] utilisé par cet organisme comprend les éléments suivant : la révélation de l’origine de l’information (particulier, groupe ou communauté, afin d’identifier le détenteur de droit économique); le niveau de transparence des informations (divulgation totale ou partielle) concernant les connaissances et savoir-faire traditionnels à l’origine de l’innovation ; le mode de partage équitable des intérêts lors des activités commerciales; l’option concernant la possibilité de transférer les savoirs ou innovations à la National Innovation Foundation. Si l’informant donne l’accord de s’engager dans des activités commerciales, ce formulaire autorise aussi la Fondation à négocier avec les investisseurs en tant que mandataire de l’informant ou de la communauté à laquelle il appartient. La Fondation fournit aussi le soutien juridique lors des différends avec une tierce personne dans toutes activités en rapport avec la mise en valeur, l’utilisation commerciale et l’innovation fondée sur les connaissances et savoir-faire traditionnels.
Cette première tentative de CLPE par écrit a reçu des éloges bien mérités, mais a également soulevé des interrogations, la plus importante étant : bien que les droits sur le contenu de l’innovation appartiennent à la personne informante, cette dernière peut décider de mettre à la lumière un savoir ou savoir-faire traditionnel issu de sa communauté qui était inconnu du monde, et cela fondé uniquement sur son jugement personnel de la situation. En théorie, le Honey Bee Network reconnait aussi que les savoirs ou savoir-faire traditionnels appartiennent à la communauté où ils sont nés et pratiqués. Or, à l’analyse du Formulaire de consentement, la communauté n’a souvent aucun droit de parole dans la décision de divulgation d’informations ou le niveau de transparence des informations. Le paragraphe premier du formulaire de consentement demande à l’informant de révéler la provenance du savoir ou savoir-faire en question en choisissant parmi quatre options : A) Personnes âgées (de la communauté); B) autodidacte; C) Tradition familiale; D) Communauté. Seulement lorsque l’option D est sélectionnée, l’informant doit préciser l’identité du chef (« leader ») de la communauté en question. Le formulaire précise qu’il est « préférable » d’obtenir le consentement en connaissance de cause de ce chef de communauté, mais cela n’est pas une condition obligatoire vu les termes employés. Compte tenu du fait qu’un savoir ou savoir-faire traditionnel est fort probablement transmis au sein de la communauté via la vie familiale, afin de rendre la tâche administrative plus simple, une personne pourrait tout à fait honnêtement privilégier l’option A ou C à l’option D qui demande de fournir d’autres réponses voire preuves. Ce Formulaire demande l’accord de la communauté uniquement lorsque le savoir ou savoir-faire traditionnel en question n’est pas encore dans le domaine public et que la personne qui le dépose n’a pas apporté d’innovation à cet élément; mais aucune précision n’est donnée concernant comment déterminer si un élément est déjà dans le domaine public, ni comment l’accord de la communauté doit être présenté et reconnu comme tel.
Ainsi, en réalité, dans le mécanisme du Honey Bee Network, un particulier peut dans la majorité des cas prendre la décision de divulgation à la place de sa communauté, que cette divulgation soit partielle ou totale. Il n’existe pas de véritable pare-feu structural prévu, mis à part éventuellement un contrôle de forme par le personnel de Honey Bee Network qui ne repose que sur le libre arbitrage en absence de critères établis en amont. En effet, lorsqu’un particulier est mis à une place si importante consistant à décider si les savoirs ou savoir-faire de sa communauté doivent être divulgués, il est amené à disposer d’un droit qui ne lui appartient pas. Quand il s’agit des recensements entrepris par les autorités publiques, cela pourrait probablement être justifié par la souveraineté de l’État; mais quand cette divulgation est à but commercial, ou touche la sensibilité ou le secret culturel de toute la communauté, la décision d’un particulier pourrait être la cause de l’utilisation illégitime ou culturellement offensante, ce qui représente certainement l’une des plus grandes menaces pour le PCI.
2. Le consentement donné par un particulier ne peut pas protéger ses propres intérêts
Bien entendu, qu’un élément culturel soit préservé par une communauté dans son ensemble ou par quelques particuliers, les activités concrètes de conservation reposent sur les particuliers praticiens : il faut toujours que les particuliers démontrent, expliquent, racontent, pour que ces éléments soient transmis, étudiés, enregistrés et conservés. Dès les années 1980, les ethnologues ont, dans leurs enquêtes du terrain, identifié les particuliers dans leurs deux rôles : à la fois « informant » et « performeur[64] ». En réalité, dans de nombreux systèmes juridiques, non seulement le contenu de la « performance » est protégé en tant que PCI, la performance elle-même forme également un objet de droit; le particulier « performeur » détient ainsi les droits en tant qu’artiste interprète et exécutant par la propriété intellectuelle. Lorsqu’un particulier exprime son consentement pour la démonstration d’un élément de PCI lors de la collecte, il renonce en réalité à deux types de droit : premièrement le droit économique, ou plus précisément ses droits en tant qu’interprète[65]; deuxièmement le droit moral, ou le droit à l’image et à la vie privée qui s’attache à la personnalité de l’informant-performeur.
Une question qui se pose dans cette hypothèse de consentement donné par un particulier est le droit voisin en tant que « performeur », ou interprète-exécutant. Par exemple, dans les enquêtes de PCI organisées par la région italienne de Lombardie[66] et dans la préparation des dossiers par l’État français[67] pour l’inscription à la liste représentative de l’UNESCO, les informants-performeurs sont aussi invités à signer un consentement individuel à l’écrit, qui autorise les administrations culturelles à traiter, analyser et utiliser les données collectées dans la recherche, l’éducation et la communication sous toute forme légale.
Si le renoncement des droits économiques lors de l’usage pour intérêt public est devenu une norme, l’autre aspect du sujet, les droits moraux du performeur, reste à discuter. Actuellement, outre le droit de paternité (de signaler l’identité de l’informant-performeur), aucune autre pratique du droit moral n’a été observée. Néanmoins, les activités de collecte et de traitement des données peuvent en effet poser problème de droit pour les informants-performeurs, telles que les images dissimulées, les expressions modifiées par le montage, ou bien la demande de l’anonymat non respectée. Si pour certains pays, le droit commun concernant la liberté d’information et la vie privée des citoyens peut toujours proposer une protection à l’informant-performeur, pour nombreux autres, comme la Chine, pour les recensements et enquêtes publics, le CLPE reste sur un accord d’enregistrement, sans mentionner aucun droit à titre personnel.
Il convient ainsi de conclure que, le CLPE donné par l’informant-performeur peut difficilement protéger les droits de la personne, ce qui est pourtant un intérêt également légitime. Dans le contexte des collectes nationales, l’exigence de CLPE semble avant tout avoir pour objet de protéger l’administration culturelle ou, quand il est applicable, l’entité privée qui réalise l’enquête du PCI, afin d’éviter les contentieux dans le futur. C’est sans doute la raison pour laquelle, même si l’individu est mis en avant comme étant le détenteur et praticien du PCI par l’article 2 de la Convention de 2003, dans l’article 11 concernant l’obligation nationale de l’inventaire du PCI, le texte de la Convention ne mentionne que « la participation des communautés, des groupes », sans le terme « individu ». Selon les principes de l’interprétation des traités, cette différence de formulation doit être analysée comme la position de la Convention que l’individu ne doit pas être mis en avant lors du dressement de l’inventaire.
Une solution plus prudente sera de ne reconnaître l’effet juridique du CLPE donné par un particulier uniquement dans la collecte de données du PCI par un organe public; tandis que pour les collectes privées de données du PCI et les activités à but commercial, il serait judicieux de privilégier le CLPE donné au nom de la communauté, quel que soit le mécanisme de décision et de représentation de la communauté en question. En Chine par exemple, depuis la Loi sur le patrimoine culturel immatériel[68], afin de réaliser des enquêtes, les entités et particuliers étrangers doivent obtenir une autorisation de l’administration culturelle au niveau provincial où l’enquête est projetée; lorsque l’enquête concerne plus de deux provinces, l’autorisation est donnée par le ministère de la culture. Pour obtenir cette autorisation, l’enquête doit être réalisée en collaboration avec une institution de recherche scientifique chinoise[69]. Sans l’autorisation administrative préalable, même avec le CLPE de la personne enquêtée[70], l’enquête est illégale. Ainsi, dans le cas de collecte pratiquée par une personne ou entité étrangère, le consentement des enquêtés (communauté et ses membres) a une valeur inférieure à l’autorisation de l’administration culturelle.
Évidemment, la Chine n’est pas le seul pays qui prend cette position. La Papouasie–Nouvelle-Guinée[71], comme le Vanuatu[72], a choisi la même stratégie. Ici, l’État décide de représenter lui-même la communauté du « Peuple chinois », ou « Peuple papouasien ». Si cette solution semble justifiée pour éviter que l’intérêt de l’ensemble de la communauté ne soit atteint par des actes d’intérêt personnel (abus de droit des particuliers), la question se pose tout de même concernant la relation entre l’État et la communauté.
B. Consentement donné par la communauté : Relation entre l’État et la communauté
Si le principe de CLPE est devenu aujourd’hui une obligation internationale de la Convention « biodiversité » et de la Convention de 2003, la mise en application de cette obligation se repose sur les États. Il importe donc, pour les États, de remanier leurs systèmes internes concernant l’accès des ressources naturelles et culturelles ainsi que le mécanisme de partage des intérêts, afin de rétablir la place centrale des communautés.
Or, cela conduit nécessairement à la question fort sensible de la relation juridique entre l’État et les communautés, notamment les communautés autochtones. Pour beaucoup, il en est question de l’autodétermination, et donc de la reconnaissance des droits territoriaux et de la souveraineté permanente des communautés autochtones sur les ressources naturelles[73]. Il est indéniable qu’il existe une tension entre les notions mêmes de « communauté » et d’« État-Nation » moderne. Ce dernier est souvent très vigilant voire hostile envers la notion de communauté, cette tendance s’est traduite dans les travaux préparatoires de la Convention de 2003, où l’on observe que le qualificatif « autochtone » derrière « communauté » a été soigneusement éliminé à la suite des débats longs, laborieux et minutieux autour du choix de la terminologie[74].
En dehors de cette tension à dimension territoriale très connue et débattue, la reconnaissance du rôle de communauté en tant que gardien et praticien des éléments de PCI, amène aussi à la question du pouvoir de contrôle des ressources naturelles et culturelles. Si la doctrine généralement acceptée du droit international attribue le pouvoir permanent sur les ressources naturelles uniquement à l’État souverain, il n’en est pas ainsi pour les ressources culturelles, le PCI. Au contraire, la Convention « biodiversité » et son Protocole de Nagoya comme la Convention de 2003 reconnaissent le droit de participation des communautés. Ainsi, si la volonté de l’État et celle de la communauté sont en conflit, qui détient le pouvoir de décision ? Même si le droit international s’intéresse aujourd’hui fortement à cette question, à ce jour, cela reste d’abord une question de droit domestique constitutionnel.
Les pays ont choisi de répondre différemment à ce défi. Certains États unitaires, comme la Chine, donnent clairement ce pouvoir par la Loi à l’État et aux régions, sans mentionner la communauté.
La loi indienne de 2002 sur la diversité biologique[75] quant à elle, a établi un système de partage de pouvoir entre l’État et les fédérés. Le pouvoir de décision reste dans la main de la National Biodiversity Authority (NBA) qui représente l’État lorsque la demande de l’accès vient d’une personne étrangère, ou de la State Biodiversity Board (SBB) qui représente le fédéré lorsque la demande d’accès vient d’un citoyen indien[76]. Mais à la différence du système chinois, cette Loi a créé les Biodiversity Management Committees au niveau administratif local qui incluent et représentent les groupes tribaux et communautés locales[77]. Ces comités sont consultés par la NBA et les SBB lorsqu’une demande d’accès aux ressources naturelles et connaissances traditionnelles qui y sont associées concerne ces communautés (art. 41-2). Il faut néanmoins noter que ce droit d’être consulté ne peut être confondu avec le droit de veto : si les communautés représentées par le comité donnent leur avis, ce dernier n’est ni systématique, ni décisif.
Le projet de loi de la Malaisie sur l’accès aux ressources biologiques adopte une politique très différente[78]. Dans ses articles 15 et 18, la loi indique clairement que tout accès aux ressources naturelles et connaissances traditionnelles à but potentiellement commercial nécessite un permis délivré par une autorité compétente établie par ce projet de loi, et que le permis doit porter obligatoirement la mention que le « consentement préalable et éclairé » de la communauté indigène et locale en question a été obtenu selon les conditions données par la loi. Il s’agit là d’un véritable droit de veto des communautés, même si la mise en oeuvre de la future loi reste à observer, compte tenu des conditions politiques complexes du pays.
De même, la Loi australienne Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulations de 2000[79] a établi le droit de veto aux communautés concernant l’accès aux ressources biologiques et les savoirs des peuples indigènes. Son article 8A.10 énonce :
Si les ressources biologiques auxquelles l’accès est demandé se trouvent dans une zone qui est la terre des indigènes et un fournisseur d’accès pour les ressources est le propriétaire du terrain ou un détenteur du titre indigène pour le terrain, le propriétaire ou le détenteur du titre indigène doit donner son consentement éclairé à un accord de partage des avantages concernant l’accès aux ressources biologiques[80]. [Notre traduction]
Et dans le cadre d’un accord de partage des avantages de ce genre, il est nécessaire d’identifier la source du savoir traditionnel, et prévoir la protection, la reconnaissance et la valorisation des connaissances des peuples autochtones à utiliser (article 8A.08). Dans cette condition précise, l’État n’a pas de contrôle direct sur le consentement donné; ce pouvoir est attribué par la loi aux communautés indigènes concernées par la demande d’accès. Et c’est seulement quand les communautés peuvent exercer un droit de veto sur l’utilisation de leur patrimoine naturel ou culturel qu’on peut dire qu’elles jouissent un véritable droit au consentement éclairé. Évidemment, dans ce cas, il est toujours question de déterminer le statut juridique de « communauté » qui peut bénéficier d’un tel droit; en Australie, il faut donc se conformer aux conditions de la Native Title Act[81] qui permet d’identifier les « indigènes ».
IV. Pratiques de CLPE des institutions culturelles
Outre les administrations culturelles, les institutions culturelles, telles que les musées, institut de recherche ou d’archives, ou organisations professionnelles internationales, en particulier quand elles travaillent dans le domaine d’anthropologie et de folklore, sont parmi les premiers à affronter à la question de CLPE, en raison de leur travail quotidien dans la collecte et la communication du PCI. Étant donné que les législations internationales et domestiques étaient soit absentes, soit peu précises sur cette question, les institutions culturelles ont progressivement formé leurs propres règles en reconnaissance du principe de CLPE. Ces règles se distinguent par deux caractéristiques : premièrement, elles sont des règles de déontologie, donc légalement non contraignantes; ensuite elles passent toutes par le consentement donné par un particulier. Malgré sa nature d’acte privé, les règles de déontologie sont en voie de créer des impacts dans différents pays, notamment via les activités des organisations internationales professionnelles.
A. Le Code de déontologie de l’ICOM
Le Conseil international des musées (ICOM), créé en 1946 à Paris, est une organisation non gouvernementale qui a pour mission de promouvoir et protéger le patrimoine culturel et naturel. Il est la seule organisation des musées et de professionnels des musées à l’échelon mondial. Avec trente mille membres répartis dans cent trente-sept pays, il est aussi un partenaire à long terme de l’UNESCO, organisation consultative du Conseil des affaires économiques et sociales des Nations unies[82].
L’ICOM est parmi les premières organisations professionnelles à l’échelon international qui s’intéressent à la question de déontologie. Il a publié son premier code de déontologie en 1986 (révisé en 2004)[83]. Un code de déontologie n’a généralement pas de force contraignante, mais dans ce cas précis, ce code fait partie des Statuts de l’ICOM, et en adhérant à l’ICOM, chaque membre s’engage à le respecter. L’ICOM en tant qu’association à but non lucratif soumise à la législation française, doit obéir au droit français en matière de contrat[84]. Ainsi, pour les membres de l’organisation, ce code est censé créer un effet normatif sur leur conduite.
La partie VI de ce Code se consacre à la question des communautés et y fait spécifiquement un développement sur la question de consentement, en particulier dans son paragraphe 6.5 intitulé « Communautés existantes » :
Si les activités du musée mettent en jeu une communauté existante, ou son patrimoine, les acquisitions ne doivent s’effectuer que sur la base d’un accord éclairé et mutuel, sans exploitation du propriétaire ni des informateurs. Le respect des voeux de la communauté concernée doit prévaloir[85].
Lue dans son contexte, l’expression « accord éclairé et mutuel » (dans la version anglaise « informed and mutual consent ») employé par ce Code n’est certainement pas un hasard, mais un reflet et une reconnaissance du principe de CLPE qui est devenu largement accepté. En devenant membre de l’ICOM, les professionnels de musées comme les institutions muséales sont tenus de respecter l’obligation de CLPE et d’obtenir l’accord des communautés lors de l’acquisition des objets et des informations. Pour les musées d’ethnologie et folklorique qui travaillent quotidiennement dans la collecte des données du PCI et des objets qui en forment véhicule, le fait de respecter le principe de CLPE est une démarche importante dans la protection des droits en rapport avec le PCI.
Bien que l’obligation soit très claire dans cet article, l’effet d’un code de déontologie reste limité. D’abord, n’étant pas une obligation légale mais un contrat, il ne peut lier que les membres de l’ICOM. Pour les collections privées, parfois très puissantes et qui choisissent de ne pas adhérer à l’ICOM, ce code n’a aucune force positive. Ensuite, même si l’ICOM est une organisation très influente en matière de patrimoine, face à l’irrespect de ses règlements, compte tenu de son statut d’association du droit français, il n’existe pas d’autres moyens de répression que l’expulsion de l’organisation. Au final, même si le code a réellement influencé les conduites des professionnels, il est d’une force morale et non pas légale. Enfin, concrètement, pendant le travail de collecte (d’objets ou d’informations), l’accord est donné par un particulier « informant » ou « propriétaire »; or cet accord n’équivaut pas toujours le consentement de la communauté dans son ensemble qui est pourtant l’objet de considération de cette partie VI du code de déontologie.
B. Pratiques des institutions culturelles américaines
Ces dix dernières années, que ce soit sur les plateformes internationales ou dans les discussions académiques internes, les États-Unis ne semblent pas être très engagés dans la question du PCI. Mais en réalité, un autre concept largement débattu aux États-Unis, celui de « folklore », est en relation très étroite avec le PCI. Partant des analyses des origines de la notion de PCI et de connotation et extension des deux notions, il convient de reconnaître aujourd’hui que le folklore fait partie de la notion, bien que plus récente, de PCI[86]. En réalité, il convient de dire que le concept de PCI a apporté un renouveau à l’étude folklorique en tant que matière scientifique, et aujourd’hui, le PCI est considéré comme le principal objet d’étude des folkloristes et anthropologues[87]. C’est clairement la raison pour laquelle les institutions américaines qui se sont intéressées à la question de PCI ont toute une longue tradition dans le domaine de folklore, notamment celles qui travaillent sur les « Amérindiens », ou les communautés autochtones d’Amérique. Trois institutions qui ont travaillé sur la question de PCI doivent être nommées ici : American Folklore Society, the American Anthropological Association, et Amarican Folklife Center.
Fondée en 1902, l’American Anthropological Association (AAA) est l’une des plus importantes organisations scientifiques sur l’anthropologie au monde. L’association qui s’intéresse aussi à la question de l’éthique professionnelle a publié une déclaration d’éthique intitulée Principles of Professional Responsibility (2012)[88]. Le principe 3 de ce texte est consacré à la question de consentement :
Principe 3 : Obtention de consentement éclairé et permission nécessaire. Les chercheurs en anthropologie qui travaillent avec des communautés de personnes doivent obtenir le consentement volontaire et éclairé des personnes participant à leur recherche. […] Les anthropologues ont l’obligation de s’assurer que les enquêtés ont donné leur consentement de manière libre, et doivent éviter de conduire des recherches dans des circonstances où le consentement peut ne pas être donnée de manière véritablement volontaire ou éclairé[89]. [Notre traduction].
Ces principes donnent une orientation claire dans le travail au quotidien des anthropologues sur leur terrain d’enquête. Mais contrairement au code de déontologie de l’ICOM, ce texte de « principes généraux » ne fait pas partie du statut (Bylaws) de l’association et reste une déclaration (Statement on Ethics). Ainsi, il n’a pas de valeur normative et ne constitue pas d’obligation pour les membres de l’association. Par ailleurs, l’association est consciente de ce fait et déclare dans le préambule de ce texte que « ces principes sont destinés à encourager la discussion, à guider les anthropologues dans la prise de décisions responsables », et déclare qu’elle « ne se prononce pas sur les affirmations de comportement contraire à l’éthique[90] ».
L’American Folklore Society a également participé à l’étude et à la conservation du PCI au niveau international[91]. En 2006, l’association a publié un document de position concernant la question de CLPE dans le travail de folkloristes[92]. Ce document se réfère aux règles du Code des règlements fédéraux[93] dans son article 45 CFR 46.116, les « lois administratives », et affirme que les enquêtes folkloristes respectent aussi le principe de CLPE qui y est mentionné, mais avec quelques réserves concernant les particularités du métier de folkloristes, par exemple la question de consentement écrit ou oral. Selon la section 46.116, une recherche impliquant un être humain comme sujet ne peut avoir lieu qu’à condition d’obtenir « le consentement éclairé juridiquement valide de l’intéressé ». Pour obtenir ce consentement, l’enquêteur doit garantir à l’enquêté « une possibilité suffisante de décider de participer ou non » et de « minimiser les possibilités de coercition ou d’influence indues ». L’information donnée doit être « dans une langue compréhensible pour le sujet ». Enfin, le consentement ne doit inclure un « langage disculpatoire par lequel le sujet renonce ou semble renoncer à l’un de ses droits légaux, ou libère ou semble libérer l’investigateur, le sponsor, l’institution ou ses agents de la responsabilité pour négligence[94] ».
Le contenu du Code des règlements fédéraux est considéré comme étant aussi contraignant que des lois selon la doctrine dite de Chevron[95]. Cet article 45 CFR 46.116 vise clairement à protéger les droits civils des citoyens au regard des autorités publiques, faisant ainsi une interprétation et application strictes du principe de CLPE. S’il est respecté, cet article peut en effet offrir une véritable protection aux communautés et éviter l’accès aux connaissances traditionnelles ou secrets culturels sans autorisation. En revanche, ce règlement s’applique aux activités de recherches soutenues, entreprises ou gérées par les institutions publiques (« Federal department or agency[96] »). La société américaine de folklore étant une personne morale privée, les recherches qu’elle et ses membres entreprennent ne sont pas systématiquement soumises au règlement 45 CFR 46.116. Si la société a choisi de le mettre dans une déclaration de position, c’est qu’elle considère que ce règlement doit être appliqué aussi aux recherches folkloriques, même avec certaines réserves en raison des particularités de la matière scientifique.
Enfin, contrairement aux deux organisations précitées, l’American Folklife Center de la Librairie du Congrès est une institution publique établie par une loi de 1976[97]. Son objectif est de « préserver et présenter la vie folklorique américaine » à travers des programmes de recherche, documentation, expositions et publications. Établi dans la Division de la musique de la Bibliothèque du Congrès en 1928, le centre dispose de l’une des plus grandes archives de matériel ethnographique des États-Unis et du monde entier, avec une vaste documentation sur les arts traditionnels, les expressions culturelles et les histoires orales de diverses communautés[98].
En raison de ces longues traditions académiques d’anthropologie au sens large, le centre s’attache fortement à la question d’éthique, et aussi au rapport entre les chercheurs et leurs « consultants », les personnes membres des communautés. L’un des travaux les plus importants du centre est d’informer les communautés indigènes concernant les enquêtes et la documentation de leur patrimoine culturel[99]. Dans la section « Guide de documentation culturelle » de leur site Web officiel, le centre se prononce clairement sur la question de consentement, en rappelant aux communautés et aux enquêteurs qu’il s’agit d’une condition nécessaire. Dans ce Guide, l’éthique professionnelle est décrite comme étant une « préoccupation centrale » pour le métier d’anthropologie, en citant les codes d’éthique des deux organisations précitées[100]. Le centre n’a pas de code d’éthique, mais considérant son statut juridique d’institution publique de recherche, ses activités quotidiennes sont soumises à l’article 45 CFR 46.116 ci-dessus discuté.
En conclusion, il n’existe pas de règle de CLPE concernant l’accès et la collecte des données de PCI dans la législation américaine, mais en réalité, les principales institutions de recherche qui s’intéressent à la question de PCI, en particulier les trois institutions présentées ici, ont pu inclure la majorité des chercheurs dont le travail couvre le domaine du PCI. Ainsi, à travers leurs codes d’éthique ou l’application des règlements administratifs, le principe de CLPE est d’une manière générale respecté dans les recherches scientifiques en rapport avec le PCI entretenues aux États-Unis.
C. Pratiques des Archives sonores de la British Library
Les archives sonores de la British Library constituent la plus grande collection du même type dans le monde. Les données proviennent surtout des collectes des anthropologues anglais lors de leurs enquêtes de terrain dans le monde entier. La collection contient plus de 3.5 millions enregistrements, couvrant les expressions culturelles, histoire orale, langues, ainsi que des sons naturels venant de nombreux pays au monde. Parmi ces enregistrements, 80 milles sont déjà accessibles librement en ligne, tandis que le projet de numérisation est encore en cours[101]. Lorsque la bibliothèque a commencé en 2004 à numériser ses enregistrements afin de les mettre en ligne, elle a réalisé en amont une réflexion approfondie sur la question de sensibilité culturelle et des droits des communautés.
Avec la collaboration de l’Organisation mondiale de la propriété culturelle, la bibliothèque a conçu un document intitulé Legal and Ethical Usage, dans lequel il est déclaré : la British Library a numérisé ces collections d’enregistrements et les a rendues disponibles uniquement dans le but de la sauvegarde, de la recherche non commerciale, de l’étude et de l’utilisation privée. Les collections comprennent des matériaux culturellement sensibles, parmi lesquels des enregistrements sonores ethnographiques. Ces enregistrements ne doivent pas être utilisés de manière à transgresser les droits des communautés autochtones et locales qui sont les gardiens traditionnels des éléments de PCI incorporés dans les enregistrements sonores. Alors que la British Library, ou autres contributeurs à ses collections, peuvent être titulaires de la propriété intellectuelle des enregistrements sonores et de leurs résultats numérisés en raison de leur contribution, la bibliothèque reconnaît que les droits et intérêts plus larges du PCI, y compris la musique traditionnelle et autres matériaux créatifs incorporés dans les enregistrements sonores peuvent, en vertu des lois nationales, coutumières et autres, appartenir aux « gardiens traditionnels » (traditional custodians) de ces matériaux. Par conséquent, le CLPE de la British Library et/ou d’autres tiers contributeurs, ainsi que des gardiens traditionnels, sont requis pour la republication et l’utilisation commerciale d’une partie ou de la totalité de ces documents[102].
Cette déclaration de la British Library est présentée avec une conscience claire de la question de « sensibilité culturelle », en citant explicitement les droits des « communautés » envers leur « patrimoine culturel immatériel », et cette exigence de consentement préalable est donc un exemple adéquat de pratique du principe de CLPE dans le domaine du PCI.
***
Il convient de se rappeler que dans la plupart des cas existants comme étudiés, les collectes des données de PCI ont pour objectif de s’ouvrir au public, au moins partiellement. Avec les collectes de plus en plus amples, et surtout l’avancement de la numérisation des PCI, il devient aussi facile d’accéder aux PCI des communautés et de les exploiter, entrainant ainsi différents risques. Dans ces conditions de véritable nécessité sociale, l’existence d’une procédure de CLPE, ne serait-ce qu’une simple signature, peut largement sensibiliser les communautés, réduire les risques d’utilisation déformante et culturellement offensante, et à certain degré éviter la divulgation de secret culturel, parfois susceptible aussi d’être secret commercial, comme nous l’avons observé dans le cas du Honey Bee Network. D’un autre côté, l’État en tant que gardien du patrimoine peut aussi bénéficier de ce principe pour réduire les risques de gestion. Ainsi, que ce soit en partant de la protection des communautés, ou de la prévention du gaspillage des ressources publiques, il importe de mettre en application le principe de CLPE dans les collectes des données du PCI. C’est pour cela que le principe de CLPE des communautés est devenu une condition obligatoire pour la communication d’un élément de PCI au plan international (la Convention de 2003), et pour l’accès et l’utilisation des connaissances traditionnelles des communautés associées aux ressources biologiques (la Convention « biodiversité »).
Néanmoins, il semble encore prématuré aujourd’hui de définir le « CLPE » comme un droit collectif des communautés, car la majorité des auteurs considèrent que ce principe requiert en amont une reconnaissance du droit à l’autodétermination, de même que leurs droits territoriaux et leur souveraineté permanente sur les ressources naturelles[103]. On constate, à travers l’exemple de la Convention de 2003 et de la Convention « biodiversité » que, ce principe a pu prendre effet uniquement sous la condition de ne pas remettre en cause la souveraineté de l’État, ni soutenir la dimension extérieure du droit à l’autodétermination des communautés autochtones. Le recours à des dispositions législatives internes, tels que les cas indien ou australien s’inspirant des développements en droit international en la matière, semble aujourd’hui encore le moyen à privilégier pour mettre en oeuvre le principe de CLPE dans le domaine du PCI[104].
Si ce principe de CLPE a pu émaner de longues négociations internationales au profit des communautés via un processus « ascendant » pour former des traités internationaux et influencer l’ensemble de leurs membres qui étaient moins sensibles à la question, pour mieux mettre en oeuvre la surveillance de « sortie » que le CLPE propose, et pour qu’il puisse véritablement bénéficier aux communautés comme aux États eux-mêmes, il faut encore que les États, à travers un processus « descendant[105] », adoptent ce principe de CLPE dans leurs législations internes en tant qu’obligation de résultat, définissant les procédures et conditions claires de dévoilement d’information pour la collecte des données de PCI, ainsi que les conditions de partage des avantages. Enfin, il faut régler la question de la représentation de la communauté, et trancher dans quelle circonstance reconnaître l’effet juridique du CLPE donné par un particulier (par exemple uniquement dans la collecte de données de PCI par un organe public), afin éviter que l’intérêt de l’ensemble de la communauté ne soit atteint par des actes d’intérêt personnel.
Appendices
Notes
-
[1]
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 3 novembre 2003, 2368 RTNU 3 (entrée en vigueur : le 20 avril 2006) [Convention de 2003].
-
[2]
Ibid, art 2.
-
[3]
Ibid, préambule.
-
[4]
Doc off UNESCO, 9e sess, ITH/14/9.COM/5.a (2014).
-
[5]
Doc off WIPO, 5e sess, WIPO/GRTKF/IC/5/3 (2003).
-
[6]
Kate Hennessy, « The Intangible and the Digital. Participatory Media Production and Local Cultural Property Rights Discourse », dans Luciana Duranti et Elizabeth Shaffer, dir, The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation, Conference Proceedings: An International Conference on Permanent Access to Digital Documentary Heritage, Paris, UNESCO, 2013 à la p 63.
-
[7]
Jane Anderson, « Anxieties of Authorship in the Colonial Archive », dans Chris et Gerstner, dir, Media Authorship, Routledge Press, 2013 à la p 232.
-
[8]
La première fois que le « folklore », concept prédécesseur de PCI, entre dans la discussion juridique à l’échelon international, c’était dans une communication du ministre des Relations extérieures et des cultes de la République de Bolivie adressée au directeur général de l’UNESCO, demandant que soit examinée la possibilité d’établir un instrument international qui règlementerait « la conservation, la promotion et la diffusion du folklore » et qui protégerait les arts populaires et le « patrimoine folklorique » de « commercialisation et exportation clandestines », ainsi que d’ajouter à la Convention universelle sur le droit d’auteur un protocole qui déclarerait les expressions culturelles traditionnelles comme « propriété de l’État », ne relevant donc pas du domaine public. Voir : Wang Li, La convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Paris, L’Harmattan, 2013, à la p 57 [Wang Li].
-
[9]
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, 29 octobre 2010, UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 (entré en vigueur : le 12 octobre 2014) [Protocole de Nagoya].
-
[10]
Pour l’histoire du concept, voir : Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, 2e éd, Cambridge University Press, 2003 à la p 630.
-
[11]
Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 27 juin 1989, Bull officiel OIT (1989), LXXII, ser. A, no 2 arts 6 et 16 (entrée en vigueur : 5 septembre 1991) [Convention no 169]. Cette convention a mentionné le principe dans son article 16, prescrivant que le déplacement des peuples indigènes et tribaux ne doit « avoir lieu qu’avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause ». De même, dans son article 6, la convention exige que les États membres consultent les peuples indigènes et tribaux lorsqu’ils envisagent des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Cela présente une version « adoucie » du principe CLPE qui est un droit de consultation.
-
[12]
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés AG 61/295, Doc off AG NU, 61e session, Doc NU A/RES/61/295 (2007) [Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones]. Son article 19 demande aux États « d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause » « avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones ».
-
[13]
Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992, 1760 R.T.N.U. 79 (entrée en vigueur : 29 décembre 1993). [Convention « biodiversité »].
-
[14]
La version anglaise de cet article emploie l’expression « prior informed consent ».
-
[15]
Ce terme décrit les phénomènes d’exploitation commerciale des ressources génériques et des connaissances traditionnelles par l’industrie, et d’appropriation illégitime via le système de propriété intellectuel, tel que le brevet. Sur cette question, voir par exemple : Catherine Aubertin et Christian Moretti, « La biopiraterie, entre illégalité et illégitimité », dans Catherine Aubertin, Florence Pinton et Valérie Boisvert, dir, Les marchés de la biodiversité, IRD Éditions, 2007, à la p 91.
-
[16]
Supra note 9.
-
[17]
Supra note 1, art 2-2. « Le “patrimoine culturel immatériel”, tel qu’il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants : […] (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; […] ».
-
[18]
Supra note 9, art 7. (Accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques) : « Conformément à son droit interne, chaque Partie prend, selon qu’il convient, les mesures appropriées pour faire en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales, et que des conditions convenues d’un commun accord soient établies ».
-
[19]
Ibid, art 15. (Participation des communautés, groupes et individus) : « Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque État partie s’efforce d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion ».
-
[20]
Frédéric Desmarais, « Le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones en droit international : la nécessaire redéfinition de son cadre conceptuel » (2006) 19:1 RQDI 161.
-
[21]
Ibid à la p 209.
-
[22]
Michel Pimbert, « FPIC and Beyond: Safeguards for Power-equalising Research that Protects Biodiversity, Rights and Culture », dans Ashley, Kenton et Milligan, dir, Biodiversity and Culture : Exploring Community Protocols, Rights and Consent, IIED, 2012 à la p 43.
-
[23]
Gurdial Singh Nijar, « Traditional Knowledge Systems, International Law and National Challenges: Marginalization or Emancipation? » (2013), 24:4 Eur J Intl L à la p 1216.
-
[24]
Parshuram Tamang, An Overview of the Principle of Free, Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples in International and Domestic Law and Practices, Doc. off. CES NU, 2005, Doc. NU PFII/2004/WS.2/8, aux paras 1-39; Antoanella-Iulia Motoc et Tebtebba, Foundation, Legal Commentary on the Concept of Free, Prior and Informed Consent, Doc. off. CES NU, 23e sess., Doc. NU E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1, aux pp 5-9.
-
[25]
Sahara occidental, Avis consultatif, [1975] CIJ rec 116, Opinion individuelle de M. Dillard (traduction) à la p. 123. Cette citation vient de la traduction officielle en français fournie par la Cour. Version originale en anglais : « self-determination is satisfied by a free choice not by a particular consequence of that choice or a particular method of exercising it. »
-
[26]
Supra note 9, art 5.
-
[27]
Mauro Barelli, « Free, Prior and Informed Consent in the Aftermath of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Developments and Challenges Ahead » (2012) 16 : 1 Int’l J HR 1.
-
[28]
Posey et Dutfield ont réalisé une liste de renseignements à dévoiler pour que la décision soit éclairée : Darrell A Posey et Graham Dutfield, Beyond Intellectual Property. Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities, International Development Research Centre, 1996 à la p 48.
-
[29]
Statutory Rules No. 181, 2000, Environment Protection Biodiversity Conservation Regulations 2000, Part 8A, Access to Biological Resources in Commonwealth Areas. En ligne : Australasian Legal Information Institute <www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/epabcr2000697/>.
-
[30]
Rob McMahon, « The Institutional Development of Indigenous Broadband Infrastructure in Canada and the United States: Two Paths to ‘Digital Self-Determination » (2011) 36: 1 Can. J. Comm. 115; Faye Ginsburg, « Rethinking the Digital Age » dans Pam Wilson et Michelle Stewart, dir, Global Indigenous Media, Atlanta, Duke University Press, 2008 à la p 287.
-
[31]
Alastair Smith, Fishing with new nets: Maori Internet Information Resources and Implications of the Internet for Indigenous Peoples, Proceedings of the 7th Annual Conference of the Internet Society (INET 97), Kuala Lumpur, Malaysia, en ligne : Internet Society, soc.org/INET97/proceedings/E1/E1_1.HTM.
-
[32]
C’est le cas de l’une des premières bases de données des connaissances et savoir-faire traditionnels, le “Honey Bee Network”. Voir l’analyse de ce cas dans la partie IV. A.
-
[33]
Ravi Katikala, et al, « Life at the Edge of the Internet. Preserving the Digital Heritage of Indigenous Cultures » dans Luciana Duranti et Elizabeth Shaffer, dir, The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation, Conference Proceedings: An International Conference on Permanent Access to Digital Documentary Heritage, Paris, UNESCO, 2013 à la p 196.
-
[34]
Adoptées par l’Assemblée générale des États parties à la Convention, 2e session, 16-19 juin 2008, Unesco, Paris, Doc off. ITH/08/2.GA/CONF.202/5, amendées en 2010, 2012, 2014 et 2016.
-
[35]
Supra note 1, art 16-17.
-
[36]
« Free, prior and informed consent of the bearers ». Voir les documents de travail produits par les réunions de l’UNESCO : Report of the Expert Meeting on Criteria for Inscription on the Lists Established by the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris, 5-6 December 2005, à la p. 3 et 6; Report of the Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention, Tokyo, 13-15 March 2006, à la p. 5; Working Draft. Possible Criteria for the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity and the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, New Delhi, 2-4 April 2007, à la p. 4. En ligne : UNESCO, <ich.unesco.org/fr/evenements?categ=2005-2000>.
-
[37]
UNESCO, Adoption du projet de compte rendu analytique de la première session extraordinaire du Comité (2007), Doc. off. ITH/07/2.COM/CONF.208/3, à la p 25.
-
[38]
UNESCO, Formulaire de candidature, en ligne : <www.unesco.org/culture/ich/en/forms>.
-
[39]
En 2009, l’Organe subsidiaire du Comité intergouvernemental a donné son avis : « L’organe a considéré que, vu la diversité des formes que peut prendre une communauté, il n’était pas nécessaire de définir un format spécifique pour la démonstration de leur consentement. Il a été noté que le formulaire de candidature ICH-02 n’imposait pas de format particulier de démonstration, mais que quelle que soit la forme que ce dernier revêtait, il devait être documenté et, dans le mesure possible, traduit dans l’une de deux langues de travail du Comité de façon à permettre aux examinateurs de l’évaluer. Il a été en particulier jugé important que les communautés, et partant les autorités habilitées à manifester leur consentement en leur nom, soient très clairement identifiées. Les membres de l’organe ont considéré le consentement des communautés comme un aspect essentiel du dossier, car déterminant leur implication dans le processus de sauvegarde dans son ensemble. » Rapport du rapporteur des réunions de l’organe subsidiaire chargé de l’examen des candidatures en vue de leur inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, Doc. off. ITH/09/4.COM/CONF.209/INF.6, au para. 35. [Notre italique.]
-
[40]
UNESCO, Report of the Consultative Body on its work in 2011, Doc. off. ITH/11/6.COM/CONF.206/7, au para 28.
-
[41]
Les formulaires ICH-02 fournis par le Comité intergouvernemental (dernière version 2016), en ligne : UNESCO, <ich.unesco.org/en/forms˃.
-
[42]
Les formulaires ICH-02 ne demandent qu’une description simple de l’élément. Dans la catégorie « Identification et définition de l’élément » du formulaire, les informations demandées sont ainsi réparties : description de l’élément en 280 mots anglais ou français; description des détenteurs et praticiens : 280 mots ; mode de transmission 280 mots; fonctions sociales et significations culturelles : 280 mots.
-
[43]
UNESCO, Dossiers de candidatures retenues sur le site officiel de la convention, en ligne : <www.unesco.org/culture/ich/en/lists/˃.
-
[44]
Zhou Wei, « Taichi Zhang Sanfen non sélectionné pour la quatrième proclamation à la liste nationale du patrimoine culturel immatériel », Xinhua Press, 16 décembre 2014, en ligne : Xinhua presse : <sg.xinhuanet.com/2014-08/17/c_126880630.htm>.
-
[45]
« Troménie de Locronan. Abandon du dossier d’inscription au patrimoine de l’UNESCO », Le Télégramme (6 nov. 2008), en ligne : Le Télégramme, <www.letelegramme.fr/gratuit/generales/regions/ finistere/tromenie-de-locronan-20081106-4123118_1523515.php>.
-
[46]
Sabrina Urbinati, « The Role for Communities, Groups and Individuals under the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage » dans Silvia Borelli et Federico Lenzerini Leiden, dir, Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity : New Developments in International Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2012 à la p 212. Les Oudis (aussi appelés Oudines ou Outis) sont un peuple du Caucase vivant principalement en Azerbaïdjan mais aussi en Russie, en Géorgie et en Arménie.
-
[47]
UNSECO, Dossier d’inscription, en ligne : <ich.unesco.org/fr/RL/lart-des-croix-de-pierre-armeniennes-symbolisme-et-savoir-faire-des-khachkars-00434?RL=00434>.
-
[48]
UNESCO, Compte-rendu de la cinquième session du Comité, Doc off ITH/11/6.COM/CONF.206/4 Rev (2011), à la p 31. Voir aussi : Supra note 46.
-
[49]
Ibid.
-
[50]
CBD, Accès aux ressources génétiques et partage des avantages en découlant : Renseignements d’ordre législatif, d’ordre administratif et de politique générale, Rapport du Secrétariat, Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, Deuxième réunion, Djakarta, Doc off UNEP/CBD/COP/2/13 (1995). Gurdial Singh Nijar et al, Framework Study on Food Security and Access and Benefit-sharing for Genetic Resources for Food and Agriculture, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, FAO, 2011.
-
[51]
Supra note 13, art 8. « Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : (…) j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques; (…) ».
-
[52]
Supra note 1, art 2-2. « Le “patrimoine culturel immatériel”, tel qu’il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants : […] (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; […] ».
-
[53]
Supra note 20 à la p 198; Bartolomé Clavero, « The Indigenous Rights of Participation and International Development Policies » (2005) 22 Ariz J Int’l & Comp L à la p 45.
-
[54]
John Bellamy Foster, The Ecological Revolution: Making Peace with the Planet, Monthly Review Press, 2009 à la p 131.
-
[55]
Convention « biodiversité », Conférence des Parties, Sixième réunion, Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, Doc off UNEP/CBD/COP/6/19 (2002) à la p. 11.
-
[56]
Supra note 9.
-
[57]
Ibid.
-
[58]
Ibid, art 7.
-
[59]
Supra note 23 à la p 1212.
-
[60]
Loi sur le patrimoine culturel immatériel (2011), adopté par la XIème législature de l’Assemblée nationale du Peuple, le 25 février 2011 (entrée en vigueur le 1er juin 2011). [Notre traduction]
-
[61]
S’agissant le partage du pouvoir sur les ressources naturelles entre l’État et les communautés, voir David Szablowski, Transnational Law and Local Struggles. Mining, Communities and the World Bank, Oxford et Portland, Hart Publishing, 2008; Véronique Lebuis et Geneviève King-Ruel, « Le consentement libre, préalable et informé : une norme internationale en émergence pour la protection des populations locales autochtones » (2010) 40:3 Recherche amérindiennes au Québec, aux pp 85-99.
-
[62]
UNU-IAS, Report : The Role of Registers and Databases in the Protection of Traditional Knowledge (United Nations University, Institute of Advanced Studies, 2004) à la p 21.
-
[63]
Society for Research and Initiatives for Sustainable Technologies and Institutions, Honey Bee Network: Prior Informed Consent Form, ainsi que la Explanatory Note for Prior Informed Consent for Traditional Knowledge, en ligne : <www.sristi.org/cms/pic>. Notre traduction.
-
[64]
Jean du Berger, Grille des pratiques culturelles, Québec, Les éditions du Septentrion, 1997.
-
[65]
Quant aux droits économiques liés à l’élément même, le particulier n’a pas le droit de décider à la place de sa communauté, comme nous l’avons argumenté dans le paragraphe précédent.
-
[66]
Pour la base de données l’« Archivio di Etnografia e Storia Sociale » (« Archive d’ethnographie et d’histoire sociale », en ligne : AESS, <www.aess.regione.lombardia.it>. Sabrina Urbinati, Le rôle de la communauté dans le processus de catalogage des bases de données en Italie dans la numérisation du patrimoine culturel immatériel (2016) [inédit]. Nous remercions le soutien de Docteur Sabrina Urbinati de l’Université Milan-Bicocca.
-
[67]
La Mission Ethnologie du ministère français de la culture (qui fait aujourd’hui partie du Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique) avait préparé un document intitulé « Inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France – Formulaire de consentement des participants » (2008) pour l’inventaire national du PCI, mais il n’a pas été appliqué vigoureusement. Dans la pratique, un formulaire de consentement a été signé par les groupes de praticiens de taille restreinte. Voir Hottin Christian, « Candidatures pour l’UNESCO : Du dossier au projet. Vademecum d’après les cycles 2008-2009 et 2009-2010 », Le patrimoine culturel immatériel : Premières expériences en France, Paris, Maison des cultures du monde et Actes sud, 2011 aux pp 175-213.
-
[68]
Supra note 60.
-
[69]
Ibid art 15.
-
[70]
Ibid art 16. La Loi demande « d’obtenir l’accord de la personne enquêtée, de respecter les coutumes qui lui sont applicables et ses droits et intérêts », mais il en est question seulement des droits et intérêts de la « personne enquêtée », et non pas le rôle qu’elle joue pour représenter sa communauté, cette dernière étant en réalité représentée par l’État.
-
[71]
National Advisory Board on Climate Change and Disaster Risk Reduction de Vanuatu, Conditions and Guidelines for Researchers in Papua New Guinea, en ligne : WIPO, <www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/databases/creative_heritage/docs/png_guidelines.pdf>.
-
[72]
Vanuatu Research Policy, en ligne : <www.nab.vu/vanuatu-cultural-research-policy>.
-
[73]
Supra note 20.
-
[74]
Supra note 8 à la p 133.
-
[75]
Inde, Biological Diversity Act (2002), en ligne : WIPO, <www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6058>.
-
[76]
La fonction principale de ce comité est (1) de préparer et d’entretenir le « Registre de la biodiversité du peuple » qui collecte les informations des ressources biologiques et les connaissances traditionnelles qui y sont associées dans leur circonscription, et (2) de donner leur avis de consultation à la demande de la National Biodiversity Authority ou du State Biodiversity Board. Voir Inde, Biological Diversity Rules (2004), Ministry of Environment and Forests Notification, art 22, en ligne : WIPO, <www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=200356>.
-
[77]
Ils sont au nombre de 31,574 à ce jour. Inde, Guidelines for operationalization of Biodiversity Management Committees (2013), en ligne : National Biodiversity Authority, <nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>.
-
[78]
Malaisie, Draft Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act (2013), en ligne : Ministry of Natural Resources and Environment, <www.nre.gov.my/ms-my/Documents/PengumumanNRE/ABS%20Working%20Draft.pdf>
-
[79]
Supra note 29 art 8A.2.
-
[80]
Ibid. Texte original en anglais : “If the biological resources to which access is sought are in an area that is indigenous people’s land and an access provider for the resources is the owner of the land or a native title holder for the land, the owner or native title holder must give informed consent to a benefit-sharing agreement concerning access to the biological resources.”
-
[81]
Australie, Federal Register of Legislation, Native Title Act (1993), Act No. 110 of 1993, en ligne : <www.legislation.gov.au/Details/C2017C00178>.
-
[82]
Voir le Web site officiel, International Council of Museum, en ligne : <icom.museum/>.
-
[83]
ICOM, Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, 15e Assemblée générale, Buenos Aires (4 novembre 1986), en ligne : <icom.museum/la-vision/code-de-deontologie//L/2/>.
-
[84]
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, JORF, 2 juillet 1901 à la p. 4025, en ligne : Légifrance, <www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570>. Article 1 : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
-
[85]
Supra note 83 au para 6.5.
-
[86]
Supra note 8 aux pp 58-89.
-
[87]
Il convient également d’éclairer sur la relation entre le « folklore » et l’anthropologie en tant que matière scientifique. Les auteurs américains considèrent généralement le folklore comme étant une partie composante de l’anthropologie. La description, qui est devenu largement accepté de Franz Boas est : L’anthropologie peut être divisée en quatre champs principaux, qui sont l’anthropologie culturelle, l’anthropologie physique, l’étude linguistique, et l’archéologie. Aux États-Unis, le folklore est un objet type d’étude de l’anthropologie culturelle. Voir « Anthropology – The Major Branches of Anthropology », in Encyclopaedia Britannica (Encyclopaedia Britannica, inc, 2017), en ligne : Encyclopaedia Britannica, <www.britannica.com/science/anthropology/The-major-branches-of-anthropology>. Voir aussi Wang Li, supra note 8 à la p 105.
-
[88]
American Anthropological Association, « Principle of Professional Responsability », en ligne : AAA <ethics.americananthro.org/category/statement/>.
-
[89]
Ibid, art 3.
-
[90]
Ibid.
-
[91]
Voir la description de « International Partnerships » de la American Folklore Society, « International Partnership », en ligne : AFS, <www.afsnet.org/?page=International>.
-
[92]
Position Statement on Research with Human Subjects, en ligne : AFS, <www.afsnet.org/?page=HumanSubjects>.
-
[93]
Le code des règlements fédéraux (Code of federal regulations, CFR) des États-Unis est le recueil des règles et règlements généraux et permanents (parfois nommé « United States administrative law »), publié dans le Federal Register par les divers départements de l’exécutif et les agences indépendantes du gouvernement fédéral. Le CFR est publié par l’Office of the Federal Register, une agence du National Archives and Records Administration (NARA), en ligne : <www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR>.
-
[94]
Ibid. Notre traduction. Le texte original en anglais : « Except as provided elsewhere in this policy, no investigator may involve a human being as a subject in research covered by this policy unless the investigator has obtained the legally effective informed consent of the subject or the subject's legally authorized representative. An investigator shall seek such consent only under circumstances that provide the prospective subject or the representative sufficient opportunity to consider whether or not to participate and that minimize the possibility of coercion or undue influence. The information that is given to the subject or the representative shall be in language understandable to the subject or the representative. No informed consent, whether oral or written, may include any exculpatory language through which the subject or the representative is made to waive or appear to waive any of the subject's legal rights, or releases or appears to release the investigator, the sponsor, the institution or its agents from liability for negligence. »
-
[95]
Cass R Sunstein, « Chevron Step Zero » (2006), 92:2 Va L Rev à la p 187.
-
[96]
Supra note 93.
-
[97]
Public Law 94-201, The Creation of the American Folklife Center, 94th Congress, H. R. 6673, January 2, 1976.
-
[98]
Voir le site Web officiel : Amarican Folklife Center, <loc.gov/folklife/index.html>.
-
[99]
Le site Web officiel du centre a établi une section dédiée, intitulée « Cultural Documentation Training for Indigenous Communities », dans l’objectif d’aider les communautés indigènes à réagir dans leurs intérêts face aux collectes d’informations des folkloriste et anthropologues, ou à prendre leur propre initiative d’archiver leur histoire orale. Cultural Documentation Training for Indigenous Communities, en ligne : Amarican Folklife Center, <loc.gov/folklife/edresources/ed-cultdocresources.html˃. Cette partie provient d’une collaboration entre le Bibliothèque du Congrès avec l’OMPI (Creative Heritage Projet) dans l’objectif d’aider les indigènes d’entreprendre la numérisation au quotidien de leur PCI. Le projet a été mis en place en Kenya et en Jamaïque. Voir : Guha Shankar, « From Subject to Producer: Reframing the Indigenous Heritage through Cultural Documentation Training » (2015), 5 Intl J Intangible Heritage, à la p 14. Eliamani Laltaika, Effects of WIPO’s Creative Heritage Project on the Welfare of the Maasai Community, Doc. off. WIPO/IP/DEV/GE/11/REF/12/LALTAIKA (2011).
-
[100]
American Folklife Center, en ligne : <www.loc.gov/folklife/fieldwork/internetlinks.html>.
-
[101]
British Library, « About British Library Sounds », en ligne : <sounds.bl.uk/Information/About/>.
-
[102]
Ibid. « These recordings should not be altered or used in ways that might be derogatory to the indigenous and local communities [...]. [T]he prior informed consent of the British Library and/ or other contributing third parties, as well as the traditional custodians is required for the republication and commercial use of part or whole of these materials ».
-
[103]
Supra note 20 à la p 163.
-
[104]
Ibid à la p 164.
-
[105]
Mireille Delmas-Marty, Critique de l’intégration normative : L’apport du droit comparé à l’harmonisation des droits, Paris, PUF, 2004 à la p 30. La démarche « ascendante » est, selon le professeur Delmas-Marty, la « recherche […] de principes communs par comparaison des droits nationaux : soit lors des négociations au niveau international, par le recours à l’expertise comparée et la promotion par chaque État partie de son droit, sans que cela relève d’une volonté hégémonique, mais bien d’une prise en compte des différences ; soit par la création de commissions d’experts des droits nationaux et de droit comparé chargés d’élaborer un avant-projet de texte ». Alors que dans une démarche « descendante », le droit comparé permet « d’évaluer une démarche d’intégration [de normes internationales] en mettant en évidence l’utilisation ou non de marges d’appréciation tant par l’émetteur que le destinataire de la norme ».