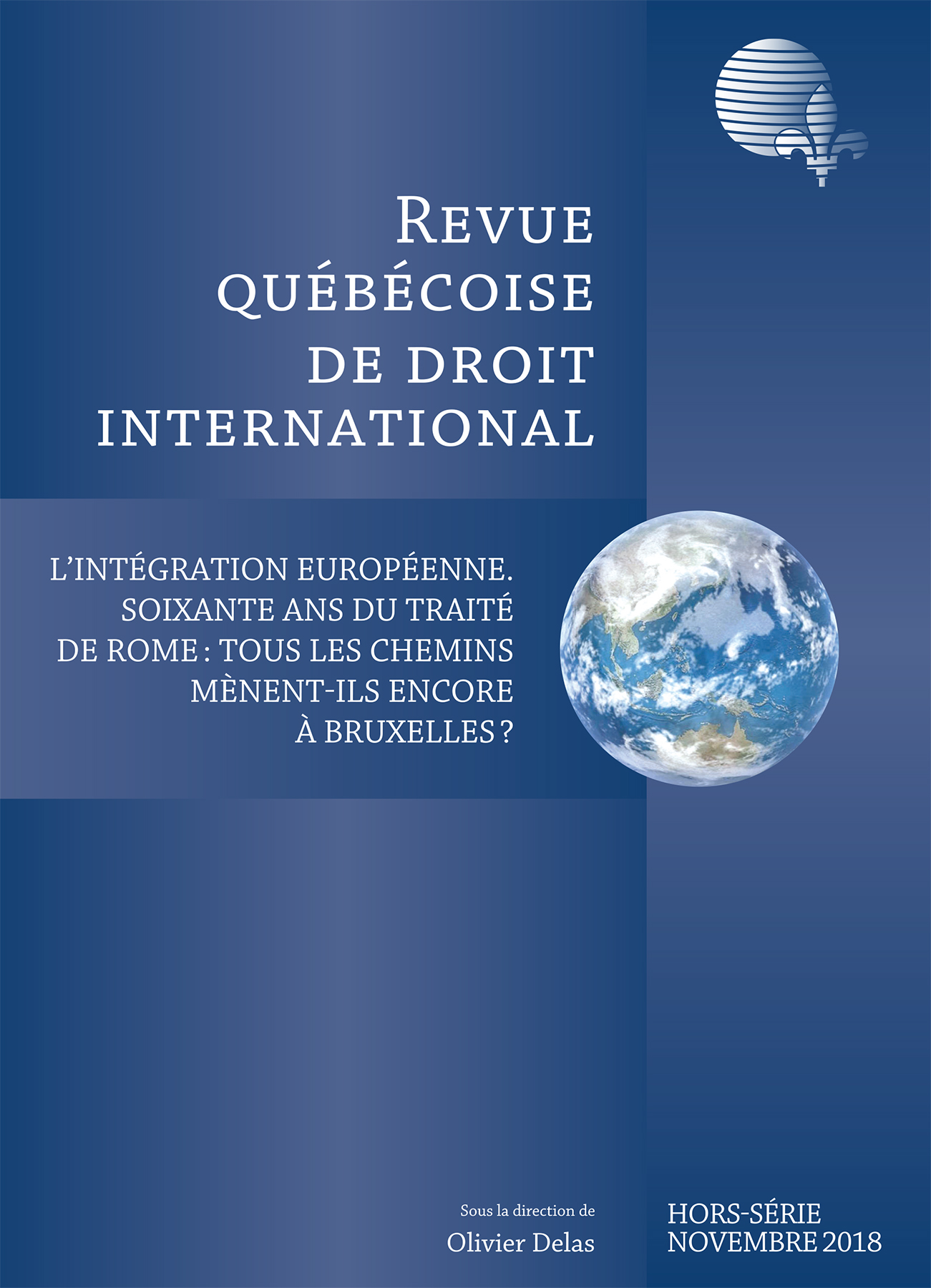Abstracts
Résumé
L’Union européenne est empêtrée dans une « crise migratoire » depuis 2015. Il s’agit en tout cas du discours politique commun. La présente contribution s’arrête sur le concept de crise qu’elle aborde de manière critique, en tentant à la fois de l’objectiver mais aussi d’en identifier la nature. Il faut ensuite s’interroger sur les impacts de ladite « crise » pour la gestion interne du droit d’asile par l’Union européenne. La gestion interne se réfère au cadre juridique gérant les questions liées à la protection internationale au sein de l’Union. L’afflux plus abondant de demandeurs de protection internationale a confronté le régime européen de l’asile commun à ses limites et au défi de la solidarité. Certains États se sont engouffrés dans le recours aux procédures dites d’évitement qui s’appuient sur des concepts permettant aux États d’échapper à l’obligation de protéger eu égard à l’origine, mais surtout à la trajectoire du demandeur d’asile. Il s’agit ensuite d’identifier les manifestations de l’évolution du régime européen d’asile commun vers une gestion externe de celui-ci. A défaut de pouvoir juguler les arrivées, l’Union se tourne vers des partenaires extérieurs pour cogérer les flux vers l’Europe. L’accord avec la Turquie, les compacts avec les pays du pourtour méditerranéen et d’Afrique subsaharienne en sont les premières expressions. Cette nouvelle orientation se caractérise, sur le fond, par un objectif de prévention des arrivées et, sur la forme, par l’usage de formes juridiques obscures, échappant à la fois au contrôle démocratique du législateur, institutionnel de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et juridictionnel de la Cour de justice. Les méthodes utilisées posent question quant à la compatibilité entre ces nouvelles stratégies et le respect des droits fondamentaux et de l’état de droit dans une organisation démocratique.
Abstract
The European Union (EU) has been facing a “migratory crisis” since 2015. At least, that is the common political discourse. This contribution focuses on the concept of “crisis” from a critical standpoint, seeking to objectify it but also to identify its nature. It is also necessary to interrogate the impacts of the so-called “crisis” for the internal management of asylum rights by the EU. “Internal management” refers to the legal framework for the questions related to international protection within the Union. The increasing influx of persons applying for international protection confronted the common European asylum regime to its limits and to the challenge of solidarity. Some states have engulfed themselves in “avoidance” procedures, which rely on concepts allowing states to avoid the obligation to protect having regard to origin, but mainly to the trajectory of the asylum seeker. Furthermore, the manifestations of the evolution of the common European asylum regime towards external management must be identified. Failure to juggle arrivals has led the EU to turn towards external partners to co-manage migration towards Europe. The agreement with Turkey and the compacts with Mediterranean and sub-Saharan African countries are its first manifestations. This new orientation is characterized, in substance, by the objective of preventing arrivals, and, in form, by the use of obscure legal forms, avoiding the democratic control of the legislator, the institutional control of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and the judicial control of the Court of Justice. The methods used lead to questions related to the compatibility of these new strategies with the respect of fundamental rights and the rule of law in a democratic institution.
Resumen
La Unión Europea se ha visto envuelta en una “crisis migratoria” desde 2015. En cualquier caso, es un discurso político común. Esta contribución se centra en el concepto de crisis que aborda de manera crítica, tratando de objetivarla y también de identificar su naturaleza. Entonces es necesario considerar el impacto de la llamada “crisis” para la gestión interna del derecho de asilo por parte de la Unión Europea. La gestión interna se refiere al marco legal que regula las cuestiones relacionadas con la protección internacional en la Unión. La creciente afluencia de solicitantes de protección internacional ha confrontado al sistema de asilo europeo con sus límites y el desafío de la solidaridad. Algunos estados se han apresurado a utilizar los llamados procedimientos de evitación que se basan en conceptos que permiten a los estados escapar de la obligación de proteger, dado el origen, pero especialmente la trayectoria del solicitante de asilo. Entonces es necesario identificar las manifestaciones de la evolución del Sistema Europeo de Asilo Común hacia una gestión externa de este. Frente a la falta de capacidad de control de las llegadas, la Unión recurre a socios externos para gestionar conjuntamente los flujos hacia Europa. El acuerdo con Turquía, los pactos con los países del Mediterráneo y África subsahariana son las primeras expresiones. Esta nueva orientación se caracteriza esencialmente por un objetivo de prevenir las llegadas y, en la forma, por el uso de formas jurídicas oscuras, escapando tanto del control democrático del legislador, del control institucional de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del control jurisdiccional del Tribunal de Justicia. Los métodos utilizados plantean preguntas sobre la compatibilidad de estas nuevas estrategias con el respeto de los derechos fundamentales y el estado de derecho en una organización democrática.
Article body
Cette contribution se fonde sur l’exposé présenté à l’Université de Laval lors de l’université d’automne de novembre 2017. Certains éléments ont été actualisés compte tenu de l’évolution juridique et politique depuis cet événement. Plus qu’une analyse doctrinale, ce texte propose une photographie de l'évolution générale d’une gestion interne des questions liées à l’asile au profit d’une gestion externe, en pointant au passage les manifestations de ce glissement.
Au moment où j’écris ces lignes, en juin 2018, un évènement illustre plus que tout discours ou écrit la nature de la crise migratoire. Le navire Aquarius, affrété par SOS Méditerranée, a secouru 629 personnes en Méditerranée au large des côtes libyennes, ne trouvant aucun port européen pour accoster. La presse titre « L’"Aquarius", le bateau avec à son bord 629 migrants, victime de la paralysie européenne ». Les pays de l’Union se renvoyant l’un l’autre un bateau rempli à craquer de migrants résume jusqu’à l’horreur, en un fait, la nature des débats sur les questions migratoires au sein de l’Union européenne ces dernières années : défaut de solidarité, incapacité à faire preuve d’humanité collectivement. Le Règlement Dublin III[1] impose à l’État secourant de prendre en charge le traitement de toutes les demandes d’asile qui seront introduites, conduisant ainsi les États à éviter le sauvetage même. Après les refus italien et maltais, pays des ports les plus proches du bateau, c’est l’Espagne qui a proposé l’accueil à Valence.
Une première partie est consacrée au concept même de crise et à son objectivation.
Il s’agit ensuite de s’interroger sur les impacts de ladite « crise » pour la gestion interne du droit d’asile par l’Union européenne. La poursuite d’un afflux plus abondant de demandeurs de protection internationale a représenté une menace ou à tout le moins une épreuve pour le régime européen de l’asile commun. Elle pose avec une acuité toute particulière l’importante question du partage de la charge et ce qu’elle implique en termes de solidarité. Cette période se caractérise également par un recours à la hausse aux procédures dites d’évitement. Cet évitement opère au départ de concepts permettant à un État d’échapper à l’obligation de protéger eu égard à l’origine, mais surtout à la trajectoire du demandeur d’asile.
Une troisième partie traite de l’évolution du régime européen d’asile commun, qui s’était largement concentré sur son volet interne, vers une gestion externe de celui-ci. Il s’agit de chercher des partenaires à l’extérieur de l’Union pour éviter, ou au moins juguler, les arrivées. L’union développe des partenariats avec des pays tiers à l’Union européenne à cet effet. L’on reviendra ainsi sur la jurisprudence Hirsi Jamaa et autres c. Italie[2] et ses implications, sur l’autre voie d’accès que sont les visas humanitaires et enfin sur l’accord entre la Turquie et l'UE[3] analysé comme prémisse à une nouvelle gouvernance politique en matière migratoire. Cette nouvelle orientation se caractérise, sur le fond, par un objectif de prévention des arrivées et, sur la forme, par l’usage de formes juridiques obscures, échappant à la fois au contrôle démocratique du législateur, institutionnel de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[4] et juridictionnel de la Cour de justice.
Pour conclure, il s’agira de s’interroger sur la compatibilité entre ces nouvelles stratégies et le respect de l’état de droit dans une organisation démocratique.
I. De l’usage raisonné du concept de crise
Plutôt que de parler de la crise européenne des réfugiés, il est plus correct de mettre le mot « crise » au pluriel et de viser, outre le défi des chiffres, la crise institutionnelle. Il ne s’agit pas de nier l’ampleur du drame ou des drames qui poussent les demandeurs d’asile à fuir vers l’Europe ni de minimiser les catastrophes humanitaires aux frontières externes et internes de l’Union européenne. Il s’agit plutôt de replacer les chiffres des arrivées auxquelles l’Union européenne est et pourrait être confrontée dans leur contexte global et surtout de se montrer critique face à la réponse de l’Union européenne comme organisation[5].
De manière provocatrice sans doute, il est intéressant de contester le recours même par l’Union européenne à l’expression « crise » ou à un vocabulaire dénonçant un afflux massif. En effet, le Conseil de l’Union européenne a renoncé à faire usage d’un instrument dont l’Union s’est dotée pour faire face à des arrivées nombreuses sur une courte période de temps. Il s’agit de la direction protection temporaire[6]. En 2001, l’Union européenne avait adopté un mécanisme de répartition ou la forme d’une directive sur la protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées. L’objectif était d’organiser la solidarité entre les États membres, compte tenu des réponses en ordre dispersé qui avaient été données par les États européens au moment de la crise qui a suivi l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Il s’agit d’une protection de groupe. Les personnes déplacées sont définies à l'article 2.c comme :
les ressortissants de pays tiers qui ont dû quitter leur pays ou région d’origine ou ont été évacués […] dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays et qui peuvent éventuellement relever du champ d’application de [la Convention de] Genève ou d’autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier : i) les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique; ii) les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l’homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard[7].
L’afflux massif doit être constaté par une déclaration du Conseil, adoptée à la majorité qualifiée[8]. Une telle déclaration n’a jamais été adoptée malgré la demande de certains pays, notamment l’Italie en 2010-2011 à la suite des printemps arabes, qui ont conduit au passage de nombreux exilés en Méditerranée. Jean-Yves Carlier soulignait à cet égard : « L’absence d’une telle déclaration et la non-utilisation de la directive protection temporaire permet d’affirmer a contrario qu’en droit, l’Union européenne n’est pas confrontée à un afflux massif[9]. »
En 2015, l’Union européenne n’a pas davantage utilisé la directive protection temporaire. Elle a préféré adopter le mécanisme de relocalisation sur lequel l’on reviendra ultérieurement.
Les chiffres du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) pour l’année 2016 indiquent une population actuelle de 65,6 millions de personnes déracinées à travers le monde. Il s’agit du chiffre le plus élevé jamais atteint. 28 300 personnes sont forcées chaque jour de fuir leur foyer à cause du conflit ou de la persécution. Parmi ceux-ci, 22,5 millions sont des réfugiés. 17,2 millions de ces réfugiés relèvent de la compétence du HCR tandis que 5,3 millions sont des réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Les apatrides sont au nombre de 10 millions tandis que les réfugiés réinstallés sont au nombre de 189 300. Tous les autres, soit plus de la moitié des 65,6 millions, sont des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays[10].
30 % des personnes qui ont fui leur pays se trouvent en Afrique; 26 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 17 % en Europe, 16 % au sein des deux Amériques et 11 % en Asie et Pacifique. 55 % des réfugiés à travers le monde sont originaires de trois pays, le Soudan du Sud 1,4 millions, l’Afghanistan 2,5 millions et la Syrie 5,5 millions. Les principaux pays d’accueil sont la Turquie avec 2,9 millions de réfugiés, le Pakistan avec 1,4 million, le Liban 1 million, l’Iran 979 400, l’Ouganda 940 800 et l’Éthiopie 791 600. Dans l’Union européenne, les chiffres les plus élevés ont été atteints en 2015 avec 1 250 030 entrées de demandeurs d’asile. Ces chiffres avaient déjà baissé en 2016, et ont continué à diminuer en 2017 et en 2018[11].
Les pays d’origine des réfugiés ne surprennent pas. Il s’agit au plus fort de ladite crise en 2015 et 2016 de la Syrie, de l’Afghanistan et de l’Irak. La Syrie représentait plus du tiers des arrivées[12]. Cette donnée est essentielle pour écarter la tentation trop souvent présente de distinguer les vrais des faux réfugiés. Il s’agit ici de personnes dont on n'a aucun doute quant à la légitimité des mobiles de leur fuite. Les taux de reconnaissance exceptionnellement élevés corrèlent avec une situation géopolitique dramatique[13].
Pour 2017, les tendances sont à la baisse puisque le nombre de demandeurs d’asile qui atteignait 100 000 par mois entrant dans l’Union européenne en 2016 est descendu à un chiffre oscillant entre 40 000 et 60 000 pour 2017. La baisse s’est poursuivie début 2018[14]. Ces données visent à montrer que l’Union européenne n’est proportionnellement pas la région du monde la plus confrontée à l’accueil de réfugiés, loin de là. En outre, la « crise » est déjà derrière elle puisque les chiffres redescendent. Certes, ils ne chutent pas parce que la cause des déplacements aurait été éradiquée, mais bien parce que les candidats à l’asile sont bloqués en Turquie. Cependant, cette baisse devrait permettre à l’Union d’envisager la gestion des migrations de manière sereine, sans urgence, et de profiter de cette « accalmie » pour s’attaquer aux problèmes de fond qui seront évoqués ci-après. Le blocage en Turquie de 2,5 millions de Syriens est un de ces défis à gérer.
La crise des réfugiés de 2015 qui a vu l’Union européenne confrontée à une augmentation significative du nombre de demandeurs d’asile fuyant principalement la guerre en Syrie n’a pas été une crise de légitimité de ces départs forcés, mais plutôt une crise de gestion de leur accueil. Il ne s’agissait pas de lutter contre une vague d’immigration clandestine dont l’origine devait être identifiée ou n’entrant pas dans le cadre égal européen. Il s’agissait de demandeurs d’asile dont les chiffres de reconnaissance démontreront ensuite qu’ils satisfaisaient massivement aux critères pour bénéficier d’une protection internationale. Ce n’est pas tant la qualité que la quantité des demandes qui a posé question. Le nombre d’arrivées concomitantes a exercé une pression sur le régime européen d’asile commun à la manière d’un test mesurant son opérationnalité.
II. Crise et gestion interne
Le système européen d’asile commun repose sur un objectif d’harmonisation des législations dans le domaine de l’accueil, de la qualification et des procédures. Il s’agit de proposer dans chaque État membre un dispositif d’accueil[15], des règles de procédures[16] et une interprétation commune[17] de la définition de la personne à protéger. Ce rapprochement des règles est censé éviter les mouvements secondaires qui seraient motivés par l’attrait d’un pays offrant des règles plus favorables. Si les normes sont identiques, ces mouvements ont moins de raisons d’être. Certaines demeurent et sont liées à des motifs culturels, économiques, rendant certains pays plus attirants ou plus proches aux yeux des demandeurs d’asile. Le Règlement dit de Dublin opère un « partage de la charge » des demandeurs de protection via différents critères liant chaque demande d’asile à un pas compétent pour la traiter[18].
Trois éléments sont ici pointés : le partage de la charge du traitement des demandes au travers du Règlement Dublin dont des projets de refonte sont discutés; le recours accru aux procédures d’évitement permettant à un État de se décharger des demandeurs d’asile sur son territoire au profit d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’États tiers. Enfin, ces différentes tendances doivent faire l’objet d’une analyse sous l’angle de la solidarité.
A. Dublin ou l’absence de partage de la charge
Le système de répartition fait l’objet depuis des années de larges critiques, justifiées, quant au caractère inéquitable de cette répartition puisqu’il concentre vers les pays du sud et de l’est de l’Europe l’essentiel de la charge des demandeurs d’asile[19]. En outre, le rapprochement des législations reste un objectif à atteindre puisque les niveaux de protection, au-delà des textes, restent largement différents d’un pays à l’autre de l’Union européenne[20].
Lorsque la pression sur le système augmente, elle opère à la manière d’un test pour celui-ci. Les conditions d’accueil dans les pays les plus exposés ainsi que la qualité des procédures s’en ressentent, ce qui contribue aux mouvements secondaires, à la manière d’un cercle vicieux. Des mécanismes correctifs ont été progressivement mis en place. Ces mécanismes correctifs incluent notamment du soutien administratif technique aux pays de première ligne, mais ils se révèlent largement insuffisants à pallier les difficultés d’accueil par manque de place, de personnel, de lieux d’accueil, par l’engorgement des procédures, les délais d’attente qui explosent, etc.
Le Règlement Dublin est un mécanisme de répartition des demandeurs d’asile et non de partage équitable de la charge. Il désigne l’État responsable de l’examen de la demande d’asile au sein des États membres de l’Union européenne et des États associés[21]. La compétence est déterminée sur la base de critères objectifs dont la légitimité repose sur une présomption d’équivalence sur fond de confiance mutuelle.
Les critères de détermination ciblent en premier lieu les mineurs étrangers non accompagnés relevant de l’État où ils introduisent une demande. Suivent ensuite les situations familiales, le règlement visant à regrouper les familles nucléaires des réfugiés reconnus ou des demandeurs d’asile. Le troisième critère est la situation de séjour; il ne vise que les étrangers qui sont soit entrés légalement sur le territoire d’un État membre, soit y ont obtenu un titre de séjour. Ces hypothèses sont relativement rares. Enfin, le critère résiduaire, mais le plus souvent utilisé est celui du pays de première rentrée. Un dernier critère existe, tout à fait résiduaire, celui du lieu où le demandeur d’asile se trouve. L’augmentation des moyens techniques et des contrôles aux entrées ont comme conséquence que ce dernier critère est moins souvent utilisé que celui de la première entrée. Dès que le demandeur d’asile est repéré, ses empreintes sont prises et le pays où elles l’ont été sera considéré comme le premier sur sa route.
Le Règlement prévoit des correctifs sous la forme d’exceptions. Elles figurent dans deux dispositions qui concernent soit les personnes à charge[22] soit l’application de clauses dites « discrétionnaires ». Le mécanisme visant les personnes à charge est un tempérament à la définition restrictive des membres de la famille dans des situations de dépendance. La clause discrétionnaire permet à un État membre de prendre en charge le traitement d’une demande d’asile qui ne lui incomberait pas, et ce pour des motifs humanitaires liés notamment à des raisons familiales. En période de pression accrue, les États se montrent toutefois encore plus réticents à faire jouer ces clauses qui augmentent le nombre de demandes d’asile à traiter sur leur territoire.
Ces tempéraments fondés sur l’examen de situations individuelles ne sont pas les seuls moyens que le Règlement Dublin prévoit pour corriger le mécanisme de répartition. Tel est le cas dans l’hypothèse où des défaillances systémiques apparaissent dans un État membre[23]. L’inscription de cette dérogation dans le texte même du règlement est consécutive aux jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme[24] et de la Cour de justice de l’Union européenne[25]. Ces arrêts avaient imposé que l’on fasse exception à un transfert au sein de l’Union lorsqu’il en résulterait une violation respectivement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme[26] et de l’article 4 de la Charte européenne dans le chef du demandeur d’asile. Ces dispositions prohibent de manière absolue la torture et les traitements inhumains et dégradants qui résulteraient ici de l’absence de protection effective contre le refoulement dans le pays européen présentant des défaillances systémiques et/ou de l’indigence des conditions d’accueil. Même si les États de l’Union sont présumés respecter ces standards, si, dans la réalité, tel n’est pas le cas, la présomption de protection équivalente est renversée. Dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique[27], la Cour souligne que la Belgique ne peut invoquer le droit de l’Union européenne et, en son sein, le Règlement Dublin II qui désigne l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile au sein de l’Union, pour se dispenser du respect dû à la CEDH. Même si le droit de l’Union bénéficie de la présomption dite Bosphorus du nom de l’arrêt de la Cour de justice mentionnant que
la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire [étant] « équivalente » à celle assurée par le mécanisme de la Convention [européenne des droits de l’homme, […] l’État membre] ne s’est pas écarté des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention lorsqu’[il] a mis en oeuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne[28].
Cette jurisprudence a été « transposée » lors de la refonte du Règlement Dublin II en Règlement Dublin III.
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable[29].
Lorsque le critère de détermination applicable désigne un État dont le système d’asile est systématiquement défaillant, le règlement intime alors à l’État où une demande d’asile est introduite de passer au critère suivant dans la hiérarchie jusqu’à ce qu’un État non systématiquement défaillant soit désigné.
Cette hypothèse des défaillances systémiques s’applique en cas de défaillance généralisée. Qu’en est-il en cas de défaillance dans un cas individuel? La jurisprudence a également envisagé une telle hypothèse. Ainsi, dans l’affaire Tarakhel[30], la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’article 3 de la CEDH interdit le renvoi vers un pays dont le système est affecté de défaillances ponctuelles lorsque le demandeur risque d’en être la victime en raison de son profil vulnérable. La famille Tarakhel est une famille afghane comprenant cinq enfants. Elle a introduit une demande d’asile en Suisse, qui souhaitait les renvoyer vers l’Italie. La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé contraire à la CEDH une décision suisse d’expulser sans condition une famille afghane avec des enfants mineurs vers l’Italie dans le cadre du Règlement Dublin. Pour la Cour, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme si les autorités suisses renvoyaient comme c’était prévu les requérants, sans avoir obtenu au préalable des autorités italiennes la garantie d’une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et de la préservation de l’unité familiale.
Les décisions ultérieures ont été plus hésitantes quant à la qualification d’un pays européen d’admissible au renvoi de demandeurs d’asile ou non. Ainsi, pour ne citer que quelques décisions européennes ou nationales, dans l’affaire Mirza[31] en 2016, la Cour de justice a validé sous d’importantes réserves la qualification d’irrecevables de demandes de protection déposées par des personnes en provenance directe de Serbie[32]. Le 13 décembre 2016, la Cour d’appel de Lyon a estimé que le système d’asile hongrois était conforme au droit de l’Union[33]. À côté de telles jurisprudences, d’autres sont plus vigilantes. La jurisprudence britannique a suspendu un transfert vers la Hongrie à la requête de deux Iraniens qui alléguaient un risque de refoulement en chaîne vers des pays non sûrs comme la Serbie, la Macédoine, la Grèce et la Turquie. La High Court s’est référée aux rapports du Asylum Information Database (AIDA) et du HCR pour critique des « broad and sweeping generalisations about presumptions of compliance[34] ». Il n’est pas possible de faire l’inventaire des nombreuses jurisprudences de ce type prononcées par les juridictions nationales des États membres. Elles sont variables dans le temps et l’espèce et divergent d’un pays à l’autre. Elles sont révélatrices à la fois du rôle fondamental du juge, mais aussi de l’insuffisance des réponses institutionnelles aux faiblesses plus ou moins graves et plus ou moins durables identifiées dans les États membres.
Une nouvelle réforme est en cours au sujet du Règlement Dublin. La proposition faite par la Commission conservait le même moule, les mêmes remèdes peu efficaces sans pour autant modifier les origines mêmes du caractère inéquitable du Règlement. Le Parlement européen, par le rapport Wikström, a proposé une approche nouvelle fondée sur l’incitation plutôt que sur la sanction. La hiérarchie des critères est repensée sur la base des « liens réel » que les demandeurs pourraient entretenir avec certains États membres[35]. Par contre, le critère de l’entrée irrégulière est supprimé. Tant les demandeurs que des organisations sponsors peuvent demander l’admission d’une personne à titre discrétionnaire. Cette avancée, bien que saluée, paraît peu intéressante en pratique vu la posture négative des États face aux demandes qu’ils ne sont pas tenus de prendre en charge. Par défaut, la règle applicable devient non la responsabilité de l’État de la demande, mais bien l’attribution automatique de la responsabilité à ou aux État(s) « supportant les moins lourdes charges ».
Tout en connaissant le caractère extrêmement novateur de ce rapport, Francesco Maiani doute que le système envisagé soit réalisable dès lors qu’il dépend de l’exécution des transferts alors que ces derniers échouent dans un nombre significatif de cas.
B. Le recours actif aux manoeuvres d’évitement
Bien que le risque de la persécution dans le pays d’origine soit établi, la directive procédure permet aux États membres d’estimer qu’une protection peut être obtenue dans un pays tiers, c’est-à-dire autre que les États membres de l’Union européenne et, par hypothèse, autre que le pays d’origine.
La notion de « pays tiers sûr » connaît diverses variantes. Le « premier pays d’asile » est un pays tiers dans lequel le demandeur bénéficie d’un statut de réfugié ou d’un autre statut de protection[36]. Si la personne a déjà été reconnue réfugiée dans un autre pays, ce pays constituant, a priori, un pays tiers sûr, la crainte de persécution ne doit plus être examinée au regard du pays de nationalité, mais de ce pays de refuge. Il convient d’examiner si ce premier pays d’asile ne donne plus de protection réelle ou ne donne plus accès à son territoire. Le « pays tiers européen sûr » est un pays tiers partie à la CEDH[37]. Les autres pays tiers sûrs sont simplement qualifiés de « pays tiers sûrs[38] ».
Le respect du principe de non-refoulement impose toujours un examen in concreto du niveau de risque au regard de la situation de chaque personne, la notion de pays sûr pouvant, au mieux, constituer une présomption réfragable. En outre, il doit toujours exister un lien de connexité suffisamment intense entre le demandeur et le pays tiers sûr, de sorte qu’il est raisonnable d’exiger du demandeur qu’il s’y rende. Ce lien de connexité doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas[39].
Le recours à ces concepts peut être qualifié de manoeuvre d’évitement. Il s’agit pour l’État, malgré une crainte fondée de persécution ou d’atteinte grave, de se décharger de l’examen d’une demande en renvoyant l’intéressé vers un autre pays. Si le principe ne peut en soi être contesté si ce pays offre des garanties suffisantes, la question fondamentale est l’existence réelle et/ou effective de ces dernières et la possibilité d’exercer un recours contre la décision de renvoi. Même si la directive procédure garantit en toute hypothèse un recours de plein contentieux avec une possibilité de suspension, l’accessibilité de ce dernier demeure extrêmement problématique. Ainsi, par exemple, la jurisprudence majoritaire des juridictions grecques a jugé que la Turquie était un pays tiers sûr permettant le renvoi de demandeurs d’asile[40]. Angeliki Tsiliou critique le raisonnement suivi quant à la protection offerte par la Turquie et regrette que le Conseil d’État grec n’ait pas saisi l’opportunité de cette question pour saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle quant à l’interprétation du concept de pays tiers sur.
C. La solidarité… par la relocalisation
Un des mécanismes correctifs de l’iniquité du Règlement Dublin qui concerne les demandeurs d’asile dans les pays du Sud-Est européen fut la relocalisation[41].
L’article 78§3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que pour
qu’un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement Européen, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés[42].
Le système de relocalisation a été validé par le Conseil dans deux décisions successives en septembre 2017[43]. L’article 7 de la Décision 2015/1601 souligne que ce mécanisme de relocalisation s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures de soutien à l’Italie et à la Grèce. Ces mesures incluent le déploiement de fonctionnaires d’autres États membres coordonnés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile et de l’agence Frontex, la création de centres d’accueil et d’enregistrement des demandes d’asile, les « hotspots », ou encore des transferts de fonds.
La relocalisation est définie comme étant
le transfert d’un demandeur du territoire de l’État membre que les critères énoncés au chapitre 3 du Règlement UE n° 604/2013 désignent comme responsable de l’examen de sa demande de protection internationale vers le territoire de l’État de relocalisation[44].
Il s’agit d’une dérogation à l’article 13 du Règlement Dublin selon lequel
lorsqu’il est établi […] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale[45].
L’objectif de la relocalisation est d’accroître l’aide d’urgence destinée aux États membres qui se trouvent en première ligne, d’examiner les possibilités d’organiser une répartition d’urgence entre les États membres sur une base volontaire et de déployer, dans les États membres qui se trouvent en première ligne, les équipes du Bureau européen d’appui en matière d’asile[46] chargées d’assurer un traitement conjoint des demandes de protection internationale. Concrètement, il s’agissait de relocaliser 160 000 personnes en provenance de la Grèce et de l’Italie. Ce chiffre a été réduit à 100 000 après l’accord avec la Turquie.
Le système fonctionne de la manière suivante : un demandeur ayant introduit la demande de protection internationale en Italie ou en Grèce, et à l’égard duquel ces États membres auraient été compétents en vertu des critères de détermination de l’État membre visés par le Règlement Dublin, peut faire l’objet du programme de relocalisation. Une clé de répartition entre les États membres est calculée à partir du critère objectif quantifiable et vérifiable. Les critères prévoient que la relocalisation est prioritaire pour les personnes vulnérables, les demandeurs d’asile avec un taux moyen de reconnaissance de la protection internationale de plus de 75% et qui sont arrivés en Grèce ou en Italie après le 24 mars 2017.
Au terme de la mise en oeuvre des décisions de relocalisation, mise en oeuvre qui s’est déroulée du 26 septembre 2015 au 4 septembre 2017, 28% des personnes à relocaliser l’ont été. 8 451 demandeurs d’asile ont été relocalisés d’Italie et 19 244 l’ont été en provenance de la Grèce. La plupart des pays européens sont bien loin d’avoir tenu leurs engagements. À l’exception de la Finlande ou de l’Irlande qui ont réalisé de 80 à 115% de leurs engagements, les autres États présentent des bilans relativement faibles.
Trois pays d’Europe centrale et orientale, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont été visés en juillet par des procédures d’infraction pour avoir refusé d’accueillir le moindre migrant dans le cadre de la relocalisation. L’Autriche était également très loin de l’objectif.
La France, comme l’Allemagne, l’Irlande et la Suisse qui ont le plus grand nombre de dossiers en attente, ont été priés en septembre d’accélérer urgemment les transferts. Malte, la Lettonie et la Norvège ont quant à eux rempli leurs engagements.
Des négociations sont actuellement en cours pour reprendre ce processus, mais elles butent toujours sur l’hostilité de certains pays d’Europe centrale et orientale. Il s’agit de la résistance du groupe dit de Visegrad. Ces derniers ont d’ailleurs introduit un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour contester la conformité de ces mesures de relocalisation aux traités. Le recours a été introduit par la République slovaque et la Hongrie. Il a donné lieu à un arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2017[47].
Par voie de requête, ces pays dénonçaient l’usage de l’article 78§3 qui ne constitue pas une base juridique adéquate pour la Décision 2015/1601 en ce que cette dernière serait un acte législatif, de caractère non provisoire, adoptée pour répondre à un afflux soudain de demandeurs d’asile.
La Cour de Luxembourg a réfuté cette lecture de la Décision 2015/1601. Il ne s’agit pas d’un acte législatif. Le programme de relocalisation qu’elle consacre est provisoire et l’Italie et la Grèce, bénéficiaires du programme de relocalisation, ont été confrontées à un afflux soudain de demandeurs d’asile tels que visés par ledit article 78§3 du Traité.
La Cour juge que
la notion de mesures provisoires au sens de l’article 78, § 3 du Traité doit revêtir une portée suffisamment large afin de permettre aux institutions de l’Union de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour répondre de manière effective et rapide à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers[48].
Selon la Cour, il est de l’essence même des mesures provisoires telles qu’autorisées par l’article 78§3 du Traité d’éventuellement déroger à des actes législatifs. L’article 78§3 du Traité verrait son effet utile « significativement réduit », s’il n’autorisait l’adoption que « des mesures d’accompagnement s’ajoutant aux actes législatifs […] et non des mesures dérogeant à de tels actes[49] ».
La circonstance que le mécanisme de relocalisation produira des effets sur le long terme, en ce que des demandeurs d’asile s’installeront ensuite dans l’État membre où ils ont été relocalisés, est donc inhérente au mécanisme de relocalisation. En déduire que ce dernier ne constitue pas une mesure provisoire pour cette seule raison reviendrait à considérer toute mesure de relocalisation comme faisant l’objet d’une interdiction de principe par le Traité, ce qui aurait pour effet de restreindre indûment le pouvoir d’appréciation du Conseil. Or, il « doit être reconnu aux institutions de l’Union un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elles adoptent des mesures dans des domaines qui impliquent de leur part des choix notamment de nature politique et des appréciations complexes[50] ».
Si l’arrêt se réfère au « principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres[51] » tel que consacré en matière d’asile par l’article 80 du Traité, la Cour le fait aux fins de justifier la légalité du mécanisme de relocalisation adopté par le Conseil. Selon la Cour,
il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a estimé devoir prendre, au vu de l’urgence spécifique de la situation, sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE, lu à la lumière de l’article 80 TFUE et du principe de solidarité entre États membres qui y est consacré, des mesures provisoires consistant à imposer un mécanisme de relocalisation contraignant[52].
L’argument est plus technique que de principe. Il est combiné par la Cour à l’affirmation de son contrôle marginal.
L’avis de l’avocat général Bot était plus cinglant. Il indiquait
derrière ce qu’il est convenu d’appeler la « crise migratoire de l’année 2015 » se cache une autre crise, à savoir celle du projet d’intégration européenne qui repose dans une large mesure sur une exigeante solidarité entre les États qui ont décidé d’être parties prenantes à ce projet ». « Il convient […] d’emblée de mettre l’accent sur l’importance de la solidarité en tant que valeur fondatrice et existentielle de l’Union ». « La solidarité figure parmi les valeurs cardinales de l’Union et se trouve même au fondement de celle-ci ». « Il ne fait pas de doute à […] [ses] yeux que, en cas de recours en manquement à ce sujet, la Cour serait fondée à rappeler aux États membres défaillant à leurs obligations, et ce de manière ferme[53].
III. La gestion externe
Les échecs rencontrés au niveau interne, les succès du populisme dans de nombreux États européens, liés notamment à la perception négative des flux paraissant ingérables – sans doute parce que non gérés – ont renforcé la détermination de l’Union à endiguer les arrivées. Le renforcement des frontières, déjà largement engagé, ne paraît pas être une solution suffisante. D’une part, il reste vain sauf pour ajouter des forteresses aux forteresses. D’autre part, les demandeurs de protection bénéficient du principe de non-refoulement de sorte qu’une fois arrivés à la frontière, terrestre ou maritime, voire bien avant celle-ci au travers des opérations de secours[54], ils relèvent de la responsabilité de l’Union. Une solution est alors d’empêcher les arrivées, à défaut de pouvoir empêcher les départs, dont les causes sont incontestablement réelles. Si l’on s’accorde à vouloir s’attaquer aux causes, leur complexité appelle une démarche de longue haleine, dont les chances de succès sont variables dans le temps et l’espace.
L’objectif de l’Union européenne, de la création et de la gestion d’un régime commun « interne » à l’Union, a évolué vers une politique visant à endiguer les arrivées en agissant en amont de celle-ci. Ce volet s’ajoute bien évidemment au premier, mais joue désormais un rôle significatif. Les chiffres en témoignent. L’accord avec la Turquie a contribué à faire baisser le nombre d’arrivées de demandeurs d’asile dans l’Union de manière significative. Les arrivées dans les îles grecques ont baissé de 98% au cours de l’année qui a suivi l’accord avec la Turquie. Une autre diminution est attendue suite aux collaborations engagées avec les pays sub-sahariens. La jurisprudence sur les refus de visas humanitaires vient asseoir l’impossibilité de demander une protection internationale au départ d’un pays tiers sur la base du droit de l’Union. Cette réduction des arrivées sera compensée à très faible proportion par le programme de réinstallation que l’Union entend mettre en oeuvre.
A. L’accord avec la Turquie
Le 18 mars 2016, les membres du Conseil européen se sont réunis avec leur homologue turc et ont conclu un accord[55]. Cet accord s’inscrit dans un cadre plus large de négociation quant à la prise en charge des réfugiés syriens. L’Union souhaitait que la Turquie « garde » plus les réfugiés syriens sur son territoire. Cela implique, d’une part, que ces réfugiés puissent s’insérer plus facilement sur le marché du travail turc et disposent d’un traitement qui les incite à y rester et, d’autre part, que la Turquie empêche leur sortie vers l’Union. En contrepartie, l’Union européenne s’est engagée à verser à la Turquie trois milliards d’euros destinés à financer des projets en faveur des réfugiés en Turquie. Elle s’est aussi engagée à libéraliser le régime des visas et à reprendre les négociations d’adhésion.
Dans le cadre des premiers accords, la Turquie s’était engagée à accepter le retour rapide de tous les migrants n’ayant pas besoin d’une protection internationale et qui ont quitté la Turquie pour gagner la Grèce et à reprendre tous les migrants en situation irrégulière interceptés dans les eaux turques.
Le 18 mars, une étape supplémentaire est franchie. Elle est présentée comme visant à s’attaquer aux passeurs, pour éviter que les réfugiés continuent à risquer leur vie. L’objectif est de mettre fin à la migration irrégulière de la Turquie vers l’Union européenne. Les points d’action convenus sont :
« Tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui partent de la Turquie pour gagner les îles grecques à partir du 20 mars 2016 seront renvoyés en Turquie[56]. » L’accord exclut toute expulsion collective et annonce que les renvois se feront « en totale conformité avec le droit de l’UE et le droit international » et dans le respect du principe de non-refoulement. Les migrants sont enregistrés et toute demande d’asile sera traitée individuellement par les autorités grecques en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les migrants ne demandant pas l’asile ou dont la demande d’asile a été jugée infondée ou irrecevable conformément à la directive procédure sont renvoyés en Turquie.
Pour chaque Syrien renvoyé en Turquie au départ des îles grecques, un autre Syrien doit être réinstallé de la Turquie vers l’Union européenne en tenant compte des critères de vulnérabilité des Nations unies. La priorité est donnée aux migrants qui ne sont pas déjà entrés, ou n’ont pas tenté d’entrer, de manière irrégulière sur le territoire de l’Union européenne. Septante places seront dédiées à cette réinstallation dans l’Union.
La Turquie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de nouvelles routes de migration irrégulière, maritimes ou terrestres, ne s’ouvrent au départ de son territoire en direction de l’Union européenne. La nature juridique de cet accord a été âprement discutée dès sa conclusion[57]. Le tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur ce point, saisi par trois demandeurs d’asile. Il s’est jugé non compétent, estimant que l’accord EU-Turquie est étranger à l’Union européenne[58].
Les trois recours demandaient l’annulation de ladite déclaration au motif qu’il s’agit là d’un accord international conclu par le Conseil européen avec la Turquie sans respecter les règles de procédure contenues dans les traités européens. En effet, si le Traité prévoit effectivement que l’Union peut, dans certaines matières, conclure un accord avec un pays tiers, la négociation et la conclusion d’un tel accord sont soumises au respect de la procédure énoncée à l’article 218 du Traité. Même si la validité du Traité devait être remise en cause au regard du droit interne de l’Union, il n’en liait pas moins l’organisation en vertu de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités[59].
Les ordonnances adoptées le 28 février 2017 rejettent les recours en recevant l’exception d’incompétence soulevée par le Conseil européen en tant que défendeur à la cause. Il a été interjeté appel de ces ordonnances de sorte que la Cour de justice tranchera définitivement au cours des prochains mois.
En vertu de l’article 263 du Traité, la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne porte uniquement sur le contrôle de légalité des actes adoptés par une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne, et non sur un accord international conclu par les États membres. Le Tribunal considère que ce n’est pas l’Union, mais ses États membres qui ont mené les négociations et conclu l’accord avec la Turquie. Indépendamment de la nature de l’acte adopté le 18 mars 2016, celui-ci ne peut être considéré comme un acte adopté par le Conseil européen, ni par une autre institution européenne. En d’autres termes, les États membres de l’Union européenne ont agi collectivement sans pour autant que l’Union elle-même ne soit engagée. La détermination des parties contractantes et de la qualité en vertu de laquelle ils se sont engagés doit se faire au regard du contenu de l’acte et de l’ensemble des circonstances entourant l’adoption de celui-ci.
En déclarant irrecevables les trois recours introduits devant lui pour cause d’incompétence, le Tribunal européen a de facto privé les intéressés de protection juridictionnelle au regard du droit de l’Union. Or, au fond, ils posaient des questions fondamentales quant aux conséquences de la mise en oeuvre de cet accord. Les trois demandeurs d’asile (de nationalité afghane et pakistanaise) étaient arrivés sur l’île de Lesbos en 2016. L’un d’eux, NF, expliquait par exemple avoir fui la République islamique du Pakistan « par crainte de persécutions et d’atteintes graves à sa personne[60]. » Entré en Grèce par bateau depuis la Turquie, il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités grecques peu après la conclusion de l’accord avec la Turquie. Sa demande a été rejetée. Ils souhaitaient que le juge européen se prononce sur la compatibilité des mesures envisagées avec la Charte et la Directive « procédures »[61]. Les requérants invoquaient notamment que la Turquie n’est pas un pays tiers sûr, au sens de l’article 38 de la directive 2013/32/UE. Ils soulevaient aussi la contrariété de l’accord avec l’interdiction des expulsions collectives. Ces questions méritent des réponses européennes. Placer l’accord en dehors du champ du droit de l’Union évite qu’elles ne soient tranchées.
B. Les visas humanitaires
Autre question géographiquement externe à l’Union, celle des visas humanitaires. Pour éviter les drames en Méditerranée, il faut à l’évidence ne pas devoir la traverser clandestinement. La solution la plus naturelle serait que les demandes de protection puissent être introduites dans des lieux où cela peut se faire en sécurité. Ces lieux pourraient être les représentations diplomatiques des pays de l’Union dans des pays tiers.
Le fondement juridique d’une telle démarche au regard du droit européen a fait l’objet de questions préjudicielles à la Cour de justice dans l’affaire X. et X.[62] Elles ont été posées par un arrêt de l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers, le juge administratif belge, du 8 décembre 2016.
Cette affaire est consécutive au dépôt d’une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par une famille syrienne auprès de l’ambassade de Belgique à Beyrouth. Elle s’appuyait sur l’article 25§1er a) du Code communautaire des visas[63]. Les intéressés invoquaient leur volonté de quitter la ville assiégée d’Alep pour introduire une demande d’asile en Belgique. Cette demande était motivée par la situation générale en Syrie et celle prévalant à Alep. Ils soulignaient aussi qu’ils étaient de confession chrétienne orthodoxe. Ils ajoutaient qu’il leur était impossible de se faire enregistrer comme réfugiés dans les pays limitrophes eu égard à la fermeture de la frontière entre le Liban et la Syrie.
L’administration a rejeté cette demande de visa. Saisi par une requête en suspension d’extrême urgence, le juge administratif d’appel interroge la Cour de justice quant à la portée des obligations internationales visées à l’article 25 du Code des visas. Ces obligations visent-elles l’ensemble des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? Parmi ces droits figurent l’article 4 relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants et l’article 18 relatif au droit d’asile, ainsi que les obligations auxquelles sont tenus les États membres sur la base de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951. Plus précisément, l’article 25 du Code communautaire des visas doit-il être interprété en ce sens que l’État membre, saisi d’une telle demande, doit délivrer le visa s’il y a un risque de violation de l’article 4 ou de l’article 18 de la Charte, ou d’une autre obligation internationale, sous réserve de sa marge d’appréciation liée aux circonstances de l’espèce? Une seconde question interroge la portée de l’existence d’attaches entre le demandeur et la Belgique.
La Cour de justice traite la demande selon la procédure d’urgence. Elle juge que le Code des visas adopté sur le fondement de l’article 62 du Traité vise les visas relatifs à des séjours d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Or, les visas sollicités en l’espèce ont été formés aux fins de demander l’asile et donc de se voir délivrer un titre de séjour dont la durée de validité excède quatre-vingt-dix jours. La Cour en déduit que ces visas ne relèvent pas du champ d’application du Code des visas.
La Cour suit le gouvernement belge et la Commission européenne pour souligner qu’aucun acte n’a été adopté par le législateur de l’Union en ce qui concerne les conditions de délivrance par les États membres de visas ou de titres de séjour de longue durée pour des motifs humanitaires. Ces demandes relèvent du seul droit national. La situation référée à la Cour n’est pas régie par le droit de l’Union de sorte que les dispositions de la Charte ne sont pas applicables. Le fait que l’article 32§1er b) du Code des visas érige en motif de refus de visa l’existence d’un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ne modifie pas la conclusion de la Cour. En effet, dans le cas d’espèce, il n’y a pas de doute quant à l’intention de solliciter un droit de séjour au titre de l’asile.
La Cour va plus loin, semblant exclure par avance une même démarche via une demande de visa long séjour. Elle ajoute en effet qu’une conclusion contraire impliquerait que le Code des visas impose aux États de permettre à des ressortissants de pays tiers d’introduire une demande de protection internationale auprès des représentations des États membres situées sur le territoire des États tiers. Pourtant, les textes de droit dérivé relatifs au droit européen de l’asile n’ont pas un champ d’application extraterritorial. L’article 3§1er 2 de la directive 2013/32 relative aux procédures d’asile est applicable aux demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, en ce compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, mais pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres. Les articles 1er et 3 du Règlement 604/2013 (Dublin) obligent uniquement les États à examiner les demandes de protection internationale présentées sur leur territoire, en ce compris à la frontière ou dans une zone de transit.
La Cour n’a pas suivi les conclusions de l’avocat général. Paolo Mengozzi a argumenté en vingt-et-une pages en faveur d’une application du droit de l’Union. L’article 25 relatif au visa à validité territoriale limitée, devait être interprété
en ce sens que l’État membre sollicité par un ressortissant d’un pays tiers afin de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée au motif de l’existence de raisons humanitaires est tenu de délivrer un tel visa si, eu égard aux circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le refus de procéder à la délivrance de ce document conduira à la conséquence directe d’exposer ce ressortissant à subir des traitements [inhumains ou dégradants] prohibés par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, en le privant d’une voie légale pour exercer son droit de demander une protection internationale dans cet État membre[64].
Cet arrêt a été largement commenté[65]. L’on renvoie pour l’essentiel à ces auteurs. Un point retient ici l’attention et fait le lien avec la décision relative à l’accord avec la Turquie. L’arrêt « visas » accorde une importance décisive au critère de l’intention, quelle que soit la forme de la demande déposée. Le fond – intention de rester – prime sur la forme – visa de court séjour. La décision du tribunal quant à la Turquie procède à l’inverse. Quel que soit le fond – un véritable accord international produisant des effets juridiques –, la forme n’est pas celle d’un traité liant l’Union puisqu’il s’agit d’un simple texte repris dans un communiqué de presse. « Des motivations très distinctes, sinon opposées, conduisent au même résultat : éviter de trancher les débats de fond[66]. »
C. Les compacts
Les termes compacts désignent le nouveau cadre pour le partenariat avec les pays tiers en matière de gestion des migrations proposé par la Commission européenne et adopté par le Conseil européen en juin 2016[67]. La Communication de la Commission du 7 juin 2016[68] indique que ces accords sont destinés « à donner un nouvel élan à la politique de réinstallation, mais amélioreraient aussi les capacités d’accueil des pays tiers en vue de la mise en oeuvre d’opérations de "retour"[69]. »
Sans que ces actes ne prennent la forme de traités en bonne et due forme, ces accords doivent être conclus avec des pays ciblés comme étant des pays d’origine ou de transit de la migration, ou encore des pays accueillant un très grand nombre de migrants. Les pays visés sont les suivants : Niger, Nigeria, Sénégal, Mali, Éthiopie, Jordanie, Liban, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Égypte, Libye, ainsi que, plus largement, trois régions : l’Afrique de l’Ouest, la Corne de l’Afrique et le Maghreb. Cinq pays sont prioritaires : le Niger, le Nigeria, le Mali, l’Éthiopie, le Sénégal.
Les bilans des négociations sont publiés par la Commission[70]. Il n’est pas possible d’entrer dans tous les détails des processus en cours. Le premier pacte signé le fut avec le Liban en novembre 2016; les suivants sont centrés sur la réadmission, avec la Jordanie ou le Nigeria. Un accord a même été conclu avec l’Afghanistan, incluant la réadmission d’Afghans en séjour illégal[71].
D. La réinstallation
Le 20 juillet 2015, l’Union européenne a signé un accord portant sur la réinstallation de 22 504 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale. Le 13 juillet 2016, la Commission a proposé un cadre de l’Union européenne en matière de réinstallation afin d’établir un ensemble commun de procédures types pour sélectionner les candidats à une réinstallation et un statut de protection commun pour les personnes réinstallées dans l’Union. Le 4 juillet 2017, les États ont été invités à faire de nouvelles propositions. Les États membres ont pris des engagements se chiffrant à 14 000 places de réinstallation. Un nouveau programme a été proposé par la Commission dans le but de réinstaller 50 000 réfugiés sur les deux prochaines années c’est-à-dire d’ici au mois d’octobre 2019. La Commission finance par 500 millions d’euros, soit 10 000 euros par personne installée pour l’État membre d’accueil. La Commission de liberté civiles, justice et affaires intérieures (LIBE) du Parlement Européen a adopté le 2 octobre 2017 à une large majorité le rapport de Malin Bjork sur le projet de règlement concernant la mise en place d’un cadre commun à l’ensemble de l’Union européenne en matière de réinstallation.
***
La confrontation du système européen d’asile commun à une augmentation brutale du nombre d’arrivées liée à l’enlisement du conflit syrien a mis en exergue des faiblesses dénoncées depuis des années. Les jurisprudences des cours européennes dans les affaires M.S.S. et NS étaient déjà la résultante du déséquilibre entre les États frontaliers de l’Union et ceux moins exposés aux premières entrées. Le refus des États d’utiliser le mécanisme de solidarité idoine, la direction protection temporaire, conçue pour faire face à de telles situations a enfoncé l’Union dans une crise institutionnelle dont la tragédie de l’Aquarius n’est qu’une des trop multiples expressions.
Outre les défaillances manifestes des solutions internes, l’Union européenne oriente son action vers l’extérieur et la prévention des flux. Si l’objectif était d’éviter des voyages et des traversées périlleuses en se dotant d’une politique de réinstallation solide, avec des objectifs chiffrés à la hauteur de la crise, il faudrait sans doute s’en réjouir. La réinstallation deviendrait un mécanisme de gestion et non d’entrave aux mouvements migratoires. Il faut pour cela que les chiffres soient à la hauteur de la crise et des demandes. Il faut aussi de la transparence et des procédures respectueuses de l’état de droit européen. Cela signifie, d’une part, un contrôle par la Cour de justice, notamment sous l’angle de la Charte, des instruments adoptés. D’autre part, cela implique un examen individualisé, de qualité, accompagné de recours effectifs, même au-delà des frontières européennes. Ces conditions ne sont pas réunies à ce jour. De la même manière que le Règlement Dublin a opéré des transferts en se fondant sur une présomption d’équivalence de protection sans avoir assuré celle-ci, ces nouveaux mécanismes vont opérer sur la base d’une présomption plus faible encore de respect des droits, hors de tout contrôle.
Que les nouvelles stratégies de l’Union européenne intègrent la gestion externe des migrations, c’est tout naturel. La gestion de l’immigration suppose naturellement la coopération avec des États tiers outre la coopération qui peut exister entre États déléguant à une organisation comme l’Union européenne le soin de négocier avec des États tiers. Il faut toutefois que les actes posés assument leur identité européenne. Celle-ci exige leur justiciable et le maintien de contrôles de qualité dans une matière aussi délicate sous l’angle des droits humains que l’immigration.
Appendices
Notes
-
[1]
CE, Règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte), [2013] JO, L 180/31 (dit « Règlement Dublin III » car il fait suite à une Convention de Dublin du 14 juin 1990 et au Règlement Dublin II du 18 février 2003) [CE, Règlement (UE) 604/2013].
-
[2]
Hirsi Jamaa et autres c Italie, n° 27765/09, [2012] CEDH [Hirsi Jamaa et autres c. Italie].
-
[3]
CE, Déclaration UE-Turquie, [2016], Communiqué de presse 144/16, en ligne : CE <https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf>; Voir aussi J.-B.F. et G.R., « Tribunal de l’Union européenne, 28 février 2017, NF, NG et NM/Conseil européen, aff. T-192/16, T-193/16 et T-257/16 » CeDIE (19 avril 2017), en ligne : UCLouvain <https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/tribunal-de-l-union-europeenne-28-fevrier-2017-nf-ng-et-nm-conseil-europeen-aff-t-192-16-t-193-16-et-t-257-16.html>.
-
[4]
CE, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, [2012], JO, C 326/391 [Charte européenne].
-
[5]
Voyez notamment Elspeth Guild et al, « The 2015 Refugee Crisis in the European Union » CEPS Policy Brief (septembre 2015), en ligne : CEPS <www.ceps.eu/system/files/CEPS%20PB332%20Refugee%20Crisis%20in%20EU_0.pdf>; Karen Akoka, « Crise des réfugiés, ou des politiques d’asile ? » La vie des idées (31 mai 2016), en ligne : La vie des idées <www.laviedesidees.fr/Crise-des-refugies-ou-des-politiques-d-asile.htm>.
-
[6]
CE, Directive 2001/55 du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection internationale en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, [2001] JO, L 212 [CE, Directive 2001/55].
-
[7]
Ibid, art 2c.
-
[8]
Ibid, art 5.
-
[9]
Voir aussi Meltem Ineli-Ciger, « Time to activate the Temporary Protection Directive » (2016) 18:1 Eur J Migr & L 1 [Ineli-Ciger]; Henri Labayle, « La politique européenne d’asile : Strange fruit? » Réseau universitaire européen (9 septembre 2015), en ligne : GDR ˂www.gdr-elsj.eu/2015/09/09/asile/la-politique-europeenne-dasile-strange-fruit-i/˃ [Labayle].
-
[10]
UNHCR, Global Trends : Forced Displacement in 2017, 2017, en ligne : UNHCR ˂https://www.unhcr.org/globaltrends2017/#_ga=2.57321187.874334244.1529335278-1194207618.1529335278˃.
-
[11]
Ibid.
-
[12]
Eurostat, « Graphique 2 : Pays d’origine des demandeurs d’asile (ressortissants de pays tiers) dans les États membres de l’UE-28, 2015 et 2016 (en milliers de primo-demandeurs d’asile) » Statistique sur l'asile (octobre 2018), en ligne : Eurostat ˂ecuropa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/fr˃ [Eurostat].
-
[13]
Eurostat, « Asylum decisions in the EU. EU Member States granted protection to more than half a million asylum seekers in 2017. Almost one third of the beneficiaries were Syrians » (19 avril 2018), en ligne : Eurostat ˂ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58˃ [Eurostat].
-
[14]
UNHCR, « Aperçu statistique » Tendances mondiales (2016), en ligne : UNHCR <www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html>.
-
[15]
CE, Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), [2013] JO, L 180/96 [CE, Directive 2013/33/UE].
-
[16]
CE, Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale (refonte), [2013] JO, L 180/60 [CE, Directive 2013/32/UE].
-
[17]
CE, Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte), [2011] JO, L 337/9.
-
[18]
CE, Règlement (UE) 604/2013, supra note 1.
-
[19]
Voyez notamment Vincent Chetail, Philippe De Bruycker et Francesco Maiani, dirs, Reforming the Common European Asylum System. The New European Refugee Law, Leyde, Martinus Nijhoff Publishers, 2016.
-
[20]
Voyez notamment les données d’Eurostat qui reprennent les taux de reconnaissance pays par pays : Eurostat, supra note 13.
-
[21]
Le Lichtenstein, l’Islande, la Norvège et la Suisse.
-
[22]
CE, Règlement (UE) 604/2013, supra note 1, art 15.
-
[23]
Ibid, art 3 au para 2.
-
[24]
M S S c Belgique et Grèce, n° 30696/09, [2011] CEDH 1 [M S S c Belgique et Grèce].
-
[25]
N S (C-411/10) c Secretary of State for the Home Department et M E (C-493/10), A S M, M T, K P, E H c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2011] CEDH.
-
[26]
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 R.T.N.U. 221 (entrée en vigueur : 3 septembre 1953) [CEDH].
-
[27]
M S S c Belgique et Grèce, supra note 24 au para 326.
-
[28]
Bosphorus c Irlande, req. n° 45036/98, [2005] CEDH aux paras 150 et 165.
-
[29]
CE, Règlement (UE) 604/2013, supra note 1, art 3.
-
[30]
Tarakhel c Suise, n° 29217/12, [2014] en ligne : gdr-elsj.eu <www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2017/02/AFFAIRE-TARAKHEL-c.-SUISSE.pdf>.
-
[31]
Shiraz Baig Mirza c Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, n° C-695/15, [2016] en ligne : curia.europa.eu <curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175167&doclang =FR>.
-
[32]
J B Farcy, « L’application du concept de pays tiers sûr dans le régime Dublin : énonciateur du régime à venir? » UCLouvain (mai 2016), en ligne : UCLouvain <uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/c-j-u-e-17-mars-2016-mirza-aff-c-695-15-ppu-ecli-eu-c-2016-188.html>.
-
[33]
Christophe Pouly, « Système "Dublin" et défaillances systémiques : la preuve impossible » Éditions législatives (6 janvier 2017), en ligne : Éditions législatives <www.editions-legislatives.fr/content/syst%C3%A8me-dublin-et-d%C3%A9faillances-syst%C3%A9miques-la-preuve-impossible>.
-
[34]
Ibbrahimi and Abasi v Secretary of State for the Home Department, [2018] EWHC Civ 445 (Admin).
-
[35]
Élargissement du critère familial, du critère lié à la résidence préalable dans un État membre, ajout d’un critère lié aux études préalables dans un État membre, etc.
-
[36]
CE, Directive 2013/33/UE, supra note 15, art 35.
-
[37]
Ibid, art 39.
-
[38]
Ibid, art 38.
-
[39]
Ibid, art 38 au para 2.
-
[40]
Angeliki Tsiliou, « When Greek judges decide whether Turkey is a Safe Third Country » EU Immigration and Asylum Law and Policy (29 mai 2018), en ligne : EU Migration Law Blog <eumigrationlawblog.eu/when-greek-judges-decide-whether-turkey-is-a-safe-third-country-without-caring-too-much-for-eu-law>; Mariana Gkliati, « The EU-Turkey Deal and the Safe Third Country Concept before the Greek Asylum Appeals Committees » (2017) 3:2 Movements 213.
-
[41]
Ineli-Ciger, supra note 9 aux pp 1-33; Labayle, supra note 9; Henri Labayle et Ph De Bruycker, « La marche turque : quand l’Union sous-traite le respect de ses valeurs à un État tiers » Réseau Universitaire européen (9 mars 2016), en ligne : GDR <www.gdr-elsj.eu/2016/03/09/asile/la-marche-turque-quand-lunion-sous-traite-le-respect-de-ses-valeurs-a-un-etat-tiers>; L Tsourdi et P de Bruycker, « Relocalisation : une réponse adéquate face à la crise de l’asile? Note d’analyse » UCLouvain (septembre 2015), en ligne : UCLouvain <uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/relocalisation-une-reponse-adequate-face-a-la-crise-de-l-asile-note-d-analyse.html>.
-
[42]
CE, Traité sur le fonctionnement du l'Union Européenne, [2012], JO, C326/47, art 78 au para 3 [Traité].
-
[43]
CE, Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, [2015] JO, L 248/80.
-
[44]
CE, Décision (UE) 2015/1523 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, [2015], JO, L 239/146; CE, Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, [2015], JO, L 248/80.
-
[45]
CE, Règlement (UE) 604/2013, supra note 1, art 13.1.
-
[46]
Pour plus d'information, voir Bureau européen d'appui en matière d'asile, en ligne : EASO <easo.europa.eu>.
-
[47]
Sur cet arrêt, voir notamment L Leboeuf, « Relocalisation des demandeurs d’asile. La Cour de justice confrontée à l’identité nationale » UCLouvain (septembre 2017), en ligne : UCLouvain <uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/c-j-u-e-6-septembre-2017-republique-slovaque-et-hongrie-c-conseil-aff-jointes-c-643-15-et-c-647-15.html>.
-
[48]
CJE, République Slovaque et Hongrie c Conseil de l'Union européenne, C-643/15 et C-647/15, [2017] ECR au para 77 [CJE, République Slovaque et Hongrie c Conseil de l'Union européenne].
-
[49]
Ibid au para 75.
-
[50]
Ibid aux para 124, 207.
-
[51]
CE, Traités de Rome, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [1957], JO, L 198 (entrée en vigueur : 1er janvier 1958) [CE, TFUE].
-
[52]
CJE, République Slovaque et Hongrie c Conseil de l'Union européenne, supra note 48 aux paras 253, 293, 304, 329.
-
[53]
CJE, République Slovaque et Hongrie c Conseil de l'Union européenne, C-643/15 et C-647/15, [2017], Conclusions de l’avocat général M. Yves Bot, présentées le 26 juillet 2017, au para 24, en ligne : InfoCuria <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193374&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=392304>.
-
[54]
Hirsi Jamaa et autres c Italie, supra note 2.
-
[55]
Conseil de l’Union européenne, Communiqué de presse relatif à la déclaration UE-Turquie, Bruxelles, CE, 2016.
-
[56]
CE, Déclaration UE-Turquie, supra note 3 à la p 1.
-
[57]
Voir notamment Olivier Corten et Marianne Dony, « Accord politique ou juridique : Quelle est la nature du “machin” conclu entre l’UE et la Turquie en matière d’asile? » EU Immigration and Asylum Law and Policy (10 juin 2016), en ligne : EU Migration Law Blog <eumigrationlawblog.eu/accord-politique-ou-juridique-quelle-est-la-nature-du-machin-conclu-entre-lue-et-la-turquie-en-matiere-dasile/>.
-
[58]
CE, NF, NG et NM c Conseil européen, affaires T-192/16, T-193/16 et T-257/16, [2016] JO, C 232/25 [CE, NF, NG et NM c Conseil européen]; J-B Farcy et G Renaudière, « L’accord UE-Turquie devant le Tribunal de l’Union européenne : une incompétence lourde de conséquences? » UCLouvain (mars 2017), en ligne : UCLouvain <uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/tribunal-de-l-union-europeenne-28-fevrier-2017-nf-ng-et-nm-conseil-europeen-aff-t-192-16-t-193-16-et-t-257-16.html>; Henri Labayle, « L’accord Union européenne avec la Turquie : l’heure de vérité? » Réseau universitaire européen (28 avril 2016), en ligne : GDR <www.gdr-elsj.eu/2016/04/28/asile/laccord-union-europeenne-avec-la-turquie-lheure-de-verite/>; Jean-Baptiste Farcy, « EU-Turkey agreement : solving the EU asylum crisis or creating a new Calais in Bodrum? » EU Immigration and Asylum Law and Policy (7 décembre 2015), en ligne : EU Migration Law Blog <eumigrationlawblog.eu/eu-turkey-agreement-solving-the-eu-asylum-crisis-or-creating-a-new-calais-in-bodrum/>; Marion Tissier-Raffin, « Crise européenne de l’asile : l’Europe n’est pas à la hauteur de ses ambitions » (2015) 8 La Revue des droits de l’homme 1.
-
[59]
Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisation internationales, 21 mars 1986, RTNU 243 (pas encore en vigueur) [Convention de Vienne de 1986].
-
[60]
CE, NF, NG et NM c Conseil européen, supra note 58 au para 10.
-
[61]
CE, Directive 2013/32/UE, supra note 16.
-
[62]
X et X c État Belge, C-638/16 PPU, [2017].
-
[63]
CE, Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, [2009] JO, L 243/2 [Code des visas].
-
[64]
CJE, Affaire C-638/16 PPU, Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi, présentées le 7 février 2017, ECR au para 176 (2), en ligne : InfoCuria <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5c05d4f8de37e465bace3a24af7d46453.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLaxb0?text=&docid=187561&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=293820>.
-
[65]
Voir notamment Violeta Moreno-Lax, « Asylum Visas as an Obligation under EU Law : Case PPU C-638/16 X, X v État belge » EU Immigration and Asylum Law and Policy (16 février 2017), en ligne : EU Migration Law Blog <eumigrationlawblog.eu/asylum-visas-as-an-obligation-under-eu-law-case-ppu-c-63816-x-x-v-etat-belge/>.
-
[66]
Sylvie Sarolea, Jean-Yves Carlier et Luc Leboeuf, « Délivrer un visa humanitaire visant à obtenir une protection internationale au titre de l’asile ne relève pas du droit de l’Union : X. et X., ou quand le silence est signe de faiblesse » Justice en ligne (mars 2017), en ligne : Justice-En-Ligne <www.justice-en-ligne.be/article974.html>.
-
[67]
À propos de ces compacts, voir notamment CE, « Migration partnership framework. A new approach to better manage migration », en ligne : CE <eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_ec_format_migration_partnership_framework_update_2.pdf>; Nations Unies, « Compact for migration » Refugees and Migrants, en ligne : Nations Unies <refugeesmigrants.un.org/migration-compact>; Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law, « The 2018 Global Compacts on Refugees and Migration » UNSW Sydney (22 avril 2018), en ligne : ARKCIRL <www.kaldorcentre.unsw.edu.au/publication/2018-global-compacts-refugees-and-migration>; Stefan Lehne, « Upgrading the EU’s Migration Partnerships » Carnegie Europe (21 novembre 2016), en ligne : Carnegie Europe <carnegieeurope.eu/2016/11/21/upgrading-eu-s-migration-partnerships-pub-66209>; Céline Bauloz, « The EU Migration Partnership Framework : an External Solution to the Crisis? » EU Immigration and Asylum Law and Policy (31 janvier 2017), en ligne : EU Migration Law Blog <eumigrationlawblog.eu/the-eu-migration-partnership-framework-an-external-solution-to-the-crisis>. Pour une présentation détaillée et une analyse critique et contextualisée de ces compacts, voir notamment AEDH, « "Partenariats", "migration compacts"… les nouveaux habits de l’externalisation de la politique migratoire européenne » Asile et immigration (22 décembre 2016), en ligne : AEDH <www.aedh.eu/partenariats-migration-compacts-les-nouveaux-habits-de-lexternalisation-de-la-politique-migratoire-europeenne>.
-
[68]
CE, Communication de la Commiddion su Parlement européen, au Conseil européen, au Consel et à la Banque européenne d'investissement relative à la mise en place d'un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l'Agenda européen en matière de migration, [2016] JO [Communication du 7 juin 2016].
-
[69]
CE, Communiqué de presse, La Commission annonce un nouveau cadre pour les partenariats de migration : une coopération renforcée avec les pays tiers pour mieux gérer les migrations, CE, 2016.
-
[70]
Premier bilan : CE, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil; premier rapport d'avancement relatif au cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l'agenda européen en matière de migration, Bruxelles, CE, 2016; Deuxième bilan : CE, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil; deuxième rapport d'avancement : premiers résultats en ce qui concerne le cadre de partenariat avec les pays tiers au titre de l'agenda européen en matière de migration, Bruxelles, CE, 2016; Troisième bilan : CE, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil; thrid progress report on the partnership framework with third countries under the European Agenda on Migration, Bruxelles, CE, 2017; Quatrième bilan en juin 2017 : CE, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil; fourth progress report on the partnership framework with third countries under the European Agenda on Migration, Strasbourg, CE, 2017.
-
[71]
CE, « Joint Way Forward on migration issues between Afghanistan and the EU », en ligne : ˂eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf>.