Abstracts
Résumé
Dans plusieurs enquêtes ethnographiques réalisées sur les manières de lire contemporaines, un élément inattendu a émergé dans les témoignages recueillis : la condition de solitude, volontairement et minutieusement aménagée par les personnes qui aiment lire. Bien que ces lecteurs ne se considèrent pas eux-mêmes comme des « solitaires », ils insistent particulièrement sur le retrait comme conquête sur et contre leur entourage. Cette solitude choisie semble relever d’un quasi-engagement tant elle est arrachée de la trame sociale dense dans laquelle ils vivent au quotidien. Pour ces lecteurs et lectrices, c’est le retrait pour lire qui a une signification particulière. Pour les femmes et les hommes interrogés, l’éloignement du groupe se construit à l’articulation des rapports sociaux d’âge et des rapports sociaux de genre : c’est en effet à l’intersection de figures aussi contradictoires, contrastées et mutuellement exclusives que celle de l’enfant-qui-lit, de l’homme-qui-lit et de la femme-qui-lit que prend sens leur retrait pour lire.
Mots-clés :
- lecture,
- conditions sociales de possibilité,
- âge,
- genre
Abstract
Different ethnographical studies on the contemporary reading experience show that solitude is chosen and set up by readers voluntarily and precisely. Not solitary people themselves, these readers have to conquer the necessary solitude for reading in spite of, and sometimes against, their social environment. In certain contexts, being a reader demands a steady action to retire from daily commitments and social interactions. For the reading women and the reading men whose daily habits and organization are analyzed here, the core of the problem is how retire from the intense social involvement they are part of : actually, there are strong effects of age and effects of gender in the social conditions that make the reading possible and desirable. Consequently, some patterns for this kind of social retreat can be drawn from different, and sometimes contradictory, configurations such as reading-as-a-child, reading-as-a-woman or reading-as-a-man.
Keywords:
- The reading,
- social framework,
- contexts,
- the effects of age,
- the effects of gender
Resumen
En varias investigaciones etnográficas realizadas acerca de las maneras contemporáneas de leer, surgió un elemento inesperado en los testimonios recogidos : la condición de soledad, voluntaria y minuciosamente preparada por las personas que les gusta leer. Aunque estos lectores no se consideran a sí mismos “solitarios”, insisten particularmente en el retiro como una conquista de quienes les rodean y en contra de éstos. Esta soledad elegida parece depender de un cuasi-compromiso, tanto que es arrancado de la trama social densa en la que viven a diario. Para estos lectores y lectoras el retiro para leer como tal tiene un significado especial. Para las mujeres y hombres entrevistados el alejamiento del grupo se construye en la articulación de las relaciones sociales de la edad y las relaciones sociales de género : es en efecto en la intersección de figuras tan contradictorias, contrastadas y mutuamente excluyentes como la del niño-que-lee, el hombre-que-lee y la mujer-que-lee, que toma sentido su retiro para leer.
Palabras clave:
- lectura,
- condiciones sociales de posibilidad,
- edad,
- género
Article body
Il existe, parmi les lecteurs et les lectrices, certains individus qui, au quotidien, s’arrangent pour sortir volontairement des interactions avec le monde environnant — jugées trop denses ou trop envahissantes — afin de lire. C’est « se faire lecteur » (ou lectrice) qui est ici analysé, pas à pas, suivant le flux des interactions quotidiennes de six personnes ayant pris part à diverses enquêtes ethnographiques sur les façons de lire contemporaines. Les témoignages recueillis auprès des lecteurs racontent des expériences de la lecture comme mise entre parenthèses du monde social, où l’acte de « se faire lecteur » est aussi important que le texte lu. Les solitudes des lecteurs sont des solitudes que l’on incorpore progressivement en aménageant une nouvelle place de soi par rapport aux autres. En plus d’être désirées, ces solitudes sont rigoureusement organisées et précieuses parce qu’elles sont quasiment gagnées contre le groupe (famille, pairs, travail) ou en échange d’un dû social, d’un coût qui parfois est élevé. Car c’est dans un mouvement antagoniste avec des sociabilités intenses que ces lecteurs, solitaires et malgré tout présents dans le collectif auquel ils appartiennent, gagnent ce retrait.
Après avoir rappelé les principaux apports de l’histoire et de la sociologie de la lecture autour de l’acte de lire, ce travail analyse à la fois les conditions sociales de possibilité et les modalités du retrait pour lire, montrant comment elles s’inscrivent étroitement dans les contextes sociaux et comment ces derniers attribuent des sens et des propriétés différentiels à la femme-qui-lit, à l’homme-qui-lit et au jeune-qui-lit.
la lecture d’évasion et ses conditions de possibilité : état des savoirs, choix méthodologiques et hypothèses
Après avoir dressé l’état des lieux des travaux sur la dimension solitaire comme dimension constitutive et symbolique de l’acte de lire, cette première partie du travail montre l’apport spécifique de la posture ethnographique pour faire émerger de nouveaux questionnements sur le degré d’autonomie que gagne l’individu en aménageant ce retrait solitaire par des artifices et des stratégies que son entourage peut accepter.
Les conditions de possibilité et les caractéristiques de l’acte de lire
Lire est un acte suprême de solitude. La personne qui lit ne parle pas, n’entend pas, est absorbée par une histoire tandis que la « vraie vie » continue à se dérouler autour d’elle mais sans elle, qui ne peut ni bouger ni interagir (Escarpit, 1958). Bien qu’intime et silencieuse, la lecture individuelle est insérée dans « une séquence de pratiques articulées les unes aux autres, et non un acte autonome, ayant sa fin en lui-même » (Chartier, 1985 : 71). Parce que les pratiques culturelles sont intimement liées au fonctionnement des structures sociales, elles sont traversées par les luttes de domination des modèles et des règles et dans le même temps offrent un terrain d’appropriations singulières. On sait, par exemple, que les différences d’attitude à l’égard de la lecture traduisent l’existence de cultures de classe qui prolongent dans les loisirs les caractéristiques du travail et sont profondément enracinées dans les conditions concrètes d’existence des individus (Coulangeon, 2011). Lorsqu’on fait partie du monde lettré, on finit par oublier que dans beaucoup de milieux, on ne peut parler de lectures sans avoir l’air prétentieux. Ou bien on a des lectures dont on ne peut pas parler, inavouables, qu’on fait en cachette (voir Chartier, op. cit. : 225). Ainsi, pour comprendre la portée de l’acte de lecture dans une société, dans une condition sociale donnée, il faut plonger dans l’ordinaire des « petits lecteurs » en faisant une ethnographie minutieuse des lecteurs de la Bibliothèque Bleue (Chartier, 1987), en retrouvant les traces des difficultés à passer tout seul de l’oral au texte écrit (Darnton, 1985) ou des tâtonnements chez un autodidacte (Hébrard, 1985). Il devient alors possible de restituer les étapes pour se faire lecteur, dans le silence, la solitude et l’immobilité. Les trois traits distinctifs de l’acte de lire, qui semblent aujourd’hui consubstantiels de la lecture et du lecteur, sont la résultante d’un processus historique long. Pour R. Chartier, l’acte de lire se déploie dans des conditions de possibilité et des limites obligées qui sont tout aussi légitimes à étudier que le sont les textes ou les pratiques de lecture.
On sait que les dispositions à se tenir, à tenir son corps, à lire en restant concentré et en silence, ont été gagnées historiquement par les prescripteurs et producteurs de texte, puis par l’institution scolaire sur les communautés et les groupes sociaux et que, d’un point de vue sociologique, elles sont aussi le fruit de modes de socialisation spécifiques. Depuis le travail de B. Lahire sur les transferts culturels imparfaits dans la socialisation familiale et scolaire et les processus de resocialisation (Lahire, 2004), on sait que, tout au long de leur existence, les individus façonnent autant qu’ils sont façonnés par les objets culturels qui les entourent et que leur rapport à la lecture se recompose sans cesse au gré des contextes quotidiens — économique, social, professionnel, amical, conjugal, familial, associatif, politique, syndical.
Là où l’opposition classique nous a habitués à une vision dichotomique de la lecture savante et de la lecture populaire, l’enquête de terrain montre plutôt des positions nuancées, des appropriations hésitantes et même des résistances. Se faire lecteur, s’isoler et rester immobile peut, dans certaines circonstances, revêtir l’allure d’une conquête individuelle. Cette conquête prend un sens particulier pour certains rôles sociaux et dans certains contextes où prime la force du collectif et des liens sociaux.
La lecture d’évasion, celle qui permet de s’échapper de son quotidien, semble être une pratique relativement indépendante des positions sociales et des ressources culturelles et scolaires détenues, bien qu’elle soit le plus souvent déniée par les plus lettrés des lecteurs ordinaires et assimilée à une prédilection féminine pour le romanesque. Les enquêtes sociologiques indiquent un ensemble de corrélations entre lecture d’évasion et effets de genre, « âges de la vie » ou telle condition marquée par la solitude ou l’ennui, ou encore telle conjoncture idéologico-politique particulière. Lecteurs et lectrices de romans ont cependant ceci en commun qu’ils manquent d’opportunités d’investissements subjectifs dans le monde réel, ce que vient combler l’évasion dans le monde fictif, et qu’ils sont plus que d’autres enclins à « faire comme si » en place du « faire » et à « se raconter des histoires » (Mauger et Poliak, 1998 : 8). C’est du moins ce que déclarent les Smithton women de J. Radway, lectrices silencieuses devenues lectrices déclarées, passionnées par des romans sentimentaux, éduquées pourtant au sens pratique et au dévouement aux autres (Radway, 1987). Parfois, la passion de lire des romans prend le pas sur les (pré-)occupations quotidiennes jusqu’à devenir une sorte d’addiction : ainsi certaines parmi ces lectrices gardent le roman à portée de main, profitent du moindre moment libre dans la journée pour se replonger dans l’intrigue, lisent tous les jours, avec soif et intensité, s’impliquent profondément dans l’aventure romantique, détestent laisser à moitié la lecture, trouvent des stratégies pour voler quelques minutes par-ci par-là au déroulement incessant des activités de la vie quotidienne, etc. Interrogées sur ce qu’elles trouvent dans la lecture de ces romans, ces femmes évoquent de manière convergente et insistante l’expérience de la lecture de romans comme un moyen pour s’évader vers quelque chose d’exotique ou de différent. Radway souligne la concomitance entre le fait de lire, le fait de lire des romans et la découverte de besoins affectifs et de désirs inassouvis chez ses lectrices. La centralité de l’acte de lire est revendiquée par les lectrices elles-mêmes : « Indeed, it was the women readers’ construction of the act of romance reading as a “declaration of independence” that surprised me into the realization that the meaning of their media-use was multiply determined and internally contradictory and that to get at its complexity it would be helpful to distinguish analytically between the significance of the event of reading and the meaning of the text constructed as its consequence » (ibid. : 7). Ces lectrices font le lien entre le fait de lire et leur condition d’épouses et de mères. Autrement dit, l’acte de lire prend son sens dans le flux des interactions ordinaires, ce que Radway décrit tout à la fois comme des conditions de possibilité (aménagement de la vie privée), des effets de position (des femmes qui résistent en tant que femmes à la domination en faisant avec les moyens de leur condition) et des stratégies de mise à distance des cadres sociaux qui sont les leurs. De manière assez significative pour mon hypothèse du retrait difficile des lecteurs, Radway montre que le seul et simple acte de prendre un livre dans les mains finit par devenir un signe d’indisponibilité pour ces femmes ; leur entourage les reconnaît « temporarily off-limits » et cesse provisoirement d’exiger affection, attention et soins. On peut alors, suivant Radway, attendre de cette évasion (« escape ») qu’elle ait un sens double : fuite de leur condition dans la vie ordinaire et projection dans un ailleurs imaginé. Mais, au lieu d’échanger la réalité contre ce monde imaginaire, ces lectrices prennent appui sur l’évasion temporaire pour colorier différemment, avec plus d’entrain et de légèreté, la vie de tous les jours et leurs relations aux êtres chers. Preuve qu’on devient lecteur non pas en quittant sa condition, mais à l’intérieur de celle-ci et que c’est bien à partir de cette condition qu’on peut comprendre comment l’acte de lire engendre le sentiment d’une transformation et l’impression de bouger par rapport à ce qu’on était. C’est ainsi que Dot la libraire, interrogée par Radway, exprime ce changement : « Now what have you been doing with your time ? and you begin to be feeling, now really, why is he questioning me ? » et fait la démonstration de l’indépendance ainsi conquise par ces lectrices de romans en tant qu’individus (Radway, op. cit. : 93). De fait, le retour rassurant aux tâches et aux responsabilités a quelque chose de subversif en soi : par la manière de se situer dans la réalité, de regarder cette réalité et de se poser à son propos des questions jusque-là restées impensées. Ajoutons à cela la conscience du temps que le retrait implique — temps pour soi et temps pour les autres ; conscience de l’espace des autres et de l’espace pour soi ; puis réflexivité sur ses propres gestes, habitudes et pratiques, désirs et plaisirs. Dans ces conditions, peut-on croire que ces individus qui transitent entre la réalité et la fiction restent les mêmes, aux mêmes places, et qu’ils continuent à reproduire l’ordre d’avant ?
Les choix méthodologiques pour les études de cas
Afin d’étudier le sens différentiel de « se retirer pour lire », qui est aussi « lire pour se retirer », j’utilise les entretiens recueillis auprès de six personnes, au cours d’enquêtes de terrain réalisées entre 2004 et 2015 (voir l’encadré ci-dessous). Il s’agit d’entretiens qui font référence de manière insistante et répétée au fait d’« être seul en lisant ».
Il faut préciser que la référence à la solitude n’est pas explicite chez les six. La solitude engendrée par l’état de lecteur et de lectrice n’est pas une solitude dont on parle et que l’on nomme : on semble parfois même vouloir s’en excuser. Ce qui distingue les six témoignages est l’importance qu’ils accordent à la difficulté éprouvée pour se détacher des tâches successives qui scandent leur journée de travail (domestique, pédagogique ou d’étude). De manière significative, ce sentiment d’entrave à s’isoler et à s’absenter s’exprime chez les six personnes par le besoin de revenir sur la description minutieuse, presque maniaque, du moment et du lieu de leurs lectures, ce qui donne à cette partie des entretiens un registre argumentatif soutenu, comme s’ils tenaient tous à souligner un certain degré de volonté requise par cet acte.
La centralité du thème du retrait chez les six lecteurs se traduit également par une occurrence plus élevée de toute une série de termes relevant du champ sémantique du « choix » tels que « initiative », « tentative », « essai », « test », « épreuve », « truc à essayer », « intention », « envie », « force », « volonté », qui constituent une manière de plaider leur cause, comme s’ils devaient se défendre. Et s’ils n’utilisent ni le mot « solitude », ni celui d’« isolement », ou encore de « retrait », c’est parce que ce sont des catégories non seulement abstraites, mais figeant une rupture avec l’entourage, alors que les six interlocuteurs mettent un point d’honneur à montrer qu’ils restent engagés dans leur groupe respectif.
Par la diversité des profils, des conditions, des trajectoires et des âges de la vie, ces six parcours de lecteurs permettent de saisir les points communs et les singularités éprouvées autour de la solitude choisie des lecteurs. Analysés comme des variations d’une expérience sociale dont le sens change selon la position de l’individu, ces témoignages présentent une gamme de dégradés d’un même processus d’individualisation des choix et de singularisation des actes.
La posture ethnographique consiste à analyser les situations quotidiennes et les flux d’interactions, dans lesquels se dessine l’éloignement comme découverte, exploration, puis expérience et intention, sur la base d’un échantillon très réduit. J’ai voulu décrire la chaîne des mouvements dans laquelle émerge concrètement la possibilité de se retirer pour lire. Se retirer implique deux éléments au moins : la décision de s’éloigner et la décision de se soustraire aux interactions. C’est un mouvement vers l’extérieur, qui prend sa source dans un processus expérientiel centré sur l’être-là, non pas le départ, non pas la fuite, mais une suspension pendant laquelle on explore un autre régime de fonctionnement. Les modifications corporelles et comportementales sont alors des signes auxquels il faut prêter attention : le fait, par exemple, de « s’habiller » pour lire ou de travailler à une certaine présentation de soi ou bien encore d’établir des rituels, tous ces indices semblent indiquer que la préparation du corps est non seulement une mise en condition de l’esprit, mais un préambule dans la préparation des autres à une certaine absence et du soi à une soustraction temporaire à toute relation. D’abord sans conscience, ensuite avec une conscience progressive de la condition inédite dans laquelle se trouve ainsi l’individu, jusqu’à ce que le dessein du retrait prenne forme comme une intention, une condition assumée, celle d’une solitude choisie. En somme, on se préparerait et on préparerait les autres à l’absence exigée par la lecture. Et cette préparation me semble porter en elle des éléments intéressants pour analyser la relation du soi avec les autres lorsque se glisse entre les deux une certaine distance.
L’expérience sociale de la solitude élective : trois hypothèses
Un échantillon si réduit impose d’avancer précautionneusement sur les hypothèses. L’hypothèse de la solitude comme condition et expérience sociales s’est dégagée de manière inductive et très progressivement.
Chez certains lecteurs et lectrices, l’introduction d’une possibilité de lecture dans leur temps quotidien passe par la conquête d’un havre de paix, démarche plus ou moins difficile et freinée selon les contextes et l’amplitude des liens et des contraintes. Parmi les conditions favorables au retrait individuel, il en est une qui concerne directement la distribution des places dans les rapports sociaux : il s’agit de la possibilité de ne pas répondre à l’injonction d’agir et à s’autoriser une pause. Car lire revient à s’accorder le droit de « ne pas faire », en se soustrayant temporairement à la relation avec les autres, tout en restant lié aux autres (qui agissent). C’est l’approche par le genre qui permet de faire ressortir le propre de situations de domination à ce point incorporées que même les rêves d’évasion et les subterfuges d’allègement des tâches quotidiennes s’en trouvent conditionnés. La première hypothèse à tester dans ce travail est donc celle d’un retrait enraciné à l’intérieur des liens sociaux et pris dans les déterminations sociales. Le trait commun qui se dégage de ces trajectoires est la suspension temporaire de la densité des interactions, avec des aménagements, des négociations et des arrangements. La question est de savoir dans quelle mesure les sociabilités qu’on quitte pour lire ne sont pas au principe même du besoin répété et jamais assouvi de lire pour se retirer, comme semble le laisser entendre par moments Radway à propos des Smithton women. Dans quel sens faut-il prendre la relation ? L’acte de lire est-il à l’origine du retrait ou bien est-il un effet du projet de retrait — auquel cas il s’agirait d’abord d’une évasion au sens littéral du terme, avant d’être une évasion littéraire ? Dans trois des six études de cas proposées ici, en effet, les personnes — deux femmes et un jeune — peinent à s’extraire de la force des liens qui occupent leur quotidien et semblent retrouver la lecture comme un havre de paix plus que dans un rapport au texte hautement désiré.
La deuxième hypothèse porte sur l’individualité, dont on peut se demander si elle devient plus pleine, plus consciente à la suite des efforts accomplis pour se retirer dans une solitude choisie. La place du « lecteur en retrait » permet à l’individu singulier de développer une résistance à la puissance de l’appel du groupe, qui se trouve ainsi désamorcée. Les lecteurs eux-mêmes ne semblent pas se considérer comme des « solitaires » et, selon les milieux, le groupe d’âge et de sexe, ils peuvent ne pas revendiquer la solitude comme condition idéale, recherchée ou distinctive. Au contraire, parfois, le stigmate lié au retrait volontaire serait plutôt un danger identitaire que les jeunes — comme en témoignent les stratégies de lecture de l’enfant et de l’étudiant étudiés plus loin — éviteraient en se cachant pour lire ou en déguisant leurs séjours en bibliothèque sous forme de séjours pour « étudier ». Il est intéressant de vérifier quels sont les artifices employés pour déguiser cette solitude choisie et les conséquences sur la réputation sociale des lecteurs. De même, certaines digressions dans les récits des lecteurs laissent entendre qu’il y aurait un coût à cette absence que les lectrices comme les lecteurs s’emploieraient à « racheter ».
Troisième et dernière hypothèse à explorer : voir si les individus qui s’isolent pour lire dans des contextes défavorables à la lecture silencieuse et solitaire bénéficient d’une marge d’action plus ample ; si, en d’autres termes, ils introduisent un peu de jeu dans les habitudes routinières et les répertoires d’action rodés et répétés après les efforts de résistance et de volonté qu’ils ont fournis. L’hypothèse serait que, à la suite des éloignements successifs pour lire, une distance relativement aux places, aux rôles et aux rapports sociaux s’introduirait dans la relation aux autres et à soi, qui prendrait l’allure d’un déplacement de point de vue sur soi et d’un gain en réflexivité.
l’expérience sociale de la solitude élective : variations sur le retrait pour lire
Les études de cas servent ici à explorer l’hypothèse de l’éloignement par la lecture comme porte de sortie des liens sociaux. Au cours des détours qu’il faut accomplir pour s’absenter provisoirement, puis pour revenir, l’être social se déplacerait et changerait à la suite de la manière chaque fois légèrement décalée de reprendre sa place. Chez les six lecteurs retenus pour l’analyse, la stratégie passe par la conquête d’un havre de paix à contretemps des dynamiques ordinaires de leur quotidien et du groupe dont ils s’extraient. Ce havre de paix correspond souvent à un lieu où l’on peut se soustraire à l’ordre établi des rôles sociaux : bibliothèque publique, bibliothèque universitaire, arrière-boutique, boudoir, véranda, etc. C’est le cas d’un jeune garçon, récemment arrivé en cité et ayant été intégré à la bande de copains, qui repère la bibliothèque de quartier comme un abri ; celui d’un étudiant, bien intégré au groupe d’étude en bibliothèque universitaire (BU), qui se met de côté pour trouver un rythme individuel plus adapté ; celui d’un enseignant ingénieur totalement impliqué dans les activités pédagogiques et créatives des élèves ingénieurs, qui s’éloigne de son institut pour être seul et devient un anonyme lecteur en médiathèque ; celui d’un jeune qui, dans l’étroitesse d’une cellule de prison partagée, parvient à mettre à distance les pressions sociales ; celui de deux femmes qui, dans deux contextes différents (un village français et le Mezzogiorno italien), transforment la solitude contrainte de la boutique en solitude remplie de lectures. Toutes ces figures produisent de petites révolutions individuelles au coeur du système social auquel ces personnes appartiennent et mettent du jeu là où les rôles et les places semblaient immuables.
La question qui se pose est alors de savoir si et dans quelle mesure ces deux régimes d’action sont liés. En d’autres termes, le fait d’être profondément et durablement engagé dans le flux ordinaire des interactions ne génère-t-il pas un besoin de suspendre, pour un temps, la présence ? Il s’agit moins d’attester une relation de cause à effet que d’explorer les chemins menant progressivement à l’émergence d’un désir de retrait pour soi qui est aussi désengagement relativement aux attentes d’autrui et de comprendre comment ce cheminement se fait jour à l’intérieur de l’expérience ordinaire. Une sorte d’indépendance émerge qui ressemble à la « déclaration d’indépendance » dont parle J. Radway, sorte de cheminement vers la conquête d’une autonomie et d’une pensée individuelle.
S’inventer un lieu à soi et lire : une conquête double
Les deux entretiens dont est issue l’analyse proposée ici ont été réalisés l’un en 2004 et l’autre en 2008. Il s’agit d’entretiens longs dans les deux cas, puisque le premier se déroule en deux fois une heure, à la boutique de layettes dont l’enquêtée est propriétaire, et le second, qui dure une heure et demie, se passe au domicile de l’enquêtée. C’est ensemble que les deux figures laissent entrevoir un fil rouge dans le retrait pour lire, qui dessine un processus en trois étapes, allant de l’individualisation d’un acte hors des habitudes à la tension générée dans l’entourage par ce qui devient une intention, en passant par la personnalisation d’une activité de plaisir.
L’expérience de la solitude concerne deux femmes que rien ne rassemble, si ce n’est le magasin qu’elles tiennent et le déroulement lent du temps qu’elles expérimentent en restant seules de longues heures durant. L’activité extradomestique semble être ici le contexte déclencheur d’un processus qui va de l’expérience de la solitude de facto à son instrumentalisation et transformation avec un projet personnel. Pour ces deux femmes autodidactes, devenues lectrices presque sans le savoir, tardivement et dans leur arrière-boutique, la lecture dans une solitude heureuse est la résultante d’un cheminement qui les amène à une lucidité accrue sur leur place respective au sein de la famille et de la société dans laquelle elles vivent. Paulette, épicière d’un village en Ardèche, et Giuliana, propriétaire d’une boutique de layettes dans une ville d’Italie du Sud, tiennent un commerce qui offre la possibilité de faire l’expérience du retrait et du « bavardage » comme formes de liberté et d’autonomie.
Ici, les couples bavardage/silence et agitation/immobilité ne constituent pas un système antagoniste dans la découverte de la solitude élective : l’une et l’autre continuent de s’agiter et de monologuer à voix haute et opèrent un retrait en même temps qu’elles continuent à travailler. Le retrait est intégré à leur travail, non pas séparé. Les codes et les pratiques avec lesquels elles glissent vers une solitude de lecture s’inscrivent dans le prolongement de l’activité, non dans un régime d’inactivité ou de loisir. Le « bavardage », opposé et antagoniste du silence — du moins dans la posture lectorale classique —, est ici, au contraire, le sas d’accès à une posture que les deux femmes incorporent progressivement. C’est dans cette configuration de coupure avec la sphère domestique, d’activité de commerce et de solitude prolongée qu’émerge le besoin de s’occuper et d’occuper le vide ; et c’est à voix haute que démarre l’acte de lecture, tant il est vrai que lire à voix haute rend l’acte moins exotique et étrange, se rapprochant d’une pratique qui peut être partagée[1] et semble alors plus accessible.
Épouse d’un agriculteur propriétaire de plusieurs terres, restée veuve très jeune, Paulette, qui est retraitée et a soixante-deux ans lorsque je l’interroge en 2008 en Ardèche, ouvre une épicerie dans le village, au bord de la route nationale. Ce qui est singulier dans son parcours est la place grandissante de la lecture dans son quotidien et la manière dont elle parvient à l’articuler avec le reste de ses activités au village et en famille. Paulette, qui me montre les locaux de son ancienne épicerie, décrit son « petit coin pour lire » comme un abri qui la tient à l’écart de l’agitation de la vie quotidienne. L’éloignement du foyer et la nécessité de différencier temps domestique et temps du commerce rompent le continuum des tâches ménagères, éducatives, conjugales, et imposent un rythme de vie serré où les tâches sont accomplies dans un laps de temps contrôlé et régulé. En ce sens, l’expérience de la lecture comme occupation personnelle relève chez ces deux femmes d’une expérience sociale dans la mesure où les conditions de possibilité de retrait ont directement à voir avec leur place dans la structure des places qu’elles occupent. Giuliana, qui a quarante-neuf ans lorsque je l’interroge dans les Pouilles en Italie du Sud, témoigne d’un parcours semblable : elle décide de transformer le grenier de sa boutique de layettes en mansarde habitable (au lieu de simple espace de stockage), avec une table, une chaise et un fauteuil. Comme Paulette, c’est au moment où elle devient mère que Giuliana ressent de manière aigüe la pression de la collectivité sur les façons de faire, de s’organiser. Jeune épouse, elle jouit d’une relative liberté dans son magasin, mais, à l’arrivée de son premier enfant, les choses changent et la pression monte d’un cran pour qu’elle laisse la boutique. Giuliana est en quelque sorte obligée de prendre en compte ces conseils en aménageant les horaires d’ouverture de la boutique qu’elle refuse de fermer ou de donner en gestion. Forte de l’appui de son père, elle résiste à l’énorme pression familiale et sociale et refuse de se diluer dans le couple et l’enfant. Alors, elle déjoue le piège en contournant le problème : elle est une des premières femmes dans sa ville à porter son enfant chez une femme qu’elle n’a pas sous contrôle et qu’elle paye. Elle se fait mal voir, mais avance dans son projet de rester maîtresse de son temps, dans son lieu secret et en arrive à se comporter comme une femme adultère, soupçonnée par l’opinion. Sa position est incompréhensible et soumise à une critique sociale constante. Tandis que Giuliana se souvient des nombreuses et inexpliquées « clientes de l’après-midi » lui rendant visite de manière flagrante sans rien acheter, Paulette évoque à plusieurs reprises les visites régulières et répétées de neveux, voisins, époux, beaux-parents[2], puis de ses enfants eux-mêmes, dépêchés pour inspecter l’emploi des heures creuses et « tenir compagnie ». Au-delà même des soupçons de plaisir illégitime attribués aux lectures féminines, l’intimité qu’induit le retrait de lecture préfigure plus généralement un cadre privé, tenu à l’abri des regards, dans lequel l’individu devient sujet d’émotion et acteur de ses émotions (Conlon, 2005).
Subversive, la lecture l’est au moins sur trois plans pour ces deux femmes et les contextes dans lesquels elles évoluent. Premièrement, sur le plan de la séparation du temps-espace entre la maison et le travail grâce à leur autonomie de gestion de leur commerce : de cette autonomie surgit une certaine liberté d’action. Deuxièmement, sur le plan de l’extraction du temps utile et rempli d’un temps pour soi : une occupation qui secrètement ne produit rien, ne sert à rien sauf à elles-mêmes, faite pour et par elles-mêmes. Troisièmement, la découverte du plaisir qu’engendre le fait de s’isoler avec une intention de repos, pour souffler et suspendre l’action du corps. Le corps des femmes étant au repos, il devient objet de convoitise et soupçon et, dans les représentations sociales d’une femme qui lit, le corps est associé au relâchement sensuel, non pas au travail ou au mouvement (voir Manguel, 1996 : 21). Or, pour Paulette comme pour Giuliana, l’expérience du retrait pour lire se fait au sein même de l’espace où elles travaillent ; mais ce travail leur laisse le loisir d’aménagements solitaires et les fait exister en tant que sujets. C’est dans ce silence qu’elles prennent conscience d’une nouvelle possibilité, celle de convertir le vide en occupation et une occupation en projet. Contre les pressions normalisantes, la conversion d’une solitude subie en solitude élective prend l’allure d’un parcours de quête de soi, qui devient connaissance de soi : il s’agit d’une conquête solitaire grâce à laquelle « la personne perçoit sa part d’auteur » (Schurmans, 2003 : 206). C’est depuis l’intérieur de leur champ d’action que les femmes parviennent, selon les mots de D. Watson, à trouver des niches de pouvoir d’action et à dépasser les qualités morales et esthétiques qu’elles développent sur la scène domestique, en contrepoint des scènes publique et artistique historiquement dominées et occupées par les hommes. « Work is for men and women the most preserved single activity done in isolation » (Bennett et Watson, 2002 : 284).
Bien que situées dans deux contextes sociaux et culturels très différents, les deux expériences présentent plusieurs points en commun qui encouragent à penser le « choix » de l’esseulement enfermé comme une tactique par défaut, silencieuse et peu perturbatrice des cadres sociaux et des normes collectives. La possibilité de retrait qui se dessine dans un lieu distinct du foyer s’insinue dans l’existence des deux femmes, sorte d’échappatoire et de réappropriation d’un destin qui semble tout ordonné. Cette possibilité opère d’abord par l’attrait d’un lieu à soi, géré en autonomie alors que toute l’existence est scandée par les rythmes collectifs et la présence des autres. L’arrière-boutique porte les traces de cette mutation : il est transformé en effet en un lieu à soi où ces deux femmes explorent les possibilités d’une liberté secrète. Abri qu’elle cache pendant de longues années, gardant secrets les moments de lecture, le local de l’épicerie qui est aujourd’hui à l’abandon garde les traces du coin que Paulette arrange pour en faire une sorte de boudoir modeste, dont je peux encore observer le fauteuil avec repose-pieds à la tapisserie rapiécée. Oeuvre de véritable conversion de soi par la transformation d’un lieu et des objets qui le décorent, les représentations de la lecture comme condition féminine et intime sont d’une puissance qui traverse les siècles et les milieux (Chartier, 1985 : 74) : pour que la solitude soit élective, pour qu’elle soit liée à la lecture comme occupation choisie et personnelle, Paulette et Giuliana doivent la mettre en scène pour elles-mêmes selon un modèle standard. Et dans ce modèle, la lectrice est une femme qui, seule, occupe la scène, une femme sujet de son action.
Le jugement social de l’état contemplatif : le cas des hommes
Comme les deux lectrices, quatre lecteurs d’âges et de milieux très différents font état de réelles difficultés pour s’éloigner du groupe. Chez deux enquêtés en particulier, cette difficulté fait l’objet de considérations spontanées, pour le premier (un étudiant) en termes d’« ostracisme » de la part des camarades, pour le second (un enseignant ingénieur) en termes de « regards interrogateurs » de la part des collègues. Ici, le cheminement est l’inverse de celui qu’empruntent les deux femmes : ce n’est pas l’expérience de la solitude qui amène à la découverte de la possibilité du retrait pour lire, mais la lecture qui conduit à la découverte d’une solitude élective. Lire pour soi, seul et séparé de son groupe de travail, est une expérience qui les conduit vers un état dont ils ne sont pas familiers et dont ils parlent à demi-mots, à la fois dubitatifs et gênés : « peu à peu, c’est devenu une habitude que j’apprécie, m’isoler ici derrière les vitres, fermer les écoutilles et lire en mangeant mon sandwich (…), mais quand je réintègre les locaux, je sens des regards interrogateurs sur moi. J’ai fini par raconter que j’allais nager pour mon dos » (Arnaud, l’enseignant ingénieur). L’étudiant fait le même constat, bénéficiant d’un statut plus flou que l’adulte et jouant sur une esthétique de la lecture solitaire : « un peu largué par le rythme des autres, très concentrés ; moi, j’aime bien lever la tête et me perdre dans mes réflexions » (Jean-Loup).
Bien qu’engagés tous les deux dans un travail intellectuel, ces deux hommes éprouvent une gêne à se montrer tels qu’ils sont quand ils lisent pour eux-mêmes, dans un état ralenti et quasi contemplatif. C’est que ni l’un ni l’autre ne correspond alors à la représentation de « l’homme-qui-lit » : quand ils lisent par plaisir, ils n’ont pas une posture attentive, ils cultivent un état contemplatif qui les gêne et gêne les autres autour.
À la suite des transgressions répétées aux règles du groupe (retard lors des rendez-vous du matin, réponse aux appels téléphoniques et aux SMS en cours de séance de travail collective, refus d’obtempérer au calendrier pourtant fixé en commun), Jean-Loup se voit mis de côté. Il accepte cette mise à l’écart car il sent bien qu’il ne peut pas suivre le rythme de travail du groupe ; il préfère s’organiser selon un agenda quotidien plus libre, avec plus de respirations entre les tâches liées aux devoirs et à l’écriture de son mémoire. Occupant une place « à côté », l’étudiant s’installe comme pôle symétriquement opposé à Anna, l’étudiante studieuse du groupe : lui faisant face spatialement, il veut en être à la fois son reflet et son opposé symétrique. Son reflet, car il voudrait au fond être comme elle, discipliné, régulier, « bon étudiant ». Son opposé symétrique, en se posant comme l’artiste romantique pour qui la lecture est d’abord un retour sur soi et le relâchement, une condition nécessaire au rêve. Il affirme que l’intégration trop étroite au groupe le serrait et qu’il n’arrivait plus à réfléchir. Le ralentissement fonctionne dans l’argumentation de Jean-Loup comme exigence antagoniste au rythme soutenu d’Anna jugé trop scolaire[4]. Construit comme l’attribut opposé à la manière de faire de l’étudiante, Jean-Loup met en scène par la lecture solitaire un éloge de la lenteur et joue sur cette posture pour brouiller les pistes : il incarne alors une figure hybride entre l’homme-qui-lit et la femme-qui-lit. La solitude conquise à côté du groupe est revendiquée tout à la fois comme une prise de conscience et une concession à son côté rêveur. En réaction, une sorte de réputation sociale se construit autour de ce lecteur « socialement excusé pour ses absences », à qui les autres reconnaissent une « sensibilité particulière », attribut qui peut paraître flatteur, mais qui de fait rend les hommes ainsi qualifiés suspects quant à leur identité sexuelle. Le côté sensible peut sous-entendre, en effet, un penchant pour le rêve et le silence inactif et dénoter un personnage efféminé, « comme passif par rapport à lui-même, incapable d’exercer sur soi la maîtrise de son corps et de son âme » (Foucault, 2001 : 327). Cette sensibilité particulière est une référence familière évoquée à propos des hommes lecteurs lors de mes deux enquêtes en bibliobus : dans les communautés rurales, le penchant à la contemplation est excusé chez l’artiste (écrivain) ou l’intellectuel (militant) comme un détour nécessaire à l’individu pour prendre du recul par rapport à la réalité et pouvoir s’abstraire des nécessités et matérialités quotidiennes (Roselli, 2016). Mais il s’agit là d’une concession sociale restreinte à quelques individus qui jouissent d’un statut à part. C’est un peu ce qui se passe avec Jean-Loup, que l’étudiante Anna doit protéger pour qu’il ne soit ni éloigné définitivement du groupe ni objet de moquerie. Quand Anna est présente, elle filtre les sollicitations, les médiatise et les retourne à l’intérieur du groupe, laissant Jean-Loup dans le silence propice et dans une posture qui mime l’isolement (tourné vers la fenêtre, dos aux autres, signifiant son indisponibilité). Cette mise en scène publique de Jean-Loup lisant en solo, passant des heures sur le même livre et non pas sur les cours, ne correspond pas exactement aux représentations associées à la lecture masculine où le corps droit de l’homme doit signifier symboliquement la maîtrise de soi, par opposition au corps relâché de la femme qui est souvent représentée lorsqu’elle lit, le regard perdu dans le vide (Conlon, 2005).
Lire comme un homme n’engage pas le corps et l’esprit de la même façon que lire comme une femme. Si dans les deux cas, il y a séparation de la sphère publique et de l’activité sociale, la frontière se dessine entre la posture digne et la posture repliée, la posture droite et la posture relâchée, l’attention et le rêve, la lecture masculine amenant avec elle l’exigence de recherche d’idées, d’ouverture de nouveaux horizons et de contact avec les problèmes concrets tandis que la lecture féminine évoque le cheminement introspectif et l’état contemplatif, avec relâchement des liens sociaux et de l’intérêt pour ce monde. Le groupe d’étudiants bouscule ces représentations et brouille les frontières, d’une part, les deux filles engagées dans une lecture attentive et un silence actif, d’autre part, les garçons présentant un dégradé assez nuancé de postures de lecteurs, allant du désinvolte au contemplatif (Jean-Loup). À la suite de cette expérience de solitude mi-studieuse mi-légère, l’étudiant se montre d’ailleurs plus lucide sur ses pratiques et même sur la division sexuée du travail studieux et « le rôle confortable des garçons qui se servent des filles pour avancer, puis les laissent derrière » (Jean-Loup).
La posture de lecture solitaire de Jean-Loup est tendue et en équilibre fragile, celle d’Arnaud, enseignant ingénieur, lecteur de BD, est solitaire et heureuse. Si la trajectoire de lecteur d’Arnaud est linéaire et constante (il lit des BD depuis l’âge de cinq ans), ses techniques d’éloignement du monde professionnel et du monde domestique s’apparentent à celles qu’expérimentent d’autres solitaires électifs.
La manière dont ce lecteur lit, lentement et revenant en arrière sur les planches, indique qu’il est un lecteur expert, mais surtout passionné (regard fixe sur les pages malgré la position assise dans un fauteuil, retour en arrière sur les pages, lecture lente et linéaire, puis diagonale, etc.). Le cadre « médiathèque » est véritablement une bulle à part et une parenthèse entre la matinée et l’après-midi de travail, bien que celui-ci ne soit jamais loin dans les références de son témoignage. On voit là comment le retrait pour lire peut correspondre à un état de relâchement même pour un lecteur homme, grâce au ralentissement du rythme des mouvements et à une épaisseur particulière du silence qui se crée autour. En bibliothèque, on ne risque pas d’être dérangé, interrompu et l’indisponibilité du corps à bouger est visiblement remplacée par un autre type de disponibilité, d’ordre privé, intime, intérieur. De la médiathèque, ce lecteur dit qu’elle l’oblige à sortir et à quitter les collègues, les élèves et l’ambiance feutrée d’une école où tout le monde se connaît, s’imite et se conforme rapidement aux règles et aux normes. L’institut où il enseigne est comparé à « une cité technique sérieuse et protégée — il m’explique que sa spécialisation est la mécanique des eaux » où il se sent à l’étroit parce qu’il n’a pas envie d’être technique, sérieux et protégé tout le temps. En venant à la médiathèque, il a le sentiment paradoxal d’être parmi les gens, de retrouver des habitudes d’enfant qu’il ne peut facilement exprimer au travail (ni en famille, d’ailleurs).
Arnauld ne fait pas que changer de cadre. En retrouvant sa place de lecteur à la médiathèque, il incarne une figure minoritaire de lecteurs, celle d’hommes, actifs, jeunes et pères de famille, qui nuance le tableau assez uniforme du public des bibliothèques, majoritairement féminin, dont une partie importante est composée de femmes, actives, jeunes et mères de famille, accompagnant les enfants et ne lisant pas pour elles-mêmes. La solitude lectorale au masculin, ainsi exhibée en public, a quelque chose de subversif : non seulement elle met en scène un homme adulte non affairé dans des choses sérieuses, mais elle le montre profondément immergé dans la lecture d’une BD, mangeant sur le pouce et prenant du temps et du plaisir. Arnaud et Jean-Loup savent que leur façon de lire est connotée au féminin, ce qui, couplé à l’effort pour se retirer du groupe, a en soi valeur de résistance individuelle.
La place ambiguë de l’individu qui transite entre dedans et dehors
Comme Jean-Loup et Arnaud, Pierre est un lecteur de bibliothèque. Ce lieu lui est apparu rapidement comme une planche de salut lorsque, enfant arrivé d’Espagne et accueilli par sa tante, il se trouve devant la nécessité de s’isoler pour rattraper le retard en français et la consigne stricte de sa tante de ne pas traîner en bas de l’immeuble. Ainsi les baies vitrées de la bibliothèque du quartier de banlieue dans lequel il vit fonctionnent comme des prises de vue sur le monde qui lui est interdit et comme un mur de séparation entre des mondes concurrents (la rue et l’école, le bruit et la lecture, la bande de copains et la bibliothèque). Quand je le rencontre, Pierre me dessine la bibliothèque comme une salle de classe, avec des tables et des chaises, des livres ouverts, une femme qui se tient debout. Il a déjà incorporé une vision du monde divisée en deux : d’un côté, le silence et la solitude nécessaires pour lire les livres de l’école qu’il trouve à la bibliothèque où il fait ses devoirs, aidé par une dame et, de l’autre, les copains de la rue qu’il trouve en bas de l’immeuble, qui passent leur temps dans la rue, en groupe, et ne parlent jamais de l’école, ne font pas les devoirs, ne viennent pas à la bibliothèque. Il sait se trouver du côté des femmes quand il vient à la bibliothèque, quand il fait ses devoirs, quand il respecte les consignes de sa tante et les conseils de la bibliothécaire (Roselli, 2011). Cette division rigoureuse du monde est nuancée par sa condition de sursis chez sa tante, où il ne restera que « si ça se passe bien », et par son statut provisoire d’enfant étranger.
Progressivement, Pierre se dote d’un laissez-passer permanent, obligeant ainsi les autres à tolérer l’unicité de sa situation, et ne manque pas de leur exposer la souplesse avec laquelle il passe d’un statut à un autre — et notamment des sociabilités et des loisirs masculins, en groupe et dans la rue, à celui plus féminin de la lecture, des devoirs scolaires et de la bibliothèque, où il est seul et enfermé. Pierre bénéficie donc d’un statut à part, glissant d’une place à l’autre et transitant entre des mondes de fait hermétiques, entre règles et transgressions, entre dedans et dehors. Mais l’apparente fluidité des transitions ne doit pas faire illusion : tout le témoignage de Pierre est, en effet, accompagné de grimaces qui, avec les hésitations en français, expriment sans doute une difficulté à faire face à ce dilemme — être avec les autres ou se retrouver seul — qui vient s’ajouter aux autres tracas quotidiens, notamment celui de la place incongrue qu’il occupe entre son âge biologique et sa condition d’enfant sous tutelle. C’est d’ailleurs une des ruses auxquelles Pierre a recours, gagner du temps en se faisant plus petit que son âge. « Quand je leur dis “je ne peux pas, avec ma tante”(il lève les yeux), ils comprennent et partent, et quand ils reviennent, je les attends, en bas, avec les plus petits. » « Faire le petit », c’est rester avec les plus jeunes sans s’aventurer dans le quartier, c’est montrer patte blanche et donner l’assurance de ne pas aspirer à une place de « grand », c’est se comporter en enfant et donc s’autoriser à faire ce que les autres faisaient quand ils étaient petits. Faire plus jeune que son âge est une stratégie, rencontrée chez d’autres adolescents aussi, pour continuer à avoir des pratiques et des préférences culturelles que les pairs considèrent comme dépassées et peu évoluées, pour gagner du temps et un peu de marge de manoeuvre dans des rôles de genre qui ont tendance à se figer avec la puberté (Lahire, 2004 : 511). Le fait de comprendre qu’en jouant sur la mise en scène de l’âge on touche aux places de chacun en dit long sur la connaissance de soi et des autres, de soi avec les autres, dont fait preuve cet enfant grandi rapidement, qui joue à faire le petit pour manoeuvrer avec un peu plus de souplesse dans les questions de place. On peut parler d’une accélération du processus de subjectivation en cours chez ce garçon, à l’occasion du passage d’un cycle de vie à un autre et d’un lieu géographique à un autre.
Un autre cas permet d’éclairer, pour finir, la problématique du passage de l’enfance à l’adolescence à travers l’expérience de la solitude. Il s’agit d’un adolescent qui a vécu la détention comme un moment pour s’affronter soi-même et a trouvé, dans une cellule de prison, paradoxalement parmi d’autres détenus, le lieu pour revenir au calme et à la lecture. Après le retrait des lecteurs, ce cas d’étude appelle une dernière requalification conceptuelle de la solitude en tant que dimension intégrante de la construction de soi en équilibre instable entre monde public et monde intime, où ce soi, face aux autres, peut se tracer une voie d’issue en empruntant l’éloignement comme étape dans le devenir adulte. Grâce à la médiathèque où il accomplit des travaux d’intérêt général, Thibault expérimente de manière volontaire et libre « la pratique régulatrice des moments ponctuels de solitude » (Schurmans, 2003 : 158), une pratique fructueuse et bénéfique, mais qui exige une force démesurée par moments.
Entre onze et dix-huit ans, le seul moment de soulagement est la cellule de détention où tout s’arrête. Une sorte de conversion prend place qui fait de l’enfermement une solitude intérieure et lui permet de passer à l’âge adulte. De manière contre-intuitive, le moment d’emprisonnement et de contrainte absolue est vécu comme un moment de liberté où il peut se retrouver. C’est dans cette condition qu’il peut aller à l’essentiel, dans un effort de réduction de son être à un sens de survie. Il ne tangue plus, tenu qu’il est par les murs, la situation figée et l’arrêt complet des pressions normatives auxquelles il avait du mal à survivre. Il emploie l’expression « remettre les compteurs à zéro » à plusieurs reprises dans l’entretien et insiste sur la crainte, souvent ressentie auparavant de « ne pas être capable, peur de ne pas m’en sortir avec tout ce qui m’attendait ». Faisant écho à cette « pathologie de l’insuffisance (…). Le déplacement de la culpabilité et de la responsabilité repose sur deux notions qui ont remplacé le religieux et la loi, celle d’intériorité et celle de conflit », caractéristiques de l’individu moderne (Ehrenberg, 2001 : 15), Thibault raconte son dilemme de l’être pour qui « rien n’est vraiment interdit, rien n’est vraiment possible » (ibid.) et qui, responsable de tout, ne tient pas. De manière symptomatique, il parvient à dompter le « moteur fou » en se contraignant à un enfermement qui l’apprivoise et lui permet d’accepter ses limites. Au contraire, une fois détenu, il redécouvre le soulagement enfantin d’être porté, d’obéir sans réfléchir, sans marquer tous ses actes de son intelligence. Se perdre parmi les autres, devenir comme eux, sans distinctions ni mérite, mais sans incertitude ni de place, ni de rôle, ni d’identité. Dans le périmètre réduit d’une cellule, il ne doit pas chercher ses propres repères pour avancer ; les repères sont là, immédiats et bien réels, fixes et indépassables.
conclusion : la solitude des lecteurs et l’expérience du dialogue du soi à soi
Au terme de ce travail, une interrogation émerge à propos de la tension entre les conditions nécessaires au retrait pour lire et l’intensité du poids des contraintes sociales. Ma première hypothèse concernait la relation du retrait avec la densité des liens sociaux. Elle trouve un éclairage dans les contextes dans lesquels s’inscrivent les six expériences. Tous, lecteurs et lectrices, sont pris dans des rôles sociaux, mais, selon leur âge et leur condition, ces rôles s’avèrent plus ou moins rigides. Prises dans des rapports sociaux de genre puissants et figés, les deux lectrices sont issues de deux milieux sociaux différents et appartiennent à deux générations qui, dans deux pays différents, n’ont pas eu un égal accès à la scolarisation. En dépit de ces différences, elles donnent à voir une expérience similaire du retrait pour lire : étroitement articulée au monde de la boutique, cette expérience se développe contre le groupe et la communauté et amorce un cheminement personnel et une affirmation de soi. De la même manière, l’éloignement du groupe expérimenté par les quatre témoins hommes se construit à l’articulation des rapports sociaux d’âge et des rapports sociaux de genre : c’est en effet à l’intersection de figures aussi contradictoires, contrastées et mutuellement exclusives que celles de l’enfant-qui-lit, de l’homme-qui-lit et de la femme-qui-lit que prend sens leur retrait pour lire. Que ce soit dans les plis du quotidien, dans les âges de la vie ou encore à un noeud biographique, les logiques mises en oeuvre par les lecteurs se construisent en relation aux contextes d’existence et aux habitudes. Selon la place d’où l’on se retire, la trame et l’intensité des sociabilités, la prégnance de l’espace collectif et public, la négociation entre intimité/partage, privé/ouvert, secret/exposé pèsent et freinent à des degrés divers la possibilité même de mouvement de retrait (Schurmans, 2003). Les contextes quotidiens et familiaux, sociaux et structurels ne sont pas, de mon point de vue, une toile d’arrière-fond, mais une détermination puissante — frein ou accélérateur — à l’émergence même d’un besoin d’espace individuel. Travailler sur ces logiques permet de comprendre comment on résiste à la saillance systématiquement négative associée à la solitude, comment on définit son désir et comment il est défini par la collectivité. En effet, le jugement de soi par l’autre détermine jusqu’à la possibilité et l’interprétation même de la situation solitaire. Par exemple, la peur d’être différent et la pression à la conformité appauvrissent le jeu des possibles, comme le fait bien comprendre le témoignage de Pierre que ses amis attendent de pied ferme de l’autre côté de la baie vitrée. S’engager dans une voie d’absences régulières du collectif implique déjà la capacité de se voir isolé et de ne pas avoir honte et peur.
La deuxième hypothèse concernait le retrait pour lire comme conquête, avec une question sur le renforcement de l’individu en tant qu’acteur. On ne peut pas affirmer que les six individus sortent de l’expérience du retrait plus forts, car au moins deux d’entre eux, Pierre et Thibault, utilisent la solitude contrainte pour se diluer parmi les autres et confier leur sort à des acteurs institutionnels. Tous les six lecteurs ne font pas l’expérience de la critique sociale, mais ce qui les rassemble, c’est que l’identité de lecteur pour soi est une déviation à la norme dans leur environnement et que cette déviation devient partie intégrante de leur personne telle qu’elle est perçue dans les relations sociales. C’est ce que racontent de l’expérience de la solitude du lecteur les six témoins : les variétés et les étapes par lesquelles chacun d’entre eux est passé par cette expérience sociale de la solitude, distinctive et critiquée ; comment, en particulier, de normal, il est devenu différent, processus dont Goffman dit qu’il est souvent vécu comme très douloureux, mais que les individus parviennent à supporter grâce à des « adaptations personnelles » (Goffman, 1975 : 45). Mes six lecteurs mettent en oeuvre des aménagements de sortie volontaire et provisoire du flux des interactions ordinaires, mais ne sont ni des individus en dehors des structures sociales ni des individus au-dessus de la norme. Au contraire, ce sont des individus intégrés à leur groupe qui « dévient communément de l’ordinaire », respectueux de la norme dont ils deviennent conscients : « bien souvent, l’individu n’exerce aucun contrôle immédiat sur le degré de son adhésion. C’est une affaire de condition et non de volonté ; de conformité et non de soumission », nous rappelle Goffman (ibid. : 143) à propos du retrait comme technique d’invisibilité sociale, qui doit toutefois être négociée avec les autres. Comme le fait de se retirer pour lire est un acte visible aux yeux des autres quand la norme quotidienne est la densité et la fluidité des interactions, il est maintenant confirmé que dans certains contextes, cycles de vie et milieux et rôles sociaux, ce retrait visible perturbe et produit une gêne. Pouvoir se retirer pour lire est une configuration sociale consentie par le collectif comme une tolérance qui fait partie d’un marché et quand celui-ci ne peut pas valoriser le retrait pour lire, ce dernier devient objet de moquerie ou de vanité et la condition de lecteur reste cachée, comme le rappelle Bourdieu dans son dialogue avec Chartier (voir Chartier, 1985 : 225).
La troisième hypothèse concernait la place occupée par le lecteur dans le système et un éventuel jeu gagné par rapport aux règles et aux habitudes. Les six cas indiquent que le retrait individuel nécessite un écran protecteur et médiateur : le commerce comme scène publique à l’intérieur de laquelle deux femmes se taillent une solitude rare ; l’institution comme scène totale où l’on peut provisoirement cesser d’être en tension avec son environnement. Mais l’aboutissement de cette expérience n’est pas le même : pour certains de nos témoins, la solitude aboutit à une affirmation de soi, comme c’est le cas de Paulette et Giuliana ; pour d’autres, elle prend les allures d’une posture esthétique qui renforce une individualité déjà bien ancrée, comme on l’a vu pour Jean-Loup et Arnauld ; pour d’autres encore, comme Pierre et Thibault, elle est au contraire une condition de suspension des pressions extérieures, seule possibilité pour éprouver un apaisement. Or, qu’elle soit cause ou fin, la lecture semble offrir un tremplin pour aller plus loin dans la connaissance de soi, par la solitude qu’elle exige. Ainsi donc, lecture et solitude ne seraient pas liées uniquement par une relation de nécessité ; elles constitueraient, chacune avec des caractéristiques et des effets propres, des apprentissages qui, de manière progressive et répétitive, accroissent la capacité de l’individu à l’introspection et à l’exploration du soi. Ce qui ne signifie pas nécessairement et toujours affirmation de soi. Je parlerais plutôt d’une « volte sur soi », reprenant l’expression de M. Foucault, « comme conversion (qui) amène à nous déplacer de ce qui ne dépend pas de nous à ce qui dépend de nous » (Foucault, 2001 : 202). Par la discipline spirituelle et corporelle qu’elle exige, la lecture offre l’une des conditions idéales à ce dialogue de soi à soi. Au vu des parcours laborieux de nos six « solitaires », je crois que ce terme de « conversion en forme de rupture et de mutation à l’intérieur même du soi » (ibid. : 214) convient pour exprimer l’amorce d’un processus long et continu d’auto-subjectivation dans lequel ils se trouvent engagés. Se retirer pour lire permet d’établir, en se fixant soi-même comme objectif, une présence de soi à soi qui établit une distance à soi-même en tant que l’on est le sujet d’une action.
Appendices
Notes
-
[1]
Dans l’enquête sur les adolescents qui désertent les bibliothèques, la lecture sous ses formes « plus populaires », au sens de partagées, semble plus fréquente chez ceux-là mêmes qui la désertent en solitaire ou en silence (Roselli, 2006a et 2014).
-
[2]
Il est à noter que les parents des deux femmes couvrent le penchant de leurs filles pour une activité impopulaire et peu diffuse en mettant en avant leur désir de poursuivre les études et l’impossibilité matérielle de le satisfaire. Giuliana parle d’un alibi, tandis que Paulette se souvient, admirative, de sa mère faisant barrière contre la belle-famille pour protéger ce « lieu à soi » comme un temps inaliénable pour sa fille. C’est comme si les parents des deux femmes pouvaient intervenir en leur faveur en établissant une vérité qui n’est acceptable pour les autres que parce qu’elle est délivrée par des personnes au-dessus de tout soupçon (adhésion à la norme et intégration à la communauté).
-
[3]
Ce groupe a été suivi pendant cinq mois (octobre 2007-février 2008). En décembre, s’est déroulé un premier entretien avec Léa, en janvier avec Jean- Loup (exclu depuis du groupe et décrit dans le portrait 13 de l’ouvrage), puis fin janvier un entretien avec trois d’entre eux (voir Roselli et Perrenoud, 2010 : 134-146).
-
[4]
Le désir de ralentir, invoqué comme protection contre des rythmes studieux trop soutenus, soit contraints soit choisis, se retrouve dans plusieurs témoignages d’étudiants garçons (inscrits en psychologie, histoire, biologie, CPGE scientifique) qui ne sont pas nécessairement « en retard » dans le cursus mais refusent de se plier au cadre imposé et se donnent les moyens de recréer un cadre personnel, individuel et contrôlé en autonomie. Sans être représentatifs, ces témoignages nous informent au moins sur deux choses : premièrement, les étudiants garçons témoignent plus ouvertement de la difficulté à adhérer à une norme et de leur réaction de libération ; deuxièmement, dans le cadre scolaire, les garçons semblent trouver des voies plus souples pour résister à la pression institutionnelle (Roselli, Chauvac et Jmel, 2016).
Bibliographie
- Albenga, V. (2009), S’émanciper par la lecture. Genre, classe et usages sociaux des livres, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- Bennett, T. et D. Watson (2002), Understanding everyday life, Oxford, Blackwell.
- Bourdieu, P. et R. Chartier (1985), « Comprendre les pratiques culturelles. Dialogue entre Pierre Bourdieu et Roger Chartier », inChartier R. (dir.), Pratiques de lecture, Paris, Rivages, p. 217-239.
- Chartier, A.-M. et J. Hebrard (2000), Discours sur la lecture (1880-2000), Paris, Fayard, 2000.
- Chartier, R. (1985), « Du livre au lire », inChartier R. (dir.), Pratiques de lecture, Paris, Rivages, p. 61-88.
- Chartier, R. (1987 [1982]), Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, Seuil.
- Chartier, R. (1996), « Communautés de lecteurs », inChartier R., Culture écrite et société. L’ordre des livres (xive-xviiie siècle), Paris, Albin Michel, p. 133-154.
- Conlon, J. (2005), « Men reading women reading. Interpreting images of women reading », Frontier. Journal of Women Studies, Nebraska Press, vol. 26, n° 2, p. 37-58.
- Coulangeon, P. (2016 [2005]), Sociologie des pratiques culturelles, Paris, La Découverte.
- Coulangeon, P. (2011), Les métamorphoses de la distinction. Les inégalités culturelles dans la France d’aujourd’hui, Paris, Grasset.
- Darnton, R. (1985), « Le lecteur rousseauiste et un lecteur « ordinaire » au xviiie siècle », inChartier R. (dir.), Pratiques de lecture, Paris, Rivages, p. 125-155.
- Demazière, D. et C. Dubar (1997), Analyser les entretiens biographiques. L’exemple des récits d’insertion, Paris, Nathan.
- Détrez, C. (2014), Sociologie de la culture, Paris, Armand Colin.
- Ehrenberg, A. (1998), La fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris, Odile Jacob.
- Escarpit, R. (1958), Sociologie de la littérature, Paris, Presses Universitaires de France.
- Fabre, D. (1985), « Le livre et sa magie. Les liseurs dans les sociétés pyrénéennes aux xixe et xxe siècles », inChartier R. (dir.), Pratiques de lecture, Paris, Rivages, p. 181-206.
- Foucault, M. (2001), « Cours du 10 février 1982 » et « Cours du 3 mars 1982 », in Ewald F. et A. Fontana (dir.), L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France. 1981-1982, Paris, Gallimard/Seuil, p. 197-236 et p. 315-353.
- Goffman, E. (1975 [1963]), Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, Éditions de Minuit.
- Hebrard, J. (1985), « L’autodidaxie exemplaire. Comment Jamerey Duval a-t-il appris à lire ? » in Chartier R. (dir.), Pratiques de lecture, Paris, Rivages, p. 23-60.
- Lahire, B. (2004), La culture des individus. Dissonances culturelles et distinctions de soi, Paris, La Découverte.
- Manguel, A. (1998), Une histoire de la lecture, Arles, Actes Sud.
- Mauger, G. et C. Poliak (1998), « Les usages sociaux de la lecture », Actes de la recherche e sciences sociales, n° 123, p. 3-24.
- Mauger, G., Poliak, C. et B. Pudal (1999), Histoires de lecteurs, Paris, Nathan.
- Radway, J. A. (1987 [1984]), Reading the Romance. Women Patriarchy, and Popular Literature, New York, Verso.
- Roselli, M. (2006a), « Usagers et usages devant une offre de lecture publique libre : parcours d’acculturation et formes d’appropriation lettrées », Sociétés contemporaines, n° 64, décembre, p. 135-151.
- Roselli, M. (2006b), « Culture lettrée des femmes et pensée magique en Italie du Sud aujourd’hui », inBojomee D., J. Dor et M.-E. Henneau (dir.), Femmes et livre, Paris, L’Harmattan, p. 65-90.
- Roselli, M. (2009), « Women reading in the countryside : an uncomfortable place », Conference Women in French, Aston University, Birmigham (UK), 9 May.
- Roselli, M. et M. Perrenoud (2010), Du lecteur à l’usager, enquête ethnographique en bibliothèque universitaire, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, p. 147-153.
- Roselli, M. (2011), « La bibliothèque, un monde de femmes. Déterminations et conséquences sur la segmentation des publics jeunes dans les bibliothèques », Réseaux, vol. 29, n° 168-169, p. 133-164.
- Roselli, M. (2014), « Cultures juvéniles et bibliothèques publiques : lier récréation et espace culturel », Agora, vol. 66, n° 1, p. 61-75.
- Roselli, M. (2016), « La construction sociale de la figure de lectrice et de sa contre-figure masculine », Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, vol. 4, décembre, « Littéracies informationnelles et médiatiques au prisme du genre » : http://airdf.ouvaton.org/index.php/16-revues/412-litteracies-informationnelles-et-mediatiques-au-prisme-du-genre, consulté le 7 avril 2019.
- Roselli, M., chauvac, N. et S. Jmel (2016), « Le temps libre des étudiants », in Giret J.-F., Van de Velde, C. et E. Verley (dir.), Les vies étudiantes. Tendances et inégalités, Paris, La Documentation Française, p. 101-116.
- Schurmans, M.-N. (2003), Les solitudes, Paris, Presses Universitaires de France.
- Woolf, V. (2016 [1929]), Un lieu à soi, (nouv. trad. par Marie Darrieussescq), Paris, Denoël.

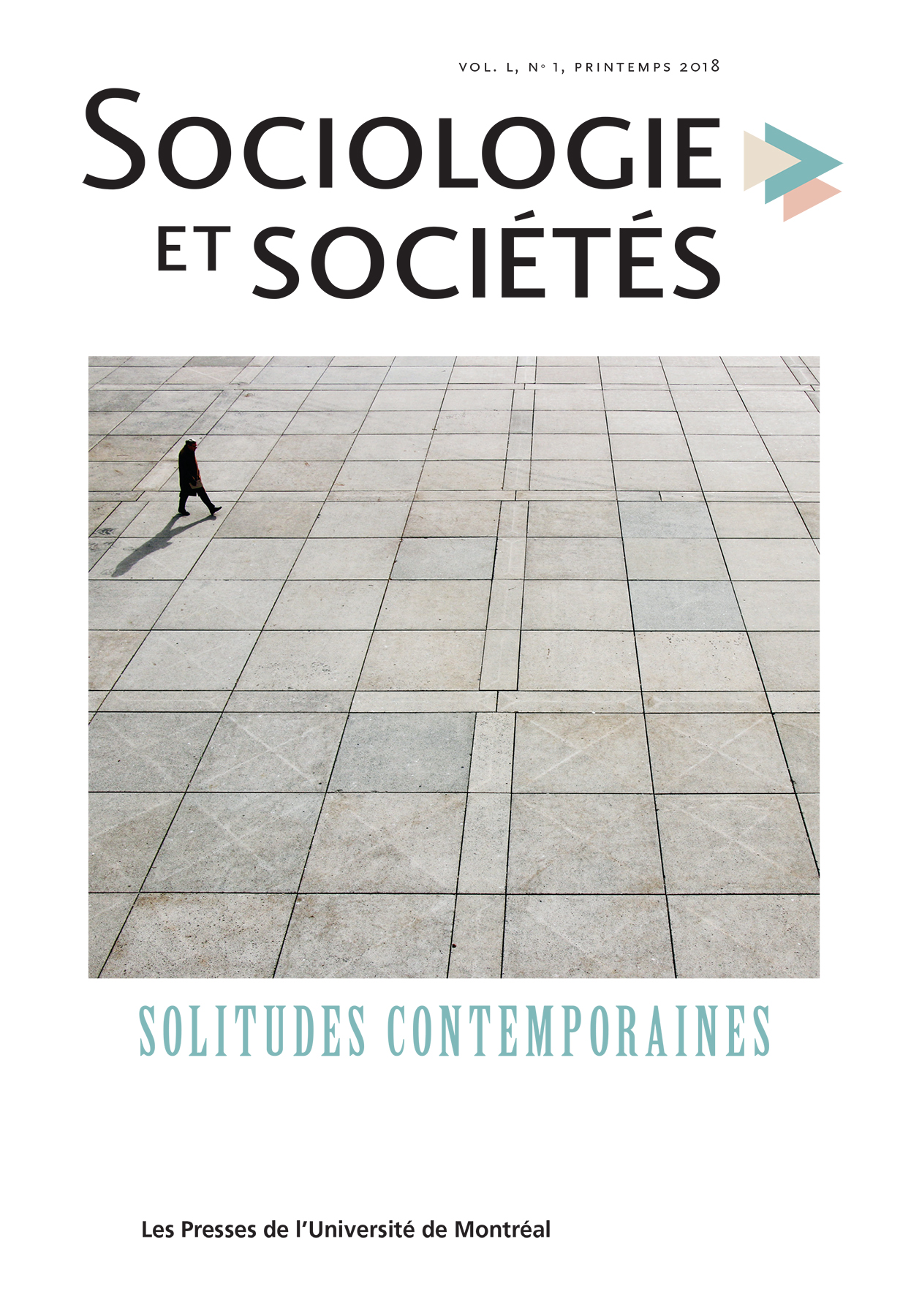
 10.7202/1046990ar
10.7202/1046990ar