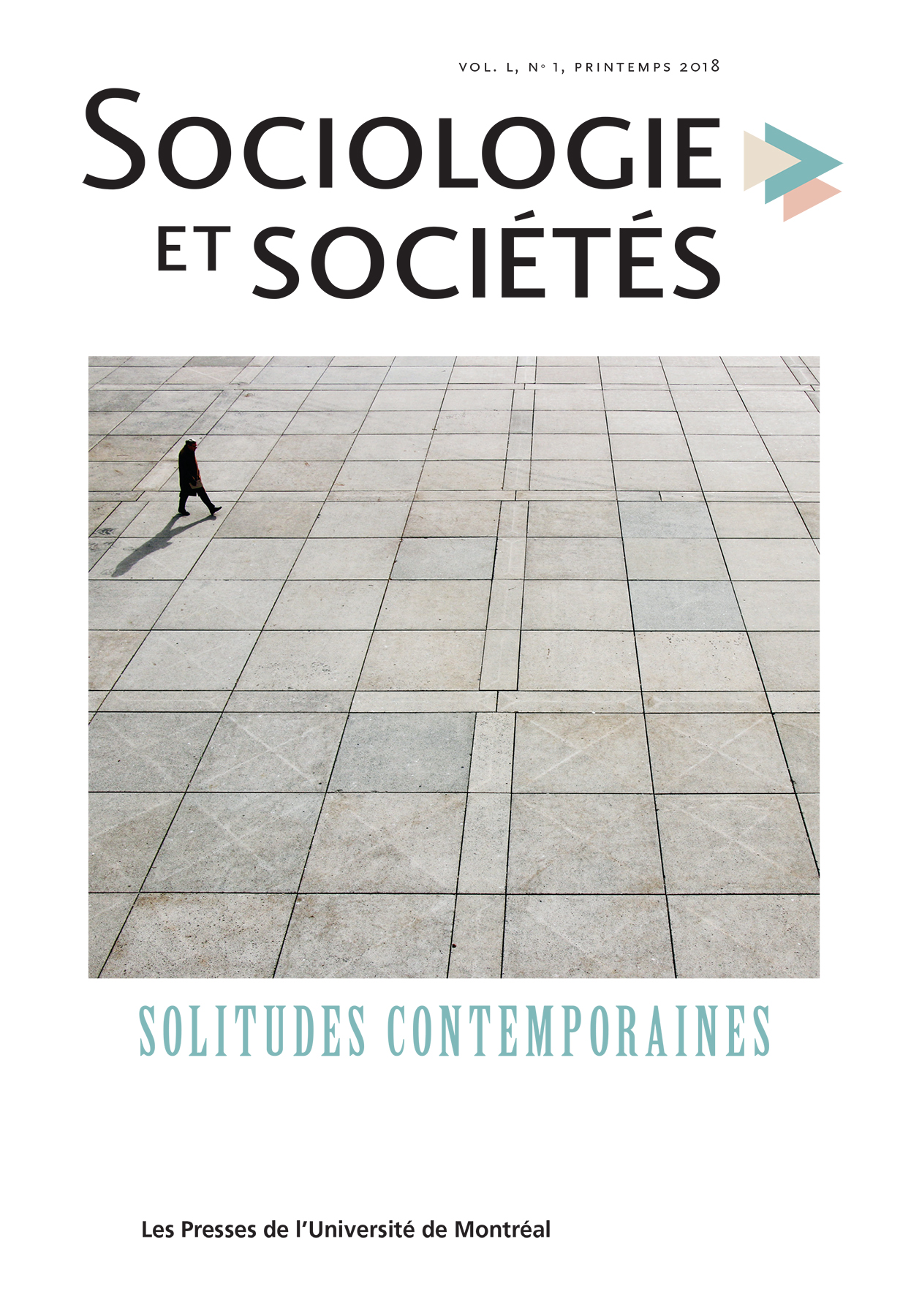Article body
Sociologue et directeur d’études à l’ehess à paris, Serge Paugam est l’auteur de nombreux ouvrages sur les questions de pauvreté, d’inégalités et de ruptures sociales[1]. Dans le cadre de ce numéro, nous nous sommes entretenue avec lui afin de mieux saisir la nature des relations complexes qui se nouent actuellement entre « attachements » et « solitudes » : Serge Paugam a développé récemment une théorie de l’« attachement social »[2] qui éclaire la façon dont nos liens sociaux s’imbriquent entre eux, et leur rôle dans la construction des inégalités. Cet entretien est l’occasion de revenir sur les processus qui peuvent mener à l’isolement et à la solitude, en fonction des différents « régimes d’attachement » qui relient l’individu aux autres et à la société.
Vous développez actuellement une théorie de l’« attachement social » : comment en êtes-vous venu à investir ce concept d’attachement qui relevait jusqu’ici davantage de la psychologie ?
Le concept d’attachement est en effet surtout connu dans le domaine de la psychiatrie. Il renvoie à une théorie élaborée par le psychiatre John Bowlby[3] dans la deuxième moitié du xxe siècle pour qualifier l’empreinte durable du lien originel de l’enfant à l’adulte en charge de lui procurer la sécurité dès les premiers mois de sa vie. Cette théorie continue de nourrir de nombreux travaux de recherche dans ce domaine. Pourtant, la notion d’attachement avait été définie par Durkheim dans une perspective analytique différente[4]. Le fondateur de la sociologie française voyait en effet dans l’attachement aux groupes une des sources de la morale, et partant, une des conditions de l’intégration sociale. Ce concept présente donc l’intérêt d’avoir connu un développement aussi bien dans la psychologie que dans la sociologie, et renvoie tout à la fois à la constitution de la personnalité individuelle, à la formation des groupes sociaux et au fonctionnement normatif de la société globale. Il porte sur une question constitutive de la vie humaine et contribue à énoncer aussi bien des principes généraux que des explications aux variations observables au sein de chaque société et entre les sociétés. Il me semble aujourd’hui que l’on peut relier des développements qui ont été réalisés dans des disciplines peu habituées au dialogue et selon des problématiques différentes et d’envisager l’attachement, non seulement comme un fait psychologique, mais surtout comme un fait social total. En réalité, sous cet angle, il est possible de faire de l’attachement le fondement d’une théorie en sciences sociales.
Les sociologues savent que la vie en société place tout être humain dès sa naissance dans une relation d’interdépendance avec les autres et que la solidarité constitue à tous les stades de la socialisation le socle de ce que l’on pourrait appeler l’homo sociologicus, l’homme lié aux autres et à la société non seulement pour assurer sa protection face aux aléas de la vie, mais aussi pour satisfaire son besoin vital de reconnaissance, source de son identité et de son existence en tant qu’homme. Il existe pourtant dans les sociétés modernes une proportion importante de personnes dont les liens qui les rattachent aux autres et à la société sont faibles, voire dans certains cas inexistants. L’isolement et le délitement des liens sociaux constituent aujourd’hui un facteur essentiel d’inégalité. Certains en sont protégés, tandis que d’autres y sont particulièrement exposés.
Quels sont, selon vous, ces différents liens qui nous « attachent » aux autres et à la société ?
À la suite de Durkheim, nous pouvons en distinguer quatre : le lien de filiation (au sens des relations de parenté), le lien de participation élective (au sens des relations entre proches choisis), le lien de participation organique (au sens de la solidarité organique et de l’intégration professionnelle) et le lien de citoyenneté (au sens des relations d’égalité entre les membres d’une même communauté politique)[5]. Chacun peut être défini à partir des deux dimensions de protection et de reconnaissance. La protection renvoie à l’ensemble des « supports » que l’individu peut mobiliser face aux aléas de la vie (ressources familiales, communautaires, professionnelles, sociales…), la reconnaissance renvoie à l’interaction sociale qui stimule l’individu en lui fournissant la preuve de son existence et de sa valorisation par le regard de l’autre ou des autres. L’expression « compter sur » résume assez bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux autres et aux institutions en termes de protection, tandis que l’expression « compter pour » exprime l’attente tout aussi vitale de reconnaissance. L’intérêt que suscite aujourd’hui le concept de reconnaissance, à la suite des travaux d’Axel Honneth[6], ne doit pas éclipser le concept de protection qui a été fondamental pour comprendre les transformations du lien social tout au long du xxe siècle. Considérer les deux concepts comme complémentaires est d’autant plus heuristique qu’ils permettent, l’un et l’autre, de rendre compte de la fragilité potentielle des liens sociaux contemporains, laquelle renvoie au moins autant au déficit de protection qu’au déni de reconnaissance.
Mais revenons, si vous voulez bien, au concept d’attachement et à votre étonnement sur l’usage que j’en fais en le décloisonnant de son ancrage actuel dans le domaine de la psychologie. Il n’y a donc pas lieu d’opposer la théorie psychologique et la théorie sociologique de l’attachement. Le langage spécifique qu’elles utilisent n’est pas un obstacle en soi puisqu’il est possible de le traduire et le rendre ainsi intelligible et signifiant au-delà des frontières disciplinaires. Les psychiatres et les psychologues qui ont fait de l’attachement leur spécialité ou leur objet d’études reconnaissent que ce qui se joue entre l’enfant et sa mère dès la naissance est très fortement dépendant de l’environnement social et culturel, c’est-à-dire des conditions d’existence et des événements qui marquent la prime socialisation. Lorsqu’ils insistent sur l’empreinte durable de ce premier lieu et son effet sur les autres, ils admettent aussi que celle-ci peut s’affaiblir avec le temps en fonction de la trajectoire spécifique de l’individu et de son attachement à d’autres groupes sociaux à l’âge adulte. Les sociologues font, de leur côté, des analyses comparables. La notion d’empreinte que les psychologues réservent au premier lien est étendue par les sociologues aux autres liens, sachant que tout individu intériorise au cours de sa socialisation les normes sociales — la morale qui s’y réfère — propres aux différents groupes qu’il fréquente durablement, ce que le concept d’habitus, sous des acceptions diverses, mais convergentes, traduit de façon générique. Depuis les recherches de Pierre Bourdieu sur l’habitus, les sociologues insistent sur la pluralité de l’héritage. La transmission n’est pas seulement économique, mais aussi culturelle, au sens du savoir et des habitudes quotidiennes, et constitue les prédispositions plus ou moins durables à agir tout au long de la vie. On parlera alors d’une combinaison des empreintes, celle laissée par le lien de filiation étant en quelque sorte prolongée par celles que laissent inévitablement les autres liens en fonction de la spécificité de la trajectoire de chaque individu. Sur ce point, le concept d’empreinte des psychologues et celui d’habitus des sociologues comportent des similitudes et constituent des plans parallèles de construction aisément traduisibles et intégrables dans un ensemble théorique plus large, travail qui reste encore à faire.
Dans cette perspective, comment envisagez-vous les liens entre « attachement » et « solitude » : les considérez-vous comme deux notions antinomiques ?
Il serait assez facilement concevable que « attachement » et « solitude » soient antinomiques. Si la solitude est souvent dépeinte comme la condition de l’individu contemporain, elle s’explique avant par la fragilité et la rupture des liens sociaux et, de façon plus générale, par les inégalités de l’attachement. En menant une enquête dans la métropole de Strasbourg auprès de 506 individus[7], nous avons pu mesurer la force ou la faiblesse de chacun de ces quatre types de liens (lien de filiation, lien de participation élective, lien de participation organique, lien de citoyenneté). Sur cette base, nous avons mis au point une représentation graphique de la surface moyenne d’intégration sociale de plusieurs catégories et pu ainsi calculer de façon comparative les inégalités d’intégration ou d’attachement au sens de Durkheim. Nous avons constaté que la souffrance de la solitude diminue de façon globalement très graduelle selon que le niveau d’intégration sociale s’élève. Il en résulte une surface d’intégration sociale nettement plus faible pour les personnes qui souffrent de solitude. Ces résultats ne signifient pas que la solitude s’explique exclusivement par le délitement des liens sociaux. Comme il peut exister des personnes souffrant de solitude bien qu’entourées, il peut exister des personnes parfaitement pourvues de tous les liens sociaux et qui pourtant souffrent de solitude. Cela dit, le délitement des liens sociaux constitue néanmoins un risque majeur.
Vous distinguez dans votre théorie différents régimes d’attachement qui renvoient à autant de modes d’articulation des liens sociaux d’une société à l’autre. Ces différents régimes d’attachement produisent-ils des formes contrastées de solitude selon les sociétés ?
Votre question m’oblige à donner une petite explication sur ce que j’entends par régime d’attachement. La typologie des liens sociaux permet d’analyser comment ces derniers sont entrecroisés de façon normative dans chaque société et comment à partir de cet entrecroisement spécifique s’élabore la régulation de la vie sociale. Cette distinction recoupe, au moins partiellement, la distinction entre les deux concepts d’intégration et de régulation. Le premier renvoie à l’intégration des individus à la société, le second à l’intégration de la société. On pourrait poursuivre en disant que l’intégration à la société est assurée par les liens sociaux que les individus s’efforcent de construire au cours de leur socialisation en se conformant aux normes sociales en vigueur et que la régulation procède de l’entrecroisement normatif de ces liens sociaux qui permet l’intégration de la société dans son ensemble. C’est dans le sens de cette régulation sociale globale que nous parlons de régimes d’attachement. Un régime d’attachement a pour fonction de produire une cohérence normative globale afin de permettre aux individus et aux groupes de faire société, au-delà de leurs différenciations et de leurs rivalités. Pour faire société, il n’est pas nécessaire, selon Durkheim, que les représentations collectives soient présentes dans chaque conscience individuelle, la pluralité étant considérée comme une des caractéristiques fondamentales des sociétés modernes. Mais, il est important que certaines d’entre elles soient partagées par le plus grand nombre, sinon par tous. Ces dernières peuvent très bien être limitées, une seule d’entre elles pourrait même suffire, mais elles doivent alors exercer une autorité sur les individus, s’imposer à eux, leur inspirer une forme spontanée de respect et d’attachement affectif. C’est aussi dans ce sens que l’on peut parler d’une économie morale des liens sociaux. Cette notion renvoie à la régulation qui s’opère à l’échelon de la société dans son ensemble lorsqu’il s’agit de s’entendre, non pas sur tout évidemment — les conflits sont inévitables — mais sur un segment au moins de la morale collective, afin assurer la cohérence de l’ordre normatif et permettre ainsi aux individus de tisser des liens sans avoir à les opposer les uns aux autres et à promouvoir non seulement leur intégration sociale, mais aussi celle de la société dans laquelle ils vivent.
L’enjeu consiste à passer d’une typologie des liens sociaux (au sens de l’attachement des individus à des groupes) à une typologie des régimes d’attachement (au sens de la régulation normative des liens sociaux dans les sociétés modernes)[8]. Dans chaque régime d’attachement, les quatre types de liens peuvent avoir une fonction d’intégration et/ou une fonction de régulation. Un lien intégrateur est un lien qui attache l’individu aux groupes alors qu’un lien régulateur a une fonction supplémentaire de tessiture, qui consiste à produire un ensemble de règles et de normes susceptibles de se traduire par une extension de son influence aux autres liens, jusqu’à infléchir leur conception normative initiale. Elle génère des valeurs et des principes d’éducation morale susceptibles de se répandre dans l’ensemble de la société. Autrement dit, un lien régulateur est en quelque sorte un lien prééminent.
À partir de cette définition préliminaire, quatre types de régimes d’attachement peuvent être définis : le régime de type familialiste, le régime de type volontariste, le régime de type organiciste et le régime de type universaliste.
Le régime de type familialiste a pour caractéristique principale d’être régulé par le lien de filiation, les autres liens de participation élective, de participation organique et de citoyenneté assurant une fonction d’intégration. Il se fonde prioritairement sur la morale domestique. Le régime de type volontariste est régulé par le lien de participation élective, les autres liens de filiation, de participation organique et de citoyenneté étant essentiellement intégrateurs. Il repose sur la morale associative. Le régime de type organiciste repose sur la régulation du lien de participation organique, lequel s’entrecroise avec les liens intégrateurs de filiation, de participation élective et de citoyenneté. Il se nourrit de la morale professionnelle. Enfin, le régime de type universaliste se régule à partir du lien de citoyenneté et recouvre de son influence les liens intégrateurs de filiation, de participation élective et de participation organique. Il prend toute sa force à partir de la morale civique.
De quel régime d’attachement se rapproche telle ou telle société ? Pour y répondre, il est nécessaire de rechercher, dans les différentes étapes de son histoire et les racines anthropologiques de son développement, ce qui a constitué sa tessiture spécifique. Cela implique un travail approfondi qui porte essentiellement sur la constitution des normes et l’étude de leurs évolutions. Pour éviter tout malentendu, il faut immédiatement écarter l’hypothèse simpliste qui consisterait à penser que toutes les sociétés peuvent être classées en fonction d’un régime spécifique. Il ne s’agit en aucun cas d’un classement, mais d’une confrontation d’un ensemble de données empiriques caractéristiques d’une société — au sens d’un système social — à un régime d’attachement qui reste d’ordre idéal-typique au sens wébérien.
Après ce détour, dont je vous prie d’excuser la longueur, il est possible de revenir à la question du lien entre ces régimes d’attachement et la solitude. Si, comme nous l’avons vu, le sentiment de solitude peut s’expliquer par la fragilité et la rupture des liens sociaux, il serait envisageable de penser qu’il puisse s’expliquer aussi par un type particulier de régime d’attachement. On pourrait faire l’hypothèse, par exemple, que dans un régime familialiste qui repose sur la prééminence du lien de filiation — et donc des solidarités interactionnelles — sur les autres liens, les individus seraient plus encastrés dans des relations et des « supports » de proximité et, par conséquent, moins touchés par la solitude. En revanche, dans un régime universaliste, on pourrait partir de l’hypothèse inverse que le lien de citoyenneté, par définition plus impersonnel, se traduirait par une sorte d’individualisme généralisé propice au détachement et donc à la solitude. En réalité, les premiers tests que j’ai pu faire à partir d’enquêtes internationales dans lesquelles des questions sur la solitude ont été posées me conduisent à émettre des doutes sur ce type de raisonnement. Dans toutes les sociétés, quel que soit le régime d’attachement dont elles sont le plus proche, il existe des cas de solitude, dont la variation ne s’explique pas par un modèle aussi simple. En revanche, on peut penser que c’est lorsque la société se dérégule que le sentiment de solitude s’approfondit et s’étend dans des couches nombreuses de la population. Lorsque le système normatif d’attachement qui assurait la cohésion sociale se délite, de nombreuses personnes ont le sentiment d’être en décalage par rapport aux normes en vigueur et de perdre tout repère nécessaire au maintien de leurs relations sociales. Prenons des exemples.
Pour expliquer le phénomène de la solitude dans un pays proche du régime volontariste, on peut prendre le cas des États-Unis. Pour Robert Putnam, dans son livre Bowling Alone[9], l’explication du délitement du lien social dans ce pays provient avant tout du déclin des communautés et des associations civiques. Les citoyens américains se sentent d’autant plus seuls que la société dans laquelle ils vivent ne les incite plus autant qu’avant à s’engager dans des organisations de la société civile. Le capital social, tel qu’il l’a défini, serait donc en perte de valeur. Mais cette explication n’est pourtant pas celle que l’on va retenir dans un autre type de société. La société française est bien plus proche d’un régime organiciste que d’un régime volontariste. Si l’on se réfère aux travaux de Robert Castel, l’explication centrale du délitement du lien social se trouve avant tout dans la crise de la société salariale. Dans cette perspective, si de nombreux individus se sentent seuls, c’est parce qu’ils ne parviennent plus à trouver leur place et leur statut dans le monde du travail ou, plus exactement, parce que les normes d’intégration de la société salariale auxquelles ils se réfèrent ne leur paraissent plus accessibles.
Autrement dit, il est peu probable de trouver une relation causale directe entre le régime d’attachement et le sentiment de solitude. En revanche, la typologie des régimes d’attachement, en ce qu’elle est le contraire d’une classification figée, peut être un outil pour mieux comprendre la dynamique de transformation des normes de l’attachement dans une société donnée. Elle est alors un moyen d’étudier les effets de cette transformation sur le malaise que peuvent en éprouver les individus, en particulier lorsqu’ils ne parviennent plus à s’y adapter et à retrouver les ressources traditionnelles, en termes de protection et de reconnaissance, dont ils pouvaient disposer auparavant. Il y aurait donc autant d’explications macrosociologiques spécifiques du risque de solitude qu’il y aurait de types de délitements des liens sociaux, lesquels peuvent être appréhendés à partir des régimes d’attachement.
Vous avez auparavant conduit de nombreuses recherches sur la pauvreté, les inégalités et les ruptures sociales. De quelle façon avez-vous rencontré les problématiques de solitude et d’isolement au sein de vos travaux antérieurs ?
Le concept de disqualification sociale tel que je l’ai élaboré à partir de mes premières recherches sur la pauvreté renvoie en effet au processus d’affaiblissement ou de rupture des liens de l’individu à la société au sens de la perte de la protection et de la reconnaissance sociale[10]. L’homme socialement disqualifié est à la fois vulnérable face à l’avenir et accablé par le poids du regard négatif qu’autrui porte sur lui. Ce processus a pour effet de produire de l’isolement social. L’objet d’étude tel que je l’avais défini, à la suite des travaux de Simmel, n’était pas la pauvreté ni les pauvres en tant que tels mais la relation d’assistance entre eux et la société dans laquelle ils vivent.
Mon ouvrage de 1991 avait permis de vérifier cinq hypothèses que l’on peut résumer ainsi : 1) le fait même d’être assisté assigne les « pauvres » à une carrière spécifique, altère leur identité préalable et devient un stigmate marquant l’ensemble de leurs rapports avec autrui ; 2) si les pauvres, par le fait d’être assistés, ne peuvent avoir qu’un statut social dévalorisé qui les disqualifie, ils restent malgré tout pleinement membres de la société dont ils constituent pour ainsi dire la dernière strate ; 3) si les pauvres sont stigmatisés, ils conservent des moyens de résistance au discrédit qui les accable ; 4) le processus de disqualification sociale comporte plusieurs phases (fragilité, dépendance et rupture des liens sociaux) ; 5) les trois conditions sociohistoriques de l’amplification de ce processus sont : un niveau élevé de développement économique associé à une forte dégradation du marché de l’emploi ; une plus grande fragilité de la sociabilité familiale et des réseaux d’aide privée ; une politique sociale de lutte contre la pauvreté qui se fonde de plus en plus sur des mesures catégorielles proches de l’assistance.
La disqualification sociale ne signifie pas l’absence de relations sociales. Les pauvres sont d’ailleurs en relation avec les services sociaux, mais leur situation se caractérise par une pauvreté relationnelle grandissante qui s’ajoute à leur pauvreté économique et renforce leur sentiment d’inutilité sociale. C’est aussi la stigmatisation des pauvres, le fait d’être aux yeux de la société pauvres et rien que pauvres, qui les conduit très souvent à intérioriser une image négative d’eux-mêmes et à éprouver un sentiment d’inutilité sociale.
C’est dans le cadre de programmes européens sur les effets du chômage que j’ai pu ensuite approfondir cette problématique du délitement des liens sociaux. Le chômage correspond à la rupture du lien avec le monde du travail — ce qui correspond sur le plan conceptuel à la rupture du lien de participation organique. Cette rupture en entraîne-t-elle d’autres ? Affecte-t-elle aussi les relations familiales — le lien de filiation —, les relations de sociabilité amicale — le lien de participation élective — et les relations avec les institutions publiques — le lien de citoyenneté ? Autrement dit, ces différents types de liens, complémentaires au lien de participation organique, s’affaiblissent-ils aussi sous l’effet d’un processus global de disqualification sociale ou, au contraire, constituent-ils des ressources vitales pour faire face au chômage ?
Prenons l’exemple du recours aux solidarités familiales qui dépend non seulement des ressources disponibles dans la famille du chômeur, mais aussi du système normatif en vigueur dans le pays en question. L’un des résultats les plus frappants d’une enquête européenne récente que j’ai coordonnée[11] est le constat d’une opposition très nette entre l’attitude générale des chômeurs allemands et français qui expriment une gêne de solliciter ce type d’aide et celle des chômeurs des pays du sud de l’Europe pour qui il est normal et légitime de se tourner en priorité vers des membres de la famille en cas de besoin, même si cette dépendance peut être également vécue comme une contrainte. On ne peut comprendre cette distinction si l’on ne prend pas en compte la norme d’autonomie.
En Allemagne et en France, les chômeurs se pensent avant tout comme des personnes autonomes et ne veulent en aucun cas dépendre de façon durable de leur famille. Cela ne veut pas dire qu’ils entretiennent nécessairement de mauvaises relations avec leurs parents ou des membres plus éloignés de la famille, mais ils ont [si bien] intériorisé cette norme de la non-dépendance qu’ils en font une question d’honneur social. Mais cette volonté d’autonomie peut les conduire, malgré eux, à se replier sur eux-mêmes et à éviter tout contact.
Dans les pays du sud de l’Europe, le régime d’attachement — au sens des liens sociaux — est de nature familialiste. Ce régime est régulé, je l’ai dit, par l’emprise qu’assure le lien de filiation sur les autres types de liens. Il est plus répandu dans des régions caractérisées par un faible développement industriel, dans des zones rurales où l’économie repose encore en grande partie sur de petites unités de production relativement repliées sur elles-mêmes ou sur un secteur géographiquement limité. Mais il peut se maintenir dans des régions plus développées en offrant ainsi une base familialiste à un capitalisme de petits entrepreneurs solidaires entre eux. Ce régime s’accompagne de fortes inégalités sociales sans que celles-ci soient pour autant fortement combattues. Elles sont en quelque sorte « naturalisées ». La pauvreté est intégrée au système social, les pauvres acceptant leur condition comme un destin, celui de leur famille, auquel ils ne peuvent pas échapper. La survie est dès lors recherchée en priorité dans le réseau familial, lequel constitue l’instance essentielle de l’intégration. Nous avons pu constater combien ce principe de solidarité familiale constitue la référence absolue aussi bien en Espagne, en Portugal et en Grèce. De nombreux chômeurs interviewés sont retournés vivre chez leurs parents. Certains avouent même qu’ils vivent grâce à la pension de retraite ou d’invalidité de leur père ou de leur mère. En réalité, ils justifient cette attitude à la fois par la contrainte de la privation, mais aussi comme l’expression d’une nécessaire réciprocité au sein de la cellule familiale, sachant qu’ils apportent eux-mêmes, par leur présence et les services qu’ils rendent, une aide précieuse à leurs parents vieillissants. Mais cet ancrage dans les relations sociales de proximité ne signifie pas que les chômeurs de ces régions pauvres n’éprouvent pas le sentiment d’isolement. Ils peuvent avoir la sensation d’étouffement lorsque les liens qui les attachent à leur groupe de destin deviennent oppressants. Ces liens ne les libèrent pas toujours. Au contraire, ils peuvent les enfermer dans des relations contraintes où ils se sentent rabaissés, humiliés, incompris. Ils peuvent alors se sentir seuls tout en étant entourés.
À travers ces deux exemples, on comprend les logiques contrastées qui peuvent conduire à l’isolement. D’un côté, c’est la volonté d’autonomie associée au besoin de maintenir leur statut social qui conduit les chômeurs à se replier sur eux-mêmes et à se sentir seuls. De l’autre, c’est bien l’oppression de relations contraintes dans un monde fermé qui est à l’origine du sentiment d’isolement et aussi de solitude.
On comprend bien, à travers ces exemples, que l’on peut souffrir de solitude tout en étant entouré. Quelle approche avez-vous privilégiée pour mesurer ce sentiment de solitude et le distinguer de la seule question de l’isolement ?
Les différents points que je viens d’aborder prouvent la difficulté de cerner de façon satisfaisante le phénomène de la solitude. Si l’on s’en tient à une définition minimale, la solitude est l’état d’une personne qui est seule. Mais les exemples que j’ai pris montrent que tout individu, dans certaines circonstances, peut être entouré et néanmoins se sentir seul. Le problème se complexifie encore si l’on entend intégrer dans la définition les facteurs explicatifs qui sont nombreux. Ces derniers peuvent être aussi bien d’ordre individuel — liés, par exemple, à des événements qui ont marqué la trajectoire d’une personne depuis son enfance — que d’ordre collectif ou environnemental, renvoyant en cela à des contextes économiques, sociaux ou culturels précis. Il existe en effet une littérature abondante sur le sujet. Les théories sont nombreuses. Certains auteurs considèrent la solitude comme une pathologie liée à des conflits remontant à la petite enfance ; d’autres insistent sur l’ajustement inadéquat entre le moi réel d’un individu et son moi idéalisé. Pour les uns, elle est un facteur existentiel positif, pour d’autres, elle est l’expression d’une carence individuelle. Les sociologues, enfin, se disputent selon qu’ils insistent sur une approche structuraliste, interactionniste ou cognitive de la solitude.
Le défaut majeur de ces différentes approches est précisément qu’elles entendent, les unes comme les autres, enfermer le phénomène de la solitude dans un cadre analytique conceptuel et théorique exclusif. Il me semble préférable d’essayer de construire des ponts entre elles. C’est ce que j’essaye de faire, par exemple, en dépassant le clivage disciplinaire entre l’approche psychologique et l’approche sociologique de la théorie de l’attachement. Si l’on peut définir l’attachement comme un fait social total, on peut en faire autant pour la solitude.
Mais il faut, pour cela, s’en donner les moyens, notamment par la réalisation d’enquêtes ambitieuses réalisées à grande échelle, en population générale, sur des territoires, des régions et des pays contrastés et disposant d’une batterie large de questions sur la trajectoire des personnes, mais aussi sur la pluralité de leurs expériences de vie en lien avec les différentes sphères de leur vie quotidienne. C’est ce que j’ai essayé de faire à partir d’une expérience pilote réalisée dans la métropole strasbourgeoise (voir supra) qui, je l’espère, pourra être étendue à d’autres zones géographiques et, pourquoi pas, à d’autres pays.
Dans cette enquête, nous avons cherché à évaluer les principales inégalités face au risque de délitement des liens sociaux, ce qui impliquait d’avoir des indicateurs fiables pour mesurer la force, la faiblesse et la rupture des quatre types de liens sociaux (définis ci-dessus). Ensuite, nous avons étudié le rapport entre isolement, solitude et délitement des liens sociaux. Ces termes, on l’a vu, ne sont pas synonymes. Nous avons retenu deux types d’indicateurs principaux pour mesurer la solitude.
Le premier provient d’une question formulée ainsi : « D’une façon générale, vous diriez que vous vous sentez très seul, plutôt seul, plutôt entouré ou très entouré ? » On peut estimer que les personnes ayant donné comme réponse la première ou la deuxième modalité peuvent être considérées comme souffrant au moins un peu de solitude. Elles représentent 15,2 % de notre échantillon. Le second indicateur est obtenu par la question suivante : « Par rapport à la solitude, quelle est la phrase qui correspond le mieux à ce que vous éprouvez : 1. Je n’éprouve jamais ou très rarement le sentiment de solitude ; 2. J’éprouve de temps en temps le sentiment de solitude : 3. J’éprouve régulièrement le sentiment de solitude ; 4. J’éprouve le sentiment de solitude, mais il ne me pèse pas ; 5. Je recherche la solitude. » On peut estimer que les personnes souffrent de solitude quand elles ont répondu la modalité 3, c’est-à-dire lorsque ce sentiment n’est pas passager, mais au contraire régulier. Dans notre échantillon, 10,7 % sont dans cette situation.
Ces deux indicateurs peuvent paraître très proches, mais ils renvoient en réalité à deux notions différentes. La première relève d’une dimension spatiale du réseau de sociabilité : le fait d’être seul ou entouré. Le deuxième fait explicitement référence à une temporalité. Nous disposons aussi de questions plus précises sur les lieux et les situations dans lesquelles les personnes peuvent se sentir seules. On leur demande par exemple si elles se sentent chez elles, au travail, dans les lieux publics, ou encore, dans leur couple, dans leur famille ou quand elles sont entourées de leurs connaissances.
C’est en croisant l’ensemble de ces indicateurs que l’on a pu évaluer l’ampleur de l’isolement et de la solitude à l’échelle de cette métropole, mais aussi les principales inégalités au sein de cette population face au risque d’en faire l’expérience et d’en souffrir.
Quelles étaient ces différentes formes d’expériences de l’isolement et de la solitude ? Avez-vous repéré des situations particulièrement porteuses de souffrance sociale ?
Il s’agissait d’étudier les effets de l’isolement sur la santé en général et, notamment, sur la santé mentale. Les personnes isolées ont globalement un risque plus élevé que les autres de connaître des symptômes de dépression. Mais jusqu’où cette hypothèse est-elle vérifiée ? Existe-t-il des différences selon les formes et l’intensité de l’isolement ? Quelles sont les ruptures de liens sociaux dont les effets sont les plus dévastateurs ? Quelles sont les formes de résistance que mobilisent les personnes isolées ?
Comme on pouvait s’y attendre, nous avons pu vérifier une forte corrélation entre la solitude — aussi bien mesurée par le sentiment d’être seul ou très seul que par le sentiment de solitude régulière — et les liens sociaux : les personnes souffrant de solitude sont proportionnellement et systématiquement moins pourvues de liens sociaux que celles qui n’en souffrent pas.
Mais nous avons essayé d’aller plus loin dans l’analyse. Pour mesurer la souffrance, nous avons introduit dans l’enquête une série d’items testés dans des recherches internationales et repris dans le Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Il s’agit d’identifier et de mesurer des symptômes dépressifs. Le protocole implique de poser deux questions. La première consiste à demander à la personne interviewée si elle a éprouvé au cours des deux dernières semaines des difficultés ainsi formulées : 1) Vous êtes-vous senti particulièrement triste, cafardeux, déprimé, la plupart du temps au cours de la journée, et ce, presque tous les jours ? ; 2) Aviez-vous presque tout le temps le sentiment de n’avoir plus goût à rien, d’avoir perdu l’intérêt ou le plaisir pour les choses qui vous plaisent habituellement ? ; 3) Vous sentiez-vous presque tout le temps fatigué, sans énergie ? Ensuite, si la personne a donné au moins deux réponses « oui », on lui propose de répondre à une autre question abordant sept nouveaux critères. On estime que la personne est déprimée si elle a répondu au total à au moins 4 réponses « oui » sur les 10 items. Dans notre échantillon, c’est le cas de 66 personnes, soit 13 %. Les personnes déprimées sont, comme on pouvait s’y attendre, nettement et systématiquement moins pourvues en liens sociaux que les personnes qui ne le sont pas. Cette forte corrélation ne signifie pas pour autant une relation de cause à effet. Il n’est pas possible, avec les données dont nous disposons, de dire si c’est le délitement des liens sociaux qui provoque la souffrance psychologique ou, au contraire, si c’est la souffrance psychologique qui entraîne le délitement des liens sociaux. Probablement que ces deux éléments peuvent jouer dans les deux sens en se renforçant mutuellement. Toujours est-il que la surface d’intégration sociale, mesurée en fonction de quatre types de liens, des personnes déprimées est nettement inférieure à celle des personnes non déprimées.
Avez-vous pu identifier les principales inégalités en jeu dans cette problématique de la solitude ?
Prenons un exemple peu connu. Celui de l’inégalité face au risque de rupture du lien de filiation. D’après l’enquête SIRS (santé, inégalités et ruptures sociales) de 2010, 12 % des personnes interrogées n’ont plus de relation avec leur père (en vie), et 8,8 % n’ont plus de relation avec leur mère (en vie). Les proportions correspondantes parmi les ouvriers sont respectivement de 27,9 % et de 21,3 %, alors qu’elles tombent à 4,3 et 3,6 % parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures. La probabilité de ne plus avoir de lien avec ses parents est par conséquent très inégale selon les milieux sociaux. D’une façon plus générale, si l’on prend chacun des types de liens sociaux séparément, les inégalités face au risque qu’ils s’affaiblissent ou se rompent sont considérables d’un milieu social à l’autre. C’est la thèse que nous avons développée dans le livre collectif, préparé au sein de l’Équipe de recherche sur les inégalités sociales[12].
Mais si nous prenons en compte les indicateurs de solitude, tels que nous les avons construits dans l’enquête réalisée dans la métropole strasbourgeoise, nous arrivons à des conclusions similaires. Les personnes qui se sentent seules ou très seules et les personnes qui éprouvent la solitude de façon régulière sont réparties de façon très inégale dans la population générale. Les hommes se sentent proportionnellement plus souvent seuls ou très seuls que les femmes (17,1 % contre 13,7 %), mais ils n’éprouvent pas davantage qu’elles le sentiment de solitude de façon régulière. Il existe des différences selon l’âge. On aurait pu s’attendre à ce que le sentiment d’être seul ou très seul augmente avec l’âge, or, un peu curieusement, les personnes de 70 ans et plus représentent la tranche d’âge pour laquelle la proportion est la plus faible (7,8 % contre 15,2 % dans l’ensemble de l’échantillon). Il n’existe pas en revanche d’écart significatif en ce qui concerne le sentiment régulier de solitude. Ces résultats montrent que ce n’est pas l’âge en tant que tel qui provoque la solitude, mais des facteurs qui peuvent lui être associés, comme le fait de vivre dans la pauvreté par exemple ou le fait de ne plus pouvoir compter sur ses proches.
La situation par rapport à l’emploi constitue un facteur déterminant de la solitude ; 45,2 % des chômeurs disent qu’ils se sentent seuls ou très seuls et 38,7 % qu’ils souffrent régulièrement de la solitude. Notons aussi que 21,3 % des « autres inactifs », c’est-à-dire notamment des mères au foyer, se sentent seuls ou très seuls. Les retraités, en revanche, éprouvent proportionnellement ce sentiment de façon beaucoup moins intense.
Le niveau d’études est également très discriminant ; 22,9 % des personnes qui ont un niveau d’études primaires se sentent seules ou très seules, contre 17,3 % des personnes de niveau secondaire et 13,1 % de niveau supérieur. La catégorie socioprofessionnelle la plus touchée par la solitude est celle des ouvriers : 20,4 % d’entre eux se sentent seuls ou très seuls et 16,3 % disent éprouver la solitude de façon régulière. Les cadres sont, au contraire, les moins touchés par ce phénomène.
Notons surtout que la solitude est très dépendante de la situation financière ; 21,1 % des personnes en situation précaire se sentent seules ou très seules et la proportion atteint 27,7 % lorsque les personnes sont en situation très précaire. On retrouve la même tendance si l’on se réfère au sentiment régulier de solitude ; 20 % des personnes en situation très précaire l’éprouvent.
Enfin, en ce qui concerne le quartier de résidence, on notera, même s’il n’existe pas de relation graduelle entre le sentiment de solitude et la hiérarchie sociale des quartiers, que la proportion la plus faible de personnes se sentant seules ou très seules est obtenue dans le type de quartier favorisé (8,6 %) et que la proportion la plus élevée dans le type de quartier pauvre (21,7 %).
Ces résultats prouvent que le sentiment de solitude est fortement corrélé, non pas à l’âge en tant que tel, mais avant tout aux conditions d’existence. Les personnes en situation de précarité ont un risque beaucoup plus élevé de faire l’expérience de la solitude que les personnes qui en sont épargnées. On peut parler alors d’un cumul de difficultés ou de handicaps.
Nous avons constaté également que la dépression et la souffrance de la solitude diminuent de façon globalement très graduelle selon que le niveau d’intégration sociale s’élève. Ce phénomène touche aussi bien les moins de 60 ans que les 60 ans et plus. La dépression et la souffrance liée à la solitude sont fortement corrélées à la faiblesse ou la rupture des liens sociaux. Mais, nous avons aussi montré qu’à niveau égal d’intégration sociale, les moins de 60 ans sont nettement plus déprimés et souffrent nettement davantage de solitude.
Ce résultat peut surprendre puisque les personnes de 60 ans à moins de 70 ans, et encore davantage les 70 ans et plus, sont proportionnement plus nombreuses à vivre seules. Comment peut-on alors expliquer ce phénomène ? Si la dépression et la solitude sont fortement corrélées au niveau d’intégration sociale, il convient de se référer, au-delà du niveau en lui-même, au modèle normatif qui fonde le système d’intégration de façon globable dans la société. Or, ce modèle normatif n’est pas le même selon le cycle de vie. Les individus intériorisent ce modèle et évaluent en permanence leur situation par rapport à ce dernier. Dans la période dite de pleine activité, c’est-à-dire aujourd’hui de 25 à 60 ans, les individus savent qu’ils doivent être actifs et performants et que leur niveau de vie, mais aussi leur protection face aux aléas de la vie et la reconnaissance sociale de leur statut, dépendent en grande partie de leur intégration professionnelle (et d’autant plus encore dans le type de régime d’attachement organiciste). Ne pas correspondre à ce modèle et déroger ainsi aux attentes sociales légitimes pousse les individus vers un processus de disqualification sociale. C’est la raison pour laquelle les chômeurs sont fortement touchés aussi bien par la dépression que par la solitude. Après 60 ans, le modèle normatif de référence change. La question n’est plus de trouver sa place dans le monde du travail, mais de faire face au quoditien avec, pour certains, un faible revenu. La question de l’isolement se pose presque inévitablement lorsque les proches décèdent ou que les membres de la famille sont géographiquement dispersés et éloignés. De fortes inégalités existent selon les personnes âgées face au risque de délitement des liens sociaux. Mais, proportionnellement, et à niveau d’intégration sociale équivalent, la dépression et le sentiment de solitude sont plus répandus parmi les actifs disqualifiés.
Il convient d’en tirer des conclusions. Si la solitude fait partie potentiellement de la condition humaine, il faut rappeler que le risque d’en faire durablement l’expérience est très inégalement réparti. Le risque est plus élevé chez celles et ceux qui ont connu dans leur vie des ruptures qui ont affecté leurs liens sociaux. Il varie aussi bien selon la trajectoire des personnes, les événements et les interactions qui ont caractérisé les étapes de leur socialisation, que selon les contextes économiques, sociaux et culturels. C’est la raison pour laquelle la question de la solitude mérite d’être analysée, non pas dans un cadre conceptuel étroit et restreint à une approche disciplinaire, mais, au contraire, dans le cadre d’une théorie plus générale qui englobe l’ensemble des sciences sociales et qui envisage l’attachement comme un fait social total.
Appendices
Notes
-
[1]
Voir les références bibliographiques à la fin de l’article.
-
[2]
Ouvrage à paraître : PAUGAM, S. (2019), De l’attachement social. Esquisse d’une théorie des liens solidaires, Paris, Éditions du Seuil.
-
[3]
BOWLBY, J. (1978 [vol. I 1969] [vol. II 1973]), Attachement et perte, vol. I Attachement, vol. II Angoisse et colère, Paris, PUF, « Le fil rouge ». BOWLBY, J. (1984[1980]), Attachement et perte, vol. III Tristesse et dépression, Paris, PUF, « Le fil rouge ».
-
[4]
Émile Durkheim se réfère explicitement au concept d’attachement aux groupes dans son cours sur l’éducation morale. DURKHEIM, É. (1902-1903), L’éducation morale, Paris, PUF, « Quadrige-Grands textes ».
-
[5]
Pour une présentation plus détaillée, voir : PAUGAM, S. (2018 [2008]), Le lien social, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? ».
-
[6]
HONNETH, A. (2002 [1992]), La lutte pour la reconnaissance, Paris, Édition du Cerf.
-
[7]
Isolement et délitement des liens sociaux. Enquête dans l’agglomération de Strasbourg, Serge PAUGAM avec la collaboration de Jean-Marie FIRDION, Camila GIORGETTI et Sébastien DUPONT, Enquête expérimentale réalisée à l’initiative de la Société Saint-Vincent de Paul en partenariat avec La Fondation Caritas France, La Fondation pour le lien social — Croix-Rouge France, La Fondation des Petits Frères des Pauvres. Voir résultats et méthodologie : www.ssvp.fr/enquete-lisolement-delitement-liens-sociaux/, consulté le 1er mai 2018.
-
[8]
On pourra se reporter à PAUGAM, S. (2016), « Poverty and Social Bonds : Towards a Theory of Attachment Regimes », in Lutz Raphael, Tamara Stazic et Beate Altahmmer (dir.), Rescuing the Vulnerable : Poverty, Welfare and Social Ties in Modern Europe, New York, Bergham Books, p. 23-46, et à PAUGAM, S. (2016), « La perception de la pauvreté sous l’angle de la théorie de l’attachement. Naturalisation, culpabilisation et victimisation », Communications, n° 98, p. 125-146.
-
[9]
PUTNAM, R. D. (2000), Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon and Schuster.
-
[10]
PAUGAM, S. (2009 [1991]), La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige ».
-
[11]
PAUGAM, S. (2016), « Social Bonds and Coping Strategies of Unemployed People in Europe », Italian Sociological Review, vol. 6, n° 1, p. 27-55. DOI : 10.13136/isr.v6i1.122.
-
[12]
PAUGAM, S. (dir.) (2014), L’intégration inégale. Force, fragilité et rupture des liens sociaux, Paris, Presses universitaires de France, « Le lien social ».
Bibliographie
- Paugam, S. (2009 [1991]), La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige ».
- Paugam, S. et D. Gallie (dir.) (2000), Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe, Oxford, Oxford University Press.
- Paugam, S. (2007 [2000]), Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l’intégration professionnelle, Paris, Presses universitaires de France.
- Paugam, S. (2012 [2005]), Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Le lien social ».
- Paugam, S. (dir.) (2011 [2007]), Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, PUF, coll. « Le lien social ».
- Paugam, S. (2008), Le lien social, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? ».
- Paugam, S., etal. (2013), Des pauvres à la bibliothèque. Enquête au Centre Pompidou, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Le lien social ».
- Paugam, S. (dir.) (2014), L’intégration inégale. Force, fragilité et rupture des liens sociaux, Paris Presses universitaires de France, coll. « Le lien social ».
- Paugam, S. (2015), Vivre ensemble dans un monde incertain, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube.
- Paugam, S., etal. (2017) Ce que les riches pensent des pauvres, Paris, Le Seuil.
Sélection des travaux de Serge Paugam en rapport avec le thème de cet entretien :