Abstracts
Résumé
Contrairement aux approches systémiques du racisme, cet article s’intéresse aux acteurs racistes et aux différentes logiques qui structurent leurs pratiques et leurs discours. Il cherche à comprendre la manière dont s’articulent le racisme différentialiste, le racisme d’infériorisation et le racisme universaliste. L’enquête ethnographique menée à Sept-Îles au Québec entre 2005 et 2009 met en évidence les pratiques et les discours racistes en se concentrant principalement sur deux situations conflictuelles : l’entrée des Innus dans le secteur des pêches commerciales et les revendications territoriales pour la restitution du Nitassinan. L’analyse de ces situations de nature économique et politique permet de discerner les multiples articulations des logiques du racisme et leurs variations en fonction des acteurs, de leurs positions et des rapports qu’ils entretiennent avec les Innus. Le racisme anti-autochtone apparaît traversé par un ensemble de tensions et d’oppositions qui en font un phénomène non pas unifié, mais plutôt éclaté.
Mots-clés :
- Racisme systémique,
- politiques de reconnaissance,
- exclusion,
- discrimination,
- Peuples autochtones,
- Québec
Abstract
Unike sytemic approaches to racism, this article focuses on racist actors and the different logics that structure their practices and discourses. The main objective is to understand the ways in which differentialist racism, racial discrimination, and universalist racism are articulated. The ethnographic fieldwork conducted in Sept-Îles, Quebec between 2005 and 2009 highlights racist practices and discourses. This article focus mainly on two conflict situations: the rise of the Innu into the fishery industry and the global land claims for the restitution of the Nitassinan. The analysis of these economic and political situations makes it possible to distinguish the multiple logics of racism against Indigenous Peoples and their variations depending to the actors, their social status and their relations with the Innu. Racism against Indigenous Peoples is a set of tensions and oppositions that make it a social phenomenon that is not unified but rather fragmented.
Keywords:
- Systemic Racism,
- Politics of recognition,
- Exclusion,
- Discrimination,
- Indigenous Peoples,
- Quebec
Resumen
Contrariamente a los enfoques sistémicos del racismo, este artículo se interesa en los actores racistas y en las distintas lógicas que estructuran sus discursos y prácticas. Se trata de entender cómo se articulan el racismo diferenciado y el racismo de inferiorización. Una investigación etnográfica realizada en Sept-Îles, Quebec, entre 2005 y 2009, evidencia las prácticas y los discursos racistas, centrándose principalmente en dos situaciones conflictivas: la entrada de los innu en el sector de las pesquerías comerciales y las reivindicaciones territoriales. El análisis de estas situaciones de naturaleza económica y política permite discernir las múltiples articulaciones de las lógicas del racismo y sus variaciones en función de los actores, sus posiciones y las relaciones que mantienen con los innu. El racismo anti-indígena aparece atravesado por un conjunto de tensiones y oposiciones que hacen de éste un fenómeno no unificado, sino más bien disperso.
Palabras clave:
- Racismo sistémico,
- políticas de reconocimiento,
- exclusión,
- discriminación,
- pueblos indígenas,
- Quebec
Article body
Le racisme anti-autochtone constitue un puissant levier de maintien du colonialisme interne au Canada. Dans la première moitié du xxe siècle, le racisme était total. L’idéologie raciste déterminait les conduites politiques de ségrégation et d’exploitation. Les travaux de la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens (CVR) ont mis en évidence le rôle de l’idéologie impérialiste et du racisme dans le génocide culturel perpétré contre les peuples autochtones (CVR, 2015). Aujourd’hui, le racisme anti-autochtone semble se déployer dans des situations et à des niveaux forts différents. Il laisse sa marque dans les régions ouvrières de la Côte-Nord délaissées par les compagnies minières (Capitaine, 2017) et surgit dans les discours de leaders politiques ou d’intellectuels (Flanagan, 2002 ; Bouchard, 2003). Il n’existe pas de parti politique dont le succès repose sur une idéologie exhortant, à proprement parler, à l’exclusion ou à l’infériorisation des peuples autochtones. Néanmoins, il existe des lois (Leclair, 2011 ; Otis, 2011), des « politiques de racialisation » (Fassin, 2014) qui réduisent les Autochtones à des positions racialisées. Ces politiques de racialisation telles que celles qui encadrent les revendications territoriales (Canada, 1984) sont connues, voire défendues par les Autochtones eux-mêmes (Eisenberg et al., 2014) et servent de base à la négociation des relations politiques entre la majorité canadienne et les nations autochtones (Tully, 2002). Si le racisme anti-autochtone contemporain n’appartient pas au passé, forme-t-il toujours un système cohérent et unifié ? Le racisme anti-autochtone obéit-il plutôt à des logiques diverses et contradictoires ? Ces logiques varient-elles selon la position et l’intérêt des acteurs ? Agissent-elles de concert sur les plans individuel, institutionnel et culturel ? Poser ces questions ne revient pas à nier l’importance des rapports de race dans la vie sociale. Interroger le caractère systémique du racisme et des discriminations revient à analyser « les articulations, coordinations ou réseaux d’action et d’acteurs impliqués dans la production » (Dhume, 2016) des discriminations et du racisme et ainsi contribuer modestement et de manière critique au débat polarisé entre les tenants d’une approche totale et structurelle du racisme anti-autochtone et ceux qui dénient au racisme tout rôle dans la production des rapports entre Autochtones et Allochtones au Québec.
Au Canada anglais, le racisme anti-autochtone est aujourd’hui la matrice explicative d’un vaste ensemble de phénomènes sociaux a priori disparates, voire contradictoires. La pauvreté endémique, l’espérance de vie moindre et les taux largement supérieurs à la moyenne canadienne de femmes et d’hommes incarcérés, de femmes autochtones disparues, assassinées ou victimes de violence, d’enfants placés en famille d’accueil par les services de protection de l’enfance ou de suicides tiennent lieu de principaux indicateurs du « racisme canadien » (Manuel et Derrickson, 2018 : 78). Le racisme y est principalement appréhendé à travers une approche systémique, c’est-à-dire à partir des structures idéologiques inhérentes à l’entreprise coloniale (Steinman, 2012 ; Coulthard, 2014 ; Chakma et al., 2001 ; Barker, 2009). Le racisme est décrit comme un rapport déterminant entre d’une part la culture blanche coloniale et, d’autre part, ce que l’on pourrait appeler la « personnalité de base » des colonisateurs. Ce racisme, qu’il s’agit, par un travail de dévoilement, de faire émerger à la conscience des acteurs, plébiscite de manière surprenante un culturalisme classique tout en empruntant à un structuro-fonctionnalisme parsonien, deux approches sociologiques largement critiquées depuis la fin des années 1960. Il est effectivement difficile de nier le rôle des mouvements sociaux autochtones (Capitaine, 2014) et les gains obtenus (ou consentis) aux échelles locales, nationales et internationales dans des sphères de la vie sociale de plus en plus larges (enseignement supérieur et curriculum, famille, représentation politique, etc.).
Alors qu’au Canada anglais, de plus en plus de chercheurs recourent au racisme systémique ou structurel pour expliquer des phénomènes aussi différents que les inégalités sociales ou les disparitions et les assassinats des filles et femmes autochtones au Canada, ce n’est pas (encore) le cas au Québec. Le travail de la CVR et les politiques d’excuses officielles ont certes renforcé le mouvement antiraciste et popularisé l’approche systémique, mais ils ont également nourri un mouvement inverse de « non-racisme » (Lentin, 2019). Le déni du racisme au Québec se nourrit du mythe collectif d’une colonisation française basée sur des alliances et le métissage par opposition à la colonisation anglaise violente et assimilationniste. Comment le Québec pourrait-il être le colonisateur puisqu’il est lui-même le colonisé ? L’historiographie des pensionnats indiens par la CVR a récemment donné lieu à une réaction de chercheurs québécois dénonçant une mémoire univoque et victimaire importée du Canada anglais et par là étrangère à la réalité historique des pensionnats mis en place au Québec à partir des années 1950[1] (Bousquet, 2016 ; Trudel, 2014 ; Goulet, 2016). Malgré le caractère ethno-racial des régimes juridique et politique qui organisent en partie les rapports entre la société canadienne et plusieurs millions d’Autochtones, la société canadienne-française se pense au prisme de l’universalisme abstrait, se réfère à la tradition républicaine (Chevrier, 2009) et serait donc à ce titre dépourvue de « races ». Cette mémoire culmine, depuis le début des années 2000, avec l’éloge du métissage entre les sociétés canadienne-française et autochtones, dont les alliances matrimoniales auraient donner naissance à une société originale au sein de laquelle les rapports de « races » n’auraient aucune signification (Leroux, 2015 ; Gaudry et Leroux, 2017).
Le champ du racisme anti-autochtone au Québec délaisse la perspective totale canadienne-anglaise. Comparativement, les travaux sont peu nombreux et se concentrent sur des niveaux d’analyse particuliers (individus, associations, discours médiatiques, politiques) à des moments de crise comme à la signature de l’approche commune avec les Innus en 2004 (Salée, 2005 ; Charest, 2003 ; Lord, 2010) ou pendant la crise d’Oka en 1990 (Trudel, 2009). Cet éclatement du champ et de la connaissance du racisme anti-autochtone au Québec permet de saisir les différentes formes qu’il peut prendre dans les secteurs de la vie sociale, des interactions ordinaires aux dispositifs juridiques et politiques de reconnaissance des droits, en passant par la production théâtrale, mais ne permet pas de le penser dans ses articulations entre les différents niveaux.
Contre toute forme de réductionnisme du racisme affirmant a priori d’un côté l’existence d’une idéologie unifiée ou de l’autre l’absence de dimension raciale dans les rapports sociaux entre Autochtones et Allochtones, cet article a pour objectif d’interroger modestement l’unité du racisme anti-autochtone en distinguant les niveaux et les espaces sociaux au sein desquels se déploient les pratiques et les discours racistes au Québec et au Canada. Si le racisme se rencontre à tous les niveaux de la vie sociale, cela ne signifie pas que le racisme anti-autochtone forme un système organisé et unifié.
Notre analyse s’appuiera sur une description et une analyse critique de deux situations conflictuelles d’ordre économique et politique. De proche en proche, le regard se déplacera de la vie quotidienne et des interactions vers les politiques de racialisation afin d’examiner les différentes logiques et le sens des discours racistes.
La première situation s’appuie sur une enquête ethnographique de terrain menée à Sept-Îles à la suite de l’accès des Innus au secteur de la pêche commerciale en 2004. La dimension économique et la forte identification des Nord-Côtiers à la pêche favorise l’examen de ce que l’on appelle le racisme de « petits Blancs » (Castel, 2003), de ses liens avec les politiques de racialisation ainsi que l’« ethnocentrisme de classe » (Hoggart, 2012) porté par des consultants et fonctionnaires du gouvernement. La deuxième situation s’enracine dans le contexte politique de reconnaissance des droits des Innus au début des années 2000. L’analyse critique des principes normatifs qui régissent les politiques de reconnaissance met en évidence le retour d’un racisme universaliste qui défend l’homogénéité de la nation.
méthodologie
Dans un contexte marqué par l’avènement des mouvements de reconnaissance dont l’enjeu est de lutter contre le mépris (Honneth, 2015) et de restaurer l’intégrité des identités minoritaires individuelles et collectives (Fraser, 2011), l’analyse du racisme à partir des discours des victimes et de leurs points de vue s’est multipliée depuis les années 1990 (Poli, 2007). Or, cette approche a eu pour effet de renforcer la dimension systémique du racisme souvent omniprésent dans l’expérience sociale des acteurs (Dunezat et Gourdeau, 2016 ; Picot, 2016), en même temps qu’elle participait à réduire la rationalité de l’acteur raciste.
Michel Wieviorka propose de distinguer quatre niveaux du racisme : l’infraracisme, le racisme éclaté, le racisme politique et le racisme total (Wieviorka, 1991 : 83-85). Le principal facteur qui permet de différencier et de mesurer le passage d’un niveau à un autre est la nature politique ou non du racisme ainsi que l’articulation entre discours et pratiques racistes allant de la désarticulation à la fusion totale. Distinguer les différents niveaux auxquels les logiques d’infériorisation et de différenciation opèrent est crucial, car cette distinction détermine le ou les niveaux de la réalité auxquels s’intéresser empiriquement. Si le racisme est total, celui-ci s’exprime à travers des lois, des politiques, des discours politiques qu’il convient d’analyser. S’il est plutôt infrapolitique, la démarche sociologique est différente. Étudier le racisme se fait alors en situation, sur le terrain, seule démarche possible pour observer et saisir ses manifestations fugaces et spontanées (Wieviorka, 1992 ; Bataille, 1997).
La difficulté d’aborder le racisme anti-autochtone réside dans le fait qu’il s’incarne dans des politiques et des dispositifs de racialisation (Leclair 2011 ; Otis 2011) ainsi que dans un racisme quotidien (everyday racism) (Essed 1991 ; Leah 1995 ; Eliasoph 1999) ou ordinaire. Ce n’est qu’à la condition de se dé-placer et de multiplier les sources et les méthodes d’analyse qu’il est possible d’entrevoir une unité ou une fragmentation de l’espace du racisme anti-autochtone. La méthode suivie adopte une approche situationnelle (Agier, 2017) dont l’intérêt est de saisir ces discours lors de situations particulières de crise qui agissent comme les révélateurs d’une « atmosphère raciste » (Martuccelli 1995). Le matériau découle de l’analyse critique de deux situations conflictuelles d’ordre économique et politique. De proche en proche, le regard se déplacera de l’aspect infrapolitique vers l’aspect politique afin d’examiner les différentes logiques, le sens des discours racistes et leur potentielle articulation.
La première situation décrit les rapports sociaux conflictuels consécutifs à l’accès des Innus, au tournant des années 2000, au secteur économique de la pêche commerciale. En vertu d’une entente avec le gouvernement fédéral, les Innus ont obtenu des subsides pour le rachat de bateaux et de permis de pêche. Durement touchés par les moratoires successifs imposés par le gouvernement fédéral dans les années 1990, certains pêcheurs nord-côtiers s’opposent à l’arrivée des Innus alors que d’autres parviennent à tirer parti de la situation en devenant partenaires ou cogestionnaires (Capitaine, 2012). L’enquête ethnographique a duré plus de huit mois entre 2005, 2006 et 2009 dans la ville de Sept-Îles située sur la Côte-Nord au Québec. Dans le cadre d’un projet de recherche (Charest, Girard, et Rodon, 2012), j’ai tout d’abord mené des entretiens formels avec des gestionnaires des secteurs privés ou publics d’origine québécoise qui travaillaient pour ou avec les Innus. Dans un deuxième temps, j’ai effectué une enquête ethnographique lors de laquelle j’ai recueilli des témoignages et observé les interactions entre les pêcheurs québécois et les Innus. J’ai également travaillé une semaine sur le bateau d’un pêcheur québécois et ai accédé à des discours de manière informelle. Ces entretiens formels, ces discours informels et ces observations ont été consignés dans un journal d’enquête et constituent le matériau pour analyser le niveau infrapolitique du racisme disséminé dans la vie quotidienne de Sept-Îles et de ses acteurs, indépendamment de leurs positions sociales.
La seconde situation s’inscrit dans le contexte politique des revendications territoriales des Innus et de la question de la souveraineté. Certaines bandes avaient signé en 2004 une entente de principe avec les gouvernements canadien et québécois. L’enjeu de l’autodétermination politique et de la légitimité des droits autochtones était, au moment de l’enquête, très présent sur la Côte-Nord marquée encore par le nationalisme québécois[2]. Lors de mon séjour à l’auberge de jeunesse, j’ai pu avoir de nombreuses conversations avec des Sept-Îliens et des résidents de passage qui ne manquaient pas de m’interpeller sur ces questions dès qu’ils avaient connaissance des raisons de ma présence sur la Côte-Nord[3]. Au-delà des discours informels collectés, l’analyse de la situation politique s’appuie sur des documents tels que l’entente de principe, la politique fédérale de revendications territoriales ainsi que des textes de politologues (Flanagan, 2002) et d’historiens (Bouchard, 2008 ; Dawson, 2003) relatifs aux revendications territoriales et aux droits autochtones.
L’ensemble de ces matériaux nous permettra en conclusion de discuter de l’articulation des expressions ordinaires et politiques du racisme anti-autochtone au Québec.
La naturalisation de la culture innue : exclusion et infériorisation
En 1995, le conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) signa une entente avec le gouvernement fédéral en vertu de la Stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA). Les Innus entreprirent la pêche commerciale la même année en se partageant un quota de pêche avec deux autres communautés de la Basse-Côte-Nord, Mingan et Natashquan. Un secteur des pêches fut créé et stratégiquement rattaché au bloc VI du conseil de bande abritant le secteur des revendications territoriales. D’abord propriétaires d’un bateau, les Innus connurent rapidement le succès. Ils firent appel à différents ministères[4] et les subventions s’accrurent.
L’ascension des Autochtones dans le secteur des pêches, forts de leur appui politique et économique, a suscité des réactions chez les Allochtones. Certains ne souhaitaient pas interrompre leur activité malgré la hausse significative du prix de vente des quotas consécutive à l’entrée des Autochtones sur le marché et certains refusaient d’apporter leur expertise aux pêcheurs autochtones. D’autres y ont vu une occasion favorable pour relancer un secteur économique durement touché par les moratoires des années 1990 en s’associant avec les Innus. Les rapports conflictuels se concentrèrent principalement sur la notion de travail de pêcheur comme empreint d’une éthique du mérite, du sacrifice. Or, ce système de valeurs modernes fut perçu comme antinomique la nature des Autochtones porteurs d’une culture traditionnelle jugée antimoderne. Interdits par la nature même de leur culture, les Innus étaient considérés comme incapables de travailler et de devenir pêcheur.
Si les préjugés étaient particulièrement explicites de la part des pêcheurs qui n’avaient pas participé au succès des Innus, les partenaires ou gestionnaires allochtones que ce soit au ministère Pêche et Océans Canada (MPO) ou au conseil de bande d’ITUM n’en étaient pas exempts. Les deux groupes, que je nommerai respectivement les « opposants » et les « adjuvants », s’inscrivaient dans une logique de différenciation culturelle reposant sur une réification de l’opposition binaire entre tradition et modernité. Il existait toutefois une différence selon la place sociale des acteurs. Pour les opposants, la logique de différenciation s’avérait totale dans la mesure où elle entraînait une volonté d’exclure les Innus de la modernité et de la ville. Dans le cas des adjuvants, la logique de différenciation s’articulait à une logique d’infériorisation qui légitimait par conséquent leur présence comme conseillers ou gestionnaires dépositaires des normes du travail.
Les opposants : préjugés et racialisation
La délégitimation du travail de pêcheur autochtone s’effectue par la mobilisation de préjugés reposant sur « des représentations de l’Autre qui valorisent l’ingroup (groupe d’appartenance, dit aussi endogroupe), au détriment de l’outgroup (groupe autre, dit aussi exogroupe), amplifient les différences et aboutissent à des stéréotypes susceptibles de nourrir ou de justifier des attitudes discriminatoires » (Wieviorka, 1998 : 55). L’amplification de la différence consistait, dans le cas du travail, à accroître la distance entre les normes régissant, selon les Allochtones, le travail de pêcheur d’une part et la culture innue d’autre part ; celle-ci étant implicitement perçue comme une somme d’essences, dépourvue de dynamisme et faisant des individus des déviants (paresseux ou alcooliques notamment). Les deux groupes (opposants et adjuvants) considéraient la culture innue sous le prisme de la tradition et d’une différence immuable et originaire se confondant avec la nature.
La logique de différenciation s’oppose, d’un point de vue théorique, à la logique de hiérarchisation. Il ne s’agit pas d’assimiler et de maintenir un groupe dans un rapport social inégal, mais d’exclure celui-ci de la société. Le racisme agit ici pour séparer et mettre à l’écart. La ségrégation est une des manifestations de cette logique. Dans sa forme radicale, la différenciation conduit à la destruction physique du groupe, au génocide. « Nouveau racisme », « néo-racisme » (Balibar et Wallerstein, 1998), « racisme différentialiste » (Taguieff, 1988), « racisme culturel » (Wieviorka, 1998) sont autant d’expressions qui marquent la césure avec la logique de hiérarchisation. Il s’agit selon Balibar, « d’un racisme dont le thème dominant n’est pas l’hérédité biologique, mais l’irréductibilité des différences culturelles ; un racisme qui, à première vue, ne postule pas la supériorité de certains groupes ou peuples par rapport à d’autres, mais “seulement” la nocivité de l’effacement des frontières, l’incompatibilité des modes de vie et des traditions » (Balibar et Wallerstein, 1998 : 33).
La pêche ne pouvait pas être l’affaire des Innus. « C’est pas leur truc », témoignait un pêcheur de Natashquan : « Vous avez de la chance de pas avoir d’Indiens chez vous [en France, ndlr]. Pour la pêche, ils ont des sous et ça y va à coups de millions de dollars alors qu’ils y connaissent rien. C’est pas leur truc. Un coup, peut-être, y a un de leurs chefs qui a fait pipi dans l’eau salée, mais c’est tout. Ils ont jamais pêché à la cage ni au poisson de fond[5]. »
La rupture avec le racisme scientifique et son référentiel génétique n’est pas si nette. Les conduites racistes qui s’inscrivent dans cette logique considèrent la culture de l’Autre comme immuable et innée, à l’instar des caractères biologiques et des traits phénotypiques. Pour qu’il y ait racisme culturel, écrit Wieviorka :
il faut notamment l’idée que l’on naît dans une culture, et non pas qu’on peut l’acquérir, il faut que la culture soit conçue comme un attribut relevant d’un passé commun auquel certains appartiennent, et d’autres non, sans qu’il puisse y avoir réellement de passage, d’inclusion […]. Le discours du « nouveau racisme » ne revient-il pas à naturaliser la culture, à lui accorder les attributs de la nature, de la race au sens biologique du mot ?
Wieviorka, 1998 : 34
L’hérédité biologique n’est pourtant pas totalement absente du racisme différentialiste. Lorsque j’objectais au pêcheur précédemment cité qu’il y avait des données anthropologiques prouvant que les Innus pêchaient en mer avant la colonisation, il s’emporta :
Les Européens qui arrivent [comme moi], ils ont une vision folkloriste, nostalgique de l’Indien. Ils veulent pas dire du mal d’eux. Mais moi depuis que je suis là, je peux te dire que c’est des fainéants. Ils accumulent les vices. Les hommes et les femmes, on voit plus la différence. Ils font 300 livres, y a que des plis. La malbouffe, ils passent leur temps à bouffer et le soir ils regardent le film porno en buvant de la bière. À Natashquan, ils sont plus racistes que nous[6].
Convoquer la différence culturelle ne sert pas uniquement à rappeler la division structurelle entre « eux » et « nous » qui est l’une des conditions de l’existence des groupes culturels (Hoggart, 2012). Le racisme culturel surgissait lorsque l’évocation de la différence culturelle enracinait les conduites des Innus dans les corps et par extension dans la race. Les individus dans leur singularité et même les catégories sociales ou de sexe qui servent dans la vie quotidienne de supports d’explication et de classification des conduites s’estompaient au profit d’une masse informe : « les Indiens ». Cet usage du terme « Indiens » plutôt que celui couramment utilisé « Autochtones » révélait par ailleurs que le conflit ne se situait pas dans un rapport d’antériorité (l’Autochtone est celui qui vient de la terre et non de l’immigration), mais dans un rapport racial (Blanc vs Indien). Les « Indiens » seraient inférieurs parce qu’ils seraient décadents, immoraux, incapables de vivre dans le monde développé, de s’adapter à la culture occidentale. Les références aux corps gros, à l’alcool et à la pornographie illustraient de manière exemplaire le processus de naturalisation de la culture à partir duquel le corps individuel se confondait avec le corps social (St-Jean, 2008). Cette assertion scellait un continuum entre racisme culturel et racisme biologique. L’individu n’était plus un être de culture, mais était livré à ses pulsions. Le racisme culturel visait à exclure.
Néanmoins, le racisme s’appuie aussi sur une logique d’infériorisation. La logique d’infériorisation engendre un positionnement inégal dans l’espace social. Dans sa forme pure, il s’agit moins pour les acteurs d’exclure ou de mettre à l’écart les groupes minoritaires que d’exploiter, d’inférioriser et consécutivement de sublimer les qualités du groupe dominant. Dit autrement, la logique de hiérarchisation implique un espace certes inégal, mais commun, une relation sociale quasi dialectique. « L’infériorisation est le corrélatif indigène de la supériorisation européenne. Ayons le courage de le dire, c’est le raciste qui crée l’infériorisé » (Fanon, 1952). Hiérarchiser n’exclut pas pour autant le fait de différencier, mais ici la différence culturelle est secondaire. Un des aspects de la situation coloniale, comme l’ont mis en évidence de nombreux travaux est l’exploitation[7] (Memmi, 1973 ; Fanon, 1968). Hannah Arendt (2006) considérait que l’impérialisme fut avant tout une question d’ordre économique.
Les opposants privilégiaient la logique de différenciation sans que celle-ci soit exclusive. Mais comment les deux logiques s’articulaient-elles l’une à l’autre ? La logique de différenciation n’avait-elle pour fonction que l’instauration d’un rapport inégal, que la légitimation d’une exploitation devenue impossible puisque les Innus contrôlaient la pêche ? Les propos d’un capitaine rapportés par un autre pêcheur allochtone éclairent ces questions. Il raconte :
Ils sont 11 embauchés. Y en a un, il est là pour réveiller les trois qui embarquent. Des fois, ceux qui embarquent, ils jettent la boët[8] avant d’arriver sur base et après ils disent : « Capt’ain, on n’a pas de boët » parce qu’ils savent qu’ils vont rentrer. Ils en ont rien à foutre. La pêche, ça a pas de sens pour eux. Le capt’ain il a dit : « J’arrête. Je peux pas bosser avec eux autres ! » Ils sont pas faits pour ça et les bureaucrates, ils les encouragent. Je donne trois ou quatre ans à la pêche, le temps que la pompe à fric s’arrête.
Le fait d’instaurer un rapport d’exploitation a pu être central au début de l’entrée des Innus dans le secteur des pêches, mais la relation sociale est apparue après un temps pour les opposants comme secondaire, voire utopique. Il n’était plus question de « travailler ensemble », d’exploiter vu la différence rendue incommensurable par le racisme culturel. La logique de hiérarchisation devenait, à mesure des relations entre Allochtones et Autochtones, virtuelle, imaginaire et laissait place à un racisme culturel visant dans ce cas plutôt l’exclusion, la ségrégation et non l’instauration d’un rapport social inégal. Cette mise à l’écart se trouvait renforcée par un processus de renversement bien décrit par Merton (1965). Le discours des opposants était structuré par le fait que les vertus de l’en-groupe, telles que la rationalité économique, devenaient les vices du hors-groupe. Les travailleurs innus étaient considérés comme des stratèges mus par la pulsion du gain immédiat et personnel, en somme des individus hobbesiens revenus à l’état de nature alors que la pêche impliquait une éthique de l’investissement et du dévouement qui n’était pas réductible à une simple source de profit. Le même pêcheur de Natashquan poursuivit : « Certains pensent encore qu’ils ont l’esprit de la forêt, animaux, chasse et tout, mais tu sais quoi ? Ils ont qu’un mot dans la bouche… tu sais ce que c’est ? Argent ! Argent ! Argent ! »
L’argent et les subsides dont bénéficient les Innus étaient des thèmes récurrents dans les discours des pêcheurs allochtones qui s’opposaient à l’accès des Innus à la pêche commerciale. L’un d’eux originaire de Natashquan relata son expérience personnelle : « Avant, j’en embauchais [des Indiens]. Je faisais le tri. Sur trente, j’en prenais un. Il y en a qui sont sympathiques, qui travaillent, mais c’est pas la majorité. C’est n’importe quoi. C’est une affaire de bureaucrates. Ils encouragent des fainéants. Ça va contre les principes de travail et d’ouvrage. Ils nous déshabillent pour habiller des fainéants qui ont que le mot “piasse” dans la tête. »
Les victimes du gouvernement n’étaient pas les colonisés, mais les colonisateurs ou plus exactement les travailleurs précaires des régions délaissées par les bureaucrates des centres urbains. Ce racisme « petit blanc » (Castel 2003) dirigé vers d’autres groupes marginalisés érigés en bouc émissaire se développait chez les opposants qui se sentaient abandonnés financièrement par l’État. En effet, depuis les années 1990, les gouvernements provincial et fédéral imposent des moratoires et des quotas de pêche dont les coûts ont flambé depuis l’arrivée des Innus. « Ils [le gouvernement] sont en train de tuer tout un secteur parce que les jeunes ils veulent pas prendre la relève. Avec le permis de crabe [très lucratif] à 1,5 M$, personne à part les Indiens peut acheter ça. Moi, à 800 000 $, j’aurai tenté le coup, mais là, non ! » raconta un pêcheur de Natashquan. « On perd nos droits », ajouta un autre. Ce racisme ne s’expliquait pas seulement par un phénomène de déclassement économique dont souffrent à intervalles réguliers les travailleurs de la région de Sept-Îles, dépendants des stratégies globalisées d’entreprises privées (minières, aluminerie) désormais sous capital étranger. La référence à la jeunesse et à l’absence de relève allochtone montrait que le sentiment de déclassement se double d’un sentiment de perte de l’identité nord-côtière structurée en grande partie par le secteur économique de la pêche en mer (Charest, 1970).
Les adjuvants : préjugés et infériorisation
Le racisme différentialiste se manifestait également dans le discours des acteurs et actrices qui travaillaient avec ou pour les Innus au développement de la pêche commerciale. La signification des discours comporte néanmoins des différences. La logique de différenciation apparaissait plutôt secondaire par rapport à la logique sociale de hiérarchisation. Autrement dit, le fait de considérer les Innus comme surdéterminés par leur héritage ancestral n’était pas central, il ne sous-tendait pas l’incompatibilité des races comme dans le cas des opposants, mais servait de prétexte au paternalisme et au maintien d’une relation sociale hiérarchique. Le discours des adjuvants était moins radical, le thème de la pureté des corps n’y avait pas sa place. Toutefois, l’ascendant hiérarchique des adjuvants allochtones sur les Innus fut remis en cause, la limite fut atteinte et les discours racistes firent surface.
Le discours est à nouveau marqué par la logique de différenciation et le processus de réification de l’opposition entre modernité et tradition. Un jeune anthropologue travaillant au ministère Pêche et Océans Canada me confiait : « J’ai quand même vu dans mes entrevues qu’ils aimaient ça monter dans le bois, prendre le temps. Personne veut faire du bureau, des études universitaires. Ils préfèrent être sur le terrain, le concret. Tant qu’il y aura pas des gestionnaires, des biologistes autochtones, ils seront pas autonomes. » L’opposition entre tradition et modernité n’était pas aussi irréductible que chez les opposants. Si les Autochtones étaient déterminés par leur culture et leur champ d’action réduit à la conformité, la logique de différenciation reposait plutôt sur une idéologie évolutionniste. La capacité à être autonome politiquement apparaissait déterminée par la différenciation sociale, à des critères propres à la société moderne (science et bureaucratie). Dans le discours des adjuvants, les Autochtones pouvaient changer et le devaient, mais ne le souhaitaient pas ou n’en avaient pas la capacité. Un autre homme allochtone qui conseillait les pêcheurs autochtones reprit un discours similaire :
Ils ont un esprit communautaire qu’on n’a pas. Ils redistribuent souvent, dès qu’ils ont de l’argent, à la communauté […]. Nous on épargne, on pense au futur, à la retraite, eux ils pensent au jour le jour. Si un jour ils veulent plus travailler, ils s’en vont. Bien sûr, ils ont besoin d’argent comme tout le monde, mais c’est pas pareil. En gros, ils en ont besoin pour la semaine et après, ça n’a pas d’importance. Ils ont pas cette volonté de faire plus, d’ascension. C’est pas des gens qui savent ce qu’est le business.
La différenciation culturelle et l’essentialisme des adjuvants semblaient anodins et s’appuyer simplement sur un relativisme culturel. « C’est pas pareil », déclara ce consultant allochtone, traçant la frontière de deux mondes culturellement distincts. Il continua et déclara : « Il y a beaucoup de consultants qui cherchent à les crosser. Il y a pas beaucoup de gens qui travaillent avec eux, si bien que quand tu viens les voir, ils te font confiance et beaucoup en profitent. Il faut que ce [la pêche] soit administré et fait par des Innus. Moi je conseille Gilbert [un Innu], mais s’il est pas d’accord, on va chercher une autre solution. » L’effacement de la relation hiérarchique n’était toutefois qu’une illusion nécessaire pour maintenir leur place au conseil de bande. L’économie de la pêche impliquait nécessairement des échanges, les deux mondes différents entraient inévitablement en interaction et dans cette situation d’interactions et d’échanges économiques surgissait brutalement des discours paternalistes. Pendant une rencontre avec le même consultant, cette fois accompagné d’un partenaire économique allochtone, ce dernier déclara :
Ils savent pas faire de business. C’est nouveau pour eux. Ils ont besoin de Blancs pour les aider. Regarde la pêche. C’est nous qui gérons l’usine et John apporte ses conseils à Marcel. Pourquoi tu vois personne travailler au restaurant ? Ça appartient à la femme d’un Innu. Y a pas un Autochtone qui travaille là. La Cage aux Sports, c’est pareil. Quand tu appelles au Shaputuan : « Allô ? Non, il est pas là… » C’est pas un service. Ils sont pas aimables. Ils envoient chier les clients.
La relation de partenariat n’était pas une relation horizontale, mais une relation de dépendance asymétrique. La différence culturelle et l’infériorité des Innus au regard du continuum évolutionniste auquel se référaient les partenaires et consultants servaient au maintien des Innus dans un rapport d’exploitation qui était totalement masqué par la logique de différenciation[9]. Celle-ci avait pour effet indirect d’ôter toute responsabilité aux Allochtones dans le maintien de ce paternalisme. Pour le dire simplement, les partenaires et consultants allochtones se trouvaient obligés de dominer les Innus qui non seulement ne détenaient pas le savoir, mais n’en auraient pas voulu puisque, comme le disait un consultant cité : « Ils ont pas cette volonté de faire plus, d’ascension. » Le partenaire allochtone tenait à m’expliquer, à la fin de l’entretien, que « le conseil réserve des places pour les Autochtones à Alouette ou à IOC, c’est des boulots stables qui gagnent 30 $ de l’heure. Mais c’est des boulots à la façon des Blancs ! Il faut pointer, c’est avec des chiffres. La plupart quittent ces boulots-là. C’est pas pour eux. Ça leur convient pas. » La logique de leurs discours conduisait à penser que les faibles salaires et les conditions de travail précaires sur appel qu’ils proposaient dans leur entreprise convenaient à la nature des Innus peu enclins au travail salarié à durée indéterminée et préférant un travail concret d’ouvrier. À l’obligation de dominer s’ajoutait l’obligation d’exploiter au nom d’une différence culturelle irréductible et soi-disant entretenue par les Autochtones.
Lorsque les travailleurs innus remettaient en cause le management allochtone, la relation hiérarchique et l’exploitation dont ils étaient l’objet, le discours des adjuvants se faisait plus conflictuel. L’un d’eux déclara : « La maison mère, c’est le conseil, ils vont tous là pour trouver un travail. Ils sont gâtés […]. Quand ils viennent [à l’entreprise], ils pensent que c’est au conseil, qu’ils vont aller chialer au conseil et revenir, mais c’est à nous ça, c’est privé. » L’autre consultant renchérit : « Quand il y en a qui rentrent pas le matin, plusieurs fois, ils ont un blâme. Le problème, c’est qu’ils vont chialer au conseil et après on les rembauche. » La remise en cause de la hiérarchie constituait un cas limite et révélait la centralité du rapport de hiérarchisation dans le racisme des adjuvants. Il n’était pas question d’exclure, de maintenir à l’écart, les Innus comme dans le cas des opposants. Le racisme des adjuvants visait à inférioriser et à légitimer l’exploitation et leur mainmise sur l’industrialisation.
Le racisme culturel ne se limitait pas aux pêcheurs déclassés socialement par l’arrivée des Innus dans le secteur de la pêche. Il était présent dans les discours des fonctionnaires des ministères qui administraient les programmes d’aide au développement de la pêche par exemple. Les préjugés reposaient encore une fois sur une conception de l’identité innue perçue comme une somme d’essences, sans plus d’horizon que celui de la reproduction d’un passé lointain. Interviewée au début de l’enquête, une coordonnatrice du MPO me confia alors : « C’était vraiment pas évident d’avoir un travail… en plus que la pêche, c’est exigeant là. C’est tout un changement pour eux autres de travailler régulièrement et puis c’est de la discipline : se lever tôt. Et puis c’est des longues journées, surtout la pêche à la crevette. » Or les Innus semblaient dépourvus de telles valeurs. La formation au métier de pêcheur pouvait apparaître néanmoins comme un moyen pour les jeunes Innus d’être reconnus, institutionnellement du moins, comme pêcheurs. Mais le comportement des Innus ne semblait toujours pas se fondre dans les normes consacrées. La même coordinatrice au MPO indiqua :
Le métier de pêcheur, il faut avoir de l’intérêt pour ça. Le recrutement, la façon dont ils le font, c’est qu’ils vont pas aller chercher des petits gars qui ont envie d’aller pêcher. Eux autres, ils veulent créer de l’emploi. Ils vont envoyer n’importe qui sur la formation parce que ce gars-là peut-être qu’il sort de prison, qu’il est dans la rue et qu’ils ont besoin de le prendre en main. C’est peut-être le gars qui travaille dans la construction l’été, mais à qui il manque 3 semaines ou 1 mois pour toucher l’assurance-chômage. Donc, ils vont dire : « Tu vas aller faire une formation sur les pêches, pendant ce temps-là on va te donner un salaire. Après, tu vas être capable d’avoir ton assurance-chômage. » Mais ils se fichent des résultats là.
Dans le cas de la pêche, la participation sociale des Innus et la mise en place de partenariats n’atténuaient pas le racisme différentialiste. Elle ne conduisait pas à l’exclusion physique ou à la destruction, mais elle légitimait plutôt une infériorisation dans le travail. Le racisme culturel était verbalisé, rationnellement construit et mobilisé au gré des discussions que j’ai pues avoir avec ces acteurs. Il n’était pas enfoui dans l’inconscient des acteurs, qu’ils soient opposants ou adjuvants, peut-être parce que comme l’ont montré de nombreux travaux, ce racisme différentialiste est directement légitimé par les dispositifs juridiques et politiques de reconnaissance des droits autochtones.
Politiques de reconnaissance des droits autochtones : du racisme culturel au « non- racisme »
La logique de différenciation à partir de laquelle les individus justifiaient la mise à l’écart des Innus ou leur infériorisation est au coeur du droit constitutionnel. L’analyse de la sphère du droit permet donc de penser l’articulation entre les niveaux du racisme, mais éclaire aussi de manière originale les controverses entourant la signature de l’entente de principe par certaines bandes innues en 2004 en faisant émerger une autre logique « non raciste ». Premièrement, la seule culture autochtone légitime aux yeux des Affaires autochtones et de la Cour suprême est celle qui prévalait au moment de l’arrivée des premiers colons. Deuxièmement, cette approche identitaire des droits naturalise les cultures autochtones et alimente le « non-racisme » à travers la diffusion, au Québec et au Canada, de discours d’acteurs qui considèrent que les « vrais » Innus, ceux qu’aurait rencontrés Champlain au moment du premier contact et qui seraient donc titulaires des droits constitutionnels, n’existeraient plus. Ils se seraient métissés, auraient perdu leur pureté. Les Innus qui réclameraient aujourd’hui ces droits ancestraux réifieraient l’idée de race, seraient les « vrais » racistes et par conséquent mettraient en danger l’homogénéité du corps social en affirmant leur différence culturelle.
Reconnaissance des droits autochtones et naturalisation de la culture
La continuité territoriale et culturelle constitue un principe central confirmé par le droit constitutionnel. La Cour suprême privilégie en effet une approche identitaire en ce qui a trait à la définition des droits ancestraux reconnus et protégés dans la Loi constitutionnelle de 1982 (Leclair, 2011 ; Otis, 2011 ; Grammond, 2008). Cette approche identitaire considère que les droits ancestraux existants renvoient uniquement à des pratiques distinctives que les groupes autochtones avaient avant la période de contact. Autrement dit, les droits autochtones sont reconnus à la seule condition que les communautés revendiquant ces droits fassent la preuve que leurs pratiques n’ont pas évolué. Comme l’écrit la juriste Isabelle Schulte-Tenckhoff, « les peuples autochtones sont désormais en mesure de réclamer certains droits spéciaux d’ordre culturel, mais à condition de se conformer à des normes de “culture distinctive” définies de manière exogène » (2004 : 159). En instituant la preuve et la rationalité dans des revendications culturelles, le gouvernement se saisit de l’identité autochtone et lui donne corps. La valeur des droits autochtones se mesure à leur authenticité et, sur ce terrain, ce ne sont pas des principes moraux qui sont mobilisés, mais bien des arguments anthropologiques et historiques profondément ancrés dans l’essentialisme. En somme, le mouvement de reconnaissance, en recourant au langage de la pureté, enferme l’identité autochtone dans une altérité irréductible et apparaît incapable de remédier à la violence ou de remettre en cause le racisme qu’il tend plutôt, de manière insidieuse, à renforcer.
La perversité de tels principes normatifs est qu’il incombe aux Autochtones d’étayer leurs revendications et de se représenter, voire à veiller par la contrainte à la « pureté » culturelle. Sans vouloir minimiser l’existence d’éléments culturels distinctifs que les groupes autochtones cherchent à préserver, il est toutefois difficile de ne pas voir dans les codes de citoyenneté qui excluent les couples mixtes de certaines réserves un effet pervers de cette approche essentialiste particulièrement dénoncée depuis plusieurs décennies par les groupes de femmes autochtones. Si la reproduction de l’identité collective prend à l’intérieur des communautés une importance croissante, c’est en grande partie parce qu’il s’agit d’un enjeu politique majeur sur lequel repose directement la légitimité juridique des droits ancestraux et du titre indien, et donc le droit à l’autodétermination et le développement économique. La responsabilité de cet impératif de pureté ne porte pas sur les chefs de bande, mais sur la logique essentialiste qui détermine les droits politiques autochtones. La ligne de crête est mince pour le mouvement politique autochtone. Soit les sociétés autochtones se présentent comme égales, c’est-à-dire comme des nations maîtresses de leur historicité sans rapport avec une quelconque antériorité, et ne peuvent pas faire reconnaître leurs droits (Tully, 2002) ; soit elles s’inscrivent dans la conformité et le primitivisme et sont reconnues comme titulaires de droits distinctifs. Cette seconde voie a néanmoins de nombreux effets pervers. Elle tend à reproduire et à légitimer le rapport colonial de domination (Simpson 2017, Coulthard 2014 et Alfred 2009) et a conduit par exemple le politologue conservateur Tom Flanagan (2002) à considérer la colonisation comme inévitable compte tenu de la supériorité technologique des Européens. Cette continuité entre le racisme quotidien sur le terrain ou dans les médias d’une part et les dispositifs juridiques et politiques de reconnaissance des droits d’autre part semble étayer la thèse d’un système raciste. Mais pour qu’il y ait système, encore faut-il que les discours et les pratiques « ordinaires » soient déterminés par les principes normatifs institués par l’État et la Cour suprême. Or, la « fondamentalisation des revendications autochtones par le droit » (Leclair, 2011 : 105) participe aussi à alimenter d’autres discours assimilationnistes qui ne se situent pas dans la continuité des politiques de racialisation promues par l’État, mais s’y opposent.
« Non-racisme » au Québec et au Canada
La représentation artificielle de l’identité innue a joué un rôle central dans le renforcement de mouvements nationalistes revendiquant l’assimilation des peuples autochtones au nom d’une égalité de principe. En 2004, une entente de principe a été signée entre les gouvernements du Canada et du Québec et plusieurs Premières Nations innues en vue de la conclusion d’un traité définitif (Grammond 2004). Pour certains intellectuels et députés québécois, cette entente menaçait les principes d’égalité entre les citoyens et par conséquent la cohésion sociale (Salée et Lévesque 2016). Plusieurs groupes de citoyens soutenus par des élus de la région se sont mobilisés pour faire échouer l’entente (Charest 2003). Plusieurs travaux se sont intéressés à cette période et aux réactions qu’a suscitées l’approche commune (Lord 2010, Rivard 2013, Salée 2005 et Charest 2003) en notant d’ailleurs que l’hostilité envers les revendications des Innus n’était pas partagée par l’ensemble des Nord-Côtiers. L’analyse s’attache ici plutôt aux discours des acteurs afin d’éclairer les logiques qui sous-tendent leurs discours dans le but de montrer que ce « non-racisme » ancré dans une conception abstraite de l’universel procède d’une logique inverse à celle de différenciation puisqu’elle « met à distance ou “déréalise” la race en que, à la fois, phénomène historique et expérience vécue, d’une part ; s’ancre sur la primauté des perspectives morales, adossées à des jugements d’ordre avant tout individuel, d’autre part » (Lentin, 2019).
La Société du 14 juillet, exposait dans l’ouvrage Le Pays trahi (Bouchard etal., 2001) les fondements de son opposition à tout octroi de terres aux Innus. Pour les auteurs, cette entente « insidieuse » entre les Innus et les gouvernements centraux s’inscrivait dans un processus volontaire de « désintégration des régions ». La région apparaissait en creux comme une société intégrée et stable par opposition à la « grande région montréalaise » symbolisant le désordre. La démonstration se concentrait non pas sur une quelconque différence culturelle irréductible entre les Innus et les Québécois, mais sur le fait que ce projet de traité visait à « larguer, à une fratrie privilégiée qui s’est elle-même dissociée de la fraternité régionale, les droits ancestraux et territoriaux de leur “pays” » (Bouchard etal., 2001 : vol. 4 : 50). Les Innus étaient considérés comme des « frères », des semblables, des sujets de la nation québécoise dont la survie dépendait du maintien de l’intégrité de cette dernière. Or, cette intégrité reposait non pas sur le respect de frontières raciales, comme dans les propos de certains pêcheurs, mais sur la négation de la différence. Ces acteurs avaient la particularité de mobiliser des principes d’égalité. Ils déconstruisaient les principes normatifs sur lesquels s’appuyait le mouvement, c’est-à-dire l’essentialisme culturel, l’ethnogénétisme, mais avaient simultanément recours à ces mêmes arguments pour fonder leur demande. Pour ses détracteurs, qui s’appuyaient, comme les Innus, sur des travaux anthropologiques et historiques, la nation innue avait disparu puisque ses membres s’étaient métissés. Leurs revendications n’avaient donc aucun fondement juridique dans la mesure où « ces soi-disant ayants droit » n’étaient pas des descendants génétiquement purs de ceux auxquels la Constitution reconnaît des droits. Russel Bouchard, historien du Saguenay et principal protagoniste de la Société du 14 juillet, écrivait :
Ici, des précisions historiques s’imposent d’entrée de jeu pour désamorcer cette réécriture orwellienne de l’histoire des Amérindiens du Saguenay. Selon ce qui ressort de l’examen des noms relevés dans le journal de Neil McLaren, commis du poste de traite de Chicoutimi de 1800 à 1804, la société montagnaise d’alors […] ne regroupait plus qu’une quarantaine de familles majoritairement composées de Montagnais plus ou moins métissés (mais qui avaient gardé des noms autochtones en raison de l’ascendance paternelle qui les identifiait), de migrants venus du sud au xvie siècle […] et de Métis de vieilles souches. Les Innus ne constituant plus « qu’une alliance interethnique »
Bouchard et al., 2001
Accéder aux demandes des Innus revenait selon eux à une différenciation sociale nuisible sans aucun fondement objectif. La revue recherches amérindiennes au Québec se fit l’écho de ce débat. Les anthropologues Rémi Savard, Pierre Trudel et Paul Charest réfutèrent ces arguments que l’un d’eux jugea « clairement inexacts et malhonnêtes » (Trudel, 2002). Autrement dit, la logique de différenciation consacrée par les négociations politiques menaçait l’unité sociale des nations québécoise et canadienne. Ici, le racisme, au lieu de naturaliser la culture innue, visait plutôt à la faire disparaître et avait pour effet de réactualiser le vieux projet d’assimilation des peuples autochtones sur fond de crise de la nation québécoise dont l’homogénéité culturelle découlerait du processus historico-génétique de métissage.
Au coeur de l’été 2002, Ghislain Lebel, député bloquiste, porta de sévères attaques au gouvernement Landry qu’il accusa de négocier une « dangereuse » entente (Lebel, 2002). Il publia dans Le Soleil, le 10 août 2002, un texte alarmiste concernant l’approche commune. La peur et la crainte du gouvernement qui n’osait pas refuser de négocier en allant contre l’avis de la Cour suprême exposaient le Québec à une inévitable « partition de notre terre » (ibid.). L’auteur craignait une « contagion » aux autres nations autochtones revendiquant tel ou tel « morceau de territoire » ou des « pouvoirs exorbitants » équivalents à ceux d’une province, ce qui revenait à donner « l’indépendance au quart du Québec » (ibid.). Il n’y avait donc dans cette entente « négociée en cachette » et « portes closes » rien de « commun […] surtout pas le désir de former une nation québécoise » (ibid.). Les Québécois n’en ressortiraient ainsi qu’« amnésiés »,« expulsés »,« dépossédés » et « trahis ». Le Bloc Québécois condamna fermement ses propos et réitéra sa confiance envers le gouvernement québécois de Bernard Landry.
Le racisme n’était donc pas du côté des Blancs, mais des Innus et de leurs alliés qui menaçaient l’unité de la nation. Ce racisme universaliste n’était pas propre au contexte québécois, mais fut également mobilisé au Canada par des penseurs tels que Tom Flanagan proche de l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper. Flanagan agitait, dans un ouvrage controversé, le spectre d’une crise de l’État-nation. Les Autochtones seraient, selon lui, en passe de faire du Canada :
un État multinational comprenant un archipel de nations autochtones qui seront propriétaires d’un tiers du territoire canadien, exemptes d’impôts fédéraux et provinciaux, économiquement soutenues par des paiements de transfert provenant des contribuables, autorisées à ne plus se soumettre aux lois fédérales et provinciales et libres d’entretenir des relations diplomatiques de « nation à nation » avec ce qui restera du Canada.
Flanagan, 2002 : 15
Logiques en tension dans le racisme anti-autochtone
Le racisme qui liait attributs physiques et conduite a légitimé les processus d’appropriation des terres et d’assimilation des peuples autochtones (CVR, 2015). S’il ne s’appuie plus sur une idéologie unitaire et structurante, le racisme anti-autochtone n’a pas pour autant disparu. Il est caractérisé par une tension entre deux logiques distinctes portées par des acteurs différents (Voir figure 1). La première valorisait les particularismes culturels de chaque Première Nation, au détriment des expériences communes et de la solidarité. Ce racisme différentialiste avait pour effet, dépendamment de la position des acteurs, de légitimer des processus de marginalisation ou d’infériorisation. La deuxième logique s’inscrivait dans le retour d’un racisme universaliste, très courant dans les États coloniaux. L’appel à l’égalité abstraite s’appuyait sur une critique du racisme différentialiste, et débouchait sur un « non-racisme » niant le caractère disctinct des Premières Nations et dont la visée est insidieusement assimilationniste.
Figure 1
Espace du racisme anti-autochtone
L’imprégnation de la logique sous tendant ces politiques dans la production du racisme anti-autochtone s’apparente davantage à un racisme d’État plutôt qu’à un racisme dont l’origine se trouverait dans un système cohérent et unifié. La volonté de faire disparaître les peuples autochtones perdure. Elle se manifeste non plus seulement par une volonté explicite d’assimilation en vertu d’une idéologie universaliste teintée d’évolutionnisme, mais aussi par un relativisme absolu mais discret, qui met à distance et exclut en construisant l’image de peuples autochtones porteurs d’une culture immuable et si singulière qu’elle en devient incompatible avec le présent. Les politiques et les structures de reconnaissance des droits ancestraux nourrissent un processus de naturalisation de la culture, mais aussi, indirectement, un mouvement universaliste qui prône un retour à l’assimilation. Les logiques du racisme anti-autochtone fonctionnent néanmoins en tension, comme le montrent les conflits auxquels se sont livrés les différents acteurs au moment des négociations de l’approche commune entre les conseils de bande innus et les gouvernements du Canada et du Québec.
conclusion
La notion de racisme systémique a connu un retour en force ces dernières années et possède plusieurs intérêts. D’une part, elle met l’accent sur les discriminations et l’expérience vécue qu’en ont les victimes (Loppie et Reading, 2014). D’autre part, elle lie intimement discrimination, préjugés et stéréotypes, et exploitation économique. L’approche systémique du racisme empêche néanmoins la compréhension des multiples significations du racisme. Le racisme anti-autochtone est un espace au sein duquel se juxtaposent et se confrontent plusieurs logiques contradictoires : une logique de différenciation déterminée par des principes d’ordre culturel (maintien de la pureté du groupe, hantise du métissage, etc.) ainsi qu’à une logique universaliste abstraite visant à nier la différence culturelle et les rapports de race. Ces logiques sont particulièrement visibles dans le contexte des revendications territoriales qui voient s’affronter des principes essentialistes et une idéologie du métissage visant à dissoudre la différence culturelle autochtone. Plusieurs recherches de terrain (Denis 2015 ; Leroux, 2014, 2015) montrent que le racisme anti-autochtone ne repose pas sur une logique univoque, mais plutôt sur des logiques diverses dont l’articulation varie selon les acteurs et les sphères économiques ou politiques dans lesquelles ils agissent. Le discours des opposants à l’entrée des Innus dans la pêche commerciale traditionnellement contrôlée par les Nord-Côtiers ne reposait pas sur une volonté de maintenir un rapport inégal d’exploitation en faveur des maîtres historiques. Le racisme visait à ériger une frontière physique, à mettre à l’écart au nom de la pureté et de l’intégrité de l’identité. Pour d’autres Allochtones qui participaient activement au développement de la pêche avec ou pour les Innus, la logique de différenciation était moins prégnante. Les Innus étaient par nature différents culturellement. Néanmoins, cette naturalisation de la culture conduisait à légitimer un rapport d’exploitation. Maintenir les Innus dans des emplois précaires et sous-payés conviendrait à leur « culture » étrangère au salariat. Les consultants et conseillers étaient en somme obligés de dominer.
Le racisme se présente plutôt sous une forme éclatée, présent au plus haut niveau des structures juridiques et des politiques publiques. L’analyse des revendications révèle que cette logique de différenciation est au coeur du processus de reconnaissance des droits autochtones et des méthodes de règlements des revendications. Les réponses juridique et politique apportées aux demandes de restitution des terres réduisent la culture à un objet, à une somme d’essences ancrées dans un passé immuable auquel les Premières Nations doivent s’identifier si elles veulent être reconnues.
Si le racisme systémique, à juste titre, rend compte du fait que le racisme doit être analysé à tous les niveaux du système social, il réifie l’opposition structurelle entre colons et colonisés dont les limites ont été pointées par Stuart Hall (2007) au détriment d’une lecture plus fine des rapports de classe, de genre, de race (Satzewich, 2011). Le racisme systémique s’appuie sur une « lecture populationnelle » du problème (Otero, 2012) qui tend à appréhender les rapports sociaux à travers des agents réduits à des masses informes racisées (blanc/autochtones) ou à leur position dans des rapports sociaux (colons/colonisés). Le colonialisme ne profite pas, pourtant, de manière égale à l’ensemble de la société majoritaire qui est elle-même traversée par des rapports sociaux de classe, de genre ou de race (Rudder et Goodwin, 1993). La logique coloniale n’empêche pas non plus l’émergence d’une classe bourgeoise autochtone (Anderson, 2013). Le racisme systémique n’échappe pas aux critiques adressées au racisme institutionnel (Van Dijk, 2005 ; Wieviorka, 1991). Il se présente comme un phénomène au sein duquel il n’y a pas d’acteurs. Or, l’État fédéral canadien en tant qu’acteur social joue un rôle majeur dans la production et la légitimation des logiques racistes même si celles-ci possèdent leur propre autonomie lorsqu’elles se déploie dans les interactions quotidiennes.
Le fait de se centrer sur les acteurs montre que ceux-ci adoptent des logiques différentes au fil de leurs trajectoires biographiques. Certains pêcheurs sont ainsi passés des logiques d’infériorisation à des logiques d’exclusion des Innus. D’autres, comme les intellectuels Tom Flanagan ou Russel Bouchard en réaction au racisme différentialiste, réifient l’idée d’un corps social homogène au mépris de toute différence culturelle. Le racisme anti-autochtone n’est pas le produit d’un lien déterminant entre un ensemble de valeurs cohérentes et des conduites humaines. Le racisme anti-autochtone est porté par des acteurs réflexifs empruntant au gré de leurs positions sociales, de leurs intérêts ou de leurs valeurs des logiques antagonistes d’exclusion, d’infériorisation, d’assimilation qui s’expriment dans des conduites plurielles de ségrégation, de discrimination, de négation.
Appendices
Notes
-
[1]
L’historien Goulet (2016) dans un livre ayant reçu le prix de la Société historique de Montréal, avance que les pensionnats au Québec auraient été mis en place par les missionnaires oblats, non pour des motifs racistes, mais pour sauvegarder la culture et les langues autochtones et que le prisme de la race constitue une étape parmi d’autres dans l’historiographie des pensionnats (Goulet, 2016).
-
[2]
Dix ans auparavant avait eu lieu le référendum populaire sur la souveraineté du Québec. La région de la Côte-Nord avait alors appuyé la souveraineté entre 60 et 65 %.
-
[3]
Je me suis toujours présenté à l’époque comme doctorant venant de Paris et étudiant les revendications territoriales innues. Vu mon statut d’étranger, mes interlocuteurs ont toujours eu à coeur de me donner leur avis sur la situation des peuples autochtones, et de me l’expliquer sans toujours avoir conscience de la nature ethnocentrique de leur discours. Albert Memmi rappela l’attitude du colonisateur qui cherche à « susciter des confirmations, qui le remplissent d’aise, ou même des objections auxquelles il répond vigoureusement » (Memmi, 1973 : 20).
-
[4]
Le ministère Pêche et Océans Canada (MPO), mais aussi le ministère des Affaires indiennes et Industrie Canada, verse chacun des fonds pour les investissements dans les bateaux, leur réfection ou l’achat des permis.
-
[5]
Homme, 52 ans, conversation informelle, Sept-Îles, 23/10/2006.
-
[6]
Idem.
-
[7]
Albert Memmi définit le racisme comme « la valorisation, généralisée et définitive, de différences, réelles et imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier ses privilèges ou son agression » (Memmi 1982).
-
[8]
La boët est l’appât (du hareng dans le cas de la pêche au crabe) que l’on place dans les cages.
-
[9]
On retrouve d’ailleurs en partie ces préjugés éculés sur le rapport à l’argent des Innus dans l’excellente étude qu’a consacrée Hoggart (2012) à la culture des pauvres que les bourgeois jugent souvent dépensiers, incapables de penser au lendemain et qui recourent massivement au crédit pour s’acheter télés et biens de consommation qui ne sont pas de première nécessité. Si les comportements décrits ne renvoient pas forcément à des situations imaginaires, celles-ci ont moins à voir avec une quelconque différence culturelle, mais avec les positions de certains Innus dans une structure de classe.
Bibliographie
- Agier, M. (2017), « Un pont sur la Manche », Cahiers d’études africaines, no 228, p. 921-923.
- Alfred, T. (2009), Wasáse : Indigenous Pathways of Action and Freedom, Toronto, University of Toronto Press.
- Anderson, A. B. (dir.) (2013), Home in the city : urban Aboriginal housing and living conditions, Toronto, University of Toronto Press.
- Arendt, H. (2006), L’impérialisme, Paris, Fayard.
- Balibar, É. et I. Wallerstein (1998), Race, nation, classe : les identités ambiguës, Paris, La Découverte.
- Barker, A. J. (2009), « The Contemporary Reality of Canadian Imperialism : Settler Colonialism and the Hybrid Colonial State », American Indian Quarterly, vol. 33, no 3, p. 325-351.
- Bataille, P. (1997), Le racisme au travail, Paris, La Découverte.
- Bouchard, R. (2008), La communauté métisse de Chicoutimi : fondements historiques et culturels, Chicoutimi, Classiques des sciences sociales.
- Bouchard, R. (2003), Mémoire adressé à la Commission parlementaire siégeant sur l’Approche commune en janvier 2003, Désintégration du Québec et des régions, Chicoutimi, Classiques des sciences sociales.
- Bousquet, M.-P. (2016), « La constitution de la mémoire des pensionnats indiens au Québec : Drame collectif autochtone ou histoire commune ? », recherches amérindiennes au Québec, vol. 46, no 2/3 p. 165-176.
- Canada (1981), En toute justice : une politique des revendications des autochtones, Ottawa, Affaires indiennes et du Nord Canada.
- Capitaine, B. (2017), « Le Québec n’est pas raciste, mais… Conflictualités réelles et imaginaires sur la Côte-Nord », Nouveaux Cahiers du socialisme, no 18, p. 46-50.
- Capitaine, B. (2014), « Les voies de la résistance autochtone à la colonisation », inDemers, M. et P. Dramé (dir.), Tiers-monde postcolonial : Espoirs et désenchantements, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 246-260.
- Capitaine, B. (2012), « Le travail de pêcheur à Uashat mak Mani-Utenam : conflictualité et créativité », inCharest, P., C. Girard et T. Rodon (dir.), Les pêches des Premières Nations dans l’est du Québec : Innus, Malécites et Micmacs, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 269-304.
- Castel, R. (2003), L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil.
- Chakma, S., M. Jensen et International Work Group for Indigenous Affairs (2001), Racism against indigenous peoples, Copenhagen, IWGIA.
- Charest, P. (2003), « Qui a peur des Innus ? Réflexions sur les débats au sujet du projet d’entente de principe entre les Innus de Mashteuiatsh, Essipit, Betsiamites et Nutashkuan et les gouvernements du Québec et du Canada », Anthropologie et Sociétés, vol. 27, no 2, p. 185-206.
- Charest, P. (1970), « Le peuplement permanent de la Basse-Côte-Nord du Saint-Laurent : 1820-1900 », Recherches sociographiques, vol. 11, no 1-2, p. 59-89.
- Charest, P., C. Girard et T. Rodon (dir.) (2012), Les pêches des Premières Nations dans l’est du Québec : Innus, Malécites et Micmacs, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Chevrier, M. (2009), « L’idée de république au Québec. L’aventure méconnue d’une ambition de liberté », Bulletin d’histoire politique, 17, no 3, p. 716.
- Clair, M. et J. S. Denis (2015), « Sociology of Racism », International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, vol. 19, p. 857-863.
- Coulthard, G. S. (2014), Red Skin, White Masks, University of Minnesota Press.
- CVR (2015), Pensionnats du Canada : rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Montréal, McGill-Queen’s University Press.
- Dawson, N.-M. (2003), Des Attikamègues aux Têtes-de-boule : Mutation ethnique dans le Haut Mauricien sous le Régime français, Sillery, Septentrion.
- Denis, J. S. (2015), « Contact Theory in a Small-Town Settler-Colonial Context : The Reproduction of Laissez-Faire Racism in Indigenous-White Canadian Relations », Behavior Modification, vol. 39, no 1, p. 218-242.
- Denis, J. S. (2012), « Transforming Meanings and Group Positions : Tactics and Framing in Anishinaabe —White Relations in Northwestern Ontario, Canada », Ethnic and Racial Studies, vol. 35, no 3, p. 453-470.
- Dhume, F. (2016), « Du racisme institutionnel à la discrimination systémique ? Reformuler l’approche critique », Migrations Société, no 163, p. 33-46.
- Dunezat, X. et C. Gourdeau (2016), « Le racisme institutionnel : un concept polyphonique », Migrations Société, no 163, p. 13-32.
- Eisenberg, A. et al. (2014), Recognition versus self-determination : dilemmas of emancipatory politics. Ethnicity and democratic governance series, Vancouver, UBC Press.
- Eliasoph, N. (1999), « “Everyday Racism” in a Culture of Political Avoidance : Civil Society, Speech, and Taboo », Social Problems, vol. 46, no 4, p. 479-502.
- Essed, P. (1991), Understanding everyday racism : an interdisciplinary theory, Newbury Park, Sage Publications.
- Fanon, F. (1968), Les damnés de la terre, Paris, Maspero.
- Fanon, F. (1952), Peau noire, masques blancs, Paris, Éditions du Seuil.
- Fassin, E. (2014), Roms & riverains : une politique municipale de la race, Paris, La Fabrique.
- Flanagan, T. (2002), Premières Nations ? Seconds regards, Sillery, Septentrion.
- Fraser, N. (2011), Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris, La Découverte.
- Gaudry, A. et D. Leroux (2017), « White Settler Revisionism and Making Metis Everywhere : The Evocation of Metissage in Quebec and Nova Scotia », Journal of the Critical Ethnic Studies Association, vol. 3, no 1, p. 116-142.
- Goulet, H. (2016), Histoire des pensionnats indiens catholiques au Québec. Le rôle déterminant des pères oblats, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
- Grammond, S. (2008), « L’identité autochtone saisie par le droit », in Noreau, P. et L. Rolland (dir.), Mélanges Andrée Lajoie, Montréal, Éditions Thémis.
- Grammond, S. (2004), « L’accord Nisga’a et l’entente avec les Innus : vers une nouvelle génération de traités ? » inOtis, G. (dir), Droit, territoire et gouvernance des peuples autochtones, Sainte-Foy, Les presses de l’université Laval, p. 83-98.
- Hoggart, R. (2012), La culture du pauvre : étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Paris, Minuit.
- Honneth, A. (2015), La société du mépris : vers une nouvelle théorie critique. Paris, La Découverte.
- Leah, R. (1995), « Aboriginal women and everyday racism in Alberta : From lived experiences of racism to strategies for personal healing and collective resistance », The Journal of Human Justice, vol. 6, no 2, p. 10-29.
- Leclair, J. (2011), « “Il faut savoir se méfier des oracles”. Regards sur le droit et les autochtones », recherches amérindiennes au Québec, vol. 41, no 1, p. 102-111.
- Lentin, A. (2019), « Post-racialisme, déni du racisme et crise de la blanchité », SociologieS, Dossiers, Politiques de la diversité [En ligne], disponible à http://journals.openedition.org/sociologies/10990, consulté le 21 juillet 2019.
- Leroux, D. (2015), « “A Genealogist’s Paradise” : France, Québec and the Genealogics of Race », Ethnic and Racial Studies, vol. 38, no 5, p. 718-733.
- Leroux, D. (2014), « Entrenching Euro-Settlerism : Multiculturalism and the Politics of Nationalism in Québec », Canadian Ethnic Studies, vol. 46, no 2, p. 133-139.
- Lévi-Strauss, C. (1953), Race et histoire, Paris, Gallimard.
- Loppie, S. et C. Reading (2014), Aboriginal Experiences with Racism and Its Impacts, Prince George, National Collaborating Centre for Aboriginal Health.
- Lord, A. (2010) L’Approche commune : nouvelle alliance innue-québécoise : la réaction au Saguenay-Lac-Saint-Jean : analyse des échanges dans les journaux (2000-2004). Groupe de recherche et d’intervention régionales.
- Manuel, A. et R. Derrickson (2018), The Reconciliation Manifesto : Recovering the Land, Rebuilding the Economy, Lorimer Books.
- Martuccelli, D. (1995), Décalages, Paris, Presses universitaires de France.
- Memmi, A. (1982), Le racisme : description, définition, traitement, Paris, Gallimard.
- Memmi, A. (1973), Portrait du colonisé, Paris, Gallimard.
- Merton, R. K. (1965), Éléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Plon.
- Neeganagwedgin, E. (2012), « “Chattling the indigenous other” : A historical examination of the enslavement of aboriginal peoples in Canada », AlterNative : An International Journal of Indigenous Peoples, vol. 8, no 1, p. 15-26.
- Otero, M. (2012) « Repenser les problèmes sociaux », SociologieS, Théories et recherches, [En ligne], disponible à : http://journals.openedition.org/sociologies/4145, consulté le 6 octobre 2018.
- Otis, G. (2011), « Identitarisme, droits ancestraux et néocolonialisme : Le système de la Cour suprême », recherches amérindiennes au Québec, vol. 41, no 1, p. 115-118.
- Picot, P. (2016), « Quelques usages militants du concept de racisme institutionnel : le discours antiraciste postcolonial (France, 2005-2015) », Migrations Société, no 163, p. 47-60.
- Poli, A. (2007), « Peut-on penser ensemble racisme et ethnicisation ? », inWieviorka, M. (dir.), Les sciences sociales en mutation, Auxerre, Sciences humaines, p. 103-111.
- Rivard É. (2013), « L’Approche commune ou l’irrésistible élan vers une définition interethnique de la planification territoriale ? », Recherches amérindiennes au Québec, vol. 43, n° 1, p. 25-38.
- Rudder, V. et P. Goodwin (1993), « Théories et débats sur le racisme en Grande-Bretagne », L’Homme et la Société, n° 110, p. 5-19.
- Rushforth, B. (2012), Bonds of alliance indigenous and Atlantic slaveries in New France. Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- Salée, D. (2005) « Peuples autochtones, racisme et pouvoir d’État en contextes canadien et québécois : éléments pour une ré-analyse », Nouvelles pratiques sociales, 17(2), p. 5474.
- Salée, D. et C. Lévesque (2016), « The Politics of Indigenous Peoples-Settler Relations in Quebec : Economic Development and the Limits of Intercultural Dialogue and Reconciliation », American Indian Culture and Research Journal, vol. 40, n° 2, p. 3150.
- Sazewitch, V. (2011), Racism in Canada, Don Mills, Oxford University Press.
- Schulte-Tenckhoff, I. (2004), « Droits collectifs et autochtonie. Que penser des “traités modernes” au Canada ? », inBerns, T. (dir.), Le droit saisi par le collectif, Bruxelles, Bruylant, p. 133-164.
- Simard, J.-J. (2003), La réduction : l’autochtone inventé et les Amérindiens d’aujourd’hui, Sillery, Septentrion.
- Simpson, L. (2017), As We Have Always Done. Indigenous Freedom through Radical Resistance, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Steinman, E. (2012), « Settler Colonial Power and the American Indian Sovereignty Movement : Forms of Domination, Strategies of Transformation », American Journal of Sociology, vol. 117, n° 4, p. 1073-1130.
- St-Jean, M. (2008), « La représentation contemporaine du corps comme allégorie de la société », Lien social et Politiques, n° 59, p. 139-147.
- Taguieff, P.-A. (1988) La force du préjugé : essai sur le racisme et ses doubles, Paris, La Découverte.
- Trudel, P. (2009), La crise d’Oka de 1990 : retour sur les événements du 11 juillet, recherches amérindiennes au Québec, 39 (1-2), p. 129-135.
- Trudel, P. (2014), « Autochtones et réconciliation : avec quelle vérité ? inL’État du Québec 2013-2014, p. 178-185.
- Tully, J. (2002), « Défi constitutionnel et art de la résistance : la question des peuples autochtones au Canada », inSchulte-Tenckhoff, I. (dir.), Altérité et droit. Contributions à l’étude du rapport entre droit et culture, Bruxelles, Bruylant, p. 263-300.
- Van Dijk, T. A. (2005), « La racisme dans les discours des élites », Multitudes, vol, 23, no 4, p. 41-52.
- Wieviorka, M. (1998), Le Racisme : une introduction, Paris, La Découverte.
- Wieviorka, M. (1993), « Nationalisme et racisme », Cahiers de recherche sociologique, no 20, p. 159-181.
- Wieviorka, M. (1992), La France raciste, Paris, Éditions du Seuil.
- Wieviorka, M. (1991), L’espace du racisme, Paris, Éditions du Seuil.
List of figures
Figure 1
Espace du racisme anti-autochtone


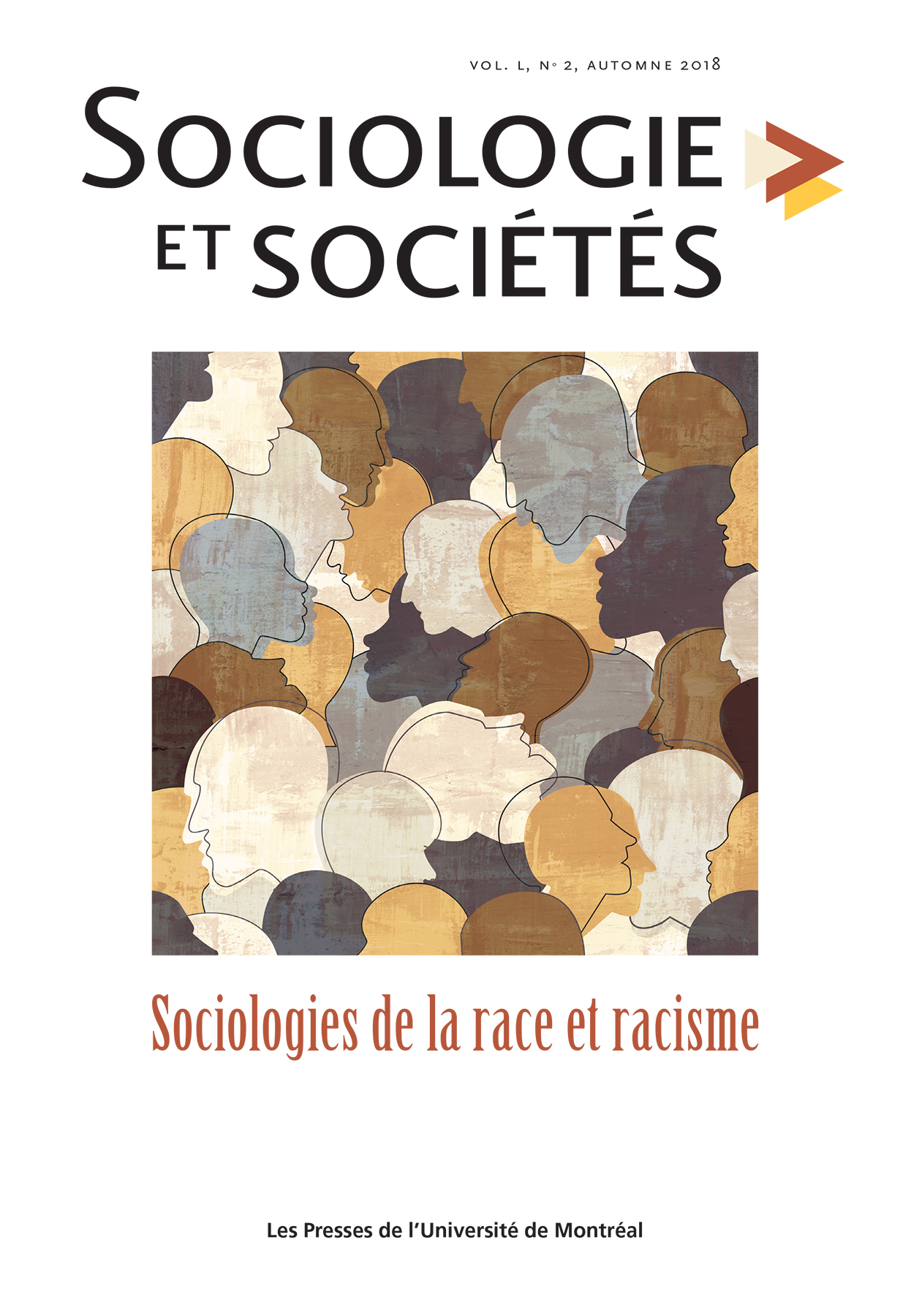

 10.7202/1012714ar
10.7202/1012714ar