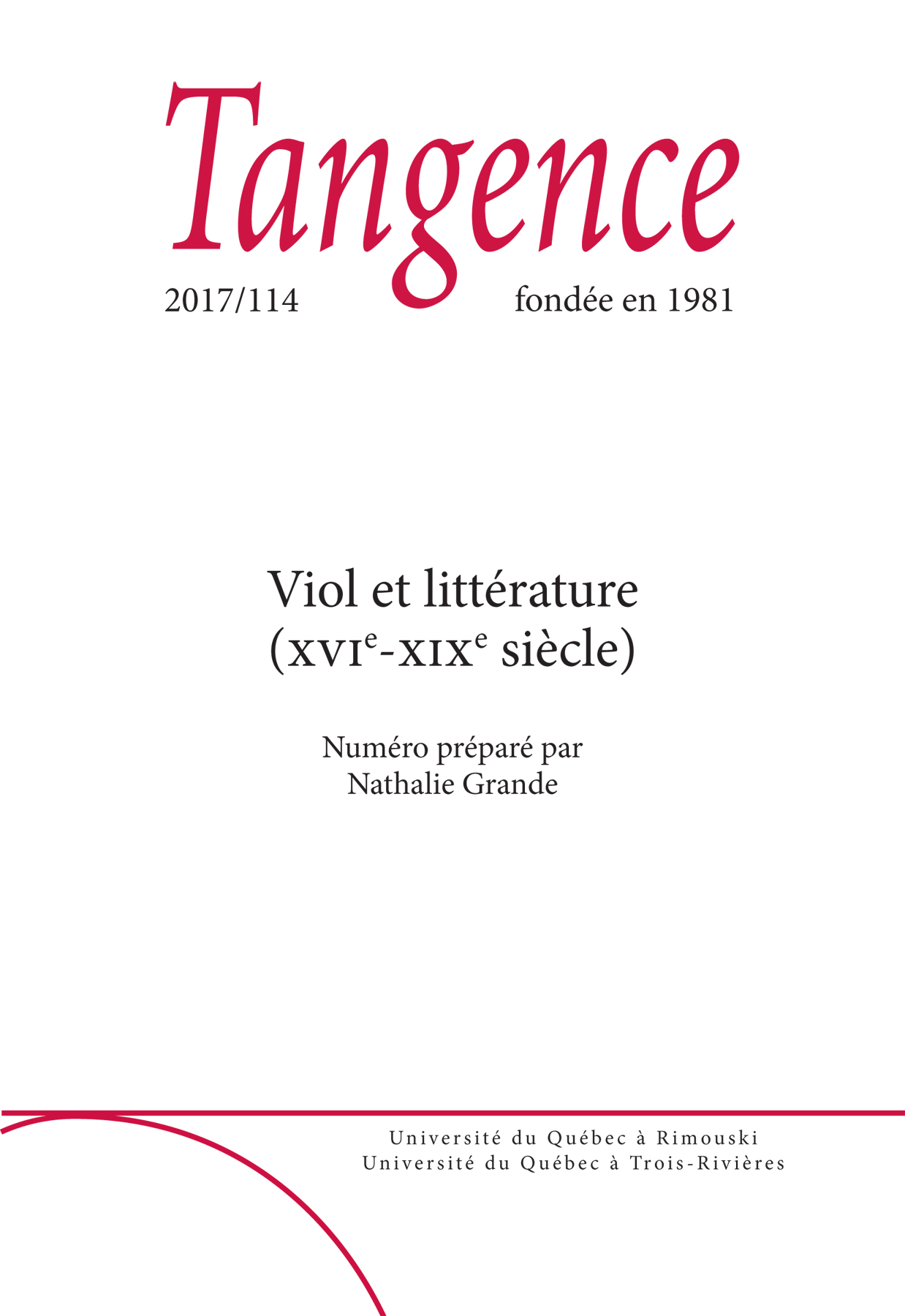Abstracts
Résumé
Cerner la figure du violeur dans la pastorale en général permet de préciser par comparaison comment ce personnage est traité dans le roman d’Honoré d’Urfé. Dans la pastorale dramatique, le violeur est un personnage-type : le Satyre. Mi-homme mi-animal, lubrique par nature, il est craint des bergères, mais il est ridicule parce qu’il est un amoureux éconduit et qu’il échoue toujours dans ses tentatives violentes. Il est un personnage comique : le rire exorcise la peur. Il n’en va pas de même quand le violeur est un berger : rien ne laisse deviner ce qu’il est et on ne peut pas être certain que sa tentative va échouer. Dans L’Astrée, le berger, s’il peut user de toutes les ruses, ne recourt jamais aux violences sexuelles : l’avatar du Satyre est Hylas qui ne ravit ni ne force les bergères mais les séduit. Le viol est, d’une part, le fait du monstre étranger et, par contraste, valorise la régulation des relations humaines qu’est l’« honnête amitié », dont la pastorale urféenne, dans le courant de la Réforme catholique, donne une représentation à des fins d’éducation morale. D’autre part, il est le fait des tyrans, romains ou barbares : le viol dans les relations interpersonnelles est l’équivalent de la tyrannie en politique. Il est donc étranger au Forez, province qui a gardé ses anciennes « franchises ».
Abstract
The portrayal of the rapist in Honoré d’Urfé’s novel contrasts with how this figure is usually depicted in pastoral literature. In pastoral plays, the rapist is a stock character: the Satyr. Half-man, half-animal, he causes fear in shepherdesses, yet is ridiculous because he’s a jilted lover whose violent attempts always fail. The Satyr is a comic figure: laughter exorcises fear. The situation changes, however, when the rapist is a shepherd: in this case, his intentions are hidden and it is not certain his attempt will fail. In L’Astrée, the shepherd, though full of tricks, never has recourse to sexual violence: the Satyr’s avatar is Hylas, who seduces shepherdesses instead of ravishing them or using force. On one hand, rape is the act of a foreign monster: it emphasizes the regulation of human relationships through “honest friendship”, which Urfé’s pastoral novel, published during the Catholic Reformation, represents for purposes of moral education. On the other hand, it is an act committed by tyrants, Romans or barbarians: rape in interpersonal relations is the equivalent of tyranny in politics. It is therefore foreign to Forez, a province that has maintained its traditional “honesty.”
Article body
Dans l’étude intitulée « Le serpent dans la bergerie », qui a beaucoup contribué à l’intérêt renouvelé porté à L’Astrée d’Honoré d’Urfé, s’appuyant sur des travaux antérieurs, particulièrement l’ouvrage de Jacques Ehrmann, Un paradis désespéré : l’amour et l’illusion dans l’Astrée (1963), Gérard Genette s’intéressait à « l’intrusion d’Éros dans la pastorale » et concluait ainsi : « L’Astrée renfermait ensemble, et en toute innocence, un roman et son anti-roman, le Pur Amour avec sa libido : le serpent dans la bergerie[1]. » La configuration particulière de l’intrigue amoureuse pastorale, A aime B qui aime C qui aime A, que l’on trouve dès le roman de Montemayor, La Diane (Alanio aime Ysmenia, qui aime Selvagia, qui aime Alanio), est en effet propice à nourrir jalousie et frustrations et, en conséquence, violences. Toutefois, dans la pastorale, c’est traditionnellement au personnage du Satyre que sont associées les violences sexuelles, rapt et viol.
Du Satyre au berger satyre
Le Satyre « est un personnage presque obligatoire sur la scène arcadique, en Italie et en France », écrit Françoise Lavocat dans son étude La Syrinx au bûcher. Pan et les satyres à la Renaissance et à l’âge baroque[2]. Dépourvu de nom particulier, ce personnage hybride, mi-homme et mi-animal, incarne la violence pulsionnelle du désir : il est, par nature, lubrique. Il n’est pas un des maillons de la chaîne des amours pastorales : nulle bergère ne soupire pour lui, bien au contraire[3]. Ainsi dans Les bergeries de Racan (1625), quels que soient les efforts qu’un Satyre fasse pour plaire à Ydalie, elle le repousse. Il en vient donc à penser que forcer sa pudeur — c’est-à-dire la violer — est le seul moyen de la rendre favorable :
Mais tout ce que je fais ne me profite rien ;
Peut-être son désir s’accorderait au mien
Si dessous les efforts de ma flamme insensée
Sa pudeur pouvait dire avoir été forcée[4].
Quand il parvient à se saisir d’elle, elle s’écrie : « Je suis morte », à quoi il répond : « Vous ne sauriez mourir d’une plus douce mort » ; même si la violence de l’acte est atténuée par le propos, ici comme ailleurs dans les pastorales du début du xviie siècle, c’est bien de viol dont il s’agit.
Le Satyre est d’une virilité évidente et agressive, ce qui le distingue du jeune berger et le rend repoussant aux yeux de la bergère. Mais la virilité, du point de vue du Satyre, est, en matière d’amour, un atout indéniable. De là ces paroles du chèvre-pied de La Sylvanire d’Honoré d’Urfé (1627) qui, à la suite de celui de L’Aminte du Tasse, s’indigne du mépris de la bergère qu’il aime :
Supporteray-je encore longuement
Qu’une affetée, une imprudente fille,
Aille estimant un berger plus que moy ?
Un berger qui n’a rien
Qui puisse estre estimable,
Sinon qu’il a la peau tendre et doüillette,
Le teint uny comme du laict caillé,
L’oeil affetté, le visage sans rides,
Et les cheveux en ondes recrespez,
Ressemblant mieux en somme
Une fille qu’un homme.
Ignorante bergere,
Si tu savois combien se doit fuïr
L’homme qui fait la femme,
Tu cherirois beaucoup plus mon visage,
Puisqu’estant homme
Un homme je ressemble,
Et non pas une fille
Comme Tirinte fait[5].
Ce que ne savent pas encore les bergères, selon lui, c’est que les jeux de l’amour requièrent la force de la virilité d’hommes faits :
LaSHU, acte ii, sc. 8, v. 3638-3841, p. 75Mais dites-moy, sont-ce des jeux d’enfans,
Ah petites follettes !
Que les jeux dont Amour
Enseigne les leçons ?
Aussi les pastoureaux doivent-ils céder aux Satyres :
LaSHU, acte ii, sc. 8, v. 3671-3674, p. 76Et qu’ils laissent aux hommes,
Aux hommes courageux,
Et tels comme nous sommes,
Le propre jeu des hommes.
Toutefois, le Satyre échoue toujours. Dans Les bergeries de Racan, le berger Tisimandre arrive à point nommé pour sauver Ydalie (ii, 2). Dans La Sylvanire d’Honoré d’Urfé, Fossinde parvient à tromper le Satyre qui veut la violer et, l’ayant attaché, elle se sauve sans qu’il puisse la poursuivre (ii, 8). Ayant compris la leçon, la seconde fois qu’elle est en sa puissance, il ne se laisse pas prendre à ses paroles fallacieuses mais elle lui échappe grâce à l’intervention musclée d’un berger (iii, 10)[6].
Quand Mairet donne une pastorale dramatique qui reprend celle d’Urfé et porte le même titre, La Sylvanire (1631), il revendique dans sa préface de donner une pièce respectant la règle des trois unités et la vraisemblance : le Satyre disparaît donc. Pour autant, les violences sexuelles n’ont pas disparu de cette pièce mais, alors qu’elles étaient chez Urfé le fait du Satyre et du berger Tirinte, seul ce dernier, chez Mairet, est coupable de tentative de viol.
Le Satyre est d’emblée source d’effroi : chacune sait à quoi s’attendre quand elle le rencontre. Toutefois, comme on vient de le voir, soit par ruse soit par force, la proie échappe au prédateur : la destinée du Satyre est d’être vaincu. Autrement dit, le Satyre fait peur mais l’on sait qu’il n’y a pas véritablement lieu d’avoir peur, et la déconfiture du prédateur est source de comique. Les scènes où s’accomplit l’échec de la tentative du violeur recourent d’ailleurs à des procédés comiques traditionnels comme la ruse, la bastonnade, la bordée d’injures. Le Satyre, de plus, est ridicule quand il tente de faire valoir ses appâts à la bergère aimée, comme celui du Triomfe d’amour d’Alexandre Hardy :
Ne trouves-tu que le poil qui te fâche ?
N’ay-je imparfait que cette seule tache ?
O la folie, un semblable defaut
Vient d’ignorer, simple, ce qu’il te faut,
Qu’en luy consiste une robuste adresse
Pour caresser une jeune maîtresse.
[…] Velu par tout je serois laid sans doute,
Mais n’en ayant que l’estomac couvert
Ma grâce rien de sa grâce ne perd[7].
Il est encore plus ridicule quand il tente de faire le galant : « Sous l’habit de berger souvent je me déguise ; / J’arrache mes sourcils, je me farde et me frise[8] ». Même si le Satyre n’est plus le monstre puant des premières pastorales françaises, même s’il s’est humanisé, il est toujours repoussant, toujours craint, mais toujours battu. Quand le berger devient satyre, en revanche, la menace qui pèse sur la bergère est bien plus grave. D’abord parce que son apparence ne révèle plus ce qu’il est : « Qui jamais eût songé qu’un berger si bien fait / Eût tourné sa pensée à si lâche forfait[9] ? » Ensuite parce que, comme le berger est un personnage non topique dans ce rôle, qui sait s’il ne parviendra pas à ses fins ? Le berger Tirinte aime Sylvanire mais elle ne l’aime pas, éprise qu’elle est d’Aglante. Comme elle refuse obstinément son amour, en une occasion où elle est seule avec lui, suivant les conseils d’un ami, Alciron, il « la veut emmener de force en quelque caverne, où loin de témoins il puisse la faire consentir à le recevoir pour son époux », lit-on dans l’« Argument » qui précède La Sylvanire de Mairet (LaSJM, p. 478). On pourrait penser qu’il s’agit d’un rapt pour contraindre au mariage la jeune fille récalcitrante[10]. La pièce elle-même dément cette interprétation. À la scène 4 de l’acte ii, Tirinte, désespéré d’amour, se confie à son ami, Alciron. Celui-ci se fait fort de mettre Sylvanire en sa puissance, « pour passer si tu veux jusqu’à la jouissance » (LaSJM, v. 832, p. 521). Sylvanire, à l’acte v, se retrouve entre les mains de Tirinte mais lui apprend que ses parents, croyant qu’elle allait mourir, ont accepté qu’elle se marie à Aglante. S’il doit renoncer au mariage, Tirinte n’en renonce pas pour autant à la jouissance, et il veut forcer la bergère à le suivre :
LaSJM, v. 2183-2192, p. 571-572Silvanire
Dieux ! où veux-tu que j’aille ?
Tirinte
Où vous serez servie
Avec tant de douceur que vous serez ravie[11].
Silvanire
Tu me ravis déjà, perfide ravisseur,
Mais c’est de violence, et non pas de douceur.
Non je mourrai plutôt.
Tirinte
Allons, allons mauvaise,
Et tais-toi seulement.
Silvanire
Voleur ! que je me taise !
O Cieux ! qui nous voyez.
Tirinte
Et la terre et les cieux
A ce crime d’amour se sont fermé les yeux.
Silvanire
Tu nommes donc amour une force[12] insolente.
Tirinte
Amour ou force, allons.
Ce n’est plus le Satyre mais le berger Tirinte qui est le « monstre » des forêts (LaSHU, acte v, sc. 6, v. 8112, p. 155). Il n’est dès lors plus question de rire et d’exorciser la peur par le rire : avec la disparition du Satyre dans la pièce de Mairet disparaissent le comique grivois et efficace des plaisanteries lourdes qu’il affectionne, et le comique lié au ridicule du personnage.
Hylas : avatar policé du Satyre
Si, dans la pastorale dramatique d’Urfé, les tentatives de viol sont le fait et d’un Satyre et d’un berger, dans son roman pastoral, on ne trouve pas de chèvre-pied. Même si les Bergeries de Juliette d’Ollenix du Montsacré[13] (1585-1598), roman pastoral français qui, avec succès, précède de quelques années celui d’Urfé, sont hantées de violeurs, ces derniers sont rarement présents dans la fiction narrative pastorale[14]. Dans L’Astrée, l’avatar du Satyre est un joyeux compagnon : Hylas[15].
Hylas n’a pas la beauté d’un Céladon : il a la « teste chauve » et, détail important, le « poil ardant[16] ». Il est donc, comme le Satyre, roux : « Les Satyres […] sont […] tous velus et couverts de grands poils de couleur rouxastre, dont mesmes ils ont été nommez les velus[17]. » Avant qu’il n’apparaisse dans le récit, on entend déjà sa chanson, la « Chanson de l’inconstant », qui le caractérise : il ne cache pas ce qu’il est. La liste de ses amours est si longue qu’il n’en a pas fini la revue quand, le soleil s’étant couché, il interrompt le récit de sa vie : Carlis, Stiliane, Aimée, Floriante, Cloris, Circene, Laonice, Madonthe… C’est que, selon sa philosophie, l’inconstance est une vertu[18] qui le garantit de tous les maux dont souffrent les bergers fidèles. Pour être heureux, il faut être inconstant. Certes, selon son adversaire en philosophie, le berger Silvandre, chantre du néo-platonisme dans cette fiction, il est un « monstre » (L’A, ii, 9, p. 389), mais il est avant tout un berger dont la compagnie est recherchée, parce qu’il est drôle, parce que, selon Silvandre même, « il est impossible de l’oüyr sans rire » (L’A, i, 7, p. 245). Il a en commun avec son ancêtre le Satyre d’introduire le registre comique dans la fiction, à une différence près, capitale : il n’est pas l’objet de la risée et du mépris des bergers et des bergères, il est celui qui fait rire et que, pour cela, on apprécie. Certes, il n’est pas le serviteur inconditionnel de sa dame du moment, mais il n’use jamais de la force physique : il est un séducteur, un très habile séducteur. Sa bonne humeur, ses manières plaisantes suffisent à lui attirer l’amour : il n’est pas sans ressemblances avec le loup galant que Perrault décrit dans la morale du « Petit chaperon rouge[19] ».
Hylas dans le roman d’Urfé, comme le Satyre des pastorales dramatiques, n’est pas un véritable danger. Mais, s’il n’y a pas de berger satyre sur les bords du Lignon, la violence sexuelle n’est pas absente du roman.
Le violeur : l’étranger
Trois figures de violeurs interviennent dans L’Astrée. Le premier violeur fait irruption dans l’univers de la pastorale pour rompre les parfaites amours de Diane et de Filandre (« Histoire de Diane », L’A, i, 6). Alors que Diane s’était endormie au bord d’une fontaine, survient un chevalier étranger qui s’en prend à elle. Grâce à l’intervention héroïque de Filandre, elle lui échappe. Filandre parvient à tuer le chevalier mais va, lui aussi, mourir de ses blessures, heureux, dit-il, d’avoir pu conserver ce que Diane a de plus cher au monde, sa « pudicité[20] » (L’A, i, 6, p. 234). La scène commence par une description d’un locus amoenus, en sorte que l’entrée en scène du « monstre » soit bien comprise comme une intrusion. La description du chevalier « estranger », « barbare » (L’A, i, 6, p. 233) en fait d’ailleurs, radicalement, un étranger :
Il avoit le visage reluisant de noirceur, les cheveux raccourcis et meslez comme la laine de nos moutons, quand il n’y a qu’un mois ou deux qu’on les a tondus, la barbe à petits bouquets clairement espanchée autour du menton, le nez aplaty entre les yeux et rehaussé et large par le bout, la bouche grosse, les levres renversées, et presque fendues sous le nez.
L’A, i, 6, p. 232[21]
Les autres personnages de violeurs, eux, sévissent loin des rives du Lignon. Dans la deuxième partie, à la suite de la visite de la galerie de peintures historiques d’Adamas, une évocation assez précise de l’histoire de l’Empire romain, particulièrement de son déclin au ve siècle[22], est engagée, notamment par le biais de deux histoires insérées qui se suivent chronologiquement, l’« Histoire de Placidie » (L’A, ii, 11) et l’« Histoire d’Eudoxe, Valentinian et Ursace » (L’A, ii, 12). Dans cette dernière, on apprend que Valentinian, qui règne sur l’Empire romain d’Occident[23], doit épouser la fille de l’empereur d’Orient, Eudoxe, qu’il n’aime pas, quoiqu’elle soit dotée de toutes les qualités. Il est amoureux d’une jeune Grecque, placée auprès d’Eudoxe, Isidore[24]. Eudoxe, elle, est aimée d’Ursace, d’un amour aussi discret que respectueux. Valentinian marie Isidore à Maxime, dans l’espoir qu’elle sera plus conciliante une fois mariée, mais elle est sage et se refuse toujours. Par ruse, Valentinian l’attire un soir dans un jardin[25]. D’abord, il cherche à la convaincre, mais elle est plus éloquente que lui pour la défense de son honneur. Valentinian est sur le point de renoncer à la violer[26] quand son eunuque, Héracle, le convainc de n’en rien faire par un discours qui est une défense du viol. Il avance la satisfaction des désirs de l’empereur, jointe à l’impunité et, pour finir, le désir qu’aurait aussi Isidore d’être violée, désir inavouable mais réel[27]. C’est ce viol qui est le sujet — sujet exceptionnel — de la gravure illustrant le livre 12 de la deuxième partie, dans la première édition illustrée de ce roman, celle que donnent en 1632-1633 Augustin Courbé et Antoine de Sommaville : on voit Héracle maintenir de force Isidore afin que son maître puisse la violer. La violence est évidente, sans ambiguïté, dans cette gravure qui est fidèle au texte :
Et lors voulant mettre la main sur elle, elle luy [Héracle] donna de la main sur la joue un si grand coup que le sang luy en sortit incontinent du nez. Mais l’eunuque qui estoit accoustumé à semblables rencontres, voyant que l’empereur n’en disoit mot, la print par le haut des manches, et la tirant à la renverse sur le lict, luy lia de sorte les bras qu’elle ne s’en pouvoit servir. Elle se mit bien à crier, et à faire toute la deffence qu’elle peust, mais tout luy fut inutile, et l’empereur en eut, par l’aide d’Heracle, tout ce qu’il en voulut.
L’A, ii, 12, p. 521
Il n’en va pas de même dans l’édition de 1733 : ce n’est pas le viol qui est illustré mais l’entretien entre Valentinian et Isidore qui le précède et la gravure pourrait tout aussi bien illustrer un entretien galant. La scène de viol n’est pas un sujet anodin de gravure mais un sujet à éviter[28].
Dans la galerie des portraits d’Adamas, Childéric, quatrième roi des Francs, ne porte pas de couronne. La postérité ne le reconnaît pas comme roi : il est écarté de la lignée souveraine des monarques francs, de la lignée des rois de France. Childéric[29] est de la même étoffe que Valentinian, l’empereur de Rome, même si, dans la troisième partie, sa tentative de viol échoue. Dans le livre 11 de cette partie, une question reste sans réponse : pourquoi Childéric a-t-il été contraint à l’exil ? La réponse est apportée par l’« Histoire de Childéric, de Silviane et d’Andrimarte » au livre suivant. Sous le règne de son père, Mérovée, Childéric n’a rien pu entreprendre contre Silviane, la fille du duc de Gaule armorique de laquelle, quoique marié, il est follement amoureux. Mérovée autorise cette dernière à épouser Andrimarte, qu’elle aime d’un amour partagé. Mais, une fois que Childéric est au pouvoir, la donne change : il parvient à éloigner Andrimarte et investit la maison où Silviane a trouvé refuge. La tentative est vaine, parce que Silviane a déjà fui. Childéric et ses gardes dévastent la maison et y abandonnent « toutes les filles et les femmes eschevelees, et deschirees par de si grandes violences, que jamais l’on n’a veu desordre si grand en une maison » (L’A, iii, 12, p. 697). À la suite de cela, le peuple de Paris se soulève contre son tyran. Dans cette histoire, en effet, le viol est clairement associé à l’exercice tyrannique du pouvoir : c’est à la suite d’une tentative de viol que Childéric est démis de son pouvoir, parce que, « tyran », il est déclaré « incapable de porter la couronne de ses ayeux » (L’A, iii, 12, p. 701). Le viol de la femme d’un sujet, qui plus est un seigneur, est la manifestation de la « tyrannie » : non exercice du pouvoir, mais abus du pouvoir, non respect des lois mais recours à la violence. Le viol d’Isidore, qu’elle avoue à son mari Maxime, engage celui-ci à tout faire pour causer la perte de Valentinian. Maxime conjure contre l’empereur et parvient à l’assassiner ainsi qu’Héracle ; il devient alors lui-même empereur. Isidore, elle, est morte de joie auprès du corps de Valentinian assassiné. Comme on le voit, dans L’Astrée le viol commis par le souverain a des conséquences politiques directes et désastreuses[30].
Pour conclure, on constate que, quoique le viol soit rarement gravement sanctionné au xviie siècle[31], il est, dans la fiction pastorale, passible de la peine de mort. C’est la loi que les druides rappellent à la fin de La Sylvanire d’Honoré d’Urfé et qui vaut à Tirinte d’être condamné à mort :
LaSHU, acte v, sc. 12, v. 9109-9134, p. 172[32]Amour permet, et nous le permettons, […]
Que tout amant essaye
Avec tout artifice
D’obtenir ses desirs
De celle qu’il adore.
Dans le regne d’Amour
Le larcin est permis,
Les ruses, les finesses
S’appellent des sagesses.
Mais qu’on se garde bien
De force et de violence,
L’amour est volontaire,
Et qui fait le contraire,
Par ceste deité
Est criminel de leze majesté :
Pour ce Tirinte en vertu de la loy
Absous est declaré
De toutes ses finesses ;
Car Amour les advoüe :
Mais pour la violence
Dont il est convaincu,
Nous ordonnons pour juste chastiment
D’un si grand demerite,
Du rocher malheureux
Que l’on le precipite.
Et c’est la loi qui est strictement respectée dans L’Astrée : toutes les ruses, à commencer par celle de Sémire, y sont possibles et l’imagination de l’auteur, en ce domaine, est prodigieuse ; mais le recours au viol y est impossible, irruption du barbare dans le locus amoenus. Tous les serpents n’entrent pas dans la bergerie.
Cette bergerie, le Forez, vit cependant au contact du monde, au contact des Romains, des Francs et d’autres tribus barbares, comme celle des Wisigoths dont le roi Thorismond, apprend-on dans le sixième livre de la troisième partie, projetait de « ravir par force » une nymphe de Galathée qui ne voulait pas l’épouser (L’A, iii, 6, p. 338). Mais, grâce au père de Damon, Thorismond n’a pas investi le Forez avec son armée : le Forez est resté à l’écart du monde et de ses pires turpitudes. Le crime en amour n’y est pas le viol mais l’inconstance libertine, dont Hylas fait l’apologie. Le Forez en effet, en dépit de l’invasion romaine, a préservé ses lois, sa religion, celle qui est proclamée par ses druides et qui ressemble fort à la religion chrétienne, et ses moeurs. C’est en ce lieu qu’il faut chercher l’authentique nation franque, antérieure à l’invasion romaine, nation que le roman glorifie, en la distinguant des nations romaine et barbares qui l’environnent mais ne parviennent pas à la corrompre. L’oeuvre d’Urfé s’inscrit dans la lignée des travaux des historiens du xvie siècle qui, en s’attachant à l’étude des origines de la France et de sa religion, voulaient lui conférer un passé prestigieux[33]. La représentation du viol dans ce roman est donc un des éléments de la célébration de la gloire de la plus pure des provinces françaises. Le viol dans les relations interpersonnelles est l’équivalent de la tyrannie en politique. Dans les relations amoureuses comme dans les relations politiques doit prévaloir le consentement mutuel, car le Forez a conservé ses anciennes « franchises », ses anciennes libertés. Le collectif et l’individuel ne sont pas dissociés, et ce qui vaut sur le plan du fonctionnement politique vaut sur celui de la relation amoureuse : refuser la tyrannie, c’est refuser le viol[34].
Le succès de ce roman est lié au mythe des origines du royaume de France qu’il vulgarise, mais aussi au fait qu’il est, dans le grand mouvement de réforme des moeurs qui suit le Concile de Trente, une oeuvre majeure[35] : il propose, corollairement à la représentation d’un fonctionnement politique, celle d’un mode de régulation des relations humaines, fondé sur « l’honnête amitié »[36], où les oppositions, même radicales, comme celle qui sépare Hylas et Silvandre, se résolvent plaisamment dans des joutes qui sont verbales. Le recours à la force brutale n’est alors plus de mise dans les relations amoureuses : il ne peut être le fait que de monstres étrangers. Alors, le risque n’est plus qu’un Satyre soit tapi en embuscade pour ravir la bergère, mais que cette dernière se laisse séduire par les propos plaisants d’Hylas.
Appendices
Note biographique
Marie-Gabrielle Lallemand, professeure des Universités, enseigne la langue et la littérature françaises à l’Université de Caen-Normandie. Spécialiste de la fiction narrative en prose du xviie siècle, elle travaille plus particulièrement sur les longs romans (Urfé, Gomberville, Desmarets, Scudéry, La Calprenède) et sur l’insertion de genres brefs (lettres, poésies, harangues, descriptions, portraits, etc.) dans les genres longs, dont le roman. Sur ce sujet, elle a publié de nombreux articles et deux ouvrages (La lettre dans le récit. Étude de l’oeuvre de Mlle de Scudéry, Tübingen, P.F.S.C.L., 2000 ; Les longs romans du xviie siècle, Classiques Garnier, 2013).
Notes
-
[1]
Gérard Genette, Figures i, Paris, Seuil, coll. « Points », 1966, p. 122.
-
[2]
Françoise Lavocat, La Syrinx au bûcher. Pan et les satyres à la Renaissance et à l’âge baroque, Genève, Droz, 2005, p. 281. Voir aussi sur le Satyre dans la pastorale dramatique, Jules Marsan, La pastorale dramatique en France à la fin du xvie siècle et au début du xviie siècle, Paris, Hachette, 1905.
-
[3]
Ce n’est donc pas une bergère qui soupire pour le Satyre dans la pastorale d’Alexandre Hardy, Alphée : la magicienne Corine aime Daphnis, le Satyre aime la magicienne, la Dryade aime le Satyre, Euriale aime la Dryade et Mélanie aime Euriale.
-
[4]
Honorat de Racan, Les bergeries, dans Théâtre du xviie siècle, éd. Jacques Scherer, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, t. i, acte ii, sc. 1, v. 527-530, p. 308.
-
[5]
Honoré d’Urfé, La Sylvanire [1627], éd. Laurence Giavarini, Toulouse, Société de littératures classiques, 2001, acte ii, sc. 1, v. 2001-2011, p. 48-49. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle LaSHU, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[6]
La scène, depuis L’Aminte du Tasse (iii, 1) est topique : dans Corine d’Alexandre Hardy, le berger Arcas sauve la bergère Caliste des entreprises du Satyre ; dans Le triomfe d’amour, le berger Céphée a projeté d’enlever la bergère Clitie mais le Satyre, au courant de ce projet, le devance. Céphée, toutefois, arrive à temps pour, à grands coups de bâton, chasser le Satyre mais, pendant ce temps, un second Satyre enlève la bergère qui, finalement, lui échappe, entre autres exemples.
-
[7]
Alexandre Hardy, Théâtre, Rouen, Daniel du Petit Val, 1626, t. iv, p. 568.
-
[8]
Honorat de Racan, Les bergeries, dans Théâtre du xviie siècle, ouvr. cité, acte ii, sc. 1, v. 526-52, p. 308.
-
[9]
Jean Mairet, La Sylvanire, dans Théâtre du xviie siècle, éd. Jacques Scherer, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, t. i, acte v, sc. 7, v. 2221-2222 p. 574. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle LaSJM, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[10]
Ou la jeune fille que ses parents refusent de marier : on en a un exemple dans Le triomfe d’amour d’Alexandre Hardy. Sur ce sujet, voir Danielle Haase-Dubosc, Ravie et enlevée. De l’enlèvement des femmes comme stratégie matrimoniale au xviie siècle, Paris, Albin Michel, 1999.
-
[11]
« RAVIR, Emporter une chose violemment. […] se dit plus particulièrement des personnes qu’on enlève pour les captiver, ou en abuser » (Antoine Furetière, Dictionnaire universel, La Haye, A. et R. Leers, 1690).
-
[12]
Le sens de forcer : « Violer une femme, pour dire la prendre par force pour luy ravir son honneur » est enregistré dans les dictionnaires du xviie siècle, par exemple dans celui de Furetière.
-
[13]
Anagramme de Nicolas de Montreux.
-
[14]
Voir Françoise Lavocat, La Syrinx au bûcher, ouvr. cité, p. 422-423.
-
[15]
Françoise Lavocat a noté la filiation (La Syrinx au bûcher, ouvr. cité, p. 423).
-
[16]
Honoré d’Urfé, L’Astrée [1607-1627], éd. Hugues Vaganay, Genève, Slatkine Reprints, 1966, partie i, livre 8, p. 286. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle L’A, suivi de la partie, du livre et de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[17]
François Hédelin, abbé d’Aubignac, Des Satyres, brutes, monstres et demons, de leur nature et adoration contre l’opinion de ceux qui ont estimé les Satyres estre une espece d’hommes distincts et séparez des Adamicques [1627], Paris, Isidore Liseux, 1888, p. 64-65.
-
[18]
Voir, par exemple, l’incipit de l’« Histoire de Palinice et de Circene » (L’A, ii, 3, p. 110).
-
[19]
« […] tous les loups/Ne sont pas de même sorte ; / Il en est d’une humeur accorte, / Sans bruit, sans fiel et sans courroux, / Qui privés, complaisants et doux, / Suivent les jeunes Demoiselles / Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles ; / Mais hélas ! qui ne sait que ces Loups douceureux, / De tous les Loups sont les plus dangereux » (Charles Perrault, Contes [1697], éd. Gilbert Rouger, Paris, Classiques Garnier, 1991, p. 115). Sur Hylas comme berger libertin, voir Jean-Pierre Van Eslande, L’imaginaire pastoral du xviie siècle. 1600-1650, Paris, Presses universitaires de France, 1999.
-
[20]
« PUDICITÉ. Chasteté, vertu qui fait abstenir des plaisirs illicites de la chair. Les Tarquins furent chassez de Rome pour avoir attenté à la pudicité de Lucrece. Une femme qui a perdu sa pudicité n’a plus rien à perdre. » Furetière, Dictionnaire universel, ouvr. cité.
-
[21]
Dans l’édition dirigée par Delphine Denis (Paris, Honoré Champion, 2011), une note précise que l’irruption d’étrangers dans le lieu pastoral, Satyre, soldat, maure, chevalier, est régulièrement liée à l’agression sexuelle (p. 398).
-
[22]
L’Astrée se déroule sous les règnes de Mérovée et de Childéric, vers 455 après J.-C.
-
[23]
Il s’agit d’un personnage historique, Flavius Placidus Valentinus, empereur de 425 à 455.
-
[24]
Sur cet épisode, on peut consulter l’article de Jean-Michel Caumont, « Le viol et la mort d’Isidore », Audace et modernité d’Honoré d’Urfé, Paris, Honoré Champion, 2013, p. 103-118. Il s’agit d’une comparaison entre le récit de ce viol et celui de Lucrèce chez Tite-Live.
-
[25]
Maxime a perdu au jeu une bague ainsi que son cachet. Valentinian se sert de ces objets comme preuves que Maxime consent à ce que l’empereur rencontre sa femme. Il n’avoue à Isidore qu’après le viol la supercherie. Isidore peut alors avouer à son mari le crime de l’empereur.
-
[26]
« Valentinian la voyant à genoux la releva, et touché de ses remontrances, estoit honteux de ce qu’il avoit fait, et eust bien desiré de ne l’avoir point entrepris. Ses paroles si pleines de veritables raisons, ses pleurs dont elle avoit tout le visage et tout le sein noyé, et la crainte de ce qui en pourroit advenir, avec sa naturelle bonté, luy firent prendre la resolution de se surmonter soy-mesme, et de la renvoyer sans la toucher » (L’A, ii, 12, p. 518).
-
[27]
« n’escoutez point la voix de ceste sireine, qui ne parle de ceste sorte que contre sa propre intention, et qui pour vous faire croire qu’elle est preude femme, ne desire rien tant que d’y estre contrainte par vous, afin de pouvoir se couvrir ainsi de ceste action » (L’A, ii, 12, p. 520).
-
[28]
On peut voir les gravures commandées à Daniel Rabel pour l’édition de 1632-1633 et à Nicolas Guélard et Hubert-François Gravelot pour l’édition de 1733 sur le site « Les deux visages d’Astrée » (Eglal Henein), URL : http://astree.tufts.edu, ou sur le site « Le règne d’Astrée » (Delphine Denis), URL : www.astree.paris-sorbonne.fr/.
-
[29]
Comme Valentinian, Childéric, roi des Francs, est un personnage historique. Voir, sur le site d’Eglal Henein, ce que Fauchet et Du Haillan écrivent à son sujet. La représentation romanesque de Childéric est fidèle à sa réputation de violeur.
-
[30]
À noter ce commentaire du narrateur, qui prend parti contre le régicide, quel que soit le crime du souverain : « encor que ce fut une meschante action que celle qu’il [Valentinian] commit contre la sage Isidore, si est-ce que ce n’est point au subject de mettre la main sur son seigneur » (L’A, iii, 12, p. 538).
-
[31]
Voir Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xxe siècle, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 1998.
-
[32]
Dans la pièce de Mairet, c’est le père de Tirinte, Adamas, qui rappelle la loi : « Non que pour le miroir on te prive du jour, / Toute ruse est permise à empire d’Amour ; / Le sujet qui sans plus à la Parque te voue, / C’est la force qu’Amour comme Amour désavoue » (LaSJM, v. 2449-2450, p. 583).
-
[33]
Voir Maxime Gaume, Les inspirations et les sources de l’oeuvre d’Honoré d’Urfé, Saint-Étienne, Centre d’études foreziennes, 1977, p. 102-144. Voir aussi Claude-Gilbert Dubois, Celtes et Gaulois au xvie siècle. Le développement littéraire d’un mythe nationaliste, Paris, Vrin, 1972.
-
[34]
Voir Jean-Marc Chatelain, « Institution civile et pensée constitutionnelle : pour une lecture politique de L’Astrée », dans Delphine Denis (dir.), Lire L’Astrée, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2010, p. 189-200.
-
[35]
Voir Maurice Magendie, La politesse mondaine et les théories de l’honnêteté, Paris, Presses universitaires de France, 1925 ; ainsi qu’Emmanuel Bury, Littérature et politesse. L’invention de l’honnête homme, Paris, Presses universitaires de France, 1996.
-
[36]
Rappelons que le sous-titre du roman est « Les divers effets de l’honnête amitié ». Voir la synthèse de Frank Greiner dans Les amours romanesques de la fin des guerres de religion au temps de L’Astrée (1585-1628), Paris, Honoré Champion, 2008, p. 287-290 et p. 407-489.