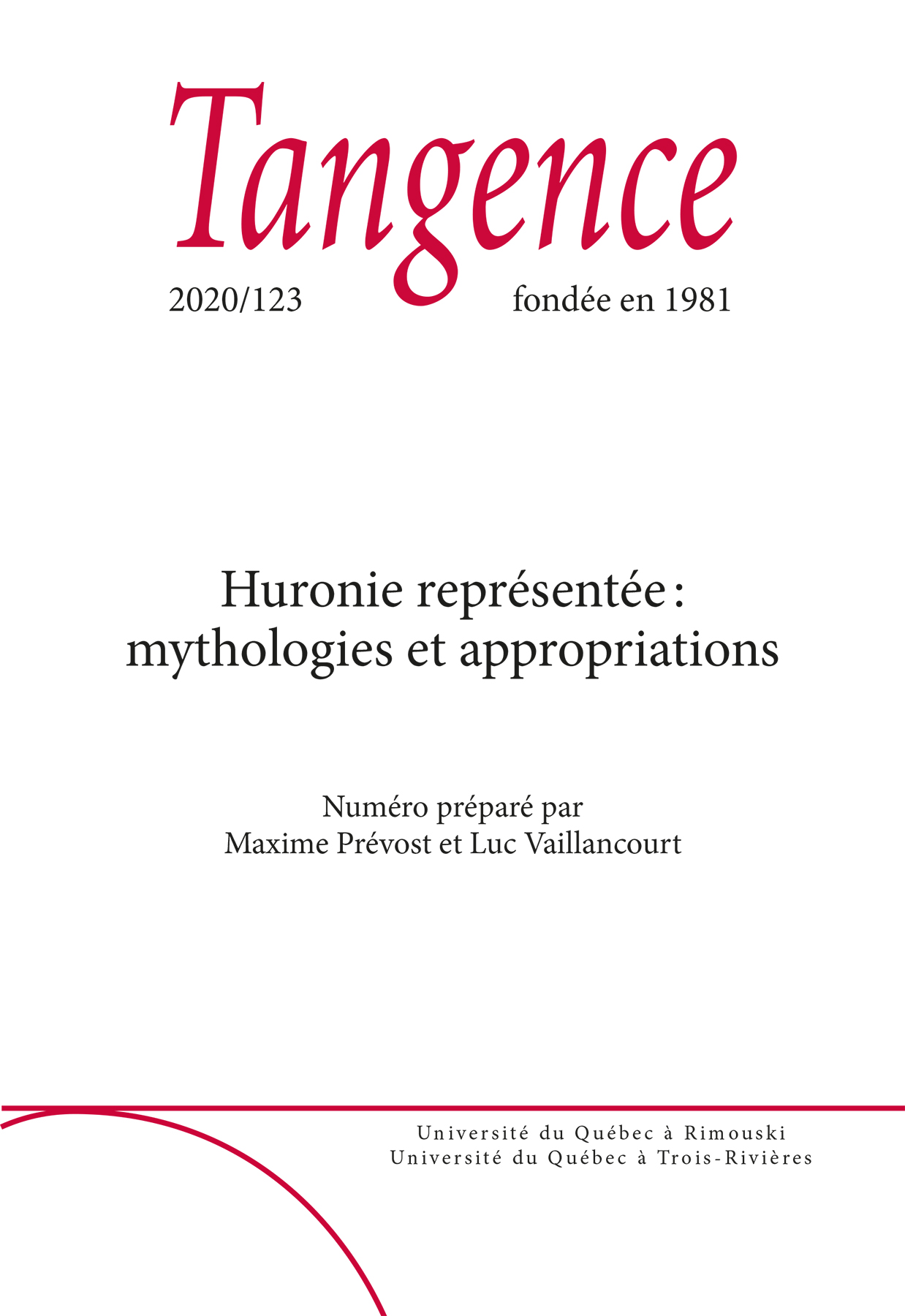Article body
Alors que les polémiques autour de l’appropriation culturelle se multiplient depuis quelques années et que se développe en Occident une sensibilité accrue face aux traumatismes occasionnés par l’héritage colonial et le racisme systémique qui en découle, il devient de plus en plus difficile, voire intenable, pour les chercheurs qui s’intéressent à ces enjeux de ne pas les aborder de front. Après l’affaire SLAV et le dossier Kanata[1], impossible de faire l’impasse (au Québec, à tout le moins), sur les questions d’éthique et de respect des sensibilités culturelle. Avant d’entreprendre un dossier portant justement sur des représentations fantasmées de la culture autochtone, en l’occurrence une Huronie utopique envisagée à travers ses mythologies et ses appropriations (non pas le Nionwentsïo, territoire historique de la nation Wendat, mais bien un territoire appartenant à l’histoire de l’imaginaire), il nous apparaît primordial de méditer sur le sens profond d’une citation, mise en exergue ici en guise de caution éthique et méthodologique[2]. Elle est issue de la plume de Peter Cole, membre de la Première Nation Douglas :
Merci de ne pas prendre nos histoires pour les enterrer dans vos livres sur nous
dans vos articles vos conférences votre blabla médiatique […]
comment voulez-vous apprêter nos histoires professeur X
est-ce votre intention (et celle de vos collègues) de nous transcrire et de nous désoraliser […]
comment voulez-vous nous reconstruire refaire représenter
nous ne sommes pas des archives nous n’attendons pas un musée […]
votre méthodologie de recherche inclusive et libératoire m’importe peu
ni votre méthode d’entrevue mes histoires ne sont pas les vôtres mon histoire n’est pas la vôtre
vos histoires sur nous sont confinées aux bibliothèques archives musées collections spéciales
la plupart dérivées des blancs en position de pouvoir […]
qui les ont soutirées ou implorées ou menties de nos communautés
ma parole appartient à l’air et aux ancêtres ceuzàvenir[3].
À travers une charge particulièrement émotive, qui participe à la fois du ressentiment pour les exactions du passé et de l’affirmation de soi face au néo-colonisateur que représente le chercheur universitaire, Peter Cole invite à cesser de réifier la culture autochtone, voire, carrément, à arrêter d’en parler, car on ne saurait le faire sans se l’approprier et la dénaturer. On rappellera aussi les mises en garde de Shawn Wilson aux universitaires cherchant à faire progresser leur carrière via la cause autochtone[4]. Pour peu que l’on ait fréquenté l’histoire de la Nouvelle-France et réfléchi aux conséquences désastreuses de la colonisation, il est difficile de ne pas leur donner raison et la tentation est forte de céder à la conscience coupable et de se taire dès à présent. Cependant, continuons : si l’on s’interroge sur les circonstances de cette supplique, on découvre que Peter Cole est lui-même un professeur/chercheur à l’Université de la Colombie-Britannique, ce qui ne remet aucunement en cause la pertinence de son intervention, bien au contraire. Sa prise de parole en tant que chercheur, publié aux presses universitaires de McGill-Queen, donne toutefois à penser que le dialogue est encore possible dans la perspective d’un décloisonnement des institutions, d’une démarche plus inclusive, voire d’une décolonisation de la recherche[5], à laquelle pourraient participer, au moins partiellement, les universitaires euro-américains, ne serait-ce qu’en cherchant à historiciser et objectiver leur propre regard sur l’altérité et l’histoire de l’ainsi nommé Nouveau Monde.
C’est dans cet esprit que nous avons tenu un colloque à Wendake, en juin 2019, pour échanger avec des chercheurs autochtones (Guy Sioui Durand, Louis-Karl Picard Sioui, Marie-Andrée Gill) sur nos conceptions respectives de l’autohistoire/hétérohistoire et des moyens d’en rendre compte respectueusement[6]. Au terme de ces échanges, nous avions encore espoir qu’il soit possible de surmonter ensemble l’écueil de l’incommunicabilité et de poser les pierres d’assise d’une décolonisation de la recherche en histoire littéraire (car elle est déjà bien amorcée ailleurs, et notamment en anthropologie et en sciences sociales[7]), en s’efforçant d’abord de déterminer ce qui, dans nos traditions respectives, relève du factuel, de l’hypothétique ou de l’invention. En tant que chercheurs allochtones, nous ne prétendons pas instruire les Premières Nations sur les pratiques de leurs ancêtres ; nous cherchons tout juste à comprendre comment nos écrits les ont mis en scène et pourquoi. Une telle entreprise procède de l’histoire de l’imaginaire, c’est-à-dire de l’histoire des idées et des représentations. Il ne s’agit pas de « mettre en boîte » la parole autochtone pour fins d’archivage ou pour l’exposer dans un musée, mais de montrer plutôt dans quel type de boîte le colonialisme a tenté de l’enfermer. Nous prenons appui sur les principes de l’ethnohistoire pour laquelle,
au sein des unités sociales qui n’ont pas d’écriture et pour lesquelles les seuls textes historiques disponibles ont été consignés par des observateurs étrangers, […] peut (s’)incarner une sorte d’histoire à rebours, telle qu’à partir de ce qui, du passé, demeure vivace dans le présent, (c’est-à-dire) ses redondances et sa part d’invention [sic] [8].
Il s’agit donc, « par un cheminement régressif », par une sorte d’ingénierie inversée, de confronter la tradition orale aux écrits, et notre rôle à nous, chercheurs allochtones, consisterait à dégager de nos textes toutes les manifestations de la parole autochtone depuis les premiers contacts, en admettant d’emblée qu’elle ait pu être mécomprise, déformée, voire détournée, pour confronter éventuellement ces témoignages à la mémoire collective de la tradition orale des Premiers Peuples, à qui il revient de bon droit, en dernière analyse, de départager le vrai du faux en toutes choses qui les concernent. Pareille entreprise sera sans doute libératoire au premier chef pour l’esprit euro-américain, dont les significations imaginaires sur l’« Indien » ne pourront être déconstruites qu’après avoir fait l’objet d’une réelle objectivation.
La recherche sur la littérature de la Nouvelle-France et sur les premiers romans québécois a depuis longtemps constaté que la figure du « Huron », lorsqu’elle n’est pas simplement prétexte, comme chez Lahontan, à une critique voilée du pouvoir, est souvent mise au service de l’affirmation identitaire, voire de la glorification du colonisateur. L’Amérindien y est dépouillé de toute existence propre et sa mise en scène y est soumise aux multiples conditionnements contextuels, intertextuels, paratextuels, génériques ou encore esthétiques de la littérature francophone colonisatrice. Cependant, l’Autochtone y est présenté comme un double symbolique de la collectivité allochtone qui l’énonce et s’en distancie pour mieux se l’approprier.
Depuis les Dialogues avec un sauvage (1703) jusqu’aux récents Cadillac de Biz (2018) et les BD 1642. Osheaga et Ville-Marie de François Lapierre et Maud Tzara (2017), en passant par L’ingénu de Voltaire (1767), les romans de James Fenimore Cooper (notamment Le dernier des Mohicans, 1826 et Wyandotté, 1843) et Famille-sans-nom de Jules Verne (1889), s’institue un imaginaire euro-américain cherchant à circonscrire, comprendre et conjurer la figure de l’autochtone à travers un certain nombre de mythologies devenues si familières qu’elles se sont imposées avec toute l’évidence du (faux) naturel : on peut citer en exemple la triade Noble Sauvage/Indien guerrier/Indien mourant ; le méchant Huron contre le bon Mohican (Cooper), le bon Huron contre le méchant Anglais (Verne) ; ou encore le « Huron civilisé », figure topique du récit de voyage du xixe siècle, le reporter s’arrêtant volontiers à Lorette pour y déplorer le recul des modes de vie traditionnels[9].
Partant du postulat que l’appropriation culturelle puisse procéder d’une représentation se voulant positive, mais enfermant néanmoins le sujet représenté dans un complexe discursif et imaginaire que devront éventuellement miner l’autohistoire et l’autoreprésentation, nous voulons retracer et analyser certaines de ces mythologies constitutives non seulement de l’hétérohistoire mais, plus fondamentalement encore, de l’hétéromythologie. Ces mythologies ont-elles étouffé la parole autochtone ? En ont-elles donné une approximation féconde ? Selon qui et quels paramètres ? Comment ont-elles présidé à des représentations confuses du monde nordique, mélangeant dans un imaginaire parfois hétéroclite les Premières Nations de tout le continent, un peu comme chez Verne au xixe siècle ou dans la série de bandes-dessinées Les pionniers du Nouveau-Monde (Jean-François Charles, 20 albums publiés de 1982 à 2015), où les peuples autochtones sont représentés à travers des amalgames de traits culturels ?
« Toute l’histoire de l’Amérique a élevé des murs et creusé des précipices de méfiance et d’incompréhension entre les premiers habitants et les nations nouvellement formées sur ce sol, avec toutes les conséquences qui s’y rattachent », écrivait Georges E. Sioui dans Pour une autohistoire amérindienne[10]. Les articles du présent volume explorent différentes représentations de la Huronie et de ses habitants dans des objets littéraires et culturels diversifiés. Il s’agit de sonder à quel point, comment et selon quelles mythologies couramment avalisées par l’imaginaire social, les sociétés européennes et américaines ont pu participer de ce double mouvement de méfiance et d’incompréhension face à la réalité autochtone, et ce même dans le cadre de fictions se voulant sympathiques à l’endroit de la Huronie.
Cette Huronie mythique, nous entendons l’arpenter en diachronie du début de l’entreprise coloniale jusqu’à la fin du xixe siècle, au moment où d’aucuns prétendent de manière péremptoire qu’il n’y a plus de Hurons et que le destin naturel de l’« Indien » est d’être assimilé par le Blanc ou détruit par lui. Ainsi, on verra avec Luc Vaillancourt comment l’ambition linguistique des Jésuites, qui rêvent de maîtriser les langues huronne et montagnaise afin de faciliter les conversions, se heurte à des facteurs de résistance qu’ils méconnaissent et qui échappent à leur contrôle. Marie-Christine Pioffet exposera ensuite comment récollet et jésuite ridiculisent les croyances huronnes, à travers une mise en scène étudiée de débats où les missionnaires s’attribuent invariablement la victoire, mettant à profit la parole de l’Autre dans le but de rallier ceux qui résistent à leur enseignement. À cette manie de la scénographie tendancieuse, Dominique Deslandres opposera la lucidité devant l’altérité autochtone, telle qu’elle trouve à s’exprimer chez Marie Guyart de l’Incarnation et dans la mise en résonance des écrits coloniaux avec d’autres sources, les verbatim des procès impliquant Français et Autochtones aux xviie et xviiie siècles, la parole des gens d’en haut comparée à celle des gens d’en bas. Enfin, Maxime Prévost et Aldo Trucchio montreront tour à tour comment cette mythologie obsède encore l’imaginaire européen tout au long du xixe siècle. Parmi les principaux pourvoyeurs de représentations écrites pour des hommes blancs, Prévost situe James Fenimore Cooper et Jules Verne au premier rang, cependant que Trucchio illustre comment l’image littéraire et stéréotypée du « sauvage américain » se propage jusque dans le milieu scientifique autour des années 1860, lequel confond lui aussi, en dernière analyse, l’Indien authentique avec sa représentation fantasmatique.
Appendices
Notes biographiques
Maxime Prévost
Maxime Prévost est professeur titulaire au département de français de l’Université d’Ottawa. Auteur de Rictus romantiques. Politiques du rire chez Victor Hugo (Presses de l’Université de Montréal, 2002) et de L’aventure extérieure. Alexandre Dumas mythographe et mythologue (Honoré Champion, 2018), il s’intéresse à la littérature romantique et aux mythologies modernes. Avec Guillaume Pinson, il a codirigé le collectif Jules Verne et la culture médiatique. De la presse du xixe siècle au steampunk (Presses de l’Université Laval, 2019) et coédite actuellement, pour Classiques Garnier, les romans canadiens de Jules Verne. Il codirige, avec François-Emmanuël Boucher, la collection « Littérature et imaginaire contemporain » aux Presses de l’Université Laval.
Luc Vaillancourt
Luc Vaillancourt est professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi, où il enseigne l’histoire littéraire et la rhétorique. Ses travaux portent principalement sur l’épistolographie humaniste (il a publié en 2003, chez Honoré Champion, une monographie consacrée à La lettre familière au xvie siècle, contribué au collectif Hélisenne de Crenne : l’écriture et ses doubles, paru chez le même éditeur en 2004, et dirigé le numéro 84 de la revue Tangence sur les Postures et impostures de l’épistolographie humaniste à l’été 2007). Plus récemment, il s’est intéressé aux Rumeurs et propagande au temps des Valois (Hermann, 2017) et aux Voix autochtones dans les écrits de la Nouvelle-France (Hermann, 2019). Il est également, depuis 2016, titulaire de la Chaire de recherche sur la parole autochtone et, depuis 2018, président de la Société canadienne d’études de la Renaissance.
Notes
-
[1]
Robert Lepage, metteur en scène québécois, s’est retrouvé au coeur de ces controverses qui ont marqué l’actualité culturelle de 2018 : « Que ce soit pour SLAV, ou pour KANATA, on lui reproche à la fois le recours à des cultures pour lequel il n’a aucun lignage culturel, mais également, de ne pas impliquer dans son processus créatif, des artistes, acteurs ou chanteurs, relevant de traditions culturelles qu’il exploiterait dans un but essentiellement commercial » (Sarah Arias, Le tatouage ethnique : mode ou ancrage ?, Paris, L’Harmattan, 2020, p. 18).
-
[2]
Dans un article consacré à « L’éthique collaborative et la relation de recherche », Louise Lachapelle et Shan Dak Puana rappellent à juste titre que, « lorsque la recherche ne remet pas en question les structures du pouvoir dominant et les inégalités socio-culturelles systémiques, elle court le risque de continuer à les reproduire, tout simplement parce que ces inégalités servent (et parfois renforcent) la culture et le pouvoir établis, la hiérarchie académique et la liberté universitaire », (Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale [En ligne], vol. 14, no 1 [Peuples autochtones et enjeux d’éthique publique], 2012, mis en ligne le 4 février 2013, consulté le 3 août 2020, URL : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.951).
-
[3]
« Please don’t take our stories and bury them in your books about us / in your articles theses conference blabble exhortations media interviews […] / how is it you want our stories professor X / is it your (and your colleagues’) intention to transcribe de/oral/ize every thing about us […] / how is it you want to reconstruct remake represent us / we are not archives we are not waiting for a museum […] / I don’t care what respectful inclusive liberatory research methodology you employ / what kind of inter/viewing method my story is not yours my history is not yours / your stories about us are housed in libraries archives museums special collections / the majority of it derived from white people in places of power […] / who pried or cried or lied it out of our communities / my word belongs to the air and to ancestors thosetocome » (Peter Cole, Coyote and Raven Go Canoeing. Coming Home to the Village, Montréal, McGill-Queen’s Press, 2006, p. 81-83 ; nous traduisons).
-
[4]
Voir Shawn Wilson, Research is Ceremony. Indigenous Research Methods, Halifax et Winnipeg, Fernwood Publishing, 2008, p. 49 : « Dans certaines universités, des départements entiers d’études autochtones ou d’anthropologie sont constitués de professeurs et d’enseignants non autochtones qui prétendent être, et sont reconnus par leurs collègues, comme des “experts en Indiens” […]. Cette étude de et sur (mais jamais par) les peuples autochtones est devenue une affaire très profitable pour les universitaires qui veulent faire avancer leur carrière » (« In some universities, entire departments of native studies or of anthropology are staffed by non-Aboriginal faculty members who claim to be, and are recognized as, “Indian experts” by their colleagues […]. This study of and on (but never by) Aboriginal people became and remains profitable business for academics who want to advance their careers » ; nous traduisons).
-
[5]
Sur ces enjeux, la référence incontournable demeure Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies : Research and Indigenous Peoples, London/Dunedin, Zed Book/University of Otago Press, 1999.
-
[6]
Voir à ce propos Georges E. Sioui, Pour une autohistoire amérindienne. Essai sur les fondements d’une morale sociale, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1989. Voir Les Wendats. Une civilisation méconnue, Québec, Presses de l’Université Laval, 1994, p. 1, où Sioui définit l’hétérohistoire comme l’« inattaquable geôle conceptuelle que construisit […] l’histoire blanche ».
-
[7]
Voir notamment Laurent Jérôme, « L’anthropologie à l’épreuve de la décolonisation de la recherche dans les études autochtones : un terrain politique en contexte atikamekw », Anthropologie et Sociétés, vol. 32, no 3, 2008, p. 179-196, et Karine Gentelet, « Les conditions d’une collaboration éthique entre chercheurs autochtones et non autochtones », Cahiers de recherche sociologique, no 48 (De l’éthique de la recherche à l’éthique dans la recherche, dir. Nathalie Mondain et Paul Sabourin), 2009, p. 143-153.
-
[8]
Roland Viau, Amerindia : Essai d’ethnohistoire autochtone, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2015, p. 31.
-
[9]
C’est le constat qu’effectue Jules Huret en 1904 : « Résignons-nous, romantiques que nous sommes ! Il n’y a plus de sauvages. L’ouïe d’Oreille-de-Renard s’atrophie aux récepteurs du téléphone, et Oeil-ouvert porte des verres isométropes ! » (En Amérique. De San Francisco au Canada, Paris, Fasquelle, 1905, p. 428).
-
[10]
Georges E. Sioui, Pour une autohistoire amérindienne, ouvr. cité, p. 2.