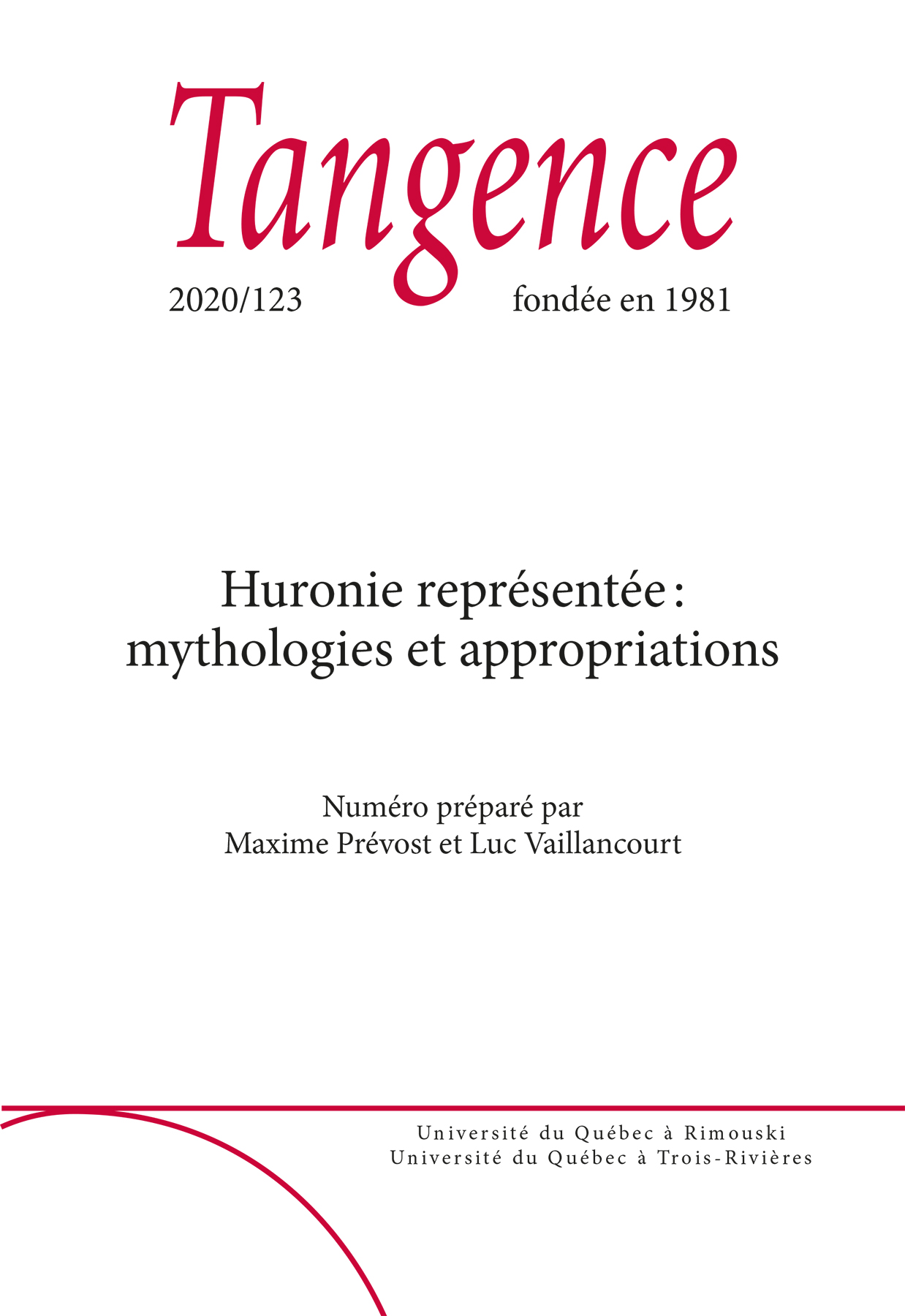Abstracts
Résumé
Cette étude repose sur l’hypothèse voulant que l’oeuvre romanesque de James Fenimore Cooper constitue la matrice fondamentale de l’imaginaire transatlantique des Premières Nations. Le roman Le dernier des Mohicans (1826), en particulier, aurait joué un rôle déterminant dans la synthèse et la diffusion de mythes informant la conception euroaméricaine des populations autochtones. L’oeuvre de Cooper présente ainsi ce que la sociocritique appellerait un « sociogramme de l’“Indien” » : différentes réalités ethnologiques y sont représentées de manière contrastée, c’est-à-dire tantôt de manière négative, tantôt de manière positive, de sorte que les Leatherstocking Tales, pas plus que le roman Famille-sans-nom (dans lequel Jules Verne adapte et infléchit certains éléments des romans de Cooper pour créer une image fantasmatique de la Huronie), ne permettent une lecture univoque. La matrice essentielle de ce que Georges E. Sioui appelle « la vision linéaire eurogène » s’y trouve néanmoins.
Abstract
This study hypothesizes that the novels of James Fenimore Cooper constitute the foundation of the transatlantic imagination regarding the First Nations. The novel The Last of the Mohicans (1826), in particular, supposedly played a decisive role in the synthesis and dissemination of myths that inform the Euro-American conception of Indigenous populations. Cooper’s works thus present what social critics would term a “sociogram of the ‘Indian’” insofar as different ethnological realities are represented in contrasting ways, that is, at times negatively, at times positively. The result is that neither Leatherstocking Tales nor the novel Family without a Name (in which Jules Verne adapts and adjusts certain elements of Cooper’s novels to create a phantasmal image of Huronia) is a straightforward read. The essential matrix of what Georges E. Sioui calls “the Eurogen linear vision” is found in them nevertheless.
Article body
Si les Premières Nations nord-américaines obsèdent l’imaginaire transatlantique tout au long du xixe siècle, leur parole est néanmoins occultée, voilée, voire volée. Les Autochtones se font parler : on leur parle de manière univoque et, surtout, on parle à leur place, la représentation se substituant généralement à la réalité. On les représente, on les pense, on les élimine souvent, on les magnifie parfois dans un cadre représentationnel qui est, encore aujourd’hui, partiellement opérant. Se fondent au xix[1]e siècle les matériaux imaginaires et discursifs, tous venus de l’extérieur, qui ont constitué ce que Georges Sioui appelle l’hétérohistoire, c’est-à-dire cette « inattaquable geôle conceptuelle que construisit […] l’histoire blanche[2] ». Bien sûr, l’idée que les Premières Nations prennent le contrôle de leur histoire et de leurs récits a fait son chemin : non seulement ce programme est-il en bonne voie de réalisation[3], mais il est aussi reconnu par une proportion grandissante de la population nord-américaine[4]. Comprendre les Premières Nations autrement que par des fictions exogènes présuppose toutefois pour un Euro-américain l’objectivation des contenus imposés par celles-ci. C’est dans cette perspective qu’il s’agira de mettre au jour un sociogramme de l’« Indien », c’est-à-dire l’ensemble flou et contradictoire de représentations constituant l’objet doxique qu’est l’Autochtone au xixe siècle, représentations dont on a sans doute sous-estimé la mauvaise conscience historique. Notons que le mot Indien est ici retenu par souci historique : c’est autour de cette appellation (depuis remplacée par amérindien, puis autochtone) que se constitue l’imaginaire linguistique euro-américain au xixe siècle[5].
Jules Verne définissait le Canada comme « le pays de Cooper, mon pays de prédilection[6] », ainsi qu’il l’écrivait en 1887 à son éditeur Louis-Jules Hetzel : c’est dire à quel point les romans de James Fenimore Cooper ont contribué à définir le regard européen sur l’Amérique, et, parmi ces romans, plus particulièrement le cycle des Leatherstocking Tales, constitué de cinq oeuvres[7] dont la deuxième, The Last of the Mohicans (1826), est la plus célèbre. Cooper a inspiré plusieurs émules romanesques, dont Jules Verne. On ne saurait assez insister sur le fait que Cooper et Verne sont des romanciers euro-américains, c’est-à-dire des producteurs de représentations écrites pour des hommes blancs à une certaine époque. Ils ne sont pas pour autant forcément malintentionnés ; il n’en demeure pas moins que, étant de formidables pourvoyeurs de représentations durables, ils comptent sans aucun doute parmi les principaux architectes de ce que Sioui appelle la « vision eurogène[8] » des Premières Nations qui a prévalu tout au long du siècle suivant. En effet, on ne peut lire ou relire simultanément Le dernier des Mohicans et Les Wendats. Une civilisation méconnue de Georges E. Sioui sans être frappé par le fait que l’un répond à l’autre ou, plus précisément, que l’un déconstruit l’autre en se réappropriant le fil de l’histoire. Notamment en ce qui a trait au mythe de l’Indien mourant, c’est-à‑dire ce que Sioui appelle « la croyance euro-américaine, désormais manifestement insoutenable, au mythe de la disparition de l’autochtone[9] ».
Jules Verne a écrit trois romans se déroulant au Canada. Les deux premiers (Le pays des fourrures, 1873 et Famille-sans-nom, 1889[10]) s’intéressent de près à la réalité autochtone, interprétée à la lumière des romans de James Fenimore Cooper, à savoir celle d’une civilisation en disparition, constituée de nations migrantes devant fuir l’avancée de la colonisation et le bruit des marteaux. Le présent article s’inscrit dans le cadre d’un projet, subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, intitulé Le Canada de Jules Verne[11]. Ce projet avait été conçu notamment pour réfléchir à la notion d’imaginaire social, et aussi d’imaginaire géographique et ethnologique, c’est-à-dire pour mener une réflexion sur Verne en tant que pourvoyeur et relayeur de représentations collectives, comme l’avaient été Victor Hugo et Alexandre Dumas[12], mais surtout, en amont, Walter Scott et James Fenimore Cooper. On peut en effet affirmer sans crainte de faire erreur que Cooper est l’un des (deux) grands romanciers orchestrateurs du premier tiers du xixe siècle, l’autre étant Walter Scott : d’un côté, l’inventeur de l’Écosse, c’est-à-dire de l’idée romantique d’une zone de sauvagerie relative aux confins de l’Europe ; de l’autre, celui de l’Amérique, ou d’une certaine Amérique, à la fois épique et tragique. Les mythographes peuvent constituer des mythes (comme Bram Stoker celui de Dracula, ou Arthur Conan Doyle celui de Sherlock Holmes), mais aussi, de manière plus diffuse, des mythologies (comme celle du vampire, ou celle du détective). Walter Scott a joué un rôle déterminant dans la constitution de la mythologie écossaise et, de manière plus globale, dans celle des identités nationales[13] ; James Fenimore Cooper, lui, a constitué une mythologie de l’Amérique et, plus précisément, une mythologie de l’« Indien ». Par mythographe, entendons formidable agent de passage (voire, au sens où l’entend Castoriadis, de constitution) d’imaginaires, de mythologies[14]. Je proposerai que l’Amérique, pour l’imaginaire transatlantique du xixe siècle, est l’Amérique de Cooper ; la nôtre l’est encore dans une grande mesure (notons par exemple que The Last of the Mohicans fut le premier texte littéraire à utiliser le mot totem[15], et il est frappant, à la lecture de la traduction de Defauconpret, de constater la présence de notes de bas de page expliquant aux lecteurs de 1826 le sens de mots passés depuis longtemps dans l’imaginaire linguistique courant : tomahawk, scalper, moccassins, squaws, totems[16]). John Saul écrivait que, la perspective gouvernementale canadienne trouvant son origine dans l’ère impériale, nos mythologies dominantes proviennent en grande partie du xixe siècle[17] — et plus précisément, serais-je tenté d’ajouter, dans la littérature romanesque de cette époque. J’avancerais que même les « écarts » entre l’Amérique imaginée d’aujourd’hui et celle de 1826 se trouvent en germe dans l’oeuvre de Cooper, laquelle est sociogrammatique, c’est-à-dire ouverte à l’étendue des possibles discursifs de son époque. Cet auteur a constitué de la réalité, ou ce qui sera institué comme tel, c’est-à-dire des significations imaginaires largement avalisées par le collectif anonyme[18], lesquelles, peuvent bien sûr être déconstruites, mais seulement après avoir fait l’objet d’une objectivation.
Cette étude s’intéressera aussi à la représentation des Hurons dans Famille-sans-nom : en quoi cette nation, sur laquelle Verne se renseigne avec zèle (quoique de manière parfois échevelée[19]) dans la presse quotidienne et périodique de son époque, de même que dans l’historiographie (François-Xavier Garneau, Eugène Réveillaud) et les romans contemporains (Gustave Aimard, Henri-Émile Chevalier), ressemble-t-elle et, surtout, se distingue-t-elle des Mohicans romanesques, élevés à la hauteur du mythe par Cooper (lequel, bien entendu, proposait lui-même une synthèse fantasmatique de ses propres lectures, dont Charlevoix, William Penn, Colden Cadwallader, John Heckwelder) ?
***
Comme Walter Scott avant lui, et comme Alexandre Dumas après lui, Cooper fait le pont entre roman et histoire ; comme Verne, il fait aussi le pont entre roman et savoirs (ethnologiques, surtout). Il est un auteur qui plonge le savoir dans le mythe ; qui, autour de savoirs (ou de pseudo-savoirs, ou de savoirs partiels, ou de savoirs tendancieux) qui circulent, constitue de la mythologie. Et tout, dans un roman comme The Last of the Mohicans, semble d’autant plus vrai qu’on est plongé dans un univers non (tout à fait) réaliste, largement fondé sur les codes du romantisme, un univers romanesque qui traite d’histoire tout en nous éloignant du temps historique au sens où l’entend Mircea Eliade, c’est-à-dire le temps ponctué par les impératifs de la contingence temporelle, celui dans lequel nous sommes contraints de travailler, vieillir et mourir[20]. Après avoir lu Cooper, il est difficile de voir l’Amérique, son histoire, son anthropologie, différemment ; et, la réception à long terme des Leatherstocking Tales ayant fait son oeuvre, nul n’est besoin de lire l’oeuvre originale pour voir le monde à travers elle, puisqu’elle a été réfractée à l’infini par la littérature, le cinéma (tout le western en procède), la bande dessinée[21] (on pourrait par exemple facilement montrer que le Far West de René Goscinny se façonne sur celui de Cooper). James Fenimore Cooper a jeté les bases d’une réévaluation complète de la réalité amérindienne pour ses contemporains, mais aussi constitué de l’imaginaire social à long terme, c’est-à-dire que son oeuvre constitue l’une des principales matrices imposant ce dont on parlera (la nature guerrière des autochtones ; leur disparition ; leur mode de vie qui entre en conflit avec ceux de l’Amérique blanche ; leur culture de la bravoure, de la torture et de la souffrance) et ce dont on ne parlera pas (leur mythologie, leur cosmologie, leur rapport métaphysique au monde ; leur vie familiale et affective). Les principaux modes de représentation sont donnés, pour les décennies à venir. Pour des lecteurs d’aujourd’hui, Cooper peut jeter les bases d’une réévaluation d’une autre nature, donc, puisque son oeuvre constitue la matrice des discours sur les Premières Nations tenus pendant cent cinquante ans, et qui continuent d’informer l’imaginaire social, même s’ils sont désormais contestés par des discours venus de l’intérieur, c’est-à-dire tenus par les nations autochtones elles-mêmes, lesquelles font désormais partie du discours social[22]. Relire Cooper à la lumière des théories relatives à l’imaginaire social peut servir d’accélérateur à une prise de conscience sur les limites des représentations disponibles de la réalité autochtone.
On peut sans doute parler d’un moment eurêka dans la production romanesque de James Fenimore Cooper, à l’intérieur même du cycle « Bas-de-cuir » : la décision de centrer le roman The Last of the Mohicans sur les autochtones, l’inclusion massive de représentation amérindienne dans son oeuvre constituant désormais sa principale source d’intérêt pour les lecteurs du monde entier. En effet, le premier des cinq romans du cycle des Leatherstocking Tales, The Pioneers (publié en 1823), se concentrait sur les colons européens (anglais, mais aussi allemands et français) de l’État de New York, les personnages de Chingachgook (le dernier des Mohicans) et de Nathaliel Bumppo (Hawk-eye) y étant secondaires, symbolisant l’Amérique condamnée à la disparition. Le roman The Pioneers s’intéresse à l’institution de la société bourgeoise de la Nouvelle-Angleterre, le protagoniste, Marmaduke Temple, inspiré du père de Cooper (et fondateur de Cooperstown), étant à la fois juge et propriétaire terrien dans l’État de New York. La question autochtone n’est ici que périphérique, James Fenimore Cooper n’ayant pas encore été visité par son illumination amérindienne. Les notes qu’il ajoute aux éditions plus tardives montrent qu’il est sensible à l’ennui que peuvent générer certains passages du roman pour les lecteurs qui le découvriraient après les autres du cycle[23]. C’est que Cooper a bien compris que le grand déclencheur d’intérêt romanesque n’est aucunement assuré par les pionniers, mais bien par les premiers habitants du territoire américain. Dans ce premier Leatherstocking Tale, le lecteur rencontre Nathaniel Bumppo (alias Hawk-eye, Pathfinder, « la Longue Carabine ») et Chingachgook (le Grand Serpent, alias John Mohegan ou Indian John), âgés, qui habitent une cabane en forêt et tentent de vivre de la chasse et de la pêche, en se confrontant aux lois bourgeoises en voie d’institution. Leur mode de vie naturel n’est plus possible. La conclusion du roman, soit la mort de Chingachkook[24] et la migration de Bumppo vers l’Ouest, signifie que la vieille Amérique, celle des autochtones, disparaît, et que les hommes des bois, tels Bumppo, sont désormais condamnés à se heurter à la justice d’inspiration européenne. Je crois que le point de vue du romancier n’est pas que la disparition des autochtones et de leur mode de vie aurait pu, ou même dû, être évité, mais plutôt que la marche de l’histoire est impitoyable, et que toute forme d’institution procède aussi de la destruction[25], parfois justifiée (mais néanmoins regrettable, selon la perspective adoptée) : le roman travaille… Il présente ce qu’on pourrait qualifier de sociogramme de l’« Indien », doublé d’un sociogramme de la colonisation : les différentes réalités ethnologiques sont représentées de manière nuancée, c’est-à-dire tantôt de manière négative, tantôt de manière positive, de sorte que les romans ne permettent pas une lecture univoque.
Nous arrivons donc à cette notion de sociogramme[26]. Il faut résister à la tentation de lire Cooper et Verne comme des romanciers à thèse, au sens où l’entend Susan Suleiman[27], leurs romans s’ouvrant plutôt aux sociogrammes tels que les conceptualiseront Claude Duchet et Marc Angenot. En d’autres termes, l’écriture de Cooper, avec l’évolution de son cycle, deviendrait de plus en plus « sociogrammatique », c’est-à-dire que, confiant dans le pouvoir de la littérature d’exprimer une chose et son contraire sans rupture logique, l’auteur rendra son oeuvre de plus en plus réceptive aux contradictions de son cotexte[28].
Rappelons que la notion de sociogramme, pourtant centrale dans la pensée de Claude Duchet, n’a pas suscité un nombre massif d’adhésions, même auprès des praticiens de la sociocritique : « Un étudiant ou un chercheur qui voudrait s’informer sur les concepts ou se faire une idée de l’opérativité du sociogramme en comparant plusieurs essais aurait le plus grand mal[29] », soulignait Patrick Maurus en 2011. Pourtant, comme l’écrit Charles-Étienne Chaplain-Corriveau, « la spécificité de la sociocritique, si elle existe, tient peut-être aux concepts de sociogramme et de sociolecte. Ne pas au moins les interroger reviendrait un peu à faire de la psychanalyse sans mentionner l’inconscient[30] ». Rappelons que la définition du sociogramme la plus souvent reprise est la suivante : « [U]n ensemble flou, instable, conflictuel de représentations partielles en interaction les unes avec les autres, centré autour d’un noyau lui-même conflictuel[31] ». Marc Angenot, pour sa part, croyait nécessaire de généraliser un peu la conception de Claude Duchet en posant que, dans son extension la plus large, le sociogramme peut être défini comme « l’ensemble des vecteurs discursifs qui, chacun à sa façon, thématisent un objet doxique[32] ». L’histoire des idées, telle que la conçoit Marc Angenot, veut s’ouvrir au « brouhaha de conceptions antagonistes[33] » ; or, la littérature n’est-elle pas le forum idéal pour écouter cette masse sonore discordante ? Pour le dire en termes sociocritiques, l’oeuvre littéraire (par rapport au pamphlet, au discours philosophique, scientifique ou politique) n’est-elle pas celle qui laisse entrevoir le cotexte le plus élargi ?
Par exemple, même si l’on ne peut nier la nature coloniale des Leatherstocking Tales, on y décèle une réelle préoccupation qu’on pourrait qualifier d’écologiste : alors que les autochtones et les coureurs des bois se contentent de consommer ce dont ils ont besoin, la nouvelle société tue et consomme trop. La nouvelle société doit tuer la nature tout comme elle doit tuer l’« Indien[34] ». Et, en bout de course, s’autodétruire ou aller détruire d’autres lieux, réalité historique faisant en sorte que la migration vers l’ouest et la mythologie de la frontière qui en découle soient représentées de manière moins simplement univoque qu’on pourrait être porté à le croire : le vieux Hawk-eye cherche la paix, mais ne la trouvera plus. Ce que Georges E. Sioui appelle la « vision linéaire eurogène[35] » semble ainsi ne pouvoir exister sans la manifestation parallèle de sa mauvaise conscience, laquelle trouve son forum naturel dans l’oeuvre littéraire.
Par sa peinture des Premières Nations, Cooper représente une civilisation sublime, au sens de Burke[36], mais sublime en cela même qu’elle appartient au passé, qu’elle participe de cette « horreur du passé[37] » réactivée à l’époque romantique à travers les représentations historico-gothiques de l’histoire, car l’Indien représente à la fois un modèle de virilité et de courage guerrier, et un parangon de cruauté et de sadisme[38]. Le projet romanesque de Cooper est en somme de montrer qu’un continent sans histoire a lui aussi une histoire, en voie d’effacement par la force naturelle des choses. L’Indien est à la fois une figure tragique, héroïque et terrifiante ; l’Indien est aussi mourant : il est condamné à la disparition. Telle est l’essence du « mythe de la disparition de l’autochtone[39] ». James Fenimore Cooper propose en somme à ses contemporains un regard sur l’histoire, et aux lecteurs subséquents un regard sur l’histoire lui-même plongé dans l’histoire, c’est-à-dire un point d’observation d’où observer la mauvaise conscience des colons euro-américains, ou encore réévaluer certaines fausses évidences, en commençant par les appellations géographiques (par exemple les appellations « lac du Saint-Sacrement », puis « Lake George » se superposant à « Horican[40] »), et ethnologiques (LotM, p. 474[41]). Les lieux, comme les gens, sont porteurs de différentes appellations comme de différentes cultures. La frontière entre le Canada et les États-Unis en vient ainsi à être perçue comme une vue de l’esprit (occidental).
Le personnage de Hawk-eye est lui-même sociogrammatique, pourrait-on dire, dans la mesure où il est au centre de tous les habitus représentés ; en lui viennent s’opposer les modes de vie des Européens, des coureurs des bois et des Amérindiens. Un peu comme la figure mi-historique, mi-mythologique de Daniel Boone, avec laquelle ce personnage tend à se confondre, Bumppo est à la fois Autochtone et Euro-américain ; il est à la fois civilisé et « sauvage », chrétien et païen. Il y a certes du racisme chez Cooper, omniprésent dans la prétention, sans cesse réitérée par Bumppo/Hawk-eye, d’être de « sang pur ». Comme l’observe bien Wayne Franklin, Cooper s’ingénie à faire tenir l’« indianité » du personnage à ses valeurs et ses aptitudes davantage qu’à son héritage littéral[42]. Dans The Prairie, le vieil Ishmael lui demande à quel peuple il appartient, ce à quoi Bumppo répond qu’il voit peu de différences entre les nations[43]. Il se présente en somme comme Blanc choisissant de vivre comme un Indien. Hawk-eye est en somme un Indien qui n’en est pas un, et un Euro-américain qui n’en est pas un non plus ; quelqu’un qui, comme le John Dunbar du film Dances with Wolves, décide « to go Indian ». Personnage sociogrammatique, il est à la fois un agent de projection sur tout ce qui a trait à la pureté raciale et à l’essence prétendument séparée des réalités autochtones et européennes, mais il représente aussi un personnage supérieur au tout venant du colonialisme, en cela même qu’il comprend le territoire qu’il habite et les moeurs de ses occupants, et choisit d’adapter son comportement à ces réalités. Il n’est sans doute pas anodin que la formule raciale, qu’il répète telle un mantra (« a man with no cross »), se prête dans l’original anglais à un double sens, racial et religieux : si Bumppo n’est pas (vraiment) un Indien, il n’est pas chrétien non plus (et ira jusqu’à affirmer, à la fin du Dernier des Mohicans qu’un seul dieu nous gouverne tous (LotM, p. 779[44]). C’est dire que ce personnage est le déclencheur d’une réflexion sans doute largement inconsciente chez plusieurs lecteurs euro-américains, hier comme aujourd’hui : Que serait-il arrivé si les colons avaient décidé de s’adapter au mode de vie des populations autochtones ? Une autre forme de civilisation était-elle possible ? L’est-elle encore ?
***
De tels questionnements sont aussi à l’oeuvre dans Famille-sans-nom de Jules Verne, mais de manière inversée, dans ce qui procède d’une forme de renversement humoristique. Le grand personnage amérindien de Jules Verne, celui qui dans son oeuvre représente les Autochtones de l’Amérique du Nord face au Thalcave des Enfants du capitaine Grant, représentant de l’Amérique du Sud, est maître Nick, le notaire de Famille-sans-nom, « excellent homme » qui, contrairement aux membres de sa famille élargie, a choisi de s’intégrer à la société européanisée du Nouveau Monde. Ce notaire huron est une image inversée du Hawk-eye de Cooper : non pas an American who goes Indian, mais bien an Indian who goes European, à tel point que « les instincts ataviques s’étaient modifiés en lui, car, jusqu’alors, il n’avait jamais senti se réveiller les velléités guerrières de sa race. Il n’était que notaire — un parfait notaire, placide et conciliant[45] ». Tel est son portrait :
Il avait cinquante ans alors. Sa physionomie prévenante, sa large et rayonnante figure, qui s’épanouissait au milieu des volutes d’une chevelure bouclée, très noire autrefois, grisonnante à présent, ses yeux vifs et gais, sa bouche aux dents superbes, aux lèvres souriantes, ses manières aimables, enfin une belle humeur très communicative, — de tout cet ensemble, il résultait une personnalité très sympathique. Détail à retenir : sous la peau bistrée, tournant au rougeâtre, de maître Nick, on devinait que le sang indien coulait dans ses veines.
FSN, p. 47
C’est que, en effet, maître Nick « descendait des plus vieilles peuplades du pays — celles qui possédaient le sol, avant que les Européens eussent traversé l’Océan pour le conquérir » (FSN, p. 47). Ce personnage est un descendant des Hurons avec lequel Verne cherche à proposer un contre-modèle à la figure de l’Indien tragique de James Fenimore Cooper, car maître Nick n’est en rien le dernier des Hurons : « Ce que l’on savait, d’ailleurs, c’est que sa race n’était pas éteinte. En effet, l’un de ses innombrables cousins, chef de Peaux-Rouges, régnait sur une des tribus huronnes, établie au nord du comté de Laprairie, dans l’ouest du district de Montréal » (FSN, p. 47).
Dans ce roman, qu’on pourrait qualifier d’anti-Anglais, où les sympathies de l’auteur sont nettement placées du côté des Canadiens français qui tentent d’opposer une rébellion patriotique au régime impérial britannique, le personnage de maître Nick fait le lien entre les deux groupes nationaux, son pacifisme le menant à observer « une prudente neutralité entre les deux partis politiques, n’étant ni Franco-Canadien ni Anglo-Américain d’origine. Aussi tous l’estimaient et recouraient à ses bons offices qu’il ne marchandait pas » (FSN, p. 49). Il sera propulsé par la force des choses du côté français, par un coup de théâtre humoristique : lors du mariage de l’un des vingt-six enfants du fermier Thomas Harcher, une délégation huronne vient lui annoncer que, suite à la mort de leur chef, les lois d’hérédité font du notaire, Nicolas Sagamore de son vrai nom (« le dernier des Sagamores »), le nouveau chef de leur tribu. « Maître Nick restait bouche béante. Bien entendu, il ne consentirait jamais à se démettre de ses fonctions, pour aller régner sur une tribu huronne. Mais, d’autre part, il ne voulait point blesser par un refus les Indiens de sa race, qui l’appelaient par droit de succession à un tel honneur » (FSN, p. 202). Or, le cours de l’Histoire et le fil de l’intrigue romanesque décident pour lui : les festivités de noces sont interrompues par l’arrivée des milices britanniques, venues arrêter le leader patriote Jean-sans-nom. Le notaire tente de parvenir à une résolution pacifique du conflit, lequel dégénère toutefois en lutte armée ; il est menacé d’arrestation et son jeune clerc, Lionel Restigouche, enjoint les Mahogannis de secourir leur nouveau chef. Les Indiens sortent alors de leur neutralité pour se joindre aux Français, et maître Nick, le dernier des Sagamores, devra abandonner son bureau montréalais pour s’établir à la tête de sa tribu huronne, dans le village indien de Walhatta, « avec des mocassins aux pieds et des plumes sur la tête » (FSN, p. 206) :
L’intervention des Indiens vint brusquement changer la face des choses. La hache à la main, ils se précipitèrent sur les assaillants. Ceux-ci, épuisés par une lutte qui durait depuis une heure, reculèrent à leur tour. […] Et voilà comment un notaire de Montréal, le plus pacifique des hommes, fut compromis pour avoir défendu une cause, qui ne regardait ni les Mahogannis, ni leur chef.
FSN, p. 232
Apportons une note d’ensemble sur l’anthropologie nord-américaine de Jules Verne : alors que les Américains (dans des romans comme De la terre à la lune, Le tour du monde en quatre-vingts jours et Le testament d’un excentrique) sont généralement représentés sur le mode comique, les Canadiens de Famille-sans-nom le sont sur le mode tragique. En ce qui a trait aux populations autochtones, toutefois, on observe une forme de renversement du modèle américain : les Hurons de Verne sont fondamentalement comiques face aux Mohicans tragiques de Cooper. Encore faut-il observer que ce renversement humoristique ne se veut nullement dégradant ; il participe plutôt d’une forme d’utopie, de ce qu’il faut bien appeler l’utopie canadienne de Jules Verne, dans laquelle se côtoient paisiblement les éléments européens et autochtones, comme l’aurait voulu, dès les origines de la Nouvelle-France, le « rêve de Champlain » mis de l’avant par l’historien David Hackett Fischer[46]. Pour parler de cet aspect de la représentation vernienne, Dominique Laporte a proposé l’intéressante notion d’« utopie à rebours de l’histoire[47] » ; Gérard Fabre propose pour sa part la pertinente notion d’« utopie compensatoire[48] », à savoir cette propension vernienne à faire du Canada le lieu d’utopies allant parfois à l’encontre de l’histoire événementielle. Plus tôt dans sa carrière, Jules Verne s’était distingué comme le plus anglophile des romanciers français, voyant dans le Canada une forme d’utopie sociale et ethnologique dans laquelle pourraient s’unir les meilleurs aspects de la France et de l’Angleterre ; le personnage québécois de Ned Land de Vingt mille lieues sous les mers (1869-1870) symbolisait cette première forme d’utopie canadienne. Vingt ans après, tout se passe comme si le patriotisme exacerbé de Jules Verne devait s’exercer au détriment de la Prusse, certes (le Jules Verne post-Sedan est un écrivain revanchard), mais aussi de l’autre ennemi historique, la Grande-Bretagne, et plus précisément l’Angleterre, de sorte que son utopie canadienne devient résolument pro-française, mais aussi pro-amérindienne. Dans cette utopie coexistent les arts de vivre européens (la société canadienne qu’il représente, lui comme la presse qui lui est contemporaine, étant constituée de cultivateurs traditionnalistes tout droit sortis de l’Ancien Régime) et autochtones (à savoir l’occupation du territoire et des espaces sauvages, mais avec acceptation partielle du modèle de sédentarisation français et une interdépendance en ce qui a trait aux produits de la pêche[49]).
Notons au passage que le Jules Verne de Famille-sans-nom (c’est loin d’être le cas dans tous ses romans) se montre tout aussi conscient que James Fenimore Cooper de l’aspect destructeur de la civilisation européenne, se révélant très sensible, par exemple, aux assauts qu’ont constitués les ardeurs défricheuses des colons français sur les forêts du Saint-Laurent :
Aux alentours de la ferme, les forêts n’étaient pas de moindre importance. Elles couvraient autrefois tous les territoires limitrophes du Saint-Laurent, à partir de son estuaire jusqu’à la vaste région des lacs. Mais, depuis de longues années, que d’éclaircies y ont été pratiquées par le bras de l’homme ! Que d’arbres superbes, dont la cime se balance parfois à cent cinquante pieds dans les airs, tombent encore sous ces milliers de haches, troublant le silence des bois immenses où pullulent les mésanges, les piverts, les aodes, les rossignols, les alouettes, les oiseaux de paradis aux plumes étincelantes, et aussi les charmants canaris, qui sont muets dans les provinces canadiennes ! Les « lumbermen », les bûcherons, font là une fructueuse mais regrettable besogne, en jetant bas chênes, érables, frênes, châtaigniers, trembles, bouleaux, ormes, noyers, charmes, pins et sapins, lesquels, sciés ou équarris, vont former ces chapelets de cages qui descendent le cours du fleuve. Si, vers la fin du dix-huitième siècle, l’un des plus fameux héros de Cooper, Nathaniel Bumpoo [sic], dit Oeil-de-Faucon, Longue-Carabine ou Bas-de-Cuir, gémissait déjà sur ces massacres d’arbres, ne dirait-il pas de ces impitoyables dévastateurs ce qu’on dit des fermiers qui épuisent la fécondité terrestre par des pratiques vicieuses : ils ont assassiné le sol !
FSN, p. 162
Un tel développement est tellement rare chez Verne qu’il valait la peine de le transcrire au long. Verne est, rappelons-le, généralement si persuadé du bien-fondé de toute forme d’industrie humaine qu’il fait dire au docteur Clawbonny des Voyages et aventures du capitaine Hatteras :
C’est la loi générale de la nature qui rend insalubres et stériles les contrées où nous ne vivons pas comme celles où nous ne vivons plus. Sachez-le bien, c’est l’homme qui fait lui-même son pays, par sa présence, par ses habitudes, par son industrie, je dirais plus, par son haleine ; il modifie peu à peu les exhalaisons du sol et les conditions atmosphériques, et il assainit par cela même qu’il respire ! Donc il existe des lieux inhabités, d’accord, mais inhabitables, jamais[50].
Ce rapprochement de deux citations des Voyages extraordinaires montre à la fois quelle est la force de l’influence ponctuelle de Cooper sur le Verne canadianiste et l’essentielle ouverture du texte littéraire à la contradiction.
Selon l’utopie canadienne de Verne, dans sa version de 1889, les Amérindiens souhaitent s’assimiler partiellement ou totalement au mode de vie nord-américain ; partiellement, comme les Hurons de Laprairie, qui conservent leurs traditions et leur mode de vie ancestral, tout en profitant d’une forme de sédentarité, de l’agriculture et de la pêche européenne. Il existe toutefois un revers essentiel à cette médaille : chez Verne, les descendants des colons européens s’adaptent aussi à la réalité autochtone, aux us et coutumes des Premières Nations. Le personnage de Lionel Restigouche constitue l’exemple d’un descendant des Européens attiré par le mode de vie autochtone. Le clerc de maître Nick est d’abord présenté comme un esprit bohème épris de poésie ; mais dès que son employeur se voit précipité à la tête des Mahogannis, Lionel trouve à ses côtés la vie qui lui convient vraiment : celle, hautement symbolique et chargée dans l’imaginaire canadien, du coureur des bois, c’est-à-dire de l’Européen qui s’intègre aux autochtones. Ce personnage refuse ainsi la sédentarisation pour adopter le mode de vie des chasseurs-cueilleurs : « Reprendre son emploi à l’étude, grossoyer six heures sur dix ?… Plutôt devenir coureur des bois ou chasseur d’abeilles. […] Lionel eût donné tous les édifices de Montréal, hôtels ou palais, pour cette inconfortable case » (FSN, p. 318). Les patriotes de Famille-sans-nom, le héros éponyme, certes, mais aussi des personnages secondaires comme William Clerc et André Farran, sont justement dépeints comme des « hommes énergiques », pour cette raison précise qu’ils sont « faits aux dures fatigues par l’habitude qu’ils avaient des grandes chasses à travers les forêts et les plaines » (FSN, p. 87). Notons que le héros du roman arbore le costume national, celui du coureur des bois, entièrement constitué en « étoffe du pays » : « Qu’on ne l’oublie pas, l’emploi de ces étoffes indigènes équivalait à une protestation politique, puisqu’il excluait ces produits manufacturés, importés d’Angleterre » (FSN, p. 54). Le patriote, en somme, est celui qui, contrairement au Britannique, en est venu à réellement habiter l’Amérique, s’inspirant largement du mode de vie des premiers occupants du territoire. L’auteur des Voyages imaginaires serait-il l’un des premiers adeptes des théories du métissage souvent mises en accusation aujourd’hui comme une forme d’appropriation qui s’ignore[51] ?
***
James Fenimore Cooper avait été le grand pourvoyeur d’imaginaires amérindiens du xixe siècle, lesquels seront relayés, développés, éventuellement contestés à travers mille et une oeuvres de représentation (Henri-Émile Chevalier — mentionnons, dans son abondante production, La Huronne. Scènes de la vie canadienne, 1862, et Les derniers Iroquois, 1863 ; Gustave Aimard — Les trappeurs de l’Arkansas, 1858 ; La belle rivière, 1874 ; Louis Noir et Pierre Ferragut — Le secret du trappeur, 1874 ; Verne demeure le plus lisible — et le plus lu — de ces romanciers[52]) et des centaines de milliers de textes (il faut ici penser à la presse et à ses effets de viralité[53]), partout dans le monde atlantique, tant en Amérique qu’en Europe, tant aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, tant au Canada qu’en France. Parmi les auteurs qui ont mis en texte le Canada français, Cooper et Verne sont ceux que la postérité et l’histoire littéraire ont retenus. Par la richesse de son oeuvre, Jules Verne constitue, pour le lecteur de langue française, une porte d’entrée capitale sur l’imaginaire du Canada qui circule depuis le xixe siècle, à condition de ne pas le considérer comme un auteur passif, ne faisant « qu’écouter » le discours social, mais aussi d’étudier comment il invente un certain Canada et construit un récit particulièrement suggestif du rôle qu’y jouent les Premières Nations. On songe ici à la notion de la géographe littéraire Sheila Hones, celle de « texte événement[54] », faisant du texte, notamment du roman, un phénomène collectif et transhistorique : collectif parce qu’il est le résultat d’un amalgame de lectures (d’un cotexte) et d’un travail dépassant celui de l’auteur (éditeurs, illustrateurs, traducteurs, journalistes, professeurs, etc.) et transhistorique parce que sa réception — si le texte est vraiment un événement — se déroule sur le long terme, auprès de plusieurs générations de lecteurs dont l’imaginaire aura été façonné par le texte, et qui, en retour, l’investiront de nouvelles potentialités heuristiques. On pourrait se demander si la notion de « texte événement », qui s’applique sans l’ombre d’un doute aux Leatherstocking Tales, est bien pertinente en ce qui a trait aux romans canadiens de Jules Verne, qui figurent sans doute parmi les plus obscurs des Voyages extraordinaires. Mais j’ai souvent eu l’occasion de constater que Verne est extrêmement influent même dans son obscurité (par exemple, le roman Thunderball d’Ian Fleming est une réécriture — voire un plagiat — du très peu lu Face au drapeau[55]). Cela tient (au moins partiellement) à ce que nombreux sont les lecteurs de l’ensemble des Voyages extraordinaires, notamment parmi les écrivains. L’approche bibliométrique de Sylvain Simard met en lumière que le Canada gagne en popularité en France à partir des années 1870, Simard distinguant une rupture assez nette en 1874. Or, Le pays des fourrures est publié en 1872-1873 dans le Magasin d’éducation et de récréation (en 1873 en volume), et se trouve donc proche de ce jalon temporel. « De 1875 à 1900 surtout, une partie non négligeable du public français est sortie de son indifférence à peu près totale à l’égard du Canada[56] », une seconde pointe d’intérêt succédant à la parution de Famille-sans-nom. Les deux romanciers orchestrateurs et mythographes que sont Cooper et Verne instituent tant des effets de viralité médiatique que des grands et des micro récits sur les autochtones, qui s’implantent de manière durable dans l’imaginaire social. Ils ne sont ni historiens, ni ethnologues, mais de formidables pourvoyeurs de significations imaginaires, certaines desquelles, pour emprunter la terminologie de Cornelius Castoriadis, sont devenues des significations centrales[57]. Celle de la disparation de l’autochtone en est une ; celle du métissage entre les colons et les premiers occupants du territoire en est sans doute une autre, ayant moins souvent été objectivée dans son historicité.
Jules Verne est ainsi, comme James Fenimore Cooper avant lui, un auteur tout désigné pour réfléchir à l’imaginaire géographique et, plus précisément peut-être, à l’imaginaire ethnologique : sa volonté de conciliation symbolique entre les Canadiens et les Amérindiens procède non seulement de l’« utopie à rebours de l’histoire » (Laporte), ou de l’« utopie compensatoire » (Fabre), mais encore et surtout d’un programme qui, par des voies détournées, mystérieuses, dont les filiations, les échos et les relayeurs seraient à retracer d’une manière plus systématique, est devenu celui du Canada actuel, c’est-à-dire celui de la reconnaissance et de la réconciliation, symbolique du moins. John Saul écrit :
La tendance est nette. En cent ans, les peuples autochtones sont parvenus à conjurer la mort. Retour en force exemplaire quand on sait l’abjection dans laquelle ils croupissaient : proches de l’extinction démographique, leur existence juridique avoisinant le mépris, leurs civilisations guettées par la caducité. Vers quoi tend cette résurgence ? Vers une position de force, d’influence et d’inventivité civilisationnelle en ce territoire qui a nom Canada.
Il observe aussi que « [l]e point de vue du gouvernement canadien trouve son origine dans l’ère coloniale et impériale. Nos mythologies dominantes ont été façonnées à la même époque[58] ». Une lecture attentive de Cooper, et sans doute surtout de Verne, porte à croire que les mythologies du métissage et de la réconciliation sont elles-mêmes issues de cette époque.
Cooper et Verne sont-ils colonialistes ? Sont-ils pro-autochtones ? La conception que constitue Cooper de la disparition de l’Indien est-elle tragique ? Est-elle plutôt triomphaliste ? Celle du métissage chez Verne est-elle bienveillante ? Procède-t-elle d’une forme d’appropriation culturelle qui s’ignore ? La théorie du sociogramme permet d’avancer que la réponse à toutes ces questions est oui. Indépendamment de ce que furent les hommes James Fenimore Cooper et Jules Verne, leurs romans sont à la fois colonialistes, racistes, assimilateurs et ouverts à la réalité autochtone — celle-ci étant toujours perçue de manière exogène, bien entendu. Les romans de Cooper et de Verne marquent à la fois le triomphe du colonialisme européen et l’explosion de sa mauvaise conscience.
Appendices
Note biographique
Maxime Prévost est professeur titulaire au département de français de l’Université d’Ottawa. Auteur de Rictus romantiques. Politiques du rire chez Victor Hugo (Presses de l’Université de Montréal, 2002) et de L’aventure extérieure. Alexandre Dumas mythographe et mythologue (Honoré Champion, 2018), il s’intéresse à la littérature romantique et aux mythologies modernes. Avec Guillaume Pinson, il a codirigé le collectif Jules Verne et la culture médiatique. De la presse du xixe siècle au steampunk (Presses de l’Université Laval, 2019) et coédite actuellement, pour Classiques Garnier, les romans canadiens de Jules Verne. Il codirige, avec François-Emmanuël Boucher, la collection « Littérature et imaginaire contemporain » aux Presses de l’Université Laval.
Notes
-
[1]
Voir Georges E. Sioui, Pour une autohistoire amérindienne, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « À propos », 2018 [1989], p. 53.
-
[2]
Georges E. Sioui, Les Wendats. Une civilisation méconnue, Québec, Presses de l’Université Laval, 1994, p. 1.
-
[3]
Voir par exemple Pierrot Ross-Tremblay, Thou Shalt Forget : Indigenous Sovereignty, Resistance and the Production of Cultural Oblivion in Canada, London, University of London Press, 2020.
-
[4]
On peut en prendre à témoin un récent reportage du National Geographic (Tristan Ahtone, « Reclaiming our Stories », National Geographic, décembre 2018, p. 102-119) sur ce processus de réappropriation des récits historiques par les autochtones de l’ensemble de l’Amérique, article présentant Madeline Sayet, une dramaturge et metteure en scène mohégane qui refuse d’adapter James Fenimore Cooper à la scène, jugeant que sa vision de l’histoire et les mythologies qui en procèdent sont mensongères et périmées ; or, lorsqu’une idée pénètre l’espace du National Geographic, c’est qu’elle est devenue mainstream, ce qui dans le cas qui nous occupe peut réjouir.
-
[5]
Je garde personnellement de l’affection pour le terme amérindien, lequel objective à travers le temps l’immense erreur géographique des « découvreurs » européens à la recherche des épices de l’Orient.
-
[6]
Lettre du 31 mai 1887 ; voir Correspondance inédite de Jules et Michel Verne avec l’éditeur Louis-Jules Hetzel, (1886-1896), éd. Olivier Dumas, Volker Dehs et Piero Gondolo della Riva, Genève, Slatkine, 2004, t. i p. 57 (« Merci pour les livres sur le Canada que vous m’avez envoyés. C’est parfait, et il ne m’en faut pas plus. Je suis là dans mon pays de prédilection, le pays de Cooper, et si le public a autant de plaisir à lire ce nouvel ouvrage que j’en ai à le faire, ça ira »).
-
[7]
Ces romans sont The Pioneers (1823), dont l’action se déroule en 1793 ; The Last of the Mohicans (1826), dont l’action se déroule en 1757 ; The Prairie (1827), dont l’action se déroule en 1804 — lesquels sont suivis de deux prequels après un hiatus de quelques années : The Pathfinder (1840), l’action prend place en 1758-1759 et The Deerslayer (1841), le roman se déroule entre 1740 et 1755.
-
[8]
Georges E. Sioui, Les Wendats. Une civilisation méconnue, ouvr. cité, p. 5.
-
[9]
Georges E. Sioui, Les Wendats. Une civilisation méconnue, ouvr. cité, p. 95, n. 5.
-
[10]
Auxquels il faut ajouter Le volcan d’or, premier opus posthume de Jules Verne (1906), roman du Klondike et de la ruée vers l’or.
-
[11]
Voir Guillaume Pinson et Maxime Prévost, « Le Canada de Jules Verne : hypothèses, méthodes, objectifs », Médias 19 [En ligne], Présentation du projet Le Canada de Jules Verne, Publications, Jules Verne : représentations médiatiques et imaginaire social, mis à jour le 8 décembre 2017, consulté le 20 août 2020, URL : http://www.medias19.org/index.php?id=18096.
-
[12]
Sur la notion d’écrivain mythographe, voir Maxime Prévost, Alexandre Dumas mythographe et mythologue. L’aventure extérieure, Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme et modernité », 2018.
-
[13]
Voir Anne-Marie Thiesse, « Le roman national », dans La création des identités nationales. Europe xviiie-xixe siècle, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 2001, p. 133-138.
-
[14]
J’utilise ce terme, comme plusieurs autres, au sens que leur confère Cornelius Castoriadis : « [L]’essentiel de la création n’est pas “découverte”, mais constitution du nouveau : l’art ne découvre pas, il constitue ; et le rapport de ce qu’il constitue avec le “réel”, rapport assurément très complexe, n’est en tout cas pas un rapport de vérification » (L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, coll. « Point essais », 1975, p. 200 ; je souligne).
-
[15]
Voir Wayne Franklin, James Fenimore Cooper. The Early Years, New Haven et Londres, Yale University Press, 2007, p. 474.
-
[16]
Voir James Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans [1826], éd. Philippe Jacquin, trad. d’A. J. B. Defauconpret, Paris, GF Flammarion, 1992, p. 49 (« Un tomahawk est une petite hache. Avant l’arrivée des colons européens, les tomahawks étaient faits avec des pierres ; aujourd’hui, les Blancs eux-mêmes les fabriquent avec du fer »), p. 66 (scalper : « Coutume barbare des sauvages américains, consistant à enlever la chevelure et la peau du crane de l’ennemi qu’ils ont tué ou mis hors de défense. Le lecteur doit excuser l’introduction du mot scalper. Il se présentera trop souvent pour y suppléer par une périphrase »), p. 67 (mocassins : « espèce de chaussures »), p. 177 (squaws : « Nom que les Indiens donnent à leurs femmes »), p. 365 (« Les totems forment une espèce de blason. Chaque famille sauvage se supposant descendue de quelque animal adopte pour ses armoiries la représentation de cette origine bizarre qui peut-être n’est qu’une allégorie »).
-
[17]
John Saul, Le grand retour. Le réveil autochtone [2014], trad. de Daniel Poliquin, Montréal, Boréal compact, 2018, p. 100.
-
[18]
Castoriadis utilise souvent l’expression « collectif anonyme » sans la définir clairement. Rappelons que, pour ce philosophe, l’imaginaire est instituant par l’activité d’un collectif anonyme. L’imaginaire instituant ne nous apparaît ainsi que dans ses créations : les formes successives mises au jour par un collectif anonyme. Voir « Les significations imaginaires sociales », dans L’institution imaginaire de la société, ouvr. cité, p. 493-538 (p. 533, notamment).
-
[19]
L’illustrateur Tiret-Bognet les représentera par exemple comme des Indiens à plumes, et le récit de Verne en fera, comme nous le verrons, des indéfectibles alliés des Patriotes de 1838-1839 ; tout comme le Mohican Uncas, le notaire huron du roman serait « le dernier des Sagamores », etc. Tout le savoir relatif aux autochtones est pour Verne une immense bouillie ethnologique.
-
[20]
Mircea Eliade, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1963, p. 234-235.
-
[21]
Voir Chad A. Barbour, From Daniel Boone to Captain America. Playing Indian in American Popular Culture, Jackson, University Press of Mississippi, 2016, p. 12-13.
-
[22]
Je pense par exemple au texte fondateur d’An Antane Kapesh, Je suis une maudite sauvagesse (Ottawa, Leméac, coll. « Dossiers », 1976), qui, avec quelques décennies de recul, s’impose désormais comme l’un des plus importants écrits québécois des années 1970.
-
[23]
James Fenimore Cooper, The Pioneers [1823], éd. Blake Nevius, New York, The Library of America, 1985, p. 234. Désormais, les références à ce roman seront indiquées par le sigle P, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[24]
P, p. 427 : « Hawk-eye ! my fathers call me to the happy hunting-grounds. The Path is clear, and the eyes of Mohegan grow young. I look—but I see no white-skins ; there are none to be seen, but just and brave Indians » (« Oeil-de-faucon, mes pères m’appellent sur leurs heureux territoires de chasse. Je regarde, mais ne vois pas de peaux-blanches ; il n’y en a aucune, seulement de justes et braves Indiens », ma traduction).
-
[25]
Voir Wayne Franklin, James Fenimore Cooper. The Early Years, ouvr. cité, p. xxviii.
-
[26]
Je synthétise ici des idées développées plus longuement dans Maxime Prévost, « “Rien ne blesse, ni mes idées, ni mes sentiments là-dedans” : Pierre-Jules Hetzel et le sociogramme du progrès chez Jules Verne », COnTEXTES [En ligne], no 21 (L’anticipation dans les discours médiatiques et sociaux, dir. Matthieu Letourneux et Valérie Stiénon), 2018, mis en ligne le 30 octobre 2018, consulté le 20 août 2020, URL : https://journals.openedition.org/contextes/6583.
-
[27]
Susan Rubin Suleiman, Le roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Écriture », 1983, p. 14 : « Je définis comme roman à thèse un roman “réaliste” (fondé sur une esthétique du vraisemblable et de la représentation) qui se signale au lecteur principalement comme porteur d’un enseignement, tendant à démontrer la vérité d’une doctrine politique, philosophique, scientifique ou religieuse. » L’auteure dit s’inspirer au premier chef des romans de Barrès, Bourget, Zola, Aragon, Malraux, Drieu la Rochelle, Mauriac, Brasillach et Nizan (p. 10).
-
[28]
Claude Duchet et Patrick Maurus, Un cheminement vagabond. Nouveaux entretiens sur la sociocritique, Paris, Honoré Champion, coll. « Poétiques et esthétiques xxe-xxie siècle », 2011, p. 44-45 : « Le cotexte est ce qui dans le texte ouvre à un en-dehors du texte, sur un ailleurs du texte, sur un domaine avec lequel le texte travaille. Avec lequel tout texte travaille. […] Le cotexte n’est pas la totalité de l’univers, il est la portion de l’univers avec laquelle le texte travaille. »
-
[29]
Claude Duchet et Patrick Maurus, Un cheminement vagabond, ouvr. cité, p. 16.
-
[30]
Charles-Étienne Chaplain-Corriveau, Le sociogramme du civisme dans les Aventures de Blake et Mortimer, thèse de maîtrise, Université d’Ottawa, 2016, p. 25, consulté le 20 août 2020, URL : http://www.ruor.uottawa.ca/handle/10393/35214
-
[31]
Claude Duchet et Patrick Maurus, Un cheminement vagabond, ouvr. cité, p. 52.
-
[32]
Marc Angenot, 1889. Un état du discours social, Longueuil, Le Préambule, coll. « L’Univers des discours », 1989, p. 104.
-
[33]
Marc Angenot, L’histoire des idées, Liège, Presses universitaires de Liège, coll. « Situations », 2014, p. 135.
-
[34]
Voir notamment, dans P, chap. xxi (la forêt comme ennemie), chap. xxii (sur la surchasse), chap. xiii (sur la surpêche), chap. xxxvii (sur la destruction euro-américaine de la forêt). Sur la surchasse, voir p. 248 ; sur la surpêche (à la dynamite), voir p. 261 (« […] the sight of the immense piles of fish, that were slowly rolling over the gravelly beach, had impelled him to leave the ladies, and join the fishermen ») ; voir aussi p. 294.
-
[35]
Georges E. Sioui, Les Wendats. Une civilisation méconnue, ouvr. cité, p. 5.
-
[36]
Voir Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful [1757], éd. James T. Boulton, Notre Dame/London, University of Notre Dame Press, 1968, p. 39 : le sublime a selon ce philosophe partie liée aux idées de douleur, de danger, de terreur en général.
-
[37]
Voir Maxime Prévost, « L’horreur de l’histoire », dans Rictus romantiques. Politiques du rire chez Victor Hugo, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2002, p. 57-66.
-
[38]
Voir Chad A. Barbour, From Daniel Boone to Captain America, ouvr. cité, p. 5 et p. 14.
-
[39]
Georges E. Sioui, Les Wendats. Une civilisation méconnue, ouvr. cité, p. 95.
-
[40]
James Fenimore Cooper, The Last of the Mohicans [1826], éd. Blake Nevius, New York, The Library of America, 1985, p. 476 et 480. Désormais, les références à ce roman seront indiquées par le sigle LotM, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[41]
« The Whites have assisted greatly in rendering the traditions of the Aborigines more obscure by their own manner of corrupting names. Thus, the term used in the title of this book has undergone the changes of Mahicanni, Mohicans, and Mohegans; the latter being the word commonly used by the Whites » (« Les Blancs ont grandement contribué à rendre les traditions des aborigènes plus obscures par leur corruption des appellations. Ainsi, le terme utilisé dans le titre de ce livre est passé de Mahicanni à Mohicans à Mohégans, ce dernier terme étant celui communément utilisé par les Blancs », ma traduction).
-
[42]
Wayne Franklin, James Fenimore Cooper. The Early Years, ouvr. cité, p. xxx.
-
[43]
James Fenimore Cooper, The Prairie, éd. de Blake Nevius, New York, The Library of America, 1985 [1827], p. 963-964 : « To me there is little difference in Nations. […] Still am I a man without the cross of Indian blood » (« Pour moi, il y a peu de différences entre les nations. […] Ceci dit, je suis un homme qui n’a pas de sang indien », je traduis). De manière un peu ridicule (et voulue telle par Cooper ?), Hawk-eye insiste constamment sur sa pureté raciale. Voir par exemple LotM, p. 507, où il se décrit comme « a man, who, his very enemies will own, has no cross in his blood », p. 540 (« I, a white man without a cross »), p. 550 (« Come on, ye bloody-minded hell-hounds ! ye meet a man without a cross »), p. 609 (« I am a man who has the full blood of the whites »), etc., etc.
-
[44]
« There is but a single Ruler of us all, whatever may be the colour of the skin » (« Oui, il n’y a qu’un seul être qui nous gouverne tous, quelle que soit la couleur de notre peau », trad. Defauconpret, ouvr. cité, p. 426).
-
[45]
Jules Verne, Famille-sans-nom, Paris, Hetzel et Cie, 1889, p. 49-50. Désormais, les références à ce roman, provenant de cette première édition illustrée (disponible en ligne sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France), seront indiquées par le sigle FSN, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[46]
Voir David Hackett Fischer, Champlain’s Dream, New York, Simon et Schuster, 2008, p. 7.
-
[47]
Dominique Laporte, « Une échappatoire aux rébellions du Bas-Canada : le rêve de métissage dans Famille-sans-nom », dans Philippe Mustières et Michel Fabre (dir.), Rencontres Jules Verne : science, crises et utopies, Nantes, Coiffard libraire éditeur, 2013, p. 148.
-
[48]
Gérard Fabre, Les fables canadiennes de Jules Verne. Discorde et concorde dans une autre Amérique, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, coll. « Amérique française », 2018, p. 185.
-
[49]
FSN, p. 120-121 : « Les hommes de ces canots étaient de race indienne pour la plupart. Ils venaient acheter du poisson qu’ils transportaient ensuite dans les bourgades et villages de l’intérieur, où leurs embarcations pénétraient par les multiples rios du territoire ».
-
[50]
Jules Verne, Voyages et aventures du capitaine Hatteras [1866], éd. Roger Borderie, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2005, p. 528-529.
-
[51]
John Saul est l’un de plus enthousiastes adeptes de ces théories ; voir Le grand retour. Le réveil autochtone, ouvr. cité, p. 197 : « [L]e Canada est une civilisation métisse, une civilisation influencée par le modèle métis de la complexité. Le peuple métis a démontré que la complexité pouvait servir de modèle civilisationnel ».
-
[52]
Sur ces auteurs, voir Gérard Fabre, Les fables canadiennes de Jules Verne, ouvr. cité, p. 81-108 et Nathalie Ducharme, Le roman d’aventures au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « L’Archive littéraire au Québec », 2019.
-
[53]
Voir Guillaume Pinson, La culture médiatique francophone en Europe et en Amérique du Nord, de 1760 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Québec, Presses de l’Université Laval, coll « Cultures québécoises », 2016, p. 10-13, notamment.
-
[54]
Sheila Hones, « The Event of the Novel », dans Literary Geographies. Narrative Space in Let the Great World Spin, New York, Palgrave Macmillan, 2014, p. 19-34 (p. 23 : « fiction can be usefully understood as a geographical event, a dynamic unfolding collaboration happening in space and time » ; « on pourrait concevoir le texte de fiction comme un événement géographique, une collaboration dynamique se déroulant à travers temps et espace », ma traduction).
-
[55]
Voir Maxime Prévost, « L’institution du terrorisme planétaire, de Jules Verne à Ian Fleming. Lire Face au drapeau à la lumière de Thunderball », Études littéraires, vol. 46, no 3 (Espionnage, complots, secrets d’État : l’imaginaire de la terreur, dir. François-Emmanuel Boucher, Sylvain David et Maxime Prévost), 2015, p. 31-45.
-
[56]
Sylvain Simard, Mythe et reflet de la France. L’image du Canada en France 1850-1914, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1987, p. 15.
-
[57]
Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, ouvr. cité, p. 526 : « Les significations centrales ne sont pas des significations “de” quelque chose — ni même, sinon en un sens second, des significations “attachées” ou “référées à” quelque chose. Elles sont ce qui fait être, pour une société donnée, la co-appartenance d’objets, d’actes, d’individus en apparence les plus hétéroclites. Elles n’ont pas de “référent” ; elles instituent un mode d’être des choses et des individus comme référé à elles. Comme telles, elles ne sont pas nécessairement explicites pour la société qui les institue. »
-
[58]
John Saul, Le grand retour. Le réveil autochtone, ouvr. cité, p. 16 et 100.