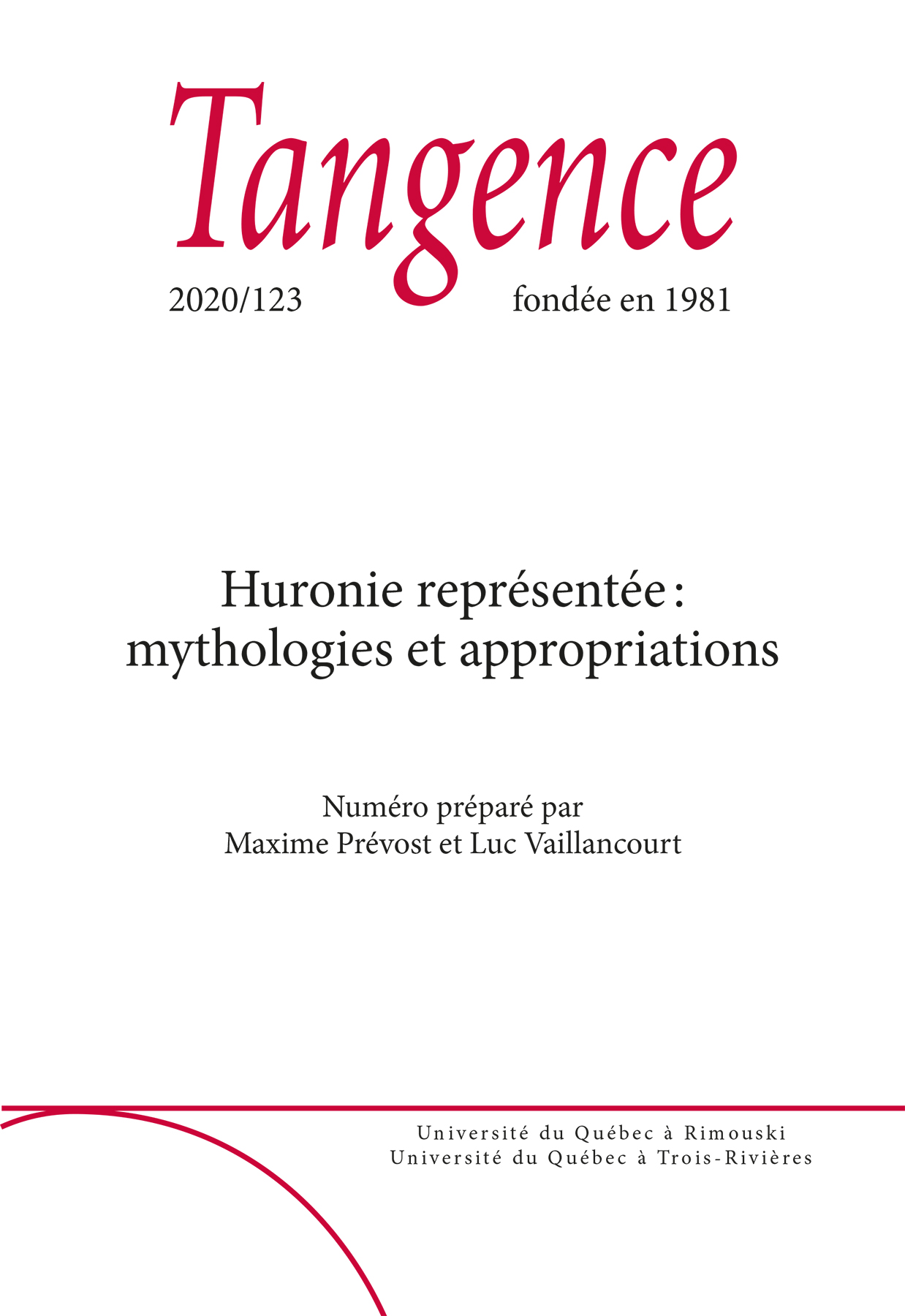Abstracts
Résumé
Louis Laurent Simonin (1830-1886) est un ingénieur mineur marseillais connu aussi bien des scientifiques de son époque que du grand public grâce à ses récits de voyage et ses reportages sur les mines du monde entier. Il est également membre de la Société d’anthropologie de Paris et l’un de ses récits de voyage est cité par Louis Figuier, le vulgarisateur le plus lu de l’époque, dans le contexte d’une comparaison entre la « race rouge » et les hommes préhistoriques. L’analyse de ce passage sera l’occasion de repenser les sciences de l’homme au moment de leur constitution et, plus précisément, d’identifier le réseau de savoirs et de pouvoirs dans lequel le racisme et le colonialisme se montrent comme constitutifs du discours scientifique moderne sur l’homme.
Abstract
Louis Laurent Simonin (1830-1886), a mining engineer and native of Marseille, was known to both the scientists of his time and the public at large for his travel writings and reporting on mines across the world. He was also a member of the Société d’anthropologie de Paris. One of his travel accounts is cited by Louis Figuier, the most widely-read science communicator of the period, as part of a comparison between the “red race” and prehistoric men. An analysis of this passage offers the opportunity to rethink the human sciences at the moment of their constitution and, more specifically, to identify the network of knowledge and power in which racism and colonialism are shown to constitute modern scientific discourse on man.
Article body
Introduction
Louis Laurent Simonin (1830-1886) est aujourd’hui cité surtout par les historiens de la littérature, car son livre La vie souterraine (1867) est l’une des sources principales de Germinal d’Émile Zola et de Sans famille d’Hector Malot[1]. Ingénieur minier originaire de Marseille, pionnier de l’archéologie minière (notamment avec des études sur la civilisation industrielle des Étrusques[2]), Simonin sera également, pour une dizaine d’années, une sorte de reporter des mines de plusieurs pays du monde pour des revues scientifiques. Au cours de ses voyages en Amérique du Nord, il entre en contact avec des peuples autochtones, auxquels il dédie plusieurs articles et chapitres de ses récits de voyage ainsi que trois livres entiers. À partir de la fin des années 1860, ses reportages connaissent un certain succès, ce qui lui vaut d’être considéré comme un expert des « races » de l’Amérique du Nord. Une dizaine des photographies d’Autochtones qu’il a prises au cours de ses voyages sont d’ailleurs conservées au musée de l’Homme et au musée du Quai Branly, à Paris.
Aucune étude n’a encore été dédiée aux écrits de Simonin sur les peuples autochtones et à son engagement au sein de la Société d’anthropologie de Paris (SAP). Dans cet article, j’analyserai un texte de Simonin cité par l’un des plus célèbres vulgarisateurs scientifiques français du xixe siècle, Louis Figuier, dans son livre Les races humaines, publié en 1872[3].
L’un des buts de cette étude est d’analyser une assertion pour le moins surprenante de Simonin : dans le texte cité par Figuier, il affirme que les Hurons-Wendat auraient « disparu ». Plus largement, mon objectif est d’interpréter certaines affirmations de Simonin, qui sont présentées comme fondées sur l’observation directe, à la lumière du contexte d’exploitation coloniale ainsi que des études en anthropologie physique, en paléontologie humaine et en médecine de l’époque. Je voudrais montrer comment l’utilisation d’une image littéraire et stéréotypée du « Peau-Rouge », contraire à toute description ethnographique, se répand dans le nouveau contexte scientifique autour des années 1860, caractérisé par l’essor de la paléontologie humaine et le succès de l’anthropologie physique (qui consiste alors presque exclusivement en une raciologie[4]). Ce cadre apparemment neutre permet de réactiver et de renforcer des stéréotypes qui sont utilisés afin de dénigrer l’Autre depuis l’Antiquité gréco-romaine : le cannibalisme, le nomadisme, la bellicosité, la paresse, le langage enfantin, les outils rudimentaires, etc. C’est grâce à la littérature de voyage sur le Nouveau Monde que ces clichés entrent dans la Modernité[5]. Au moment de la naissance des sciences modernes de l’homme, le discours scientifique confère une aura de vérité objective à ces images.
Dans la littérature scientifique du xixe siècle, la figure du « sauvage américain » s’est également construite sur la base de la littérature de voyage du xviiie siècle, notamment sur celle de Joseph-François Lafitau (qui est rééditée à plusieurs reprises au cours de la première moitié du xixe siècle[6]). Il est à noter que des romanciers, tels que François René de Chateaubriand, s’en étaient aussi inspirés pour écrire leurs oeuvres de fiction[7]. En dépit de l’apparente contradiction entre ethnologie et fiction, cette figure du « Peau-Rouge » entre dans le discours scientifique moderne au xixe siècle. Bien qu’elle soit présentée comme objective et censée s’appuyer sur des realia, elle sert moins à présenter aux lecteurs les moeurs et les coutumes de peuples exotiques qu’à tracer une frontière entre l’humain et le non-humain. Je montrerai comment, dans certains contextes, elle représente le degré zéro de l’humanité, le plus bas de son échelle. Grâce à sa « disponibilité métaphorique[8] », cette figure peut passer d’un domaine à l’autre et être appelée à représenter à la fois un être resté à l’état primitif (qui résiste à l’évolution) et un ennemi de la civilisation (qui résiste à la colonisation). Les sciences biomédicales n’échappent pas à l’utilisation de ce cliché, notamment quand il s’agit de décrire les fonctions cérébrales selon le stade d’évolution des différentes « races humaines ».
Louis Simonin et la Société d’anthropologie de Paris
La conférence que Simonin présente à la SAP lui donne l’occasion de se présenter comme un expert des « questions d’anthropologie, d’ethnologie, de linguistique » chez « les tribus indiennes »[9]. Le rôle fondamental de la SAP et des savants qui gravitent autour d’elle dans la constitution des sciences modernes de l’homme est bien connu : dans ce contexte, préhistoriens, anthropologues, zoologistes, linguistes, géologues, géographes, médecins, etc. partagent leurs connaissances au moment où les frontières entre leurs disciplines ne sont pas encore imperméables[10]. Leur principal point commun est de considérer le raisonnement déductif, le comparatisme et la perspective diachronique comme les principes de base de l’étude de l’humain.
Simonin avait demandé et obtenu son statut de membre de la Société en 1865 sur présentation de Franz Pruner, Eugène Dally et Gabriel de Mortillet. De plus, son voyage en Amérique du Nord, en 1867-1868, est officiellement une « mission » scientifique pour la SAP[11] : c’est pourquoi, à son retour, il est invité à présenter ses observations au cours de la séance du 3 juin 1869 de la SAP, en présence du fondateur, Paul Broca[12].
Quelques passages de cette conférence et de la discussion qui a suivi permettent de comprendre le cadre idéologique dans lequel s’inscrivent les réflexions de Simonin sur les Autochtones. Le discours de Simonin s’articule autour d’une description générale de ce qu’il désigne comme la « race rouge » et qui renvoie pour lui aux « Indiens » du Nord. L’auteur y affirme avoir connu tant les Autochtones du Saint-Laurent que ceux du « Far West » (SRAN, p. 447). Simonin insiste surtout sur la différence entre les Autochtones et les Européens. Il admet avoir connu des individus appartenant à des « tribus civilisées » qui étaient capables d’« éloquence » ainsi que de « chanter au lutrin et [de] faire tous les exercices pieux que demande le culte dans nos églises », mais il affirme également avoir toujours reconnu « entre eux et nous [les Européens] une distance incommensurable » (SRAN, p. 455). Simonin conteste donc l’idée selon laquelle les Autochtones américains auraient une origine commune avec les Européens, et préfère le polygénisme, théorie soutenant que plusieurs « centres de création ou d’apparition différents » (SRAN, p. 450 ; l’auteur souligne) auraient existé. Il accepte aussi la théorie de la dégénération car, selon ses mots, l’« Indien d’Amérique, du moins aux États-Unis, ne sait plus fabriquer la poterie, n’incinère plus les os et semble avoir régressé à un état encore plus sauvage que celui de ses premiers pères ». À ce propos, il affirme que, « dans la barbarie comme dans la civilisation, il y a donc des degrés, et des époques de progrès et de décadence : l’évolution de l’humanité obéit partout aux mêmes lois » (SRAN, p. 452). À la fin de la discussion qui suit la conférence, Broca se plaint des expropriations des terres faites par les colons en les considérant comme « un fait regrettable et non un droit », ce à quoi Simonin répond : « Je ne vois de tous côtés dans l’histoire qu’une longue suite d’expropriations faites par le plus fort, vainqueur du plus faible » (SRAN, p. 456).
Louis Simonin et Louis Figuier
Le 15 septembre 1859, lors de la réunion annuelle de la British Association for the Advancement of Science, l’éminent géologue Charles Lyell annonce sa conversion à l’idée de la « haute antiquité » de l’homme, en faisant notamment référence aux fouilles que Jacques Boucher de Perthes, un botaniste amateur, avait menées dans la région de la Somme à partir de la fin des années 1820. Sa conférence est publiée dans le Times du 19 septembre et est considérée comme un tournant dans la naissance de la paléoanthropologie.
À partir de ce moment, la plupart des savants français acceptent l’idée des « hommes fossiles » ou « antédiluviens » ainsi que leur « haute antiquité », selon les expressions de l’époque. Cela permet de donner un nouvel élan à une pratique de comparaison courante dans la littérature occidentale, qui consiste en l’éclaircissement réciproque de l’antique et de l’exotique[13]. À la suite de cette « invention de la préhistoire[14] », cette démarche prend la forme d’une comparaison entre le sauvage et le préhistorique, qui peuvent tous deux entrer dans la catégorie de primitif. De ce fait, le comparatisme et la perspective diachronique s’affirment comme les principes de base de l’étude de l’humain. Ainsi Louis Figuier, dans son livre L’homme primitif publié en 1870, utilise des récits de voyage portant sur les « Indiens d’Amérique » afin de reconstituer le monde préhistorique (la forme des flèches, la fabrication d’outils, les rites funéraires, etc.[15]) et, dans Les races humaines (1872), affirme que ces femmes et ces hommes sont les derniers représentants du monde préhistorique. Plus précisément, il distingue les « Indiens échappés à la dévastation de leur race et [qui] se sont soumis aux vainqueurs, [et] ne sont plus que des cultivateurs ou des artisans », des « Indiens restés indépendants [… qui] errent dans les bois et les prairies, et sont les derniers représentants de l’homme à l’état sauvage ou demi-sauvage ». Ces derniers, ajoute-t-il, « vivent dans les forêts et les savanes des produits de leur chasse et de leur pêche […], tiennent dans la plus grande abjection leurs femmes [… et] font encore des sacrifices humains à leurs idoles » (RH, p. 466). Il est important de souligner d’emblée que ces affirmations concernent indifféremment tous les peuples autochtones des Amériques, du Nord et du Sud.
Figuier désigne sous le nom de « race rouge » toutes les populations autochtones des Amériques. Quand il s’agit de discuter de son « rameau septentrional » et plus en particulier de « la famille du nord-est » (c’est-à-dire des Autochtones qui vivaient entre l’Atlantique et les Rocheuses), il affirme que « presque toutes ces tribus indiennes ont disparu à cause de la guerre acharnée que leur ont faite les Européens » (RH, p. 524) et il s’en tient aux portraits des Hurons-Wendat, des Iroquois, des Algonquins et des Natchez faits par Chateaubriand, ainsi qu’à celui que fait Fenimore Cooper des Mohicans. Il évoque par exemple le « portrait terrible » que Chateaubriand dresse des Iroquois et sa description de la « physionomie légère » du Huron-Wendat « qui avait l’air d’être né pour être l’allié des Français » (RH, p. 529). Ces images littéraires, tirées de la littérature de voyage du siècle précédent et politiquement influencées par les conflits entre États européens en Amérique du Nord (les Iroquois étant traditionnellement alliés des Anglais, les Hurons-Wendat des Français), sont parfois prises en considération comme de véritables descriptions ethnographiques par les savants du xixe siècle. À plus forte raison, certains « voyageurs contemporains » (RH, p. 529), tels que Simonin, peuvent constituer la source principale de Figuier sur les « Indiens sauvages de l’Amérique du Nord » (RH, p. 538).
Examinons maintenant le texte de Simonin cité par Figuier dans son livre Les races humaines. Le récit de voyage duquel il est tiré connaît une vaste diffusion car il est publié non seulement dans le livre Une excursion chez les Peaux-Rouges[16] (1868), mais également dans la revue Le tour du monde[17] (1868), dans le Bulletin de la Société de géographie[18] (1870), ainsi que dans plusieurs recueils de récits de voyages publiés les années suivantes. Le passage cité par Figuier contient une série de considérations théoriques générales sur la « race rouge » et la déclaration qu’elles sont fondées sur l’observation directe.
Il vaut la peine de transcrire ici quelques-unes des phrases reprises par Figuier dans sa longue citation de Simonin :
C’est une singulière race, dit M. Simonin, que celle des Peaux-Rouges, à laquelle la nature a si généreusement départi le plus beau sol qui existe au monde, sol de riches alluvions, épais et plat, bien arrosé ; et cependant cette race n’est pas encore sortie de l’étape primitive qu’a dû partout parcourir l’humanité au début de son évolution, celle de peuple chasseur, nomade, celle de l’âge de pierre. Les Indiens, si les blancs ne leur avaient pas apporté le fer, auraient encore des armes de silex, comme l’homme antédiluvien, qui s’abritait dans des cavernes, et fut en Europe contemporain du mammouth. Les Indiens fuient le travail, hors la chasse et la guerre ; chez eux la femme fait toute la besogne. Quel contraste avec la race qui les entoure, si travailleuse, si occupée, et où on a pour la femme un si profond respect ! Cette race les enserre, les enveloppe entièrement aujourd’hui, et c’en est fait des Peaux-Rouges s’ils ne consentent à rentrer dans les réserves.
Et encore, dans ces réserves, l’industrie et les arts naîtront-ils ? On sait combien la race rouge est mal douée pour la musique et pour le chant. Chez elle les beaux-arts sont restés dans l’enfance. L’écriture, si ce n’est une grossière représentation pictographique, est complètement inconnue. On sait à peine, avec des perles, tracer quelques dessins sur des peaux. Sans doute ces dessins sont souvent heureusement groupés, et les couleurs s’y lient dans une certaine harmonie, mais c’est tout. L’industrie, à part une grossière préparation des viandes et le tannage des peaux et des fourrures, est également tout à fait nulle. L’Indien est moins avancé que le nègre africain, qui sait au moins tisser et teindre les étoffes. […] Les tribus se font souvent la guerre entre elles sous le moindre prétexte : pour un troupeau de bisons qu’elles poursuivent, pour une prairie, où elles veulent camper seules. […] Les langues de toutes les tribus sont différentes ; mais peut-être qu’un linguiste y reconnaîtrait des racines communes, comme on en a trouvé de nos jours entre les langues européennes et celles de l’Inde. […] Les langues des Peaux-rouges n’ont ou paraissent n’avoir aucune affinité dans les différents termes de leur vocabulaire ; celui-ci, du reste, est souvent très-restreint. Pour se comprendre entre elles, les tribus ont adopté, d’un commun accord, le langage par signes et gestes, qui se rapproche de celui des sourds-muets
RH, p. 538-544
Dans ses récits, Simonin s’en tient en général à des descriptions précises de ses rencontres avec les Autochtones et, dans ses photographies, il cherche à montrer les caractères différents de chaque nation. Cela ne l’empêche pas de présenter ses conjectures comme valables pour tous les « Peaux-Rouges » et donc pour tous les Autochtones de l’Amérique du Nord. Une autre remarque préliminaire touche aux nombreux stéréotypes présents dans ce texte, lesquels décrivent le « Peau-Rouge » comme à la fois paresseux et belliqueux, son art comme enfantin, ses capacités techniques comme limitées à la chasse et au travail des peaux, etc. Figuier aussi, on l’a vu, réactualise le récit des « sauvages » des Amériques en tant qu’« idolâtres » pratiquant des sacrifices humains, récit qui remonte aux premiers contacts des colonisateurs et des missionnaires espagnols avec les Aztèques, trois siècles plus tôt.
Pour Figuier, la conception générale des Autochtones qui n’ont pas été « civilisés » par les Européens est encore tributaire de la figure médiévale de l’homme sauvage, qui vit dans les bois et se nourrit de chasse et de cueillette[19]. Le discours de Simonin est quant à lui exemplaire de son époque, une période charnière de la constitution des sciences modernes de l’homme. À y regarder de plus près, plusieurs de ses affirmations contiennent une allusion directe et assez claire au débat scientifique de l’époque, et même les idées les plus stéréotypées prennent un sens nouveau à la lumière des sciences de l’homme, dont les frontières sont encore poreuses à ce moment.
Un texte exemplaire
Reprenons donc la première phrase du passage cité (« C’est une singulière race […] l’âge de pierre »). Ces affirmations, qui ne font de prime abord qu’exprimer une évidence, constituent en fait une bonne entrée en matière dans les sciences de l’homme de l’époque, car elles impliquent une question majeure : pourquoi, en dépit du fait que la nature ait été généreuse avec ces peuples en leur octroyant une terre fertile et « bien arrosée », les « Indiens » ne sont-ils pas sortis de « l’étape primitive […] l’âge de la pierre » ? Même si Simonin n’avance pas d’explications, il est fort probable que cette phrase ait suscité l’intérêt de Figuier, qui était bien conscient des enjeux théorique et théologique de la question ; ce qui expliquerait son choix de commencer sa longue citation de Simonin avec cette phrase.
Figuier est un créationniste, plus précisément un « spiritualiste » (selon la terminologie de l’époque), car il accepte l’idée d’une transformation graduelle des êtres vivants, tout en demeurant convaincu que n’a jamais eu lieu un passage de l’animal à l’homme et que ce dernier a été créé par Dieu à son image. Pour les spiritualistes, les hommes savent, dès leur apparition sur Terre, comment tailler le silex et utiliser le feu, et consacrent des rites aux morts, car ils pressentent que l’âme survit à la matière. Figuier ne prend donc pas à la lettre le récit biblique et, même s’il croit que ce sont « des mains divines » qui transforment graduellement « les êtres organisés[20] », il accepte les idées de Boucher de Perthes sur l’« homme fossile », c’est-à‑dire sur la « coexistence de l’homme avec les grands animaux de l’époque quaternaire[21] ». Le contraste entre matérialistes (ou transformistes) et spiritualistes caractérise les débuts de la paléontologie humaine et prend la forme d’une rivalité entre Gabriel de Mortillet et Émile Cartailhac, qui opposent science et religion, et Armand de Quatrefages et le marquis de Nadaillac, qui sont convaincus, comme Figuier, que science et religion sont parfaitement compatibles[22]. Toutefois, Figuier évite d’aborder l’oeuvre de Charles Darwin autant que possible et considère l’homme comme l’achèvement de la Création, sorti directement des mains de Dieu : « Nous sommes loin, on le voit, de partager l’opinion des naturalistes qui se représentent l’homme, au début de l’existence de son espèce, comme une sorte de singe, à la face hideuse, au corps poilu, habitant les cavernes comme l’ours et les lions, et participant des instincts brutaux de ces animaux féroces[23] ». Par conséquent, Figuier est persuadé que la civilisation a commencé peu après la création de l’homme et refuse l’existence historique de centaines de siècles obscurs pendant lesquels l’homme ne se serait pas nettement distingué de la bête. Or, cette forme de créationnisme est incompatible avec l’existence d’êtres féroces et primitifs tels que les « sauvages américains » comme ils sont décrits dans certains récits de voyage, car ils ne sont certainement pas faits à l’image de Dieu. Tout comme Simonin, Figuier soutient donc l’idée d’une dégénération après la création de l’homme et considère que les premiers habitants de l’Amérique du Nord étaient dans un « état de civilisation avancée et, dans tous les cas, bien supérieur à celui qui est aujourd’hui le partage des tribus indiennes » qui ont abandonné l’agriculture et le sédentarisme, perdu la capacité de bâtir des monuments, et sont passées « à la vie sauvage[24] ». Pour Figuier, l’existence des « Indiens » ne peut être une cause de remise en question du récit biblique ; mieux vaut, alors, aller à l’encontre de la vision progressive de l’histoire qui caractérise le xixe siècle et accepter l’idée que des peuples entiers puissent (re)devenir sauvages — plus sauvages encore que les hommes préhistoriques.
La suite du discours de Simonin (« Les Indiens, si les blancs […] que les blancs leur imposent ») reprend la justification du colonialisme la plus répandue à l’époque, qui tient compte tant de la théorie des races que des progrès de la paléontologie humaine. Selon cette idée, une « race supérieure » s’impose naturellement et donc nécessairement sur celle qui lui est « inférieure » à l’occasion d’une rencontre. Le silex et le fer sont des métaphores claires : si une race est, dès son apparition, douée de la potentialité d’avancer rapidement sur la voie du progrès technique et spirituel, l’autre ne pourra que s’adapter aux conditions imposées par la race supérieure ou périr. À la même époque, à Montréal, John William Dawson, géologue, recteur de l’Université McGill et premier archéologue québécois, résume avec une phrase fulgurante la question de la relation entre les Autochtones et les Européens : « Rome a fait pour l’Europe ce que l’Europe a fait pour l’Amérique », c’est-à-dire remplacer des « tribus barbares et nomades » avec des « colons simples et industrieux[25] ». Dans ce contexte, qui voit également se former ce qui sera appelé le « darwinisme social », la question des Autochtones qui ne s’adaptent pas à la « civilisation » devient urgente. Quelques-uns des savants de l’époque prévoient qu’il sera nécessaire de les « détruire complétement[26] » ; plusieurs d’entre eux acceptent leur « inévitable extinction[27] ».
Après avoir insisté sur l’état primitif des « Peaux-Rouges », en utilisant comme comparant l’homme préhistorique, Simonin poursuit sa description générale des Autochtones de l’Amérique du Nord en pointant leur incapacité à faire de l’art, de l’artisanat et à transmettre des informations :
La race rouge est des plus mal douées pour la musique ou pour le chant. […] L’écriture, si ce n’est une grossière représentation pictographique, est complètement inconnue. On sait à peine, avec des perles, tracer quelques dessins sur les peaux. […] L’Indien est moins avancé que le nègre africain, qui sait au moins tisser et teindre les étoffes.
Interprétées à l’aune de leur contexte, ces affirmations renvoient à deux topoï des sciences de l’homme de l’époque. Le premier concerne la frontière entre l’humain et l’animal à la lumière des découvertes de la paléontologie humaine ; le second a trait à la relation avec le passé, avec l’histoire, des peuples dits « primitifs ».
Pour les premiers préhistoriens français, la capacité à faire de l’art est considérée comme l’une des caractéristiques qui distinguent l’homme de l’animal et, dans le cas de la paléontologie, les premiers vrais humains de leurs ancêtres, encore proches de l’animalité[28]. Par conséquent, les préhistoriens transformistes, pour lesquels l’humain peut effectivement provenir de l’animal, attribuent l’art pariétal à une époque relativement récente et soutiennent que les plus anciens ancêtres de l’homme n’en auraient pas été capables. Parallèlement, pour les spiritualistes, il n’y a pas d’homme sans esprit humain et donc sans formes d’art qui transcendent l’imitation de la nature. Ainsi, dans les deux courants de pensée, pendant cette première phase de la paléontologie humaine, le fait de ne pas attribuer une capacité artistique complexe à une « race » implique forcément de l’éloigner de l’humanité et la rapprocher de l’animalité.
En ce qui concerne le deuxième point, soit la relation des peuples autochtones avec leur propre histoire, on retrouve une idée bien plus ancienne, déjà présente chez Samuel de Champlain[29] et Joseph-François Lafitau[30]. L’affirmation, si violente, de l’infériorité de l’« Indien » au « nègre africain, qui sait au moins tisser et teindre les étoffes », situe l’« Indien » au plus bas de l’échelle de l’humanité. Pour Simonin, sans écriture ni monuments, sans le chant et la musique pour transmettre récits et traditions, et sans même des capacités artisanales qui dépassent l’utilisation de la peau, des tendons et des os du gibier, la « race rouge » est muette. Elle n’a pas d’histoire culturelle et appartient donc entièrement à l’histoire naturelle. En outre, elle est vaincue par des « races supérieures » et destinée à disparaître « sans laisser de trace dans l’histoire de l’humanité[31] », comme il l’écrit encore dans la dernière page de ce même texte.
Le troisième et dernier sujet abordé par Simonin, après la proximité (ou plutôt l’infériorité) des « Peaux-Rouges » avec les hommes préhistoriques et leur incapacité à transmettre leurs connaissances (ce qui implique le manque de toute forme de culture), concerne leurs capacités linguistiques (« Les langues […] sourds-muets »). Attribuer à l’Autre une capacité linguistique restreinte dans le but de réduire son humanité est un autre topos de la littérature occidentale. Mais ce cliché est aussi devenu un fait scientifique à partir de 1861, lorsque Paul Broca présente à la Société d’Anthropologie de Paris sa découverte du « centre de parole » du cerveau humain, aujourd’hui désignée comme l’« aire de Broca ». Contre les tenants de l’holisme cérébral, Broca inaugure ainsi le localisationnisme : la capacité linguistique, et par conséquent, les autres facultés, telles l’intelligence même, sont désormais visibles et mesurables. À la suite de la découverte de Broca, alors que l’anthropologie physique est incontestablement déterministe, le fait d’attribuer à l’Autre — à une autre « race », selon le lexique de cette époque — un langage primitif, un vocabulaire « restreint », la nécessité de gesticuler, etc. implique son infériorité par nature : biologique, objective, observable et quantifiable. Rappelons que, l’intelligence étant alors devenue quelque chose qui peut être mesuré et même pesé, Broca n’hésitera pas à considérer les femmes comme biologiquement inférieures, car leur cerveau est en moyenne plus petit que celui des hommes.
Conclusion
Comme mentionné ci-dessus, Simonin affirme qu’il n’y a plus de « Hurons », car ils auraient tous « disparu » à cause des guerres menées par les Français, de la petite vérole et de l’abus d’« eau de feu ». En général, pour Simonin, tous les « Peaux-Rouges perdent peu à peu leurs caractères distinctifs[32] » et le destin naturel de l’« Indien » est de se fondre « avec le blanc » ou d’être « détruit[33] ».
Ce texte de Simonin, comme beaucoup d’autres à cette époque, présente deux types de description des « Peaux-Rouges ». La première, bien que stéréotypée et faite à partir d’un langage qui aujourd’hui serait considéré comme raciste, est accompagnée de certains détails qui suivent, au moins superficiellement, les modalités d’une description ethnographique ou scientifique : dates, noms, lieux, faits précis décrits du point de vue d’un observateur. Or, on l’a vu, un deuxième « Peau-Rouge » se superpose souvent au premier, renvoyant à une description générique, valable pour des grands groupes d’individus, sans tenir compte des distances spatiales, temporelles et culturelles qui les séparent. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, pour ces scientifiques, la seconde image est plus véridique que la première : l’Indien authentique est celui des stéréotypes. Les Hurons-Wendat rencontrés par Simonin au cours de ses voyages le long du Saint-Laurent sont pour la plupart catholiques et francophones, sont sédentaires, pratiquent l’agriculture et et leurs productions artistiques sont très bien connues. Ils ne correspondent pas du tout à la description générale de Simonin, qui tire donc la conclusion que les « Hurons » authentiques n’existent plus. N’étant plus de vrais Indiens, ils sont finalement devenus de vrais hommes et échappent donc au regard de l’anthropologie physique, qui était à la recherche d’une « race inférieure ».
Simonin possède une solide formation en sciences dures ; il est un scientifique reconnu par ses pairs et est au courant des théories scientifiques les plus récentes ; il est également un grand voyageur qui a observé les moeurs et les coutumes de peuples partout dans le monde. Ses contemporains estiment donc ses conjectures comme dignes de la plus grande considération. Il est devenu facile, aujourd’hui, de reconnaître les éléments idéologiques de son discours et, notamment, ceux qui, par le biais d’un langage raciste, constituent une justification du colonialisme. Dans cet article, j’ai donc cherché à offrir une lecture plus complexe de la question en reprenant cette page de Simonin citée par Figuier. Loin d’être une simple accumulation de stéréotypes, celle-ci répond non seulement à des problématiques distinctives des sciences de l’homme moderne au moment de leur constitution au mi-temps du xixe siècle, mais aussi à des questionnements qui les caractérisent encore aujourd’hui : qui a été le premier homme ? Où se situe la frontière entre l’homme et l’animal ? Quelles sont les différences entre les hommes ? L’humanité est-elle une donnée biologique ?
Selon Giorgio Agamben, on peut désigner comme « dispositif anthropogénique » ce qui, dans l’Occident moderne, définit l’humain à travers l’opposition « homme-animal » ou « humain-inhumain ». Cette frontière, mobile au cours du temps, constitue une « zone d’indifférence » entre nature et droit et permet de nier à certains groupes le statut de « sujets de droit[34] ». Dans les textes des savants français de la seconde moitié du xixe siècle, la représentation du « Peau-Rouge » se trouve précisément sur cette frontière. Dans le contexte de la littérature scientifique de l’époque, ce cliché ne sert pas toujours à présenter les moeurs et les coutumes de peuples exotiques. Quand il s’agit de décrire les « hommes fossiles », de présenter les différences entre les « races humaines » ou d’expliquer l’évolution des facultés cérébrales, le « Peau-Rouge » est évoqué afin de tracer la frontière entre le non-humain et l’humain, de manière à confirmer la conception scientifique de ce dernier. Une recherche sur ces questions, encore très peu étudiées, me paraît nécessaire afin de mettre en lumière les sciences de l’homme au moment de leur constitution et, plus précisément, d’identifier le réseau de savoirs et de pouvoirs dans lequel le racisme et le colonialisme se montrent constitutifs du discours scientifique moderne sur l’homme[35].
Appendices
Note biographique
Aldo Trucchio est chercheur au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) à l’Université du Québec à Montréal. Titulaire d’un doctorat en philosophie politique (Université de Naples « L’Orientale ») et d’un doctorat en langue et littérature françaises modernes (Université de Genève), ses recherches se situent au carrefour de la philosophie, de la littérature et de l’histoire des sciences. Ses plus récentes recherches portent sur l’oeuvre du critique et historien de la médecine Jean Starobinski et sur les figures d’altérité entre science et littérature au xixe siècle. Il a publié de nombreux articles sur ces sujets et dirigé plusieurs ouvrages collectifs (pour la liste de ses publications, voir la page https://uqam.academia.edu/AldoTrucchio). Après une monographie sur l’anthropologie politique de Baruch Spinoza, il prépare un nouveau livre sur les relations entre langages littéraire et scientifique, dont la parution est prévue pour 2021.
Notes
-
[1]
Louis Simonin, La vie souterraine, ou Les mines et les mineurs [2e éd. revue et corr.], Paris, Librairie L. Hachette et Cie, 1867.
-
[2]
Voir par exemple Louis Simonin, « De l’exploitation des mines et de la métallurgie en Toscane pendant l’Antiquité et le Moyen Âge », dans Annales des mines ou Recueil de mémoires sur l’exploitation des mines et sur les sciences et les arts qui s’y rattachent, Paris, Dalmont et Dunod, 5ᵉ série, t. 14, 1858, p. 557-615.
-
[3]
Louis Figuier, Les races humaines, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1872. Désormais, les références à cet article seront indiquées par le sigle RH, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[4]
Voir Claude Blanckaert, « Le “Manuel opératoire” de la raciologie. Les instructions aux voyageurs de la Société d’Anthropologie de Paris (1860-1885) », dans Claude Blanckaert (dir.), Le terrain des sciences humaines. Instructions et enquêtes (xviiie-xxe siècle), Paris, L’Harmattan, 1996, p. 139-173.
-
[5]
Voir Jean-Paul Duviols, Le miroir du Nouveau Monde. Images primitives de l’Amérique, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006.
-
[6]
Joseph-François Lafitau, Moeurs des sauvages américains comparées aux moeurs des premiers temps [1724], Lyon/Paris, Libraire d’Éducation Périsse frères, 1845. Sur ce sujet, voir Mélanie Lozat et Sara Petrella, « Introduction », dans Mélanie Lozat et Sara Petrella (dir.), La plume et le calumet. Joseph-François Lafitau et les « sauvages ameriquains », Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2019, p. 15-26.
-
[7]
Voir Gilbert Chinard, L’exotisme américain dans l’oeuvre de Chateaubriand, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1918.
-
[8]
J’emprunte ce concept à Jean Starobinski, La relation critique, Paris, Gallimard, 1970, p. 200.
-
[9]
Louis Simonin, « Sur les races de l’Amérique du Nord », Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, iie série, t. 4, 1869, p. 446. Désormais, les références à cet article seront indiquées par le sigle SRAN, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[10]
Voir Claude Blanckaert (dir.), Les politiques de l’anthropologie. Discours et pratiques en France (1860-1940), Paris, L’Harmattan, coll. « Histoire des sciences humaines », 2001.
-
[11]
Voir « 203e séance — 13 mai 1869 », Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, iie série, t. 4, 1869, p. 403-404.
-
[12]
Sur Paul Broca, voir Claude Blanckaert, De la race à l’évolution. Paul Broca et l’anthropologie française (1850-1900), Paris, L’Harmattan, coll. « Histoire des sciences humaines », 2009.
-
[13]
Voir Francis Affergan, Exotisme et altérité. Essai sur les fondements d’une critique de l’anthropologie, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Sociologie d’aujourd’hui », 1987 ; et François Hartog, Anciens, Modernes et Sauvages, Paris, Seuil, 2005.
-
[14]
Voir Nathalie Richard, Inventer la préhistoire. Les débuts de l’archéologie préhistorique en France, Paris, Vuibert, coll. « Inflexions », 2008 et Arnaud Hurel et Noël Coye (dir.), Dans l’épaisseur du temps. Archéologues et géologues inventent la préhistoire, Paris, Publications scientifiques du Muséum, coll. « Archives », 2011.
-
[15]
Louis Figuier, L’homme primitif, Paris, Librairie L. Hachette et Cie, 1870, p. 112-113 et 194-195.
-
[16]
Louis Simonin, Une excursion chez les Peaux-Rouges, Paris, Challamel aîné, 1868.
-
[17]
Louis Simonin, « Le Far West américain (1867) », Le tour du monde. Nouveau journal des voyages, vol. 17-18, 1868, p. 286-288.
-
[18]
Louis Simonin, « L’homme américain. Notes d’ethnologie et de linguistique sur les Indiens des États-Unis », Bulletin de la Société de géographie, 5e série, t. 19, 1870, p. 118-142.
-
[19]
Voir François Gagnon, « Le thème médiéval de l’homme sauvage dans les premières représentations des Indiens d’Amérique », dans Guy-H. Allard (dir.), Aspects de la marginalité au Moyen Âge, Montréal, Les Éditions de l’Aurore, 1975, p. 83-115 et Peter Mason, Deconstructing America : Representations of the Other, London/New York, Routledge, 1990.
-
[20]
Louis Figuier, L’année scientifique et industrielle ou Exposé annuel des travaux scientifiques, des inventions et des principales applications de la science à l’industrie et aux arts, qui ont attiré l’attention publique en France et à l’étranger, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1867, p. 264.
-
[21]
Louis Figuier, L’année scientifique et industrielle, ouvr. cité, p. 250.
-
[22]
Voir Nathalie Richard, « Entre matérialisme et spiritualisme : les préhistoriens et la culture dans la seconde moitié du xixe siècle », dans Albert Ducros, Jacqueline Ducros et Frédéric Joulian (dir.), La culture est-elle naturelle ? Histoire, épistémologie et applications récentes du concept de culture, Paris, Errance, 1998, p. 25-40.
-
[23]
Louis Figuier, La Terre avant le déluge [5e éd.], Paris, Librairie Hachette et Cie, 1866, p. 425.
-
[24]
Louis Figuier, L’homme primitif, ouvr. cité, p. 422.
-
[25]
« Rome did for Europe what Europe has been doing for America » ; « barbarous and migratory tribes » ; « simple and industrious colonists » (John William Dawson, Fossil Men and their Modern Representatives, Londres, Hodder et Stoughton, 1880, p. 67 ; je traduis).
-
[26]
Alfred Edmund Brehm, Les mammifères, caractères, moeurs, chasses, combats, captivité, domesticité, acclimatation, usages et produits, dans Merveilles de la nature. L’homme et les animaux, éd. française par Zéphirin Gerbe, Paris, Baillière et fils, 1891, p. 658.
-
[27]
Clémence Royer, Origine de l’homme et des sociétés, Paris, Victor Masson et fils, 1870, p. 466. Sur Royer, voir Claude Blanckaert, « “Les bas-fonds de la science française”. Clémence Royer, l’origine de l’Homme et le Darwinisme social », Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, nouvelle série, t. 3, fascicule 1-2, 1991, p. 115-130.
-
[28]
Voir Nathalie Richard, L’invention de la préhistoire, ouvr. cité, p. 38-44.
-
[29]
Voir Samuel de Champlain, Des sauvages, ou Voyage de Samuel Champlain, de Brouage, fait en la France nouvelle l’an mil six cens trois…, Paris, C. de Monstr’oeil, 1603, ch. 3, p. 6 et suiv.
-
[30]
Voir Joseph-François Lafitau, Moeurs des sauvages américains, comparées aux moeurs des premiers temps, Paris, Saugrain l’aîné et Charles Estienne Hochereau, 1724, « De l’origine des peuples d’Amérique », p. 27 et suiv.
-
[31]
Louis Simonin, Une excursion chez les Peaux-Rouges, ouvr. cité, p. 72.
-
[32]
Louis Simonin, Une excursion chez les Peaux-Rouges, ouvr. cité, p. 69.
-
[33]
Louis Simonin, Une excursion chez les Peaux-Rouges, ouvr. cité, p. 72.
-
[34]
Voir Giorgio Agamben, L’ouvert. De l’homme et de l’animal [L’aperto. L’uomo e l’animale, Turin, Bollati Boringhieri, 2002], trad. de l’italien par Joël Gayraud, Paris, Rivages, coll. « Bibliothèque Rivages », 2002.
-
[35]
En dépit de l’importance de la figure du « Peau-Rouge » dans la constitution des sciences de l’homme au xixe siècle, aucune étude n’a encore été spécifiquement dédiée à ce sujet. Je me permets donc de renvoyer à mon projet de recherche (financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique — FNS) : L’homme « sauvage » et l’homme « fossile » entre France et Nouvelle-France (Laboratoire TEMOS, Le Mans Université et Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie — CIRST, Université du Québec à Montréal). Plusieurs publications sont en cours.