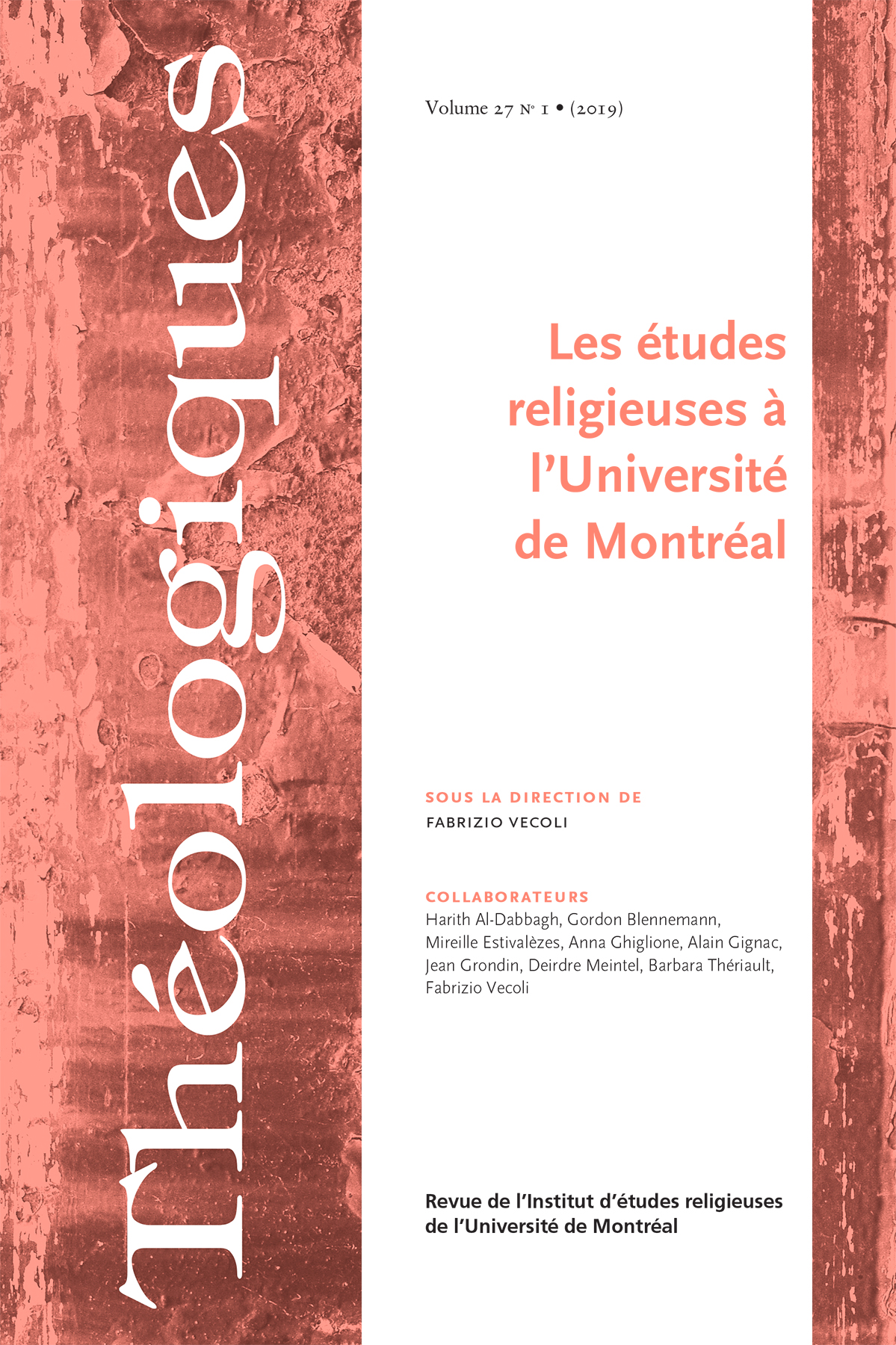Article body
En soutenant la liberté de la religion la Cour suprême définit le champ de son intervention en essayant de proposer une définition de la religion. À la différence des tribunaux des instances inférieures, elle ne touche pas à la question de la construction d’une souccah comme une obligation inéluctable d’un adepte du judaïsme. Par ailleurs, le judaïsme n’étant pas unifié par un canon universel et divisé en plusieurs courants assez divers, ce genre de détermination restera toujours sujet à controverse. Par contre, la Cour suprême se croit habilitée à « considérer la sincérité des croyances dictées à un individu par sa propre conscience ». La sincérité de l’individu à l’égard de la religion me semble plus difficile à déterminer qu’évaluer « l’enseignement officiel donné par les autorités religieuses de la communauté à laquelle se rattache cet individu », ce que la Cour suprême, avec raison, préfère éviter. Si, comme le dit le jugement, « ceux qui invoquent la liberté de religion ne devraient pas être tenus d’établir la validité objective de leurs croyances en apportant la preuve que d’autres fidèles de la même religion les reconnaissent comme telles » comment pourraient-ils jauger la sincérité ?
Ce problème est d’autant plus important que le judaïsme, comme par ailleurs, l’islam mettent un accent plus fort sur la pratique que sur la croyance qu’invoque la décision de la Cour suprême. Au sein du judaïsme, il existe, depuis des siècles, tout un débat portant sur la sincérité de la pratique. Dans le langage judaïque, il s’agit de se demander si la pratique des commandements requiert une intention sincère (mitsvoth tserikhot kawana). Par exemple, si un juif ne voulant pas manger de pain azyme le premier soir de Pâque est forcé de le faire, peut-on quand même considérer qu’il a accompli le commandement ? Plusieurs sources classiques affirment qu’en effet, il l’a accompli, l’intention (celle-ci pouvant être assimilée au concept de sincérité invoqué par la Cour suprême) n’étant donc pas une condition nécessaire. Il en résulte que la Cour suprême base sa décision sur un concept qui reflète plutôt le système de valeurs propre au christianisme et qui, dans sa forme laïcisée, semble rester opératoire dans ses délibérations juridiques. Il est à voir si cette extrapolation conceptuelle est légitime.
Ce dossier nous oblige à nous pencher sur les limites du champ religieux. Lorsque M. Amselem a acheté l’appartement au Sanctuaire de Montréal il a signé un contrat qui stipulait l’interdiction de construire sur le balcon mais a ensuite invoqué la liberté de la religion pour y ériger une souccah. La Cour suprême lui a donné raison. Prenons un exemple hypothétique d’un juif pratiquant qui obtient un poste qui l’oblige à travailler le samedi. Une fois engagé, il refuse de transgresser le sabbat et de se présenter au travail. Lorsqu’il est limogé suite à son refus, il invoque la liberté de la religion et accuse son ancien employeur de discrimination religieuse. Est-ce que la Cour suprême lui donnerait raison également ? Sans être juriste, je considère cette question hypothétique pertinente à notre discussion.
Une autre question que soulève l’affaire Amselem porte sur les limites de la religion et sa distinction des identités culturelles ou politiques. En l’occurrence, où se termine la religion et où commence l’engagement idéologique ? Par exemple, lors des élections tenues par l’Association des étudiants de l’Université McGill en 2017 quelques candidats n’ont pas été élus à la direction de l’association à cause de leur participation active dans des organismes sionistes pro-israéliens. En réponse, ces candidats ont accusé leurs détracteurs d’antisémitisme. Il est certain que ces étudiants croient sincèrement que le sionisme fait partie de leur identité religieuse et que la défense de l’État d’Israël constitue une obligation découlant de leur engagement religieux. Beaucoup de synagogues intègrent l’appui à Israël, voire des prières pour l’armée israélienne et pour « tous les actes de leurs mains », dans la liturgie. Dans ces communautés on affirme la centralité d’Israël dans l’enseignement judaïque depuis des décennies. D’autres communautés juives, souvent de stricte observance, restent indifférentes, voire hostiles, à l’idée même d’un État sioniste. Est-ce-que l’opposition à l’engagement sioniste constitue un acte de discrimination contre le groupe confessionnel juif ? Cet engagement, doit-il être protégé dans le contexte de la liberté de la religion ou bien être considéré comme politique et donc légitimement ouvert à la contestation politique ?
Finalement, quelques mots sur l’affirmation de mon collègue qu’« avec le retour du phénomène religieux, le droit ne pouvait plus faire abstraction des questions liées à la religion ». Des siècles durant, le droit était intimement lié — tant institutionnellement qu’en termes de ses origines et de sa légitimité — avec la religion et ne pouvait « en faire l’abstraction ». Plusieurs cultures juridiques continuent de se nourrir explicitement des sources religieuses. Il s’agit surtout de pays non-occidentaux tels que l’Inde ou Israël. Ainsi le parlement israélien encourage explicitement l’intégration du droit talmudique (michpate ha-ivri) dans le processus décisionnaire des tribunaux « laïcs » qui coexistent déjà dans l’espace légal israélien avec les tribunaux rabbiniques. L’affirmation est d’autant plus curieuse que, un peu plus bas, il reconnaît que la culture juridique au Québec, et au Canada en général, évolue dans un contexte différent de celui de la République française où la séparation entre l’Eglise et l’État est plus stricte et plus enracinée. En plus, il se réfère à la jurisprudence de nos voisins du sud qui ont une histoire continue de décisions visant à assurer le droit constitutionnel du citoyen d’exercer la liberté de la religion dans le contexte de la séparation entre l’église et l’État. Donc il ne s’agit guère d’un retour du phénomène religieux mais plutôt de son enracinement implicite qui devient plus explicite.
Appendices
Note biographique
Yakov Rabkin est professeur émérite au Département d’histoire de l’Université de Montréal. Ses champs d’intérêt incluent l’histoire juive contemporaine et l’histoire des sciences. Parmi ses publications, citons : (2004) Au nom de la Torah. Une histoire de l’opposition juive au sionisme, Québec, Presses de l’Université Laval.