Abstracts
Résumé
La question de l’altérité chez Michel de Certeau est au coeur de sa (dé)-marche théologique et noue inséparablement la question d’un sujet en quête de son désir et en ce qu’il se reconnaît comme manque à être. Quelques repères nous permettent d’étayer l’état de la question. Il semble que pour Certeau, la théologie, s’il en est une, se fait autrement. Depuis la modernité quelque chose s’est rompue, le « dire » et le « faire » théologiques ne font plus consensus ni sur les pavés des Églises ni dans l’ordre des discours relatif à l’éveil des sciences humaines. Un socle s’est rompu. La rupture même fait office de lieu théologique, elle porte une coupure épistémologique : le travail théologique ne peut en aucun temps être fixé une fois pour toutes et figé dans des énoncés évidés de leur fondement, c’est-à-dire évacuer l’expérience même d’une rencontre de l’autre et de l’Autre. Il ne s’agit pas pour Michel de Certeau de poser un savoir sur Dieu ni de lui imposer un lieu mais de reconnaître l’(in)-appropriable d’un « non-lieu ». L’acte théologique pose désormais l’acte d’un sujet qui se met en mouvement, entamant une marche incessante, en travail de désir d’autre et en la rencontre de l’Autre. Le discours théologique porte le produit langagier de cette rencontre dans son (im)-possibilité d’en tenir lieu. La théologie devient ainsi elle-même acte d’énonciation.
Abstract
The question of otherness is at the heart of Michel de Certeau’s theological approach and is inseparably related to the question of a subject in search of his desire, in that he recognizes himself as a lack of being. Here, some benchmarks allow us to support the state of the question. It seems that for Certeau, theology, if there is one, has to be done differently. Since the beginning of modernity, something has broken down : the “saying” and the “doing” of the theology are no longer in consensus, neither on the pavements of the Churches nor in the order of the discourses related to the awakening of the social sciences. It seems as if a pedestal broke. The rupture itself serves as a theological locus, as it carries an epistemological break : the theological work can no more be secured once and for all nor can it be settled in statements hollowed out of their foundation. That is to say that it cannot evacuate the very experience of meeting the other and the Other. For Michel de Certeau, it is neither a question of postulating any actual knowledge on God nor it is one of assigning the place where such knowledge could be found, but the matter is to recognize the (in)appropriability of a “no-place. Henceforth, the theological act poses the act of a subject who sets himself in motion and whose incessant march is nothing but the work of his desire of otherness and for the Other. The theological discourse carries the language-product of this meeting in its (im)-possibility to take its place. Theology itself, thus, becomes its very act of enunciation.
Article body
« “Penser […], dit Certeau, c’est passer” (Certeau 1987a, 52), c’est “passer à l’autre” »
Dosse 2003, 1
Préambule
Quelque chose de cet autre initie notre propre démarche, où lecture et mouvement d’écriture déploient une disponibilité, un élan vers, voire une disposition à penser, à passer… Participer de ce mouvement, c’est s’atteler à ne jamais en figer les moindres contours, se récuser de tout savoir, car le mouvement appelle une rencontre, c’est-à-dire que de part et d’autre de la rencontre — de ce qui entretient l’ouverture et l’assigne — il y a quelque chose de ce qui fait lien, sans pour autant en suturer la disparité, faisant appel au creuset d’une béance. Mouvement, où il s’agit bien d’une lecture/écriture de la différence : va-et-vient, écart, retrait, suture/coupure se conjuguant, poussée en tant que vif de l’élan s’exhibant dans le présent d’un futur antérieur. Cet autre qui passe et altère, nourrit en creux les intériorités d’un propre, un en soi singulier invité à se déchausser à la manière d’un va-nu-pieds prenant la route, sans attaches, délogé de son lieu, habité et conduit par un « désir d’autre » (Dosse 2003, 1).
Dans ce « penser » la théologie de l’altérité chez Certeau, il nous faut engendrer à notre tour ce « passer » à l’autre, prendre la route. Penser, ce peut être prendre corps avec l’autre en ce que de l’identique déporte les frontières altérées, enfourche les traverses en tant que chemin de vie. Penser, parce qu’il y a bien rencontre… itinérance comme lieu sans lieu dans les traces du « marcheur blessé » (Dosse 2002).
Introduction
Dans une première partie de l’article (Hervieux 2017), nous avons posé que la théologie de l’altérité chez Michel de Certeau se présente comme un appel à se tourner vers l’autre[2] et qu’elle prend ses distances eu égard à l’élaboration d’un rapport d’appropriation, lequel instaure et soutient un droit de possession et de maîtrise. Dès lors, elle n’est pas uniformité, elle ne s’y conforte pas. Elle participe du mouvement même du désir de ce que l’Autre[3] en sa parole fait naître ; elle a pour figure une main tendue par un singulier affranchi de son propre enfermement et apte à devenir sujet désirant et de s’y abandonner en accueillant l’acte d’une coupure : d’une séparation/aliénation[4] : altération. Cette deuxième partie pose l’acte théologique dans le mouvement certalien, où la question de l’altérité s’entretient du mouvement même de l’« exil », là où l’autre se pose en sa différence à même le « non-lieu » de l’Autre, qui s’offre à l’inédit de la rencontre ? La question de l’altérité chez Michel de Certeau est au fondement de sa démarche théologique et noue inséparablement la question d’un sujet en quête de son désir et en ce qu’il se reconnaît comme manque à être. L’acte théologique pose désormais l’acte d’un sujet qui se met en mouvement et en travail de désir d’autre et de l’Autre. L’acte théologique loge au creuset d’une béance, il appartient à l’histoire singulière d’un sujet qui se reçoit de l’autre parce qu’il y a bien de l’Autre. Dès lors, l’acte théologique porte en lui-même le fruit d’une altération, il signe un singulier et non point une totalité, il introduit essentiellement une différence dans ses facettes inédites. L’oeuvre de Michel de Certeau nous place au coeur de ce mouvement d’altération.
1. La rencontre de l’autre : un tracé d’absence ou la figure (in)sensée d’une itinérance du théo-logos
À quoi la théologie est-elle confrontée sur cette route de l’« exil » ? D’où parle-t-elle au sein des interstices de ces « non-lieux » ? Peut-elle parvenir à penser le rapport à l’autre si celui-ci loge dans les sphères de l’itinérance ? Lorsque « penser », c’est « passer à l’autre », la théologie ne peut-elle pas devenir à son tour chemin d’altération, lieu privilégié de rencontres inédites ? Ce passage est un acte, il exige une sortie de soi, parce que l’autre ne peut se poser en objet, il est inobjectivable, mais élan et compagnon de route, il est ce qui fait marcher. L’infranchissable de l’autre, l’acte théologique ne peut qu’en donner la portée de sa non-saisie, la théologie en est foncièrement dépossédée, c’est-à-dire l’autre est à la fois ce qui lui manque et ce qui la fonde. Cet autre ne lui apparaît en aucun temps comme un propre mais bien plutôt comme un infranchissable. Ce que nous appelons acte théologique, c’est essentiellement cette mise en marche vers l’autre, à la limite nous concevons la théologie comme un mouvement, s’accréditant de ce que l’autre insinue par les voies et les voix de l’Autre jamais conquises. Elle substitue un savoir objecté et objectivable à l’épreuve de la « faiblesse de croire » que ce qui manque ne peut être que source vive.
L’autre chez Certeau concerne un absent « nécessaire et manquant », souligne Destrempes (2005, 141). Le rapport à l’altérité se cerne en quelque sorte par le biais d’un deuil, d’une perte animant ce vers quoi nous continuons de marcher. Et chez Certeau, cette marche incessante sera celle du mystique et du croyant, en tant que sujets désirants. L’altérité est le foisonnement d’un manquant brut, elle est riposte d’un deuil sans objet où les mots pour le dire ne se supportent d’aucune coïncidence avec la perte. L’altérité appartient à l’ailleurs, elle est marginale… comme le fou, l’enfant, l’illettré illustrant chez Certeau des figures de l’altérité (Certeau 1982, 280-405). « Cette expérience n’est jamais donnée par le langage qui tente de la raconter » (Destrempes 2005, 141). Il ne peut y avoir d’énoncés pour l’esquisser mais qu’une possible pratique énonciative, créatrice d’un indicible qui ne cesse d’interpeller. Ce qui se met en oeuvre par l’énonciation est le langage d’un corps s’ouvrant à son désir, mais désir prenant son élan dans le manque, marqué d’une présence d’absence. « Dans le discours mystique, “il y a de l’Autre, mais il n’y a rien à en attendre sinon le désir qui s’instaure d’en être privé” (HPSF, 173) » (Destrempes 2005, 143).
Avant de poursuivre, faisons une incise, et considérons pour notre propos l’avancée de Destrempes et situons-la pour notre question. Ce parcours avec Destrempes sur la question de l’altérité chez Certeau, puisé au domaine de la mystique, pose les éléments fondamentaux de la théologie de l’altérité chez Certeau. Ce à quoi la théologie se trouve confrontée, c’est à une sorte de déprise de l’autre, il lui est marginal et, paradoxalement, le propre du mouvement de la théologie est d’aller à sa rencontre. La théologie, en quelque sorte, renverse le mouvement en le relançant au procès d’intériorité du marcheur ; ici le travail de la théologienne et celui du théologien portent les fruits de la singularité d’un parcours : aller vers l’autre c’est autant s’affubler des voies de l’Autre, c’est une sortie non pas uniquement de soi mais en soi, inséparable d’un mouvement intérieur. Nous dirons que l’autre est ce que nous portons dans la béance du manque. C’est du lieu de son itinérance en regard de ce manque que la théologie peut poser son rapport à l’autre. Et c’est du « non-lieu » se signifiant dans l’Autre, en tant que réverbère du manquant nécessaire qu’elle entamera l’acte de son discours, c’est-à-dire qu’elle se recevra d’un acte d’énonciation. De l’Autre précisément, la théologie ne peut élaborer que le tracé de sa propre altération, parce que de l’autre est passé, la rencontre est effective. La théologie n’a pour assise que le fondement d’une absence. Et c’est à partir de cette radicalité du manque qu’elle prend parole et, à son tour, elle en offre une écriture.
Nous voulions souligner que le travail théologique n’est pas une abstraction intellectuelle car on ne théorise pas sur l’autre, on le rencontre. Ainsi, le « penser » théologique, c’est un « passer à l’autre », dans le sens plein d’un véritable retournement. Il s’agit d’un « travail », c’est une naissance en l’inédit prenant forme, où il y a bien un avant et un après. La théologie est partie prenante de cette altérité/altération dont elle est porteuse. Quelque chose de l’ordre du bouleversement inflige son discours et oriente sa dé-marche : un croire[5] en l’Autre met en relation un désir et un absent ; le « travail théologique » donnera corps à l’écriture de cette relation, à la fois corps langagier et corps mortel, puisque l’autre passe… et c’est en l’Autre que s’assume la corporéité langagière de la relation. La relation ne peut être que parole dans un corps.
Poursuivons. Pourtant, paradoxalement, Destrempes (2005, 141) nous dit bien que « [c]ette expérience n’est jamais donnée par le langage qui tente de la raconter, si bien que la langue mystique est dépossédée de son Autre ». Qu’est-à-dire ? Qu’il ne peut y avoir d’énoncé qui peut représenter ce qu’il en est de cette expérience qu’autrement que par l’enjeu d’un procès énonciatif, c’est-à-dire que la relation demeure une ouverture, elle n’est jamais achevée, l’écriture théologique ne cessera pas de ne pas pouvoir l’écrire. Certeau dira : « L’écrit est l’effet et la fiction de la relation » (Certeau 1987a, 176). La relation d’un corps désirant et d’un manquant appartient à une impossibilité[6]. L’altérité chez Certeau a donc affaire avec la perte et l’absence, avec ce qui crée un « vide ». Le « vide » ne peut se cerner qu’à partir d’un acte énonciatif, il n’est pas de l’ordre d’un énoncé mais d’un évidement. Ainsi, l’absence n’est pas une non-présence, elle répond d’un corps désirant et non pas d’une altérité dans sa transcendance inaccessible. L’impossibilité dont un Réel se marque, c’est cette impossibilité d’en suturer le « vide », de le combler par quelque objet, voire tout autant par un ordre représentatif ou langagier. L’autre demeure inassimilable, il indique une pure différence. Un sans objet, un évidement, une absence sert de transfuge à l’investissement du désir faisant marcher vers l’autre à même le « non-lieu » de l’Autre en son surgissement, d’où un sujet s’efface pour laisser l’espace à la rencontre insaisissable et pourtant inaliénable, dirons-nous : « [N]ous touchons ici à un dépassement du schème sujet/objet, puisque deviennent interchangeables les places du “je” et de l’autre : “l’Autre toujours institue le sujet en l’aliénant” (HPSF, 183) » (Destrempes 2005, 146). Ce dernier point nous amène à poser la question du rapport à l’autre, celui-ci à la fois nécessaire et manquant ; autrement dit, qu’elle peut être l’écriture du « vide », c’est-à-dire « examiner ce qui advient d’un langage qui n’est plus soutenu par un corps ? » (Destrempes 2005, 144).
Cette question introduit en filigrane la question du croire[7] chez Certeau. Les analyses certaliennes sur la mystique au xvie-xvie siècle constituent l’écriture de la mise en acte de ce manquant nécessaire. Le rapport à l’autre est inséparable d’un langage et d’un corps. Ce qui se mettra en oeuvre par l’énonciation mystique est le langage d’un corps s’ouvrant à son désir, mais désir prenant son élan dans l’absence, dans la privation de l’Autre dont l’écriture mystique se reçoit :
Sa littérature a donc tous les traits de ce qu’elle combat et postule : elle est l’épreuve par le langage, du passage ambigu de la présence à l’absence ; elle atteste une lente transformation de la scène religieuse en scène amoureuse, ou d’une loi en une érotique ; elle raconte comment un corps « touché » par le désir et gravé, blessé, écrit par l’autre, remplace la parole révélatrice et enseignante. Les mystiques luttent ainsi avec le deuil, cet ange nocturne. Mais la propédeutique médiévale d’une assimilation à la vérité devient chez eux un corps à corps.
Certeau 1982, 13
Ce désir « gravé », « blessé » est relation mais relation sans objet ; l’altérité, comme on a souligné, est chemin de traverse d’une impossible captation : « La dynamique même du désir implique qu’il doit se passer de son objet ; dès qu’il atteint celui-ci, il s’éteint en se réalisant » (Destrempes 2005, 145). Comment faire lien avec ce qui s’absente ? Un croire en l’autre met en relation un désir et un absent, un tracé d’écriture à la fois corps et acte énonciatif, fruit de l’insaisissable rencontre, tiendra lieu de cette relation : « La croyance est “le mouvement né et créateur d’un vide” ; “ce qui noue l’écriture au ‘rien’ : un croire” (HPSF, 141) » (Destrempes 2005, 147).
À notre question d’où parle la théologie et comment se construit son rapport à l’autre dans une marche à la merci de l’« exil » et du « non-lieu » de ses traverses, que pouvons-nous transiger avec ce tracé d’absence, ou pour le moins vers quoi nous conduit la démarche de Destrempes ? L’altérité chez Certeau, nous indique-t-il, a donc affaire avec le « rien », d’un « vide » d’où un creuset donne place à de l’autre, ce qui est absence laisse une présence, en se marquant de sa trace[8]. Le mouvement vers l’autre dont la théologie partage les itinérances et les écueils est un mouvement traversant un « vide », un « rien » qui est le « rien » dans le geste de le rendre tel, un « rien » qui ne peut en aucun temps supplanter le mouvement, au contraire, il le module, c’est un « vide » plein du surgissement de l’Autre. Le « vide », c’est ce « rien » opérant un croire, et ce dernier est ce qui permet d’orienter la marche vers l’autre, à la limite, croire devient le chemin lui-même. La foi est ce qui s’écrit à même l’évidement, car ce qui se noue avec ce qui s’absente, c’est un croire en l’autre. Si l’absent fait marcher, la foi est ce qui conditionne l’élan du marcheur : « La foi est le fondement du mouvement du désir, la force même de la fiction qui fait marcher » (Destrempes 2005, 146).
Ainsi, dirons-nous, la théologie, dans son mouvement de rencontre de l’autre, ouvre la parole à partir du « non-lieu » d’un évidement. D’où parle-t-elle ? Il apparaît que le « vide » qu’elle traverse est ce qui rend présent l’absence : l’évidement est constitutif de l’articulation de la parole qu’elle engendre, il en offre le « non-lieu » d’où une parole peut éclore. Le rapport à l’autre passe par l’évidement, la théologie a pour tâche d’en offrir une lisibilité. L’Autre est la demeure du langage de ce qui s’absente :
Dieu s’adresse-t-il à l’être humain ? Il n’y a pas une présence divine, dirait de Certeau […], mais plutôt une « absence » entendue à vrai dire non pas comme l’opposé de la présence, […] mais plutôt comme la condition de possibilité de l’expérience croyante dont il est parlé dans ce langage mystique. Dieu est l’autre comme absent, comme non-dit qui fait néanmoins « marcher » le dire du discours mystique. Dieu est dans le langage, en tant qu’ineffable, indicible, à titre d’effets qui débordent le langage, qui pointent vers du non-langage. Le dialogue entre Lui et le « je » humain déborde inévitablement la finitude du langage humain […], mais se dévoile pourtant par les traces que le passage de l’Autre a laissées dans l’expérience dont il est parlé […].
Destrempes 2005, 147
La rencontre de l’autre s’entretient d’un tracé d’absence dans l’évidement d’un croire, pour ne pas dire que ce tracé est ce « vide » même revêtu de l’étoffe d’un croire, évidement entendu dans le sens de ce qui fait place à de l’autre, évidement, parce que cet espace est non objectivable et non représentable, il demeure sans objet et sans représentation langagière appropriée et adéquate ; il est intenable, puisqu’il se soutient du mouvement d’altérité en réponse au surgissement inédit de l’Autre. Le croire, chez Certeau, est non seulement le nouage du désir et d’un manque, il est l’expérience même du « vide », il est ce qui donne lieu aux prolégomènes d’une écriture de l’altérité, il entretient le mouvement d’un tracé d’absence menant à la rencontre de l’autre. Croire, dans le dialogue que pose Destrempes avec Certeau, c’est la réponse d’un sujet de désir dans le tracé de son manque, c’est le contraire d’une appropriation, d’une possession ou d’une saisie. Le croire est béance, il est ce qui donne corps au « vide », et c’est à cet égard essentiellement qu’il en donne un tracé d’écriture : il est ce qui donne forme au « vide » dans le vif d’un corps altéré. S’il peut y avoir altérité, c’est bien parce qu’il y a un croire en l’autre, parce qu’il y a parole à même le surgissement de l’Autre. Croire signe une différence, il est écart et n’est-il pas béance même, dirons-nous ? Sa manifestation est ce qui crée ce « vide », croire est ce « rien » faisant lien paradoxalement avec une présence d’absence, il en expérimente la lisibilité. C’est pourquoi Destrempes retiendra de M. Certeau : « Le langage mystique, dans lequel les “mots sont abandonnés par les choses”, est un langage qui à vrai dire “n’exprime pas une expérience, parce qu’il est cette expérience même” (FM, 203 ; voir aussi FM, 170) » (Destrempes 2005, 148). Le langage théologique se soutient de cette expérience d’évidement, elle n’en substitue aucunement la béance ou le « vide », elle en expérimente sa profondeur : ce qui s’absente devient l’enjeu de sa propre écriture, son socle appartient à « la faiblesse de croire ». Comment dès lors rendre lisible cette écriture d’un tracé d’absence nous menant à la rencontre de l’autre par où un croire noue un sujet de désir et un manquant ?
2. Une théologie du « samedi saint » comme écriture de l’évidement : le lieu théologique
L’Autre s’insinue comme constitutif du sujet, d’un sujet désirant. En mystique comme en théologie, l’altérité est constitutive de l’identité du sujet à même l’expérience du manque : « […] comment de “l’autre” s’insinue dans la place du soi qui parle, du “je” qui écrit, comment est-il possible de pratiquer la langue de telle façon que l’altérité se manifeste comme constitutive de l’identité du sujet humain ? » (Destrempes 2005, 151). Tout comme la mystique, le langage théologique se pose en tant qu’acte d’énonciation, expérimentant la rencontre sans nom de l’autre, dont un sujet affublé de la dimension du croire porte le tracé d’une corporéité atteinte par la rencontre de l’autre. L’altérité n’est pas une donnée toute faite, elle appartient à la dimension pragmatique (du langage) ; l’absence est présence, parce que de l’Autre en son surgissement en donne une lisibilité. L’acte d’énonciation consume l’altération du sujet désirant, il en tient lieu sans jamais pour autant la remplacer. L’entrelacement d’un sujet de désir dans sa marche vers l’autre, faut-il le rappeler est constitutif d’un évidement. Il ne peut y avoir d’écriture de l’autre que là où un manquant s’incorpore entre la chair et le langage, dirons-nous. L’altérité n’est pas un énoncé mais le fruit d’une rencontre en sa radicalité, elle introduit un « faire » dans la chair d’un sujet en son évidement, l’expérience d’un « je » altéré, défiguré de sa mêmeté parce que l’autre est passé. L’acte d’énonciation auquel se rattache le langage théologique est un corollaire de l’altération, elle en assume la promiscuité.
Destrempes relève que cette dimension pragmatique de l’acte d’énonciation permet à Certeau de faire un pas de plus dans sa théologie de l’altérité : « En fait, ce mouvement vers l’approche pragmatique du discours mystique va permettre à Certeau d’aller bien au-delà de sa théorie de la différence […] » (Destrempes 2005, 152). Les figures de l’altérité constituent l’autre que le système exclut ; Destrempes reprenant Certeau : « […] “qu’est-ce qui reste de la parole sans laquelle il n’y a pas de foi ? ” (FM, 9 et 23). La réponse à cette question se lie partout dans l’oeuvre de Michel de Certeau : “quelque chose d’autre parle encore […]. Le sauvage, le fou, l’enfant (IQ, 230 ou FM, 24) » (Destrempes 2005, 153). Un irréductible se marquant de présence d’absence, voie du désir et chemin vers l’autre donne corps à l’infranchissable d’une différence, et conséquemment, s’en exclure c’est s’abstenir de toute Parole et, en ce sens, c’est être voué à la mort, le chemin de l’altérité est à ce prix. Cette référence ici à l’expérience mystique du xvie-xviie siècle illustre pour notre propos que l’infranchissable d’un « vide » opère un retour dans l’insondable de l’expérience du croire : croire, c’est l’écart où un manquant devient présence, croire, c’est avancer malgré l’absence dévorante et ne jamais cesser de marcher au-delà de l’absence, l’autre passe mais il fait retour dans le creuset du manque. Prendre le chemin de la rencontre de l’autre, c’est s’en remettre à l’autre, c’est croire en lui, c’est s’abandonner. Croire, c’est poser un acte relationnel :
Refuser que le croire soit réduit à un savoir, c’est maintenir la place de l’autre. […] Le croire constitue la marque de la dépossession, c’est-à-dire de l’impossibilité de la maîtrise totale, ne serait-ce que celle du savoir, […] Le croire dit alors qu’il y a de l’autre et qu’il y a du sens.
Royannais 2003, 510
Le croire est ce qui supporte la fiction d’une présence/absence. Croire, c’est porter l’absence pour entendre la parole de ce qui ne peut plus s’entendre parce qu’il n’y a plus de corps (social ou mortel) pour le recevoir en son évidement, puisqu’il « […] “est devenu l’autre ‘refoulé’ par le système […] il est d’autant moins introduit dans le langage comme un objet qu’il est plus exclu de la cité comme sujet” (FC, 202-203) » (Destrempes 2005, 153).
Cet autre comme absent apparaît par la trajectoire d’une lisibilité que le discours théologique peut susciter : l’acte d’énonciation (tant mystique que théologique) ne peut que restituer l’écart entre l’expérience de l’altérité et un corps institutionnel et mortel qui l’en exclut pour qu’un présent puisse poser l’altérité dans le creuset d’un ad-venir ; l’« exil », dont nous parlions, met en oeuvre le détachement nécessaire pour écrire ce qu’il en est du « passer à l ’autre » ; le chemin de l’« exil », c’est la marche matérialisant l’évidement, autrement on ne peut que se cramponner aux défilés des énoncés, là où s’est évacué non pas l’autre puisqu’il demeure dans son illisibilité mais l’altération même qui est fruit de l’énonciation. De là, l’autre s’objective en réponse à un présent qui se découpe en extrayant le rapport à l’ad-venu du manquant faisant retour dans les interstices du manque. L’autre s’insinue par les voies insondables d’une présence/d’absence, et, pour de Certeau, entre l’historien et le théologien la question de l’écart soutient leurs discours distinctifs, le « penser » l’autre c’est à chaque fois « passer à l’autre » pour autant que chacun ne puisse faire l’économie de ce que le sujet Robinson éprouve de l’évidement d’un tracé en son sillon :
Tel Robinson Crusoé sur la grève sur son Île, devant « le vestige d’un pied nu empreint sur le sable », l’historien parcourt les bords de son présent ; il visite ces plages où l’autre apparaît seulement comme trace de ce qui a passé. Il y installe son industrie. À partir d’empreintes définitivement muettes (ce qui a passé ne reviendra plus, et la voix est à jamais perdue), se fabrique une littérature : elle construit une mise en scène de l’opération qui confronte l’intelligible à cette perte. Ainsi se produit le discours qu’organise une présence manquante.
Certeau 1973, 8-9
De cet absent, se laissant en quelque sorte entrevoir par son retour inattendu, d’où un sujet de désir marqué du sceau de l’altérité en ressasse le parcours. Ainsi, qu’un manquant fasse retour, agite l’insondable de ce qui se répète d’un passé dans l’ici/maintenant d’un présent cherchant à se dire en offre le contour d’une ressaisie, puisque le manquant demeure en tant que présence/d’absence. Ce parcours nous amène à construire un parallèle avec ce que Destrempes introduit en qualifiant la théologie certalienne, de « théologie du samedi saint » (Destrempes 2005, 154). Qu’est-ce à dire ? L’article de Destrempes porte sur la dimension mystique des analyses certaliennes. Un sans objet ouvre à la parole créatrice, inédite, le corps s’absente mais l’Autre de la parole demeure : « Le tombeau vide est la possibilité de la vérification qui se déploie dans l’ère de la parole et de l’Esprit […]. Mais le fondateur disparaît, impossible à saisir et à “retenir”, à mesure qu’il prend corps et sens dans une pluralité d’expériences et d’opérations “chrétiennes” (FC, 213) » (Destrempes 2005, 155). Une expérience de la perte est fondatrice d’altération, c’est-à-dire d’une vie nouvelle. Ce qui s’absente, un évidement, pouvons-nous dire, engendre l’inédit de l’autre, une disparition est ce qui peut faire naître un tracé d’écriture. Un tracé d’évidement maintient l’écart, entretient la marche vers la rencontre ; l’écart est tout à la fois l’insaisissable du corps de l’autre et ce qui l’autorise. Ce qui signifie que le « vide » est réceptacle de l’altérité. Croire en l’autre procède d’une coupure, exige de sortir de son lieu, il appartient au chemin d’« exil », inaugure un déplacement et le propre de l’évidement se constitue sans appropriation, la coupure ne peut être qu’un acte de conversion : « Car “croire, c’est ‘venir’ ou ‘suivre’ […], sortir de son lieu, être désarmé par cet exil hors de l’identité […] pour être livré à la voix de l’autre” (FC, 302) » (Destrempes 2006, 45).
Une absence fait figure d’altérité… elle porte les traits d’une présence de l’autre. Croire, croire en l’autre et à ce que de l’Autre se signifiant, n’est ni de l’ordre d’une possession ni d’une certitude, et ce n’est pas non plus répondre à une donnée préétablie, c’est un acte qui se soutient d’un infranchissable écart, en l’inouï de l’évidement d’un corps mortel et d’un Ressuscité. L’autre passe, l’Autre parle… Le tombeau, en la chair qui s’absente, crée un « vide » pour que s’ouvre la Parole de l’Autre à même l’étoffe d’un Suaire froissée et ensanglantée signant une présence d’absence. Ainsi la rencontre n’est pas vaine pour autant, elle déterre une écriture participant d’un futur antérieur, comme le tracé sur la plage de l’Île du Robinson… pour celui-ci dans le « hors temps » d’un Vendredi qu’une fiction entravée en suspens l’oubli, et pour l’Autre, dans le « non-lieu » d’un tombeau évidé à l’affût de l’aube pour que naisse une Écriture en l’écueil d’un Samedi saint…
3. L’entre-deux d’un parcours : lorsque la théologie se fait écriture[9] de l’altérité
Tout se passe aussi comme si l’écriture tenait du Temps la double caractéristique de perdre le lieu (c’est un exil) et de dévorer la vie (c’est un cannibalisme). Comme si c’était la marche (interminable) et la faim (insatiable) d’un corps de la Lettre (Certeau 1987a, 138).
La théologie certalienne est une écriture de l’altérité parce qu’elle met en oeuvre un mouvement incessant de rencontre de l’autre ; un manque, un désir, une quête conditionnent sa structure. Le chemin de l’altérité est un chemin sans assurance, d’incertitudes et de doutes, il est non conforme, sans direction pré-établie puisqu’il transige avec l’inédit et l’inattendu, voire ce que le manque opère chez le sujet désirant ; l’autre est ce qui ne s’atteint pas mais qui m’est nécessaire pour vivre : mouvement incessant vers la rencontre et tout autant ce qui se reçoit de cette rencontre, l’autre altère. L’expérience demeure une béance sans possibilité de l’assouvir, c’est-à-dire de la suturer, l’« insatiable » demeure « interminable », parce que le manque est porteur de la quête au sein du creuset d’un désir, en théologie certalienne la foi est posée comme feu dévorant dont le sujet théologien ne peut s’épargner :
En théologie, on ne peut comprendre ni la foi, ni l’intelligence sans tenir compte de ce qui les noue l’une à l’autre, la quête. […] S’il y a quête, c’est qu’elle se trouve soutenue par le manque et que ce manque inscrit la quête comme une trajectoire de désir. La quête nous renvoie à la question de la foi […], une question non seulement théologique […] mais foncièrement anthropologique, mettant en cause l’humain dans ce qui le constitue comme humain.
Lemieux 1999, 17-18 et 21
Si la théologie est à mettre en rapport avec ce désir de rencontre, le sujet théologien ne peut de son côté faire fi de sa propre démarche, ce qui alimente sa propre quête, du mouvement qui oriente sa marche et soutient son élan, son désir, c’est-à-dire son manque : « Le théologien […] parle de ce qui lui échappe et dont il sait ne pouvoir parler adéquatement. Autrement dit, il est aux prises avec l’impuissance. L’échec est son pain quotidien, la condition même de son existence. […] Le théologien […] : quelque chose d’autre le fait parler » (Lemieux 1999, 13).
Raymond Lemieux nous apprend à soutenir le travail théologique dans le rapport au manque, lieu d’un « non-lieu », pour reprendre notre propos plus avant où un sujet se révèle. L’irruption de l’Autre est ce qui fait entaille au sujet au creuset de son manque. La théologie entretient un acte d’énonciation en regard de l’autre parce qu’il y a l’Autre, et par cet acte d’énonciation le sujet théologien se construit et se révèle sujet désirant. L’acte théologique n’est pas étranger à la faiblesse de croire, il s’agit d’un
sujet marqué par l’Autre [effectuant] un travail d’intelligence qui consiste à questionner, dans la recherche et l’amour mais aussi dans la plainte et le gémissement, ces événements de langage qui représentent les irruptions de l’Autre dans son histoire personnelle et dans l’histoire collective d’où il se constitue comme sujet.
Lemieux 1999, 31-32
Le théologien se fait lecteur de ce que l’Autre se donne à entendre, à Révéler et à lire dans l’histoire et l’histoire singulière d’un sujet désirant et d’une culture particulière ; le théologien se met en marche, s’attarde aux chemins de traverses, est attentif aux discontinuités, et aux différents parcours des tracés d’altérité qu’il repère (tradition, transmission, les quêtes de sens inséparables d’une anthropologie de la question du croire…), mais il devient à son tour écriture de cet Autre à partir du présent de son questionnement et de sa mise en route, de sa propre quête. Avec la démarche certalienne, faire de la théologie est « l’acte d’un sujet qui par là se risque à exister » (Lemieux 2002, 222). Le « non-lieu », l’« exil », l’« évidement » à même l’acte de croire appartiennent au sujet désirant en quête d’existence, c’est-à-dire de rencontre vers l’autre.
L’histoire de la théologie, c’est aussi l’histoire de la Révélation. Chacune appartient à ce mouvement du rapport à l’autre et au surgissement de l’Autre, et ce mouvement porte le « non-lieu » d’une béance. Ce qui se révèle pour chacune, c’est un chemin d’altération. La Révélation peut-elle même avoir un « lieu », osons-nous questionner ? S’il en est un, il ne peut tenir que par l’épreuve d’altération d’un singulier. Le « non-lieu » est le nom d’un singulier marqué par le manque et l’ouvrant à marcher à la rencontre de l’autre. Le « non-lieu » indique un écart où peut s’indiquer une Révélation, ce « non-lieu » n’a pas de propriétaire fixe mais que des locateurs itinérants s’engageant dans un mouvement de dépouillement et de responsabilité en regard de l’impromptu de la rencontre. L’Autre de la Révélation à même le « non-lieu » du manque se signifiant échappe à toute tentative d’appropriation que pourrait entretenir l’articulation théologique ; l’Autre ne peut se recevoir que par une non-maîtrise, la théologie ne peut en offrir qu’une écriture singulière et à la fois universelle dans le sens qu’elle s’offre à l’« exil » du tout-venant, parce qu’il y a bien de l’autre en quête d’existence :
Ce lieu de la Révélation, lieu donné à l’Autre, est une utopie. Entendons ce terme dans son sens premier : outopos, la terre de nulle part et pour cela, la terre idéale, désirable mais non réalisable ici-bas. Le mot n’a rien de péjoratif. Bien au contraire, il indique une dynamique de vie, il implique un travail, un effort pour parvenir ailleurs, dans un pays qui reste toujours à atteindre et qui, n’appartenant à personne, appartiendrait à tous.
Lemieux 1999, 12
Ainsi, la théologie ne peut être absorbée par une construction conceptuelle, elle n’est pas un discours sur Dieu mais une invocation, une adresse que le croyant formule à Dieu, il s’agit de l’expression de sa foi. La faiblesse de croire, ce n’est pas une incapacité du croyant dans son mouvement vers l’autre ni une décrépitude, mais il s’agit plutôt de son élan même qui le porte vers l’autre par l’accueil d’une non-maîtrise : non pas « considérer la faiblesse comme une déchéance alors qu’elle est ce à partir de quoi il peut exister » (Royannais 2003, 517, n. 47).
À la limite, la théologie dans l’axe certalien ne comporte pas d’objet, dirons-nous, l’irruption de l’Autre en son irréductibilité « est de l’ordre de ce qui parle en l’homme quand il répond de ce qui lui arrive, la parole » (Lemieux 2002, 227). Dans l’Autre, il est parlé de lui, c’est-à-dire du sujet désirant au coeur de son propre manque, l’irréductibilité de l’Autre le concerne en sa vérité. L’Autre n’est pas un objet ni de satisfaction ni de savoir, il invite au mouvement en la parole de l’Autre d’où il s’insinue, il est de connivence avec le désir et manie l’écart, il laisse pour trait le tracé d’une béance, d’un vide, là où il est possible de faire place à de l’autre, lieu d’un « non-lieu » d’où le sujet apparaît en sa vérité, c’est-à-dire qu’il se reçoit comme sujet altéré, ayant reconnu l’« exil » qui le porte en sa différence.
L’ouverture à l’inédit de l’Autre instaure une posture d’itinérance pour chaque sujet entretenant une (dé)-marche théologique, car « [p]our survivre, il doit continuer de marcher et trouver sa subsistance au hasard de ce qu’offre la route » (Lemieux 2004, 13) ; mieux encore, l’ouverture exige un décentrement de soi-même, « de passer d’une position égocentrique à une position épistémique » (Lemieux 2004, 16), l’autre entretient sa propre subsistance, l’alimente, le dévore…, il lui est nécessaire. Pour le recevoir et se recevoir tout à la fois de l’autre, pour le reconnaître comme autre, il « doit alors admettre l’impossibilité, voire l’imposture de toute démarche réductrice » (Lemieux 2004, 15). Le décentrement de soi implique qu’il n’y a pas de panoptique du savoir, le nouvel épistémè est de l’ordre du manque, il appartient à la faiblesse de croire bien plus qu’à une stature d’érudition. Cela exige du travail théologique un déplacement d’ordre épistémologique, une non-appropriation de l’autre cède au passage d’une approche unidimensionnelle à une approche multidisciplinaire : « L’enjeu de la multidisciplinarité s’avère donc moins la constitution d’une position de force qu’un aveu de vulnérabilité, dans la conscience des limites et de la relativité des discours » (Lemieux 2004, 16). Devant la différence, on ne peut se saisir d’une maîtrise de l’Autre, ce dernier « nous laisse en mouvance, désirants, pantelants » (Lemieux 2004, 17). L’Autre dans son surgissement nous échappe mais nous est nécessaire, il est de l’ordre du désir, lequel se soutient du manque, du creuset de la béance. Ainsi, « [d]ans cette perspective, l’enjeu de penser l’Autre n’est rien de moins que le désir humain. Le désir, c’est-à-dire cette posture qui consiste à faire place à l’autre sans le réduire à un objet de satisfaction » (Lemieux 2004, 53) et, nous ajoutons, la tentation de réduire l’autre à un objet de savoir en sa vérité toute. Le chemin du désir comporte un reste, un écart, lieu d’une différence en sa vérité irréductible. Le nouvel épistémè a pour « régime de vérité[10] » une altération, un ce qui se reçoit de l’autre et transforme, fruit de la rencontre. L’altération opère une discontinuité fondatrice, l’altération est « rupture instauratrice », elle ne perpétue point un traçage, un alignement, au contraire, une continuité et son nivellement ne sont plus du ressort d’une lisibilité, la rupture exige une lecture autre parce qu’elle est devenue une écriture de l’autre. Ce « régime de vérité » s’appuie sur une posture d’accueil et d’hospitalité dans une non-appropriation, dont la théologie a pour tâche d’en devenir l’hôte et non point la gérante ou la dépositaire.
Jeremy Ahearne souligne chez Michel de Certeau cette posture en ces termes : « [Certeau] shows, moreover, how these operations of learned interpretation may themselves be subjected to forms of “alteration” » (Ahearne 1995, 91). L’acte théologique, dans ses interprétations en dialogue avec les sciences humaines, ne peut porter cette posture que de l’intérieur même de son acte théologique : la théologie interroge ce que de l’autre (l’Autre) en son absence la tenaille et le déploiement de son discours ne vient en aucun temps combler ce vide, il participe d’un non-savoir car l’autre demeure infranchissable : « The place of the interpreter emerges in Certeau’s writing as precarious, fleeting and finite. His apprehension of the other which he aspires to undertstand is both given to him and taken away by a larger Other which, precisely, can never be apprehended as such » (Ahearne 1995, 10).
La posture elle-même fait oeuvre d’altération, une congruence paradoxale s’instaure entre l’« exil » et le « non-lieu », c’est-à-dire entre le manque qui met en mouvement et le désir qui entretient la quête. Notre rapport à l’autre ne peut se révéler que par l’émergence d’une altération de nos interprétations, de l’Autre s’insinue en notre rapport à la parole. Cette nouvelle épistémè se marque du « pas tout », c’est -à-dire du manque, car on ne peut tout dire sur l’autre ; le « pas tout » ouvre à une disponibilité, l’accueil demeure patience, fragilité et constitutive de la « rupture instauratrice ». La posture se noue avec l’épreuve du manque, entretenant un rapport de non-appropriation dont nos interprétations théologiques se marquent de cette (im)posture. « Par conséquent, si la parole ne veut ni masquer le manque, ni détourner le regard du manque, c’est qu’elle vient signaler le manque, permettant, par l’ordre symbolique du langage qu’elle instaure, de vivre dans la pauvreté du manque » (Fortin 2005, 12). Le « régime de vérité » est à poser à même le mouvement de la rencontre, ce régime n’est ni totalitaire ni englobant, le « pas tout » transige avec le reste et l’incomplétude. La relation peut prendre forme mais la mise en rapport avec le sujet désirant et l’Autre entretient un reste, puisque le rapport altérité/altération introduit essentiellement à la différence, laquelle prend l’inscription d’une béance. Ainsi par distinction du quotient qui équivaut au résultat d’une division pouvant en redonner le rapport, lequel équivaut pour nous à la reconstitution originelle de l’un et de l’autre de la rencontre, comme si le partage des éléments en leur division pouvait une fois rassemblée en redonner l’unité. L’altérité fait figure du dividende en son reste, le « pas tout » indique bien qu’il ne peut y avoir de correspondance univoque, la rencontre est relation, elle ne signe pas un rapport de coïncidence ni le définitif d’une mise en rapport. La rencontre fait entaille, elle s’entretient d’une altération et non point d’une équivalence, elle est irréductible. L’Autre de la théologie se construit par la mise en discours, par ce que de l’Autre opère par le langage et, à la manière de Magritte, nous dirons que le « Dieu » de la théologie n’est pas Dieu. L’autre demeure tributaire de la marche inassouvie en tant que sujet de désir dans la béance du surgissement de l’Autre, le mouvement vers sa rencontre est sans fin, mettre un terme à la marche, c’est réduire l’autre à un rapport au signifié et taire la voix de l’Autre : « quand on fait des mots porteurs de cette expérience la réalité même de celle-ci » (Lemieux 1999, 12).
Comment peut-on alors écrire cette relation, ce mouvement vers l’autre lequel ne peut s’entretenir d’aucun rapport de correspondance ou de réciprocité ? Lorsque la théologie se fait écriture, posions-nous, et précisément comme écriture de l’altérité avec Certeau : « Penser […], c’est passer », « c’est passer à l’autre », c’est passer de signifiant en signifiant[11], dirons-nous, là où un sujet désirant peut ad-venir, là où l’écriture théologique prend le risque d’une énonciation : « Elle est écrit en tant que lieu de lecture, confrontant le sujet à l’écriture d’un Autre dont le désir lui échappe, et écriture confrontant le sujet à son propre désir, le faisant advenir dans un risque pris avec l’Autre » (Lemieux 2004, 56). L’écriture théologique porte en elle-même le désir théologique dans sa démarche de rencontre de l’autre d’où un Autre se reçoit, se lit (l’acte de lecture) et se lie (l’acte d’écriture). Laissons la théologienne Anne Fortin exprimer le propre de son écriture dans la singularité d’une rencontre comme acte théologique : « […] une description du chemin creusé dans la vie par la parole lue » (Fortin 2005, 21). Ainsi, la rencontre c’est aussi la rencontre du sujet et du langage où de l’Autre s’insinue. Le « régime de vérité » ne peut que s’y entretenir : le sujet désirant, tenaillé par le manque… tel est son chemin de traverse dans sa rencontre de l’Autre qui le constitue comme sujet autre.
Écouter, entendre, lire, puis écrire, tel est le travail théologique… Quelque chose d’un parcours s’inscrit chez le sujet lecteur, quelque chose d’autre de soi-même apparaît, le transforme, le fait autre. Lire, c’est sortir de notre fixation identitaire : « […] traversée qu’il fait faire à chaque lecteur pour qu’il arrive sur l’autre rive de lui-même, là où il peut re-connaître que le parcours de la parole l’a révélé à lui-même, l’a révélé être autre que ce qu’il croyait être » (Fortin 2005, 38). L’acte de lecture introduit une soustraction à soi-même, un céder le passage à l’irruption de l’Autre qui se glisse dans les coulisses de l’entendre et de l’écoute. L’écart demeure en ce « non- lieu » du manque, lequel ne peut être captif, ni se clore par addition ou compilation d’un plus de savoir ; au contraire, le reste est structure d’ouverture, il indique en soustraction l’en trop de l’assurance de nos savoirs (théologiques), ainsi l’acte théologique réintroduit l’« exil » et le « non-lieu » dans leur mouvement d’itinérance, dirons-nous.
La parole intervient en une chair qui se croit remplie d’évidences vient soustraire ce corps à cette croyance. Le sens que le corps croit posséder lui est retiré dans la distance introduite par une parole qui vient d’ailleurs et qui mène ailleurs. […] La loi de la soustraction se révèle ainsi être le chemin de la parole.
Fortin 2005, 38-39, souligné dans le texte
Accueillir l’Autre exige une soustraction à soi-même, en être évidé non pas pour disparaître ni pour s’effacer, mais se soustraire pour que s’inscrive le reste d’un manque, condition de la rencontre et d’une écriture : l’écart qu’il insinue, le creuset constitue le vide nécessaire pour que s’éveille à nouveau dans sa forme inédite l’écoute, l’entendre, la lecture et l’écriture. La soustraction est condition du surgissement de l’Autre, et introduit la Parole autre en son tracé d’écriture.
« Dans cette perspective, l’enjeu de penser l’Autre n’est rien de moins que le désir humain. Le désir, c’est-à-dire, cette posture qui consiste à faire place à l’autre sans le réduire à un objet de satisfaction […] » (Lemieux 2004, 53). L’écriture théologique loge dans cet écart entre l’autre et l’Autre ce dernier pouvant se formuler en termes de désir d’Autre : « Fondamentalement, cet “écart” […] est plutôt de l’ordre de l’excès et de l’ouverture. C’est une pure dépense. Elle est déraison, parce qu’elle n’est pas rentabilisable. Départ et surcroît, geste “poétique” d’ouvrir l’espace, de passer la frontière, de jeter par la fenêtre, de risquer plus : un langage chrétien se paie à ce prix » (Certeau 1987b, 262). L’écriture est engagement en regard de l’Autre, elle est tout à la fois écriture d’un manque et d’une quête dépossédée de l’ordre du vrai en adéquation, le mouvement de la rencontre est assujetti au désir d’Autre, il appartient bien davantage à la véracité d’autant qu’il est quête mais aussi épreuve. L’altération est ce qui supporte l’écriture théologique, cette dernière est rencontre de la chair et du langage, dont l’écriture est ce tracé du « passer à l’autre », elle ne s’identifie pas à l’autre de la rencontre mais elle en écrit une lisibilité, elle le révèle et le trahit tout à la fois, l’autre est passé, il demeure absence, de par l’Autre une écriture de l’absence s’offre : L’Autre « guide ce sujet [théologien, théologienne] dans les méandres de cette nuit de l’esprit où toute croyance touche à sa vanité, mais qui rend le coeur et son corps aptes à l’expérience de la rencontre, si d’aventure quelque autre s’avise de s’y présenter… là précisément où brûle, au-delà de tout masque, le visage même de l’absence » (Apollon 2004, 156).
Le théologien cherche l’Autre où il ne peut le trouver, c’est-à-dire le saisir, le capturer. Il se trouve ainsi sans cesse convié au (difficile) passage de la « capitalisation de son savoir » à la « mobilisation de son désir ». L’Autre manque — dans tous les sens du terme — au théologien ; c’est pourquoi celui-ci parle (et ne peut parler que) du lieu de son désir : […]. »
Nault 2004, 129-130
Si « [l]e lecteur ne sort jamais indemne de l’acte de lecture » (Fortin 2005, 289), c’est bien parce que les chemins de traverses de son « exil » ont rencontré l’écriture de son désir d’Autre, où l’altération en la rencontre de l’autre opère, signifiant d’un « non-lieu » du sujet dans le mouvement embrasant de son désir.
Conclusion
De ce parcours auprès de quelques commentateurs sur la question de la théologie de l’altérité chez Michel de Certeau, nous en avons retenu le mouvement, quelque chose de la mise en route vers l’autre, pourrait-on dire, s’en pour autant entrer de l’intérieur de leur démarche singulière que ces auteurs entretiennent avec l’oeuvre certalienne, encore moins de certaines prises de position critique à son égard. Nous nous sommes tenue d’au plus près de cette mise en mouvement, ce qu’elle peut suggérer comme lecture et écriture de l’altérité. Leur langage qualifiant le mouvement certalien a retenu davantage notre attention. Nous avons choisi cette démarche pour nous introduire plus particulièrement à l’écriture certalienne sur la théologie de l’altérité. Suite à ce parcours, nous en concluons que l’altération est ce qui donne corps à l’écriture d’un mouvement singulier et non-appropriable dans sa fermeture, il révèle la marche incessante et ouverte d’un sujet désirant se recevant de la parole de l’Autre, et pourtant, l’autre « ne cesse pas de ne pas s’écrire » (Lacan 1975, 132), quelque chose d’un impossible à dire maintient le mouvement de la rencontre de l’autre en l’Autre.
Appendices
Annexe
Abréviations
FC : La faiblesse de croire
FM : La fable mystique, tome 1, XVIe – XVIIe siècle
HPSF : Histoire et psychanalyse entre science et fiction
IQ : L’invention du quotidien, tome I : Arts de faire
Note biographique
Lucie Hervieux est auxiliaire d’enseignement en philosophie et en théologie à l’Université de Montréal.
Notes
-
[1]
Je tiens à remercier bien sincèrement Mme Denise Couture, professeure titulaire à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal pour sa disponibilité, son accompagnement, ses remarques judicieuses et pour ses encouragements bienveillants tout au long de ce parcours, qu’autrement, cette démarche n’aurait pu prendre son élan.
-
[2]
Tel qu’indiqué à la note 2 de la première partie : Pour une articulation des concepts d’autre et d’Autre, nous nous référons (1) à Lemieux (2004, 62, n. 5) : « Quand nous écrivons l’autre en italique et avec un petit a, c’est précisément pour distinguer cette concrétude, instance de la singularité, de l’Autre (majuscule sans italiques), instance de l’universel et condition logique de possibilité de la première. Nous introduisons ainsi une distinction qui ne s’entend pas mais qui peut s’écrire. »
-
[3]
Tel qu’indiqué à la note 2 de la première partie, également, pour une articulation des concepts d’autre et d’Autre, nous nous référons (2) à Lacan (1973, 228) : « L’Autre est le lieu où se situe la chaîne du signifiant qui commande tout ce qui va pouvoir se présentifier du sujet, c’est le champ de ce vivant où le sujet a à apparaître. » Et dans Lacan (1966, 284) : « Quel est donc cet autre à qui je suis plus attaché qu’à moi, puisqu’au sein le plus assenti de mon identité à moi-même, c’est lui qui m’agite ? Si j’ai dit que l’inconscient est le discours de l’Autre avec un grand A, c’est pour indiquer l’au-delà où se noue la reconnaissance du désir au désir de reconnaissance. Autrement dit cet autre est l’Autre qu’invoque même mon mensonge pour garant de la vérité dans laquelle il subsiste. »
-
[4]
Tel qu’indiqué à la note 11 de la première partie : On peut souligner ici l’apport de la psychanalyse lacanienne à la question de l’altérité chez Certeau. Cela nous permet de poser que le mouvement de rencontre déplié en termes de « non-lieu » et d’« exil », termes empruntés à Geffré et Moingt, terminologie constituant pour notre propos des opérateurs conceptuels pour la question de l’altérité chez Certeau dans son mouvement d’aliénation/séparation. Lacan nous indique que l’aliénation est « la première opération essentielle où se fonde le sujet. […] Le vel de l’aliénation se définit d’un choix dont les propriétés dépendent de ceci, qu’il y a, dans la réunion, un élément qui comporte que, quel que soit le choix qui s’opère, il en résulte un ni l’un, ni l’autre » (Lacan 1973, 234 et 236). En un second temps, la séparation, « [c]est là que rampe, c’est là que glisse, c’est là que fuit, tel le furet, ce que nous appelons le désir. Le désir de l’Autre est appréhendé par le sujet dans ce qui ne colle pas, dans les manques du discours de l’Autre » (Lacan 1973, 239). Nous y ajoutons simplement que la « rupture instauratrice » chez Certeau n’est pas étrangère à la rencontre du sujet et de l’Autre, il n’y a pas à choisir entre le sujet et l’Autre puisque la dialectique de la rencontre est le fruit du rapport au signifiant et non pas du signifié : « un signifiant est ce qu’il représente le sujet pour un autre signifiant » (Lacan 1973, 232). Le discours théologique chez Certeau rend compte d’un acte d’énonciation, par distinction de l’énoncé qui abrite plutôt la rencontre des mots et des choses et le signifie ; chez Certeau, l’acte d’énonciation répond d’un surgissement de l’Autre dans la marche du sujet marqué par un désir d’autre. Il ne s’agit ni du « dit » ni de l’« objet » proprement, mais de l’acte d’énonciation qui opère un ni l’un ni l’autre se recevant de l’ordre du signifiant et non point du signifié ; l’écart, c’est le « non-lieu » de la rencontre d’un sujet en « exil » de sa maîtrise.
-
[5]
La question du croire chez Certeau introduit d’emblée le croire dans le mouvement du désir. Le langage mystique en déploie l’entrelacement.
-
[6]
L’impossibilité dont il est question ici n’est d’aucun rapport avec un « ce qui n’est pas possible », dirons-nous, mais c’est de cette absence même que se crée la relation ; l’impossibilité est ce qui du Réel donne corps à la relation. On peut reprendre la définition du Réel en terme lacanien : « Selon J. Lacan, le [R]éel ne se définit que par rapport au symbolique et à l’imaginaire. Le symbolique l’a expulsé de la réalité. Il n’est pas cette réalité ordonnée par le symbolique, appelée par la philosophie “représentation du monde extérieur”. Mais il revient dans la réalité à une place où le sujet ne le rencontre pas, sinon sous la forme d’une rencontre qui réveille le sujet de son état ordinaire. Défini comme l’impossible, il est ce qui ne peut être complètement symbolisé dans la parole ou l’écriture et, par conséquent, ne cesse pas de ne pas s’écrire » (Chemama et Vandermersch 1998, 359-360), voir aussi Lacan (1975, 132).
-
[7]
Nous esquissons ici brièvement quelques paramètres sur la question du croire chez Certeau pour dégager comment se construit le rapport à l’autre en tant que nécessaire et manquant.
-
[8]
L’expression « se marquer de sa trace » que nous introduisons à notre parcours signifie pour nous qu’il y a un rapport altérité/altération qui se construit à même le rapport au manque.
-
[9]
« Écriture » est à mettre en lien avec le mouvement de la rencontre s’ouvrant à l’altérité.
-
[10]
« Régime de vérité » est entendu dans son sens foucaldien que nous exprimons en nos termes : un procès social, institutionalisé, symbolisé construisant un rapport à la vérité.
-
[11]
« Un signifiant, c’est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant » (Lacan 1973, 176).
Bibliographie
- Ahearne, J. (1995), Michel de Certeau. Interpretation and its Other, Stanford, Stanford University Press.
- Apollon, W. (2004), « La question de l’autre aujourd’hui », dans A. Fortin et F. Nault, dir., Dire l’impensable, l’Autre. Pérégrinations avec Raymond Lemieux, Montréal, Médiaspaul (Notre Temps 58), p. 145-157.
- Certeau, M. de (1973), « Le noir soleil de Michel Foucault », dans L’absent de l’histoire, Paris, Repères / Mame, p. 115-132.
- Certeau, M. (1982) « Figures du sauvage », dans La fable mystique, tome I : xvi-xviie siècle Paris, Gallimard (Tel 115), p. 280-405.
- Certeau, M. (1987a), « Le rire de Michel Foucault », dans Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Paris, Gallimard (Folio/Essais 116), p. 51-65.
- Certeau, M. (1987b), La faiblesse de croire, Paris, Seuil (Esprit/Seuil).
- Chemama, R. et B. Vandermersch (1998), dir., Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Larousse.
- Destrempes, S. (2005), « L’altérité dans le discours mystique selon Michel de Certeau, 1 : La question de la mystique », Science et Esprit, 57/2, p. 141-157.
- Destrempes, S. (2006), « L’altérité dans le discours mystique selon Michel de Certeau, II : Conversion à l’autre », Science et Esprit, 58/1, p. 43-57.
- Fortin, A. (2005), L’annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Une théologie de la grâce et du Verbe fait chair, Montréal, Médiaspaul.
- Hervieux, L. (2017), « Une théologie de l’altérité. Michel de Certeau », Théologiques 25/1, p. 177-195.
- Lacan, J. (1966), « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud »,Écrits, tome 1, Paris, Seuil (Points/Essais 5), p. 249-289.
- Lacan, J. (1973), Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J. A. Miller, Paris, Seuil (Points/Essais 217).
- Lacan, J. (1975), Séminaire XX : Encore, texte établi et présenté par J.-A. Miller, Paris, Seuil.
- Lemieux, R. (1999), L’intelligence et le risque de croire, Théologie et sciences humaines, Montréal, Fides.
- Lemieux, R. (2002), « Théologie de l’écriture et écriture théologique. L’invention de l’Autre », Laval théologique et philosophique, 58/2, p. 221-241.
- Lemieux, R. (2004), « Penser l’Autre, enjeu des sociétés contemporaines », dans A. Fortin et F. Nault, dir., Dire l’impensable, l’Autre. Pérégrinations avec Raymond Lemieux, Montréal, Médiaspaul (Notre Temps 58), p. 13-70.
- Nault, F. (2004), « L’épistémologie de la pratique théologique de Raymond Lemieux ou “Les jeux de l’amour et du hasard”… », dans A. Fortin et F. Nault, dir., Dire l’impensable, l’Autre. Pérégrinations avec Raymond Lemieux, Montréal, Médiaspaul (Notre Temps 58), p. 117-142.
- Royannais, P. (2003), « Michel de Certeau. L’anthropologie du croire et la théologie de la faiblesse de croire », Autour de Michel de Certeau, « le marcheur blessé »,Recherches de science religieuse, 91/4, p. 499-533.

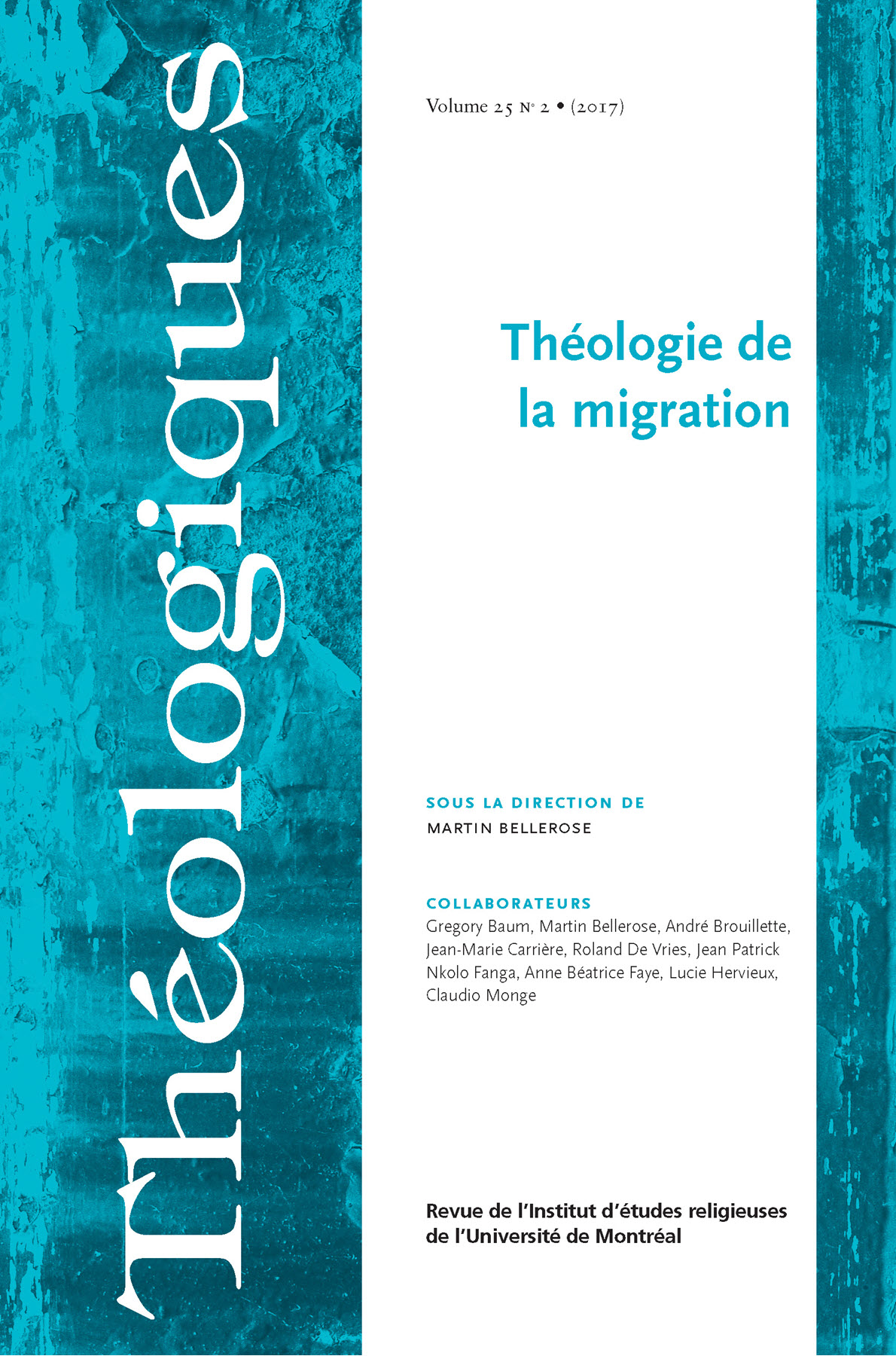
 10.7202/1055246ar
10.7202/1055246ar