Abstracts
Résumé
Trois déplacements majeurs dans la conception de la spiritualité sont présentés en vue de fournir à cet égard des repères épistémiques et historiques, relativement à la tradition philosophique occidentale et de la tradition spirituelle chrétienne. Les renversements de perspective qui s’y sont opérés définissent de façon liminaire une orientation tantôt objective, tantôt subjective, tantôt langagière (rapport sujet-objet lui-même) de la spiritualité. Des considérations tout aussi liminaires sur le corps et la danse sont proposées en conséquence. Par cette analyse, la spiritualité se voit progressivement accorder la place de principe herméneutique et le rôle de pratique herméneutique, la faisant passer d’un traitement mimétique à une approche sémiotique : d’où les effets sur la question de la danse et du corps.
Abstract
Three epistemological shifts about spirituality throughout the continental philosophical and theological tradition are exposed so to define in a summary way an objective and a subjective orientation in the conception of spirituality, then a subject-object relation in language. Considerations on dance and body follow consequently. When spirituality is given the place of a hermeneutical principle and the role of a hermeneutical practice, it leads us from mimetic to semiotic reflections about it and about dance and the body.
Article body
Il peut être utile d’examiner le rapport dynamique entre la danse et la spiritualité pour montrer comment l’une influence ou détermine l’autre. Les projets en ce sens méritent intérêt à plus d’un titre. Mon propos n’a toutefois pas la prétention d’engager le genre d’analyse psychologique, historique ou sociale requis pour atteindre cet objectif. Il se limitera à indiquer, comme lorsqu’on pointe du doigt du haut d’une montagne vers quelque chose au loin, en quoi la façon même de concevoir la spiritualité situe éventuellement la façon de concevoir la danse à la ligne d’horizon où on l’aperçoit alors. Je présenterai essentiellement des considérations d’ordre épistémologique quant à la spiritualité, à partir desquelles commencer à éclairer un lien possible avec la danse et laissant donc à d’autres, plus férus en matière d’art et de danse, le soin d’en déterminer les éléments précis. Je le redis : ma réflexion vise à constituer un regard sur certaines conditions pour penser la spiritualité — c’est là mon lieu d’analyse et mon expertise — afin de faciliter la reconnaissance des certaines configurations possibles de la danse, ce que j’initie sans (pouvoir) le parachever.
Je regroupe mes considérations sur la spiritualité selon trois ensembles de conditions épistémiques. Je signale ensuite en quoi la tradition philosophique (occidentale) puis la tradition spirituelle chrétienne reflètent et assument chacune à leur façon ces conditions ; cette façon d’aborder la spiritualité, simple option pour un propos différent, vise à ne pas en rester à l’évidence commune actuelle selon laquelle la spiritualité est une dimension de la personne ou concerne toute la personne — car au risque de le répéter, je souhaite montrer ce qui se trouve derrière une certaine vision de la spiritualité, en termes d’horizons et de tournure épistémiques ou (si l’on préfère) en termes de « pièces » et de « mécanismes » épistémiques. L’éclairage finalement offert sur la danse l’est à titre indicatif, comme pour se situer globalement selon tel ou tel horizon possible de la danse — sans prétendre fournir des définitions arrêtées de la danse ou des fils conducteurs sur le sujet.
1. Spiritualité vs matérialité
Une première perspective épistémologique consiste à concevoir la spiritualité en stricte opposition à la matérialité. Les deux notions fonctionnent alors comme des contraires nettement différenciés. Elles renvoient à deux ensembles de réalités et ces ensembles sont parfaitement séparés.
De façon générale, ce départage ressortit de ce que le réel l’est pareillement, tranché par le visible et l’invisible, par l’ordre physique et l’ordre spirituel, par le sensible et l’intelligible. Le « poids du réel » réside dans l’un ou bien l’autre « compartiment » et la connaissance sera à la remorque de cette division. En effet, le réel se dessinera sur arrière-fond spirituel dit « méta-physique », sinon sur arrière-fond de matérialité dit physique, et c’est d’un côté ou bien de l’autre que résidera le véritable et plein fondement du réel. La matérialité sera généralement repoussée comme illusoire et erronée lorsque le lieu ultime de la vérité est l’ordre spirituel et celui-ci fonctionnera du coup tel un fonds où les choses spirituelles ont, comme le reste, chacune leur place et leur rôle propres. Inversement mais de manière assez semblable, tout ce qui est spirituel sera traité comme pur imaginaire et factice lorsque la matérialité prendra le relais ultime de la vérité, les choses empiriques composant seules ce fonds bien organisé.
Dans ces perspectives, un ordre spirituel totalement constitué peut fonctionner de manière semblable à un ordre matériel lui aussi d’emblée constitué. On a alors affaire à des « mises en ordre » achevées, ce qui ne signifie pas qu’aucune dynamique ni qu’aucune évolution n’y ont cours mais qu’il en va d’un ordonnancement fixé et descriptible comme tel. On traite finalement une différence de nature et de degrés au sein du réel, en une hiérarchisation des êtres. On se trouve, somme toute, dans un projet fondationaliste de totalité dont l’orientation peut varier, que ce soit dans un sens (direction) spirituel ou matériel.
1.1 Horizons ou tournures épistémiques
Cette mise en opposition des notions de spiritualité et de matérialité est repérable dans notre tradition philosophique et théologique occidentale. Quelques considérations sommaires et non exhaustives quant à cette tradition permettront de l’illustrer.
Quand la philosophie grecque émerge, elle se constitue en projet de conquête de savoir sur le cosmos en vertu de l’intelligible par-delà le sensible qui s’en distingue nettement — et lui est plus ou moins opposé. Platon recherche la contemplation du monde des Idées au-delà des apparences trompeuses des réalités sensibles ; Aristote veut sauvegarder un lien avec le sensible mais son projet n’en demeure pas moins celui d’une abstraction du sensible pour réaliser un projet « méta-physique » ; avec Thomas d’Aquin, aussi bien, le giron de l’être assure la primauté des essences (substances) sur le reste, à travers une organisation systématique définie des réalités, quelles qu’elles soient et de quelque ordre qu’elles soient. La connaissance du réel joue par conséquent selon ces deux plans distincts, en fonction d’une vérité-correspondance entendue comme adéquation de l’intelligence aux choses ; tour à tour, le vrai renvoie à ce qui existe puis à ce qu’en formule l’intelligence, en vertu d’une raison dont les catégories sont analogues à celles de l’être[1].
L’empirisme procède somme toute de ce même rapport entre spiritualité et matérialité, mais en le renversant. D’une certaine façon, l’empirisme inverse ni plus ni moins la métaphysique classique ; il se détourne de l’idéal philosophique à hauteur spéculative et du statut des idées et concepts dans le rationalisme, mais en reprenant certaines règles et en reproduisant certains fonctionnements logiques et autres. Cette tournure en miroir, on peut en voir l’écho dans une description de ce genre de l’empirisme :
Deux problèmes peuvent surgir lorsque l’on réfléchit à la possibilité de connaître, à savoir celui posé quant à la source de la connaissance et celui concernant sa légitimité. Contrairement au rationalisme, l’empirisme affirme que la source de toute connaissance est non pas l’esprit humain, mais bien l’action du monde extérieur [matériel] sur nous, le sujet, et que la connaissance tient sa légitimité par vérification expérimentale [rivée à une matérialité] et non pas par une démonstration rationnelle. Pensons ici à l’axiome d’Aristote qui exprime, en quelque sorte, la thèse fondamentale de l’empirisme, à savoir que « rien n’est dans l’esprit qui ne fût d’abord dans les sens », ou encore à l’idée de Locke selon laquelle « l’esprit est une page blanche vide de tout caractère », une « tabula rasa »
Deragon s.d.
Il s’avère ainsi que l’expérience quant à l’acte de connaître peut constituer, à peu de chose près, le même rapport duel au réel, pour la métaphysique et pour l’empirisme les plus « purs et durs ». Lorsque l’expérience (experimentum) représente un moment ou un espace préalable à l’acte de connaître, elle s’entend comme précondition d’essai et d’erreur, de recherche à tâtons dans une théorie spécialement prémoderne de la connaissance, qui maintient l’expérience à l’extérieur de la connaissance, avant elle ou en dessous d’elle. L’empirisme minimise, sans tout à fait l’exclure il est vrai, cet aspect de tâtonnement au profit de ce qu’on désigne par positivisme, cet envers de la médaille quant à la plus pure (ontologie dans une) métaphysique. Il en va donc, avec ces paramètres épistémologiques, d’une conformité pour refléter ou d’une certaine pertinence pour penser aussi bien un ordre spirituel extérieur et au-dessus d’un ordre matériel et totalement séparables.
Les perspectives patristiques sur l’existence chrétienne empruntent à cette opposition que l’on dit souvent reconnaître encore entre la spiritualité et la matérialité. Dans la mesure où les Pères de l’Église insistent pour parler des Mystères de la foi comme tels ou d’une doctrine divine, ils mettent en relief un ordre « méta-physique », un savoir sur Dieu lui-même et par lui révélé, qui ne procède pas du monde (matériel, physique, humain) et ne porte pas formellement sur lui — mis à part le salut qui engage l’univers. Dans la mesure, aussi, où l’on considère que les Pères de l’Église accordent un primat de l’intelligence sur la volonté, dans la contemplation des mystères cachés de la foi, on est conduit à une connaissance plus profonde, plus parfaite du fond du réel qu’est Dieu et que ne saurait être le monde matériel ou d’apparence première[2]. La tradition chrétienne exploite assurément ce monde spirituel posé aux antipodes du monde matériel et par-delà lui. À son tour, Maître Eckart en témoigne excellemment à la fin du Moyen âge, lui dont le propos a un caractère nettement spéculatif et fraye clairement avec un ordre métaphysique ontologique estimé par-dessus tout, par-delà l’ordre matériel notamment.
1.2 Danse, sacré, divinisation
Comment tout cela pourrait-il donner à penser la danse ? Quelques indications, liminaires seulement — que d’autres contributions développeront et préciseront bien mieux.
D’abord, le corps et l’esprit peuvent être considérés dans une perspective semblable, selon un rapport tel que le corps, n’étant point constitutivement spirituel, en est séparé ou séparable, et de même pour l’esprit quant au corps. Par conséquent, la danse peut apparaître comme une situation extraordinaire, presque un miracle et peut-être même un miracle contre nature, puisque le corps est alors — littéralement ou forcément — investi de ce qu’il ne peut en principe se charger ni devenir de lui-même et par lui-même. C’est en tant que possédé par l’esprit, parce qu’assiégé par ce qu’il ne saurait être, que le corps est organe de la danse ; de la même manière, un esprit « se tient en-dessous » ou au-delà de ce qui advient comme danse, tel un sujet-hypostase en cet autre côté qui n’est point corps ou matière.
On comprend ainsi que la danse puisse correspondre à une sorte d’habit pour le corps, qui l’excède par l’extérieur et produit sur lui cette étrangeté à la fois étonnante et accidentelle de la danse. Quand le matériel conçu comme le non-spirituel est lié au spirituel conçu comme le non-matériel, la danse ressemble à un difficile mariage mixte où l’un des partis — le spirituel — a des droits sur l’autre ; quand cet autre-ci y cède, pour en être traversé, pour se laisser aller et « emballer » par le spirituel, la fusion a lieu, conformément à ce qu’on croit ou ce qu’on applaudit même dans l’horizon du sacré. Là, le corps-matériel n’a pas tellement de valeur en lui-même et pour lui-même, ou il en acquiert dans la mesure où il s’emplit de sacré, de spiritualité — l’assimilation sacré et spiritualité étant alors inévitable.
L’opposition spiritualité-matérialité où la danse tranche le corps et l’esprit au moment même où elle les fusionne peut résonner aussi à travers le discours — typiquement mais non exclusivement patristique — de divinisation de l’homme. De façon plus excellente encore qu’avec le sacré, la danse est alors occasion et moyen de mimer ce qui existe au-delà du corps et se manifeste par-delà le monde matériel. La divinisation de l’homme marque en effet de quel côté le monde matériel, le corps et la danse doivent trouver leur véritable issue. C’est au profit du Transcendant, qui préside à tout, que la danse révèle la source, extérieure et combien plus majestueuse, du matériel ou du corps. Divinisation de l’homme et spiritualisation du corps vont de pair.
2. Vie spirituelle, vie intellectuelle, vie morale, vie sociale, vie biologique…
Il est aussi une perspective épistémologique selon laquelle la spiritualité est davantage conçue comme une dimension parmi d’autres du réel, avec son fonctionnement propre. La vie spirituelle, à proprement parler, fait partie de l’existence humaine. Elle constitue un univers en soi, en parallèle au monde physique ou métaphysique, du fait de se constituer en univers en nous-mêmes, c’est-à-dire à titre de vie intérieure. Aux côtés de la vie biologique, de la vie sociale, de la vie morale, de la vie intellectuelle (etc.), la vie spirituelle est un fait comme tel, un phénomène à connaître comme tel et pour tel. Elle a ses règles et comporte ses étapes ; elle se déploie en itinéraire et signale une autonomie. L’intériorité n’est pas simplement affaire de facultés particulières chez un sujet ; c’est tout un monde à part en nous. Dans ces conditions, la spiritualité peut donc être comprise en elle-même, pour elle-même et par elle-même. Que l’on fasse de la spiritualité la dimension suprême, sublime, transversale ou intégratrice n’y change pas grand-chose, contrairement à ce que l’univers des soins de santé suggère actuellement.
La conception générale du réel dont ressortit cette perspective implique pareillement des dimensions spécifiques qui se complètent sans se confondre. Ces dimensions sont distinguables et séparables, chacune opérant en son terrain propre et sans nécessaire emprunt aux autres dimensions. Chacune des dimensions du réel a son lieu propre, ses règles et son organisation propres et c’est de l’intérieur de chacune qu’il nous est possible de les exposer, de les comprendre. En outre, une véritable complexification du réel, dans son ensemble comme dans chacune de ses dimensions, a cours.
2.1 Horizons ou tournures épistémiques
Cette dimension de la spiritualité, mise en parallèle avec d’autres dimensions de l’existence et contrastant avec elle, peut être clairement quoique non exclusivement reconnu dans certains horizons de notre tradition philosophique et théologique.
Avec la modernité naissante, la philosophie tout autant que les sciences ont pareillement retourné leurs projets de connaissance et d’action sur le monde en fonction du sujet — et non plus en direction des objets tels que posés dans une ontologie, dans une métaphysique classique. En une véritable révolution copernicienne où la subjectivité devient la condition de possibilité de l’objectivité de la connaissance et de l’intervention dans le monde, l’explication des phénomènes du monde et la gestion de ce monde sont reprises à nouveaux frais. D’une part, elle procède à partir de l’instance du sujet ou, si l’on préfère, en fonction d’une rationalité opératoire et donc « désubstantialisée ». D’autre part, elle procède de « L’Expérience » (Erfahrung), une et universelle, qui fait désormais partie intégrante de l’épistémologie (théorie de la connaissance) et de la méthodologie d’une science ; c’est l’expérience qui permet de fonder notre savoir et notre agir en référence à une rationalité tenue pour déterminante comme jamais auparavant, en nous engageant dans la recherche de vérité entendue comme vérification-validation par nous et pour nous[3].
La connaissance humaine de l’univers, tout comme l’univers lui-même, se développe infiniment, lot d’une complexification sans terme définitif. L’univers philosophique/scientifique moderne est alors une construction autrement — c’est-à-dire non dans un esprit prémoderne — systématique des dimensions physique, biologique, sociale, psychologique, intellectuelle, spirituelle (etc.) du réel. L’hyperspécialisation des champs du savoir et de l’intervention en représente un aboutissement manifeste, avec toutes les difficultés d’articuler entre elles des expertises parce que s’affirme l’autonomie des spécialités, de ces savoirs, de ces dimensions du réel. Dans des conditions où règnent la multi- et la pluridisciplinarité cherchant à contrebalancer cette tendance « autonomiste » des entreprises scientifiques modernes, la vie spirituelle, en l’occurrence, se trouve à son tour normalisée. On n’hésite donc pas à la présenter et à la traiter comme une dimension particulière spécifique de la personne, comme c’est le cas en milieu de santé où on en fait une dimension des soins de santé, voire une dimension transversale aux autres dimensions et donc à sa manière intégrative dans un régime holistique[4]. Les besoins dits spirituels restent ainsi l’avatar et le réquisit d’un matérialisme méthodologique moderne, qui a certes sa part de vérité-validité.
C’est encore une perspective semblable, qui engage une dimension contrastée et autonomiste de la spiritualité, que mettent en place les grands spirituels des xvie-xviie siècles. S’émancipant du projet métaphysique et théologico-philosophique de leur époque, ils opèrent un retournement de perspective dans la tradition chrétienne en mettant de l’avant, et ce formellement, le pôle subjectif de la spiritualité[5]. Ils exposent du coup la réalité, toute autre par rapport au monde naturel, de la vie intérieure : qui tient, qui vaut, qui est valide, qui est fondée en elle-même et par elle-même. Les mystiques, ces modernes, ouvrent tout spécialement cet univers de la vie intérieure. En un premier temps, déjà avant l’époque moderne il est vrai, ils mettent en relief l’expérience, une et universelle, toujours structurée, de l’âme s’unissant à Dieu à travers des étapes purgative, illuminative, unitive. À un autre moment, à titre de maîtres spirituels typiquement modernes, ils sont non seulement des guides au coeur de l’itinéraire spirituel, mais aussi des « théologiens nouveaux » construisant cette fois une théologie de « L’Expérience » (Erfahrung) ; dans cet exercice, le donné des Écritures sert de présupposé, de cadre, de garantie, mais n’est pas lui-même pris directement en considération puisque ce sont les conditions de possibilité de la spiritualité qui sont visées (Adnès 1932, col. 1923-24)[6]. Le point est donc acquis quant à l’expérience même de transformation du sujet, en l’acheminement du sujet vers son Dieu :
Les mystiques, atteignant Dieu à travers cette passivité consentante, décrivant leur expérience propre, retraçant les étapes vécues de leur itinéraire et c’est [précisément] à travers la subjectivité de leur expérience et de leurs états intérieurs qu’on atteint l’aspect objectif de la révélation faite dans l’Écriture.
Agaesse et Sales 1932, col. 1942 ; voir Congar 1963, 16
On peut et on doit signaler une tournure plus concrète encore, plus concrètement située, de la spiritualité entendue comme dimension propre et autoréférée de l’existence humaine. La mystique (des xvie-xviie siècles) va ensuite donner lieu à des spiritualités contextuelles, nettement considérées en leurs déterminations et médiations concrètes ; c’est pourquoi chacune correspond à un style particulier de spiritualité ou à une manière de vivre — en étant plus qu’une simple façon de penser ou de philosopher. Lorsque l’« Itinéraire spirituel » cèdera le pas aux itinéraires et aux cheminements existentiels personnels, se dessineront des spiritualités ascétiques ou bien mystiques (au sens de sommets exceptionnels et extraordinaires de vie spirituelle)[7]. L’explosion des spiritualités, à laquelle nous continuons d’assister, les présente dès lors davantage comme condition concrète de réalisation (de dimensions) de la personne et non plus seulement comme condition de possibilité de « la » spiritualité (ou vie intérieure) ; une telle réorientation tient d’ailleurs d’une nouvelle conception de l’expérience (Erlebnis, le « vécu »), par laquelle la dimension spirituelle de l’humain se comprend désormais en lien avec les médiations-événements qui la constituent.
2.2 Danse, expressivité, humanisation
Dans ces conditions, qui donnent à penser la danse, celle-ci peut — par rapport aux précédentes perspectives où elle s’éclaire notamment à partir du sacré et se lie inévitablement à lui — se séculariser et s’esthétiser. Pour ce faire, il faut, d’une part, comprendre le corps comme une machine, à traiter selon différentes dimensions (biochimique, neurologique, musculaire, etc.), et une machine autonome, système de systèmes organiques. Il faut, d’autre part, comprendre les dimensions psychologique, morale, intellectuelle, proprement spirituelle, etc., comme des systèmes constitutifs de la personne, de cette instance fonctionnelle qu’est le sujet. Le corps, avec sa mécanique bien réglée pour des fonctions bien définies, peut, en outre, servir à la danse ; le corps peut être comme l’instrument d’un sujet (esprit), lui aussi déterminé (programmé) en partie du moins, pour manifester précisément l’indéterminé de sa condition de sujet. Chacun est en mesure d’élaborer quelque chose comme la danse, par quoi s’exprimer et se recréer. La danse se présente ainsi non pas tant comme surdétermination du corps, puisqu’il s’agit clairement d’indétermination possible de cette dimension corporelle en nous, mais de « délivrance » du sujet (« spirituel », au sens très large), dont c’est l’expressivité aussi bien que l’originalité qui sont mises en cause. Par son caractère sublime en particulier, qui « colle naturellement » à la danse, celle-ci est re-création de soi, intérieurement ou psychiquement ou autrement.
C’est pourquoi on danserait pour se trouver soi-même, pour advenir à soi-même. Avec la danse, spiritualisation, du corps entre autres, signifie, plus tangiblement, humanisation de soi. Nourriture de l’âme ou de l’esprit, la danse est l’occasion et la chance de se saisir (de) soi-même. En un mariage de raison aussi bien que de coeur, la vie intérieure ou spirituelle peut s’allier à la vie intellectuelle, à la vie morale mais aussi à la vie sociale, à la vie psychologique, à la vie physique, etc. ; alors éclosent des bourgeons de vie, qui ont tous leur valeur et leur intérêt propres ; mais ce qu’en révèle et exploite la danse, outre leur malléabilité, c’est notre pouvoir d’être, c’est-à-dire d’exister authentiquement et « pour-soi ». Après tout, notre humanité, transcendance en pleine immanence, manque toujours de s’exprimer, de s’exposer, de se parachever. C’est grâce à la danse (entre autres) que nous comblons ce manque ou, négativement, que nous pouvons pallier notre décréation.
3. Le spirituel-en-acte, à la racine des idées et des choses
Une autre perspective épistémique sur la spiritualité semble encore possible à dégager. Elle consiste à concevoir celle-ci de manière éminemment pratique, comme rapport d’altérité, comme geste spirituel — non pas spécialement ni typiquement mais fondamentalement ou intrinsèquement spirituel. Le spirituel-en-acte est à la racine de ce qui existe, que ce soit une idée en tant qu’elle est toujours déjà produite, une chose en tant que son usage la définit pragmatiquement, une activité en tant qu’elle accomplit une (inter)subjectivité… Ce « spirituel » ne représente donc pas, comme tel, une dimension de la personne ou un secteur de la réalité mais sa structure même ; une dé-régionalisation du « spirituel » peut seule le montrer en son caractère premier. On peut dire que le plus spirituel est, aussi bien, le plus concret, en fonction d’une contradiction levée ou d’une opposition devenue « ré-union ».
Cette dé-régionalisation du « spirituel » fait accéder non seulement à une saisie radicale du « spirituel » mais encore à une constitution toute première des réalités. D’une part, le spirituel-en-acte montre la consistance (con-sistere, tenir avec) même du réel, car au commencement est la Relation. C’est de cette structure, dans et par quoi « de l’autre » est produit concrètement (con-crescere, qui croît avec), qu’« originent » « objet » et « sujet » ; une conditionnalité d’ordre ternaire est en jeu. C’est pourquoi, d’autre part, la réalité peut aussi s’accomplir et être comprise de manière seconde — pas nécessairement secondaire — et binaire, en l’effacement ou en l’oubli de cette structure existentielle. Subjectivité et objectivité se présentent alors comme premiers mais suivant une certaine approche du réel, une approche telle que celui-ci devient affaire de données brutes et de « tout fait » (déterminisme, positivisme pur, matérialisme plat) dans une technique ou encore un art de l’interprétation[8]. Selon le type de rationalité alors engagé s’expose une idée en soi, une essence métaphysique, de l’empirique, de l’utile, du senti/vécu… Quoi qu’il en soit, le réel n’est pas moins spirituel et il est reconnu et vécu tel selon la manière originaire ou non, en-deçà ou non de toute fixation objectale et gnoséologique a priori ou encore a posteriori des choses du monde, des choses pensées et senties.
3.1 Horizons ou tournures épistémiques
Une pareille conception pour le moins paradoxale et concrètement spirituelle du réel, de pair avec une rationalité comprise en conséquence a peut-être déjà été reconnue, par exemple à la croisée de la pensée médiévale et de la pensée moderne[9]. Certaines approches contemporaines l’ont en tout cas mise de l’avant. Ainsi est-il nommément de l’herméneutique philosophique existentielle, qui a opéré une dé-régionalisation de l’interprétation et a réenraciné la phénoménologie dans le langage, offrant du réel une perspective en même temps qu’une approche antifondationalistes. Tout est interprétation ; il n’est rien que ne ressortit pas d’un rapport interprétatif qui nous implique au plus haut point parce qu’il est à la racine de tout. Même dans le règne de l’objectivité ou celui de la subjectivité transcendantale et de la conscience, cela se révèle simplement second, non originaire, pas moins légitime mais limité. Heidegger (1985) nous l’apprend : la « différence ontologique » mine « l’être-fond » de toute chose, « l’arrière-fond » du réel, l’objectivité pure, la subjectivité monolithique, bref tout ce qu’on a pu croire condition première en l’oubli même de l’être ; le langage est constitutif de notre existence, il en est le mode originaire. L’« esprit scientifique » moderne, avec l’exemplification qu’en offre la physique quantique, nous y habitue : le réalisme scientifique qui permet de comprendre et de « pénétrer » la matière (la réalité atomique, par exemple) nous la fait découvrir comme structure corpusculaire ondulatoire, voire la probabilité d’un certain rapport espace-temps de l’observé relativement à un observateur ; car la matière est à peu près tout sauf pleine, c’est un « presque-vide », un ensemble de rapport de forces qu’il est finalement plus simple et juste de qualifier de (rapport) spirituel[10]. Le poststructuralisme nous y convie avec empressement : notre réalité (biologique, sociale, morale, intellectuelle…) se constitue et se comprend dans et par ce qu’on appelle l’expérience qui engage tout ensemble, simultanément, objet et sujet toujours déjà en rapport, toujours en structuration[11]. Une philosophie du langage, où s’inscrit la sémiotique grémassienne par exemple, nous y entraîne[12].
Certaines études en spiritualité dénotent — ou se déploient dans — cette perspective du spirituel-en-acte, que nous tentons de dégager. C’est le cas lorsque la spiritualité est abordée et traitée comme une pratique signifiante, une pratique qui fait « du spirituel » en la matérialité même d’une pratique. Une étude de Louis Bouyer sur l’étymologie du terme « mystique » l’indique de façon liminaire ; il montre que ce terme est essentiellement lié à un contexte rituel à l’époque hellénistique et qu’il concerne donc, à son origine, (la matérialité d’)un faire-rite et non quelque contenu, savoir, mystères comme tels — comme on a l’habitude de le penser (Bouyer 1949, 3-23). Michel de Certeau (1982 ; 2005) reprend le collier quand il expose le travail langagier des mystiques modernes, qui définit ainsi ce qu’ils sont par ce qu’ils font du discours religieux, des savoirs théologiques, des vérités de la foi ; l’itinéraire spirituel devient plutôt affaire d’itinérance, quand ce n’est pas une « parole vivante » advenant comme véritable lieu d’altérité (De Certeau 1970, 488-498 ; 1982 ; 2005) ou encore une indétermination fondamentale qui préside désormais à l’expérience spirituelle (Bergamo 1992). Le projet de la théologie spirituelle peut et devrait être dé-régionalisé en théologie afin de définir tout autrement les enjeux de l’une comme de l’autre (Robert 2009, 53-74). On pourrait notamment explorer comment la spiritualité est non pas d’abord ni surtout une discipline théologique spéciale mais la condition de possibilité et de réalisation de la théologie, c’est-à-dire un acte et une pratique (qu’est la théologie) produit et validé par la spiritualité (Pouliot 2009, 93-106 ; Pouliot et Fortin 2009). On a alors avantage à reconsidérer la spiritualité dans l’horizon du langage, au lieu même où chaque fois « de la spiritualité » se produit et produit du neuf et du vivant (Pouliot 2010, 121-142 ; 2007, 47-63). Et pourquoi pas élaborer à nouveau une théologie du Verbe et proposer la « Parole » en tant qu’elle constitue la relation vive, l’oraison même sur toute la vie, un centre de décentrement (Fortin 2015 ; 2009, 23-34 ; 2005, 125-137 ; Bellet 2011 ; Zundel 1986).
3.2 Danse, (pratique du) langage, relation (originaire)
Cette perspective du spirituel-en-acte donne à penser encore autrement, au moins de façon liminaire, l’objet de notre propos. La danse peut certes être explorée comme un moyen d’expression (d’un sujet) ou même occasion de manifester un quelque chose de plus, mais elle est alors considérée et traitée comme un instrument, dans un autre instrument que serait le corps (ou même l’esprit, dans l’horizon du sacré). Il en va ainsi lorsque le langage, a fortiori la danse comme langage, est pareillement réduit à n’être que le véhicule de la pensée, qu’une courroie de transmission de l’émotion ou d’un message (y compris message du divin). Et alors la spiritualité, de par son « langage spécial », peut être ramenée à une discipline théologique, une spécialité, un aspect parmi d’autres de l’expérience humaine, voire du monde. Il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre que cette approche de la danse, nommément, reste seconde — pas nécessairement secondaire et donc en un sens valide, légitime et limitée — par rapport à une approche qui s’avérerait première, c’est-à-dire originaire[13].
La danse trouve sa raison d’être en elle-même lorsqu’elle constitue un langage (en acte). Saisie comme pratique du langage, la danse met en oeuvre le corps phénoménologiquement et herméneutiquement conçu, c’est-à-dire un corps vécu, un réseau d’intercommunication et donc pas simplement une mécanique ou une machine ; théologiquement parlant, on considère la chair pouvant et devant se faire verbe, puisque « le Verbe (qui) s’est fait chair » en est la condition de possibilité et réalisation[14]. La danse peut advenir en pratique signifiante (= pratique du langage) quand, investissant des fonctions biologiques ou autres, elle est vécue comme désir du sujet et de[15] son objet, réelle transcendance par rapport à l’immanence de ces fonctions biologiques mais le tout marqué par leur ouverture en direction d’un sujet et d’un objet. On en connaît et en expérimente des situations dans notre existence, à commencer par le sein maternel qui est bien plus pour l’enfant que la mamelle, car psychiquement il est fusion, attachement, satisfaction, ou encore par le baiser qui est bien plus que l’accolement des lèvres (comme lors d’un exercice de respiration artificielle), car il est passion, désir, « manger/dévorer d’amour ».
Comme pratique langagière, la danse fait bien plus que mimer ou représenter (ceci ou cela). Elle peut le faire, certes, mais de façon toujours seconde, étant traversée par cela même qui ne se dit pas, qui ne s’exprime pas mais demande à l’être[16]. Telle est d’ailleurs la différence, l’écart entre le besoin et le désir, le manque comblé et le manque barré mais pas moins effectif et effectuant[17]. La danse signifie ; elle est structuration du sujet (danseur) dans et par son acte (danse) ; elle est élaboration, production et procès du langage-faisant-corps[18].
Mais alors, la danse n’est pas d’abord ni surtout une spiritualisation, après coup ou par surcroît, du corps, du monde et de l’individu — quoiqu’elle puisse être comprise et traitée de la sorte suivant quelque approche seconde (non originaire) auparavant signalée. Re-saisie simplement comme pratique signifiante, dans l’horizon du spirituel-en-acte donc, elle « rend parlant » et « fait parler » ce geste de la main, du bras, du dos, des corps, bien sûr, non pas tant en vertu de signe/symbole codé mais en l’articulation du corps signifiant, du système des gestes où, pareillement, co-relativement, survient la structuration du sujet dansant lui-même. Le caractère originaire de la danse concerne ainsi l’espace imprescriptible de l’Autre, c’est-à-dire de ce qui en elle a trait à une relation vécue mais indicible et non « dessinable » (avec l’Autre), qui instaure et qui maintient, qui poursuit et que poursuit la danse, le danseur, le dansé. L’Autre, ici, c’est le fait que la danse altère, barrant le sujet dansant jusque dans sa transparence, son expressivité, sa constitution ; le sujet dansant, tout autant que la danse, restent à faire, tout ensemble : voilà bien ce qui relance le danseur comme la danse. C’est la relation qui est première, qui est originaire dans la danse ; et cette relation vécue n’est jamais comblée par l’objet de la danse ni par le sujet dansant. Une sémiotique de la danse — comme on a mis ailleurs en place et déployé une sémiotique des textes, des images et d’autres formes d’art — signalera certainement mieux que toute mimétique cette condition du spirituel-en-acte, jamais « (dé)montrable » mais « parlante/signifiante ». Pourrait-on signer la danse comme autocompréhension transformatrice, Relation vécue, expérience de « co-naissance » ? Pourquoi pas. En autant qu’on l’examine et la réalise « con-crètement[19] ».
Je souhaitais offrir quelques balbutiements sur la danse, qui demeurent finalement une invitation à la danse. Dis-moi donc comment tu comprends la spiritualité et je t’indiquerai quel est l’univers où tu danses.
Appendices
Note biographique
Étienne Pouliot est chargé d’enseignement à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval (Québec). Ses recherches actuelles concernent la spiritualité et la croyance/incroyance, la sémiotique des textes (bibliques), l’herméneutique philosophique et la théologie réflexive. Il a publié, en tant que co-auteur (2009), Re-cueillir la Parole. Une lecture sémiotique de récits évangéliques, Montréal, Novalis.
Notes
-
[1]
La conception prémoderne de la vérité demeure assurément une piste majeure à explorer pour notre propos. Voir Augustin (1993) et Thomas d’Aquin (s.d. a ; s.d. b). On trouve là, aussi, des indications sur la conception de la raison.
-
[2]
Il est difficile de nier que la perspective des Pères de l’Église prête flanc au régime d’opposition et distinction d’un ordre spirituel vs matériel, mais il conviendrait au moins de rappeler qu’on l’y ramène et l’y réduit souvent très vite. La portée métaphysique du projet patristique ne signifie pas pour autant un projet métaphysique comme celui de Platon ou d’Aristote. Il resterait à démontrer — mais cela dépasse le propos actuel — en quoi l’intelligence est par eux (les Pères de l’Église) mise en oeuvre comme capacité spéculative-réflexive quant aux mystères divins ; la théorie augustinienne du signe et l’exercice spéculatif/réflexif sur les choses du monde et sur les choses de la foi dont elle est l’occasion l’illustre admirablement (voir le célèbre De doctrina christiana d’Augustin mais aussi son oeuvre en général). Il me semble donc qu’on assimile trop, mais non sans raison, l’épistémè ainsi que la démarche des Pères de l’Église à la philosophie (néo)platonicienne et aristotélicienne dont le projet demeure onto-métaphysique ; Dupuy (1932) en est un exemple. Mais encore, un propos comme celui de Hans Urs von Balthasar (1984, 23-24) irait en ce sens à son tour, bien qu’il faudrait aussi rendre justice à sa redéfinition esthétique du monde et de la théologie : « [c]hez les anciens, l’expérience spirituelle [la spiritualité] tout entière se laissait investir par le dogme ; tout devient objectif : états, expériences, émotions, efforts subjectifs intérieurs, ne sont là que pour saisir d’une manière plus profonde et plus pleine le contenu objectif de la révélation, pour l’orchestrer. » Il n’est certes pas impossible, non plus, de reconnaître cette détermination de la mystique dans l’histoire ultérieure, comme le suggère Albert Deblaere : « Chez les maîtres médiévaux [de la mystique], la vie de l’âme est commandée par une vue théologico-métaphysique sur la relation de l’âme à l’essence divine et à la Trinité » (Deblaere 1932, col. 1942). Voir encore Vandenbroucke (1950, 372-389), Agaesse et Sales (1932, col. 1940-1941), Solignac (1932, col. 1861-1862).
-
[3]
Sur la notion moderne de vérité, qu’on pourrait considérer comme figure exemplaire de la tournure d’esprit à illustrer ici, voir entre autres Labarrière (1983, 257-273), Mughier (1962), Schmitt (2003).
-
[4]
Sur l’adjonction de la spiritualité au modèle bio-psycho-social d’intervention proposé par G. L. Engel, voir Berghändler (2010, 162-164) ; une référence à Engel y est incluse. Voir aussi le modèle proposé par l’anthropologie spirituelle, dite et présumée ternaire, de Fromaget (2009 ; 1999 ; 2006). Le Centre spiritualité santé de la Capitale-nationale, à Québec, suit cette avenue <http://www.cssante.ca/>.
-
[5]
On pourra toujours se demander si c’est à l’univers philosophique/profane ou bien à l’univers religieux/théologique qu’est avant tout attribuable ce renversement en direction de la subjectivité, qui caractérise globalement la modernité.
-
[6]
Le terme spiritualitas peut d’abord désigner ce qui est immatériel ou non sensible ou non physique ; ce sens conviendrait davantage à la perspective ontologico-métaphysique des mystères de la foi précédemment exposée. Le terme renvoie, aussi et surtout, à la vie de l’esprit, ici en question. En ce sens, la vie spirituelle de l’humain connoterait elle-même un caractère divin, du fait qu’elle touche au divin ou en relève, du fait de comporter des voies fondamentales vers Dieu. Voir Solignac (1932, col. 1142-1150).
-
[7]
Sur cette évolution historique, voir Adnès (1932, col. 1922-1923.1934-1935), Solignac (1932, col. 1142-1160). Sur les écoles de spiritualités, consulter entre autres Dupuy [1932, col. 1169-1173]. Congar distingue entre les spirituels qui « se sont attachés à l’union à Dieu elle-même, vécue, soit seulement et purement selon l’essentiel d’elle-même — c’est le cas de Tauler —, soit sous l’angle d’une expérience particulière : oraison, croix, dénuement… » (Congar 1963, 16).
-
[8]
La différence entre « le binaire » et « le ternaire » est capitale dans mon propos actuel. J’en risque une explication. Dans nos projets de science et d’intervention, il ne suffit pas d’examiner des éléments (données, faits, réalités, disciplines, thèmes…) isolément, quitte à additionner les considérations à leur sujet, comme si le tout égalait la somme de parties, suivant un fonctionnement épistémique binaire (1 + 1 = 2). Dans ces conditions, les « données » sont des codes à déchiffrer ou de purs signes-symboles à interpréter en fonction de leur référence (ça renvoie à autre chose que ces données mêmes), quitte à additionner les résultats obtenus en vertu de ce qui a toujours déjà été instrumentalisé, c’est-à-dire réduit à un strict moyen, rendu utile, ramené à une stricte application. L’infinitisation des déterminations ainsi articulées n’y change que l’ampleur quantitative du projet, qu’une recherche qualitative pourrait compléter avec virtuosité certes mais guère plus. En revanche, suivant un fonctionnement épistémique ternaire, tout élément a d’emblée une « con-sistance » (c’est toujours déjà un « tenir avec ») de sorte que sujet et objet sont à « com-prendre » ensemble, comme en un procès commun et simultané. C’est pourquoi 1 + 1 = 3, le tout dépassant la somme des parties. Si l’habitude de traiter de manière esthétique (qualitative) cette condition a pu porter fruit, il n’en demeure pas moins que c’est dans un horizon pratique qu’il importe de revenir pour en rendre compte.
-
[9]
Nicolas de Cuses, au xve siècle, en est un témoin et protagoniste, avec son maître ouvrage (de Cuses [s.d.]). Sur le plan de la raison qui connaît, mesure et exerce toutes sortes d’activités, le réel est, pour lui, un tissu de contradictions insolubles et tout pourra toujours être infiniment (par infinitisation) mieux connu, mesuré, produit ; sur le plan de l’Intellect à la racine de la raison raisonnante, le réel est Acte pur, Infini en acte, en quoi tout est en tout ou, si l’on préfère, quand la coïncidence des contraires se réalise et est par nous comprise en une ignorance docte (on comprend pourquoi on ne comprend pas et, alors, il n’en va plus d’un savoir sur le réel).
-
[10]
Voir Bachelard (2012). J’en signale une présentation vulgarisée intéressante bien que d’un lieu autre, plus philosophique dans Zundel (1948).
-
[11]
Je renvoie aux travaux de Michel de Certeau, par exemple.
-
[12]
Je renvoie aux travaux de Louis Panier et du CADIR (Centre d’analyse du discours religieux) à Lyon en France.
-
[13]
J’emprunte à Heidegger ce vocable de mode second et mode originaire des réalités et renvoie à son projet herméneutique existentiel (Heidegger 1985).
-
[14]
Je renvoie de nouveau à l’ouvrage de Fortin (2015).
-
[15]
Au double sens de la préposition « de » : comme génitif objectif, alors que le résultat de cette élaboration ou de cette production est ce langage-corps tout comme le procès porte sur un objet qui est ce langage-corps, puis comme génitif subjectif, alors que le langage-corps est l’instance ou le sujet qui élabore, produit et mène un procès.
-
[16]
J’ai expliqué ailleurs, sur un sujet tout autre, en quoi la mimesis (représentation), qui prend tant de place et d’importance dans la pensée humaine, demeure en fait seconde par rapport à la semiosis (signification, pratique signifiante), qui s’efface et se fait paradoxalement oublier au profit de la mimesis mais sans pour autant fondamentalement y céder (Pouliot 2015, 29-39).
-
[17]
On pourrait consulter Jacques Lacan pour étoffer ces notions de sujet barré, de désir, de parole.
-
[18]
Par cette expression, je veux simplement ne pas en rester au langage dit corporel, qui serait un langage spécifique parmi d’autres (le langage verbal, le langage de la nature, le langage philosophique, théologique, etc.) et peut-être même à la remorque de l’un de ces autres langages. Un langage-faisant-corps pointe la racine (langagière) du réel, dont le phénomène « corps » ou celui de la danse sont aussi tributaires ; l’expression fait écho, en théologie, au « Verbe fait chair » ; le langage-faisant-corps pourrait impliquer un matérialisme tout au plus méthodologique, ne noyant pas le sujet personnel (qui n’est pas le simple produit de conditions matérielles) — on parle de poststructuralisme, pourrait-on parler de « postmatérialisme » ?
-
[19]
« Concret », du latin con-crescere, qui signifie : croître avec. Sujet et objet, mais aussi sujets tous ensemble, grandissent également l’un l’autre, l’un avec l’autre, l’un par l’autre, l’un pour l’autre.
Bibliographie
- Adnès, P. (1932), « Mystique. II — Théories de la mystique chrétienne — B. xvie-xxe siècles », dans M. Viller, dir., Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire, Paris, Beauchesne, col. 1919-1939.
- Agaesse P. et M. Sales (1932), « Mystique. III — La vie mystique chrétienne », dans M. Viller, dir., Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire, Paris, Beauchesne, col. 1939-1983.
- Augustin (1993) [s.d.],Le Maître — Dialogue avec Adéodat. Le libre arbitre — Dialogue avec Evodius, Paris, Institut d’études augustiniennes, p. 56-86.
- Bachelard, G. (2012) [1934], Le nouvel esprit scientifique, Chicoutimi, Bibliothèque Paul-Émile Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi.
- Bellet, M. (2011), Translation. Croyants (ou non) passons ailleurs pour tout sauver !, Paris, Bayard.
- Bergamo, M. (1992), La science des saints, Grenoble, Éditions Jérôme Millon.
- Berghändler, T. (2010), « La spiritualité. Un complément au modèle bio-psycho-social », PrimaryCare, 10/9, p. 162-164, disponible sur : www.primary-care.ch/docs/primarycare/archiv/fr/2010/2010-09/2010-09-016.PDF.
- Bouyer, L. (1949), « Mystique. Essai sur l’histoire d’un mot », Supplément de la vie spirituelle, 9, p. 3-23.
- Congar, Y.-M. (1963), « Langage des spirituels et langage des théologiens », dans La mystique rhénane. Colloque de Strasbourg, 16-19 mai 1961, Paris, Presses universitaires de France (Travaux du Centre d’études supérieures spécialisé d’Histoire des religions de Strasbourg), p. 15-34.
- d’Aquin, T. (1984) [s.d.], Somme théologique, Tome 1, prima pars, q. 16-17, Cerf.
- d’Aquin, T. (2002) [s.d.], Première question disputée. La vérité (De Veritate), Paris, Librairie philosophique J. Vrin, p. 46-93.
- Deblaere, A. (1932), « Mystique. II — Théories de la mystique chrétienne — A. La littérature mystique au Moyen Âge », dans M. Viller, dir., Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire, Paris, Beauchesne, col. 1902-1919.
- De Certeau, M. (1970), « L’expérience spirituelle », Christus, 17/68, p. 488-498.
- De Certeau,M. (1982), La fable mystique. xvie-xviie siècle, Tome I et II, Paris, Gallimard.
- De Certeau,M. (2005), Le lieu de l’autre. Histoire religieuse et mystique, Paris, Gallimard/Seuil.
- De Cuses, N. (1930) [s.d.], De la docte Ignorance, Paris, Maisnie.
- Deragon, S. (s.d.), « L’empirisme et le rationalisme », extrait d’un cours de philosophie sur Les grandes figures intellectuelles du monde moderne, offert à l’UQAM, disponible sur : http://www.phi2080.uqam.ca/node/41.
- Dupuy, M. (1932), « Spiritualité. II. La notion de spirituel », dans M. Viller, dir., Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire, Paris, Beauchesne, col. 1160-1173.
- Fortin, A. (2005), « De la recherche d’identité à l’écoute de la Parole », Lumen Vitae, 60/2, p. 125-137.
- Fortin, A. (2009), « La prise de parole, lieu de spiritualité pour les laïques », Cahiers de spiritualité ignatienne, 126, p. 23-34.
- Fortin, A. (2015), L’annonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres. Une théologie de la grâce et du Verbe fait chair, Montréal, Mediaspaul.
- Fromaget, M. (1999), « Corps, Âme, Esprit ». Introduction à l’anthropologie ternaire, Bruxelles, Éditions Edifie.
- Fromaget, M. (2006), Naître et mourir. Anthropologie spirituelle et accompagnement des mourants, Paris, F.X. de Guibert.
- Fromaget, M. (2009), Spiritualitésanté, 2/2, p. 12-37.
- Heidegger, M. (1985), Être et temps / trad. par E. Martineau, Paris, Authentica.
- Labarrière, P.-J. (1983), « La véri-fication », dans J. Greisch et F. Bousquet, dir., La vérité, Paris, Beauchesne, p. 257-273.
- Mughier, R. (1962), Le problème de la vérité, Paris, Presses universitaires de France.
- Pouliot, É. (2007), « Theorization of Spirituality in Health Care. An Illustration Through Occupational Therapy », dans C. Dumont et G. Kielhofner, dir., Positive Approaches to Health, New York, Nova Science Publishers, p. 47-63.
- Pouliot, É. (2009), « D’une spiritualité autre à la spiritualité autrement », Cahiers de spiritualité ignatienne, 126, p. 93-106.
- Pouliot, É. (2010), « Par ici la sortie. Ce qu’il advient de la spiritualité dans l’horizon du langage », Théologiques, 18/2, p. 121-142.
- Pouliot, É. (2015), « Au travers de la représentation du témoignage », Laval théologique et philosophique, 7/1, p. 29-39.
- Pouliot, É. et A. Fortin (2009), Re-cueillir la Parole. Une lecture sémiotique de récits évangéliques, Montréal, Novalis.
- Robert, S. (2009), « Vocation actuelle de la théologie spirituelle », Recherche de sciences religieuses, 97/1, p. 53-74.
- Schmitt, F.F. (2003), Theories of Truth, Blackwell Publishing.
- Solignac, A. (1932), « Spiritualité. I. Le mot et l’histoire », dans M. Viller, dir., Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire, Paris, Beauchesne, col. 1142-1160.
- Ursvon Balthasar, H. (1984), « Théologie et sainteté », Dieu vivant, 12, p. 23-24.
- Vandenbroucke, F. (1950), « Le divorce entre théologie et mystique », Nouvelle Revue Théologique, 72, p. 372-389.
- Zundel, M. (19482) [1944], L’Homme passe l’homme, Paris, La Colombe.
- Zundel, M. (19862) [1962], Morale et mystique, Beauceville, Anne Sigier.


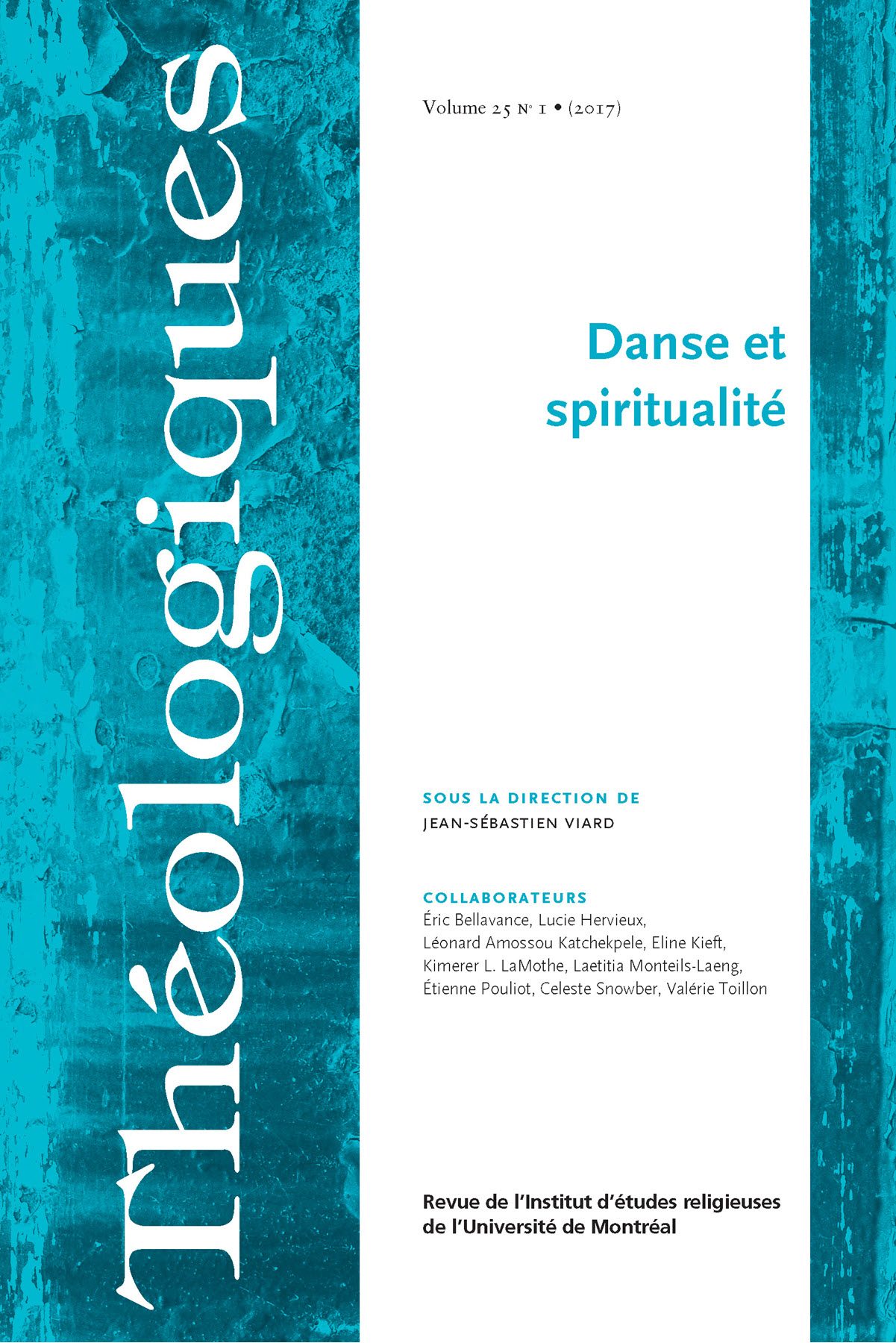
 10.7202/1007483ar
10.7202/1007483ar