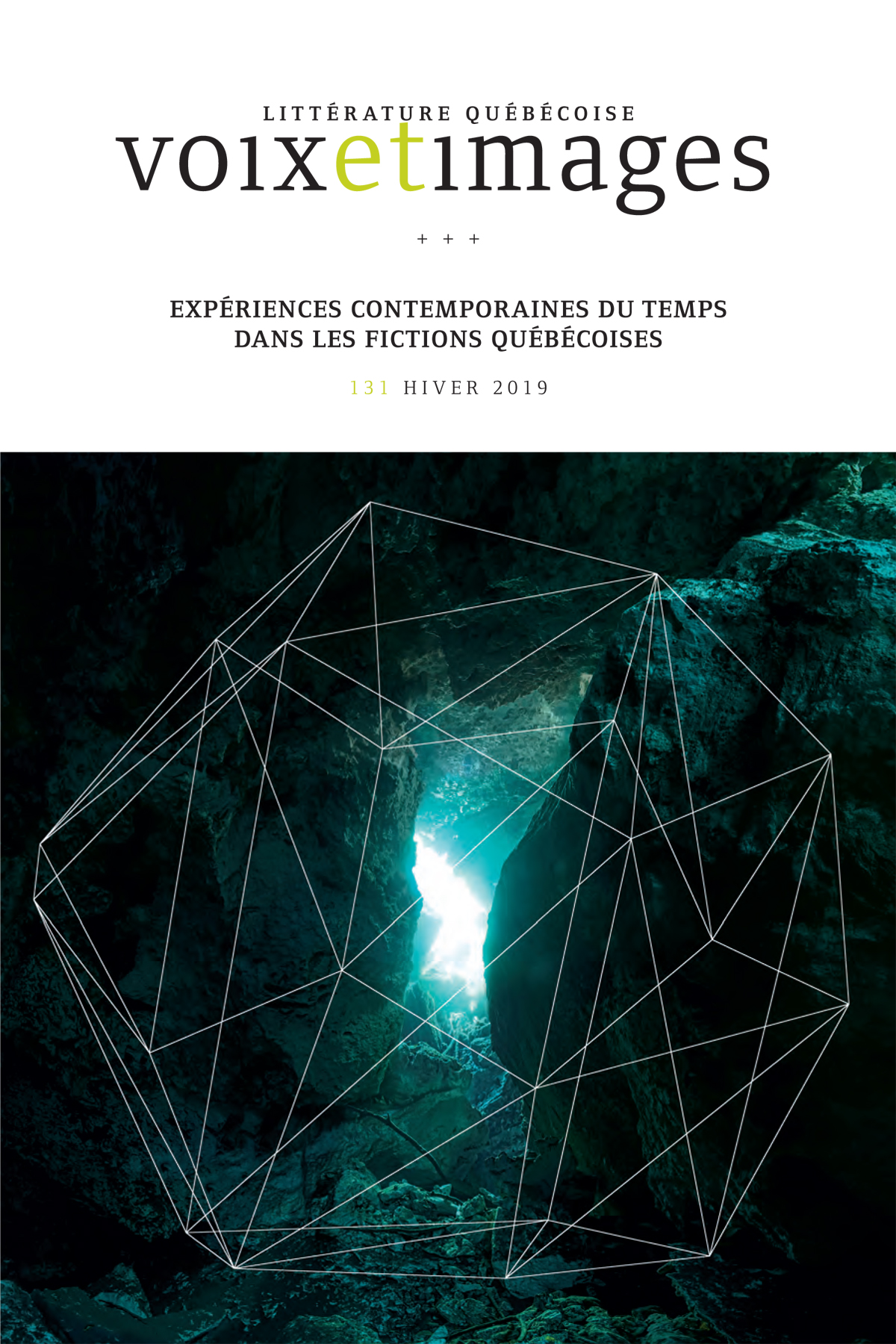Abstracts
Résumé
Cet article s’intéresse à l’expérience du temps dont témoigne le texte de Micheline Morisset Arthur Buies, chevalier errant. À l’aide de la notion de régime d’historicité, et plus précisément de celle de présentisme, développée par François Hartog, il y est montré que le texte de Morisset s’inscrit dans un contexte global où le passé est principalement envisagé selon la notion de patrimoine, mais qu’il témoigne également d’une conception littéraire de l’histoire. Faisant de Buies une figure tutélaire de l’histoire littéraire du Québec, Morisset propose de reconsidérer la tradition de lecture nationale en se recentrant autour de l’oeuvre du chroniqueur. Il en découle un rapport complexe au temps, où les enjeux du présentisme se conjuguent à ceux de l’histoire littéraire.
Abstract
This article examines the experience of time embodied in Micheline Morisset’s Arthur Buies, chevalier errant. Using the ideas of regimes of historicity and presentism developed by François Hartog, the author shows that Morisset’s text is part of a global context in which the past is viewed mainly through the idea of heritage, but that it also is based on a literary conception of history. Making Buies into a tutelary figure of Québec’s literary history, Morisset suggests that we reconsider the national reading tradition by recentering it on Buies’s work. The result is a complex relationship with time, in which the issues of presentism are combined with those of literary history.
Resumen
Este artículo se interesa por la experiencia del tiempo del cual es testimonio el texto Arthur Buies, chevalier errant (Arthur Buies, caballero andante), de Micheline Morisset. Apoyándose en la noción de régimen de historicidad, y más precisamente en la de presentismo, desarrollada por François Hartog, se muestra que el texto de Morisset se inserta en un contexto global donde se considera principalmente el pasado según la noción de patrimonio, pero también se da testimonio de una concepción literaria de la historia. Transformando a Buies en figura tutelar de la historia literaria de Quebec, Morisset propone que se vuelva a considerar la tradición de lectura nacional recentrándose en torno a la obra del cronista Buies. De ello se desprende una relación compleja con el tiempo, en la cual se combinan los retos del presentismo con los de la historia literaria.
Article body
Cet article comporte une double visée qui pourra, à première vue, sembler contradictoire. Il s’agira dans un premier temps d’illustrer comment Arthur Buies, chevalier errant[1], la fiction biographique de Micheline Morisset, constitue une fiction présentiste, au sens où l’historien François Hartog définit ce terme, c’est-à-dire un récit dans lequel le présent constitue le principal horizon du discours historique, témoignant d’une expérience du temps inquiète, obsédée notamment par l’idée d’oubli. Dans un deuxième temps, il s’agira de prendre un pas de recul et d’envisager autrement cette méthode d’analyse en essayant de révéler ses limitations, ses zones d’ombre, et d’identifier les aspects du texte dont elle ne permet pas de rendre compte ; il apparaîtra de cette manière que le présentisme peut être conjugué à d’autres approches, spécifiques au type de discours étudié — ici, le discours littéraire. Nous verrons que si l’oeuvre de Morisset se rattache à un certain imaginaire de l’histoire et du temps particulièrement prégnant au moment de sa publication à la fin des années 1990, le rapport au passé qui s’y dessine repose également — avant tout, peut-être — sur une mise en scène de l’histoire littéraire, où la tradition de lecture et l’héritage intellectuel de Buies occupent le premier plan. Sans être incompatibles, ces deux perspectives sur le rapport au temps se posent néanmoins en décalage l’une par rapport à l’autre, ce qui soulève la question de la transférabilité de méthodes historiques vers les études littéraires, mais surtout, nous met en présence d’un temps propre à l’histoire littéraire.
La démarche proposée ici se veut une contribution au champ de plus en plus riche de l’analyse des expériences du temps dans la littérature, où les régimes d’historicité jouent fréquemment un rôle majeur[2], mais elle vise par le fait même à poser un regard critique sur ce champ. Il ne s’agit pas de remettre en question la pertinence des régimes d’historicité dans le cadre des études littéraires, mais bien de réfléchir aux stratégies qui peuvent être mises en place pour repousser les limites de cet outil d’analyse historique, notamment en ce qui concerne les oeuvres de fiction mettant en scène des figures auctoriales. En effet, si cet emprunt méthodologique au champ historique peut s’avérer fécond, il comporte néanmoins certains écueils qui tiennent aux différences entre les objets dont se préoccupent les deux disciplines. Aussi, l’un de nos objectifs sera de mettre à l’épreuve cette idée, somme toute assez simple, mais dont l’importance n’en est pas moins capitale qu’à défaut d’adapter aux objets littéraires les théories et les méthodes historiques, on risque d’occulter des éléments essentiels des oeuvres. Cette réflexion s’appuiera notamment sur l’étude importante de la mise en scène de l’histoire littéraire par des écrivains de l’équipe réunie autour de Vincent Debaene, Marielle Macé, Jean-Louis Jeannelle et Michel Murat[3].
ARTHUR BUIES, CHEVALIER ERRANT : UNE FICTION PRÉSENTISTE
Précisons d’abord que l’utilisation des régimes d’historicité pour l’étude d’un texte de fiction n’est pas le seul fait de chercheurs en études littéraires : Hartog lui-même s’appuie sur la littérature pour étayer son argumentation. Dans Régimes d’historicité, l’historien se penche largement sur les oeuvres de Chateaubriand, notamment les Mémoires d’outre-tombe, l’Essai historique et le Voyage en Amérique, tandis que, dans un article paru en 2010 intitulé « La temporalisation du temps : une longue marche », il s’intéresse au roman de l’écrivain américain Don DeLillo, L’homme qui tombe, paru en 2007[4]. Hartog voit en ce texte « une exploration littéraire du présentisme : jusqu’à son paroxysme[5] ». L’homme qui tombe relate la vie de personnages new-yorkais après le 11 septembre 2001, en explorant la question de l’impossibilité, après le choc de la catastrophe, de constituer un récit ou de s’extirper d’une expérience du temps sans cesse réduite à l’immédiat. Paragraphes décousus, narration incertaine, dialogues artificiels, tout concourt à faire la démonstration d’une réalité « désormais sans récit [où] courent les petites histoires, sans liens entre elles[6] ». Le texte est d’ailleurs traversé par une métaphore, celle de la maladie d’Alzheimer, qui évoque ce présent perpétuel sur lequel butent les personnages et dont ils ne peuvent s’extirper.
Hartog interprète ce « récit suspendu[7] » comme une mise en forme littéraire de l’expérience présentiste du temps, mais d’autres formes de récits peuvent arriver à ce même résultat. Arthur Buies, chevalier errant est un exemple pour le moins éloquent, puisqu’il ne s’organise pas autour de la question de l’oubli, comme le fait le texte de DeLillo, mais plutôt en présentant une mémoire disproportionnée et omniprésente qui témoigne du même phénomène. Le texte se construit autour d’une interrogation simple : que penserait et que dirait Buies s’il revenait dans le monde d’aujourd’hui ? Cette question implique de synthétiser et d’exposer la pensée de Buies afin de l’appliquer au contexte contemporain, mais Morisset l’utilise également comme prétexte pour faire voir l’héritage de cette pensée à travers le xxe siècle. Dès le début de cette démonstration, la figure de Buies est associée à l’identité québécoise de manière à valider l’idée selon laquelle les textes du chroniqueur posaient déjà, au xixe siècle, les bases de la société québécoise, telle qu’elle s’est développée depuis la Révolution tranquille. Néanmoins, le texte n’est pas le vecteur d’une réflexion identitaire qui, par un retour aux sources, s’interrogerait sur l’évolution de cette société, et en particulier sur le développement de sa littérature. Dans l’ensemble du récit, il ne s’agit pas non plus d’adopter une perspective historique, mais plutôt d’utiliser Buies comme un miroir pour le présent, comme un outil pour dresser le portrait d’une société et d’une littérature, ici et maintenant.
Il n’est certes pas rare que des oeuvres littéraires utilisent ainsi des écrivains du passé comme figure médiatrice afin d’appréhender le présent. Toutefois, Morisset s’engage dans cette voie en limitant au strict minimum la place accordée au passé dans sa réflexion et en gardant les yeux constamment rivés sur le présent. Ne traitant pas Buies dans une perspective réaliste ni à la manière d’une biographie conventionnelle décrivant la vie d’un individu de sa naissance à sa mort, l’écrivaine y fait plutôt revivre le chroniqueur pour une courte période de l’année 1995, à Rimouski et à Québec, et le confronte à diverses questions d’actualité comme l’état de la langue française dans la province, le rapport des Québécois avec les États-Unis, l’évolution de la littérature nationale, de même que l’événement politique majeur de cette période : le second référendum sur la souveraineté du Québec. La superposition des deux voix de Buies, celle de la figure historique, qui intervient par le biais de citations de ses textes, et celle du personnage de fiction, le Buies de 1995, a pour effet de placer les deux époques sur un même pied. Les oeuvres de l’écrivain ne sont pas contextualisées et apparaissent alors dépourvues de tout ancrage historique ; de ce fait, elles semblent pouvoir s’appliquer directement aux événements de 1995.
À ces deux voix s’en ajoutent rapidement deux autres qui contribuent au rapprochement entre les deux époques. Il s’agit d’abord de celle du personnage de Geneviève, une jeune femme vivant une vie normale en 1995, qui est la principale interlocutrice de Buies et avec lequel elle se trouve parfois en désaccord. Son rôle dans le texte est de relancer Buies dans ses réflexions et de le pousser à exprimer sa pensée. Une fonction plus importante encore est assumée par une narratrice externe, que l’on peut identifier à Morisset, qui relate les pensées et les discussions des personnages, et qui effectue des commentaires métatextuels alors qu’elle s’adonne à la rédaction d’une oeuvre de fiction consacrée à Buies. Avec les propos de cette narratrice, les citations des oeuvres de Buies se voient accompagnées de remarques interprétatives visant à les relier au temps présent et à comparer le Québec contemporain, celui des années 1990, à celui du xixe siècle. Cette comparaison s’avère souvent hasardeuse, voire malheureuse, dans la mesure où les textes de Buies qui sont cités en exemple ont été écrits plus d’un siècle avant les événements qu’ils sont censés éclairer. En témoigne la scène où Buies assiste en direct au dévoilement des résultats du référendum en compagnie de Geneviève. Alors que cette dernière est déçue par les propos désormais célèbres de Jacques Parizeau sur l’influence de l’argent et du vote ethnique, le personnage de Buies s’empresse pour sa part d’abonder dans le sens du premier ministre. Comparant Parizeau à la figure tutélaire du curé Labelle, il évoque ensuite plusieurs de ses chroniques, notamment celles où il critique les anglophones du Québec, puis une autre, où il se désole de « l’invasion des races étrangères » (AB, 166-170).
Cet exemple montre bien que le raccord entre ses chroniques, parues en plein xixe siècle, et le monde contemporain ne s’effectue pas sans heurts ; il n’est d’ailleurs possible qu’au prix de l’invention d’une tradition permettant de lier la pensée de Buies à celle de divers écrivains et intellectuels, donnant dès lors l’illusion que Buies a toujours été d’actualité. Au sein de la tradition de lecture inventée par Morisset apparaissent ainsi différentes figures d’écrivains, de critiques et de chercheurs — Francis Parmentier ou Laurent Mailhot ou Roger Duhamel — qui attestent l’importance de Buies pour l’évolution de la pensée et de la littérature québécoises. Cette rhétorique donne l’image fort étonnante d’un Buies presque omniprésent dans tout le xxe siècle ; Jack Kerouac avant la lettre, homme de la Révolution tranquille, précurseur de l’abolition de la peine de mort, défenseur des droits des femmes (AB, 91 et 130-132), et ainsi de suite. Sous la plume de Morisset, Buies semble être de tous les combats et de toutes les époques. Le personnage a lui-même conscience d’échapper aux frontières temporelles, ce qu’il explique au personnage de Geneviève : « [J]e serai loin, ou très près, c’est pareil parce que dans la contrée des pensées qui fusionnent, il n’y a ni temps, ni espace, seulement l’ultime certitude de la rencontre. » (AB, 190) Ailleurs dans le texte, la narratrice affirme encore : « Il est des êtres que le temps ne touche pas. Certains jours, il n’y a plus d’avant ni d’après. » (AB, 55) Comme le texte de DeLillo, Arthur Buies, chevalier errant apparaît tel un « récit suspendu », où l’impossibilité de raconter n’est toutefois pas une conséquence de l’oubli, mais plutôt celle d’un trop-plein de mémoire, laquelle se manifeste partout avec insistance : dans les médias, dans les lectures de la narratrice, dans la vie des personnages, dans la rue même — comme nous le verrons en évoquant la présence dans le texte de l’acteur Paul Dupuis —, au point où tout dans l’oeuvre est susceptible de devenir prétexte au souvenir ; au point aussi d’établir une équivalence entre passé et présent.
Les régimes d’historicité, et plus précisément la notion de présentisme, peuvent nous aider à tirer quelques conclusions quant à cette suspension du temps qui est à l’oeuvre dans le récit, en montrant qu’elle s’inscrit dans un phénomène de grande échelle. Le terme « présentisme » vise à décrire une crise du temps qui occupe les sociétés occidentales depuis les dernières décennies du xxe siècle. Cette crise du temps, c’est-à-dire un moment où « viennent à perdre leur évidence les articulations du passé, du présent et du futur[8] », l’historien la définit comme celle d’un présent hypertrophié, chronophage, garant à la fois du passé, dont il se fait le gardien et le protecteur, et de l’avenir, dont il se sent responsable. Au cours des dernières décennies du xxe siècle, dans les sociétés occidentales, l’idée qu’à défaut d’être protégé, le passé risque de disparaître caractérise en grande partie le rapport au temps qui découle de cette crise. D’où l’importance de quelques notions fondamentales, comme celles de patrimoine, de mémoire et de commémoration, qui synthétisent l’obsession présentiste pour la conservation et la transmission — éléments qui faisaient défaut au sein du régime moderniste. Depuis la fin des années 1970, au moins, ces notions jouent en effet un rôle clé dans la manière dont sont envisagés le passé et le futur : elles sont le signe d’un passé sans cesse réactualisé, réinjecté dans le présent, et d’un avenir perçu comme incertain, pour lequel il importe de préparer et de transmettre un héritage.
Cette articulation des catégories temporelles qui caractérise le présentisme, avec, en son centre, le présent qui en constitue le maître d’oeuvre et la perspective dominante, se retrouve à divers égards dans le texte de Morisset. En essayant de faire de Buies, écrivain somme toute assez peu connu hormis par les spécialistes, une figure majeure du xxe siècle, le texte se livre à une véritable surenchère de mémoire qui reflète le rapport au temps de la société à la même époque. Cette volonté de faire le portrait d’une tradition de lecture de Buies et d’illustrer ainsi l’épanouissement de sa mémoire semble constituer la contrepartie de la quasi-absence de mémoire consacrée à l’écrivain. Il faut à cet égard souligner que le texte constitue une commande de la radio de Radio-Canada, qui, en 1999, a sollicité Micheline Morisset afin qu’elle produise une série de dix textes destinés à être lus en ondes afin de mieux faire connaître la figure de Buies aux auditeurs. On a vu que la version imprimée du récit conserve cette vocation et fait de l’écrivain un objet de patrimoine dont l’intérêt ne se limite pas au domaine littéraire, mais concerne l’évolution d’une identité collective. Contemporain de toutes les époques, Buies n’apparaît jamais dans le texte comme une figure du passé, mais trouve toujours à s’incarner, figurativement ou littéralement, dans un présent qu’il semble avoir entrevu à travers ses textes. À la toute fin du récit, Morisset cite longuement l’acteur Paul Dupuis, l’interprète du personnage de Buies dans Les belles histoires des pays d’en haut, qui décrit clairement cette image :
Il m’arrive encore aujourd’hui de rencontrer d’aimables personnes qui m’interpellent dans la rue : « Salut Arthur ! », « Bonjour Monsieur Buies, comment ça va Monsieur Buies ? » Je sais bien alors que ce n’est pas l’acteur Paul Dupuis qu’on salue, mais plutôt l’instrument qui rappelle la présence du bon génie d’Arthur Buies qui passe… et repasse… parmi nous.
AB, 192
C’est cette obsession pour le présent et la réactivation d’une figure du passé afin de se construire un héritage qui font avant tout du texte une fiction présentiste. Les notions de patrimoine et de commémoration fournissent à l’auteure des termes généraux lui permettant d’aborder et de représenter la figure de Buies et, en ce sens, le propos de Morisset s’inscrit tout à fait dans une mouvance dominante au moment de la parution de son récit.
LE FUTUR ET L’ORIGINE DE LA LITTÉRATURE
Les analyses d’Hartog montrent que la crise présentiste correspond à une vision pessimiste de l’histoire s’observant notamment dans des récits mettant en scène l’avenir, développant le plus souvent un discours morose, désenchanté, voire carrément dystopique. Alors que le régime moderne d’historicité avait durablement associé les notions d’histoire et de progrès — un mariage dont la philosophie des Lumières ou le positivisme du xixe siècle offrent les exemples les plus probants —, cette conception de l’évolution de l’humanité s’est vue écorchée au xxe siècle, et n’en a traversé qu’à grand-peine les premières décennies. Aussi, après 1945, l’horizon lumineux que constituait l’avenir avait sans contredit pâli. Cette perception inquiète de l’avenir s’est accentuée par la suite, notamment avec les prises de conscience écologiques, si bien qu’à la fin du siècle, l’idée d’un futur sombre avait définitivement imprégné l’imaginaire historique.
La littérature n’a pas manqué de reconfigurer selon divers schémas narratifs cette articulation des catégories temporelles, en évoquant plus ou moins directement un futur problématique. À plus forte raison lorsqu’il est question de mémoire ou de patrimoine, il n’est pas rare de rencontrer dans des récits de fiction un discours sur l’histoire ou sur le temps reproduisant la structure du présentisme. Parce qu’il envisage le temps dans une perspective strictement littéraire, le texte de Morisset transforme toutefois ce rapport à l’avenir, lequel prend en effet une connotation tout à fait positive, dans la mesure où la littérature québécoise contemporaine est comparée de manière avantageuse au contexte et aux oeuvres du xixe siècle. En traitant l’histoire littéraire sur un mode fictionnel, Arthur Buies, chevalier errant s’avance sur le terrain d’une discipline comportant ses règles et sa structure propres, et cet aspect du texte échappe en partie à la grille de lecture présentiste, même si son influence se situe avant tout sur l’articulation des catégories temporelles, et plus particulièrement sur la valeur accordée au futur.
De fait, ce rapport à l’avenir se manifeste clairement dans les passages de l’oeuvre où il est question de l’évolution de la littérature québécoise. En témoigne une scène importante, dans laquelle Buies assiste à la remise d’un prix littéraire nommé en son honneur. Sous le coup de l’enthousiasme suscité par cet événement, le personnage décide de rédiger une lettre à l’intention de Geneviève, dans laquelle il dresse une sorte de bilan de l’état de la littérature québécoise qui, comme d’autres passages du texte, est en partie composé d’un collage de ses écrits réels. Le constat de Buies dans cette lettre est sans équivoque : la littérature québécoise est plus dynamique que jamais auparavant, et tout porte à croire que les choses continueront à s’améliorer. On peut noter le décalage qui sépare le regard paternel et bienveillant du personnage et les idées du véritable Buies sur la jeunesse de son temps : amer et pessimiste, l’écrivain était loin de s’enthousiasmer devant le nouveau dynamisme de la littérature canadienne-française, notamment incarné par les poètes de l’École littéraire de Montréal. Au contraire, dans l’un de ses derniers textes, intitulé Les jeunes barbares[9], Buies se montre consterné par la relève, soulignant à grands traits les anglicismes et les lacunes stylistiques de plusieurs textes parus dans la revue le Glaneur.
Si le texte de Morisset peut poser un constat inverse avec autant d’assurance, c’est parce que l’auteure manipule l’histoire littéraire de manière à ce que Buies en soit à la fois le point de départ et l’étalon. C’est-à-dire que Morisset propose un véritable récit alternatif, allant partiellement à l’encontre des discours savants, et dans lequel Buies est présenté en père fondateur de la littérature nationale — laquelle serait pratiquement apparue ex nihilo, grâce à la seule intervention du chroniqueur —, tandis que son oeuvre en constituerait l’un des sommets à partir duquel il convient de comparer les nouvelles productions. Sous la plume de l’écrivaine, le personnage se décrit d’ailleurs lui-même comme le principal artisan ayant stimulé l’émergence d’une littérature nationale au xixe siècle :
Certes, l’on a écrit à mon époque et l’on a pu s’enorgueillir d’illustres penseurs […], mais qu’on ne vienne pas me parler du développement d’une littérature nationale ! […] [J]e n’ai cessé, au fond de moi, non seulement d’espérer qu’un jour s’édifierait une littérature vraiment nationale, mais que je serais reconnu comme celui qui y aurait travaillé.
AB, 180-181
Cette manière de présenter un écrivain comme le point de départ d’une littérature et d’en faire le jalon essentiel, celui à partir duquel il est possible de mesurer son avancement, n’est pas un procédé unique à l’oeuvre de Morisset. Au contraire, les auteurs de l’ouvrage collectif L’histoire littéraire des écrivains soulignent que les écrivains traitant d’histoire littéraire dans leurs oeuvres effectuent fréquemment ce genre de recadrages autour de certaines figures, ce qui ne manque pas d’engendrer des rapports inédits au temps et à l’histoire[10]. Ces rapports peuvent être à divers degrés indépendants des régimes d’historicité, mais, surtout, ils sont déterminés par les questions qui orientent l’histoire littéraire. La contribution de William Marx à L’histoire littéraire des écrivains est particulièrement éclairante à cet égard, puisqu’elle s’intéresse à l’invention de traditions littéraires dans les années 1920 en France. À ce moment, les écrivains d’avant et d’arrière-garde cherchent simultanément à se pourvoir de précurseurs et de modèles afin de justifier des choix esthétiques et idéologiques — l’exemple le plus célèbre demeure le premier Manifeste du surréalisme, où une suite de figures disparates est convoquée à cette fin, allant de Dante à Swift, en passant par Shakespeare et Sade. Affirmant que la mémoire et la transmission d’héritages littéraires apparaissent particulièrement difficiles à cette période, Marx met en lumière ces procédés d’appropriation des figures du passé (qui ne sont pas sans rappeler ceux mis en place par Morisset à propos de Buies), telle celle d’Edgar Allan Poe :
Edgar Allan Poe fut l’un des auteurs les plus souvent convoqués dans ce contexte. […] Cette soudaine prééminence […] permettait en fait de donner cohérence à une période passablement complexe de l’histoire de la littérature : celle de la fin du xixe siècle. En lieu et place d’une pluralité désordonnée de mouvements juxtaposés les uns aux autres, la référence commune à Poe faisait ressortir la logique d’un développement continu, de Baudelaire à Mallarmé. […] On attribua donc à Poe la paternité de toute une tradition[11] […].
Citant des conférences, des articles et même des thèses de doctorat, Marx retrace les moments forts de la construction de l’image et des oeuvres de Poe qui ont fini par être utilisées comme une sorte de fourre-tout idéologique, permettant de justifier jusqu’aux idées les plus banales. Toutefois, la principale vertu de l’oeuvre de Poe pour les critiques de l’époque, notamment Paul Valéry, est de constituer une base sur laquelle développer la thèse d’une filiation entre Baudelaire et Mallarmé. Détachant des éléments de continuité entre les deux poètes, la référence à Poe permettait aussi aux partisans de l’avant-garde poétique de revendiquer des racines américaines et ainsi de se couper de la tradition française — comme les romantiques qui, un siècle plus tôt, se réclamaient de Shakespeare pour marquer la coupure avec la tragédie classique française.
LA TRADITION DE LECTURE
En utilisant Buies comme figure structurante pour le récit de l’histoire littéraire qu’elle met en place, Morisset n’agit pas autrement que les auteurs évoqués par Marx. Son texte s’attaque en effet à une question complexe, taraudant les historiens de la littérature au moins depuis les années 1960, et qui est de déterminer la présence ou non d’une tradition de lecture collective au Québec. De cette question en découlent d’autres, non moins importantes, comme celle des origines de la littérature québécoise ou de ses potentialités — rappelons que, contrairement aux historiens, les auteurs de fiction sont libres d’anticiper ou de formuler des pronostics —, mais aussi celle de son existence à proprement parler, si l’on considère qu’une littérature n’a de réalité qu’à travers sa lecture par une collectivité. Signe que ces préoccupations précèdent et dépassent l’oeuvre de Morisset, Georges-André Vachon s’y intéressait déjà à la fin des années 1960[12] en défendant cette idée faisant de la tradition de lecture la condition nécessaire à l’existence d’une littérature nationale. Arguant qu’une littérature peut se définir comme un ensemble organisé par une certaine tradition de lecture et de critique, Vachon considérait que les oeuvres « majeures » sont celles qui sont relues à travers le temps, peu importe l’accueil qu’elles ont pu recevoir à l’époque de leur première parution[13]. À l’époque, Vachon estimait que rien de tel n’existait pour les oeuvres québécoises :
« Un ensemble d’oeuvres lues et relues. » Mais, ici, relues par qui ? J’aimerais bien savoir combien d’exemplaires des Anciens Canadiens étaient encore accessibles aux lecteurs québécois avant la réédition toute récente de l’oeuvre en format de poche. Et qui donc aura relu, avant la réimpression de 1946, les Forestiers et voyageurs, de Joseph-Charles Taché ? (J’écris ces noms et prénoms en toutes lettres, les lecteurs du présent ouvrage les ayant certainement oubliés ; ou s’ils les ont retenus, ce sera en vertu d’une mémoire bien différente de cette mémoire traditionnelle, par quoi nous savons qui est l’auteur des Fleurs du mal, de Monsieur Teste, de La porte étroite)[14].
Contrairement à ce que pouvait observer Vachon dans les années 1960, les auteurs de la plus récente histoire de la littérature québécoise soulignent qu’il existe désormais une tradition de lecture au Québec[15], constituée principalement des oeuvres de Nelligan, d’Anne Hébert, de Gabrielle Roy et de Réjean Ducharme, à laquelle on pourrait sans doute ajouter celle de Gaston Miron. Il faut toutefois reconnaître que cette tradition est très circonscrite et surtout très récente, si bien que dans les décennies 1980-1990, il n’existe aucun consensus à ce sujet. Dans un bref article paru en 1994 dans Québec français, André Gaulin remarquait par exemple que le système d’éducation n’accordait que peu de place aux auteurs québécois, faisant ainsi entrave à la construction d’une tradition de lecture québécoise. Même si la perspective de Gaulin, alors député à l’Assemblée nationale pour le Parti québécois, n’est pas celle d’un historien de la littérature, ses observations mettent en évidence l’importance de l’école comme vecteur d’une culture littéraire nationale. Paru dans un contexte marqué par les questionnements identitaires, ce bref texte montre également une volonté de mettre à profit la capacité de l’histoire littéraire à véhiculer des récits identitaires et nationaux. Dans le contexte des années 1990, une large part du discours sur l’histoire littéraire — du moins, à l’extérieur de l’université — se concentre d’ailleurs sur ces aspects historiques au détriment des autres facteurs susceptibles d’orienter la discipline, comme les genres, les pratiques ou l’esthétique. C’est notamment ce qu’illustre le texte de Gaulin :
En France, un finissant de lycée sait au moins qui est Montaigne […]. [De] Descartes à Pascal ou à Molière ou à Racine, et d’eux à Hugo, Lamartine, Balzac, Stendhal, etc., jusqu’à Camus ou Barthes se tisse une tradition de lecture et à travers elle ce qui fait l’esprit national français […]. Qu’en est-il du Québec ? Quelle est notre tradition de lecture, c’est-à-dire que fait lire le réseau scolaire de tous les niveaux qui permette aux Québécois et aux Québécoises de se situer dans la pensée et la sensibilité québécoises [16]?
Parmi les oeuvres de fiction abordant ces enjeux, Arthur Buies, chevalier errant est assurément la plus explicite, non seulement parce que Buies y assiste au référendum de 1995, mais aussi parce que cet écrivain y est convoqué de manière à mettre en évidence les grands traits de ce que Gaulin désigne comme « la pensée et la sensibilité québécoises », ou du moins l’idée que s’en fait la narratrice :
Geneviève exprime une émotion qui ressemble à de la confiance, la confiance qu’elle a en elle, en ses racines, en les forces vives qu’elle a su déployer après les siècles d’oppression. […] Ce n’est pas comme à Paris, c’est comme au Québec, c’est comme à Rimouski, c’est là, en plein centre du Café du Moulin à Sainte-Luce, à seize heures un jour de l’an mille neuf cent quatre-vingt-quinze […].
AB, 122-123
Mais Morisset n’est pas la seule auteure de l’époque à s’intéresser ainsi à l’histoire littéraire dans une perspective nationale. D’autres oeuvres s’emparent également de figures d’écrivains du xixe siècle de manière à proposer des réécritures de l’histoire littéraire dans lesquelles la question des origines et la tradition de lecture occupent une place centrale, montrant ainsi qu’un certain imaginaire du temps et de l’histoire se met en place, ou plutôt se fixe à ce moment à travers les oeuvres littéraires. Pensons à des textes comme le Nelligan de Michel Tremblay, Le spasme de vivre d’André Vanasse ou Le portrait déchiré de Nelligan d’Aude Nantais et Jean-Joseph Tremblay[17], qui utilisent le poète comme figure tutélaire de la littérature et de l’identité québécoises. Bien que le récit national qui en découle soit fort différent de celui décrit par Morisset — notamment parce qu’ils font du « sacrifice » de Nelligan, à savoir son basculement vers la folie, l’une des conditions d’émergence de la littérature québécoise —, ces textes effectuent eux aussi, plus ou moins explicitement selon les cas, une relecture de l’histoire littéraire du xxe siècle basée sur le poète. Le même phénomène s’observe, toujours avec une même logique et des conclusions différentes, dans des oeuvres consacrées à Laure Conan, comme La saga des poules mouillées et La romancière aux rubans, où la dimension féminine s’ajoute à l’idée de nation. À ces oeuvres, il faut en ajouter au moins une autre, elle aussi consacrée à Buies, Le grand Buies de Mireille Maurice, d’un style plus près du roman historique et proposant une vision de l’histoire littéraire similaire à celle de Morisset, dans laquelle le chroniqueur joue un rôle de premier plan.
Tous ces textes parus dans les deux dernières décennies du xxe siècle ont en commun de proposer de nouvelles périodisations de l’histoire littéraire en se questionnant sur l’origine de la littérature québécoise. À l’instar de Vachon, leurs auteurs semblent en effet se demander comment définir les limites de la littérature nationale en l’absence d’une tradition de lecture et de critique qui aurait, comme en France, en Angleterre ou en Russie, hiérarchisé les oeuvres de manière relativement stable. Pour Vachon, la réponse semble claire : l’expression « littérature québécoise » ne désigne pas (en 1967) un ensemble de textes collectivement reconnus comme importants, valables, significatifs, etc., mais englobe plutôt la « collection matérielle » des oeuvres produites sur ce territoire donné. Les textes « littéraires » ne constituent qu’une partie du corpus littéraire québécois ; à leurs côtés se rangent également les récits de voyage (de Cartier, de Champlain…), les relations (des jésuites), les écrits historiques (en particulier ceux de Garneau), les correspondances (comme celle de Marie de l’Incarnation), mais aussi des écrits politiques et des publications tirées des journaux. Les limites de l’histoire littéraire québécoise sont ainsi nettement plus poreuses que celles de la France, où les oeuvres ayant un statut similaire (par exemple les lettres de Madame de Sévigné, les sermons de Bossuet, etc.) ne jouent qu’un rôle relativement mineur. C’est ce qui explique, par exemple, qu’Arthur Buies soit considéré comme l’un des écrivains importants du xixe siècle, même s’il n’a jamais publié de textes relevant d’un genre reconnu comme le roman ou la poésie[18].
Si l’on peut supposer que, pour Morisset et les autres auteurs évoqués précédemment, des textes anciens comme ceux de Cartier ou de Marie de l’Incarnation puissent se situer à l’intérieur des limites de l’histoire littéraire, il semble clair que ces écrits ne relèvent pas du domaine de la « littérature » à proprement parler. Pour ces écrivains, l’émergence d’une véritable littérature nationale se situe quelque part dans les dernières décennies du xixe siècle, selon une chronologie similaire à celle qui se dégage de plusieurs manuels de littérature québécoise du xxe siècle. Les travaux de Karine Cellard à ce sujet montrent en effet comment l’idée d’un xixe siècle fondateur prend forme dès la première version du manuel de Camille Roy, pour se retrouver, avec différentes variantes, dans la plupart des textes didactiques des décennies suivantes[19]. Même en tenant compte des éléments de nouveauté apportés par chaque texte de fiction — les filiations entre Buies et les auteurs de la Révolution tranquille par exemple —, on peut observer la persistance de cette idée qui s’est transmise tout au long du xxe siècle et se voit réactualisée à travers les fictions de la décennie 1990 afin, semble-t-il, de contrer le défaut de mémoire qui est toujours le lot de la littérature québécoise.
+
Deux constructions différentes de la mémoire sont donc à l’oeuvre dans le récit de Morisset : la mémoire en crise du présentisme et la mémoire littéraire québécoise, laquelle s’avère, dans le contexte des années 1990, tout particulièrement teintée par la question de l’identité nationale. Pour Morisset comme pour beaucoup de ses contemporains, la définition de cette identité passe par une réécriture de l’histoire littéraire, et plus particulièrement d’un nouveau repérage de ses origines. À partir de l’oeuvre de Buies, l’évolution de la littérature québécoise est donc repensée, de sorte que l’oeuvre porte en elle une conception du temps qui lui est propre, où les progrès se mesurent par comparaison avec la littérature du xixe siècle. Bien qu’il ne soit pas entièrement étranger aux considérations extérieures à la littérature et qu’il reconduise des idées circulant déjà dans les manuels et les ouvrages du xxe siècle, l’arc narratif de cette histoire littéraire n’en est pas moins entièrement basé sur Buies et sur les enjeux évoqués dans son oeuvre. Si, à travers ce discours sur la littérature, le texte témoigne quand même de la crise du temps présentiste, c’est avant tout parce qu’il emploie des notions et des termes centraux de ce régime pour parler du passé, en ramenant Buies dans le présent, en faisant de lui une figure patrimoniale dont il faut assurer la conservation, et en le plaçant au coeur d’une démarche identitaire.
On pourrait également arguer que le texte de Morisset évoque à plusieurs égards le régime moderne d’historicité, puisqu’en cherchant à retracer la généalogie d’une pensée nationale et en soulignant l’évolution des idées et de la littérature, la narratrice fait en effet de l’histoire du Québec une véritable marche vers le progrès. Cette vision de l’avenir s’opposant fortement au point de vue présentiste, où le futur est plutôt perçu comme une période inquiétante, montre bien la nature complexe du rapport au temps du récit de Morisset. Reposant sur la métaphore foncièrement présentiste d’un Buies toujours présent dans la société par le biais de son héritage littéraire et intellectuel, le texte n’en pose pas moins un regard positif sur l’avenir, contribuant à donner l’image d’une société et d’une littérature en constante amélioration.
Ces différentes manières d’envisager le rapport au passé de l’oeuvre ne sont pas en concurrence. C’est-à-dire que le présentisme et les enjeux liés à l’histoire littéraire sont inextricablement liés dans l’oeuvre de Morisset, et ces perspectives ne se discréditent jamais mutuellement, même si leur conjonction engendre un rapport inédit à l’histoire et une articulation originale des catégories temporelles. Il apparaît néanmoins clair que la grille de lecture que constitue la notion de régime d’historicité doit être adaptée et révisée pour rendre compte du type particulier de discours que représente le texte littéraire et pour éclairer la façon dont il témoigne d’un rapport au temps contemporain.
On peut souligner que, même si Hartog lui-même utilise la notion pour l’analyse de textes littéraires, ses lectures sont avant tout marquées par la perspective historique et ne mettent pas à profit d’outils proprement littéraires. L’une des conséquences de ce biais est d’escamoter en partie ce qui fait la spécificité de chaque mode de représentation du passé. Cette situation découle de la nature même de la notion de régime d’historicité qui permet d’adopter un point de vue très général, en soulignant les points communs de types de discours extrêmement variés. Le coût de cette approche globalisante est toutefois de négliger les caractéristiques particulières d’un texte au profit des traits qui permettent de l’inscrire dans un ensemble. Chaque représentation du passé possède en effet ses propres conditions d’émission, une poétique qui lui est propre et son cadre pragmatique spécifique. Plus particulièrement dans le cas d’oeuvres fictionnelles, les représentations du passé sont aussi un espace de projection où se manifeste l’imaginaire contemporain et où peuvent être reformulées des questions dépassant largement le cadre de la littérature. Toutes ces caractéristiques ont une influence sur la manière dont se manifeste le rapport au temps dans le texte et instaurent une infinité de variations et de nuances dans un régime d’historicité donné.
Appendices
Note biographique
PIERRE-OLIVIER BOUCHARD est chercheur postdoctoral à l’Université du Québec à Montréal. Membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), il s’intéresse au rapport au passé, aux expériences du temps et à la représentation de l’histoire dans les littératures françaises et québécoises. Son projet de recherche intitulé « Le passé qui ne meurt pas : la crise de la modernité du Québec vue par les magazines illustrés » s’intéresse à la représentation du Québec des années 1930 dans des magazines français, québécois et américains.
Notes
-
[1]
Micheline Morisset, Arthur Buies, chevalier errant, Québec, Nota bene/Société Radio-Canada, coll. « Proses », 2000, 208 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle AB suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[2]
La journée d’étude Expériences du temps, de la mémoire et de l’histoire dans les écritures contemporaines québécoises, qui s’est tenue le 14 juin 2016 à la Maison de la littérature de Québec et a servi de point de départ à une partie des textes composant ce dossier, en est un bon exemple.
-
[3]
Jean-Louis Jeannelle, Marielle Macé et Michel Murat (dir.), L’histoire littéraire des écrivains, préface d’Antoine Compagnon, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, coll. « Lettres françaises », 2013, 367 p.
-
[4]
Voir François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire », 2012 [2003], p. 97-140, et François Hartog, « La temporalisation du temps : une longue marche », Jacques André, Sylvie Dreyfus-Asséo et François Hartog (dir.), Les récits du temps, Paris, Presses universitaires de France, 2009, p. 9-29.
-
[5]
François Hartog, « La temporalisation du temps : une longue marche », p. 11.
-
[6]
Ibid.
-
[7]
Ibid.
-
[8]
François Hartog, Régimes d’historicité, p. 38. Pour une plus ample définition du présentisme, voir aussi p. 15-16, p. 29 et p. 37-42.
-
[9]
Arthur Buies, Réminiscences, t. II : Les jeunes barbares, Québec, Imprimerie de l’électeur, 1892, p. 61-110.
-
[10]
Jean-Louis Jeannelle, Marielle Macé et Michel Murat (dir.), L’histoire littéraire des écrivains, p. 21-23.
-
[11]
William Marx, « Transmission et mémoire », Jean-Louis Jeannelle, Marielle Macé et Michel Murat (dir.), L’histoire littéraire des écrivains, p. 135-136.
-
[12]
Soulignons que, dans une perspective similaire, Jules Fournier défendait, au début du xxe siècle, l’idée de la nécessité d’une critique littéraire sérieuse pour faire advenir une littérature de qualité (voir Mon encrier. Recueil posthume d’études et d’articles choisis, dont deux inédits, Montréal, Madame Jules Fournier, 1922, 2 vol.). Dans les années 1950, Yves Thériault a aussi abordé cette question en soulignant, parfois durement, les lacunes de la critique au Québec — dans la presse, mais aussi dans les établissements d’éducation —, prônant, sans le formuler ainsi, l’établissement d’une tradition lectorale et académique qui favoriserait un meilleur climat culturel pour les écrivains et le développement de la littérature québécoise. Voir entre autres « Coup de pioche dans notre sol » dans Textes et documents, choix des textes, présentation et documentation par Renald Bérubé, Montréal, Leméac, coll. « Documents », 1969, p. 90-95.
-
[13]
George-André Vachon, « Le domaine littéraire québécois en perspective cavalière », Pierre de Grandpré (dir.), Histoire de la littérature française du Québec, t. I : 1534-1900, réimpression révisée, Montréal, Librairie Beauchemin, 1971 [1967], p. 28.
-
[14]
Ibid.
-
[15]
Voir Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), Histoire de la littérature québécoise, avec la collaboration de Martine-Emmanuelle Lapointe, Montréal, Boréal, coll. « Boréal compact », 2010, p. 13-14.
-
[16]
André Gaulin, « Avons-nous une tradition de lecture ? », Québec français, no 94, été 1994, p. 69-70.
-
[17]
Michel Tremblay, Nelligan. Livret d’opéra, musique d’André Gagnon, Montréal, Leméac, coll. « Théâtre », 1990, 90 p. ; André Vanasse, Émile Nelligan, le spasme de vivre, Montréal, XYZ éditeur, coll. « Les grandes figures », 1996, 201 p. ; Aude Nantais et Jean-Joseph Tremblay, Le portrait déchiré de Nelligan, préface de Jean Royer, Montréal, L’Hexagone, coll. « Voies », 1992, 117 p.
-
[18]
Sur ces questions, on peut consulter notamment Lucie Robert, « La littérature québécoise. “Québécoise”, avez-vous dit ? Notes sur un adjectif », Karine Cellard et Martine-Emmanuelle Lapointe, Transmission et héritages de la littérature québécoise, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2011, p. 17-31.
-
[19]
Karine Cellard, Leçons de littérature. Un siècle de manuels scolaires au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Nouvelles études québécoises », 2011, 387 p.