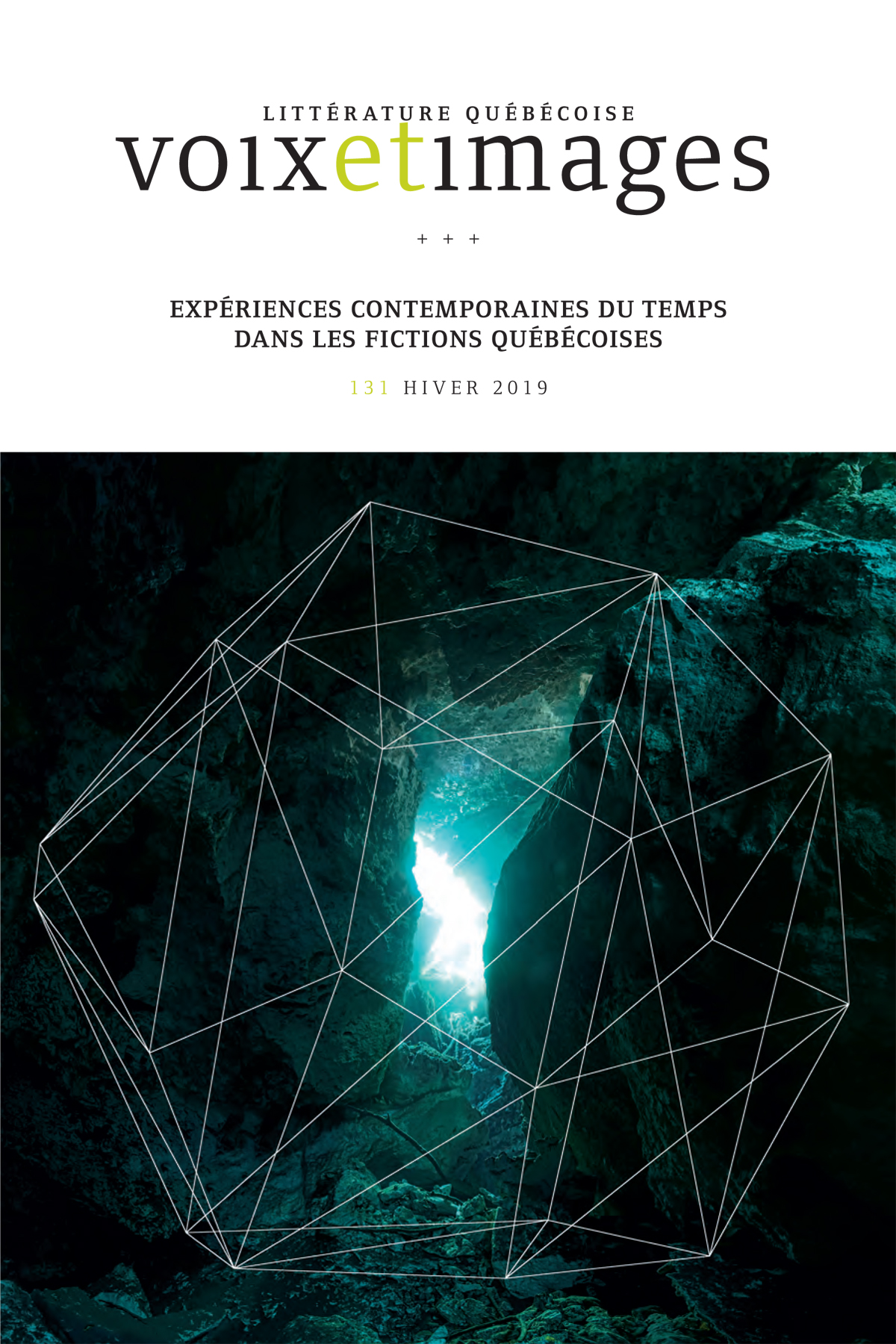Article body
C’est bien connu, tout se vend ; la littérature (ou, devrais-je dire, les écrivain.e.s) ne faisant évidemment pas exception. Prenez Samuel Beckett ; pensez à son visage. Pensez à toutes les phrases que l’on pourrait citer hors contexte. Par exemple : « Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter. » Merveilleux. Imprimez la phrase sur une carte, ajoutez son beau visage, creusé par l’inquiétude, et offrez-la à un ou une ami.e. Vous pouvez même en faire un slogan de pensée positive (super !)[1]. N’essayez pas de trouver la référence précise, en revanche (en français ou en anglais), le seul gage d’authenticité de la phrase, semble-t-il, étant le nombre de reprises. Que Beckett, en disant cela, pensait à la littérature irlandaise, pourquoi s’en soucier ? Ou devrait-on ? Il voulait dire écrire, alors ? Transposons le contexte à aujourd’hui. On pourrait, à certains égards, être porté à chanter. Ou à écrire. On ne s’en prive pas, d’ailleurs, avec la merde de l’époque en tête ou non. L’écriture, dans ce cas, peut faire office de refuge ou d’arme[2]. Les trois livres dont il sera question ci-dessous ont en commun d’opposer l’écriture à l’époque, soit par une forme de repli, soit pour lutter, avec les armes du discours, contre l’hégémonie ambiante.
+
Commençons avec la question du travail. Il fut un temps où les films de Denys Arcand étaient porteurs de révolte, d’impatience, voire de colère face à une soumission perçue comme déraisonnable ; celle des travailleuses et travailleurs du textile, par exemple, qu’il avait longuement interrogés pour le documentaire On est au coton. Transposée en matériau de fiction, cette somme d’affects a donné lieu, en vrac, à : un viol collectif ; une vengeance exercée à coups de chaînes et de bâtons de baseball en plein visage ; un gros plan sur les résidus rougeâtres rejetés par la cheminée d’éjection d’un souffleur à neige après qu’il a happé le corps d’un motoneigiste. Pour que l’on comprenne bien la portée sociale et politique d’un tel déchaînement, Gina reprenait, à la suite de la censure qui obligera On est au coton à circuler sous le manteau, des citations explicites du documentaire (Frédérique Collin, notamment, dont le personnage de Dolorès livre mot pour mot un extrait du témoignage de Carmen Bertrand), le film mettant en scène une équipe de cinéastes de « l’Office national du cinéma » en visite à Louiseville afin de tourner un documentaire sur l’industrie du textile. C’est à une violence similaire, aussi excessive, aussi crue, que nous convie Kevin Lambert dans son deuxième roman, Querelle de Roberval[3]. Et au même mélange d’excès et de distanciation, nourri par une enquête qui donne à certaines sections du livre des accents proprement documentaires, alors que des éléments empruntés au théâtre antique viennent au contraire souligner la construction du dispositif.
Résumé simplement, Querelle de Roberval se veut le récit d’une grève, celle des travailleurs et travailleuses de la scierie de Roberval. Or on le sait, la capitalisation financière des entreprises et la diminution du poids symbolique des syndicats dans le climat actuel rendent les conflits de travail défavorables aux travailleurs[4]. Le conflit représenté se terminera en toute logique en catastrophe. À ce récit se greffe d’emblée ce qui est décrit comme un corps étranger : le héros éponyme, Querelle, d’un roman de Jean Genet, « copié-collé » dans le récit afin de servir de « grain de sable dans l’engrenage de la machine économique, hétérosexuelle et patriarcale[5] ». Beau, musclé, à la virilité « minutieusement pétri[e] » (115) et décidée pour lui par les vétérans d’un bar gai de la métropole selon le « patron usé » de la « position top » (117), Querelle suscite le désir des jeunes garçons de Roberval, et avec lui la crainte, si ce n’est « les envies les plus inavouables » (86), incestueuses, de leur père. La figure qui sert d’interface à ces deux registres de la demande (sociale et sexuelle) prend les traits de trois jeunes amants isolés décrits comme de la « graine de terroristes » (123), constamment défoncés, prêts à tout pour accéder à leur jouissance, et que le titre de la section dans laquelle ils font leur apparition revêt des oripeaux marxistes du « lumpenprolétariat ». On se souviendra que Marx désigne ainsi ceux qui échappent à la division des moyens de production entre la bourgeoisie et la force de travail, flottant entre le monde rural et la ville, déclassés parmi les déclassés, prêts à se vendre au plus offrant, et qu’il décrit comme « rebut », « déchet » et l’« écume de toutes les classes de la société » sur laquelle Louis Bonaparte peut s’appuyer dans son coup d’État[6]. Ils serviront ici d’agents provocateurs pour le compte de Brian Ferland, le patron de la scierie, en incendiant la veille de Noël la demeure des grévistes, tout en poursuivant leur repli dans les marges de Roberval, exclusivement occupés par la recherche mortifère de leur jouissance. Lambert se sert donc de ce conflit de travail comme d’un révélateur, esquissant à terme une division proprement politique à même la pluralité de voix que son roman donne à entendre : celles des travailleuses et travailleurs, elles-mêmes plurielles, et des discours syndicaux qui accompagnent tout arrêt de travail ; celle du patronat ; celle des travailleurs forestiers immanquablement affectés par ce premier conflit ; celle, diffuse, de l’antisyndicalisme qui traverse à des degrés divers la classe moyenne de l’époque ; celle du capital (Évolu), qui, sous ses atours locaux, permet d’inclure la demande mondialisée des marchés pour le rendement ; celle, enfin, quasi hégémonique dans certaines régions du Québec (et en Amérique en général), d’un populisme de droite entretenu et relayé par la radio parlée (« KYK Radio-X »), venant marginaliser celle déjà anachronique des grévistes. D’ailleurs, Lambert ne laisse pas le moindre doute sur le sort imparti aux grévistes : celui-ci sera tragique, comme l’indique la division du roman en autant de parties directement tirées de la tragédie antique (« Prologue », « Parodos », « Stasimon », « Kommos », « Exodos » et « Épilogue »).
Car ultimement, la question posée par le roman a trait à la nécessité. Les conditions de travail sont-elles condamnées à reculer dans le contexte d’une concurrence mondialisée ? Les conflits de travail — on peut penser à ceux ayant sévi dans les journaux de Québecor Média — se soldent-ils nécessairement au détriment des travailleuses et travailleurs ? La grève sert-elle leurs intérêts ou ceux des entreprises, qui, comme l’explique Brian Ferland à son père, peuvent profiter de tels conflits pour « rééquilibrer les ventes et la production » (37) ? S’interrogeant, à propos des tragédies tirées des mythes d’Oedipe ou de Médée, sur ce qui fait d’un meurtre un meurtre tragique, Jacqueline de Romilly précise qu’il doit être « rattach[é] à des causes qui dépassent le cas individuel et qui l[e] rend[ent] nécessair[e] au nom de circonstances s’imposant à l’homme[7] ». Lorsque la partie est terminée, perdue irrémédiablement pour les travailleurs, ceux-ci prêtent serment pour « s’enrôler dans l’apostolat du pire » (222), ce qui poussera Jézabel, en réponse à la mort de Querelle, à commettre l’irréparable. Le meurtre des deux enfants de Brian Ferland, dans cette dramaturgie du pire, se justifie-t-il par les circonstances ? Ce serait évidemment trop dire. Ce serait aussi priver Jézabel de sa responsabilité. Or, rappelle Romilly, c’est l’« un des traits les plus remarquables de la pensée grecque [:] la possibilité d’expliquer tout événement sur deux plans à la fois et par deux causalités, qui se combinent et se superposent[8] » ; l’une divine et nécessaire, l’autre libre et humaine. Force est de constater que le roman de Lambert cherche précisément, par ces références à la tragédie (et non au tragique, il faut le noter), à interroger les limites de cette liberté, de cette responsabilité — limites de l’action des travailleuses et travailleurs dans des conditions socioéconomiques qui prescrivent l’issue du conflit à l’avance.
On pourrait donc voir dans l’outrance de la violence du roman une sorte de compensation, de règlement des comptes symboliques. Il se trouve que Querelle de Roberval est beaucoup plus que cela, construisant, à travers l’articulation de demandes hétérogènes, ce qu’Ernesto Laclau appelle une « chaîne d’équivalence », c’est-à-dire la « formation d’une frontière antagoniste[9] » à travers la constitution de véritables identités politiques. Car c’est à une guerre culturelle que se livre l’auteur, dont l’une des stratégies vise précisément à délimiter les fractures sociales. Mais comme bien des guerres récentes, celle-ci sera longue, et n’en est qu’à ses balbutiements. Querelle, personnage qui incarne la mise en commun des revendications queer et sociales du roman, meurt au bout de son sang, égorgé et le dos brisé par le représentant viril, bien stéréotypé, des travailleurs forestiers. Le meneur des grévistes, Jacques Fauteux, se suicide dans sa grange et, surtout, se livre dans sa lettre de suicide à une charge misogyne, homophobe et islamophobe, intégrant à son discours progressiste sur le plan socioéconomique le catalogue des plaintes et misères régionales propres à certaines radios parlées. Il n’y a peut-être que les trois anges inquiétants qui ne cèdent pas, eux qui sont appréhendés après avoir profané (et de quelle manière !) le cadavre de Querelle, soignés de force de cette maladie incurable « qu’on s’injecte bareback » (267) qui fait leur fierté, séparés et renvoyés, qui en famille d’accueil, qui dans le sous-sol familial ; ils se suicideront simultanément en direct sur Internet, faisant le bonheur de « trois mille heureux » fascinés par ces « suicide boys » (269). Heureusement, il faut aussi compter avec le jeu polyphonique des tons et des voix, le roman passant d’une esthétique de l’outrance, volontairement choquante, à l’empathie la plus tendre. La fin du roman est à cet égard exemplaire, l’auteur parvenant avec virtuosité à transmettre la gravité de Jézabel, au moment où elle commet son double infanticide, avant de retrouver une légèreté de ton proprement carnavalesque lorsque le père des enfants et patron de l’usine grille à feu doux avant le festin final aux abords du lac. Une journée à la plage avant de reprendre la lutte.
+
La nouvelle collection « Difforme », chez Triptyque, se définit par une propension à échapper aux catégories existantes, aussi bien de natures générique, esthétique, que socionormative. Après une traduction de The Argonauts (Les argonautes) de Maggie Nelson, c’est au tour du premier roman de Clara Dupuis-Morency, Mère d’invention[10], de paraître dans la collection. Divisé en deux parties, la première déployant une parole impossible adressée à l’enfant qu’aurait pu être celui que portait la narratrice avant d’interrompre sa grossesse, la seconde accompagnant la gestation et la mise au monde de jumelles, le roman se présente comme un journal — une scène d’écriture — consignant les différentes étapes de cette double gestation, à laquelle il faut encore ajouter celle d’une thèse sur Proust et Sebald. Jouant la fonction d’une véritable transcendance, au-delà même de la forme finie des idées, l’écriture est ce qui redonne du possible à ce qui semblait clos (« t’écrire […] me donne enfin un peu d’air, j’arrive à respirer dans cet espace que j’ai créé, que je crée au fur et à mesure, où je peux rêver dans tes possibilités, dans l’incommensurable de tes rêves à venir » [41]). Elle a donc tout à voir, le roman ne cesse d’y insister, avec le temps, les différentes temporalités qu’elle ne peut manquer de convoquer, et que la narratrice traque, tout au long de sa gestation dédoublée, chez les écrivains qui font l’objet de ses recherches. À quel moment précis le désir d’un enfant s’est-il mué en impossibilité ? Qu’est-ce qui relie la fin des possibles avec la suspension du temps ? Comment intégrer l’interruption propre à la maternité au corps et au temps de l’écriture ? Ces questions, Clara Dupuis-Morency les creuse à même son matériau (rythmique) : le flux, parfois délié, parfois contraint, de ses phrases. C’est même cette question du temps qui permet de relier l’espace intellectuel, voire abstrait, de la thèse (sur « l’informe du temps » [108], justement) et le corps, le corps d’écriture qui dédouble la thèse en forme de respiration, la machine à scruter les signes de la maternité qu’est ce journal de création, lui-même informe, qui cherche par anticipation à aménager l’espace temporel où pourra exister cette écriture une fois la vie bouleversée par non pas une, mais deux vies inopinées.
Mais parler du corps traduit imparfaitement le caractère obsessionnel d’une parole angoissée qui interroge non seulement les signes de son présent incarné, mais aussi les conséquences à la fois passées (un moment inadéquat révélant un désir d’enfant) et futures (ce que signifie pour l’écriture la modalité d’interruption propre au fait d’être mère) de la révélation qui suit l’avortement de la narratrice, dès lors située entre « Saul et Paul » (103).
On pourrait croire qu’un livre aussi occupé par le corps, les signes passés, non advenus, du corps et ceux, accaparants, du présent, offre une perspective restreinte, intime et individuelle. Or, c’est tout le contraire que Mère d’invention permet de penser. La réflexion qui accompagne le passage d’une expérience manquée de la maternité à sa réalisation donne lieu à une pensée du temps qui fait écho à toute une réflexion sur la mémoire ; sur ce qu’il convient de conserver des possibles demeurés entravés, sur ce qui, de ces possibles, demeure présent, insu et agissant. Elle s’ouvre aussi à une entreprise de nomination de ce qu’une telle expérience de l’entre-deux fait surgir : « [L]a maternité, ce n’est bien sûr pas le bon mot, bien sûr, mais comment marquer, comment nommer ce qui s’est passé, et qui n’a pas été nommé, qu’on a choisi de ne pas nommer, et quand l’autre maternité, la vraie, arrivera, est-ce que ça invalidera la première ? » (105) Dupuis-Morency interroge, scrute, reprend sans cesse, sur le mode de l’épanorthose, l’élaboration de son propre tâtonnement, qui est le signe d’une exigence qui refuse les catégories préétablies. Loin de toute mélancolie, l’interruption de grossesse racontée dès le début du texte se présente plutôt comme la confirmation d’un désir, et donc d’une parole vouée à errer, à « passer la limite du sens du monde » (84), comme l’affirme la narratrice dans une filiation revendiquée avec Angot, qu’elle lit compulsivement, mais aussi Duras, et « Catherine » (Mavrikakis), sa directrice de thèse. Autant d’écrivaines ayant fait de la maternité, à un moment ou à un autre de leur oeuvre, un seuil, mais aussi une condition de l’écriture.
Une dernière section, « Caedere », s’efforce de mettre un terme à cet enchevêtrement de la grossesse et de la thèse, dans un tâtonnement (« il y a bien un lien, même mince, il doit y avoir un passage, entre les deux » [175]) qui traduit bien l’incertitude affolante de la parole, et qui paradoxalement lui donne toute sa clarté. Ainsi, après plusieurs rêves sur le col, le franchissement des jumelles à naître, vient le récit d’une césarienne (évidemment, il fallait couper le lien) qui rappelle à la narratrice l’expérience manquée de la soutenance, marquée par l’absence de la spécialiste, par qui devait passer l’épreuve, et le concert d’éloges convenus. Évoquant la sexualisation à outrance du corps qui amène certains milieux à privilégier la césarienne (qu’est-ce que quelques muscles sectionnés à côté d’un vagin « préservé, intact » [170]), la narratrice, avec sarcasme, peut asséner que « ça rassure tout le monde, le vagin et la thèse, intouchés » (175). On aura compris que Mère d’invention met de l’avant une pensée tout autre, faite d’épreuves, d’hésitations et de retours en arrière ; à la hauteur du réel.
+
Dans une tonalité aux antipodes des romans de Lambert et de Dupuis-Morency, le plus récent roman de Patrick Brisebois met en scène les dernières extrémités de la solitude. Auteur d’une oeuvre déjà importante, dont sa « trilogie sinistre[11] », parue à l’Effet pourpre, et un recueil de poésie, Carcasses au crépuscule, récemment republié aux éditions de l’Écrou, Patrick Brisebois n’avait plus rien publié de nouveau depuis Catéchèse[12], en 2006, avant que Le modèle de Nice[13] ne paraisse. La trajectoire de Constantin, écrivain à la recherche d’une justesse de plus en plus difficile à atteindre, nous permet de mieux mesurer cette rareté. Lecteur boulimique et iconoclaste, écrivain oscillant entre une écriture minimaliste et les romans de fantasy, Constantin achète une petite maison centenaire à La Meunière afin d’éviter de retourner vivre à Montréal lorsque sa conjointe quitte La Malbaie pour commencer l’université. Il s’y promène, hésite sur la manière de classer ses trop nombreux livres, boit et passe ses nuits à regarder des films ou des séries de science-fiction. Depuis toujours, Constantin y revient à plus d’une reprise,
il se cache derrière ses jouets, ses comics, ses livres, ses films, ses jeux de rôle, ses jeux vidéo, sa musique. Il a eu peur de devenir adulte et comme un personnage ducharmien il a voulu rester enfant et l’imaginaire et l’écriture sont ce qui lui a semblé le plus approprié […].
33
Mais force est de constater que cette fuite du réel a son prix, celui d’une solitude de plus en plus difficile à porter, d’une peur du réel qui va en s’aggravant, d’une mélancolie qui avec les années se teinte d’amertume. Car cette fuite n’empêche nullement la lucidité, dont elle serait plutôt l’un des effets : « Tout va mal et on ne peut rien y changer. Il n’écoute plus tellement les bulletins d’informations […]. Il préfère lire des bandes dessinées ou jouer à un jeu vidéo. Il se sent plus tranquille ainsi et la vie sur Terre est moins inquiétante. Il sait qu’il se cache la tête dans le sable. » (62-63)
Il s’agit donc de trouver la juste distance avec cette société qui lui fait peur, ce que lui permettent La Meunière, cette petite ville « ennuyante, mortifère [et] dépeuplée » (62), Angéline, adulescente comme Constantin qui habite toujours chez sa mère, se décrit comme « infréquentable » (59) et avec qui il picole volontiers, mais aussi l’écriture ; les quelques mots qu’il lui arrive encore d’écrire, échappant au storytelling qu’il récuse (« plus de personnages, plus de narration, que le chant ténu de l’atroce » [67]). Difficile, dans cette solitude aménagée au moyen des vestiges de l’enfance (des figurines Star Wars vintage aux silhouettes des sylvidres qu’il retrouve chez Marianne, sa conjointe), d’imaginer ce que pourrait être cet atroce qui l’étreint. Peut-être la misanthropie qui le guette, les fissures de la maison trop vieille qu’il décide, à la fin du livre, de laisser mourir sans intervenir, l’absence d’amour décrite par Fitzgerald dans La fêlure et qui est consécutive à la fuite dans l’imaginaire[14]. Or, c’est aussi le prix à payer, Brisebois le sait bien, pour régler la justesse de son regard sur la déliquescence du réel. « Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses, disait Hemingway. Constantin écrit la phrase la plus vraie, il écrit : Ma solitude n’aura pas été bonne. » (4e de couverture) Jacques Ferron, fils du notaire de Louiseville, ville d’adoption de Brisebois, expliquait le retrait de la vie publique de Gabrielle Roy à la fin de sa vie par le fait qu’elle avait « trop écrit » : « [I]l n’y a rien, absolument rien de vivant parmi les heures consacrées à l’écriture, […] ce n’est rien d’autre qu’un désert et qu’un manuscrit[15]. » « Le langage, la conscience des choses se rétrécissent comme une peau de chagrin », constate Constantin avant de conclure qu’« il n’est plus ni romancier ni poète. Il ne sait plus ce qu’il est dans l’écriture » (68-69). Cette crise de Constantin est très exactement ce qui fait de Brisebois un écrivain indispensable. Mêlant fragments poétiques de récits d’anticipation et aléas tragi-comiques d’un mésadapté laissé derrière par le train de l’histoire, Brisebois nous offre à travers son Modèle de Nice quelques-unes des phrases les plus justes qu’il m’ait été donné de lire ces dernières années.
+
Dans ces trois livres, comme dans les milieux littéraires, culturels et intellectuels en général, on note une insistance sur le difforme, le passage, l’ouverture queer de l’identité. Pourquoi une telle insistance ? À quoi répond-elle ? Dans quelle merde, pour reprendre le mot de Beckett, ou marasme cette ouverture s’inscrit-elle ? On peut se demander si les débats identitaires crispés, récurrents, obsessionnels, qui continuent, encore aujourd’hui, de saturer l’espace public (politique et médiatique, à tout le moins), n’appellent pas le besoin de nommer ce qui pourtant va de soi pour plusieurs. Une rubrique intitulée « Roman » répond-elle toujours adéquatement à ce désir (contre-)hégémonique de faire éclater les frontières ? « L’obsession de la catégorie, écrit Clara Dupuis-Morency, c’est une obsession de l’individuel, ça nous vient de notre état constitué, sexué, irréversible. Mais la vie modulaire, le polype, elle n’en a rien à faire des distinctions. Elle prolifère. » (118) Gardons-nous de nous jeter dans l’indifférencié. Mais prenons des notes.
Appendices
Note biographique
STÉPHANE INKEL est professeur au Département d’études françaises de l’Université Queen’s, dont il est actuellement le directeur intérimaire. Il mène depuis quelques années un projet de recherche sur les notions d’historicité et de messianisme dans la littérature québécoise, et travaille également sur les écritures politiques dans le roman contemporain. Il est l’auteur d’un livre sur Hervé Bouchard, Le Paradoxe de l’écrivain, publié aux éditions La Peuplade.
Notes
-
[1]
Voir, par exemple, la page suivante : http://www.printempsdeloptimisme.com/beckett-samuel-quand-on-est-dans-la-merde-jusquau-cou-il-ne-reste-plus-qua-chanter/ (page consultée le 5 février 2019).
-
[2]
Je pense ici au collectif de Jean-Christophe Bailly, Jean-Marie Gleize, Christophe Hanna, Hugues Jallon, Manuel Joseph, Jacques-Henri Michot, Yves Pagès, Véronique Pittolo et Nathalie Quintane, « Toi aussi, tu as des armes. » Poésie et politique, Paris, La fabrique, 2011, 208 p. La citation du titre vient du Journal de Franz Kafka, entrée du 12 juin 1923.
-
[3]
Kevin Lambert, Querelle de Roberval. Fiction syndicale, Montréal, Héliotrope, 2018, 277 p.
-
[4]
Voir, sur cette question, Barry Eidlin, « Crise de légitimité du mouvement syndical à l’ère de Trump », Nouveaux Cahiers du socialisme, no 19, hiver 2018, p. 98-107. En entrevue à l’émission radiophonique Plus on est de fous, plus on lit, Kevin Lambert évoque explicitement ce nouveau rapport de force lorsqu’il commente les manifestations antisyndicales des travailleurs forestiers touchés par la grève des employé.e.s de la scierie, parlant de l’instrumentalisation de la colère née de l’impuissance face aux structures économiques par ceux qui profitent de ces mêmes structures : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/88364/kevin-lambert-querelle-roberval (page consultée le 5 février 2019).
-
[5]
Quatrième de couverture.
-
[6]
Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, en ligne : https://www.marxists.org/francais/marx/works/1851/12/brum7.htm (page consultée le 5 février 2019). Voir aussi le chapitre « Bourgeois et prolétaires » du Manifeste du Parti communiste, où Marx et Engels évoquent également ce « lumpenprolétariat » comme une « vermine passive, lie des plus basses couches de la société [qui] peut se trouver entraînée dans le mouvement par une révolution prolétarienne ; cependant, ses conditions de vie la disposeront plutôt à se vendre à la réaction ». Cités dans Karl Marx, Oeuvres choisies I, choix de Norbert Guterman et Henri Lefebvre, traduit de l’allemand par Laura Lafargue, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1963, p. 247.
-
[7]
Jacqueline de Romilly, La tragédie grecque, 4e édition, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 1992 [1970], p. 169.
-
[8]
Ibid., p. 172.
-
[9]
Ernesto Laclau, La raison populiste, traduit de l’anglais par Jean-Pierre Ricard, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Ordre philosophique », 2008, p. 93.
-
[10]
Clara Dupuis-Morency, Mère d’invention, Montréal, Triptyque, coll. « Difforme », 2018, 195 p.
-
[11]
Patrick Brisebois, Que jeunesse trépasse, Montréal, L’Effet pourpre, 1999, 236 p. ; Trépanés, Montréal, L’Effet pourpre, 2000, 197 p. (repris au Quartanier, coll. « Série QR », 2011, 184 p. Édition définitive/texte revu par l’auteur) ; Chant pour enfants morts, Montréal, L’Effet pourpre, 2003, 133 p. (repris au Quartanier, coll. « Série QR », 2011, 172 p. Édition définitive/texte revu par l’auteur).
-
[12]
Patrick Brisebois, Catéchèse, Québec, Alto, 2006, 92 p.
-
[13]
Patrick Brisebois, Le modèle de Nice, Montréal, Le Quartanier, coll. « Série QR », 2018, 148 p.
-
[14]
« Je m’aperçus que depuis longtemps je n’aimais plus les gens ni les choses, mais que je continuais tant bien que mal et machinalement à faire semblant de les aimer. » Francis Scott Fitzgerald, La fêlure, cité par Brisebois (123).
-
[15]
Jacques Ferron, « Des sables, un manuscrit », Du fond de mon arrière-cuisine, Montréal, Éditions du Jour, coll. « Les romanciers du jour », 1973, p. 109.