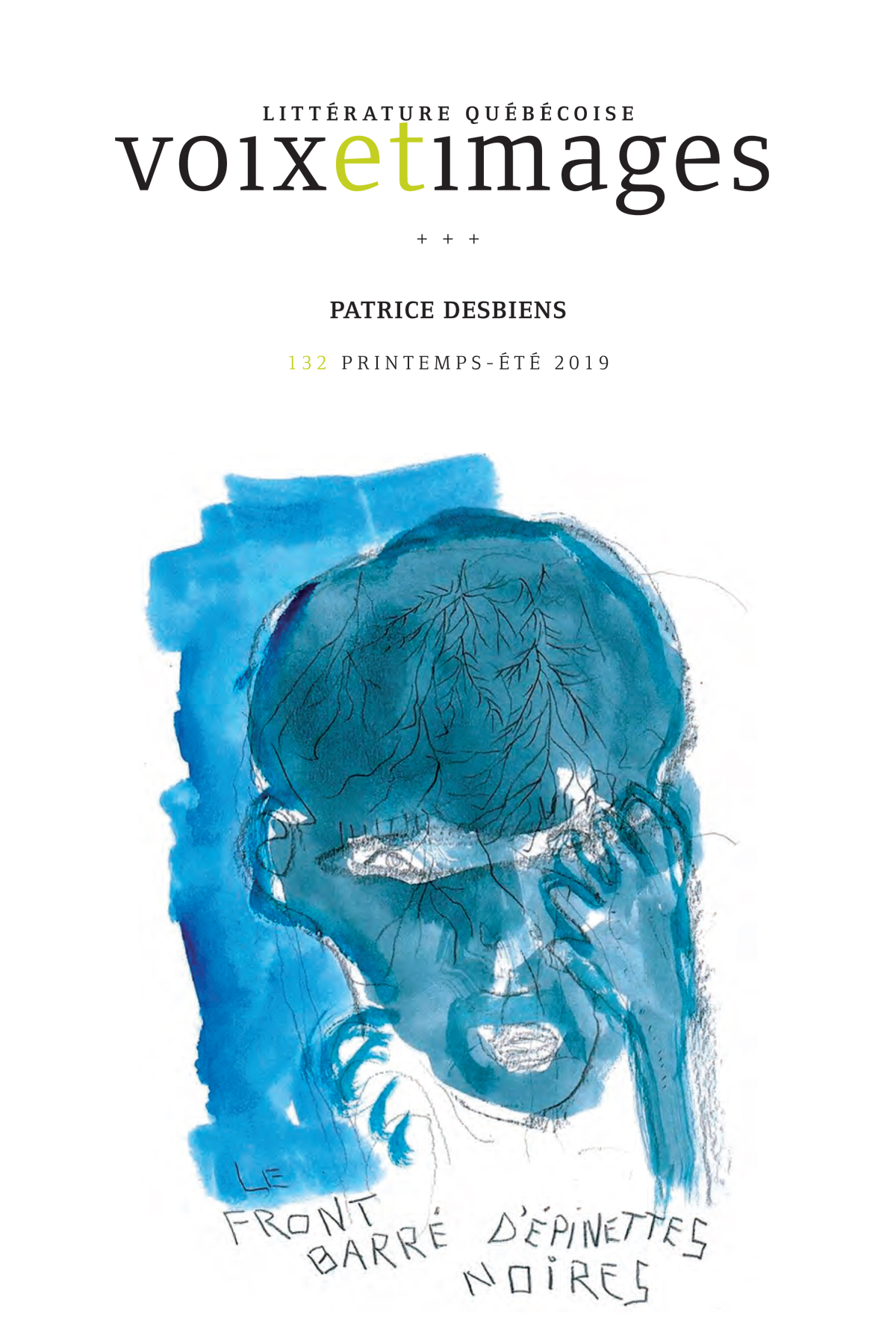Abstracts
Résumé
Les études théâtrales québécoises sont le lieu de débats et de tensions multiples depuis plusieurs années qui résultent, pour une part, de l’emplacement géographique et culturel particulier qu’elles occupent entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Cette étude se propose de cerner le paysage épistémologique de la discipline au Québec en examinant un corpus d’écrits issus de trois communautés savantes portant sur la question de la modernité. Au regard du traitement réservé à cette question par des chercheurs québécois, canadiens et américains, l’analyse tente de retracer le développement de ce domaine de recherche depuis son établissement dans les années 1980 et de nommer les défis qui l’attendent dans un contexte de décloisonnement disciplinaire et d’érosion du théâtre comme référence commune au sein de la culture québécoise.
Abstract
For some years, theatre studies in Québec have been the locus of multiple tensions and debates, partly resulting from their specific geographical and cultural location between Europe and North America. This study is intended to define the discipline’s epistemological landscape in Québec by examining a corpus of writings from three academic communities on the issue of modernity. Having considered the treatment of this question by scholars from Québec, Canada, and the United States, we attempt to describe how theatre studies have evolved as a research area since they were established in the 1980s, and to identify the challenges they face in a context of disappearing boundaries between disciplines and erosion of the theatre as a shared reference in Québec culture.
Resumen
Los estudios teatrales quebequenses son, desde hace varios años, el lugar de debates y tensiones múltiples que resultan, por una parte, del emplazamiento geográfico y cultural particular que ocupan entre Europa y América del Norte. En este estudio, se propone delimitar el paisaje epistemológico de la disciplina en Québec estudiando un corpus de escritos procedentes de tres comunidades cultas sobre la cuestión de la modernidad. En lo que concierne al trato que dan a esta cuestión los investigadores quebequenses, canadienses y estadounidenses, el análisis trata de exponer el desarrollo de este sector de investigación desde su creación, en los años 1980, y enumerar los retos que lo esperan en un contexto de liberalización disciplinaria y erosión del teatro como referencia común en el seno de la cultura quebequense.
Article body
Si l’histoire du théâtre au Québec se présente aujourd’hui sous la forme d’un récit fragmentaire, résultat du travail soutenu de chercheurs dévoués mais ayant oeuvré en ordre dispersé, sa lecture n’offre pas moins une compréhension assez cohérente, sans être unanimiste, de l’évolution de l’activité théâtrale sur ce territoire. Le corpus d’écrits publiés depuis l’émergence d’une expertise savante dans le domaine témoigne, à l’évidence, de la diversité des approches qui caractérise les recherches sur le théâtre québécois, sans que soit pour autant radicalement modifiée la vision historique dominante qui s’est imposée depuis trente ans. Celle-ci se manifeste par le recours à un « horizon commun de justification[2] » qui permet d’identifier les figures et les oeuvres marquantes de l’histoire, d’établir les étapes de son parcours et d’en dégager les forces ayant réglé son développement institutionnel et son évolution esthétique.
L’établissement de ce consensus épistémologique informe sur les lois qui président à la construction du récit aussi bien que sur l’objet (le passé) qui mobilise l’attention des producteurs de la mémoire. Comme d’autres ont pu en témoigner[3] en regard de la production historiographique nationale, des conditions particulières peuvent expliquer la relative homogénéité de la lecture historique du théâtre québécois, la principale étant que celle-ci a été élaborée sur une période assez courte de vingt-cinq ans (1970-1995) par une génération de chercheurs partageant, au-delà de leurs positionnements théoriques et politiques divergents, un même climat idéologique et l’idée que leur mission consistait d’abord à faire du théâtre un objet de recherche légitime. En résulte non pas une version unique de l’histoire, mais un champ des possibles néanmoins bien balisé qui définit le cadre à l’intérieur duquel se développe, depuis, la discipline des études théâtrales au Québec, en proposant notamment un certain nombre d’idées-forces, de modèles heuristiques et d’agencements argumentatifs permettant d’opérer la nécessaire synthèse de l’hétérogène[4] qu’appelle toute mise en récit de l’histoire.
Ce cadre général oriente, en d’autres termes, la discussion que mènent entre eux les agents de ce milieu. Ainsi, un certain nombre de problèmes et de thèmes récurrents, propres à l’évolution des pratiques théâtrales et dramaturgiques au Québec, ont donné lieu à des lectures et à des interprétations divergentes qui n’ont pas entravé, mais plutôt confirmé la formation d’une trame narrative globale du théâtre québécois. Bon nombre de ces thèmes appartiennent à une tradition historiographique bien établie qui prescrit les conditions pour penser le développement du théâtre dans une perspective nationale — que l’on pense aux réalités économiques, technologiques et structurelles ainsi qu’à l’environnement idéologique et politique entourant l’activité théâtrale. Au Québec, comme ailleurs, l’histoire du théâtre aux xixe et xxe siècles reste indissociable en effet du capitalisme industriel émergent et de la mise en place de l’État national. Il en va de même des questions relatives au répertoire, au développement d’une pratique professionnelle, au statut des comédiens, aux instances de réception et de légitimation, à l’aménagement d’une infrastructure de production et de diffusion, enfin à l’évolution de la fonction artistique et symbolique du metteur en scène dans la dynamique théâtrale. Dans la saisie de ces enjeux, la référence au Québec comme réalité culturelle spécifique et expérience historique singulière est, à l’évidence, prise en compte, mais elle se déploie néanmoins dans les limites d’un récit préformaté qui opère suivant des catégories, des figures et des topoï, sans oublier un modèle de périodisation, hérités en grande partie de l’historiographie théâtrale européenne.
POUR UNE HISTOIRE COMPARÉE DES RÉCITS DE LA MODERNITÉ THÉÂTRALE
Nous avons montré dans une précédente étude[5] quelles distorsions le théâtre européen, entendu ici comme matrice narrative hégémonique, pouvait entraîner dans la représentation du passé théâtral québécois. Le choix d’un moment fondateur, par exemple, expose bien l’une des contradictions que doivent résoudre les chercheurs québécois confrontés à la difficulté, comme l’a bien montré Gérard Bouchard, de « construire une mémoire longue à partir d’une histoire courte[6] ». Le consensus établi depuis longtemps autour du Théâtre de Neptune, divertissement présenté à Port-Royal en 1606, confirme ainsi la stratégie visant à inscrire l’activité des spectacles en Nouvelle-France dans la continuité historique de la mère patrie, quitte à produire un récit troué, inconsistant, voué à reprendre sans cesse la question des origines.
Pareille tension dans la construction de la mémoire théâtrale québécoise s’observe à plusieurs échelles. Dans la suite de travaux antérieurs, nous abordons ici un autre chapitre problématique de l’histoire : l’entrée dans la modernité. Notre analyse sera inspirée, comme la précédente, par une approche comparative mettant en regard trois traditions savantes traversées par les préoccupations communes à ce que Bouchard appelle les « nations et cultures du Nouveau Monde ». Au-delà de la comparaison, notre regard porte toutefois prioritairement sur la recherche produite au Québec, à la lumière de laquelle seront examinés des corpus états-uniens et canadiens dans le but de mieux comprendre, là encore, comment s’articule, dans le récit global du développement de l’activité théâtrale en Amérique, l’enjeu de la modernité. Sans anticiper nos conclusions, observons d’emblée qu’à ce chapitre, les stratégies rhétoriques et narratives des uns et des autres apparaissent bien distinctes en dépit du cadre commun dans lequel s’est développé le théâtre dans ces trois sociétés. Ce constat de départ, qu’il faudra par ailleurs détailler, n’est pas sans rapport, à notre avis, avec les conditions particulières ayant présidé à la formation de la discipline au Québec, aux États-Unis et au Canada, de même, et c’est là un point majeur, qu’à la reconfiguration épistémologique de celle-ci dans les années récentes.
Un dernier élément d’ordre méthodologique mérite d’être soulevé avant de passer à l’analyse. La modernité dont il sera question dans ces pages n’apparaît ni homogène ni uniforme. Il convient de rappeler sa valeur de concept par rapport à l’idée courante qui en fait un moment historique précis. Ces deux acceptions font partie du débat permanent entourant la modernité. Pour Baudrillard, Brunn et Lageira[7], celle-ci ne saurait se réduire à l’idée de rupture, et moins encore à un événement qui instaurerait, dans la trame du temps, un avant et un après. Pensée en termes de dialectique, la modernité demeure paradoxalement solidaire de la tradition en ce qu’elle aspire elle-même, sur le mode de la contestation, à exercer une forme de régulation. Son modus operandi, variable selon les circonstances et les contextes, se définirait suivant une logique de l’instabilité permanente des forces gouvernant le monde social, culturel, technique et économique. Retraçant la genèse du terme, les auteurs affirment « qu’il n’existe pas pour autant partout une modernité, c’est-à-dire une structure historique et polémique de changement et de crise. Celle-ci n’est repérable qu’en Europe à partir du xvie siècle, et ne prend tout son sens qu’à partir du xixe siècle[8] ». Ils ajoutent que le terme « ne prend force que dans les pays de longues traditions. Parler de modernité n’a guère de sens quand il s’agit d’un pays sans tradition ni Moyen Âge, comme les États-Unis, et, inversement, la modernité a un impact très fort dans les pays du tiers monde, de forte culture traditionnelle[9] ».
Comment penser, dans ces conditions, la modernité québécoise ? Gardons-nous de conclure trop vite qu’elle n’a pas lieu d’être sur la base d’une assimilation du destin historique du Québec à celui des États-Unis. Nous suivrons en cela les recherches de Gérard Bouchard, qui ont bien montré que l’expérience « américaine » au sud et au nord du 45e parallèle offre des contrastes marqués, notamment en regard de la référence coloniale et de son héritage culturel et symbolique. Si l’on adopte le schéma évolutif de Baudrillard et ses collègues, cela signifie que l’idée de modernité, dans l’espace culturel québécois, serait liée à un rapport singulier, sans équivalent dans les sociétés anglo-saxonnes issues du protestantisme, avec la tradition et le pouvoir normatif qu’elle instaure. Une telle perspective soulève la question, pour nous fondamentale, du théâtre comme scène et rite institutionnels de régulation des forces, des valeurs et des représentations collectives. Comment interpréter, à l’échelle nord-américaine, les disparités et les décalages à cet égard dans le discours savant ainsi que dans le développement de l’activité théâtrale elle-même ? Notre analyse du thème de la modernité sera conduite à la lumière de ce questionnement plus large.
THÉÂTRE QUÉBÉCOIS : LE MIROIR OBSÉDANT DE LA MODERNITÉ
Dans l’ensemble des écrits recensés et analysés dans le cadre de cette étude, le corpus québécois présente assurément le terrain discursif où la question moderne semble recouvrir les enjeux les plus importants. De manière constante depuis les années 1980[10], les chercheurs en études théâtrales, à l’instar de leurs collègues en littérature, en histoire de l’art, en philosophie, sans compter les spécialistes en histoire de toutes allégeances, en ont fait l’une des figures imposées de la recherche sur l’activité théâtrale. De fait, le mouvement correspond, dans l’histoire de ces disciplines, à une volonté de réviser en profondeur le discours commun, diffusé par les élites de la Révolution tranquille, selon lequel le Québec serait advenu à la modernité d’un seul bloc, traçant une ligne séparant désormais les temps anciens et les temps nouveaux. Le travail de réfutation de « l’idéologie du rattrapage[11] », qui fut le mantra des intellectuels des années 1950 et 1960, visait, d’une part, à replacer le débat dans l’histoire longue du processus de modernisation de la société québécoise et, d’autre part, à identifier les différents foyers et les modalités multiples d’apparition d’une dynamique sociale, culturelle et esthétique proprement moderne.
Le choix des mots, dans les circonstances, n’est pas insignifiant. On parlera dès lors d’avènement, d’apprivoisement, de formation, d’apprentissage ; des termes qui décrivent un enchaînement gradué d’opérations couvrant un large éventail de pratiques et de discours, et donnant à voir le développement de la société comme un processus de conscientisation et de subjectivation. Cette approche contraste en effet avec la doctrine des réformateurs de la Révolution tranquille, qui avaient forgé le mythe d’une modernité « technocratique[12] » fondée sur le déploiement de l’appareil d’État, parachevant l’ambition de faire du Québec une « société normale ». À l’inverse, les discours révisionnistes des années 1980 (et après) insistent davantage sur l’idée de modernité comme accomplissement de la souveraineté (individuelle et collective), décrivant ainsi un cheminement qui trouve son aboutissement spectaculaire dans les années 1960, mais qui aurait été préparé par un travail patient, souterrain, ayant modifié le corps social et politique en même temps que les modes d’action et d’interprétation des acteurs. On comprend aisément que, dans la période qui a suivi immédiatement le premier référendum sur l’indépendance du Québec en mai 1980, la question de la modernité ait pu ressurgir et faire l’objet d’une réévaluation. Le domaine du théâtre n’y aura pas échappé.
Si l’on admet que ce travail de réévaluation advient au moment où se met en place un nouveau régime d’historicité[13], c’est peu dire que la lecture du corpus d’écrits sur l’histoire du théâtre québécois dessine non pas une, mais plusieurs modernités. Celles-ci peuvent toutefois être regroupées sous trois grands axes (modernité/modernisme ; culture de la modernité ; modernité populaire) reflétant des postures idéologiques et des partis pris esthétiques distincts qu’il faut interpréter comme des façons d’incorporer dans l’analyse historique un nouveau critère de légitimité. De fait, la modernité devient ce par quoi le passé et le présent doivent être désormais jugés et évalués, si bien que la plasticité du terme donne lieu à diverses stratégies interprétatives qui conduisent à proposer des dé/reclassements (auteurs, oeuvres dramatiques, spectacles), à revoir le fil des événements, enfin à repenser la production théâtrale québécoise à la lumière de nouvelles filiations. Face à l’abondance des discours, et afin d’éviter une impression de dispersion, nous avons choisi de centrer notre propos sur un nombre restreint de travaux universitaires représentatifs de ces trois axes d’analyse.
MODERNITÉ/MODERNISME
André-Gilles Bourassa (1936-2011) aura consacré une partie importante de sa carrière de chercheur à tenter d’inscrire les pratiques scéniques et dramaturgiques québécoises dans la filiation des avant-gardes européennes et du mouvement automatiste incarné par la figure de Paul-Émile Borduas. Auteur d’une thèse sur le surréalisme et la littérature au Québec[14], ses travaux subséquents sur le théâtre s’appuient largement sur les recherches dans le domaine de l’histoire de l’art qui, durant cette même période[15], ont contribué à façonner le mythe d’un art moderne québécois articulé au récit héroïque des automatistes. Cinq études importantes jalonnent la réflexion de Bourassa sur cette question ; il est possible aujourd’hui de les lire comme un ensemble unifié et cohérent qui réaffirme l’idée d’une pensée et d’une pratique modernes du théâtre placée d’une part à l’enseigne de l’interdisciplinarité ou du croisement des arts, et alignée d’autre part sur l’esprit de contestation idéologique et d’émancipation manifesté par le Refus global de 1948. Autour de cette période charnière, Bourassa repère une série de moments et d’oeuvres emblématiques (Bien-être, 1947 ; Le vampire et la nymphomane, 1949) de même que des figures marquantes (Claude Gauvreau, Alfred Pellan, Françoise Sullivan, Jeanne Renaud) du mouvement qu’il examine non pas à la lumière de données objectives sur des productions, à l’évidence trop rares, mais à partir des connaissances accumulées sur le milieu artistique lui-même, sur ses réseaux d’influence et d’appartenance, sur les accointances et amitiés entre créateurs qui en font des agents privilégiés de la circulation et de la transformation des idées, des formes et des sensibilités esthétiques. Le portrait qui se dégage de ces diverses analyses correspond à l’image d’une tendance forcément en rupture avec la production nationale courante de l’époque[16], souffrant de l’incompréhension de la critique et de l’indifférence des élites, et qui n’aura pas de suites probantes avant le déblocage culturel des années 1960 et 1970.
Aussi bien dire que prend forme ici une sorte d’infra-histoire retraçant le récit d’une activité qui ferait écho, mais avec dix, vingt, parfois trente ans de décalage, aux pratiques et théories ayant contribué à fonder en Europe l’idée de modernité théâtrale. Histoire qui répercute également le récit canonique de cette modernité qui s’est imposée, dans les années 1960 et 1970 en France[17], comme le modèle interprétatif du progrès théâtral articulé autour d’un certain nombre de postulats. Parmi ceux-ci, notons l’importance attribuée à la formation de l’acteur comme condition de possibilité du renouvellement et de la diversité des formes de jeu. Suivant en cela les travaux d’Odette Aslan[18], André-Gilles Bourassa identifie au fil du temps les lieux, les personnes et les pratiques de formation qui, faute d’une école bien établie dans le Canada français, auront permis tant bien que mal de structurer la pratique naissante du théâtre au Québec.
Découlant de cette nécessité de transmission, l’idée que la modernité soit définie par une pensée, par un savoir réflectif, donne lieu par ailleurs à un questionnement sur les relais québécois des théories européennes en matière de jeu, de dramaturgie, de scénographie et de mise en scène. Outre les écrits des naturalistes (André Antoine, Émile Zola) et des symbolistes français (Aurélien Lugné-Poe, Jacques Copeau), relayés au Québec dès le premier tiers du xxe siècle par des acteurs du Vieux Continent établis à Montréal, Bourassa aura suivi avec insistance la piste de François Delsarte, dont les Cours d’éloquence parlée, adaptés par Mgr Thomas-Étienne Hamel[19] de l’Université Laval, auraient servi de point d’entrée vers la modernité à de nombreux praticiens canadiens-français. Fait à noter, la référence delsartienne inaugure dans le discours de l’historien une vision « américaine » de la modernité. Presque oubliée en France, c’est par le biais des États-Unis[20] que la pensée du maître de Rudolf Laban et d’Isadora Duncan aurait, semble-t-il, pénétré au Québec. Cette américanité s’affirme dans plusieurs des travaux de Bourassa, pour qui les expérimentations scéniques et dramaturgiques des automatistes doivent être placées à l’enseigne de l’abstraction (ou non-figuration), notion empruntée au critique d’art new-yorkais Clement Greenberg, qui en faisait l’élément-clé du modernisme en peinture.
C’est dire la tentative de Bourassa, en dépit du cadre européen de son analyse historique, de cerner l’expression d’une modernité qui serait ancrée dans un territoire géographique et culturel distinct. Mis à part le décalage temporel observé entre les innovations scéniques qui auront cours sur le Vieux et le Nouveau continents, l’historien n’aura eu de cesse de montrer par quels détours (géographiques et idéologiques), et surtout en contournant quels obstacles (moraux, économiques), l’esprit de la modernité a pu être diffusé au Québec. Au final, le portrait n’est pas très éclatant, et le lecteur est souvent amené à se demander, au vu des échecs répétés, des déclarations timides et des compromissions avouées des artistes du théâtre, si l’exigence de la modernité a été un réel enjeu pour ces derniers. Ce doute conduit à interroger le fait d’avoir mené, dans le cas de Bourassa, une réflexion sur ce thème pendant pas moins de vingt-cinq ans. Pour être juste, il convient de rappeler que la discipline des études théâtrales qui, au Québec, émerge au tournant des années 1970 et 1980 entreprend un réexamen du passé théâtral à la lumière des avancées esthétiques et institutionnelles que le milieu a connues depuis dix ans à peine. La nécessité d’atténuer l’impression d’une rupture brutale, introduite par les années 1960, et l’ambition de combler le vide mémoriel qui en découle ont été interprétées par plusieurs comme une invitation à dégager les prémisses de cette modernité, à remonter à sa source dans un geste qui disait d’une part que le théâtre québécois avait, malgré les apparences, été du « bon côté de l’histoire » et, de l’autre, qu’il offrait à la pensée esthétique et historique un matériau digne de considération.
Reflet de son temps et de son milieu, l’oeuvre critique et historique d’André-Gilles Bourassa donne ainsi un aperçu assez fidèle de la doxa académique de l’époque en matière d’histoire du théâtre québécois. Au chapitre de la périodisation, par exemple, l’analyse bourassienne de la modernité (1930-1965) aura permis d’établir un consensus qui, pour l’essentiel, semble tenir encore aujourd’hui, si l’on en croit les ouvrages généraux et les synthèses historiques disponibles sur le marché[21]. En revanche, c’est peu dire que l’approche formaliste privilégiée dans l’ensemble des travaux de l’auteur, centrée sur le mouvement automatiste, soulève de nombreuses réserves ; ceux-ci n’ont guère eu de suites notables dans la recherche plus récente.
MODERNITÉ CULTURELLE
L’entreprise savante de relecture du passé théâtral québécois, engagée dans les années 1980, a été possible grâce à l’initiative de chercheurs dont la principale tâche a consisté à produire des outils documentaires recensant l’ensemble de l’activité théâtrale en prenant appui sur le dépouillement systématique d’archives privées et publiques et des sources journalistiques. Amorcée en 1978 par l’équipe du Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec[22], à laquelle ont été associés des spécialistes du théâtre, cette initiative répondait à une volonté de désenclaver le passé en refusant la grille interprétative de la génération pionnière de l’histoire littéraire et théâtrale. En déplaçant ainsi les lignes du partage culturel établi par les élites de l’immédiat après-guerre[23], l’équipe du DOLQ aura eu comme mission de faire émerger la partie cachée de l’iceberg littéraire et culturel québécois. Dans le domaine du théâtre, c’est l’époque des premières grandes synthèses sur l’activité dramatique et scénique des xviiie et xixe siècles[24], sur les rapports entre l’Église et le théâtre[25] comme ceux entre le théâtre et l’État[26], de même que des travaux sur l’établissement d’une scène professionnelle à Montréal[27]. Dans ce même esprit — il en sera question plus loin —, des études sur les formes et pratiques populaires[28] auront mis en lumière l’enracinement du théâtre dans une société marquée par une urbanisation rapide et l’avènement de la culture de masse. C’est à cette enseigne que surgit à nouveau le problème de la modernité, laquelle est saisie cette fois dans son état embryonnaire, alors que les marquages disciplinaires ne sont pas encore fixés et que se pose plus nettement la question d’une sensibilité touchant non pas seulement les détenteurs du capital culturel, mais bien tous les acteurs sociaux.
Lucie Robert use, dans une communication récente[29], d’une formule éloquente pour décrire ce phénomène, qui est en même temps une façon nouvelle de l’observer. À ses yeux, la modernité québécoise apparaît à la pensée là où elle est mise « à l’épreuve de l’hétérogène » : hétérogénéité des discours, des pratiques, mais aussi des représentations collectives. L’approche compréhensive qu’elle privilégie l’amène ainsi à n’adopter ni le point de vue surplombant de l’histoire des idées (approche européenne) ni celui des Cultural Studies (approche à l’américaine), qui tend à dissoudre la vie artistique dans l’histoire des pratiques de la vie quotidienne. Son ambition consiste plutôt à « reconstituer la conception que se font les acteurs de l’époque de cette modernité[30] ». Dans des travaux qui s’échelonnent sur près de vingt ans, à commencer par ceux produits dans le cadre de La vie littéraire au Québec[31] auxquels elle collabore, Robert envisage les pratiques ainsi que les oeuvres dramatiques et scéniques dans l’espace des possibles de la création artistique qui commande des stratégies individuelles et collectives, mais sans porter de jugement sur leur succès immédiat et encore moins sur leur postérité heureuse ou malheureuse. Lieu de l’hétérogène par excellence, la ville de Montréal constitue l’ancrage de cette modernité ; une modernité qui se vit, s’expérimente, se performe, avant d’être un objet de pensée, dans la mesure où elle représente quelque chose de mouvant, d’incertain, d’inachevé, et à laquelle est associé un profond sentiment d’incertitude[32].
Ce cadre explique, en partie du moins, pourquoi Lucie Robert n’a jamais définitivement rompu, dans ses travaux sur le théâtre, avec l’histoire littéraire, à la différence de plusieurs spécialistes en études théâtrales québécoises qui ont mis en avant une vision plus « autonomiste » de la discipline, en anticipant sans doute sur le développement à venir du champ théâtral. Au risque d’insister, cet enjeu apparaît, dans la perspective de l’histoire culturelle, au coeur de la question moderne au Québec. Car au-delà du brouillage des frontières entre littérature et théâtre, l’analyse de Robert fait état de la circulation constante des comédiens, des auteurs et des concepteurs, mais également de celle des publics, entre les milieux de la musique, des arts lyriques (opéra, chanson), de la danse et du théâtre, sans oublier leur commerce constant avec les univers émergents des médias (cinéma, radio).
Le parcours de Jeanne Maubourg est étudié sous cet angle[33]. Arrivée au Québec en 1916, cette fille d’un chef d’orchestre et d’une cantatrice, née à Namur en Belgique, aura eu une brillante carrière à Londres puis à New York avant de s’établir à Montréal, pour y fonder avec son mari (Albert Roberval) son propre studio de chant. Elle représente alors, avec Yvonne Audet et Eugène Lassalle (fondateur du Conservatoire éponyme), la première génération de formateurs des talents dramatiques et lyriques au Québec. Sa carrière d’interprète montre bien par la suite, du moins pour les artistes locaux, qu’il n’y a pas d’étanchéité entre ces milieux, comme il ne semble pas non plus y en avoir entre la sphère des professionnels et les cercles amateurs. Active au sein de la Société des arts lyriques et de la Société nationale d’opéra, elle se joint en 1926 à la troupe Barry-Duquesne, peu de temps après avoir pris part à plusieurs productions du Théâtre Intime à titre de metteure en scène. Ce fait, en lui-même, mérite d’être signalé et mis au compte d’une lecture à rebrousse-poil de l’histoire canonique de la mise en scène au Québec, fondée, selon ce qu’en a établi la doxa, sur deux figures masculines (Émile Legault et Pierre Dagenais). Mais il témoigne également de l’existence, à l’époque, d’une activité souterraine, trop mal documentée, à laquelle peuvent être reliés certains des enjeux de la modernité québécoise : la place des femmes, le développement de la carrière artistique, la formation de la relève, l’art en tant que travail. En empruntant ces chemins de traverse, les recherches de Lucie Robert dessinent une modernité qui aura été, selon son expression, un « apprentissage discret[34] », qui se donnerait à entendre aujourd’hui comme une musique en sourdine.
À tous égards, il faut parler ici d’une oeuvre historique de restauration, à ne pas confondre avec l’ambition de réhabilitation qui caractérise la recherche sur les formes et pratiques scéniques vernaculaires. L’approche de Lucie Robert s’inscrit à l’enseigne d’une sociologie esthétique dans la mesure où ses travaux témoignent d’un souci constant à l’égard des conditions sociales, culturelles et idéologiques qui entourent l’activité théâtrale. Son questionnement s’intéresse à la légitimité de cette pratique auprès des différentes classes et générations, de même qu’à l’importance d’une production régulière et professionnelle pour la diffusion d’une image sociale positive du théâtre. À ce titre, comme d’autres avant elle, Robert note le rôle crucial des expatriés français qui ont permis l’instauration de certaines exigences en matière de production et de répertoire tout en assurant la transmission du patrimoine scénique et dramatique européen. Dans les pages introductives d’une anthologie de pièces en un acte de la Belle Époque à la Crise[35], la chercheuse campe ainsi le décor d’une première scène de la modernité qui appelle à être interprétée à la lumière d’une double référence historique.
Dans un premier temps, le corpus mis en exergue dans cette anthologie se donne à entendre comme un écho lointain (nord-américain) de la crise sociale et idéologique dans laquelle aura pris naissance le drame moderne européen[36]. Selon les postulats de l’analyse szondienne, qu’adopte l’essai de Robert, le sentiment de malaise que traduisent les écritures modernes (August Stringberg, Anton Tchekhov, Henrik Ibsen, Gerhart Haupmann) donne lieu à une remise en question de la forme dramatique conventionnelle, de son système d’action unidirectionnel tourné vers la résolution des conflits, de même que de la conception unifiée de l’espace-temps qu’elle sous-tend. En résulte une dramaturgie qui met en scène des sujets isolés, confrontés non pas l’un à l’autre, mais à leurs mondes intérieurs. L’analyse de Lucie Robert montre, dans un deuxième temps, comment, dans le contexte québécois du début du xxe siècle, le malaise moderne opère autrement sur la forme dramatique, d’où le recours à une autre référence historique. La brièveté des pièces rassemblées dans l’anthologie apparaît ainsi comme une réponse à la forme canonique pratiquée par la génération précédente d’auteurs dramatiques canadiens[37] : le drame historique. Rompre avec celle-ci, tant sur les plans formel que thématique, c’est rompre, écrit Robert, avec « l’esprit national » ; c’est mettre à distance un récit dominant — puisant à la source du drame national : la défaite des plaines d’Abraham, la rébellion des Patriotes — visant à faire converger théâtre et histoire collective ; enfin, c’est rompre, et pour la première fois, avec une certaine idée du théâtre (commerciale, professionnelle) diffusée à la faveur du régime des tournées américaines qui aura structuré longtemps la vie théâtrale à Montréal.
Au final, ce corpus « rescapé de l’oubli » n’aura toutefois pas réussi, malgré — ou peut-être en raison de — sa modernité, à résister à l’usure du temps. Sans doute parce qu’il n’a pas su s’inscrire d’abord dans son propre temps… Phénomène essentiellement littéraire, sans écho notoire sur la scène et dans la critique de l’époque, cet ensemble de pièces n’interpellera pas davantage les générations subséquentes. Robert n’essaie pas de dire le contraire, de même qu’elle n’explique pas vraiment pourquoi il en a été ainsi. Tout se passe comme si son entreprise de restauration mémorielle avait pour but, en définitive, de désigner ce qu’il faut bien appeler une modernité de circonstances.
MODERNITÉ POPULAIRE
Autre continent oublié, la tradition québécoise du burlesque[38] a bénéficié des faveurs de la recherche savante au moment où celle-ci entreprenait son travail d’excavation de la modernité culturelle québécoise dans les années 1970 et 1980. Dans le récit historique qui s’élabore à l’époque, l’idée d’un « nouveau théâtre québécois[39] » apparaît indissociable de ses sources populaires. Celles-ci s’incarnaient jusque-là dans les figures réconciliatrices de Gratien Gélinas[40] et de Marcel Dubé[41], sur lesquelles était construite la lignée patriarcale de la dramaturgie nationale. Elles trouveront désormais des résonances plus authentiques dans le verbe irrévérencieux, le ton gouailleur et la geste comique de ces comédiens et comédiennes dont les noms traduisent bien le rapport de familiarité qu’ils entretenaient avec leur public : Tizoune, La Poune[42], Baloune, Pic-Pic, Macaroni, Pizzi Wizzi. C’est à Chantal Hébert, qui publie en 1981 Le burlesque au Québec : un divertissement populaire, que revient d’avoir ouvert cette voie :
Le burlesque, pourtant, n’en déplaise aux lares de la grande culture, a pu naître, se développer et prospérer ici ; c’est sans doute parce qu’il répondait aux attentes d’un bon nombre de Québécois… quel que soit leur goût. De ce fait, il était susceptible de nous informer, au même titre que toute autre manifestation culturelle signifiante, sur une tranche de notre histoire. N’était-ce pas là une raison suffisante pour nous inciter à y regarder de plus près, et cela, même si le champ du « comique », malgré son indéniable popularité, fut rarement retenu comme objet d’étude, comme le faisait remarquer le Théâtre Euh ![43]
La référence au Théâtre Euh !, troupe qui a marqué la période faste de la création collective, n’est pas anodine, et ce à double titre. Elle signale, pour les chercheurs de l’époque, que la légitimité de leur objet d’étude se mesure aussi à l’échelle de la conscience historique que les artisans du théâtre ont de leur propre pratique. Du moins, ce facteur doit-il être pris en compte au même titre que celui qui dicte, dans l’optique d’une mémoire populaire du théâtre, la nécessité de faire une place à des usages et à des formes qui, en résonnant à travers tout le corps social, ont contribué à façonner l’identité nationale. Du point de vue de la création théâtrale[44] comme de la recherche savante, ce phénomène s’apparente à un processus de patrimonialisation, si l’on associe à ce terme l’idée d’assembler des biens matériels ou immatériels aux fins de leur conservation et de leur transmission. La valeur de ces biens, qu’elle soit affective, symbolique ou sacrée, apparaît alors fondée sur leur capacité à exposer, à révéler, à rappeler un état, un climat, voire une dynamique sociale globale qui menace de se dérober à la mémoire.
Dans ses travaux, Chantal Hébert abordait le burlesque sous cet angle en percevant dans le jeu de l’acteur comique et sa relation au public une attitude de défiance et de résistance face aux normes sociales ambiantes, y compris théâtrales[45], de même que l’expression d’une modernité typiquement populaire. Celle-ci réapparaît dans un ouvrage plus récent, signé Germain Lacasse, Johanne Massé et Bethsabée Poirier[46], et portant sur la figure de Silvio, bonimenteur du cinéma muet, ainsi qu’auteur et acteur de revue au moment de l’âge d’or du divertissement populaire au Québec (1900-1930). Cette étude déploie avec brio l’arsenal conceptuel de l’histoire culturelle qui s’arrime à une vision plutôt binaire du passé du Québec, puisqu’elle s’appuie sur une représentation de la société formée de deux entités antagonistes : les élites et les masses. L’ambition des auteurs consiste à « comprendre comment les masses se sont représenté et approprié la modernité[47] ». Leur analyse, articulant le point de vue de ces masses à la vision qu’en avaient les élites, reprend largement celle des réformateurs de la Révolution tranquille en ce qu’elle amplifie le conservatisme des classes dominantes dans le but de célébrer le « potentiel libérateur[48] » de la culture urbanisée qu’incarne le maléfique Silvio.
Que l’on adhère ou non à cette représentation du passé, il convient de souligner qu’elle procède d’une reformulation de la question de la modernité qui dégage son interprétation du cadre heuristique auquel l’historiographie théâtrale s’en tenait jusque-là. À proprement parler, Le diable en ville se situe à la jonction de la recherche sur les pratiques scéniques populaires et de celle sur les premiers temps du cinéma[49], alors que les lignes disciplinaires, pour reprendre l’argument de Lucie Robert, restent encore mouvantes, mais où surtout la notion de spectacle commence déjà, dans le discours social ambiant, à désigner un type d’expérience collective qui n’est pas exclusive aux salles de théâtre. Prenant appui sur trois références majeures de la modernité (Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Berthold Brecht), Lacasse, Massé et Poirier retracent ainsi la trajectoire de Silvio et analysent la forme de la revue d’actualité, évoquant entre autres les figures archétypales du flâneur et du badaud, qu’ils associent aux phénomènes de la rapidité et de la distraction propres à la vie citadine, ce que percevaient bien, et c’est la raison de leur action répressive à l’endroit de Silvio, les élites cléricale et bourgeoise. À l’époque, revues dramatiques et cinéma participent, selon les auteurs, d’une même logique sociale qui s’abreuve à la culture de consommation naissante, laquelle fait usage des stratégies éprouvées de l’exposition d’objets hétéroclites et du montage de récits discontinus[50]. Ces formes épousent par ailleurs une conception nouvelle de l’espace et du temps, inaugurée par les médias (journaux et radio), qui tend à faire de l’ici-maintenant le foyer des pulsions, des sensations et des imaginaires collectifs. En définitive, la modernité vernaculaire, ainsi diffusée par la scène et l’écran, de même que celle vécue par le promeneur à l’échelle de la rue[51], et dont s’inspire le revuiste, apparaît comme une expérience sensorielle plutôt que discursive[52].
Cette vision s’aligne directement sur la compréhension benjaminienne de la modernité[53] comme sensorium humain, décrit comme un environnement hostile orchestrant la collision des différences et affectant, de ce fait, les cadres cognitifs et perceptuels des individus. Chez les auteurs du Diable en ville, cette analyse trouve écho dans la caractérisation d’un milieu social canadien-français « semi-colonial verrouillé par l’autorité politique de l’Empire britannique et l’emprise idéologique du clergé catholique traditionaliste[54] », mais qui parvient, grâce à l’effet de dislocation qu’exerce le capitalisme industriel sur les forces de régulation sociale, à briser certaines entraves, à fissurer le voile de la société traditionnelle. Cette interprétation positive de la modernité populaire dit bien l’emplacement américain de la culture québécoise. C’est par le truchement des classes populaires, et non grâce aux élites qui majoritairement la réprouvent, que la modernité aurait transformé la société canadienne-française le plus durablement, en brouillant la représentation homogène qu’elle avait d’elle-même et en instaurant un espace public caractérisé par la libre circulation des corps et des images, condition nécessaire à toute démocratisation. Pour le public des spectacles et des divertissements, cela se manifeste par le fait que Montréal vit de plus en plus au rythme du continent américain, dès lors que ses habitants partagent son Star System — où les vedettes locales rivalisent avec les icônes américaines — et adhèrent au modèle de la consommation et de la communication de masse.
Une telle entreprise de réhabilitation des pratiques culturelles populaires s’inscrit à contre-courant d’une analyse de la modernité fondée sur l’idéal des Lumières, dont l’agent principal serait la culture lettrée. Aborder le moment moderne en ces termes conduit de fait à mettre à distance un modèle d’interprétation qui interroge les processus d’autonomisation et de subjectivation généralement associés à la modernité artistique, littéraire et philosophique. Faut-il y voir l’explication du peu d’intérêt, outre dans les travaux cités, que cette perspective a suscité parmi les chercheurs en études théâtrales ? Un regard critique oblige à faire le constat d’une approche qui semble en effet désaccordée avec celle privilégiée par les spécialistes de cette discipline. L’ouvrage de Lacasse, Massé et Poirier, faut-il s’en étonner, n’entre pas lui non plus en dialogue avec la recherche dans le domaine du théâtre, si ce n’est pour en tirer des données factuelles. Le malentendu ne résiderait pas seulement dans une compréhension divergente des phénomènes, mais dans les enjeux que sous-tendent deux types différents d’enquêtes, comme si les questions de l’une n’intéressaient pas l’autre, et vice versa.
À cet égard, il convient de signaler en terminant que l’histoire culturelle, en posant comme principe de son analyse le clivage classes populaires/élites, fournit malgré cela les éléments d’une réflexion essentielle — qui concerne également une histoire des pratiques scéniques et dramaturgiques — sur les causes du déclin graduel du théâtre, tout au moins de sa marginalisation, dans la vie culturelle québécoise, alors que semble se maintenir vaille que vaille, dans le discours social, le mythe d’un « théâtre national et populaire », pour reprendre l’expression de Gratien Gélinas, capable de produire du lien social et de rallier la mémoire collective[55]. Ce mythe apparaît antinomique avec l’idée, promue par le récit canonique de la modernité, d’un art conçu comme instrument critique et vecteur de progrès, qui considère suspecte l’approbation du public (et son corollaire, le vedettariat) et dévalorise toute pratique fondée sur la collaboration et la communalité[56]. C’est cette contradiction, qui contribue à disqualifier le théâtre dans le Grand Récit de la Modernité[57], que chercherait à résoudre l’histoire culturelle.
L’AUTRE AMÉRIQUE
Qu’en est-il maintenant de la modernité dans la recherche anglo-saxonne nord-américaine ? Après ce survol, forcément partial et partiel, des écrits québécois en la matière, il convient d’établir un premier examen du corpus de recherche en histoire du théâtre produit au Canada et aux États-Unis. Dans les limites de notre enquête, il apparaît que le thème de la modernité dans les discours savants de ces deux nations n’a pas eu la même portée que celle que nous avons observée dans la production savante québécoise. Une recherche par mots-clés dans différentes bases de données, bien qu’elle révèle la récurrence du terme dans les titres coiffant une quantité appréciable de travaux sur le théâtre, laisse néanmoins percevoir un usage plus neutre de la notion. À cet égard, deux remarques préliminaires s’imposent pour bien marquer la différence avec la recherche produite au Québec.
Le mot « moderne » est, au Canada et aux États-Unis, le plus souvent employé pour évoquer un nouveau canon littéraire ou dramatique, par opposition à une désignation plus large qui embrasserait l’ensemble des pratiques théâtrales (mise en scène, jeu, scénographie). Suivant cette vision classique, très contestée dans l’historiographie récente, la modernité serait ainsi une caractéristique reconnaissable à sa textualité et fondée sur l’idée que l’oeuvre moderne, à l’instar du grand répertoire européen, est celle qui parvient, grâce à l’édition et parce qu’elle accède au statut de répertoire, à transcender les conditions particulières de la représentation. Dans les ouvrages de synthèse historique consultés, l’expression « Modern Drama » apparaît ni plus ni moins comme une étiquette référant à un ensemble circonscrit dans le temps, et selon des critères esthétiques relativement lâches, de textes dramatiques reconnus par la critique et sélectionnés en fonction de leur représentativité ou exemplarité. Y est nécessairement associé un critère de jugement, mais qui n’entraîne pas forcément, dans la majorité des publications recensées, une problématisation du concept de modernité, comme si celui-ci reposait sur une compréhension implicite et n’appelait pas une interprétation adaptée au contexte nord-américain.
Ce premier constat établi, il s’impose de noter que l’usage du terme « Modern » dans la recherche académique anglo-saxonne décline sensiblement à partir des années 1980 et 1990. Les auteurs l’emploient tout au plus pour désigner un ensemble d’oeuvres dramatiques appartenant au répertoire national distinct du Contemporary, du Mainstream ou du Popular. C’est dire qu’en plus de fixer le genre dans la distance d’un moment historique révolu, l’appellation tend également à marquer une dissension au sein d’un ordre de discours, celui des études théâtrales elles-mêmes, qui entre alors dans une période de refondation radicale au terme de laquelle, d’après les observations que nous faisons, la question moderne devient caduque et, avec elle, les enjeux esthétiques, sociaux et idéologiques qui motivaient auparavant son usage répandu.
C’est donc sous le signe de la disparition que vont se déployer les pages suivantes, traitant du thème de la modernité dans les études théâtrales au Canada et aux États-Unis. En guise de précaution, soulignons d’emblée les limites d’une telle analyse qui ne repose ni sur une fréquentation assidue de la production savante anglo-saxonne ni sur un prélèvement exhaustif des écrits dans le domaine de l’histoire du théâtre. Nos choix en la matière ont été dictés dans un premier temps par la compréhension que ceux-ci offraient des questionnements épistémologiques mobilisant les acteurs de la discipline de part et d’autre de la frontière. Dans un deuxième temps, notre attention s’est tournée vers des travaux de synthèse historique ou de théorie qui, en dépit de leur silence relatif sur la modernité, faisaient directement écho aux discussions en cours au Québec sur le sujet. Faute d’avoir pu analyser un ensemble plus large d’écrits, notons en terminant que nous avons privilégié ceux qui se distinguaient par une énonciation critique et un contenu métadiscursif affirmés permettant d’évaluer le positionnement des auteurs dans leur espace disciplinaire respectif.
ÉTATS-UNIS : UNE MODERNITÉ REVUE ET CORRIGÉE
Il existe un récit canonique du théâtre américain consigné dans bon nombre de monographies et d’ouvrages de synthèse produits jusque dans les années 1960 et 1970. Ce récit trace globalement une ligne continue qui permet de relier les formes et les pratiques populaires du xixe siècle, emblématiques du régime industriel de divertissement qui se met en place dans les grandes villes (New York, Philadelphie, Boston), avec un théâtre moderne issu du mouvement des Little Theatre, dont la source européenne apparaît alors comme un gage du progrès. Dans ce récit évolutif, le point de bascule signant l’entrée du théâtre dans l’ère de la maturité correspond généralement aux années 1920[58], avec l’essor d’une dramaturgie américaine, acquise aux vertus du réalisme et faisant la synthèse des influences européennes (Eugene O’Neill/Henrik Ibsen), l’apparition de changements institutionnels importants (Actor’s Equity Association) qui favorisent la professionnalisation de l’acteur, enfin l’établissement d’une tradition (au moyen de la formation) qui rend possible le développement de l’art de la mise en scène. L’ensemble de ces facteurs, combinés à un contexte économique (la crise des années trente) qui incite l’État américain à mettre sur pied un système d’aide publique (Federal Theatre Project [1935-1939]) dont pourront bénéficier certaines troupes de l’époque et qui s’appuie sur un idéal de décentralisation, contribuent, toujours selon ce récit consensuel, à instaurer une dynamique qui fonde la légitimité nouvelle du théâtre au sein de la société américaine. En peu de temps, ce qui aux yeux des élites ne possédait pas ou peu de valeur aurait acquis le statut d’une profession respectable, à défaut d’être noble, correspondant aux nouvelles normes de la société.
C’est ce récit canonique qui commence à vaciller dans la production savante des années 1980 et 1990. Au texte linéaire et héroïque de la modernité théâtrale américaine, plusieurs chercheurs vont s’opposer ouvertement en le déconstruisant d’une part et de l’autre en proposant des récits parallèles : celui des femmes, des Noirs, des amateurs, des autochtones, des gais, des populations immigrées ; bref, en traçant des chemins alternatifs dans l’histoire qui épousent leur parti pris en faveur d’une communauté ou d’une cause, mais qui surtout renversent la logique unifiante de l’opération historique pour y substituer un récit polyphonique scandé par le rythme décalé de cela qui se manifeste à la marge de l’espace culturel hégémonique et normatif. Dans la production savante récente, cette diversité apparaît comme l’élément moteur de la recherche esthétique et de l’investigation historique. Et l’on se tromperait en pensant que ce principe ne concerne que l’activité théâtrale de l’après-guerre. Dans les faits, nombreuses sont les enquêtes qui s’engagent dans cette voie dans le but de revisiter le passé plus éloigné et de déterrer des filiations et des généalogies inexplorées.
Dans « The Hieroglyphic Stage: American Theatre and Society[59] », l’historien du théâtre Thomas Postlewait poursuit cette ambition. À défaut d’employer expressément le terme, cet essai propose, en guise d’introduction au tome II du Cambridge History of American Theatre (1999), une relecture en profondeur de la modernité théâtrale américaine. Celle-ci passe d’abord par une périodisation (1870-1945) qui refuse la démarcation habituelle des années 1920 signant l’entrée dans un temps nouveau. Postlewait postule qu’il y aurait plutôt continuité entre l’ère du divertissement qui s’amorce dans la deuxième moitié du xixe siècle et l’accession du théâtre à la légitimité sociale que vient en effet confirmer le financement de l’État et l’émergence d’une véritable dramaturgie nationale. Outre que la période couverte est délimitée par deux guerres (la guerre de Sécession et la Deuxième Guerre mondiale), l’auteur ne manque pas de souligner que ces deux repères correspondent également à la mort de deux présidents américains, dont le premier (Abraham Lincoln) aura péri sous les balles d’un acteur (John W. Booth), unissant à jamais le destin du théâtre à la vie politique américaine.
Davantage qu’à la politique, c’est à la vie sociale et culturelle que réfère Postlewait. La modernité en cause ici a peu à voir avec la conception métaphysique ou esthétique héritée des Lumières. Dans la tradition d’une sociologie des pratiques et des formes culturelles, l’auteur montre comment le théâtre aurait non seulement participé au processus de modernisation de la société américaine, mais également contribué à en définir les conditions d’émergence. Suivant de longs développements sur le décalage frappant entre l’insouciance affligeante qui caractérise l’activité théâtrale et la réalité tragique qui marque les années suivant la guerre de Sécession, l’historien américain s’intéresse en effet au commerce idéologique, technologique et culturel que le théâtre entretient avec une société qui se donne elle-même à penser comme un spectatorium. Au coeur de ce dispositif, dérivé du capitalisme industriel et de la culture de masse, le théâtre apparaît comme un élément central dont la signification, selon l’auteur, n’est compréhensible qu’à la condition de refuser les clivages disciplinaires pour mieux apercevoir une dynamique sociale globale. L’un des exemples servant à illustrer cette dynamique met en scène nul autre qu’Orson Welles, à la fois homme de théâtre, acteur de cinéma célébré et propagandiste politique. L’histoire ne retient d’habitude que les deux premiers, rappelle Postlewait, alors que Welles fut, au faîte de sa popularité, un tribun très actif au service de Franklin Delano Roosevelt durant la campagne présidentielle de 1944. L’auteur y voit l’expression d’une modernité à l’américaine où convergent, par le biais du spectacle, des réalités et des temporalités distinctes façonnant des mythes et imposant de ce fait des représentations nouvelles de l’identité nationale :
The history of American entertainment from the mid-nineteenth century to the present can be understood, then, not only as a struggle between Europe and America, melodrama and realism, lowbrow and highbrow, stage and screen, country and city, natives and immigrants, men and women, whites and blacks, but also, and more tellingly, as an overall process whereby a democratic or mass culture enters into a new kind of spectatorship, or optical culture defined by the reign of the eye and the seduction of images[60].
CANADA : AU-DELÀ DE LA MODERNITÉ
À notre connaissance, il n’existe pas au Canada anglais d’entreprise historique comparable à celle de Postlewait, dont l’ambition serait de reprendre à nouveaux frais la question de la modernité au théâtre. L’impression qui se dégage des travaux récents dans le domaine semble plutôt traduire l’inconfort — sinon l’indifférence — suscité par cette notion. Cette impression s’accompagne du constat — qui n’est sans doute pas sans rapport avec notre sujet —, formulé par certains sur le mode de la déception ou de l’échec, de l’impossibilité grandissante de poser un regard englobant sur le passé théâtral. Dans « The Trades of T.R.i.C. There Are No Macrohistories Here », Robin C. Whittaker déplore l’abandon, depuis 1987, de tous projets de synthèse historique du théâtre au Canada. La référence à 1987 éclaire le débat qui semble avoir cours dans les milieux académiques puisqu’elle cerne à la fois le moment où l’on publie l’ouvrage de Eugene Benson et Leonard W. Conolly, English-Canadian Theatre[61], à ce jour la dernière tentative de synthèse, et ce qui semble avoir été le début de l’aggiornamento qui a transformé profondément la discipline des études théâtrales au Canada.
[The] absence of Canadian macrohistory is a product of long, extended, hard fought, and ongoing efforts to erase the act of narrativizing historical events in our increasingly pluralistic, polyvocal, fragmented discipline. For decades the “story” was the nationalizing, professionnalizing project of Anglophile Canadians. To tell the story, even a story, of Canadian theatre is a dated notion that, for some, threatens to monologize the plurality of voices engaged in the practice and research of drama, theatre, and performance[62].
Ainsi, dans le même mouvement que celui qui aura balayé les États-Unis à la même époque, cette transformation remet en cause l’idée qu’il n’y aurait qu’une seule histoire possible du théâtre canadien. La force de la critique formulée à l’endroit de la génération des chercheurs ayant forgé le cadre de cette histoire unifiée et unifiante apparaît, pour qui se place à l’extérieur, démesurée, mais elle s’éclaire si l’on tient compte des efforts consentis, des ressources mobilisées et des motifs idéologiques qui ont présidé à ce que plusieurs conviennent d’appeler désormais le mythe du théâtre canadien. À l’instar de celui qui a cours aux États-Unis, le récit canonique du passé théâtral canadien, patiemment construit par les pionniers de la discipline entre les années 1950 et 1970, se veut indissociable du projet national qui s’élabore à peu près à la même époque. On comprend par là que l’activité théâtrale devient le véhicule d’une identité collective en quête d’affirmation et que la modernité — ce terme recouvre alors une signification positive pour cette génération — se conjugue sur le mode du Nation Building (édification de la nation).
Les éléments composant cet édifice sont bien connus : Vincent Massey, le Dominion Drama Festival, Stratford, le Canada Arts Council. Dans l’historiographie classique, le théâtre canadien se présente, à bien des égards, comme une affaire d’État[63], du moins le résultat d’une volonté collective et politique qui s’est exprimée, faut-il le rappeler, sur fond de divisions régionales (dix provinces) et linguistiques (Canada vs Québec), mais également comme une réaction à l’hégémonie culturelle de l’Empire britannique et des États-Unis. Un tel récit commun, fondé sur l’idée que le théâtre parvient à incarner et à exalter l’esprit de la nation, viendra se rompre sur le récif des réalités politiques (la victoire du « Non » au référendum de 1980, l’échec de l’accord du lac Meech en 1990, la montée des Premières Nations) de la même façon qu’il y aura puisé son élan initial. À lire la production savante de nos jours, la représentation du théâtre canadien ressemble à celle du corps politique lui-même : fragmenté en une pluralité de communautés d’appartenance existant dans une relative tranquillité les unes avec les autres, et chacune pouvant aspirer légitimement à construire sa propre mémoire dans les brèches du Grand Récit national.
Pour étayer ce constat, il conviendrait de noter le rôle qu’a pu jouer dans la dynamique savante l’essor des Performance et des Cultural Studies dans le monde académique anglo-saxon à partir des années 1990 et 2000. Ce fait mérite d’être souligné en regard de la question posée par la modernité. Celle-ci apparaît, à la lumière des postulats théoriques et épistémologiques qu’épousent un grand nombre de chercheurs canadiens, comme inconcevable ou inadmissible dans la mesure où elle repose sur un système normatif qui hiérarchise les pratiques et fonde la légitimité sur un principe d’autonomie. L’idée de modernité esthétique suppose en effet que le théâtre se déroule à distance du quotidien, dans un monde qui définit ses règles par et pour lui-même. À l’inverse, l’idée de Performance implique un décentrement radical du principe et du pouvoir de représentation qui a permis à la discipline d’étendre son domaine d’expertise à des objets (phénomènes, activités et manifestations) très diversifiés débordant largement les sphères esthétique et culturelle. Aussi bien dire que l’institution du théâtre comme champ d’analyse et d’interrogation cède progressivement le pas, sous le régime du performatif, à des pratiques dont l’efficacité, plus que la signification, se mesure non plus à leur dialogue soutenu avec une tradition culturelle, mais à la manière dont elles mettent en jeu des données concrètes d’une réalité située. S’il existait une histoire produite sous le signe des Performance Studies, on devine qu’elle ne saurait incorporer le schéma évolutif qui appartient à l’historiographie moderne du théâtre. Le projet de cette histoire demeure pour le moment impensé, mais il n’est peut-être pas impensable.
CONCLUSION : EN FINIR OU PAS…
Au terme de ce parcours, il conviendrait d’affirmer la nécessité de poursuivre la traversée critique qui a été amorcée ici en approfondissant la lecture des écrits sur le théâtre au Canada, aux États-Unis et au Québec. L’importance de cette tâche apparaît clairement au moment où la discipline semble arrivée à la croisée des chemins. En ce qui nous concerne, l’occasion serait d’autant plus indiquée que l’ambition de produire une synthèse historique du théâtre au Québec se trouve ravivée après des années de jachère[64]. Au-delà de la question des origines du théâtre et de l’entrée dans la modernité, ce que veut interroger la présente recherche entretient un lien direct et étroit avec le projet de synthèse historique en cours en ce qu’elle pose comme condition de sa réalisation l’examen critique des postures épistémologiques et idéologiques qui s’offrent au chercheur, quel qu’il soit. En cela, et au risque de le répéter, l’opération comparative qui met en regard l’une de l’autre des traditions savantes voisines ne peut manquer de servir d’enseignement et d’amener chacun à faire en la matière des choix judicieux.
Ajoutons qu’il existe là un terrain d’analyse fertile largement inexploré. L’ensemble de notre recherche a permis de pointer en direction de nouveaux objets qui mériteraient d’être abordés sous l’angle comparatif : la question du texte et de l’auteur, la périodisation historique, l’émergence de la mise en scène. D’autres apparaissent à l’horizon : la critique, le public de théâtre, le statut de l’acteur, l’importance des médias de masse. Notre réflexion y aura touché par endroits, mais chacun de ces thèmes pourrait faire l’objet d’une analyse plus poussée qui viserait à cerner, comme les précédentes, les agencements narratifs, les procédés discursifs qui, dans la mémoire des collectivités, sont mis en oeuvre pour raconter l’itinéraire artistique, social, économique et politique du théâtre.
À cet égard, il s’impose en terminant de formuler quelques remarques conclusives sur le thème de la modernité dans la recherche théâtrale au Québec par rapport au traitement qui en est fait au Canada et aux États-Unis. Dans les limites d’une analyse fondée sur un corpus restreint d’écrits, on ne dissimulera pas notre envie de qualifier le Québec de « société distincte » en matière de recherche sur le théâtre. Ce que la question de la modernité permet de mettre au jour, à l’échelle québécoise, concerne des enjeux (culturels ou identitaires) qui, dans la dynamique savante mais également à l’échelle de la mémoire collective du théâtre, ne semblent pas avoir été résolus, alors que ce sont précisément ces enjeux qui, dans le monde anglo-saxon, marquent à l’heure actuelle le point de rupture avec l’ordre ancien du discours. Les raisons ne manquent pas pour expliquer cet état de fait, dont celles qui ciblent la place et le rôle que joue aujourd’hui le théâtre dans les trois collectivités en cause. Celui-ci demeure central dans la dynamique culturelle québécoise en raison d’un développement institutionnel qui n’a pas d’équivalent en Amérique du Nord et qui repose sur un système d’aide publique traduisant une volonté collective d’affirmation par la culture. À l’échelle du Québec, ajoutons que le domaine du théâtre accapare une large part des ressources distribuées par l’État, si l’on compare avec la danse, la musique, la littérature et les arts visuels. C’est dire la valeur qui lui est accordée, mais aussi sa fonction en tant que repère symbolique et vecteur de représentations sociales associées, en dépit du travail de relecture dont il a été l’objet, à l’héritage européen.
Le consensus sur lequel s’est établi ce système semble toutefois menacé d’éclatement. Pour plusieurs, l’assimilation du théâtre à la « culture commune » n’apparaît plus une évidence au vu du décalage entre les tendances démographiques récentes, marquées par la diversité, et la création scénique et dramaturgique courante. La position de marginalité que celle-ci acquiert dans le champ culturel devient ainsi doublement manifeste, d’une part aux yeux des plus jeunes générations qui n’adhèrent pas à l’horizon de sens que cet art représente et de l’autre en regard du développement des pratiques elles-mêmes, qui affichent ouvertement leur opposition au régime dominant, notamment en contestant l’assignation à une seule discipline et en revendiquant des modes de production alternatifs.
De cela, les études théâtrales québécoises prennent progressivement la mesure. Balayée par la montée de l’interdisciplinarité et par les débats autour du post-dramatique, la discipline semble amorcer une transformation similaire à celle qui s’est produite ailleurs sur le continent en réfutant l’hégémonie du modèle théâtral et dramatique dans l’analyse des arts vivants. Les résistances y sont toutefois plus fortes et nous ramènent à la question de la modernité. Celle-ci se comprend à la lumière d’un paradoxe qui en fait, au Québec, un moment à la fois révolu et fondateur[65]. Qu’est-ce à dire ? La récurrence du terme dans les travaux en histoire (mais pas exclusivement) depuis trente ans témoigne de la recherche constante d’un élément qui assure une sorte de cohésion dans le récit, d’un principe inaugural qui fait tenir ensemble les pièces du casse-tête que forme la mémoire collective du théâtre. La labilité des usages ne doit pas tromper à cet égard : dans le choix des mots (modernité, modernisme, modernisation), des marqueurs temporels (1900, 1930, 1965) ou des filiations (européenne ou américaine), c’est précisément le passé du théâtre québécois qui s’affiche comme une question ouverte parce qu’il nomme l’emplacement inconfortable d’une culture dans l’espace politique et culturel du Nouveau continent. Si la discipline des études théâtrales embrasse aujourd’hui de plus en plus la perspective que donne à voir la diversité des pratiques théâtrales et des itinéraires individuels et collectifs qui façonne son développement, elle reste aussi attachée à poursuivre un questionnement essentiel sur un héritage culturel qui a perdu sa valeur de référence dans la société actuelle, mais qui dit tout de même quelque chose de son expérience historique singulière.
Appendices
Note biographique
YVES JUBINVILLE est professeur en études théâtrales. Ses travaux portent sur la dramaturgie québécoise contemporaine et l’historiographie théâtrale. Il a été directeur de la revue L’Annuaire théâtral de 2008 à 2014. Membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), il est engagé dans le cadre d’un projet de recherche (Régimes socio-esthétiques du théâtre au Québec [1945-2015] : synthèse historique, CRSH 2014-2018) avec une équipe de chercheurs québécois dans la production de la première synthèse historique du théâtre moderne au Québec. Il occupe depuis 2015 le poste de Directeur de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM.
Notes
-
[1]
Cette étude est une version remaniée et augmentée d’un article d’abord paru en anglais ; voir Yves Jubinville, « Theatre in the New World: Troubles in Modernity », Heather Davis-Fisch (dir.), Canadian Performance Histories and Historiographies, Toronto, Playwrights Canada Press, coll. « New Essays on Canadian Theatre », 2017, p. 232-253.
-
[2]
Voir Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, t. II : Pour une critique de la raison fonctionnaliste, traduit de l’allemand par Jean-Louis Schlegel, Paris, Fayard, coll. « Espace du politique », 1987. Cité par Jocelyn Létourneau, « Le “Québec moderne”. Un chapitre du grand récit collectif des Québécois », Revue française de science politique, vol. XLII, no 5, octobre 1992, p. 767-768.
-
[3]
Voir Létourneau, ibid., p. 765-785 et Jean-Philippe Warren, « Petite typologie philologique du “moderne” au Québec (1850-1950). Moderne, modernisation, modernisme, modernité », Recherches sociographiques, vol. XLVI, no 3, septembre-décembre 2005, p. 495-525.
-
[4]
Paul Ricoeur, Temps et récit, t. I, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1983, 324 p.
-
[5]
Yves Jubinville, « Un théâtre du Nouveau Monde. Prolégomènes à une approche comparée de l’histoire théâtrale des “collectivités neuves” », Revue d’historiographie du théâtre, no 1, automne 2013, p. 8-18.
-
[6]
Gérard Bouchard, Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde. Essai d’histoire comparée, Montréal, Boréal, 2000, p. 34.
-
[7]
Jean Baudrillard, Alain Brunn et Jacinto Lageira, « Modernité » [1973], Encyclopaedia Universalis. En ligne : http://www.universalis.fr/encyclopedie/modernite/ (page consultée le 10 mai 2019).
-
[8]
Ibid.
-
[9]
Ibid. ; nous soulignons.
-
[10]
Ce moment coïncide avec l’essor des études théâtrales au Québec. Voir notre étude récente : Yves Jubinville, « Les études théâtrales au Québec : émergences, réseaux et enjeux disciplinaires », Joseph Danan et Marie-Christine Lesage (dir.), Chemins de traverse. L’apport de Jean-Pierre Ryngaert aux études théâtrales, Montreuil, Éditions théâtrales, coll. « Sur le théâtre », 2014, p. 225-241.
-
[11]
L’expression est de Marcel Rioux, « Sur l’évolution des idéologies au Québec », Revue de l’Institut de sociologie, no 1, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1968, p. 95-124. En ligne : http://classiques.uqac.ca/contemporains/rioux_marcel/sur_evolution_ideologies/sur_evolution_ideologies.pdf (page consultée le 30 mai 2019).
-
[12]
Jocelyn Létourneau, « Le “Québec moderne”. Un chapitre du grand récit collectif des Québécois ». p. 780.
-
[13]
À ce sujet, voir François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Librairie du xxie siècle », 2003, 272 p., et Yves Jubinville, « Un théâtre du Nouveau Monde. Prolégomènes à une approche comparée de l’histoire théâtrale des “collectivités neuves” ».
-
[14]
André-G. Bourassa, Surréalisme et littérature québécoise, Montréal/Québec, L’Étincelle/L’Action sociale, 1977, 375 p.
-
[15]
François-Marc Gagnon, Paul-Émile Borduas (1905-1960). Biographie critique et analyse de l’oeuvre, Montréal, Fides, 1978, 560 p.
-
[16]
L’activité théâtrale à Montréal dans les années 1940 fait une part belle aux comédies de boulevard, au divertissement populaire et au théâtre religieux. Les explorations du père Émile Legault (Compagnons de Saint-Laurent) et de Pierre Dagenais (L’Équipe), du côté du répertoire classique ou contemporain, demeurent l’exception, malgré l’écho enthousiaste de la presse de l’époque.
-
[17]
On pense en particulier à Denis Bablet, qui entre au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en 1953 et dirigera, dès 1978, le Laboratoire de recherche théâtrale et musicologique. Les rapports du théâtre avec les autres arts sont au coeur de ses travaux. Une autre influence importante a été celle d’André Veinstein, responsable des collections des arts du spectacle à la Bibliothèque nationale de France de 1953 à 1971 et auteur de La mise en scène théâtrale et sa condition esthétique (Paris, Flammarion, coll. « Bibliothèque d’esthétique », 1955, 394 p.).
-
[18]
Odette Aslan, L’acteur au xxe siècle. Évolution de la technique, problème d’éthique, Paris, Seghers, coll. « L’Archipel », 1974, 398 p.
-
[19]
Mgr Thomas-Étienne Hamel, Cours d’éloquence parlée d’après Delsarte, préface de M. l’abbé Camille Roy, Québec, Imprimerie de la compagnie de L’Événement, 1906, 301 p.
-
[20]
C’est au dramaturge américain Steele MacKaye (1842-1894) que l’on doit la diffusion de la pensée de Delsarte en Amérique.
-
[21]
Il existe peu d’ouvrages destinés au grand public portant entièrement ou partiellement sur le théâtre québécois. Notons néanmoins deux publications : Madeleine Greffard et Jean-Guy Sabourin, Le théâtre québécois, Montréal, Boréal, coll. « Boréal express », 1997, 120 p. ; et Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge, Histoire de la littérature québécoise, avec la collaboration de Martine-Emmanuelle Lapointe, Montréal, Boréal, 2007, 689 p.
-
[22]
Maurice Lemire (dir.), Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec, t. I : Des origines à 1900 ; t. II : 1900-1939 ; t. III : 1940-1959 ; t. IV : 1960-1969 ; t. V : 1970-1975 ; t. VI : 1976-1980 [Gilles Dorion (dir.), 1994] ; t. VII : 1980-1985 [Aurélien Boivin (dir.), 2003] ; t. VIII : 1986-1990 [Aurélien Boivin (dir.), 2011], Montréal, Fides, 1978-2011.
-
[23]
Dans le domaine de la littérature, l’influence des manuels littéraires de Pierre de Grandpré (Histoire de la littérature française du Québec, t. I : 1534-1900 ; t. II : 1900-1945 ; t. III : La poésie de 1945 à nos jours ; t. IV : Roman, théâtre, histoire, journalisme, essai, critique de 1945 à nos jours, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967-1969) et de Roger Duhamel (Manuel de littérature canadienne-française, Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 1967, 161 p.) a été déterminante. Pour le théâtre, les pionniers de l’historiographie sont Jean Béraud (350 ans de théâtre au Canada français, Montréal, Le Cercle du livre de France, coll. « L’Encyclopédie du Canada français », 1958, 316 p.), Léopold Houlé (L’histoire du théâtre au Canada, Montréal, Fides, 1945, 170 p.) et Jean Hamelin (Le Renouveau du théâtre au Canada français, Montréal, Éditions du Jour, coll. « Les idées du jour », 1961, 160 p.).
-
[24]
John Hare, « Panorama des spectacles au Québec : de la Conquête au xxe siècle », Paul Wyczynski (dir.), Le théâtre canadien-français. Évolution, témoignages, bibliographie, Montréal, Fides, coll. « Archives des lettres canadiennes », 1976, p. 60-107.
-
[25]
Jean Laflamme et Rémi Tourangeau, L’Église et le théâtre au Québec, Montréal, Fides, 1979, 355 p.
-
[26]
Baudouin Burger, L’activité théâtrale au Québec (1765-1825), Montréal, Parti pris, coll. « Aspects », 1974, 410 p.
-
[27]
Jean-Marc Larrue, Le théâtre à Montréal à la fin du xixe siècle, Montréal, Fides, 1981, 139 p., et L’activité théâtrale à Montréal de 1880 à 1914, thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 1987, 1 021 f.
-
[28]
Voir Chantal Hébert, Le burlesque au Québec : un divertissement populaire, préface de Yvon Deschamps, LaSalle, Hurtubise HMH, coll. « Cahiers du Québec. Ethnologie », 1981, 302 p. ; « Sur le burlesque : un théâtre “fait dans notre langue” », Jeu. Revue de théâtre, no 18, 1981, p. 19-31, Le burlesque québécois et américain : textes inédits, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Vie des lettres québécoises », 1989, 335 p. ; et Rémi Tourangeau, « Les jeux scéniques du Québec et la théâtralisation de l’histoire », L’Annuaire théâtral. Revue québécoise d’études théâtrales, nos 5-6, automne 1988-printemps 1989, p. 171-182.
-
[29]
Lucie Robert, « Le moderne à l’épreuve de l’hétérogène ou Du bon usage des catégories lexicales dans les études littéraires » [inédit], Conférence présentée dans le cadre du Colloque annuel de l’Association des littératures canadiennes et québécoises, Université d’Ottawa, 31 mai 2015. Nous référons à ce texte avec l’aimable autorisation de son auteure.
-
[30]
Ibid.
-
[31]
Maurice Lemire (dir.), La vie littéraire au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 6 volumes, 1991-2010.
-
[32]
Lucie Robert, « La “vie culturelle” et son histoire. Quelques remarques sur la notion de “vie” », Globe. Revue internationale d’études québécoises, vol. XV, nos 1-2, 2012, p. 231-242.
-
[33]
Lucie Robert, « Jeanne Maubourg (1875-1953) : l’apprentissage de la modernité théâtrale », Jeu. Revue de théâtre, no 124, 2007, p. 173-182.
-
[34]
Ibid., p. 182.
-
[35]
Lucie Robert, Apprivoiser la modernité théâtrale. La pièce en un acte de la Belle Époque à la Crise. Anthologie, Québec, Nota bene, 2012, 263 p.
-
[36]
Voir Peter Szondi, Théorie du drame moderne (1880-1950), traduit de l’allemand par Patrice Pavis avec la collaboration de Jean et Mayotte Bollack, Lausanne, L’Âge d’Homme, coll. « Théâtre/Recherche », 1983 [1956], 145 p.
-
[37]
Robert cite Louis Guyon, auteur de Denys le patriote (1902), et Louis Fréchette, à qui l’on doit Félix Poutré (1962) et Papineau (1880).
-
[38]
Sous l’effet de la censure religieuse, la tradition américaine du Burlesque Show, associé au spectacle d’effeuilleuse, trouvera au Québec sa forme spécifique dans un jeu comique empruntant ses codes au vaudeville et expurgé du contenu grivois du spectacle américain.
-
[39]
Michel Bélair, Le nouveau théâtre québécois, Montréal, Leméac, coll. « Dossiers », 1973, 205 p.
-
[40]
En 1949, tout juste après le triomphe de sa pièce Ti-Coq, Gélinas prononce, à l’Université de Montréal (qui lui décerne un doctorat honoris causa), un discours intitulé « Pour un théâtre national et populaire ».
-
[41]
Le qualificatif « populaire » désigne les premières pièces de Dubé, de Zone (1953) à Un simple soldat (1957), qui dépeignent le milieu ouvrier dans lequel a grandi l’auteur.
-
[42]
Dans la première version (inédite) des Belles-soeurs, datée de 1965, Michel Tremblay attribue (sur la première page) au personnage de Rose le patronyme de Ouellette, référence directe à la comédienne du burlesque, première femme directrice de théâtre (Théâtre Cartier, Théâtre National), qui se faisait appeler La Poune. À la création de la pièce en 1968, l’auteur optera pour le nom de Rose Ouimet, mais le personnage ne reflète pas moins l’influence du comique populaire sur l’écriture de la pièce. Il désigne aussi les origines féminines (féministes) du théâtre québécois, par contraste avec la lignée paternelle avec laquelle Tremblay souhaitait rompre.
-
[43]
Chantal Hébert, « Sur le burlesque : un théâtre “fait dans notre langue” », p. 20.
-
[44]
Le mouvement majeur de la création collective au Québec, représenté entre autres par le Grand Cirque ordinaire, prendra appui sur plusieurs traditions populaires et techniques issues de formes comme le cabaret, le cirque et le burlesque.
-
[45]
Suivant le chemin tracé par Chantal Hébert, Larrue parle, à propos du burlesque québécois, d’une « avant-garde version peuple ». Jean-Marc Larrue, « Le burlesque québécois : l’avant-garde version “peuple” », Jeu. Revue de théâtre, no 104, 2002, p. 87-98 ; nous soulignons.
-
[46]
Germain Lacasse, Johanne Massé et Bethsabée Poirier, Le diable en ville. Alexandre Silvio et l’émergence de la modernité populaire au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2012, 299 p.
-
[47]
Ibid., p. 54.
-
[48]
Ibid., p. 38.
-
[49]
Voir André Gaudreault et Tom Gunning, « Le cinéma des premiers temps : un défi à l’histoire du cinéma ? », Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie (dir.), Histoire du cinéma, nouvelles approches, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Langues et langages », 1989, p. 49-63.
-
[50]
Walter Benjamin, L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, traduction inédite de l’allemand par Frédéric Joly, préface d’Antoine de Baecque, Paris, Payot & Rivages, coll. « Petite bibliothèque Payot. Philosophie », 2013 [1939], 144 p.
-
[51]
La référence à la « scène de la rue » de Brecht est ici explicite. Notons que l’auteur dramatique allemand en parle dans un texte de 1938 où il traite du principe dramaturgique de l’accident ; voir Bertolt Brecht, « La scène de la rue : modèle type d’une scène de théâtre épique » [1938], Écrits sur le théâtre, édition établie sous la direction de Jean-Marie Valentin avec la collaboration de Bernard Banoun, Paris, Gallimard/L’Arche, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2000, p. 856.
-
[52]
Dans la suite des travaux d’André Gaudreault sur l’émergence de l’institution du cinéma (Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe, suivi de Les vues cinématographiques [1907] de Georges Méliès, édité par Jacques Malthête, Paris, CNRS éditions, coll. « Cinéma & audiovisuel », 2008, 252 p.), cette analyse invite à repenser l’histoire des pratiques scéniques au Québec en regard des autres médias (l’intermédialité) ainsi que des séries culturelles qui ont pu informer son devenir. Le modèle auquel s’intéressent Lacasse, Massé et Poirier correspondrait ainsi à un dispositif caractérisé par l’« attraction » regroupant des activités (magie, cirque, variétés, revues, etc.) réfractaires aux règles du réalisme et de la diégèse que l’histoire du théâtre a eu tendance à reléguer à l’ère prémoderne des divertissements urbains.
-
[53]
Benjamin la développe principalement dans son essai L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Siegfried Kracauer la reprend à son compte dans ses travaux sur la ville et le cinéma : voir Le voyage et la danse. Figures de ville et vues de films, nouvelle édition, textes choisis et présentés par Philippe Despoix, traduits de l’allemand par Sabine Cornille, Paris/Québec, Maison des sciences de l’homme/Presses de l’Université Laval, coll. « Pensée allemande et européenne », 2008, 192 p.
-
[54]
Germain Lacasse, Johanne Massé et Bethsabée Poirier, Le diable en ville, p. 47.
-
[55]
Voir Yves Jubinville, « Du théâtre populaire au Québec ou la généalogie d’un mythe moderne (1968-1999) », L’Annuaire théâtral. Revue québécoise d’études théâtrales, no 49, printemps 2011, p. 113-128.
-
[56]
Nous reprenons ici l’analyse de Kirsten Shepherd-Barr sur le préjugé antithéâtral qui imprègne l’analyse historique et esthétique de la modernité : « Many of the art works (and their media) that have come to define modernism are characterised by their isolating or anti-communal nature: the work itself and the experience of viewing or reading it undercuts any sense of community and reinforces the solitary existence traditionally associated with the modern, alienated subject. Theatre by its communality does not seem to fit this paradigm. » Kirsten Shepherd-Barr, « Modernism and Theatrical Performance », Modernist Cultures, vol. I, no 1, mai 2010, p. 64. En ligne : http://dx.doi.org/10.3366/E2041102209000057 (page consultée le 10 mai 2019). « Un grand nombre d’oeuvres d’art (et leurs médias) qui définissent le modernisme se caractérisent par leur nature isolante ou anticommunautaire : l’oeuvre elle-même et l’expérience de la regarder ou de la lire minimisent le sens de la communauté et accentuent l’expérience solitaire propre au sujet aliéné moderne. Le théâtre, par la communauté qu’il constitue, ne semble pas correspondre à ce paradigme. » Nous traduisons.
-
[57]
Ibid.
-
[58]
Le critique Sheldon Cheney est réputé avoir promu l’idée d’un théâtre moderne américain dans la revue Theatre Arts Magazine dès 1916. Sur l’influence de Cheney, voir DeAnna M. Toten Beard, Sheldon Cheney’s Theatre Arts Magazine. Promoting a Modern American Theatre, 1916-1921, Lanham, Scarecrow Press, 2010, 281 p.
-
[59]
Thomas Postlewait, « The Hieroglyphic Stage: American Theatre and Society, Post-Civil War to 1945 », Don B. Wilmeth et Christopher Bigsby (dir.), Cambridge History of American Theatre, t. II : 1870-1945, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 107-195.
-
[60]
Ibid., p. 188. « L’histoire du divertissement américain depuis le milieu du xixe siècle jusqu’à aujourd’hui peut être comprise non seulement comme une lutte entre Europe et Amérique, mélodrame et réalisme, culture d’en haut et culture d’en bas, scène et écran, pays et ville, autochtones et immigrants, les hommes et les femmes, les Blancs et les Noirs, mais aussi, et de manière encore plus révélatrice, en tant que processus global par lequel une culture démocratique ou de masse voit naître un nouveau type de spectateurs, ou une culture optique définie par le règne de l’oeil et la séduction des images. » Nous traduisons.
-
[61]
Eugene Benson et Leonard W. Conolly, English-Canadian Theatre, Toronto, Oxford University Press, coll. « Perspectives on Canadian Culture », 1987, 134 p.
-
[62]
Robin C. Whittaker, « The Trades of T.R.i.C. There Are No Macrohistories Here », Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada, vol. XXXV, no 2, été 2014, p. 250-251. L’auteur souligne.
-
[63]
Dans un essai synthèse qui reprend l’essentiel des éléments que nous venons de citer, l’historien et critique Alan Filewod identifie la source de cette interprétation historique en la personne de Don Rubin, fondateur de la revue Canadian Theatre Review. Il écrit : « Writing in 1974, Don Rubin […] stated categorically that “the Massey Commission Report then becomes a key to understanding the rapid rise of Canadian arts and arts organization in the period following World War II”. […] In this narrative, the Massey Report legitimizes the principle of intervention, and the Canada Council spreads the seeds of cultural development […] by establishing a model for the provincial and municipal arts council […], a system clearly design to implement a model of theatrical federalism that would serve as a metonym of the national state. » Alan Filewod, « Undermining the Centre: The Canon According to Canadian Theatre Review », Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada, vol. XI, no 2, automne 1990, p. 178-185. En ligne : https://journals.lib.unb.ca/index.php/TRIC/article/view/7287/8346 (page consultée le 2 juillet 2019). « Dans son article de 1974, Don Rubin […] a déclaré catégoriquement que “le rapport de la Commission Massey devient alors un élément clé pour comprendre l’essor rapide des arts et des organismes artistiques canadiens au cours de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale”. […] Dans ce récit, le rapport Massey légitime le principe d’intervention de l’État et le Conseil des Arts du Canada étend les bases du développement culturel […] en établissant un modèle pour le conseil des arts provincial et municipal […], un système clairement conçu pour mettre en oeuvre un modèle de fédéralisme théâtral agissant comme une métonymie de l’État national. » Nous traduisons.
-
[64]
Dans le cadre du projet « Régimes socio-esthétiques du théâtre au Québec (1945-2015) : synthèse historique », financé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), une équipe de huit chercheurs (sous la direction de Gilbert David) s’affaire, depuis 2014, à la mise en forme de la première synthèse de l’histoire du théâtre au Québec de 1945 à nos jours.
-
[65]
Élisabeth Nardout-Lafarge, « La valeur “modernité” en littérature québécoise : notes pour un bilan critique », Élisabeth Nardout-Lafarge et Ginette Michaud (dir.), Constructions de la modernité au Québec, Outremont, Lanctôt éditeur, 2004, p. 285-291.