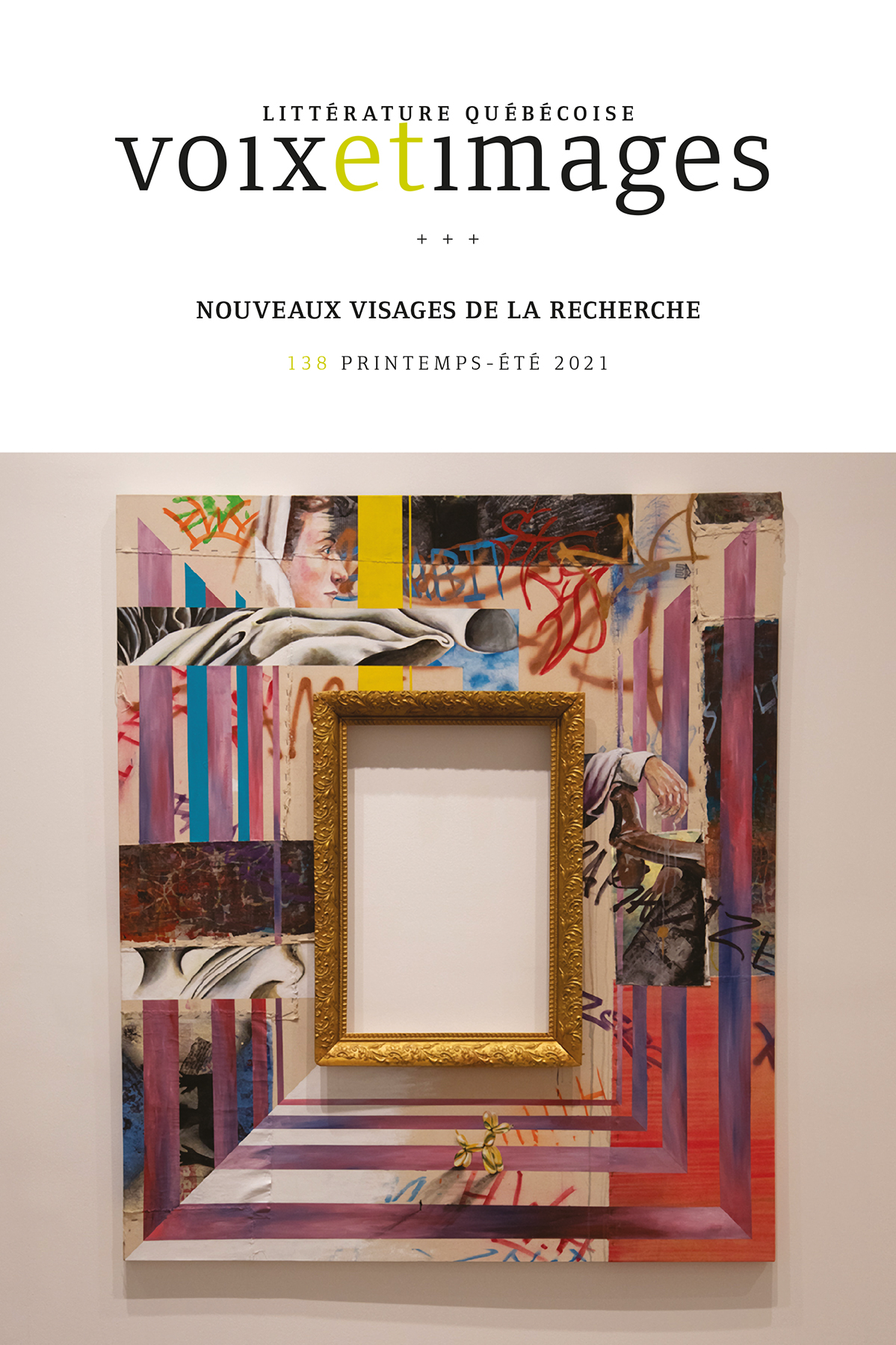Abstracts
Résumé
Cet article propose une lecture de La Grand-tronciade, un long poème héroï-comique publié par Arthur Cassegrain en 1866 et racontant un voyage en train de Québec à Rivière-du-Loup. Fortement ancré dans l’économie discursive de son époque, où le chemin de fer et le Grand Tronc dominent l’actualité, ce poème reprend, pour mieux les railler ou les mettre à distance, aussi bien la culture classique dont il émane que les topoï et pratiques médiatiques en vogue. Dans cette représentation humoristique de l’espace ferroviaire, traité comme une métaphore de l’espace social des années 1860, le poète livre en dernière analyse une réflexion sur sa propre condition et sur son inscription problématique au sein de la société.
Abstract
This article offers a reading of La Grand-Tronciade, a long heroic-comic poem published by Arthur Cassegrain in 1866 that recounts a journey by train from Québec to Rivière-du-Loup. Firmly anchored in the economic discourse of its era, when the railway and the Grand Trunk dominated the news, this poem addresses both the classical culture from which it comes and the topoï and media practices in vogue at the time in order to better mock them or to observe them from a distance. In this comical representation of the railway space, treated as a metaphor for the social space of the 1860s, the poet ultimately delivers a reflection on his own condition and on his problematic inscription within society.
Resumen
Este artículo propone una lectura de La Grand-Tronciade (El gran itinerario), un largo poema heroico-cómico publicado por Arthur Cassegrain en 1866, que relata un viaje en tren de la Ciudad de Quebec a Rivière-du-Loup. Sumamente arraigado en la economía discursiva de su época, en la que el ferrocarril y el Grand Tronc (Gran vía férrea troncal) dominaban la actualidad, este poema retoma, para burlarse mejor o distanciarse tanto de la cultura clásica de la que emana como de los topoi de las prácticas mediáticas en boga. En esta representación humorística del espacio ferroviario, tratado como metáfora del espacio social de los años 1860, el poeta entrega, como último análisis, una reflexión sobre su propia condición y sobre su inclusión problemática en la sociedad.
Article body
En février 1868, les journaux francophones annoncent la mort d’Arthur Cassegrain, un jeune avocat de Québec né à L’Islet en 1835. Admis au barreau en mars 1860 « après de brillantes et solides études », arraché par « la tombe » à une « trop courte carrière », celui qui préférait faire « dormir les dossiers sous son pupitre pour ne s’occuper que de littérature » laisse quelques poésies éparses parues dans les périodiques de l’époque. « Mais l’oeuvre principale, poursuit le Courrier du Canada, du poëte dont nous déplorons la perte, celle qui assure à son nom une place distinguée parmi tous les noms de la littérature canadienne, est sans contredit la Grand-Tronciade, poëme badin en neuf chants[2]. »
Poème héroï-comique, cette Grand-Tronciade relate un voyage en train de Québec à Rivière-du-Loup dans les wagons du Grand Tronc. Lancée en avril 1865 dans le « feuilleton » de l’éphémère Journal de Lévis, la publication de ce texte « humouristique » remarqué est interrompue à l’été, l’auteur ayant « l’intention de le publier en volume[3] » ; enrichi d’une « préface » signée à Québec en décembre 1865, l’ouvrage paraît en juin 1866, à Ottawa, chez l’imprimeur George-Édouard Desbarats[4]. Ce long récit en vers suscite des réactions contrastées. Plusieurs s’esclaffent à la lecture de ce poème mordant, « spirituel » et « plein de mérite[5] » ; d’autres ne rient pas. La Revue canadienne, qui a pourtant coutume de limiter ses notices bibliographiques à des avis de réception ou à de brèves recensions descriptives[6], sort de ses habitudes et publie une critique négative de Pamphile Le May, qui déplore la faiblesse des vers, des rimes ratées, une prosodie déficiente[7]. En 1869, dans une conférence sur la poésie présentée à l’Institut canadien-français d’Ottawa, Aeneas McDonell Dawson place Cassegrain dans sa liste des écrivains « dignement appréciés par leurs compatriotes[8] » ; Edmond Lareau salue également, en 1874, la « muse badine et gaie de M. Cassegrain[9] ». D’autres signes encore révèlent une réception active : en 1870, dans le récit d’un voyage en train à l’est de Québec, James MacPherson Le Moine cite à neuf reprises les vers du poète de L’Islet, qui accompagnent le regard qu’il jette sur le paysage traversé[10].
Puis La Grand-Tronciade tombe dans l’oubli ; elle n’en est jamais vraiment sortie.
Les dix-neuviémistes la connaissent et les ouvrages de référence la répertorient, mais on ne la lit plus – et on l’étudie encore moins. Pierre Rajotte l’évoque à peine dans son ouvrage sur les récits de voyage du xixe siècle[11]. Claude La Charité en a dit quelques mots, mais dans un bref article destiné au grand public[12]. Exclusivement consacrée à l’inventaire des traces et des nombreux détournements comiques de l’intertextualité classique, la seule étude existante du poème de Cassegrain émane de la thèse de doctorat – jamais publiée – d’Iréna Trujic[13].
Cette désaffection s’explique aisément. De fait, les deux clés d’interprétation qui permettaient au public de 1865 et de 1866 d’apprécier La Grand-Tronciade sont aujourd’hui disparues. D’une part, le texte reste profondément attaché à l’univers intellectuel de l’éloquence et de la culture classique de l’époque, qui s’est effondré en même temps que la formation collégiale que recevaient et partageaient les écrivains canadiens-français du xixe siècle ; cet effritement de l’horizon référentiel gréco-romain qui permettait son assimilation et qui la rendait à la fois drôle et compréhensible a enfermé l’oeuvre dans une sorte d’illisibilité culturelle. Or cet ésotérisme est aggravé, d’autre part, par une autre coupure historique. Anecdotiques et « badins », fortement enracinés dans leur contexte d’écriture immédiat (médiatique, social, politique), les vers de Cassegrain ont « mal résisté à l’usure du temps[14] » et sont vite devenus inintelligibles. Truffé d’allusions aujourd’hui obscures au monde ferroviaire, aux personnages et aux débats politiques de son temps, le récit est de nos jours doublement illisible.
L’historien de la littérature et de la culture peut cependant redonner à La Grand-Tronciade une part de sa lisibilité perdue : loin d’être une anodine curiosité, cette représentation du wagon, traité comme une métaphore de l’espace social, permet au poète – on le verra – de livrer une réflexion sur sa propre condition. Peut-on prendre au sérieux un texte écrit pour « faire rire » le « bon public » ? Arthur Cassegrain, qui dit « tout en riant des choses sérieuses », nous y invite lui-même. Car « on ne rit pas longtemps sans finir par pleurer :/La rate est difficile en diable à modérer » (GT, iv et 93).
ÉCRIRE LE CHEMIN DE FER EN 1865
Précédés d’une « épître dédicatoire » à Charles John Brydges (arrivé à la direction générale du Grand Tronc vers la fin de l’été 1862), suivis d’un épilogue, les neuf « chants » qui composent le récit homodiégétique d’Arthur Cassegrain racontent un voyage estival entre Québec et Rivière-du-Loup : à Québec, dans la Basse-Ville, le narrateur achète un billet de train au « dépôt tout neuf, dit du Grand Trunk Ferry » (GT, 3), et s’embarque avec d’autres voyageurs pour se rendre à Lévis, où les « chars », comme le disent les contemporains, attendent le traversier. Tandis que plusieurs passagers prennent place « dans la seconde classe », il monte de son côté dans le wagon de « première classe » et « ouvre vite les yeux sur tout ce qui s’y passe » (GT, 20-21), versifiant intarissablement, jusqu’à Rivière-du-Loup, son expérience de la vapeur et ses observations sur la sociabilité et la faune ferroviaires : au fil du voyage, les personnages se mettent en mouvement, s’interpellent et interagissent, passent d’un wagon à l’autre et fument, mangent, boivent aussi bien dans « le char à bagage » (GT, 21) qu’aux différentes stations. Le texte relève du pastiche héroï-comique, qui s’oppose dans le système classique des genres au « travestissement burlesque » : alors que celui-ci « transcrit en style vulgaire un texte noble dont on [conserve] l’action et les personnages », le pastiche traite plutôt « un sujet vulgaire dans un style noble en pratiquant hors de propos le style héroïque[15] ». Le titre et la division en « chants » évoquent l’Iliade par classicisme interposé : se réclamant ouvertement du Lutrin de Boileau, le poète de L’Islet « chante le Grand-Tronc » (GT, 2) comme son prédécesseur « chante les combats[16] », par « pure plaisanterie », entre un chantre de la Sainte-Chapelle et son trésorier, en 1667.
Que le récit soit, ou non, la transposition d’un ou de plusieurs voyage(s) fait(s) par Cassegrain « en compagnie de quelques amis, gais poëtes comme lui[17] », est indifférent : la diégèse, les situations et les personnages, fictionnalisés mais vraisemblables, reprennent exactement les réalités ferroviaires que connaissent en 1865 les voyageurs de la région de Québec.
Incorporé le 10 novembre 1852 par un acte qui l’autorise à construire un chemin de fer entre Montréal et Toronto, le Grand Tronc (Grand Trunk Railway Company of Canada) absorbe au cours de la décennie suivante plusieurs compagnies antérieures et voit sa charte s’étendre successivement : en 1865, au moment où Cassegrain publie sa Grand-Tronciade, son réseau ferroviaire s’étend de Détroit (à l’ouest) à Portland et à Rivière-du-Loup (à l’est), en passant par Toronto, Kingston, Montréal (avec son pont Victoria, ouvert en décembre 1859), Saint-Jean-sur-Richelieu, Richmond, Sherbrooke, Trois-Rivières (sur la rive sud du fleuve) et Lévis. Les habitants de Québec doivent franchir le fleuve sur le traversier de la compagnie pour prendre le train. Victime des flammes en 1856, puis remplacé par des installations temporaires[18], le « dépôt » de Québec est sans doute « tout neuf » (GT, 3), en effet, à l’époque où le poète entonne son badinage lyrique. Il n’a rien inventé, du reste, des stations qu’il croise sur sa route (comme Saint-Henri, Saint-Thomas ou Saint-Pascal, qui figurent sur les indicateurs de l’époque), où les voyageurs peuvent descendre pendant qu’une « bande fort active/S’en va remplir les flancs de la locomotive/Avec le bois et l’eau qui sont sa ration » (GT, 30). Le lecteur de 1865 ne s’étonnera pas non plus de voir le convoi s’arrêter « un quart d’heure » à la gare de L’Islet, « étape solennelle » où les « voyageurs altérés, affamés », ont quelques minutes (c’est la « façon américaine ») pour combler « un bon appétit » (GT, 52 et 58) : de fait, c’est à L’Islet, et pour une quinzaine de minutes, que s’arrêtent les trains de passagers entre Lévis et Rivière-du-Loup[19]. Avocats et marchands, députés et ministres, ruraux, citadins, écoliers et touristes : féminine et masculine, socialement variée, mais plus bourgeoise que populaire – on trouve « trois bourgeois », mais un seul « habitant » (GT, 19) – et plus urbaine que villageoise, la « galerie » sociale (GT, 20) mise en scène par Cassegrain, de même que la division des classes et l’espace intérieur des « chars » (ouverts comme le sont les wagons américains), reflète aussi assez bien les conditions matérielles et la composition sociale de la vie ferroviaire vers 1865[20].
Le récit poétique de Cassegrain n’intègre pas seulement le paysage ferroviaire de son époque ; il absorbe aussi tous les lieux communs qui caractérisent, au milieu du xixe siècle, les représentations collectives du train et de la vapeur. Né en 1835, un an seulement avant l’implantation du chemin de fer au Bas-Canada, l’auteur n’a jamais connu le monde pré-ferroviaire et a sans doute appris à « dire » la vapeur au contact des rhétoriques qui, dès les années 1830, façonnent sa mise en discours, et dont les journaux sont inondés. Comme l’a relevé Wolfgang Schivelbusch, l’avènement de la locomotive est décrit par les contemporains comme une abolition des distances ou une suppression de l’espace. Cet omniprésent procédé (une « traduction spatiale de l’abrègement temporel[21] » du voyage) apparaît dès l’épître dédicatoire du texte : le train « s’élançant plein d’audace,/Aussi prompt que l’éclair dévora tout l’espace » (GT, vi). Aux yeux des contemporains, cette vitesse effroyable fait du train une sorte de « projectile » volant à travers le paysage[22]. Cassegrain peut en témoigner : sur cette voie ferrée qui « rend l’espace infime », le voyage est un « vol d’aigle » (GT, vii). À l’instar de ses contemporains, par ailleurs, le poète animalise la locomotive, ce « monstre de feu », ce « coursier » aux « reins d’acier » qui peut être « essoufflé » (GT, vi, 29, 30, 49, 89). Les contraintes naturelles et géographiques ? La vapeur les surmonte, les détruit : « soudain, s’abaissèrent les monts ;/Les gouffres, les torrents se couvrirent de ponts » (GT, vi). Il est difficile, enfin, de raconter le chemin de fer, au milieu du xixe siècle, sans se laisser happer par le refrain du « progrès » et de sa marche inexorable : dans ce « siècle de fer » où le progrès « refait tout à sa guise », « qui sait si bientôt la puissante chaudière,/Subissant elle aussi les hasards du destin,/Ne s’éclipsera pas devant la Montgolfière » (GT, 75, 6)[23] ?
D’autres topiques narratifs ont trouvé leur chemin jusque dans La Grand-Tronciade. En 1853, un poème comique paru dans The Quebec Mercury raconte la mésaventure d’un voyageur qui, tombant endormi dans un train bondé, se ridiculise devant une passagère rieuse[24]. Arthur Cassegrain reprend ce motif – source évidente du rire ferroviaire – en mettant en scène un shérif somnolent : « [R]egardez tout auprès, dans ce coin,/C’est Monsieur le Shérif ronflant comme un marsouin./Lorsqu’il est éveillé, c’est un homme adorable ;/Mais lorsqu’il dort pourtant il est bien plus aimable. » (GT, 59-60) Dans ce lieu de circulation et d’intensification des regards qu’est le wagon, le sommeil est perte d’autocontrôle et, par extension, d’autorité et de respectabilité sociale.
En France, au xixe siècle, le discours commun décrit la gare comme « un lieu de flirt » et met fréquemment en scène la figure de « la jeune femme en voyage, donc disponible à la rencontre[25] ». Ce topos ne met pas beaucoup de temps à franchir l’Atlantique. En 1851, un correspondant du Journal de Québec relate son excursion ferroviaire à Troy : dans les chars, il a « devant les yeux une de ces pâles mais charmantes voyageuses qui se passent bravement d’un vieux protecteur ». En 1857, c’est à bord du Grand Tronc, entre Québec et Toronto, qu’un chroniqueur tombe sur « la rose la plus fraîche que 18 printemps aient pu faire éclore dans les Townships de l’Est » ; les regards se croisent, il se met à rimer et s’imagine séance tenante qu’« elle rêve déjà peut-être de trouver un épouseur[26] ». Ce poncif fait aussi l’objet de blagues ferroviaires. Il ne faut jamais, rapporte en substance une farce publiée par L’Ordre en 1860, laisser sa femme partir en train avec des inconnus ; elle ne reviendra jamais[27]. On ne s’étonnera donc pas de rencontrer chez Cassegrain un couple de villageois retournant à la campagne : c’est en train que la « charmante blonde », « coquette » et « fort volage », s’était rendue seule à la ville pour « tâter un peu du citadin » ; c’est aussi dans le train, avec son amoureux « venu la chercher » et à qui elle « [jure] bien ne plus jamais pécher », que cette « friponne » le trahira à nouveau, convoitée par trois bellâtres qui se disputent chaudement « la victoire » (GT, 18, 37). Le regard masculin du xixe siècle voit le train comme un lieu d’idylles irrépressibles, symptôme à la fois d’un fantasme (dénicher une femme séduisante) et d’une frayeur (perdre la sienne) : les chars, qui sont fuite, évasion, vol dans l’espace, libèrent dangereusement cette femme, la fugitive, qu’ils arrachent à ses amarres domestiques.
Dans La Grand-Tronciade, caisse de résonance des voix de son époque, on entend retentir les lieux communs du discours ferroviaire. Le poème de Cassegrain apparaît ainsi comme la reprise humoristique d’un exercice littéraire très fréquent dans le deuxième tiers du xixe siècle : versifier le chemin de fer est, en 1865, une pratique déjà banalisée. Un dépouillement systématique de la presse bas-canadienne le confirme : entre 1830 et 1867, les poèmes – écrits par des Canadiens comme par des Européens – qui évoquent le chemin de fer ou qui lui sont exclusivement consacrés se comptent par dizaines. Plusieurs de ces textes abordent le Grand Tronc et la vie ferroviaire locale. En 1858, par exemple, Adolphe Marsais, cet infatigable rimeur qui chante sans relâche ses excursions touristiques, publie dans Le Canadien un poème sur sa « visite par chemin de fer à St. Thomas » (Montmagny). À bord du Grand Tronc, sur l’air d’« Au clair de la lune », il savoure et chante sa vive « cavale » : « La distanc’ s’efface/Sous son rapid’ pas/Comme un trait je passe/Jusqu’à St. Thomas[28]. » C’est dans cet univers de pratiques médiatiques et littéraires historiquement datées, qui forment en partie l’horizon d’attente du public de 1865, que vient s’inscrire La Grand-Tronciade.
« JE CHANTE LE GRAND-TRONC »
Comme tout pastiche héroï-comique, qui forge « par voie d’imitation stylistique un nouveau texte noble pour l’appliquer à un sujet vulgaire[29] », le poème de Cassegrain déploie un humour fondé d’abord sur l’extrême décalage entre l’élévation du dire et la banalité du dit, entre la poéticité du style et le prosaïsme du thème. « Je chante le Grand-Tronc et tout le bataclan », écrit le poète au début du premier chant : le sujet vulgaire, le « comble de l’antipoésie[30] », c’est moins le chemin de fer lui-même – largement constitué, on l’a vu, en objet poétique – que la compagnie du Grand Tronc. C’est aussi ce que confirme la réaction froide de Pamphile Le May : si, au « terminus » du poème, il est arrivé « ne riant pas du tout », c’est parce que « le sujet est mal choisi » et que « le Grand-Tronc n’a guère de côté comique[31] ». Mais tous ne partagent pas l’humeur de Le May, et c’est précisément parce que le sujet est sérieux que Cassegrain le constitue en objet humoristique et donne à son badinage « la couleur de la satire » (GT, iv). Il n’est pas le seul à railler le Grand Tronc et sa Grand-Tronciade semble répondre à une boutade d’Adolphe Marsais, qui invitait dans une chanson, en 1862, les poètes à s’en emparer :
La colère du fier Achille
Eut jadis un chantre immortel ;
Du Grand-Tronc pour peindre la bile
Il faut un ton moins solennel ;
Un ouvrage de longue haleine
Du reste n’est point dans mes goûts ;
Mon sujet n’en vaut pas la peine ;
D’une chanson contentons-nous[32].
En 1865, c’est cet « ouvrage de longue haleine », chanté dans le style de l’Iliade mais avec un « ton moins solennel », que compose et publie Cassegrain.
À partir de 1852, et sans interruption jusqu’au moment de la Confédération, le Grand Tronc est un objet éminemment polémique, qui ne cesse d’engendrer dans la presse des débats acrimonieux et de soulever l’insatisfaction publique. Nombreux, les motifs d’indignation et les griefs transcendent souvent les divisions linguistiques (et parfois les clivages idéologiques) qui marquent l’espace social de l’époque.
Possédé majoritairement par des actionnaires londoniens – son bureau de direction principal déménage d’ailleurs à Londres en 1862 –, propulsé à l’origine par les réformistes de Francis Hincks[33] et systématiquement appuyé, ensuite, par les conservateurs, le Grand Tronc est constamment accusé de grever le Trésor public. Perpétuellement au bord de la faillite en raison à la fois de ses principes de construction, de sa désastreuse administration financière et des rigueurs du climat canadien, le Grand Tronc multiplie les demandes d’aide à la législature[34] et obtient successivement (notamment en 1855, en 1856 et en 1861) d’importantes contributions financières. Dès 1854, les soupçons de corruption et la dénonciation des pratiques frauduleuses et des conflits d’intérêts reviennent périodiquement dans l’espace public, alors que plusieurs des directeurs de la compagnie cumulent également des fonctions politiques au cabinet ministériel. Nommé avocat de la compagnie à l’été 1853, porte-parole du Grand Tronc à l’Assemblée législative de la Province du Canada entre 1852 et 1867, George-Étienne Cartier (qui assure simultanément plusieurs charges ministérielles)[35] devient l’un des symboles, aux yeux de ses adversaires, de cet « odieux[36] » outrage à la moralité publique. Ces griefs politiques sont aggravés par plusieurs critiques circonstancielles. En 1863 et en 1864, par exemple, les charretiers de Montréal déclenchent une grève (vigoureusement appuyée par L’Union nationale et par le Montreal Witness) pour dénoncer les méthodes commerciales du Grand Tronc, qui précarisent les voituriers en les privant du transport de la marchandise entre la gare et les commerçants urbains[37]. Fréquence des déraillements et des accidents, retards et bouleversements récurrents du service pendant l’hiver, tarifs irréguliers : les plaintes atteignent dans les années 1860 une vivacité inédite, alors que les francophones déplorent de leur côté la discrimination linguistique de la compagnie.
On retrouve dans La Grand-Tronciade les échos de ce climat polémique. Le ton grandiloquent de l’épître dédicatoire au directeur général de la compagnie souligne d’emblée le caractère ironique de l’hommage à cet « arbitre suprême » du Grand Tronc, ce « noble enfant de la vieille Angleterre » (GT, vi). La raillerie n’est pas bien loin : Cassegrain écrit « toujours pour louer, ou bien pour faire rire ;/Quelquefois pour le blâme, allons ! je dois le dire ;/Cependant, dans ce cas, je le fais sans aigreur,/Par amour du prochain, pour le rendre meilleur. » (GT, vii)
Cet « amour du prochain » s’attaque d’abord à la collusion de la compagnie et des politiciens. Dans le train, le narrateur croise un ministre du gouvernement, ce « puissant honorable » qui voyage gratuitement. Cette puissance lui attire des opportunistes quémandeurs : « Deux hommes aux regards d’éloquente prière/Suivent aussi de loin l’homme du ministère./Le plus maigre des deux est en quête d’emploi ;/L’autre, le gros ventru, d’un contrat veut l’octroi. » (GT, 11) Pour ceux qui savent « montre[r] des poumons qu’aucun autre n’efface[38] », la persévérance porte ses fruits : au troisième chant, le « contracteur et le chercheur de place » parviennent à faire comprendre « son devoir » à « l’homme du Pouvoir » (GT, 24). Mais la compagnie en sort également gagnante. « En donnant au ministre un libre passeport », elle attire à bord de son train ceux « qui, sans l’homme au pouvoir, n’auraient point pris passage ». Cette politique, dit le poète, est « intelligente et sage/[…] Puisque pour un [billet] donné, c’est bien trois qu’il y gagne…/Ergo ledit Grand-Tronc est fort au Qui-perd-gagne » (GT, 11).
Cette scène renferme pour le lecteur de 1865 un double sens, l’allusion au « qui-perd-gagne » ayant dans le contexte de l’époque un sous-texte évident. Elle renvoie à cette pratique fréquemment dénoncée qui consiste à offrir des billets gratuits à des membres de l’élite politique ou à réserver, pour leur usage, des « trains spéciaux[39] » qui nuisent parfois au service régulier : ce que gagne réellement la compagnie, ce n’est pas, en fait, deux ou trois billets supplémentaires (ceux achetés par les quémandeurs), mais la protection politique et l’appui de « l’homme du Pouvoir », qui dans le poème de Cassegrain est aussi (on l’apprend plus loin) un défenseur du Grand Tronc. À demi-mot, l’image de la compagnie est donc ici doublement écorchée : on rappelle au lecteur que le Grand Tronc achète ses puissants alliés, qui à l’instar du Zeus de l’Iliade savent faire trembler leurs « auditeurs » par un « seul mouvement » de leur « noir sourcil » (GT, 23)[40] ; on lui signale aussi que, dans ses trains, ces alliés corrompus manigancent avec des « contracteurs » et des « chercheurs de place ».
Sans dénoncer ouvertement ce « mépris pour la race française[41] » que plusieurs francophones reprochent à la compagnie vers 1860, le poète raille également la barbarie de la langue commerciale anglaise et le monopole qu’elle exerce sur le monde ferroviaire. Du « Grand Trunk Ferry » à la gare de « South-Quebec » (Lévis), le lexique anglophone est mis en italique (GT, 3, 19). L’anglais sature aussi les espaces ferroviaires : à la station de Québec, on lit « Waiting room » (mots qu’un « marin stupéfait » ne parvient pas à comprendre) et « ticket office ». Et on n’enregistre pas ses bagages ; il faut plutôt les « chèquer » (GT, 5). À la fin du premier chant, le poète renonce à ce langage imposé, concentré surtout dans les premières pages du texte. Il se demande comment sonne « ce jargon étranger aux oreilles des dieux […]/Ils se sont crus sans doute en plein pays barbare/Au mot ticket ou check arrivant jusqu’aux cieux./Tâchons donc d’employer une langue plus douce » (GT, 7).
LE WAGON COMME THÉÂTRE SOCIAL
Dans sa lecture du George Dandin de Molière, joué à Versailles devant la cour de Louis XIV en juillet 1668, Roger Chartier propose une hypothèse fondamentale, aux inflexions bourdieusiennes : « [L]es textes littéraires, écrit-il, mettent en représentation les principes contradictoires de construction du monde social, les classements en actes par lesquels les individus […] classent les autres, partant, se classent eux-mêmes. » Son analyse montre que la littérature comique trouve l’un de ses ressorts les plus puissants dans la mise en scène de ces classements et de la dynamique de leurs affrontements, « par lesquels, contradictoirement, [l’espace] social est construit[42] ».
Ces remarques s’appliquent admirablement à La Grand-Tronciade, qui constitue très exactement un exercice de classement, par lequel Cassegrain, qui voit dans l’espace ferroviaire un microcosme de la société, donne une figuration de l’espace social de 1865 tel qu’il le perçoit, avec ses divisions et ses « classes », ses oppositions et ses conflits. Par sa composition (chaque wagon représente une classe, la première ou la seconde) comme par la division intérieure de ses chars (ce sont des espaces ouverts dans lesquels les voyageurs peuvent circuler, mais dont l’aménagement impose en même temps un découpage fixe, déterminé par la position des sièges), le train de l’époque, fréquenté par une clientèle diversifiée, s’offre comme une métaphore plausible de l’espace social. C’est bel et bien un « tableau » ou un « portrait » (GT, 94) de société que compose Cassegrain, dans lequel il se place lui-même, se classant tout en classant ses personnages : en faisant « la revue/De tous les voyageurs que rencontre [sa] vue », l’écrivain dresse un théâtre social qu’il appelle sa « galerie » (GT, 8, 20) et qui se met en mouvement quand les « chars » quittent Lévis. « Voici que va parler, agir ce personnel :/Ne perdons pas un trait, pas un mot, pas un geste./O dieux que j’invoquai, j’écris, faites le reste ! » (GT, 20)
La Grand-Tronciade met en scène 43 personnages individualisés (en incluant le poète lui-même qui, présent dans le train, assiste aux scènes qu’il chante) et quelques groupes indéfinis (comme ce « petit groupe enjoué » et ces « filles à foison » [GT, 16, 19]) présentés comme des amas indistincts dont les individus sont dépourvus d’une identité sociale propre. Cette société imaginée s’ordonne selon deux principes de classement : elle se compose à la fois de figures incarnant des groupes sociaux (définies et distinguées par leur statut ou leur rôle professionnel) et de personnages représentant des types abstraits, comme la jeune fille volage, la « digne commère[43] » (cette « machine à son », ce « sac à tout cancan » qui dérange les voyageurs) ou le « charlatan », ce « médecin malgré vous » en quête de victimes qui soigne « envers et contre tous » (GT, 64, 15)[44]. Les figures sociales et professionnelles relèvent essentiellement de cinq grandes catégories. Accompagné d’un député, son « humble vassal », l’« homme du ministère » rencontre dans le train un « opposant » du « présent cabinet ». À ce groupe des politiciens s’ajoutent celui des professions libérales (on trouve trois avocats et deux notaires), celui des notables de province (un marguillier, un écolier du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et sa « tendre mère », un « gros habitant » [GT, 19], un seigneur), celui de l’élite urbaine (un marchand, des bourgeois, trois citadins aristocrates et charmeurs) et celui, enfin, des forces de l’ordre (un shérif, un colonel et un major, assistés dans le texte par le conducteur du train).
Cette société du wagon est un espace organisé par une double division. La première division est pour ainsi dire verticale : elle sépare le wagon de « première classe » et celui de « seconde classe », autrement dit elle oppose l’espace des classes dominantes, où prend place l’écrasante majorité des personnages individualisés décrits par le poète (assis lui-même en première classe), à l’espace informe des classes dominées, le « modeste char » (GT, 25) de deuxième classe, dont la composition n’est pas détaillée, étant peuplé par la masse indivise « des braves gens » (GT, 27). Cette population de seconde classe est représentée comme un réservoir de ressources et de forces exploitables que l’élite cherche à mobiliser à son avantage. C’est en deuxième classe que « commence la chasse » des avocats qui se cherchent des « procès » (GT, 21). C’est aussi en seconde classe que le député de l’opposition se rend pour semer la discorde et lever l’opinion publique contre la « taxe » adoptée (GT, 25) par l’« homme du ministère ». Mais à ce peuple indigné qui, dans le « tapage » et le « tumulte », se lève alors « debout comme un seul homme », la première classe rétorque en envoyant ses forces de l’ordre : le major lève « sur l’heure un petit bataillon » pour mater la « fougue populaire », mais c’est le conducteur du train, appelé par le ministre, qui rétablit avec autorité « une paix admirable » dans ce « char mal-appris » où « règne la licence » (GT, 28, 26). Dans ce conducteur nommé Paulet, le lecteur de Québec reconnaît sans doute « M. Paulet[45] », un conducteur du Grand Tronc apparemment connu et apprécié du public, et affecté dans les années 1860 aux trains de passagers entre Lévis et Rivière-du-Loup. Mais il faut peut-être également voir dans ce « brave Paulet », maître à bord, partisan de « l’ordre » (GT, 60, 27) et allié de l’« homme du ministère », une figuration fictionnelle du gouverneur et de lord Sydenham (Charles Poulett Thomson) en particulier, artisan de l’Union et gouverneur de la colonie entre 1839 et 1841, appelé malicieusement « Poulet[46] » par Napoléon Aubin dans Le Fantasque[47].
La seconde division est plutôt d’ordre horizontal : elle oppose, à l’intérieur même du char de première classe, les groupes représentés et les personnages entre eux. Ces divisions sont nombreuses. La principale et la plus structurante, bien sûr, est politique. L’affrontement entre le « ministre », figure du parti au pouvoir, et l’« opposant », son adversaire, renvoie à la polarisation sociale et politique qui organise l’espace public au milieu du xixe siècle, où les réformistes et conservateurs (qui nouent une alliance avec le clergé, qui adoptent le principe de l’Union et de la tutelle britannique et qui restent les principaux promoteurs et défenseurs du Grand Tronc) s’opposent aux libéraux radicaux puis modérés (qui rejettent l’Union et qui se tournent vers l’annexion aux États-Unis à la fin des années 1840 avant de contester la Confédération)[48]. D’un côté, « l’homme du ministère » incarne le parti conservateur, et probablement, aux yeux du public de 1865, George-Étienne Cartier lui-même : affichant un « air de dignité », prétentieux (« il vous regarde à peine ») et proche de « notre souveraine », le ministre mange et s’habille chez les commerçants anglais (« chez Fuch », « Russell »), il « se gourme » et s’enorgueillit de « ses parchemins », il s’enrichit et s’embourgeoise (« monsieur a pris du ventre »), il veut « adopter la Fédération » et défend les intérêts de « cet avide Grand-Tronc » (GT, 8, 22), exactement comme l’anglophile Cartier, qui recevra en 1868 le titre de « baronnet » et dont la carrière est gouvernée « par [un] ardent désir d’acquérir du prestige aux yeux de la société britannique[49] ». De l’autre, l’opposant apparaît, dans La Grand-Tronciade, comme un amalgame concentré des diverses positions libérales : il soutient la « Rep by Pop », le nationalisme (« Notre langue, nos lois ») et l’annexionnisme (« les nobles étoiles/Des glorieux yankees »), tout en dénonçant au passage le financement public du Grand Tronc, ce « diable dans nos bourses » (GT, 22). Cassegrain transpose cette polarisation politique dans l’espace du wagon, microcosme sommaire de l’espace social : alors que le ministre, en montant dans le train à Lévis, « va s’asseoir […] au fond du dit char », son « farouche adversaire » s’installe « à l’autre bout » (GT, 21). Cette division politique se répercute chez les avocats : deux sont « conservateurs », l’autre appartient au « parti rouge » (GT, 26). Et d’autres oppositions encore divisent la société du wagon. Le notaire « hait tout avocat du profond de son coeur » ; l’écolier poursuit une fille « de sa galanterie » et conteste l’autorité de sa mère, qui « croit l’enfant perdu/Lorsque d’en faire un prêtre, elle aurait bien voulu » (GT, 14, 59) ; quant à la « friponne », elle est convoitée par un « rustre » comme par les jeunes citadins, qui disputent au « villageois rustique » la possession de son « charmant bijou » (GT, 37).
Bref, la société représentée par Cassegrain est un ensemble d’oppositions structurantes : entre classe dominante (constituée d’individus) et classe dominée (une masse populaire), entre prédateurs (les « brigands en toge » [GT, 14], le « charlatan », etc.) et proies (le peuple maté, le Trésor public vidé par le Grand Tronc, « gouffre à l’argent » [GT, 22], voire la jeune fille poursuivie par les prétendants), entre conservateurs et libéraux, entre « homme du Pouvoir » et subalternes complaisants, entre ville et campagne, entre vocation cléricale et vocation mondaine, etc. Les classements qu’il propose et la configuration générale qui en résulte correspondent probablement aux représentations spontanées de l’espace social que se font, vers 1865, les écrivains et les journalistes, puisque ce sont eux qui font rire les contemporains : les « esquisses de moeurs » sont « jolies » ; « les croquis [sont] d’une ressemblance parfaite et d’un comique irrésistible », et l’on rit même sans connaître « d’avance » les individus que les amis d’Arthur Cassegrain « reconnaissent bien à première vue » ; même Le May doit admettre que « les personnages qu’il nous présente sont assez vraisemblables[50] ».
UN POÈTE DANS LA « GALERIE »
Mais comment le poète se situe-t-il lui-même dans sa propre galerie ? Comment pense-t-il sa position au sein de l’espace social ?
La représentation du théâtre social émane dans La Grand-Tronciade d’une perception située : le poète, assis « dans la première classe » (GT, 20), relève lui-même précisément de la classe dominante qu’il s’efforce de portraiturer. « Voilà, d’un seul coup-d’oeil, notre position,/Et maintenant, voilà le temps de l’action » (GT, 21), déclare-t-il : occupant une position déterminée dans l’espace ferroviaire et social qu’il observe, il ne peut voir et classer les autres positions qu’à partir du point de vue inscrit dans la sienne. Faut-il s’étonner, dès lors, que ses « chants » ne mettent en scène que les figures qui peuplent son univers immédiat, avec lesquelles il entre directement en interaction ? Seuls les passagers de cette première classe apparaissent comme des acteurs individualisés ; dans le « modeste char » de seconde classe, où le poète ne pénètre jamais, il ne perçoit qu’un tout informe.
Mais par sa position de retrait, celle du spectateur de théâtre, qui regarde une « action » (GT, 20) sans jamais y prendre part, le poète se distingue tout autant des autres êtres de la première classe. En adoptant la posture de l’observateur, voire de l’ethnographe qui dresse un portrait de la « galerie » sociale, le poète se positionne en quelque sorte à l’extérieur de celle-ci. Vers le milieu du xixe siècle, les chemins de fer, qui réunissent dans un même espace une foule hétéroclite, se présentent à certains comme l’annonce d’une égalisation sociale et d’une démocratisation nouvelle[51] ; c’est encore plus vrai du wagon américain, dont l’aire ouverte s’oppose au compartiment du train européen. En 1851, dans ses Lettres sur l’Amérique, Xavier Marmier, entre Albany et Montréal, s’élève avec humour contre « ce chemin de fer égalitaire » où les odeurs vulgaires de certains voyageurs (ce « parfum de république ») donnent envie de devenir « plus aristocrate que les aristocrates[52] ». Dans cet espace d’indistinction au moins relative, l’écrivain et journaliste peut faire de l’observation sociale et de l’écriture des pratiques de distinction : « chanter », rimer d’un « coup d’oeil » railleur le théâtre social du train, c’est marquer sa distinction en adoptant cette double distance que la culture littéraire et la parodie permettent de prendre vis-à-vis des choses prosaïques, en habitant de manière distinctive un lieu qui ramène au commun. Comme tout autre passager, Cassegrain prend le train ; mais contrairement à tout autre, il se regarde et les regarde le prendre. Bref, il habite le wagon de façon distanciée.
Le poète représenté dans La Grand-Tronciade est défini à la fois par son appartenance objective à la « première classe » (ce qui le porte à ne voir la seconde que comme une masse indistincte) et par la distanciation qui caractérise son rapport subjectif à cette appartenance de classe. Peut-on voir dans cette mise en scène humoristique l’expression des ambivalences qui marquent la condition sociale de l’écrivain au xixe siècle ? Que dit le texte de Cassegrain de la manière dont les jeunes poètes canadiens, vers 1865, peuvent concevoir leur inscription dans la société ?
Cette représentation traduit d’abord l’appartenance de Cassegrain aux classes dominantes. Issu d’une famille seigneuriale – les Casgrain – qui cultive la conscience de sa valeur et de son rang social[53], il arrive à la poésie en suivant une trajectoire représentative de la condition des écrivains canadiens-français du xixe siècle : dans un contexte où « l’écriture et l’enseignement secondaire de type classique sont indissociables », et où les gens de lettres se recrutent essentiellement au sein du bassin des jeunes hommes qui « cumulent les avantages de la famille et de l’enseignement[54] », l’auteur de La Grand-Tronciade complète son cours classique à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, étudie à l’Université Laval et accède au barreau tout en commettant quelques textes dans les journaux. Alors que se creuse, vers le milieu du siècle, l’écart entre cours commercial et cours classique, le second devenant l’apanage des fractions dominantes de la bourgeoisie[55], la réalisation des études classiques – que seule une minorité d’élèves entreprend d’achever[56] – est un signe de distinction et d’appartenance à l’élite sociale.
Comme tout poème héroï-comique, genre qui repose sur la maîtrise d’un code culturel et sur la connivence avec un public d’initiés capable d’en saisir les subtils détournements, La Grand-Tronciade démontre cette possession d’une culture classique et la distinction élitaire de l’« honnête homme[57] » qui, inculquée au collège, lui est intimement liée dans la société canadienne du xixe siècle. Le texte demeure attaché d’une certaine façon à l’univers de l’exercice scolaire, à une époque où l’on demande aux élèves des classes de rhétorique de se mettre dans la peau d’un grand personnage – Cassegrain se place dans celle de l’aède – pour écrire un discours mettant à profit les règles de l’éloquence[58]. Virgile, Cicéron, Homère, Tite-Live : les sources intertextuelles que détourne Cassegrain sont nombreuses et leur travestissement sollicite la « capacité du lecteur à dépasser le sens littéral[59] » pour communier avec l’auteur dans la reconnaissance de codes littéraires issus d’une culture (de classe) commune. Le poète intègre aussi cette culture classique au récit lui-même. Alors que le train passe devant son ancien collège, il devient nostalgique : « c’est là que je goûtai les plaisirs de l’esprit », le lieu qui « donna naissance » à « mon intelligence », celui où « j’appris la parole et [où] j’appris la pensée » (GT, 65).
En tant que performance, le poème héroï-comique manifeste textuellement l’appartenance de son auteur à la « première classe » de sa société. Et il le fait d’autant plus que, par la distance qu’il prend avec la culture légitime, qu’il détourne gentiment, le pastiche héroï-comique manifeste un degré plus élevé de maîtrise de cette culture, ou une maîtrise plus distinguée, que la simple reprise mécanique ou trop déférente. Pierre Bourdieu a décrit cette logique de la distinction par la négligence maîtrisée : en écrivant sa Grand-Tronciade, le poète, détenteur des titres scolaires qui l’autorisent à la « désinvolture » et « à toutes les formes de distance à soi-même », s’oppose au « prétendant » maladroit (qui « ignore le droit d’ignorer » la déférence) et trouve dans l’incorrection et dans le détachement parodique « une occasion de manifester la toute-puissance de [sa] disposition esthétique[60] ». Arthur Cassegrain ne peut se permettre ce « luxe » que parce qu’il a déjà un pied dans le monde de la culture légitime, qu’il salue d’ailleurs à bord du Grand Tronc en citant au passage Charles Guérin, l’auteur des Anciens Canadiens et (son cousin) l’abbé Casgrain (GT, 65, 63, 70). Auteur, en 1860, d’un poème historique sur la perte de la « France bénie[61] », qui évoque la nostalgie nationale de certains vers de Crémazie, Cassegrain signe aussi les comptes rendus du cours d’histoire donné par l’abbé Ferland à l’Université Laval, parus dans Le Courrier du Canada et dans le Journal de l’Instruction publique à partir de l’hiver 1859[62].
Cette appartenance première à la culture légitime est ce qui lui permet de la mettre à distance par le rire tout en raillant en même temps ce qui s’y oppose, c’est-à-dire la petite poésie ferroviaire et médiatique de son époque, parodiée avec la connivence de cette culture classique et de ses genres institués (en l’occurrence le poème héroï-comique). Il faut connaître les topoï du temps pour percevoir cette portée satirique, mais le lecteur de 1865 l’entend bien lorsque le poète, par exemple, renonce à offrir une description de la vapeur pour éviter de sombrer dans les lieux communs : « Vous pâlissez, lecteurs, d’ici je vous devine ;/D’une description vous flairez le danger./Cessez d’être inquiets ; comme vous j’abomine/La fureur de décrire et de tout imager. » (GT, 4) De même, l’introduction de son couple d’amoureux est présentée comme une concession légère à l’univers convenu du topos : « Convenez-en, lecteurs, je ne puis clore ici,/Ce chant où d’amoureux le couple manque ainsi. » (GT, 17) En chantant le chemin de fer et le Grand Tronc, en traitant de façon parodique un sujet que bien des rimeurs du temps magnifient dans la presse, Cassegrain se distingue précisément, pour reprendre les termes d’un autre poème héroï-comique paru en 1871, des « insipidissimes poêtereaux canadiens » comme « [Adolphe] Marsais[63] », auquel – on l’a vu – il semble d’ailleurs répondre. Cette divergence et les positionnements en jeu n’échappent pas aux contemporains. Quand on n’aime pas Cassegrain, qui « se donne pour grand poëte », c’est à Marsais qu’on le ramène : « Le style et le vers ont beaucoup d’analogie avec ceux de M. A. Marsais moins l’invention[64] », écrit-on dans Le Canadien en juillet 1866.
La Grand-Tronciade mobilise la culture classique, mais sur le mode parodique ; elle fait écho à l’univers des pratiques médiatiques, mais pour les railler ; le poète met en scène son appartenance à la première classe, un espace qu’il partage avec des avocats et des notaires, avec des « bourgeois » et des politiciens, mais pour se positionner à l’écart, en tant qu’observateur satirique. Dans cette triple mise à distance, qui proclame une appartenance foncièrement distanciée au champ des classes dominantes, ne voit-on pas s’exprimer un rapport à la vie littéraire et sociale qui se rattache à l’univers et au style de vie de la bohème, nés en France au milieu du xixe siècle ?
Vers 1860, Cassegrain évolue dans les réseaux de sociabilité littéraire et estudiantine de la ville de Québec, où la « gaieté [est] soutenue », lors de certaines « soirées d’universitaires » entre « bons gaillards », comme il le dit lui-même dans la presse en 1857, par des « rasades d’un vin généreux[65] ». Il côtoie Louis Fréchette et d’autres jeunes poètes : comme le rapporte en 1873 Louis-Michel Darveau, ils se réunissent alors sur la rue du Palais, « en plein quartier latin », dans « la mansarde de Fréchette », le « rendez-vous de ces gais lurons, de ces joyeux viveurs, de ces bruyants et spirituels tapageurs qui faisaient marcher de pair le plaisir, la poésie, la politique et l’étude de la loi[66] ». Fréchette a rappelé lui-même avec nostalgie, dans un poème d’exil, ces « beaux jours de jeunesse », ce « temps de bohême » où « nous avions pour nid la même mansarde » : c’est parmi « tous ces amis à la joue imberbe », ces « [m]inistres futurs et grands hommes en herbe » que « Cassegrain lisait sa Grand-Tronciade[67] ». En 1865, c’est Fréchette, alors rédacteur au Journal de Lévis, qui publie le texte. Et c’est encore son compagnon Fréchette, cet « auteur de “Mes Loisirs” » (GT, 49), que Cassegrain met en scène, avec lui, à bord du Grand Tronc : ce poète « exalté » y fait une tirade sur le chagrin d’amour et console l’amant désespéré de la friponne en l’invitant à noyer joyeusement sa peine dans l’alcool, au « dépot de L’Islet [qui] a du bon Maccallomme[68] » (GT, 48).
Un collectif informel, faiblement institutionnalisé, qui se met en scène dans sa « mansarde » où l’insouciance, la gaieté et la jeunesse, où les amitiés poétiques masculines, forgées dans l’assurance d’une vocation littéraire naissante et dans la complicité d’une indigence transitoire, forment un espace alcoolisé situé en marge du monde bourgeois : on reconnaît dans cette configuration les principaux éléments constitutifs de la bohème littéraire. « Chaque fois que les mêmes conditions ont été réunies (une métropole culturelle, une population d’artistes et d’écrivains trop large pour le marché local, condamnant la plupart à la pauvreté), une bohème et des discours sur la bohème ont surgi[69]. » Or, le Canada français de 1865 offre à la jeunesse littéraire des perspectives et des conditions qui, sans être celles de Paris, tendent à produire un style de vie et des revendications apparentés, dont Cassegrain et sa Grand-Tronciade sont l’une des figures. La balade en chemin de fer ne s’éloigne jamais de la satire sociale et de la prise de position esthétique. Engagé dans une lutte des classements, le poète se classe positivement en réagissant aux classements négatifs de ceux qu’il classe négativement. Dirigée contre « le profane vulgaire » pour qui « les poètes sont de pauvres sires », la préface de Cassegrain rétorque : « nous sommes à vrai dire les aristocrates de la pensée » (GT, iii. L’auteur souligne). L’épilogue revient à la charge, accusant une société qui ne sait guère « encourager la sainte poésie » : « [S]i tout jeune coeur qui sent le feu sacré/N’était d’un tel mépris souvent désespéré,/J’ose dire, qu’au lieu d’une Grand-Tronciade,/Nous aurions nous aussi peut-être une Illiade. » (GT, 96)
Le poème de Cassegrain s’achève ainsi dans l’amertume. Pour ce « jeune coeur » qui préférait laisser « dormir les dossiers sous son pupitre pour ne s’occuper que de littérature[70] », pour l’écrivain qui aspire à la carrière littéraire dans une société où le littéraire ne peut en être une, il ne reste, face au « mépris désespéré », qu’une appartenance malheureuse, railleuse et désabusée à l’espace social. Dans une société pour laquelle le prosaïsme du Grand Tronc est objet poétique, dans une société qui donne tout aux chemins de fer et qui ne donne rien aux lettres, cet être d’élite, l’« aristocrate de la pensée », doit inventer sa place dans une distance à l’égard de toutes les autres. C’est aussi, peut-être, la raison pour laquelle, en définitive, il ne « rit pas longtemps sans finir par pleurer ».
Appendices
Note biographique
Docteur en littérature de l’Université de Montréal, ALEX GAGNON a fait trois stages postdoctoraux à l’Université du Québec à Montréal, à l’Université McGill et à l’Université Laval (avec la prestigieuse bourse Banting). Publié en 2016 aux Presses de l’Université de Montréal, l’ouvrage qu’il a tiré de sa thèse (La communauté du dehors) a remporté de nombreux prix. Il a publié en 2017, chez Del Busso, un essai sur la société et la culture contemporaines (Nouvelles obscurités) et, en 2020 aux Presses de l’Université de Montréal, un nouvel ouvrage intitulé Les métamorphoses de la grandeur. Imaginaire social et célébrité au Québec, de Louis Cyr à Dédé Fortin. En septembre 2021, il a entrepris un deuxième doctorat en histoire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, où il rédige présentement une histoire sociale et culturelle du chemin de fer et des rapports à l’espace et au temps au Québec, entre 1832 et 1886. Il a publié plusieurs articles dans des collectifs et dans la Revue d’histoire de l’Amérique française, Déviance et société, Études françaises, Voix et images et Sociologie et sociétés.
Notes
-
[1]
Le projet de recherche dont cet article est issu a reçu l’appui d’une bourse postdoctorale Banting (2019-2021).
-
[2]
« Nécrologie », Le Courrier du Canada, 10 février 1868, p. 2. Je maintiens l’orthographe d’époque.
-
[3]
« Encore un poème », Le Journal de Québec, 5 juillet 1865, p. 2.
-
[4]
Arthur Cassegrain, La Grand-Tronciade ou itinéraire de Québec à la Rivière-du-Loup, Ottawa, Desbarats, 1866, 96 p. Cette édition est la seule existante. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle GT, suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte. Dans les citations, je maintiens l’orthographe d’époque et les fautes, le cas échéant.
-
[5]
« Bibliographie », Le Courrier du Canada, 20 juillet 1866, p. 2 ; « Publication », L’Ordre, 6 juillet 1866, p. 2.
-
[6]
Voir Maurice Lemire, « Les revues littéraires au Québec comme réseaux d’écrivains et instance de consécration littéraire (1840-1870) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. XLVII, no 4, printemps 1994, p. 548-549.
-
[7]
Léon-Pamphile Le May, « Notice bibliographique », Revue canadienne, vol. III, no 7, juillet 1866, p. 441-442. Le poème présente cependant quelques qualités aux yeux de Le May ; on y reviendra.
-
[8]
Aeneas McDonell Dawson, « Les poètes canadiens-français », Journal de l’Instruction publique, vol. VIII, nos 2-3, février et mars 1869, p. 20.
-
[9]
Edmond Lareau, Histoire de la littérature canadienne, Montréal, John Lovell, 1874, p. 110.
-
[10]
James MacPherson Le Moine, « Itinéraire d’un voyage de Québec au pays de la Gaspésie », L’album du touriste. Archéologie, histoire, littérature, sport, Québec, Augustin Côté et Cie, 1872, 385 p. Ce texte était paru sous un autre titre en 1870 dans Le Courrier du Canada.
-
[11]
Pierre Rajotte, avec la collaboration d’Anne-Marie Carle et François Couture, Le récit de voyage au xixe siècle. Aux frontières du littéraire, Montréal, Triptyque, 1997, p. 30 et p. 46.
-
[12]
Claude La Charité, « La Grand-Tronciade (1866) d’Arthur Cassegrain ou l’épopée burlesque du chemin de fer », Le Mouton Noir, vol. XIII, no 4, janvier-février 2008, p. 7 ; en ligne : https://www.moutonnoir.com/2008/01/la-grand-tronciade-1866-darthur-cassegrain-ou-lepopee-burlesque-du-chemin-de-fer1 (page consultée le 1er février 2022).
-
[13]
Iréna Trujic, « Les poèmes héroï-comiques », L’intertextualité classique dans la production littéraire du Québec des années 1850-1870, thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 2011, f. 204-243.
-
[14]
Maurice Lemire et Denis Saint-Jacques, cités dans ibid., f. 207.
-
[15]
Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Points, coll. « Points Essais », 1992 [Seuil, coll. « Poétique », 1982], p. 193.
-
[16]
Nicolas Boileau-Despréaux, « Le Lutrin », Oeuvres complètes, introduction d’Antoine Adam, textes établis et annotés par Françoise Escal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1979 [1966], p. 190-191. Boileau est l’un des inventeurs de la notion de « poème héroï-comique », qu’il applique à son texte en 1701.
-
[17]
« Nécrologie », Le Courrier du Canada, 10 février 1868, p. 2. La prétention du journal est cependant plausible : en effet, le poème met en scène Louis Fréchette, que Cassegrain fréquente à Québec dans les années 1860. J’y reviendrai.
-
[18]
C’est ce qu’indiquent les documents de la compagnie (Rapport du Comité spécial nommé pour s’enquérir et faire rapport sur l’état […] du chemin de fer Grand Tronc, Toronto, John Lovell, 1857, p. 80).
-
[19]
Voir « Chemin de fer du Grand Tronc », Gazette des campagnes [Sainte-Anne-de-la-Pocatière], 15 novembre 1865, p. 12.
-
[20]
Voir, sur tous ces aspects, Alex Gagnon, « L’expérience primitive du voyage ferroviaire au Québec. Univers social et sensoriel des “chars” (1836-1867) », Revue d’histoire de l’Amérique française, à paraître en 2022.
-
[21]
Wolfgang Schivelbusch, Histoire des voyages en train, traduit de l’allemand par Jean-François Boutout, Paris, Le Promeneur, 1990 [1977], p. 40.
-
[22]
Voir à ce sujet ibid., p. 59.
-
[23]
L’expression « siècle de fer » est elle-même un topos. Elle apparaît, par exemple, dans un poème d’Auguste Barthélemy sur « La vapeur », diffusé au Canada en 1845 (« La vapeur », Le Journal de Québec, 11 novembre 1845, p. 1).
-
[24]
Knickerbocker, « Napping in the Cars », The Quebec Mercury, 20 septembre 1853, p. 1.
-
[25]
Stéphanie Sauget, À la recherche des pas perdus. Une histoire des gares parisiennes au xixe siècle, Paris, Tallandier, 2009, p. 172.
-
[26]
C., « Excursions canadiennes », Le Journal de Québec, 19 juillet 1851, p. 2 ; Anonyme, « Notes à la vapeur », Le Journal de Québec, 23 juin 1857, p. 2.
-
[27]
« Nouvelles et Faits divers », L’Ordre, 17 février 1860, p. 2.
-
[28]
Adolphe Marsais, « Visite par chemin de fer à St. Thomas », Le Canadien, 4 octobre 1858, p. 1.
-
[29]
Gérard Genette, Palimpsestes, p. 35.
-
[30]
Claude La Charité, « La Grand-Tronciade (1866) d’Arthur Cassegrain […] », p. 7.
-
[31]
Léon-Pamphile Le May, « Notice bibliographique », p. 441.
-
[32]
Adolphe Marsais, « La colère du Grand-Tronc », Le Pays, 4 octobre 1862, p. 1.
-
[33]
Voir à ce sujet George Roy Stevens, Canadian National Railways, t. I : Sixty Years of Trial and Error (1836-1896), Toronto/Vancouver, Clarke, Irwin & Company Limited, 1960, p. 44-89 et p. 241-295.
-
[34]
Voir à ce sujet Archibald William Currie, The Grand Trunk Railway of Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1957, p. 40-91.
-
[35]
Voir Brian Young, George-Étienne Cartier, bourgeois montréalais, traduit de l’anglais (Canada) par André D’Allemagne, préface d’André Champagne, Montréal, Boréal, 2004 [1982], p. 92 et p. 159-172.
-
[36]
« Le Grand-Tronc vs le bien public et la Justice », L’Ordre, 20 juillet 1864, p. 2.
-
[37]
Voir Margaret Heap, « La grève des charretiers à Montréal (1864) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. XXXI, no 3, décembre 1977, p. 371-395.
-
[38]
C’est-à-dire pour ceux qui savent crier et quémander plus fort que tous les autres.
-
[39]
« The Grand Trunk Railway – Special Trains and the Mail Service », The Montreal Witness, 5 mars 1862, p. 1.
-
[40]
Au premier chant de l’Iliade, Zeus fait trembler l’Olympe « en abaissant ses sombres sourcils » (Homère, Iliade, traduit du grec par Mario Meunier, Paris, Librairie générale française, coll. « Le livre de poche », 2020 [1972], p. 68).
-
[41]
« Le Grand Tronc », Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 9 août 1861, p. 2.
-
[42]
Roger Chartier, « George Dandin, ou le social en représentation », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. XLIX, no 2, 1994, p. 281 et p. 298.
-
[43]
Cette figure renvoie à un stéréotype de l’époque. En 1865, dans les « Croquis de voyageurs » du journal humoristique montréalais Le Perroquet, où sont rassemblés « quelques profils » ferroviaires, on raille le type du « voyageur bavard » : « il parle, il parle sans relâche et cela lui suffit » (« Croquis de voyageurs », Le Perroquet, 5 août 1865, p. 115-116).
-
[44]
Dans « ce docteur enragé renommé sur la côte » (GT, 15), le public de 1865 reconnaît peut-être un avatar du légendaire « docteur l’Indienne », qui fait les manchettes à l’été 1865 (voir Alex Gagnon, La communauté du dehors. Imaginaire social et crimes célèbres au Québec (xixe-xxe siècles), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2016, p. 281-288).
-
[45]
Voir « Souvenir de la fête du 17 juin », Le Courrier du Canada, 28 juin 1869, p. 1. Après une fête au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en juin 1869, les anciens élèves repartant vers Québec en train crient à la gare des « hourrahs […] en remerciements à M. Paulet, conducteur des chars ».
-
[46]
Voir par exemple Le Fantasque, 6 juillet 1840, p. 227-228.
-
[47]
Iréna Trujic avait aussi suggéré cette lecture. Voir L’intertextualité classique dans la production littéraire du Québec…, f. 230.
-
[48]
Voir à ce sujet Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec, t. I : 1760-1896, Montréal, Fides, 2000, p. 283-358.
-
[49]
Brian Young, George-Étienne Cartier, bourgeois montréalais, p. 76.
-
[50]
Voir « Publications », Le Courrier du Canada, 2 juillet 1866, p. 2 ; « Bibliographie », Le Canadien, 9 juillet 1866, p. 2 ; Léon-Pamphile Le May, « Notice bibliographique », p. 442.
-
[51]
Voir Wolfgang Schivelbusch, Histoire des voyages en train, p. 75-77.
-
[52]
Xavier Marmier, Lettres sur l’Amérique. Canada, États-Unis, Havane, Rio de la Plata, t. I, Paris, Arthus Bertrand, 1851, p. 69-70.
-
[53]
En 1869, l’épouse de Charles-Eusèbe Casgrain (père d’Henri-Raymond et oncle d’Arthur) publie pour ses enfants des Mémoires de famille. Elle y fait l’apologie de son mari en mettant « sous [leurs] yeux les vertus et les exemples que [leur] père a laissés après lui » (Éliza-Anne Baby, Mémoires de famille. C. E. Casgrain, Rivière-Ouelle, Manoir d’Airvault, 1869, p. 13).
-
[54]
Lucie Robert, « Les écrivains et leurs études. Comment on fabrique les génies », Études littéraires, vol. XIV, no 3, décembre 1981, p. 532-533.
-
[55]
Ollivier Hubert, « Collèges classiques et bourgeoisies franco-catholiques (xviie-xxe siècles) », Louise Bienvenue, Ollivier Hubert et Christine Hudon, Le collège classique pour garçons. Études historiques sur une institution québécoise disparue, Montréal, Fides, 2014, p. 113-136.
-
[56]
Voir Ulric Lévesque, « Les élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1829-1842) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. XXI, no 4, mars 1968, p. 783.
-
[57]
Voir Claude Galarneau, Les collèges classiques au Canada français (1620-1970), Montréal, Fides, 1978, p. 201-217.
-
[58]
Max Roy, « Les pratiques littéraires des étudiants au cours classique », Études littéraires, vol. XIV, no 3, décembre 1981, p. 443.
-
[59]
Iréna Trujic, L’intertextualité classique dans la production littéraire du Québec…, f. 212.
-
[60]
Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions du Minuit/Maison des sciences de l’homme, coll. « Le sens commun », 2012 [1979], p. 286 et p. 379.
-
[61]
Arthur Cassegrain, « Le héros de Ste. Foye », L’Ordre, 4 mai 1860, p. 1.
-
[62]
Cette séparation entre le jeu héroï-comique et la culture sérieuse, que l’auteur maîtrise simultanément, s’exprime jusque dans sa signature : ses textes du Journal de l’Instruction publique sont signés « Arthur Casgrain », et non « Cassegrain ».
-
[63]
Un Chérubin [Ernest Tremblay], La Carabinade, ou combat entre les Carabins et les Chérubins (Premier chant), Montréal, Les Chérubins, 1871, p. 3.
-
[64]
N. L., « Chronique québecquoise », Le Canadien, 20 juillet 1866, p. 2.
-
[65]
Arthur Casgrain, « Soirée d’universitaires », Le Courrier du Canada, 28 décembre 1857, p. 1-2.
-
[66]
Louis-Michel Darveau, Nos hommes de lettres, Montréal, A. A. Stevenson, 1873, p. 187.
-
[67]
Louis Fréchette, « Reminiscor », Pêle-mêle. Fantaisies et souvenirs poétiques, Montréal, Lovell, 1877, p. 77-87.
-
[68]
Ce calque phonétique renvoie à McCallum, un brasseur de Québec, comme le dit Cassegrain dans « La Tauride », court poème héroï-comique (Arthur Cassegrain et Pascal-Amable Dionne, « La Tauride », Revue canadienne, vol. I, no 5, mai 1864, p. 302).
-
[69]
Anthony Glinoer, La bohème. Une figure de l’imaginaire social, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2018, p. 13.
-
[70]
« Nécrologie », Le Courrier du Canada, 10 février 1868, p. 2.