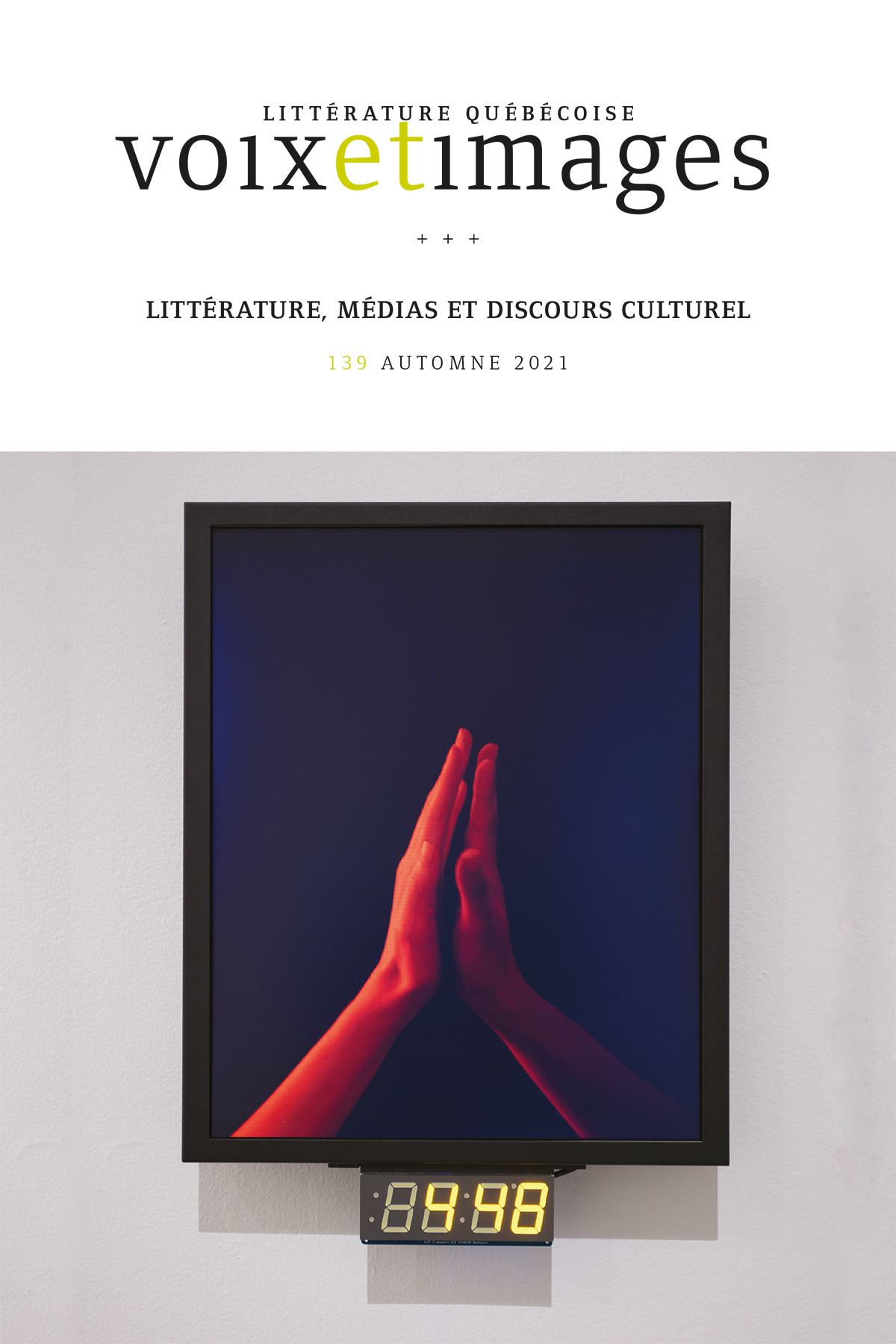Article body
Les romans de Maryse Andraos[1] et de Jean-Philippe Martel[2] ont valeur actuelle et contemporaine pour des raisons que la critique, les ayant tous deux bien accueillis, a énumérées ailleurs. Sans refuge est composé de fragments narratifs à plusieurs voix dont l’enchaînement dessine une suite de saisons dans la vie d’une jeune femme luttant avec l’incertitude professionnelle, la vocation artistique, et l’angoisse. Chez les sublimés est peuplé de personnages parvenus à divers stades du désenchantement de l’âge adulte, en plus de reposer sur un système temporel ambitieux où les époques et les signifiants culturels passés se voient non seulement juxtaposés mais, dirait-on aussi, remixés. Pour faire vite, on peut dire que ce sont là deux livres représentatifs des années suivant le Printemps Érable. Ils ont la sensibilité de qui a connu un épisode de solidarité historique en opposition franche au néolibéralisme, mais aussi de qui, presque aussitôt après, a dû passer à la suite, c’est-à-dire à l’emploi, au salariat, au logement, à l’économie familiale, au vieillissement, au système de santé, à l’ennui quotidien, tout cela à travers la précarisation croissante du monde et des choses qui caractérise, précisément, la logique du néolibéralisme. Une semblable lecture générationnelle expose l’épiderme sociologique des deux romans, et on ne ferait pas honneur à la littérature en la considérant à travers cette lorgnette exclusive. Cependant l’idée que des livres puissent représenter une communauté d’expériences liée à l’âge des protagonistes ou de leur lectorat est un point de départ fructueux pour creuser plus avant dans ceux d’Andraos et de Martel. Il est vrai que leur structure, leur ton, leur trame narrative, leur rapport même à l’idée de « drame » sont on ne peut plus différents. Cela dit, il m’apparaît que leurs auteur·es parlent mieux que quiconque ces derniers temps en littérature de l’épreuve considérable qui consiste à appartenir à un groupe.
Je ne parle pas d’une grande solidarité populaire, mais seulement du besoin à la fois banal et crucial de faire correspondre une part de son ego à une appartenance commune. Quelque chose en mesure de noyer nos petits écarts et idiosyncrasies personnels, voire nos fautes, dans un corps social. Pendant longtemps l’idée de génération a tenu ce rôle. Mais aujourd’hui, il suffit de se détourner ne serait-ce qu’un instant des clameurs publicitaires sur les milléniaux, ou les Y, ou les X, ou les boomers, pour prendre conscience de l’invisibilité quasi absolue dans laquelle sont confinées les personnes des troisième et quatrième âges. De génération on ne clame le plus souvent que le nom. Cela est d’autant plus vrai que, depuis peu, le terme communauté paraît avoir pris les devants dans l’adhésion publique. Malheur à qui n’est pas désormais en mesure de signaler son appartenance à « sa communauté », en particulier dans les échanges en ligne et sur les réseaux sociaux. Ne pas avoir de communauté est devenu un faux pas civique aussi périlleux que de ne pas avoir de médecin de famille. Or ce mot de communauté, on l’entend la plupart du temps lorsqu’il est question de la grande Histoire, et non guère de la petite, de la toujours multiple, de l’histoire intime à partir de laquelle existe la littérature. Si je dis tout cela, c’est encore parce que les livres d’Andraos et de Martel me l’ont mis en tête. C’est le difficile travail d’être ensemble et le tout aussi difficile travail d’être soi-même, aujourd’hui peut-être plus qu’auparavant, qui s’expriment et s’exposent dans Sans refuge et Chez les sublimés.
Sans refuge est le premier roman de Maryse Andraos, qui avait fait son entrée sur la scène littéraire en 2018 avec l’obtention du Prix de la nouvelle Radio-Canada. C’est un livre pétri d’anxiété. Je vous entends dire : mais qui voudrait lire cela ? Dans le cas du livre d’Andraos, ce devrait être le plus de monde possible. Car je n’ai pas dit que c’est un livre anxieux. C’est plutôt un livre très fort – dans tous les sens, parfois même violent – sur la texture que prend une voix, en plus des mots qu’elle fait siens, quand elle affronte l’anxiété sans détour, et qu’elle s’efforce de lui assigner une place dans quelque chose de plus grand. Mais de quelle anxiété, de quelle angoisse s’agit-il donc ? De celle que la plupart d’entre nous n’avouent pas vivre au quotidien, au risque, justement, du discrédit communautaire ; la crispation à la fois physique et existentielle qui prend au ventre et noircit le cerveau dans ces moments où, indépendamment des acquis et des privilèges, on prend conscience qu’on ne sait pas du tout où va notre vie. L’action est centrée sur Naïma, personnage de toute évidence le plus proche de l’auteure dans ce roman qualifié de choral en quatrième de couverture. Naïma a grandi en banlieue, puis elle a étudié et a rejoint la vie active dans la métropole. C’est le traditionnel parcours du combattant de la jeunesse des classes moyennes. À ceci près que, au stade supposé normal où le consensus social nous dit que les incertitudes devraient s’apaiser et les responsabilités reprendre leur droit, tout part plus ou moins en vrille chez Andraos.
Naïma se voit comme une « adulte terrifiée, dont l’existence se résume à des stratagèmes pour éviter de souffrir » (33). Elle n’est pas pour autant marginale et délaissée. Elle a des ami·es et des partenaires de vie comme vous et moi : Nathan, Delphine, Simon, Ariane. C’est le début de la trentaine. Les couples se calcifient dans un nouveau rôle. Il ne s’agit plus de célébrer et de consommer le désir, mais plutôt de concevoir et de développer des « projets de vie commune ». Les grands soirs du militantisme étudiant sont déjà loin derrière. Idem des fugues et des bacchanales adolescentes. Naïma observe son entourage à la dérobée et ne laisse ni la respectabilité des statuts nouvellement acquis ni les démonstrations de bonheur lui dissimuler le fait que la cohésion de la vie des autres ne tient, comme la sienne, qu’à un fil. Sans refuge n’est donc pas le roman d’une jeunesse « qui se cherche » (un cliché s’il en est), mais au contraire celui d’une adulte qui avoue ne pas parvenir à se trouver. C’est infiniment plus pertinent. Durant les 159 pages du livre, on voit Naïma quitter son travail alimentaire puis traverser deux unions amoureuses, un groupe de punks anarchistes à Montréal, le Printemps Érable, une auberge espagnole résolument inclusive aux Îles-de-la-Madeleine, une commune quant à elle résolument féminine, et une résidence d’artiste en Islande. La force de Sans refuge consiste en un mélange radical d’honnêteté et de lucidité. Naïma franchit les divers cercles de la vie commune et du partage comme un pèlerin quelque peu détaché, le regard rivé sur un absolu toujours plus loin, et qu’elle ne saurait ni définir ni décrire. Elle note ses résolutions : « Je ne dirai que l’essentiel. Je verrai tout sans être vue. » (85) Elle voit ses amies s’engluer « dans la mélasse familiale » (142), ces amies à qui le roman prête la voix en indirect libre et qui, de leur côté, perçoivent en Naïma une espèce d’énigme inconstante, « toujours aussi flottante, à moitié engagée dans l’instant ; charmante, irritante. […] Égoïste dans sa joie comme dans sa souffrance » (134). Naïma jette partout alentour une lumière incisive : « À la cafétéria, Kristelle se vante de sa routine d’entraînement et de son plan d’alimentation sans glucides. […] Mais toi tu sais, tu l’as surprise en larmes ce matin dans les toilettes… » (14) Vaciller dans sa propre existence, se découvrir de loin en loin nu·e et sans protection, sans giron véritable, élémentaire et seul·e, voilà qui constitue sans doute l’expérience la plus démocratiquement partagée au monde. Il y en a pourtant si peu en littérature qui choisissent d’en parler de front. Au regard d’un quotidien où les espaces de travail comme les lieux intimes ne conviennent plus pour vivre en respirant réellement, Andraos pondère la nature fictionnelle de choses que nous tenons pour acquises. Ainsi du couple, de la famille qui s’ensuit et du besoin étrangement compétitif, grégaire, d’en faire des réussites :
Delphine réprime un bâillement en pinçant les lèvres, attentive aux tétées de Ludovic dont la bouche inconstante engloutit et régurgite le lait maternel. L’enfant redéfinit la magnitude de l’amour […]. On ne revient pas d’une telle expérience dit-elle en riant à ses amis, comme si elle n’avait pas passé des nuits à pleurer avec son fils dans les bras, impuissante à soulager le besoin derrière ce cri.
26
De là à dire que l’enfer c’est les autres chez Maryse Andraos, il y a tout de même une marge. Sans refuge possède une charge émotionnelle bien trop grande pour cela. Les autres n’y ont rien de conceptuel, ce sont des voix et des corps toujours aimés ou repoussés, désirés ou déchirants, et la voix de Naïma, intériorisée au « tu », présente elle-même un alliage de vulnérabilité et de détermination émotionnelles sans équivalent. De fait, quand des vies autres sont représentées chez Andraos, parmi l’entourage fluctuant de sa protagoniste centrale, c’est afin de comprendre, au juste, comment ces vies arrivent à entretenir l’artifice de leur harmonie. En deçà de l’accumulation communautaire du roman (couple, polyamour, amitiés, études, travail, commune pastorale, résidence artistique) se trouve de la sorte un beau secret structurel et thématique. Les différentes mises en scène de l’entité « groupe » sont une façon pour Andraos, dans son art romanesque, de mettre d’abord en évidence l’instabilité foncière de l’individu. Je parle de ce soi-même qui ne nous laisse aucun répit dans nos heures de veille et dont la maîtrise, la stabilité, et encore une fois la réussite exemplaire passent pour les prérequis indépassables de notre temps.
Dans quel giron faut-il nous efforcer de maintenir ce que nous sommes ? On parle toujours de joindre une communauté, d’appartenir à une communauté, mais beaucoup moins de laisser entrer une communauté en soi. À bien y penser, il ne signifie pas grand-chose de dire que le roman d’Andraos est un roman choral ; encore faut-il voir comment les voix y cohabitent. Dans Sans refuge, il est pénible de laisser entrer les autres en soi. Le maintien de soi-même est tout autant une aventure qu’un travail. Les autres y contribuent de façon vitale. Mais qui a décrété que tout cela devrait être facile ? Pourquoi le prétendons-nous ? « Vue d’en haut, tu n’es qu’une conscience prisonnière de ses soucis, négociant sa rencontre avec d’autres individus. » (80) La plupart des fictions qui font la texture de notre quotidien nous enseignent que le maintien de soi serait la chose la plus naturelle du monde. Il n’y a rien de plus faux. Qui serez-vous dans dix ans ? À quelle tribu appartiendrez-vous en vieillissant ? Mieux encore : quel sera alors votre désir de tribu ? À quel groupe – ou fantasme de groupe – s’identifiera votre effort de cohésion personnelle ? Le passé, évidemment, regorge de groupes ; à qui sait bien regarder, il serait même composé d’une infinité de solidarités non dénouées, encore embryonnaires, promises à mieux : « Voilà où on en est, à concentrer dans les petits gestes une lutte qui nous a foudroyés par son ampleur. » (31) Par contre l’avenir, au même titre, ne promet rien. L’avenir est le domaine des rêves, mais il est aussi bien celui de l’anxiété. Or l’anxiété n’a pas vraiment de statut pathologique en littérature, en dépit des ravages qu’elle occasionne dans le réel. L’anxiété défait les hiérarchies et les tropes qui voudraient préorganiser les choses vues. L’anxiété est antisociale au sens où elle rompt le sens même du groupe. Elle est, à sa manière, un rythme de la pensée. On demandera alors si ce rythme est en phase avec le monde, s’il peut se faire authentiquement littéraire. Mais que signifie au juste être en phase avec le monde ? Question immense et qui palpite sans discontinuer au coeur de l’univers de Maryse Andraos.
+
Chez les sublimés est le second roman de Jean-Philippe Martel. Il est paru presque une décennie après le remarqué Comme des sentinelles en 2012. On me dirait que Martel a consacré tout ce temps à la préparation du présent livre que je m’empresserais de le croire. Chez les sublimés est massif, foisonnant, complexe. En ce sens, il s’agit d’un roman au sens ancien du terme, c’est-à-dire dix-neuviémiste, ce type de roman documenté et réaliste à propos duquel on a coutume de dire qu’il présente des « destins entrecroisés », mais dont on ressent que la texture véritable est celle du temps historique lui-même avec ce qu’il charrie d’événements marquants et d’illusions anéanties. Cependant Martel est un bûcheur de structure autant qu’un écrivain réaliste de très grand talent. Chez les sublimés impressionne au premier coup d’oeil par sa forme globale. Il s’agit de mesurer l’Histoire récente à partir du point de vue contemporain (2013, précisément) de trois personnages masculins liés par le sang ou l’amitié ancienne. Mais par Histoire ici, il faut entendre « faillite ». Et par personnage aussi d’ailleurs. Vincent, Thomas et Emmanuel sont des êtres rompus. Le roman s’ouvre sur leurs retrouvailles forcées, après un revers vécu par Emmanuel, le plus fragile de la bande. La suite nous fera comprendre que ces trois personnages incarnent trois façons d’être devant la déshérence des promesses collectives et des solidarités d’antan. Pour eux, parvenus à l’adolescence dans les années 1990, la faillite de l’Histoire consiste en la disparition d’un fond qui sous-tendait les choses et les liens sociaux. On voit alors l’ossature du monde. C’est une lucidité, mais une lucidité sans grâce ni délivrance. Les chapitres du roman alternent entre Montréal, ses environs immédiats, et Sherbrooke. De même, ils alternent les époques à partir de la position de réminiscence des trois protagonistes.
Emmanuel est le maillon passionnel et donc mélancolique du trio. Lui dont la soif d’absolu et les penchants artistiques ne se sont pas tout à fait dissipés avec les heurts du temps entretient une proximité inquiétante avec des figures tutélaires de jadis disparues tragiquement de leurs propres mains, l’oncle Michel d’abord, grand parleur et grand faiseur dans les extrêmes (« une sorte de violence courait sous sa peau » [21]), ou carrément Kurt Cobain, considéré dans ces pages comme la figure populaire la plus représentative des émois de jeunesse des trois hommes et qui symbolise une sorte d’authenticité sacrifiée. Vincent et Thomas, quant à eux, sont respectivement désillusionné et cynique. Lorsque Emmanuel dit : « On est devenu les adultes qu’on devait devenir. […] Il nous reste peut-être du temps à vivre […] mais on fera pas grand-chose d’autre que d’ajouter des couches à un dessin fini » (113), Thomas soupire et baisse les bras aussitôt : « Je n’ai rien ajouté, c’était inutile. » Tout se passe comme si la faillite de l’Histoire commençait par celle des terrains d’entente se diluant dans le caramel sursaturé et angoissant de l’âge adulte, qui n’est autre que le degré auquel on calibre ses désirs et qui repose donc sur sa capacité à négocier l’anxiété. Il n’est pas facile de rendre tout le sel de l’affaire tant Martel brille par son talent à glisser de la généralisation sociologique à la minutie dans l’ordinaire, mais c’est précisément en vertu d’une telle virtuosité dans la juxtaposition des multiples plans et formes de restitution du monde vu, vécu et remémoré que Chez les sublimés se distingue au premier chef.
Considérons la manière dont commence le récit, lequel s’ouvre sur un déplacement automobile dans un espace urbain sans nom ni caractère. La narration est celle d’un mouvement hâtif en voiture, mais le moment en est un de rêverie. On y assiste à un télescopage des temporalités à travers l’espace de la couronne est de Montréal. Puis survient la scène d’un dialogue court et saccadé. Trois hommes se retrouvent, deux se connaissent et le troisième est à la rue après l’incendie de son appartement. Le rythme d’ensemble évoque un drame télévisuel. Mais la vision qui le commande s’étend loin hors de ce cadre, quand s’agglutinent dès les premiers paragraphes les images d’une description impressionniste des strates humaines de l’île de Montréal. Bientôt, nous sommes devant une scène de baignade familiale dans les Cantons-de-l’Est en 1986. Tout est d’une grande acuité. C’est un souvenir d’enfance d’Emmanuel, personnage comme je l’ai dit le plus souffrant du lot, mais aussi le plus familial, le plus attentif, le plus voué à l’exercice de la mémoire. Puis on remonte aux années 1950, y retracer la jeunesse de l’oncle suicidé devenu légendaire dans le folklore familial. On passe ensuite à Seattle en 1994. Quelques chapitres plus loin, on se retrouvera en Nouvelle-France, en 1619. La forme de l’aventure est donnée : ce roman fonctionnera à l’ellipse. Ce sera aussi le roman d’un observateur-orchestrateur, un souverain penché sur un monde foisonnant auquel il a donné jour sans savoir où il s’arrêtera, et au charme duquel il ne peut lui-même s’arracher.
L’acuité du regard réaliste et l’ellipse, petite ou grande, sont ce qui permet l’oscillation entre les regards sociologique et prosaïque dont j’ai parlé plus haut. Martel veut peindre une génération : la sienne (dont il se trouve que c’est la mienne aussi). On dirait toutefois qu’il a renoncé depuis longtemps à donner un sens à l’idée générationnelle. Ses personnages croient plutôt à la prédétermination, ce qui n’est pas la même chose. Ils s’interrogent sur la généalogie et la génétique. La question de l’atavisme de la dépression et du geste suicidaire plane en marge de leurs conversations. « Depuis des années, raconte Emmanuel, je ramassais des objets qui me rappelaient mon enfance, là d’où on vient, Vincent et moi, mais aussi nos parents, et leurs parents à eux. » (85) Une génération, si on peut encore parler ainsi, ne serait finalement qu’un ensemble de sédiments désordonnés. D’où l’apport de l’écriture réaliste ; c’est elle qui, en plus des individus, des ancêtres et de leurs discours, sait porter attention aux objets inanimés, aux écosystèmes en lambeaux dont sont faites les mémoires, et qui travaille par là à leur conférer de la valeur. La prédétermination serait alors comme une manière de tracer des lignes de sens réellement fiables à travers les couches sédimentaires d’une génération en pagaille. Ellipse et acuité, sédimentation et prédétermination : ce sont les outils fonciers de Jean-Philippe Martel. Quant à son horizon d’écrivain, il est totalisant et splendidement décomplexé :
La carte qui fait véritablement rêver, c’est ce dessin où seraient enchâssé[e]s toutes les représentations de tous les lieux et de tous les temps […], la carte non pas des savoirs sur le monde, mais des liens que les humains ont tissés entre eux, dématérialisés puis réinvestis ailleurs fonctionnant comme une flèche dans l’Histoire, l’ensemble de leurs espoirs et paroles, les grands boulevards de leurs certitudes, et les fausses routes, détours et culs-de-sac, tous les cours d’eau remontés depuis le Grand Océan jusqu’aux dernières petites cases habitables, un chemin formidable, ce n’était que ça. Vous êtes ici.
73
S’il fallait à tout prix identifier un thème central, je dirais que Chez les sublimés traite de la phase terminale à laquelle la culture serait parvenue aujourd’hui au Québec et ailleurs en Occident. Le personnage de Thomas donne tout son sens à l’expression « cordonnier mal chaussé » : lui qui ne croit plus en l’avenir continue néanmoins de pratiquer le métier de conseiller pédagogique. Vincent, pour sa part, a conservé une fibre politique, notamment face à la controverse de la charte des valeurs québécoises, mais celle-ci tourne à vide, et s’abîme vite dans une impudence révélatrice : « Lâche donc ça, tes affaires d’ancêtres […]. T’essayes de faire tenir ensemble des affaires qui ont jamais été liées. » (197) Il y a moins une crise des valeurs qu’une crise du temps dans le monde que dépeint Martel : y a disparu la durée qui, auparavant, transformait les divertissements en rituels, rituels qui se muaient ensuite en amitiés, amitiés qui auraient pu, qui auraient dû, devenir projets solidaires et luttes communes. Mais non : « personne ne [mène] plus de lutte suivie » (64). Martel constate cette disparition et fait exister ses personnages en son centre. La technologie a supprimé l’avenir en compartimentant le présent à l’infini. Tous y jouent un rôle de plus en plus étroit et de plus en plus désespérant. La faillite du langage et surtout celle de l’éducation traversent le roman comme les veines bleuies et gonflées d’un membre en décomposition.
Tous les modèles de développement dans la durée ont échoué dans le monde de Martel : éducation, nostalgie saine chez l’adulte, progrès économique à l’échelle d’une vie, famille nucléaire, communautés de classes, et, plus que tout autre, concept de nation. S’il est vrai que ceux nés avec le millénaire auront connu la précarité d’emploi comme l’air qu’on respire, dans le roman de Martel court l’idée que la génération précédente, la « X », est la véritable génération du grand basculement néolibéral ayant engendré la destruction du temps quotidien avec ses promesses de paix et d’épanouissement à petite et à moyenne échelle. La génération X a inventé la nostalgie mercantile, à savoir le jalonnement des âges de la vie avec des commodités liées au besoin du jeu et du divertissement. Le monde dans lequel cette génération se retrouve pleinement adulte est invivable : « Nos anciennes amitiés nous semblaient de plus en plus accidentelles, basées sur des champs d’intérêt temporaires, parfois même des malentendus. » (47) C’est banal de le dire : les idéaux des gens de l’âge de Martel n’ont pas pris corps. Mais qu’on y pense un instant, et le contraire aurait été stupéfiant. Imagine-t-on l’historien·ne ou sociologue qui nous annoncerait que les idéaux d’une génération donnée se sont, en fin de compte, bel et bien réalisés ? La levée de boucliers serait inévitable. On contesterait aussitôt l’exclusivité octroyée à ceux-là plutôt qu’à d’autres. En définitive, le concept de génération semble avoir pour fonction cardinale d’entériner la ruine de toutes les valeurs et de tous les projets qu’on reconnaît à chacune de ses incarnations successives. Le personnage de Thomas l’exprime de plusieurs façons, lui dont les réflexions dessinent la trame secondaire essayistique du texte, où on sent poindre la tentation du roman à thèse chez son auteur :
C’était le ronron habituel de la vie 2.0, les mille milliards de petites boutures qui vibrent à la surface du Web, la pelouse au vent, ses minuscules aigrettes tournées vers le soleil, mais ce n’est pas le soleil, et ses racines plongées dans le sol, mais ce n’est pas le sol ; la gestion des soins médicaux à la place du traitement des maladies, la promotion du livre au lieu de la mise en oeuvre d’une parole pérenne, le discours sur l’enseignement plutôt que la transmission des savoirs, mes commentaires sur la vie plutôt que les borborygmes produits par ma digestion.
156
En somme, l’âge adulte est chez Martel la période assez courte durant laquelle il nous est donné de mesurer, en pratique, la différence entre le rêve romantique de la sublimation des émotions en des formes idéales et la réalité physique voulant que les corps et les êtres puissent se voir soudain dispersés avec tout ce qui les compose, y compris leurs souvenirs et leurs amours. La sublimation est un phénomène naturel avant d’être une aspiration générationnelle, esthétique ou spirituelle. Jean-Philippe Martel ne nous permet pas de l’oublier, et c’est tout à son honneur.
Quand on se retourne sur le chemin de la vie pour constater qu’on a changé, c’est toujours pour s’apercevoir aussitôt qu’on n’a pas d’idée claire ni de souvenir de la manière dont ce changement a pu s’opérer. Si les beaux romans de Maryse Andraos et de Jean-Philippe Martel se rejoignent, c’est sur ce point qui a partie liée avec quelque chose de plus profond que la pensée narrative et structurelle de l’histoire. Sans la compagnie des autres, sans leur amour, on meurt intérieurement. C’est prouvé. Non seulement par la médecine, mais aussi par la population entière de la planète pendant deux ans de confinement pandémique. Est-ce à dire qu’en compagnie des autres, on exulte automatiquement ? Rien n’est si simple. La vie n’est pas un objet qu’on pourrait isoler afin d’en parler. La vie est une durée. Et dès qu’il est question de durée, du temps et des choses qui passent, rien ne peut aller tout à fait bien. L’habitude est commune qui fait traquer l’événement comme moteur de toute histoire : les ruptures amoureuses, les conflits interpersonnels, mais aussi les grandes rencontres se doivent d’être spectaculaires ou à tout le moins manifestes. Pourtant, combien de délitements dans nos relations passent inaperçus au long des années, à cause de leur discrétion ou de leur absence de vagues ? Combien de rencontres, aussi, résistent à l’interprétation, voire à la compréhension ? Le concept de présent, théorique et insaisissable, est compatible avec l’idéal d’un bien-être inentamé, c’est-à-dire du bonheur. Pour sa part, l’expérience, réelle et inévitable, de la durée ne l’est pas du tout. Alors qu’en est-il de nos appartenances communautaires – si vitales, si attendues, si impératives – dans l’inexorable de la durée ? Sans refuge et Chez les sublimés m’ont frappé en ce qu’ils considèrent, chacun à sa manière et avec une perspective issue de l’expérience, le groupe et la sociabilité comme des épreuves de la vie plutôt que comme des dons unilatéraux. Ce sont deux romans qui cherchent des moyens de relier le désir de communauté au passé et à l’avenir sans céder aux expédients consensuels qui nous sont proposés comme des évidences au jour le jour. C’est là un choix non seulement lucide, mais intelligent ; et je pèse mes mots.
Appendices
Note biographique
DANIEL LAFOREST est professeur titulaire à l’Université de l’Alberta. Ses recherches actuelles portent sur les rapports entre la littérature et les humanités médicales. Il est auteur de L’archipel de Caïn. Pierre Perrault et l’écriture du territoire (XYZ, prix Jean-Éthier-Blais, 2011), et de L’âge de plastique. Lire la ville québécoise contemporaine (PUM, 2016). Il a également codirigé les ouvrages Literary Narrative, the Biomedical Body, and Citizenship in Canada (PULIM, 2016), et Inhabiting Memory in Canadian Literature (UofA Press 2017). Il a été chercheur titulaire de la Chaire en études canadiennes de l’Université de Limoges, ainsi que professeur invité du programme Medicine and the Muse au Center for Biomedical Ethics de l’Université Stanford aux États-Unis.