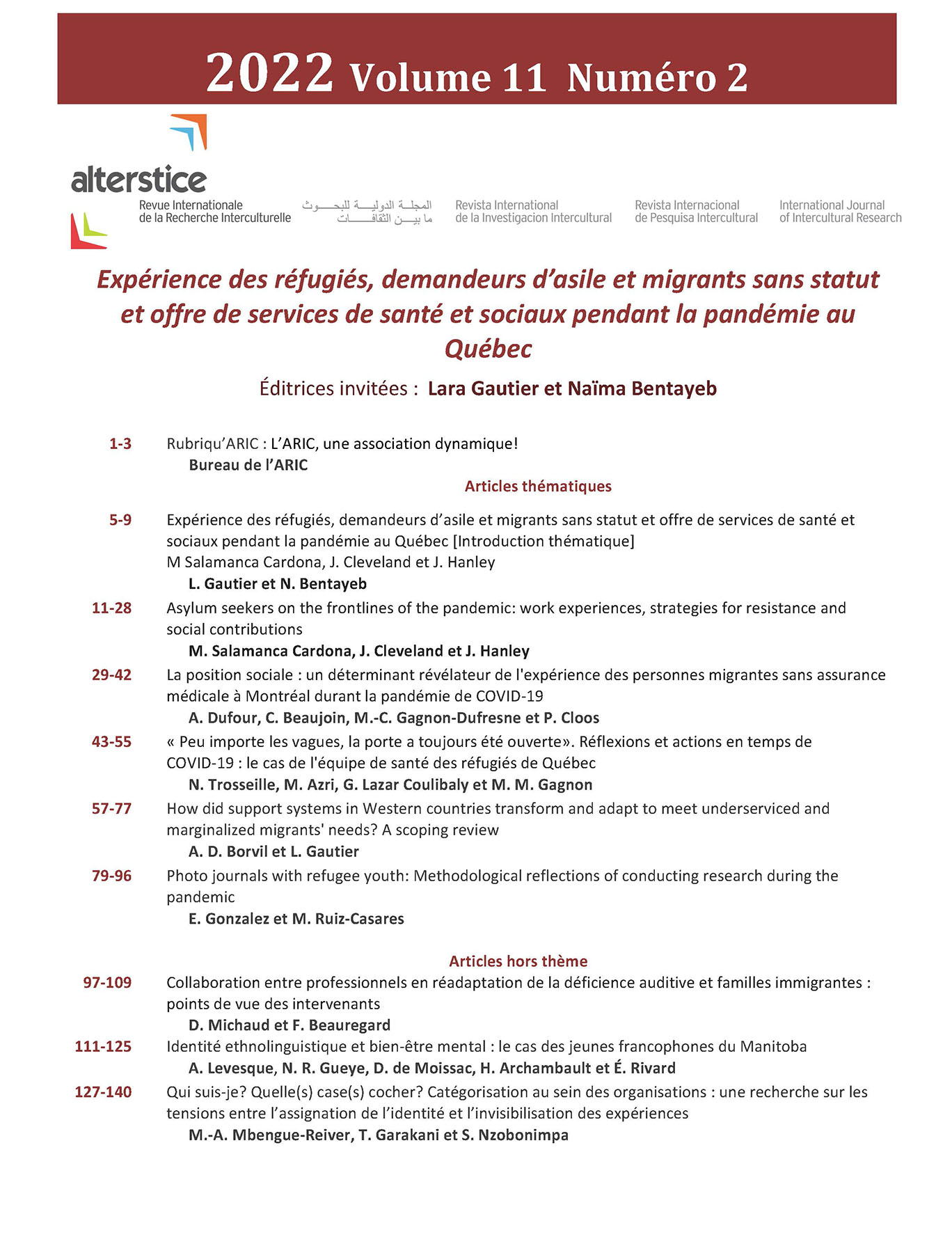Article body
Mémoires d’Afriques est « l’histoire d’un mec », Henri Vieille-Grosjean, qui partage les expériences interculturelles qu’il a vécues en Afrique dans différents contextes : l’école, l’administration, la vie quotidienne, les rituels, etc. Plus que de simplement les narrer, il les analyse via ses multiples regards de coopérant français, d’anthropologue de l’éducation, de touriste et d’avocat des oubliés de la modernisation. La première partie de l’ouvrage rapporte ses expériences interculturelles en contexte scolaire et au contact direct des populations locales. La deuxième partie sous-tend une critique des transferts Nord-Sud incarnés par les ONG, les élites politiques et les sociétés civiles, concernant la gouvernance et l’éducation. La troisième analyse les effets paradoxaux de la transmission (inter)culturelle, via notamment les modèles économique et scolaire français, en particulier ses effets sur l’insertion sociale et économique des jeunes. Mémoires d’Afriques est une contribution et une invitation à un projet interculturel.
Introduction
Dans Mémoires d’Afriques, Henry Vieille-Grosjean (H.V.G.) use d’entrée d’un style qui n’est pas sans rappeler le swing endiablé d’un jazzman. Il nous engage résolument dans une danse des mots dont chaque pas dévoile une source, une ressource ou une odeur, facette de ses Afriques. Des souvenirs resurgis de sa mémoire « récitative puis méditative » (p. 9) d’anthropologue de l’éducation, de coopérant français, mais fondamentalement d’avocat des « oubliés de la modernisation » (p. 230). En effet, au fil des plus de 250 pages de son récit, transparaît sa défense d’une Afrique plurielle dont il décrit « les sources et les ressources » (p. 247, 253). Pour autant, ses voyages et surtout ses expériences vécues au sein des organes de la coopération française en Afrique lui donnent l’occasion de pointer divers obstacles endogènes et exogènes qui freinent le développement de ce continent peuplé de plus d’un milliard d’habitants, en majorité des jeunes.
Première partie : « Anamnèse-récits – Initiation »
Ainsi, dans la première partie, « Anamnèse-récits – Initiation », H.V.G. nous décrit dans quelles conditions, jeune coopérant français, il s’est directement confronté à l’altérité culturelle sur le sol africain au lendemain des indépendances formelles. Son odyssée est parsemée d’étapes révélatrices de la diversité et de la complexité de ce continent. Celle de Marseille, ville particulièrement cosmopolite sur le territoire métropolitain, semble avoir constitué une sorte de bizutage acculturatif. Elle semble l’avoir préparé à ajuster ses « premiers regards » sur le chemin de son « initiation » interculturelle (p. 18-29) dans une Francophonie aux « couleurs et aux odeurs » africaines (p. 137-141).
D’un côté, il nous donne à voir ses pérégrinations aux confins d’une Afrique authentiquement ancestrale, qu’il découvre auprès d’habitants qui lui ont fait vivre des expériences acculturatives en mode boomerang. H.V.G. les partage avec force détails tels les épisodes d’une série : virées parfois rocambolesques en avion, en voiture ou à dos d’animal, dans la brousse ou dans le désert, cérémonies traditionnelles aux allures parfois mystiques et dont il a quelquefois été le « sujet naïf » plus ou moins consentant, etc. Les malentendus culturels subséquents sont assumés et presque revendiqués, toujours avec le sens de la formule et sans se prendre au sérieux. À chaque fois, H.V.G. semble les vivre dans la logique de Lachman citée par Rodgers (1991). En effet, selon lui, « le problème des différences culturelles n’est pas tant qu’elles provoquent des désaccords; en fait elles produisent plutôt des malentendus. Et, contrairement aux désaccords qui sont visibles et que nous pouvons essayer de régler, le vice des malentendus est qu’en général nous ne savons pas qu’ils existent » (p.123). H.V.G. nous invite ainsi à vivre les différences culturelles comme des défis humains à relever pour instaurer un dialogue interculturel, plutôt qu’à percevoir en eux des facteurs mécaniques d’un conflit de cultures. In fine, H.V.G. semble avoir vécu ses différentes rencontres avec l’altérité comme autant d’opportunités d’une prise de conscience, parfois aigüe, des « distances » culturelles à parcourir par les protagonistes. C’est en tout cas ce que laisse entrevoir la narration de ses très nombreuses expériences : cérémonie funéraire au Dahomey (actuel Bénin, p. 63, 64), proposition d’un père de le fiancer à sa fille mineure comme le veut sa coutume (p. 85), festivités de la tabaski à l’occasion desquelles lui a été révélé le traitement spécifique réservé aux enfants chez les Songhaï du Niger (p. 88), sans oublier sa rencontre avec ce garçon, gardien de chèvres aux alentours de Biskra, qui symbolise toute l’hospitalité algérienne en dépit de sa propre précarité (p. 97-98).
De l’autre, H.V.G. nous restitue ses expériences interculturelles dans des institutions officielles héritées de la colonisation française, en particulier le système éducatif, par exemple au Mali (p. 35-45). Dans tous les cas, le défi interculturel semble pointer son nez à la moindre occasion. Il en est ainsi, par exemple, dans la gestion du temps ou concernant la place des ancêtres et des liens lignagers, au sein de systèmes régis par des normes enracinées dans la logique des sociétés occidentales industrialisées (p. 35-101)
Deuxième partie : « Métanoïa-épiphanie – Apprentissage »
Dans la deuxième partie de son livre, « Métanoia-épiphanie – Apprentissage », H.V.G. nous invite à un véritable slalom dans les méandres de la coopération française en Afrique, notamment autour de la mise en place de projets de « développement social » dans les années 2000. Son récit en éclaire les apports mais surtout les paradoxes et les effets pervers (p. 115). Les ONG occupent une place centrale dans ces projets. Nombre d’entre eux s’avèrent cependant inadaptés, puisque résultant uniquement de la « soumission intéressée des ONG aux propositions » des institutions financières internationales (p. 154-155). Les ONG font ainsi partie, selon H.V.G., des nombreuses variantes des « sociétés civiles » qui émergent en Afrique. Pour autant, elles se montrent incapables de « satisfaire à des exigences de développement d’autonomie et de maturité, pas plus qu’elles ne répondent aux urgences les plus manifestes et les plus primaires en matière d’éducation » (p. 154). En fait, elles favorisent plutôt ce que H.V.G. qualifie de « forme de prostitution associative » (p. 176). Toutes ces observations lui permettent de mieux souligner l’importance d’un « appren(d)-tissage » (p. 10) par les différents acteurs de la gestion des « continuités », mais aussi des « distances » et des « ruptures » (p. 157) culturelles et administratives existant entre les sociétés du « Sud » et du « Nord » (p. 246-247). Rien d’étonnant alors que l’éducation des jeunes, l’avenir du continent, constitue pour l’anthropologue de l’éducation qu’il est, le levier essentiel du développement africain. C’est donc à l’école et surtout aux jeunes qu’il accorde l’essentiel de la troisième et dernière partie de son ouvrage.
Troisième partie : « Autopoïèse-Récréation »
En effet, la troisième partie de l’ouvrage, « Autopoïèse-Récréation », a pour fil conducteur la « transmission » (p. 163), un processus que H.V.G. analyse surtout là où tradition et modernité se télescopent le plus, telles des plaques tectoniques : les « espaces urbains » (p. 165, 210, 211, 237-242). Il interroge les facteurs de « fragilité » et de « légitimité » de la société civile et de la classe politique dans les pays d’Afrique parcourus. Il nous explique dans quelle mesure elles sont prises en étau « entre dépendance et inventivité » face aux modèles venus de la France, l’ancienne puissance coloniale, ou apportés par d’autres puissances comme la Chine (p. 172-178). Il dissèque, tous azimuts, les lacunes et les atouts potentiels des modes de transmission des savoir-faire et des savoir-être véhiculés auprès des jeunes par différents acteurs aux intérêts souvent contradictoires : l’école coranique, l’école de la rue, l’école occidentale, la famille (p. 242-244). Il pointe surtout les lacunes de l’école, cette institution dont c’est la vocation par excellence dans des sociétés aspirant à ce qu’on appelle la modernité. Au-delà, c’est tout le système éducatif officiel qu’il nous invite à interroger. H.V.G. voit dans ses lacunes actuelles un effet de la « mauvaise gouvernance » qui se traduit en particulier par des « ressources mal distribuées ». Selon lui, ces inégalités favorisent, entre autres, des mouvements d’« exodes » et de « migrations », voire des « discordes entre clans alimentées et entretenues par des forces étrangères », à l’instar du conflit biafrais au Nigéria (p. 183-185).
Les élites africaines semblent ainsi ignorer le leitmotiv de Mandela, ce sage africain, à savoir que « l’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde » (Mandela, 1990). En effet, dans la plupart des pays d’Afrique, le système éducatif oscille entre « résistances et utopies » (p. 188-189). Selon H.V.G., ses errements sont fondamentalement tributaires des stratégies inadaptées de transfert des modèles du Nord vers le Sud. Il considère que cette institution éducative qu’il connaît bien de l’intérieur repose sur « l’imitation et la reproduction » du « modèle de l’école française », sans constituer un véritable « système scolaire » adapté aux exigences du « contexte socio-économique du présent » (p. 198-208). En Afrique, l’école n’intègre pas « la congruence et la monosémie » du processus éducatif qui constituent « les éléments matriciels de la construction sociale dans les sociétés occidentales » (p. 198). De son expérience, H.V.G. conclut qu’en Afrique en général, l’école semble, hélas, n’avoir « d’autre ambition permise que l’imitation d’un modèle, mais qui plus est, dans ses aspects obsolètes, sans être en mesure de le proroger dans ses intentions et ses prétentions » (p. 198-199). Que peut-on alors en attendre d’autre, qu’une « performance dévastatrice sur les territoires humains que ces modèles continuent de vouloir coloniser »? (p. 198). H.V.G. illustre cette défaillance particulière via l’exemple de nombreux jeunes « qui ont réussi leur scolarité (…), jouissent de la reconnaissance sociale et sont la fierté de leurs familles […], mais qui sont arrêtés dans leur élan vers une insertion économique par une série de barrages qui les empêchent d’exercer une activité rentable pour eux et leur parentèle » (p. 244). D’où la « proportion de jeunes sans feu ni lieu, sans toit, ni loi familiale et éducationnelle [qui] augmente au fil des années dans les métropoles et capitales africaines » (p. 245). Malheureusement, cette « boursoufflure sociale » et plus globalement ce fameux sous-développement est multifactoriel, étant alimenté par de nombreux paradoxes. H.V.G. évoque notamment (p. 245-247) des « injonctions à plus de démocratie ou le rôle ambigu de l’école et des diplômes », des stratégies de préservation d’un « avenir serein pour les générations futures » et de « l’écosystème » qui sont controversées, des « industries et leurs capitaines » qui exploitent la « richesse minière et maraîchère » de l’Afrique, pour y « placer les déchets, essayer les vaccins ou les nouveaux armements ». Pendant ce temps, les villes sont « abandonnées à une urbanité non contrôlée et à la paupérisation, la scolarisation ne remplissant son rôle de socialisation que pour une minorité ». De simples raccommodages y sont généralement apportés via en particulier les actions menées par les ONG et les associations, « souvent présentées comme des alternatives au fonctionnariat », ainsi que grâce à « l’économie informelle » (p. 189-192). On connaît la musique…
Discussion
Il semble donc opportun, voire vital, d’une part que les élites politiques et les sociétés civiles africaines trouvent le chemin le plus adapté pour instaurer un véritable développement endogène, une voie « à l’africaine ». D’autre part, et dans une économie mondialisée où elles doivent beaucoup emprunter aux autres, elles devront trouver des moyens leur permettant de s’approprier dans une perspective propre des « projets de développement » enracinés dans les normes et les intérêts des sociétés du Nord. La capacité au dialogue interculturel n’est pas une option, mais une nécessité historique. Les élites politiques et les sociétés civiles africaines subiront-elles le sort de Samba Diallo, le malheureux héros de l’« aventure ambiguë » de Kane (1971) pour que les contraires puissent se réconcilier? Ou sauront-elles tirer profit de toutes les nombreuses ressources dont l’Afrique regorge, pour se construire « elles-mêmes », et être prêtes au « rendez-vous du donner et du recevoir » cher à Senghor (1993)?
De mémoire d’Africain et d’Africaine, ces questions se posaient déjà avant les indépendances politiques factuelles. Elles sous-tendent une problématique éminemment interculturelle. Tout au long de cette « saga Africa » d’un Alsacien amoureux de l’Afrique, ou plutôt des « Afriques », le lecteur trouvera certes des éléments de réponse, mais surtout de réflexion, ancrés dans la propre trajectoire acculturative de l’auteur. Certes, comme le précise H.V.G. lui-même, son ouvrage est avant tout le récit d’une « balade africaine qui s’est transformée progressivement […] en manifeste, voire en profession de foi » (p. 254). C’est donc avant tout « l’histoire d’un mec » qui a d’abord voulu modestement « laisser la trace » d’une aventure humaine personnelle, vécue sur un continent qui est souvent représenté en Occident uniquement à travers ses failles. Pour autant, Mémoires d’Afriques se révèle être, sur le fond, une importante contribution à un « projet interculturel » (p. 253) volontariste, et optimiste, justifiant ainsi les critiques parfois sévères que son auteur adresse aux différents protagonistes de la Françafrique, et pas qu’à eux. Il prend clairement la défense d’une « interculturalité qui n’est pas collection de connaissances livresques, ou de clichés sur les différences et les moyens de les vaincre ou les oublier, mais prudence et modestie, optimisme et vertu » (p. 255). Bref, H.V.G. nous apparaît comme le chantre d’une interculturalité de terrain, en adoptant parfois le ton d’un sage africain maîtrisant l’art des contes, le soir au coin du feu.
Des bémols? Tenez, juste quelques-uns, parole de (au) lecteur. Sur la forme, on relèvera que le langage professoral surgit de temps en temps, notamment au détour d’un titre ou d’une expression qui semble venue d’une quelconque culture ésotérique, renvoyant parfois le lecteur à une recherche effrénée dans son dictionnaire lexical. Mais dans l’ensemble, le propos est explicite, exprimant, de manière parfois plus ou moins impétueuse, ici l’indignation, là, la colère, mais toujours un authentique volontarisme militant comme on n’en rencontre plus beaucoup. La lecture de l’ouvrage est efficacement rythmée par des cartes, des photos, des récits de cérémonies rituelles et d’anecdotes d’ordres culturel, politique et de la vie quotidienne. Sur le fond, les analyses proposées sont le fruit de ses séjours en Algérie, au Mali et au Tchad, « trois pays présentés comme des lieux de paix, de travail, et d’hospitalité » (p. 253- 255). On relèvera, malheureusement, que ces dernières années, nous avons assisté, tour à tour, à la violente répression du mouvement populaire du « Hirak » en Algérie et à deux coups de force en moins d’un an au Mali, deux événements sanctionnés par les institutions panafricaines et les puissances occidentales. Le Tchad, quant à lui, a connu une succession lignagère suivie d’une violente répression de la population l’ayant contestée, en n’entraînant que des réactions complaisantes. La « mauvaise gouvernance » qui sous-tend ces faits traduit l’incapacité des élites à créer les conditions d’un dialogue interne véritablement démocratique et interculturel, indispensable aux échanges avec d’autres pays du Sud et du Nord. En ce sens, dans une Afrique affaiblie par de nombreux conflits endogènes, une réflexion plus approfondie sur l’interculturalité Sud-Sud (au sein et entre les sociétés africaines) aurait pu compléter l’analyse des relations Sud-Nord que promeut, à juste titre, H.V.G.
En tout état de cause, H.V.G. nous expose ici sa vision des Afriques qui s’écarte de l’image d’une Afrique homogène et nourrie à l’afro-pessimisme. Certes, c’est une démarche toute subjective et intime. Mais elle a le mérite de nous offrir l’occasion d’un échange sur l’interculturalité, libéré en quelque sorte de l’orthodoxie théorique et méthodologique habituelle, sans pour autant sacrifier à la pertinence du propos. En cela, l’auteur apporte du grain à moudre au débat africain. Plus que jamais, il revient aux femmes et aux hommes de tous les pays africains, et du Sud en général, de cultiver leur propre jardin. Parallèlement, H.V.G. les invite à « construire leur identités propre et spécifique, dans le respect curieux et intéressé des autres expériences et des autres vécus » (p. 254). Comme lui, nous espérons qu’ainsi les sociétés africaines pourront, tout au moins, escompter atteindre « la dimension interculturelle des espaces relationnels qui mettent en présence différences et diversités » (p. 254). Que les Africaines et les Africains, et surtout leurs élites, arrêtent enfin de se dire : « Toi dans la forêt, moi dans la forêt, et tu me demandes où est le soleil ? » (Proverbe téké du Congo).
Mémoires d’Afriques sous-tend effectivement un projet interculturel.
Appendices
Annexe
Autres ouvrages de H. Vieille-Grosjean
Vieille-Grosjean, H. (2022). Derniers cris d’Alsace et même d’ailleurs. Éditions De Bonne Heure.
Vieille-Grosjean, H et Solomon Tsehaye, R. (dir.). (2022). Le respect, pensé autrement – 12 variations entre éthique et pédagogie. Edition Albiana – Università di Corsica.
Bibliographie
- Kane, C. H. (1961). L’aventure ambiguë. Julliard
- Mandela, N. (1990). Discours prononcé au Madison Park High School. Boston, 23 juin. https://qqcitations.com/citation/159172
- Rodgers, I. (1991). Les entreprises internationales et le défi des cultures différentes. Cahiers de sociologie économique et culturelle. Ethnopsychologie, 15, 121-132. https://doi.org/10.3406/casec.1991.2133
- Senghor, L. S. (1993). Liberté 5 : le dialogue des cultures. Paris : Seuil.