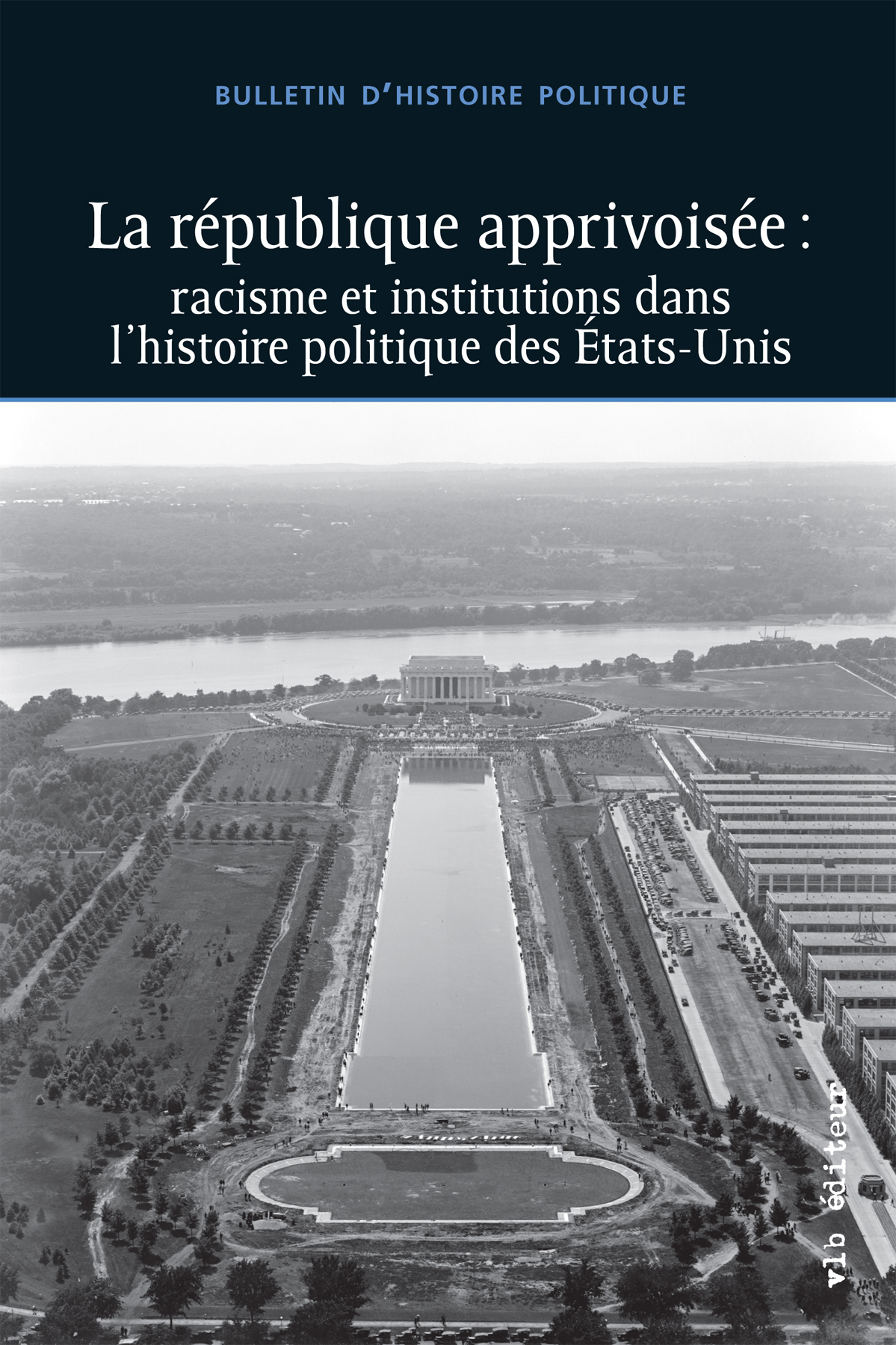Abstracts
Résumé
Dans la nuit du 9 au 10 septembre 1965, La Nouvelle-Orléans est dévastée par l’ouragan Betsy. Une inondation soudaine submerge une portion de la ville, en particulier le Lower Ninth Ward, un quartier dense à majorité noire. Dès le soir suivant, le président Lyndon B. Johnson se rend sur place et promet aux Orléanais une réponse rapide et efficace. Toutefois, au fil des semaines, des voix s’élèvent pour dénoncer les obstacles au rétablissement des quartiers noirs. Johnson était-il sérieux dans son engagement de venir en aide à tous les sinistrés, Noirs comme Blancs ? Cette étude tente de répondre à cette question en examinant l’influence du thème de l’équité raciale sur les décisions et les actions de l’administration Johnson après Betsy.
Mots-clés :
- Lyndon B. Johnson,
- La Nouvelle-Orléans,
- Noirs,
- États-Unis,
- ouragan,
- Années 1960
Article body
Dans la nuit du 9 au 10 septembre 1965, la Louisiane est en état d’alerte à l’approche de Betsy, un ouragan de catégorie 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson. Depuis quelques jours, les experts sont médusés par son trajet imprévisible : alors que sa trajectoire semble le mener vers la côte est, Betsy effectue deux boucles au large des Caraïbes et frappe les Bahamas et la péninsule de la Floride, avant de poursuivre son chemin dans le golfe du Mexique. Le cyclone est alors en voie de s’abattre directement sur La Nouvelle-Orléans, métropole portuaire du sud de la Louisiane, mais touche finalement terre quelques dizaines de kilomètres au sud. La ville échappe à l’oeil de l’ouragan, mais essuie des vents de 150 km/h avec des rafales excédant 200 km/h. Des toitures sont arrachées, des arbres sont déracinés, des clochers s’écroulent et la ville est presque entièrement privée d’électricité et d’eau potable[1].
Des dégâts encore plus graves sont causés par des ondes de tempête atteignant cinq mètres de hauteur. En remontant des canaux de navigation liant le lac Pontchartrain au golfe du Mexique à travers La Nouvelle-Orléans, ces puissantes vagues déclenchent une série de débordements et de brèches de digues qui inondent 20 % de la superficie de la municipalité[2]. Selon les premières estimations, Betsy cause la mort d’environ 65 personnes en Louisiane, la plupart d’entre elles étant des Afro-Américains de La Nouvelle-Orléans[3].
Nul endroit n’est plus touché que le Lower Ninth Ward. Ce quartier majoritairement noir[4] et densément peuplé n’est pas particulièrement défavorisé (notamment, plus de la moitié de ses résidents sont propriétaires), mais il existe à peine aux yeux de l’administration municipale. Situé au sein du Ninth Ward mais isolé du reste de la ville par deux canaux artificiels et le fleuve Mississippi, le quartier ne compte aucun poste de police, hôpital, clinique ou bibliothèque. Malgré des inondations à répétition (comme lors du dernier ouragan à avoir fouetté la municipalité, en 1947), le réseau d’égouts et de drainage demeure totalement obsolète[5]. Pour des raisons géographiques et politiques, donc, cette zone enclavée est extrêmement vulnérable à des cataclysmes comme c’est le cas avec l’ouragan Betsy : des débordements de digues, auxquels s’ajoutent des brèches de l’Industrial Canal, forcent des milliers de résidents à fuir sans préavis ou à se réfugier en hauteur[6].
Le président Lyndon Baines Johnson se rend sur place le soir suivant. Visiblement marqué par la destruction et la souffrance dont il a été témoin, il promet en conférence de presse de « sabrer dans la paperasserie » (« cut all red tape ») afin d’assurer une réponse rapide et efficace. Sa visite hors du commun, saluée de toutes parts, marque les esprits de la population locale[7].
Par son ampleur, l’ouragan Betsy se démarque d’autres catastrophes de l’histoire américaine. Dès septembre 1965, la Croix-Rouge évalue le montant des dégâts à un milliard de dollars – une somme jusqu’alors inégalée[8]. La situation à La Nouvelle-Orléans, une ville dont le nom est connu à travers le monde, est suivie avec grand intérêt par les médias américains.
Au fil des semaines, des voix s’élèvent toutefois pour dénoncer la lenteur et l’opacité du processus de rétablissement non seulement dans le Lower Ninth Ward, mais aussi dans les autres quartiers noirs du Ninth Ward (Desire, Florida et Pontchartrain Park). Ces critiques nous amènent à nous interroger : Johnson était-il sérieux dans son engagement de venir en aide à tous les sinistrés, Noirs comme Blancs, ou cherchait-il avant tout à faire des gains politiques ? Après tout, la visite du président démocrate s’inscrit dans un environnement ségrégué et dans un État qui, en réaction à son programme visant à garantir les droits civiques des Noirs, avait penché en faveur du Parti républicain aux élections présidentielles de 1964. Cette étude tente de répondre à cette question en démontrant comment les décisions et les actions de l’administration Johnson soutiennent – ou ne soutiennent pas – les sinistrés noirs.
Rappelons que cet ouragan se produit durant les années 1960, une époque singulière de l’histoire des relations raciales aux États-Unis. C’est à cette période marquée par des émeutes raciales (en particulier celles dans le quartier noir de Watts, à Los Angeles, le mois précédent) et par une forte mobilisation des militants des droits civiques que l’inondation frappe de manière disproportionnée la communauté afro-orléanaise[9]. Les rapports entre cette dernière et le maire Victor Schiro (un opportuniste sans réelles convictions pour ou contre la déségrégation[10]) sont mis à rude épreuve par la catastrophe, mais le Big Easy échappera aux violences qui secouent tant d’autres villes durant la décennie.
Jusqu’à récemment, la dimension raciale de Betsy n’avait jamais fait l’objet d’une étude historique approfondie. Edward Haas, dont l’article « Victor H. Schiro, Hurricane Betsy, and the “ Forgiveness Bill” »[11] paru en 1990 est longtemps demeuré la référence sur le sujet, relate la gestion de la crise par le maire Schiro, mais ne fait que mentionner au passage le thème épineux de la dynamique interraciale. D’autres historiens, dont Kent Germany[12], y ont accordé une certaine attention sans toutefois en faire le sujet central de leur analyse. En 2014, Andy Horowitz a placé cette question au coeur de son étude en se basant sur des témoignages oraux de survivants du Lower Ninth Ward recueillis en 2003 par l’historienne Nilima Mwendo, ainsi que sur des archives de groupes locaux, pour analyser l’aide reçue (ou non reçue) par les résidents de ce quartier[13].
Aucun de ces travaux n’analyse cependant l’histoire de l’ouragan du point de vue de la Maison-Blanche. Les archives de la bibliothèque présidentielle Lyndon Baines Johnson s’avèrent donc particulièrement éclairantes pour comprendre les efforts concrets de Washington pour soutenir la communauté orléanaise[14]. Elles démontrent comment Johnson intervient pour améliorer la réponse de tous les paliers de gouvernement, et sa préoccupation envers l’équité dans l’aide d’urgence accordée aux sinistrés. Elles mettent en lumière la puissance de l’État-providence à l’ère de la Great Society, mais aussi sa capacité parfois limitée à surmonter certains obstacles, en particulier une résistance des forces ségrégationnistes. Dans le contexte de Betsy, cette résistance prendra chez plusieurs politiciens la forme d’un cruel désintérêt pour les sinistrés noirs. Les archives présidentielles, jumelées à d’autres sources et à l’historiographie, offrent donc un regard inédit sur cet ouragan déterminant dans l’histoire de La Nouvelle-Orléans.
Ce désastre, bien que datant d’il y a plus de 50 ans, demeure pertinent dans l’histoire orléanaise et américaine. Si l’administration Johnson, malgré quelques défauts importants, a tracé la voie à suivre après une catastrophe majeure, la réponse du président George W. Bush à l’ouragan Katrina de 2005 est plutôt devenue un exemple d’échec effarant de l’appareil gouvernemental[15].
Nous poserons d’abord un regard sur la visite de Johnson afin de mieux analyser la réponse de son administration dans les semaines suivant l’ouragan. Nous aborderons ensuite la question des tensions raciales entre la communauté noire et les autorités locales au plus fort de la crise. Nous terminerons avec un regard sur le Betsy Bill, un projet de loi fédéral de soutien financier aux sinistrés déposé dans les semaines après la catastrophe, et les efforts en faveur d’une plus grande reconnaissance des Noirs du Ninth Ward.
Johnson au coeur de la dévastation
Le matin du 10 septembre, Johnson suit attentivement la situation en Louisiane depuis le Bureau ovale[16]. En après-midi, le sénateur de la Louisiane Russell Long, avec l’appui des représentants louisianais Edwin Willis et Hale Boggs, joint le président par téléphone pour l’implorer de se rendre dès que possible à La Nouvelle-Orléans afin d’offrir un soutien moral à la population. Pour aider le président à appréhender l’ampleur de la catastrophe, Long, qui se trouve à Washington, lui explique – à tort[17] – que l’ouragan a déversé le contenu de l’imposant lac Pontchartrain, situé au nord, sur la ville et la paroisse de Jefferson à l’ouest. Johnson est d’abord peu enclin à se rendre lui-même sur les lieux, mais le sénateur démocrate parvient à le persuader en lui faisant miroiter les retombées politiques que sa présence pourrait avoir pour son parti en Louisiane, l’un des rares États ayant échappé au Parti démocrate à l’élection présidentielle de 1964[18].Quelques heures plus tard, le président s’envole pour la Louisiane à bord d’Air Force One.
L’avion présidentiel survole brièvement la métropole avant d’atterrir à l’aéroport Moisant en fin d’après-midi. Après une courte déclaration devant les médias, Johnson entreprend une tournée d’observation à bord d’un cortège motorisé comprenant notamment Long, Boggs, Willis, le maire Victor Schiro et une foule de journalistes. Après 40 minutes à se frayer un chemin à travers les décombres, le cortège s’arrête sur le pont Judge Seeber, qui enjambe l’Industrial Canal, afin de laisser le président observer de près l’étendue de l’inondation. Entouré de journalistes, Johnson s’entretient ensuite avec des sinistrés tels que William Marshall, un homme noir de 74 ans en quête d’un refuge. Peu après, le cortège atteint l’école élémentaire George Washington, devenue de facto un refuge bondé de sinistrés noirs[19] dépourvus de vivres et nécessitant une assistance immédiate. Faisant fi des préoccupations des Services secrets chargés d’assurer sa sécurité, le groupe s’aventure dans le bâtiment armé de simples lampes de poche, afin de constater les conditions déplorables et d’évaluer les besoins les plus urgents. Braquant sa lampe-torche vers son visage, le président s’adresse aux réfugiés et proclame d’une voix puissante destinée à couvrir le brouhaha ambiant : « This is your president and I’m here to help you »[20].
Johnson et son groupe sont consternés par l’absence d’eau potable, de nourriture, d’électricité et de salubrité. Dans le carnet de bord, sa secrétaire exprime avec émotion la détresse des réfugiés : « It was a mass of human suffering. They were crowded into the school [with] their families gathered around them. Calls of “water – water – water” were resounded over and over again in terribly emotional wails from voices of all ages. […] The people all about were bedraggled and homeless… thirsty and hungry. It was a most pitiful sight of human and material destruction[21] ».
Le président ordonne à Buford Ellington, directeur de l’organisation fédérale responsable de la planification de la réponse aux désastres – nommée Office of Emergency Planning (OEP) – de leur trouver de l’eau. Rapidement, 13 bidons d’eau de 66 litres entreposés dans un abri nucléaire à proximité sont transportés vers l’école et mis à la disposition des réfugiés[22]. Johnson demande également au maire de se renseigner auprès des compagnies de boissons gazeuses sur leur capacité à fournir des rafraîchissements jusqu’à la levée de l’avis d’ébullition[23].
Avant de rentrer à Washington à bord d’Air Force One, Johnson promet devant la presse de lutter contre la paperasserie (« cut all red tape ») afin d’accélérer le rétablissement de la ville. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de donner quelques ordres et d’exprimer de bonnes intentions ; il doit prévoir un mécanisme flexible et adapté à une telle situation. C’est pourquoi il laisse sur place une équipe de cinq experts de l’OEP dirigée par Robert Phillips, directeur de la division des désastres. Officiellement, leur travail est de superviser et de coordonner les efforts des différentes agences fédérales, et d’entretenir des contacts étroits avec les agences locales et la Croix-Rouge. Cependant, leur tâche implique également d’assouplir la législation et les règlements sur-le-champ, dans le but d’assurer l’efficacité bureaucratique et la poursuite par toutes les agences des objectifs présidentiels. Les fréquentes allusions à l’enjeu de la paperasserie, qu’on retrouve dans les communications internes de la Maison-Blanche, laissent entrevoir l’importance qu’accorde Johnson à l’aspect bureaucratique[24].
Nulle part ce souci d’efficacité n’est-il plus évident que lorsque, en compagnie du sénateur Long dans le Bureau ovale, Johnson s’entretient avec Phillips pour faire le point sur sa mission. Le président utilise une métaphore pour rappeler que « tous les membres de la famille » – les gouvernements orléanais et louisianais ainsi que les agences sur le terrain – doivent mettre de côté leurs différends et leurs problèmes individuels pour venir en aide à « la mère malade », c’est-à-dire la Louisiane :
In times of distress it’s necessary that all the members of the family get together and lay aside any individual problems they have or any personal grievances and try to take care of the sick mother. And we’ve got a sick mother on our hands. And I said the other night when I was there [in New Orleans] we’ve got to cut out all the red tape. We’ve got to work around the clock. We’ve got to ignore hours. We’ve got to bear in mind that we exist for only one purpose, and that’s to do the greatest good for the greatest number.
The people who’ve lost their homes, the people who’ve lost their furniture, the people who’ve lost some of their crops or even their families aren’t going to be very interested in any individual differences between federal or state or local agencies. So I hope that all the government people can put their shoulder to the wheel without regard to hours, without regard to red tape, to bring to these people the kind of assistance they need in this emergency which is worthy of a great government and a great country[25].
Long renchérit avec des mots qui illustrent l’importance bien relative accordée au strict respect des lois face à la lutte aux entraves administratives : « We’re not trying to make you violate the law. But insofar as you can find a way to make the law bend to the problem, well that’s what we want you to do[26]. »
L’OEP s’assure entre autres de baliser clairement les responsabilités de l’Army Corps of Engineers (ACE), principale organisation chargée des opérations de nettoyage et de reconstruction, et de simplifier ses démarches administratives avant d’entreprendre ou de déléguer des travaux. Le colonel Thomas Bowen, commandant local de l’ACE, obtient de l’OEP l’accès direct aux fonds d’urgence fédéraux pour rembourser certains types de travaux effectués pour le compte des agences locales, sans devoir attendre l’approbation préalable normalement exigée par le gouvernement fédéral[27]. À cet effet, l’OEP se charge de fournir aux agences locales toute la documentation pour faire une demande d’assistance ou de subvention à l’ACE. De plus, afin de faciliter le remboursement de petits contrats, l’OEP abroge temporairement la limite minimale de 1000 dollars requise pour un contrat de réfection ou de remplacement d’installations ou d’infrastructures publiques essentielles[28].
En se rendant lui-même à La Nouvelle-Orléans – d’abord pour des motifs électoralistes – Johnson a pu rapidement prendre connaissance des besoins de la communauté. Dans les jours suivant sa visite, le président démontre une réelle volonté de réduire le fardeau bureaucratique susceptible de ralentir le retour à la normale.
Les Noirs du Ninth Ward face aux politiciens locaux
Les effets de cette simplification administrative tardent toutefois à rejoindre les Noirs du Ninth Ward. Les efforts de la Maison-Blanche visant à soutenir l’ensemble de la population sans distinction raciale sont souvent gênés par des dirigeants locaux qui, malgré le contexte exceptionnel d’une catastrophe naturelle, refusent d’accorder une juste considération à la population noire.
Durant la nuit du 9 au 10 septembre, les résidents du Ninth Ward attendent en vain un avis d’évacuation formel des autorités[29]. Alors que les canaux débordent depuis des heures sur les quartiers de l’est et du sud-est de la ville, le bulletin météorologique émis à 00 : 01 le 10 septembre ne recommande toujours d’évacuer que le nord et l’ouest[30]. Heureusement, des soldats de la Garde nationale sillonnent le Lower Ninth Ward (où se trouve leur base, Jackson Barracks) avec des camions munis de haut-parleurs pour avertir les résidents de fuir leur domicile[31].
Il est difficile d’expliquer pourquoi la population du Ninth Ward fut laissée ainsi à elle-même. Plusieurs facteurs tels que des problèmes techniques ou l’impact méconnu du Mississippi River-Gulf Outlet Canal peuvent expliquer cet échec fatidique, mais aucun n’est à lui seul déterminant. Aucune preuve ne permet cependant de conclure que cette décision fut motivée par une volonté de nuire ou de causer la mort[32]. En revanche, lorsque confrontés à ce sujet, plusieurs dirigeants locaux refusent expressément de faire amende honorable.
Dans une entrevue le 15 septembre, le célèbre physicien Edward Teller accuse les autorités municipales d’avoir forcé les citoyens du Ninth Ward à fuir sans préavis en n’ayant pas prévu la rupture des digues et l’inondation subséquente[33]. Ses propos seront unanimement corroborés par des centaines de résidents du quartier, sondés par l’hebdomadaire afro-américain Louisiana Weekly[34]. Face à cette accusation, des dirigeants orléanais et louisianais font front commun, dans une tentative de se dédouaner de toute responsabilité, de faire porter le blâme à l’administration Johnson et de rabrouer le scientifique. Ainsi le gouverneur de la Louisiane John McKeithen qualifie-t-il Teller de « savant fou », tandis que Schiro l’accuse de faire des déclarations « ridicules et irresponsables[35] ». Parmi les autres répliques, celle du représentant louisianais Edward Hébert se démarque par sa virulence et sa condescendance. Le Louisiana Weekly rapporte ainsi les propos tenus par ce politicien ségrégationniste durant une réunion de planification à laquelle presse et membres de la communauté noire étaient conviés :
The congressman further commented, “Teller like all great scientists, lives in an ivory tower and does not have any relations with people as individuals.” […] Addressing himself almost exclusively to the Negroes present, Hebert went on to say he felt this was not the time for charges of any kind. “Save our charges and accusations to be resolved at a later day, ” he proposed. […] He said political implications should be put aside and any politician who uses a disaster of this sort for political gains “should be taken out and hanged[36].”
Un autre responsable, Charles Erdmann, dirigeant local de la Civil Defense[37], tente sciemment de désinformer le public en prétendant que le Ninth Ward était lui aussi ciblé par l’avis d’évacuation. Il ajoute l’insulte à l’injure en insinuant à mots couverts que les résidents ont volontairement ignoré l’ordre d’évacuer : « The uprooting of people is not as simple as Dr. Teller wants it to be… if they don’t want to get out they’re not going to get out. » Une déclaration appuyée par le directeur de la Civil Defense de la Louisiane, Marshall T. Cappel : « We can advise [a person] of the danger and urge and insist on evacuation, but there always have been and always will be some areas that will not heed the danger signal[38]. »
Des résidents du Lower Ninth Ward dénoncent également ce qu’ils perçoivent comme la pratique d’une discrimination raciale systémique durant l’évacuation. Le cas de Lucille Duminy, une résidente noire du quartier, illustre bien le climat de méfiance qui prévaut entre Blancs et Noirs malgré des exemples d’entraide. Réfugiée avec sa famille à l’école McCarty, en plein coeur de son quartier submergé, Mme Duminy a été évacuée par un homme blanc venu prêter main-forte sur son bateau[39]. Cependant, alors qu’elle s’apprêtait ensuite à monter à bord d’un autobus public se dirigeant vers un refuge de la Croix-Rouge, elle affirme avoir été rabrouée par le chauffeur blanc pour des motifs qu’elle impute à la couleur de sa peau. Elle a enfin été transportée, avec sa famille, à bord d’un camion de transport de bétail[40].
Lucille Duminy et sa famille ne sont pas au bout de leurs peines. Ceux qui, comme eux, rejoignent les camps de la Croix-Rouge peinent souvent à obtenir nourriture et vêtements propres. Ces établissements souffrent déjà d’un surpeuplement qui met à l’épreuve leur capacité à répondre aux besoins des personnes hébergées. Des bâtiments publics sont utiles comme abris officiels contre les vents violents, mais ils ne sont pas équipés pour subvenir au besoin de centaines de personnes durant plus d’une journée. Des milliers de personnes regagnent certes leur domicile lorsque les vents s’apaisent durant la matinée du 10 septembre, mais leur départ est compensé par l’arrivée de sinistrés des quartiers inondés. Mme Duminy affirme n’avoir rien mangé pendant deux jours au camp établi à l’hôtel de ville[41].
L’accès aux ressources de première nécessité est également une préoccupation constante hors des refuges. La Croix-Rouge ne possède qu’un seul centre de distribution de dons pour l’ensemble des sinistrés – qui se charge aussi de dons moins urgents tels que la distribution de fonds pour des meubles. Dans son témoignage, Lucille Duminy explique qu’elle doit s’y rendre à deux reprises avant d’obtenir une aide d’urgence, une fois avoir quitté l’hôtel de ville[42]. L’absence totale de distribution d’aide alimentaire au sein des quartiers noirs du Ninth Ward représente aussi un problème majeur pour ceux qui ne peuvent se rendre au centre. Lorsque des hommes sont enfin envoyés au sein du quartier pour distribuer de la nourriture, ils sont souvent équipés pour un affrontement avec de dangereux criminels plutôt que pour une simple mission humanitaire : dans le ghetto noir de Desire, par exemple, les cargaisons alimentaires sont envoyées seulement sous escorte armée, déplore le président de la branche locale du syndicat AFL-CIO A.P. Stoddard[43].
Les forces de l’ordre ne démontrent toutefois pas le même souci pour la sécurité générale des quartiers noirs. Le chef de police Joseph Giarusso déclare certes que ses hommes et la Garde nationale sont parvenus à contenir le pillage, mais les résidents de la zone inondée rapportent de nombreux actes de vol et de vandalisme, commis dans l’indifférence générale des forces policières. Le sentiment d’insécurité et d’abandon qu’éprouvent les résidents du Ninth Ward est ainsi exacerbé par des individus mal intentionnés libres d’agir en toute impunité[44].
La gestion insoutenable de la quarantaine de camps répartis à travers la ville incite les autorités à regrouper progressivement l’ensemble des réfugiés à un seul endroit : à la base de la marine américaine dans le quartier d’Algiers, sur l’autre rive du Mississippi[45]. Les besoins élémentaires sont certes comblés, mais l’insalubrité et la promiscuité font craindre une épidémie[46]. De plus, ce nouveau camp devient de facto ségrégué puisque le Lower Ninth Ward est alors, hormis quelques poches en milieux moins peuplés, le seul quartier toujours inondé : le Times-Picayune, qui ne se démarque pourtant pas par son engagement pour la cause des droits civiques, estime à 98 % la proportion de Noirs parmi la population du camp[47].
D’autres décisions de l’administration Schiro, prises sans considération pour la participation des Noirs ou pour leurs effets sur leur communauté, aggravent les tensions raciales.
Le matin du 10 septembre, le Sewerage and Water Board, l’office responsable notamment du réseau d’aqueducs et d’égouts et du drainage des inondations, bloque les canalisations qui pourraient permettre à l’eau amassée dans le Lower Ninth Ward de s’écouler vers le reste de la ville, au moment où le niveau est le plus élevé[48]. Cette solution logique pour contrôler l’étalement de l’inondation a cependant aussi pour effet de prolonger de plusieurs jours l’opération de pompage de l’eau. C’est ainsi que le 15 septembre, alors que presque toute la ville est asséchée et investie dans les opérations de nettoyage, le maire Schiro se rend dans le Lower Ninth Ward en compagnie de politiciens et de journalistes – à bord d’un véhicule amphibien. Les résidents de ce quartier ont donc le sentiment, une fois de plus, d’être traités comme des citoyens de second rang[49].
Le 15 septembre, la Ville attise davantage leur colère en prenant une décision à la légitimité contestable qui cible spécifiquement le Lower Ninth Ward. Prétextant des motifs de santé publique, Schiro place le quartier sous « conditions d’urgence », suivant l’ordre du directeur exécutif des services médicaux, le Dr Rodney C. Jung : les lieux sont bouclés par la police et la Garde nationale, et l’accès nécessite une autorisation préalable[50]. Cette autorisation, qui ne peut être obtenue qu’à un seul endroit, est accordée en échange d’empreintes digitales et sur présentation d’une preuve d’identité. Ainsi, non seulement cette pratique revient-elle à traiter les victimes comme des criminels, mais elle empêche également l’accès au quartier à quiconque n’a pu sauver de pièce justificative de l’inondation[51]. Dans un commentaire inscrit à la main sur un exemplaire du communiqué de police, l’adjoint au maire Jack McGuire dit considérer cette mesure comme le décret de la « loi martiale » : « Dennis Need to make clear we are in effect imposing martial law in the Lower 9th Ward[52]. » Une mesure qu’il réclamait avec insistance depuis le 10 septembre[53]. On peut raisonnablement douter de la validité de l’interprétation extrême que fait MacGuire des pouvoirs conférés par ce décret, jamais reconnu juridiquement ou historiquement comme une déclaration de loi martiale[54]. Le chef de police semble toutefois y voir un feu vert pour le recours à la force contre la population du Lower Ninth Ward, tel qu’il l’exprime dans sa réponse à une question sur les méthodes préconisées par ses policiers auprès de la population noire, une semaine après le décret : « The methods of a policeman at a time like this may appear uncontrolled and harsh, but they are the only ones a policeman can display[55]. »
Il est peu surprenant, dans un contexte aussi volatile, de voir proliférer des rumeurs préjudiciables à Schiro. La plus répandue – et potentiellement la plus nocive, considérant que les élections municipales du 6 novembre arrivent à grands pas – soutient que le maire, pour protéger les quartiers blancs et empêcher les Noirs d’exercer leur droite de vote, a ordonné le dynamitage des digues de l’Industrial Canal afin d’inonder le Lower Ninth Ward. Cette rumeur pourrait avoir plusieurs origines, la plus probable étant le dynamitage réel et volontaire de la digue de Caernarvon, en aval de La Nouvelle-Orléans, durant les inondations du fleuve Mississippi en 1927 : les paroisses rurales de St Bernard et Plaquemines avaient alors été englouties, sacrifiées afin de préserver la métropole[56]. Sans être véridiques, les allégations de dynamitage qui pèsent contre Schiro révèlent néanmoins la méfiance de la communauté noire envers les autorités politiques blanches qui, depuis de longues décennies, usent de leurs pouvoirs pour entraver le droit de vote et l’ascension sociale des Noirs[57].
La Maison-Blanche et les organisations noires demeurent en contact afin de lutter, autant que possible, contre la discrimination raciale. Dans un télégramme adressé à la Maison-Blanche le 13 septembre, le président du chapitre de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) à Baton Rouge, Murphy Bell, exhorte Johnson à intervenir pour contraindre le gouverneur John McKeithen à assurer l’équité raciale dans l’aide aux victimes[58]. Le même jour, deux hautes figures du Congress Of Racial Equality (CORE), le directeur associé George Wiley et le haut responsable des opérations de terrain Jerome Smith, décrivent la crise humanitaire qui prend forme dans le Ninth Ward à Lee White, conseiller spécial du président. Les brèves notes de White résument la situation avec lucidité : aide matérielle « délibérément retenue » ; marché noir de la glace, un produit essentiel à la préservation de la nourriture et au rafraîchissement en l’absence d’électricité ; fortes tensions en raison d’une rumeur voulant que l’inondation résulte d’une brèche volontaire des digues sur le « côté noir » de l’Industrial Canal (c’est-à-dire le Lower Ninth Ward) ; absence de nourriture menant à du « pillage réfléchi » (« level-headed looting »)[59].
Il est difficile de dire précisément comment et si Johnson, depuis Washington, a utilisé ces informations pour intervenir en faveur de l’équité raciale. Les choses semblent toutefois s’améliorer quelque peu pour les Noirs dans les jours suivants. Le 15 septembre, Schiro promet une meilleure distribution de denrées alimentaires pour les zones inondées, et s’engage à embaucher des sinistrés pour le nettoyage. Il demande également à deux conseillers municipaux de collaborer avec les représentants noirs afin de mieux disséminer, parmi la population afro-américaine, l’information concernant l’aide alimentaire et financière[60]. Buford Ellington rapporte que des représentants d’organisations noires visitent quotidiennement les camps de la Croix-Rouge, en plus de participer aux réunions du maire. « The racial situation seems to have been handled admirably », écrit-il à l’attention du président dans un rapport du 19 septembre[61].
Un projet de loi historique, mais imparfait
Alors que les Noirs continuent de lutter pour subvenir à leurs besoins au jour le jour, les élus s’affairent à dresser un projet de loi pour financer la reconstruction de la communauté.
La Nouvelle-Orléans dépend de l’assistance financière de la Small Business Administration (SBA) pour se reconstruire. Cette agence fédérale a le mandat de prêter des fonds pour réparer ou remplacer du matériel ou un bâtiment endommagé non assurable (comme dans le cas d’une inondation). Sans une subvention fédérale d’urgence, la SBA sera incapable de faire face au flot exceptionnel de demandes d’emprunts, qui totalisent des dizaines de millions de dollars. Privés d’aide financière, nombre de citoyens pourraient ne jamais amasser la somme requise pour reconstruire leur demeure ou leur commerce.
Inquiet pour le bien-être de ses citoyens, mais aussi pour ses chances de remporter les élections municipales du 6 novembre, Schiro presse Washington d’agir. Malgré plusieurs tentatives, le maire peine cependant à s’entretenir directement avec le président : outre une conversation téléphonique de deux minutes, le 15 septembre, les deux hommes n’entretiendront aucun contact direct dans les semaines après l’ouragan[62]. Johnson, selon les archives, préfère déléguer à Ellington la tâche de communiquer avec le maire. C’est donc la signature d’Ellington qui figure au bas des réponses aux correspondances que Schiro adresse au président[63]. Johnson fait montre du même désintérêt lorsque le maire se rend à Washington pour discuter, avec lui et des membres du Congrès, du projet de loi déposé au Sénat le 1er octobre visant à offrir une aide financière aux sinistrés. Le président indique clairement à son chef de cabinet non officiel, Marvin Watson, qu’il préfère à nouveau le référer à Ellington ou remettre la rencontre : « Prefer he see Ellington but I can’t say no to [Senator Russell] Long. Hold back until next week if possible 2 [weeks].[64] » Le Times-Picayune rapporte que Schiro a en fait assisté à cette rencontre du 2 octobre aux côtés du sénateur Long – une affirmation qui n’est pas corroborée par les archives de la Maison-Blanche[65].
Avant cette rencontre, le maire profite heureusement du soutien de Long, proche allié de Johnson. Les deux hommes, avec la collaboration de l’autre sénateur louisianais Allen Ellender, s’entendent d’avance sur le texte du projet de loi déposé par Long[66]. Cette législation garantirait à des milliers de victimes une aide financière sous la forme de l’annulation – dans les faits, un don – des premiers 5000 dollars d’une dette contractée auprès de la SBA pour des travaux de reconstruction dus à Betsy[67].
Des politiciens prônant le conservatisme fiscal menacent toutefois d’entraver cette proposition qu’ils considèrent comme trop dispendieuse. Or, leur soutien est crucial : les deux chambres doivent adopter par une majorité des deux tiers une dérogation aux procédures habituelles, ce qui accélérerait le processus législatif et permettrait la ratification du projet de loi avant la relâche hivernale. Sans cette mesure, la SBA et les États affectés devront attendre des mois avant d’obtenir le soutien tant attendu. Sans surprise, Edward Hébert[68], représentant ségrégationniste dont la circonscription comprend le Lower Ninth Ward, s’oppose à cette dérogation. Buford Ellington, directeur de l’OEP et ancien gouverneur républicain du Tennessee, dénonce lui aussi une intervention fédérale qu’il considère trop soutenue. En réponse à un texte de loi similaire alors en cours de rédaction et destiné à être présenté à la Chambre, Ellington écrit : « […] it was estimated that to carry out such a program it could cost the Treasury 200 to 300 million dollars. Certainly, we oppose such legislation and wanted you to know that we were “captives” in its drafting[69]. »
Déterminés à faire ratifier le projet de loi dès que possible, les partisans de l’interventionnisme fédéral parviennent à un compromis avec leurs opposants. Celui-ci prend la forme du Southeast Hurricane Disaster Relief Act (H. R. 11539), surnommé le Betsy Bill ou le Forgiveness Bill, déposé le 12 octobre à la Chambre par George H. Fallon, président du comité des travaux publics de la Chambre[70]. Une législation identique est proposée par l’ensemble de la délégation louisianaise à la Chambre – incluant Hébert[71] – et par les sénateurs de la Louisiane, du Mississippi et de la Floride[72]. Le montant maximal du pardon de la dette est réduit à 1800 dollars, moyennant une franchise de 500 dollars. Cette nouvelle proposition est nettement moins généreuse ; Long regrette en particulier l’inclusion d’une franchise qui, craint-il, pénalisera les non-propriétaires et les moins nantis[73]. Cette nouvelle version, certes édulcorée, promet toutefois d’être adoptée rapidement au Congrès et obtient le soutien officiel du président[74]. En privé, Ellington continue de douter des intentions des membres de la délégation louisianaise, et à craindre que les subventions aux particuliers prévues par ce projet de loi n’entraînent des dérives :
I would hope that the State of Louisiana is doing everything possible to place these people [rendered homeless by Betsy] in other accommodations. This I cannot personally guarantee. […] I am very much concerned that we might be opening up a door where the slightest loss from any person in the United States could bring a request to the Federal Government for direct assistance[75].
Au Congrès, les inquiétudes d’Ellington trouvent désormais peu d’écho. Le Betsy Bill est entériné de façon expéditive : le 18 octobre, les deux chambres votent en faveur de la dérogation afin d’accélérer le processus. La Chambre adopte la législation au simple vote oral. Le Sénat fixe quant à lui à 70 millions la somme mise à la disposition de la SBA, sans attendre le rapport du comité sénatorial chargé d’étudier la question. Le 8 novembre, seulement cinq semaines après avoir été déposé au Sénat, le Betsy Bill (P. L. 89-339) reçoit la signature du président[76].
Pendant que les politiciens au Congrès et à La Nouvelle-Orléans célèbrent le succès de cette initiative historique – et Schiro sa réélection à la mairie, deux jours plus tôt[77] – les Noirs, exclus du processus législatif, restent sur leur faim. Certains d’entre eux relèvent dans le Betsy Bill d’importantes lacunes qui limiteront ses retombées pour leur communauté. À l’instar de Long, ils redoutent que la franchise de 500 dollars exclue les moins nantis, en particulier les non-propriétaires, et maintienne injustement certains d’entre eux dans un statut de précarité. Pour obtenir un prêt de la SBA à un taux d’intérêt de 3 %, un requérant doit démontrer sa capacité à rembourser sa dette sur une période de 30 ans et l’impossibilité d’obtenir de l’assistance du privé. Or, le volume exceptionnel de demandes prolonge le traitement des dossiers par la SBA, ce qui alimente davantage l’incertitude pour les requérants les moins nantis. Après une attente de plusieurs semaines, nombre de personnes voient leur demande rejetée en raison de leur précarité financière : le système de prêts établi par le Betsy Bill nourrit ainsi un cercle vicieux dans lequel les plus pauvres, ayant logiquement un plus grand besoin de soutien financier, peinent à recevoir de l’aide précisément parce qu’ils sont les plus pauvres. D’ailleurs, ceux qui ont les moyens d’accéder à un prêt de la SBA le font souvent à contrecoeur, regrettant de devoir s’endetter pendant des décennies pour payer une autre hypothèque[78].
Ceux qui se voient refuser un prêt doivent ainsi se contenter de ce que donne la Croix-Rouge. L’OSBL offre argent et dons matériels aux sinistrés inéligibles au financement gouvernemental, incluant celui provenant de la SBA. Excédée par l’ampleur de la catastrophe, elle peine toutefois à combler même les besoins de première nécessité. De plus, elle souffre d’une réputation peu reluisante au sein de la communauté noire, qui perçoit souvent comme bureaucratiques et impersonnelles ses pratiques et ses politiques relatives au soutien au retour à domicile[79].
Ce fossé se creuse davantage lorsque la Croix-Rouge ferme son camp de sinistrés à la mi-octobre, malgré le fait que des centaines d’Afro-Américains y sont encore hébergés. Plusieurs d’entre eux écrivent à leurs représentants politiques pour déplorer le soutien dérisoire obtenu au moment de la fermeture. Totalement dépouillée par l’inondation du Lower Ninth Ward, Doris Alphonse s’adresse au président après n’avoir reçu que 160 dollars et deux matelas pour sa famille de huit personnes. Shirley Mae Portis, mère de quatre enfants, n’a droit qu’à deux matelas pour compenser ses pertes évaluées à 2500 dollars. Le cas de Willie Williams, un vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale, marié et père de douze enfants, illustre quant à lui les failles de la logique du système d’aide en place : privé de prêts par la SBA en raison d’une faillite passée, Williams doit emménager avec toute sa famille dans la petite résidence de sa mère, avec pour seule aide une quantité insuffisante de nourriture[80].
Face à cette situation intenable, la Ninth Ward Civic Improvement League (NWCIL), une organisation locale influente présidée par Leontine Luke (connue pour son implication dans la lutte pour l’intégration scolaire à La Nouvelle-Orléans), fait parvenir une pétition à la Maison-Blanche en décembre 1965. Ses signataires déplorent l’empressement de la Croix-Rouge à fermer ses camps et s’indignent que le Lower Ninth Ward, pourtant le quartier le plus durement touché, soit également le plus faible bénéficiaire d’aide gouvernementale et paragouvernementale[81].
Les pétitionnaires exigent également la tenue d’une enquête publique accessible sur les causes de l’inondation et l’adoption d’un système de protection visant à mitiger les dommages causés par un ouragan d’une force similaire à Betsy. Un sous-comité de la Chambre évaluant les conséquences matérielles et financières de Betsy a certes siégé en Louisiane à la fin septembre, mais n’a autorisé aucune intervention du public. Il s’est notamment intéressé aux causes de l’inondation et au projet d’amélioration du système de digues, adopté par le Congrès peu avant l’ouragan, mais grandement augmenté par la suite. Bien que les plans d’amélioration de l’Army Corps of Engineers prévoient une réelle protection pour tous les quartiers inondés, l’appel de la NWCIL révèle un manque de transparence et d’ouverture pour l’implication citoyenne dans le processus qui détermine la sécurité future de leur milieu de vie[82].
Les Betsy Flood Victims, un groupe de victimes du Lower Ninth Ward qui s’est constitué dans la base d’Algiers, dénoncent les failles inhérentes au système d’aide établi par le Betsy Bill, qui laisse au dépourvu les victimes ayant les besoins les plus criants à moyen et long terme. Dans une série de pétitions soumises aux politiciens fédéraux en 1965 et 1966, le groupe formule quatre demandes ambitieuses : l’annulation de l’hypothèque pour les personnes incapables de reconstruire leur demeure ; une compensation de 10 000 dollars pour chaque maison détruite par l’inondation ; un bureau fédéral pour contrôler le prix des loyers et assurer une aide alimentaire pour les personnes toujours dans le besoin ; une protection efficace contre les inondations dont les détails seront dévoilés et discutés lors d’une commission publique. Le groupe réitère ses demandes au mois de juillet 1966 alors que des audiences publiques d’une durée de trois jours se tiennent à Washington – audiences auxquelles les résidents du Lower Ninth Ward ne sont pas invités à témoigner[83]. Encore les autorités pourraient-elles au moins mener à terme l’opération de nettoyage du Lower Ninth Ward : en août 1966, certains endroits sont toujours jonchés de débris laissés par Betsy[84]. Tout indique que les pouvoirs politiques continueront de faire la sourde oreille aux appels de ces organisations citoyennes.
C’est alors que, subitement, Schiro commence à collaborer avec la communauté noire. Poussé par la promesse d’un financement fédéral massif, le maire dévoile un vaste projet de rénovation du Ninth Ward : dans le cadre du programme Urban Renewal, Washington doit assumer les deux tiers de la somme évaluée à 76 millions de dollars[85]. Peu après, le maire annonce même son intention de faire parvenir au Congrès une lettre soutenant les demandes des Betsy Flood Victims pour une commission d’enquête publique sur l’ouragan Betsy à La Nouvelle-Orléans[86]. Ces gestes font partie d’un ensemble de mesures visant à augmenter la participation des Noirs à l’administration municipale, mesure qui, ultimement, signalent la fin de leur exclusion en politique orléanaise[87]. Cette réalité, rendue possible grâce aux avancées législatives des droits civiques sous Johnson, est mise en évidence en 1978 par l’élection d’un premier Afro-Américain, Ernest « Dutch » Morial, à la mairie de La Nouvelle-Orléans.
Dans Betsy, les germes de Katrina
La visite exceptionnelle de Johnson à La Nouvelle-Orléans constitue encore, à ce jour, une réponse digne d’un grand président dans un contexte de catastrophe. D’abord envisagé comme un exercice de relations publiques, son déplacement s’est transformé en véritable incursion au coeur de la dévastation, lui offrant une occasion unique de démontrer – et ressentir – de l’empathie pour les sinistrés les plus vulnérables. Cette empathie s’est traduite notamment en une série d’efforts visant à concrétiser sa promesse d’éliminer les entraves au grand ménage de la ville.
Les retombées des mesures entreprises par l’administration Johnson peinent parfois à atteindre la communauté noire. À une époque marquée par de violentes émeutes raciales, la Maison-Blanche est naturellement préoccupée par l’état fragile des relations entre la communauté noire et les administrations locales blanches. Johnson et ses alliés au Congrès choisissent toutefois leurs batailles et estiment que celle d’une version plus généreuse du Betsy Bill est vouée à l’échec. Un choix réaliste reçu comme une gifle par les centaines de personnes qui tombent ainsi entre les mailles du filet.
Le Betsy Bill demeure néanmoins historique, pour son parcours exceptionnel au Congrès et la somme consentie aux victimes, mais aussi pour ses ramifications sur la philosophie guidant la réponse fédérale aux désastres. Conformément à la section 5 du texte de loi, le gouvernement entreprend d’explorer d’autres méthodes d’intervention à la suite des désastres[88]. Ce processus mènera à l’adoption, en novembre 1966, d’un projet de loi mettant fin à l’approche « au cas par cas » axée sur la seule réponse aux désastres, au profit d’une stratégie conférant à Washington un rôle systématique et prévisible auprès des communautés et des particuliers sur une période à long terme[89]. La réponse de Johnson, malgré quelques défauts, a ainsi pavé la voie à l’avènement d’un appareil gouvernemental mieux équipé pour faire face à des catastrophes majeures.
L’ouragan pousse également le Congrès à entériner un plan majeur de renforcement du réseau de digues à La Nouvelle-Orléans et dans les paroisses avoisinantes[90]. Prévue pour 1978, la fin de ce vaste projet est sans cesse retardée en raison de modifications techniques et de litiges concernant les expropriations et la protection de l’environnement. Les digues, maintenant plus élevées, peuvent retenir un plus grand niveau d’eau ; inversement, une brèche causerait un déversement plus important. Ces investissements en infrastructure permettent à La Nouvelle-Orléans de maintenir un sentiment de sécurité et de poursuivre son étalement urbain. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’assèchement des marécages et le développement des systèmes de drainage municipaux contribuent graduellement à l’enfoncement du sol : vers la fin du XXe siècle, certaines zones se situent à deux mètres sous le niveau de la mer[91].
Ces nouvelles structures en béton, érigées afin de protéger la région d’un ouragan d’une force similaire à Betsy, portent en elles les germes d’une autre catastrophe. Le 29 août 2005, Katrina, un ouragan plus puissant que Betsy, sème la destruction sur les côtes du Golfe du Mexique : plus de 1500 personnes périssent en Louisiane et plusieurs dizaines de milliards de dollars de dommages sont rapportés[92]. 80 % de la surface de La Nouvelle-Orléans est inondée en raison d’innombrables brèches et débordements survenant dans l’ensemble de son réseau hydrologique. Le Lower Ninth Ward, depuis longtemps remis de Betsy, est cette fois englouti sous cinq mètres d’eau par endroits. Le maire Ray Nagin, un Afro-Américain, est malmené pour avoir tardé à ordonner l’évacuation, condamnant à l’état de survie 90 000 personnes (la majorité noire). La réponse de l’administration de George W. Bush n’est guère meilleure : le président républicain patientera cinq jours avant de se rendre en Louisiane, pour une visite qui a toutes les allures d’un exercice de relations publiques. La Federal Emergency Management Agency (FEMA), successeure de l’Office of Emergency Planning, est vilipendée pour sa gestion apathique de la crise et ses politiques qui multiplient, au lieu de réduire, les contraintes bureaucratiques[93]. Plutôt que de désavouer le directeur de la FEMA Michael Brown, le président s’attire les foudres en prononçant devant les caméras une phrase devenue tristement célèbre : « ‘Brownie’, you’re doing a heck of a job »[94]. La population afro-orléanaise peinera à se remettre de cette catastrophe, chutant de 118 000 entre les recensements de 2000 et 2010[95]. La consternante déconnexion affichée par l’administration Bush fut ainsi aux antipodes de l’attitude de Johnson qui, des décennies plus tard, demeure une référence en matière de réponse aux désastres.
Appendices
Notes
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[1]
Edward F. Haas, « The Hurricane Mayor », dans Mayor Victor H. Schiro : New Orleans in Transition, 1961-1970, Jackson, MS, University Press of Mississippi, 2014, p. 228.
-
[2]
L’inondation couvrira une majeure partie du Ninth Ward, ainsi qu’une partie du Eighth Ward et du Seventh Ward, situés à l’ouest du Ninth Ward. Voir Richard Campanella, Bienville’s Dilemma : A Historical Geography of New Orleans, Lafayette, LA, Center for Louisiana Studies, 2008, p. 321-323.
-
[3]
Le Louisiana Weekly estime que les Noirs représentent entre 75 % et 80 % des personnes tuées en Louisiane. Une proportion corroborée par la recension quotidienne des morts dans le Times-Picayune. John E. Rousseau, « 25,000 Homeless Being Cared For In Many Evacuation Centers », Louisiana Weekly, 18 septembre 1965, section 1, p. 1. Pour le compte des personnes décédées, voir aussi « List of Persons Reported as Missing is Released », Times-Picayune, 15 septembre 1965, section 3, p. 18 ; « Casualty List », Times-Picayune, 16 septembre 1965, Section 1, p. 1 ; « Coroner’s Office Issues New Report of Missing », Times-Picayune, 16 septembre 1965, section 1, p. 4.
-
[4]
Lors du recensement de 1960, la population blanche représentait 26 % des 29 473 résidents du Lower Ninth Ward, principalement concentrée dans quelques zones du quartier. Cette proportion n’est plus que de 14 % en 1970. Voir United States Census Bureau, U.S. Censuses of Population and Housing : 1960 Census Tracts, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1961 ; Id., U.S. Censuses of Population and Housing : 1970 Census Tracts, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1971.
-
[5]
Andy Horowitz, « Hurricane Betsy and the Politics of Disaster in New Orleans’s Lower Ninth Ward, 1965-1967 », Journal of Southern History, vol. 80, no 4, novembre 2014, p. 899-901 ; Kent Germany, New Orleans After the Promises : Poverty, Citizenship, and the Search for the Great Society, Athens, GA, University of Georgia Press, 2007, p. 24-25 et 68-69 ; « Lower Ninth Ward Eligible for “Face-Lifting” Federal Funds », Louisiana Weekly, 5 février 1966, section 1, p. 1 et 7.
-
[6]
Richard Campanella, op. cit., p. 321-323.
-
[7]
Bibliothèque Lyndon Baines Johnson, « President Johnson’s Remarks Upon Departure of New Orleans to Washington, DC », 10 septembre 1965.
-
[8]
La somme d’un milliard est notamment évoquée dans un rapport de la Croix-Rouge, cité lors d’une étude d’un sous-comité de la Chambre des représentants en septembre 1965. Un comité de la Chambre des représentants, le mois suivant, évalue la somme à 782 millions de dollars uniquement pour la Louisiane. Aucun consensus n’existe dans l’historiographie sur le montant réel des dommages. United States House of Representatives, Hearings Before the Special Subcommittee to Investigate Areas of Destruction of Hurricane Betsy, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1965, p. 111 ; Id., Report of the Special Subcommittee to Investigate Areas of Destruction of Hurricane Betsy of the Committee on Public Works, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, octobre 1965, p. 6.
-
[9]
Au moment de Betsy, les émeutes de Watts étaient les plus récentes à avoir secoué les États-Unis. Le bilan à Watts est lourd : 34 morts, des centaines de blessés, 40 millions de dollars de dommages, et des milliers d’arrestations. Voir Gerald Horne, Fire This Time : The Watts Uprising and the 1960s, Charlottesville, VA, University of Virginia Press, 1995, 443 p.
-
[10]
Edward F. Haas, « The Expedient of Race Victor H. Schiro, Scott Wilson, and the New Orleans Mayoralty Campaign of 1962 », Louisiana History, vol. 42, no 1, hiver 2001, p. 16-29.
-
[11]
Edward F. Haas, « Victor H. Schiro, Hurricane Betsy, and the “Forgiveness Bill” », Gulf Coast Historical Review, vol. 6, no 3, automne 1990, p. 67-90. Cet article a été réédité pour un recueil d’articles de l’historien portant sur le maire Schiro : voir Edward F. Haas, « The Hurricane Mayor », loc.cit., p. 225-245.
-
[12]
Kent Germany, op. cit., 460 p.
-
[13]
Andy Horowitz, « Hurricane Betsy and the Politics of Disaster… », loc.cit.
-
[14]
Dans le cadre de nos recherches, nous avons examiné deux fonds d’archives de la bibliothèque LBJ. Dans le premier, Papers of Lyndon B. Johnson : Presidential Papers, nous nous sommes intéressés aux collections White House Central Files, 1963-1969 (identifiées désormais par l’acronyme WHCF) ; Office Files of the White House Aides ; et Special Files, 1927-1973. Le deuxième, Lyndon B. Johnson’s Daily Diary Collection, est une compilation du carnet de bord quotidien du président, rédigé par ses secrétaires, comprenant l’horaire quotidien du président et quelques commentaires sur ses activités, voir www.lbjlibrary.net.
-
[15]
Voir par exemple Douglas Brinkley, The Great Deluge : Hurricane Katrina, New Orleans, and the Mississippi Gulf Coast, New York, HarperCollins, 2007, p. 340 et 407-408 ; Jed Horne, Breach of Faith : Hurricane Katrina and the Near Death of a Great American City, New York, Random House, 2008, p. 83.
-
[16]
Brian Williams, « L. B. J.’s Political Hurricane », New York Times, 24 septembre 2005, p. A 15.
-
[17]
Long, qui n’a pas été témoin de l’ouragan, se trompe en affirmant que l’inondation s’est déclenchée à partir du lac Pontchartrain. Celle-ci s’est plutôt déclenchée depuis les canaux de navigation à l’est de la ville, principalement en raison de reflux des ondes de tempête dans le Mississippi River-Gulf Outlet Canal (MR-GO), menant ensuite à des brèches et des débordements des digues dans l’Intracoastal Waterway et l’Industrial Canal. Pour une explication détaillée, voir par exemple Richard Campanella, op. cit., p. 321-323.
-
[18]
Miller Center, « Conversation with Russell Long », Université de Virginie, Secret White House Tapes, 10 septembre 1965, enregistrement audio, en ligne : <https://millercenter.org/the-presidency/secret-white-house-tapes/conversation-russell-long-september-10-1965>. [Consulté le 29 juillet 2018] ; Id., « Conversation with Buford Ellington and Marvin Watson », Ibid., 10 septembre 1965, enregistrement audio, en ligne : <https://millercenter.org/the-presidency/secret-white-house-tapes/conversation-buford-ellington-and-marvin-watson-september>. [Consulté le 29 juillet 2018].
-
[19]
La secrétaire de Johnson inscrit dans le carnet de bord : « Most of the people inside and outside of the building were Negro. » Voir Bibliothèque LBJ, Daily Diary, 10 septembre 1965, p. 8.
-
[20]
« Johnson Visits City, Promises Swift Help », Times-Picayune, Section 1, p. 1 et 3 ; Edward F. Haas, « The Hurricane Mayor », loc.cit., p. 230.
-
[21]
Bibliothèque LBJ, Daily Diary, 10 septembre 1965, p. 8-9.
-
[22]
Bibliothèque LBJ, WHCF, DI, Boîte 13, Mémo de Buford Ellington au président Johnson, 11 septembre 1965 ; Id., Daily Diary, 10 septembre 1965, p. 8-9
-
[23]
Bibliothèque LBJ, Daily Diary, 10 septembre 1965, p. 8-9 ; Id., « President Johnson Speaks to the Media Prior to Departure for Baton Rouge », 10 septembre 1965, en ligne : <http://www.lbjlibrary.net/collections/quick-facts/lyndon-baines-johnson-hurricane-betsy/lbj-new-orleans-hurricane-betsy.html>. [Consulté le 15 janvier 2017].
-
[24]
Voir, par exemple, Bibliothèque LBJ, WHCF, DI, Boîte 13, Mémo de Buford Ellington au président Johnson, 19 septembre 1965 ; Miller Center, « Conversation with Robert Phillips, Marvin Watson and Russell Long », Secret White House Tapes, 14 septembre 1965, enregistrement audio, en ligne : millercenter.org
-
[25]
Miller Center, « Conversation with Philipps, Watson and Long », loc.cit. [La transcription est la nôtre].
-
[26]
Ibid.
-
[27]
United States House, Hearings Before the Special Subcommittee…, op. cit., p. 44.
-
[28]
United States Army Corps of Engineers New Orleans District, After Action Report on Hurricane Betsy, 8-11 September 1965, Nouvelle-Orléans, U. S. Government Printing Office, p. 15, Exhibit 6-1, 6-2.
-
[29]
Richard Campanella rappelle qu’à l’époque, la notion « d’évacuation » à La Nouvelle-Orléans signifiait le déplacement de personnes de zones ciblées vers des structures plus robustes, et non l’évacuation hors de la municipalité. Voir Richard Campanella, op. cit., p. 322.
-
[30]
« Hurricane Advisory », Times-Picayune, 10 septembre 1965, section 1, p. 1, 3.
-
[31]
Selon Lucille Duminy, une résidente du Lower Ninth Ward, le quartier avait commencé depuis peu à être inondé lorsqu’elle a entendu l’appel de la Garde nationale. Nilima Mwendo, Lucille Duminy Oral History Interview : Session I, Baton Rouge, LA, T. Harry Williams Center for Oral History Floods, Storms and Levee Breaks, 20 novembre 2003, p. 14-16.
-
[32]
Ce constat s’applique à l’ensemble des autorités compétentes. « 9th Warders All Agree : No Evacuation Warning Given for Area », Louisiana Weekly, 25 septembre 1965, section 1, p. 1, 9 ; « Letter to the Editor », Louisiana Weekly, 25 septembre 1965, section 2, p. 4 ; Thomas Forrest, Hurricane Betsy, 1965 : A Selective Analysis of Organizational Response in the New Orleans Area, Delaware, Disaster Research Center of the University of Delaware, Historical and Comparative Disaster Series #5, 1979, p. 28 ; Edward F. Haas, « The Hurricane Mayor », loc.cit., p. 233.
-
[33]
Plus précisément, Teller, une figure bien connue en raison de son rôle dans le développement de la bombe à hydrogène, critique l’administration Schiro et la New Orleans Civil Defense (NOCD). Voir « 9th Warders All Agree : No Evacuation Warning Given for Area », Louisiana Weekly, 25 septembre 1965, section 1, p. 1 et 9.
-
[34]
Ibid., « Letter to the Editor », Louisiana Weekly, 25 septembre 1965, section 2, p. 4 ; Thomas Forrest, op. cit., p. 28 ; Edward F. Haas, « The Hurricane Mayor », loc.cit., p. 233. Voir aussi Nilima Mwendo, Duminy Interview, Session I, op. cit., p.14-15.
-
[35]
Edward F. Haas, « The Hurricane Mayor », loc.cit., p. 232-234 ; James H. Gillis, « Flood Barrier, M’Keithen Aim », Times-Picayune, 15 septembre 1965, section 1, p. 1 ; « McKeithen Hits Teller’s Claims », Times-Picayune, 16 septembre 1965, section 2, p. 23.
-
[36]
Ces quelques phrases ne sont que les faits saillants de l’article. Stanley Taylor, « Hebert Strongly Disagrees with Dr. Teller’s Charges », Louisiana Weekly, 25 septembre 1965, section 1, p. 7.
-
[37]
Branche locale du département national de l’Office of Civil Defense, la NOCD est chargée de planifier et de coordonner la réponse locale à des désastres.
-
[38]
« Teller Charges Bring Retort », Times-Picayune, 16 septembre 1965, section 2, p. 23.
-
[39]
Nilima Mwendo, Lucille Duminy Oral History Interview : Session II, Baton Rouge, LA, T. Harry Williams Center for Oral History Floods, Storms and Levee Breaks, 20 novembre 2003, p. 5. L’école McCarty est aujourd’hui connue sous le nom d’école Martin Luther King Jr.
-
[40]
Nilima Mwendo, Lucille Duminy Oral History Interview : Session I, op. cit., November 19, 2003, p. 21-24.
-
[41]
Ibid., p. 25.
-
[42]
Ibid., p. 31-32.
-
[43]
« Negroes to Get Emergency Aid », Times-Picayune, 16 septembre 1965, section 2, p. 22 ; Bibliothèque LBJ, Office Files of the White House Aides, Files of Lee White, Boîte 6, Notes personnelles, 13 septembre 1965.
-
[44]
« National Guard Aid Asked to Protect from Looters », Times-Picayune, 11 septembre 1965, section 1, p. 13 ; « Looting Held to Minimum by Police, Army, Guard », Times-Picayune, 12 septembre 1965, section 5, p. 14 ; John Rousseau, « Looters, Freeloaders Have Field Day in Aftermath of Hurricane », Louisiana Weekly, 25 septembre 1965, section 1, p. 3.
-
[45]
Le camp à la base d’Algiers ouvre officiellement le matin du 12 septembre. Thomas Forrest, op. cit., p. 9, 74 et 84.
-
[46]
Podine Schoenberger, « Refugees Due Disease Check », Times-Picayune, 12 septembre 1965, section 1, p. 1 et 15 ; Idem, « Close Quarters Health Hazard ; Appeal Issued », Times-Picayune, 14 septembre 1965, section 1, p. 11.
-
[47]
Don Hughes, « Storm Refugees Formed into Bustling Community », Times-Picayune, 16 septembre 1965, section 1, p. 4.
-
[48]
Thomas Forrest, op. cit., p. 9
-
[49]
La date exacte de l’assèchement total du Lower Ninth Ward ne semble pas rapportée par les médias. Toutefois, le procès-verbal d’une rencontre entre le maire et les départements municipaux tenue le 24 septembre indique « qu’il reste une poche d’eau considérable » à l’est de l’Industrial Canal. Voir Joe Darby, « Cruel Betsy Blew Water Into Area ; It’s Still Here », Times-Picayune, 16 septembre 1965, section 1, p. 5 ; Andy Horowitz, loc.cit., p. 914-915 et 921.
-
[50]
Don Lee Keith, « Police Shut Broad Area », Times-Picayune, 16 septembre 1965, section 1, p. 1.
-
[51]
Lucille Duminy exprime notamment le sentiment d’être traitée comme une criminelle lorsqu’elle visite sa maison le 17 septembre. Voir Nilima Mwendo, Lucille Duminy, Session II, op. cit., p. 21-22. Pour le décret, voir « Big Areas of N.O. Under ‘Emergency Conditions’ », Times-Picayune, 16 septembre 1965, section 1, p. 6.
-
[52]
La note sur le communiqué est adressée à Dennis Lacey, assistant exécutif du maire. Voir Bibliothèque Howard-Tilton Memorial, 1001 - Schiro, Victor H. (Victor Hugo), 1904-1992, Tulane University Special Collections, Boîte 9, Communiqué de la police de La Nouvelle-Orléans, 15 septembre 1965.
-
[53]
Ibid., Mémo de Jack McGuire à Victor Schiro, 10 septembre 1965.
-
[54]
Nos recherches n’offrent aucune preuve indiquant qu’il s’agissait d’un réel décret de loi martiale, et cette thèse n’est soutenue par aucun historien. Cette note est toutefois un puissant indice des tensions raciales au sommet de la crise, et de l’attitude prônée par le bras droit du maire face aux habitants du Lower Ninth Ward.
-
[55]
Stanley Taylor, « Hebert Strongly Disagrees with Dr. Teller’s Charges », Louisiana Weekly, 25 septembre 1965, section 1, p. 7.
-
[56]
Pour l’histoire détaillée du dynamitage de la digue de Caernarvon, voir John Barry, Rising Tide : The Great Mississippi Flood of 1927 and How it Changed America, New York, Simon & Schuster, 1997, p. 238-258.
-
[57]
L’interprétation de l’origine et de la signification de la rumeur du dynamitage est la nôtre. Pour un survol des rumeurs dirigées contre Schiro, voir Edward F. Haas, « “Don’t Believe any False Rumors” : Mayor Victor H. Schiro, Hurricane Betsy, and Urban Myths », Louisiana History, vol. 45, no 4, automne 2004, p. 464-466.
-
[58]
Baton Rouge a aussi été balayée par Betsy. L’appel de Bell ne mentionne pas le cas spécifique de La Nouvelle-Orléans, mais cible néanmoins l’iniquité dont fait preuve le gouverneur McKeithen à l’échelle de l’État. Bibliothèque LBJ, WHCF, DI, Boîte 15, Télégramme de Murphy Bell au président Johnson, 13 septembre 1965.
-
[59]
Bibliothèque LBJ, Office Files of the White House Aides, Files of Lee White, Boîte 6, Notes personnelles, 13 septembre 1965.
-
[60]
« Negroes to Get Emergency Aid », Times-Picayune, 16 septembre 1965, section 2, p. 22 ; « NAACP to Concentrate on Hurricane Victims », Louisiana Weekly, 25 septembre 1965, section 1, p. 1 et 3.
-
[61]
Le ton utilisé par Ellington est plutôt emphatique, mais il révèle néanmoins une certaine amélioration des relations raciales, ainsi que l’intérêt de l’administration Johnson pour cette question. Bibliothèque LBJ, WHCF, DI, Boîte 13, Rapport de Buford Ellington au président Johnson, 19 septembre 1965, p. 3.
-
[62]
Le carnet de bord du président (Daily Diary) révèle un seul court appel de Schiro à Johnson, le 15 septembre.
-
[63]
Dans les dossiers du maire Schiro, deux réponses aux lettres adressées à Johnson sont signées par Ellington. Une troisième lettre du maire, du 6 octobre, est rédigée à l’intention d’Ellington. Aucune ne contient la signature de Johnson. Voir Bibliothèque H.-T., Schiro papers, Series 1 : General Files, Boîte 9, Dossier 30.
-
[64]
Les mots entre crochets sont ajoutés pour la clarté. Voir Bibliothèque LBJ, Special Files, 1927-1973, President’s Night Readings, Boîte 2, 30 septembre 1965, p. 1-2.
-
[65]
Dans un article du 3 octobre, le Times-Picayune affirme que Schiro s’est réuni avec Johnson et Long pour discuter du projet de loi déposé par Russell Long. Cependant, son nom n’apparaît pas dans le carnet de bord du président (Daily Diary) pour le 2 octobre 1965. Il n’est toutefois pas impossible, malgré l’absence de preuves documentaires, que Schiro ait participé à la rencontre sans que son nom soit inscrit au registre. Voir « Loan Hope Good, Schiro States », Times-Picayune, 3 octobre 1965, p. 1 et 3 ; Bibliothèque LBJ, Daily Diary, 2 octobre 1965, p. 7.
-
[66]
Sur une copie du projet de loi S. 2591 figurant dans les dossiers de Schiro, Long a inscrit : « Vic : This is the bill that we agreed to push. Wish us luck ! Russell ». Voir Bibliothèque H.-T., Schiro papers, Series 1 : General Files, Boîte 9, Dossier 29.
-
[67]
Edgar Poe, « Long to Urge Aid Plan », Times-Picayune, 1er octobre 1965, Section 1, p. 1 ; « Long Asks Help for Uninsured », Times-Picayune, 2 octobre 1965, section 1, p. 1 et 12.
-
[68]
Jack McGuire affirme que le maire avait d’abord approché le représentant Hale Boggs pour faire déposer une première version du Betsy Bill à la Chambre ; Boggs aurait refusé, mentionnant explicitement qu’il redoutait l’opposition de Hébert. C’est alors que Schiro aurait approché le sénateur Long. Voir Bibliothèque H.-T., Schiro Papers, Lettre de Jack McGuire à Edward F. Haas, Boîte 9, Dossier 31, 6 janvier 1997, p. 3. Pour l’opposition de Hébert, voir aussi « Levees Will Be Restored in St. Bernard – Rep. Hebert », Times-Picayune, 5 octobre 1965, section 3, p. 3.
-
[69]
Bibliothèque LBJ, WHCF, DI, Boîte 13, Mémo de Buford Ellington au président Johnson, 29 septembre 1965.
-
[70]
United States Congress, Congressional Record, 89th Congress, vol. 3, pt. 20, p. 26810-11.
-
[71]
Devant le comité d’étude de la Chambre sur ce projet de loi, Hébert justifie son changement de position par le fait que la législation existante ne permettait pas l’aide individuelle, mais « qu’une telle législation aurait dû être adoptée depuis longtemps ». United States House of Representatives, Hearing of the Committee on Public Works, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 13 octobre 1965, p. 15-17.
-
[72]
Edgar Poe, « Speedy House Action is Aim on Storm Aid », Times-Picayune, 12 octobre 1965, section 1, p. 1.
-
[73]
U. S. House, Hearing of the Committee on Public Works, op. cit., p. 11-15.
-
[74]
Edgar Poe, « Speedy House Action is Aim on Storm Aid », Times-Picayune, 12 octobre 1965, section 1, p. 1.
-
[75]
Bibliothèque LBJ, WHCF, LE, Boîte 35, Mémo de Buford Ellington à Lyndon Johnson, 11 octobre 1965.
-
[76]
« Johnson Signs Betsy Aid Bill », Times-Picayune, 9 novembre 1965, section 1, p. 1 ; Edward F. Haas, « The Hurricane Mayor », loc.cit., p. 245.
-
[77]
Schiro remporte de justesse l’élection au premier tour avec 50,1 % des voix, devant James Fitzmorris qui récolte 48,1 %. Schiro amasse environ 40 % du suffrage afro-américain. Voir « Mayor Schiro Winner On Unofficial Tally », Times-Picayune, 8 novembre 1965, section 1, p. 1-2 ; Stanley Taylor, « Mayor Schiro Takes Note of Independent Negro Vote », Louisiana Weekly, 20 novembre 1965, section 1, p. 2.
-
[78]
Les Betsy Flood Victims figurent parmi les groupes à dénoncer le plus ouvertement l’iniquité pour les plus pauvres et l’offre de prêts à long terme au lieu de dons. Voir Andy Horowitz, loc.cit., p. 895-896, 924-925, 928 et 931.
-
[79]
Thomas Forrest, op. cit., p. 71.
-
[80]
Bibliothèque LBJ, WHCF, DI, Boîte 15, 9 décembre 1965 ; Id., WHCF, LE, Boîte 35, 16 octobre 1965 ; « Refugee Family Sends Telegram to President Johnson for Help », Louisiana Weekly, 30 octobre 1965, section 1, p. 1 et 4.
-
[81]
Bibliothèque LBJ, WHCF, DI, Boîte 1, Pétition de Leontine G. Luke au président Johnson, 13 décembre 1965.
-
[82]
U. S. House, Hearings Before the Special Subcommittee, op. cit., p. 40-44 ; Richard Campanella, op. cit., p. 322.
-
[83]
Andy Horowitz, loc.cit., p. 924 ; « “Betsy Flood Victims” Want More Federal Aid », Louisiana Weekly, 12 février 1966, section 1, p. 5 ; « “Betsy Flood Victims” Pushing Petition for More Federal Aid », Louisiana Weekly, 26 février 1966, section 1, p. 3 ; « Betsy Flood Victims Ask for Open Hearings in N.O. », Louisiana Weekly, 16 juillet 1966, section 1, p. 2 ; « Betsy Flood Victims Again Ask for Open Hearings in N.O. », Louisiana Weekly, 30 juillet 1966, section 1, p. 1, 7.
-
[84]
Les opérations de nettoyage se sont conclues à la fin janvier, malgré les plaintes des résidents du Lower Ninth Ward arguant que le travail ne fût pas terminé. « 9th Ward Residents Alert Mayor to “Debris Problem” », Louisiana Weekly, 29 janvier 1966, section 1, p. 1 et 8 ; Bob Caffrey. « Ninth Ward Improvements Promised », Louisiana Weekly, 13 août 1966, section 1, p. 3.
-
[85]
Le programme tardera à prendre son envol en raison de l’obstruction du gouverneur McKeithen, qui a le pouvoir d’interdire le fédéral de financer la construction ou la rénovation d’infrastructures municipales. La pression des administrations Schiro et Johnson ainsi que celle d’organisations citoyennes ouvrira finalement une brèche dans l’intransigeance de McKeithen en 1968. Kent Germany, op. cit., p. 186-189 ; « Lack of Urban Renewal “Powers” Kills 9th Ward Improvement Plan », Louisiana Weekly, 24 décembre 1966, section 1, p. 1 et 8.
-
[86]
« Mayor Schiro Presents 9th Ward St. Improvement Plans », Louisiana Weekly, 13 août 1966, section 1, p. 1, 3 ; « Mayor Schiro to Act for Betsy Victims », Louisiana Weekly, 3 septembre 1966, section 1, p. 1, 8.
-
[87]
Schiro nomme deux Afro-Américains à des postes de haute fonction (une mesure considérée par plusieurs, au départ, comme étant avant tout symbolique) : A. M. Trudeau à titre de procureur général adjoint en janvier 1966 et Philip Batiste au conseil exécutif en mai 1966. Il met également sur pied en 1967 un comité consultatif biracial visant à trouver des solutions à la discrimination raciale. « Trudeau is Choice of Mayor Schiro », Louisiana Weekly, 1er janvier 1966, section 1, p. 1. Pour la nomination de Batiste, voir « Mayor Victor H. Schiro (1961-1970) », en ligne : leh.org. Pour le comité, voir Kent Germany, op. cit., p.135-136 et 144-145.
-
[88]
U.S. Congress, United States Statutes At Large (1965), Washington, D.C., Government Printing Office, Vol. 79, 1966, p. 1301-1302.
-
[89]
Cette réforme prend la forme du Disaster Relief Act de 1966, une version amendée de la loi en vigueur depuis 1950. Cette loi a depuis été modifiée à plusieurs reprises. Id., United States Statutes At Large (1966), Washington, DC, Government Printing Office, Vol. 80, p. 1316-1321. Pour un résumé de l’évolution de la législation concernant la réponse aux désastres, voir Anna Marie Baca, « History of Disaster Legislation », On Call, Washington, DC, septembre 2008, p. 1 et 3.
-
[90]
Entériné peu avant Betsy, le projet est élargi et bonifié après le passage de l’ouragan.
-
[91]
Richard Campanella, op. cit., annexes p. 36.
-
[92]
CNN, citant FEMA, estime le nombre de morts à 1833 pour l’ensemble du pays, dont 1577 en Louisiane. Ces estimations varient grandement d’une source à une autre. Voir CNN, « Hurricane Katrina Statistics Fast Facts », 28 août 2017, en ligne : <https://www.cnn.com/2013/08/23/us/hurricane-katrina-statistics-fast-facts/index.html>. [Consulté le 1er août 2018].
-
[93]
Voir par exemple Douglas Brinkley, The Great Deluge : Hurricane Katrina, New Orleans, and the Mississippi Gulf Coast, New York, HarperCollins, 2007, p. 340 et 407-408 ; Jed Horne, Breach of Faith : Hurricane Katrina and the Near Death of a Great American City, New York, Random House, 2008, p. 83. Pour une carte détaillée de l’inondation, voir Richard Campanella, op. cit., annexes p. 45.
-
[94]
Les images captées en direct à Mobile, en Alabama, sont disponibles en ligne sur la chaîne C-SPAN : www.c-span.org/video/?c4548480/katrina-10-years-later-brownie-heck-job.
-
[95]
Michelle Krupa, « New Orleans’ official 2010 census population is 343,829, agency reports », Times-Picayune, 3 février 2011, en ligne : nola.com.