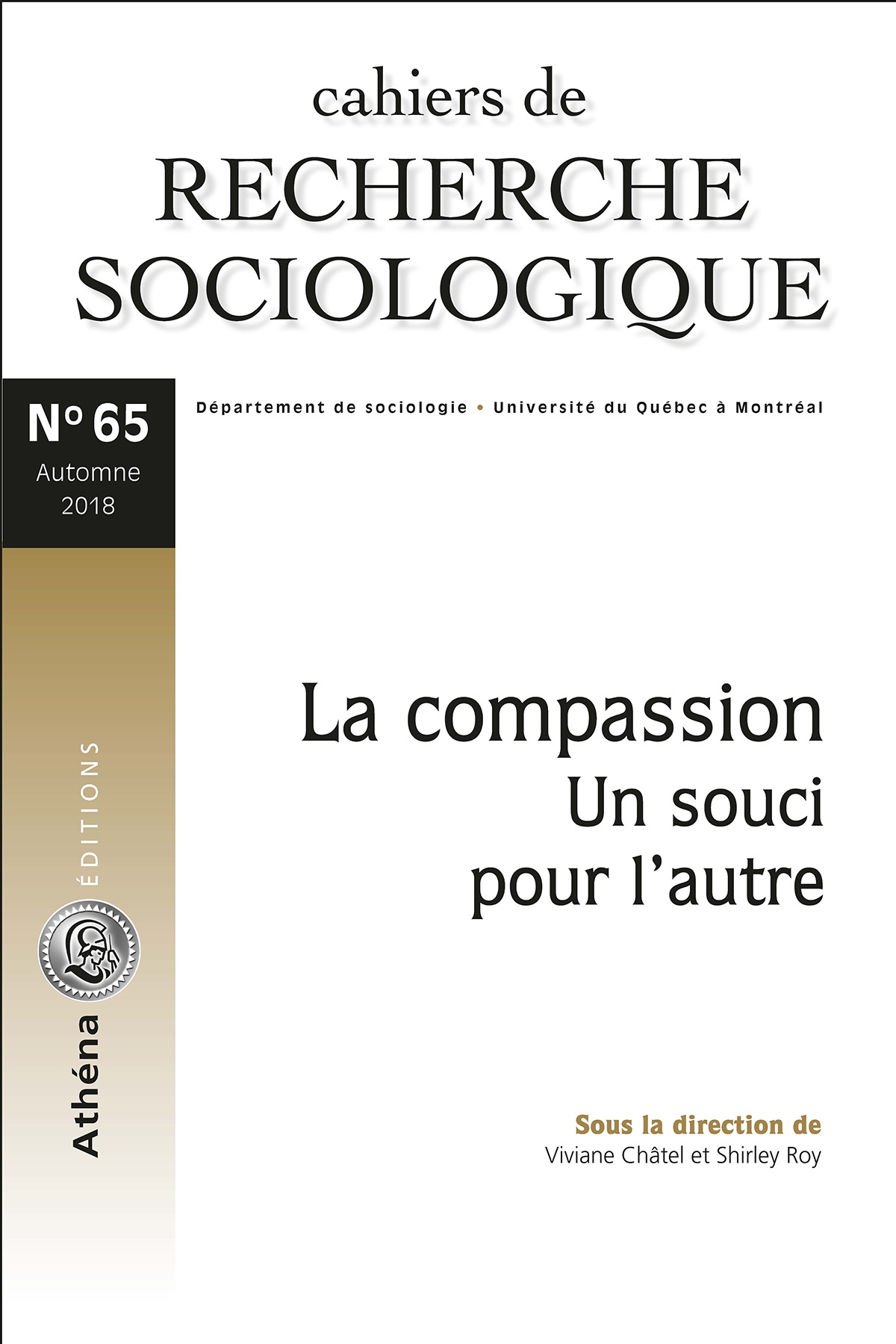Article body
Le pari de ce numéro des Cahiers de recherche sociologique sur le thème de la compassion est d’ouvrir le débat sur ce terme équivoque comme transcription d’un monde contemporain tourné vers l’autre et soucieux de l’Autre.
Les images de guerres, de catastrophes naturelles, de famines qui nous arrivent en temps réel de toutes les parties du monde (même si les faits nous contraignent à être plus circonspects sur cette idée d’un partage à l’échelle globale des événements, des idées et des catastrophes)[1], ont développé et développent un fort sentiment compassionnel. Comme l’écrit Paul Ricoeur, la souffrance « affecte et désorganise […] le rapport à soi-même en tant que porteur d’une variété de pouvoirs et aussi d’une multiplicité de relations avec d’autres êtres[2]… », mais elle affecte (ou non d’ailleurs), avec plus ou moins de force, les spectateurs et spectatrices de cette souffrance, qu’elle soit le fruit de la maladie, d’une catastrophe naturelle ou de ce que les êtres humains sont capables d’infliger à leurs semblables.
Cette question est d’autant plus pertinente en cette période de pandémie mondiale de la Covid-19. Bien que n’ayant pas été préparé dans ce contexte, ce numéro rencontre de manière quelque peu brutale l’actualité d’une catastrophe annoncée (depuis, au moins, l’épidémie de H1N1). Si nous pouvons certes y voir l’occasion d’une compassion généralisée, d’un souci, enfin marqué, pour ceux et celles qui prennent soin, certains indices signalent, au contraire, le rejet, la stigmatisation voire l’hostilité dans certains lieux, montrant par là même que sécurité, liberté et compassion ne font pas toujours bon ménage.
L’être humain aime la catastrophe, il s’en repaît même, diraient certains. Ambrose Gwinnett Bierce écrivait ainsi, dès 1906, dans son fameux Dictionnaire du diable que « le bonheur est une sensation que nous éprouvons au spectacle du malheur d’autrui[3] ». Faut-il voir, dans la compassion, la volonté de se repaître du malheur d’autrui ? Sans doute pas, et nous n’irons pas jusqu’à cette lecture audacieuse. Cependant, nous pouvons postuler ici quelques évidences tant la compassion, bien que clairement affichée et revendiquée, s’est révélée, in fine, plutôt inopérante quant aux modifications des pratiques et des politiques.
La question essentielle, qui alimente notamment le monde journalistique[4], dépasse celle de la frontière entre voyeurisme et témoignage, pour rejoindre celle de l’utilité, celle de l’efficace de ces photos et de ces reportages sur les désastres humains pour amener une prise de conscience généralisée. Comme l’exprimait le photo-journaliste Patrick Chauvel en 2013 : « La photo empêche de dire “on ne savait pas”, aujourd’hui, on peut juste dire “je ne veux pas savoir”[5]. » Cette dernière formule valide en tout point le constat fait, en 2013, par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie qui, la même année, pointait une « fatigue de la compassion », mêlée à un certain défaitisme et sentiment d’impuissance, [comme élément explicatif] de la baisse de l’importance accordée à la solidarité interindividuelle dans la cohésion sociale[6] ». Autrement dit, tout en regardant les informations les plus désespérantes du monde humain (guerres, crimes, catastrophes naturelles, pandémies, etc.), le sentiment compassionnel semble s’effriter et s’épuiser au regard de leur démultiplication mais aussi de l’impuissance individuelle à agir. La mise en mouvement par la compassion semble bel et bien éphémère au regard de la répétition des actions, de l’impossibilité d’agir ou de l’impuissance à vraiment aider[7]. Le psychologue étatsunien Charles Figley évoquait, dès la fin du XXe siècle, « the cost of caring for others in emotional pain » et, à l’appui d’autres analystes, notait la perte de la compassion comme résultat de ce travail permanent en présence de la souffrance[8]. Autrement dit, la compassion s’épuise et la « fatigue de compassion » s’installe comme résultat d’une exposition prolongée au stress de la compassion dans le cas des travailleurs du soin, mais aussi comme saturation d’une exposition aux drames humains dans le cas du grand public. Qui n’a pas entendu l’un ou l’autre de ses collègues ou de ses proches dire : « je n’en peux plus de voir ces images atroces d’enfants morts ou affamés, de ces familles détruites par la guerre, de ces populations décimées par la maladie, etc. » ? Susan Sontag évoquait aussi, dans Devant la douleur des autres, cette résistance qui s’effrite et cet engourdissement face à la sur-exposition à des images choquantes (de guerres, de famines, d’indignités…) qui finissent par éteindre le sentiment d’indignation ou de compassion[9].
Reste, d’une part, la culpabilité quand l’événement amenant à la compassion n’est que le résultat du mal commis ou des injustices commises dans le monde et, d’autre part, l’impuissance et l’incompréhension devant des phénomènes subis, pour lesquels les causes et les moyens d’action ne sont pas identifiables et à propos desquels le désintérêt est tout simplement impossible. Dernier point de cet exercice d’équilibre sur ce qu’exprime la compassion, les cas de violence ou d’exploitation de « l’homme par l’homme », et qui génèrent souffrance et surtout perte de la croyance en un monde meilleur. Le sentiment lié à l’impossibilité à agir donne à voir la complexité des sentiments et des émotions vécus. Nous pouvons compatir devant la figure d’un enfant travailleur, mais bien souvent cet ébranlement ne change rien aux pratiques quotidiennes qui conduisent à ce travail des enfants. La compassion, en quelque sorte, sans remise en cause réelle de nos propres fonctionnements, de ce qui conduit à ces situations insoutenables, ne traduit-elle pas, en fait, incompréhension, hypocrisie ou faux-semblant dans le souci-pour-l’Autre ? C’est cette piste que nous suivrons avant de faire un retour sur la définition de celle-ci et sur ses modalités, et d’introduire rapidement les thématiques plus spécifiques développées par les auteur.e.s ayant contribué à faire de ce numéro un lieu de débat pertinent en ce temps de compassion bien affirmée, mais aux résultats suscitant quelque perplexité.
Alors pourquoi s’intéresser encore à la compassion ?
Tout simplement, pourrions-nous dire de manière quelque peu provocatrice, parce que c’est un thème omniprésent dans les attitudes et revendications individuelles, notamment autour des tragédies (évitables ou non, d’ailleurs) qui heurtent notre sensibilité humaine. Sans les détailler, notons ici quelques exemples, ayant fait la une entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle :
-
le séisme du 26 décembre 2004 dans l’océan Indien suivi d’un tsunami entraînant des milliers de morts (environ 250 000 morts), et lançant un appel aux dons incroyablement relayé qui, très vite, va poser la question non seulement de l’usage des fonds mais aussi de la médiatisation de la compassion ; celui de janvier 2010 en Haïti donnant à voir des milliers de morts, des humanitaires aux premières lignes, des hôpitaux militaires… et, aujourd’hui, un pays toujours meurtri qui peine à se relever ; celui de mars 2011 au Japon, suivi d’un tsunami meurtrier et surtout d’une catastrophe nucléaire majeure, avec ses 23 500 morts et disparus, et des questions environnementales d’ampleur internationale ;
-
les attentats dans le monde touchant principalement l’Europe, à commencer par celui commis contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, visant non pas des personnes à l’aveugle (comme dans le cas des attentats du 11 septembre 2001 à New York, du 13 novembre 2015 au Bataclan à Paris ou encore du 14 juillet 2016 à Nice), mais des personnes précises, incarnant des idées précises[10] ; mais aussi le Québec, le 6 décembre 1989 à l’École polytechnique de Montréal où 13 femmes ont été assassinées ou encore le 27 janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec où 6 personnes ont été tuées au moment de la prière ; et enfin ceux qui atteignent quasi quotidiennement l’Afrique, y compris les enlèvements massifs de jeunes filles ;
-
les situations improbables qui ont mobilisé télévisions et radios du monde entier, tel le cas du petit Julen, en Espagne (janvier 2019), tombé dans un puits (de 70 à 80 m de profondeur) et dont la tentative totalement irréelle et malheureuse de le sauver a duré 13 jours ; le cas des 12 jeunes footballeurs thaïlandais et de leur entraîneur coincés dans la grotte de Tham Luang à 4 km de l’entrée et qui a tenu en haleine le monde entier pendant plus de 18 jours en juin 2018 et mobilisé des centaines de sauveteurs des quatre coins du monde ;
-
et maintenant, les nombreux morts dus au coronavirus qui mettent à l’épreuve les systèmes de soins de tous les pays, y compris les pays occidentaux, et qui, depuis les premiers cas en Chine, envahissent notre quotidien.
Comme le proposait l’écrivaine espagnole Sara Mesa (à propos du cas du jeune Julen), nous assistons à une version sensationnaliste télévisuelle qui alimente les tragédies en personnages plus ou moins héroïques. Même si la solidarité, dans les cas des tragédies évoquées, est incontestable, l’exploitation de l’émotion ne constitue pas nécessairement une marque d’humanisation de l’information, mais au contraire celle d’une fictionnalisation de la tragédie au service du spectacle[11].
Autre élément expliquant notre intérêt pour la thématique de la compassion, sa mobilisation dans le cadre des analyses du care comme approche du « prendre soin », associée à la démultiplication des publications sur ce thème. Depuis la publication étatsunienne de Carol Gilligan, en 1982[12], le care a fait florès. Et même si cela ne constitue pas l’axe central de cette publication, il nous faut en souligner sa pertinence. Entre le « prendre soin » et l’attention à l’autre en passant par le souci des autres, la question du rapport à l’Autre souffrant ou considéré souffrant illustre des lieux d’interstices dans lesquels la relation interpersonnelle fait encore sens, et qui font face au monde hyper-individualisé, dénoncé par nombre d’analyses. Depuis l’oeuvre de Carol Gilligan, d’autres voix et d’autres analyses ont été publiées. Notons ainsi, sans prétention d’exhaustivité, les ouvrages de Joan Tronto, Pascale Molinier, Sandra Laugier ou Patricia Paperman[13].
Si ces analyses du care ont, les unes et les autres, montré la compassion comme force vitale de l’intervention, une interpellation autour de la considération accordée aux personnes actives dans le « prendre soin » s’est imposée, et pose un certain nombre de questionnement, notamment autour de la vision genrée, et largement ethnicisée, de ce « prendre soin », hors du monde médical. Ainsi, le care, comme « prendre soin » des plus souffrants et des plus vulnérables, présuppose une clarification des notions mêmes de vulnérabilité et de souffrance. Outre la question de la relation de la société à ses sujets qui souffrent plus que questionnable aujourd’hui, tant les tendances à la réduction des budgets en termes de politiques sociales et des politiques de santé publique manifestent un détachement pour les plus faibles et les plus fragiles, se fait jour, dans le même ordre d’idées, l’enjeu des exigences, tous services confondus, d’efficacité et de rentabilité face à la nécessité d’agir, de prendre le temps d’aider, d’entrer en relation. Mais, comme le montrait Michael J. Sandel[14], faire entrer ces idées d’efficacité et de rentabilité dans le social, c’est en quelque sorte affecter et transformer largement les valeurs qui accompagnent l’intervention sociale. Le manque de temps des travailleurs sociaux dans les divers domaines du social (pensons aux domaines des enfants en difficulté – dont l’épineuse question de la Direction de la protection de la jeunesse au Québec –, des personnes âgées, des familles dysfonctionnelles, de la santé mentale, etc.,) est fréquemment dénoncé, comme marque d’un monde de plus en plus déshumanisé et, au final, de moins en moins efficace.
Dans cette perspective, la définition de la souffrance que propose Paul Ricoeur, qui « n’est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d’agir, du pouvoir-faire, ressenties comme une atteinte à l’intégrité du soi[15] », suggère bien l’ensemble des formes d’intervention, autour de la question de la souffrance. En fait, le monde tourné vers la concurrence et la réussite génère inévitablement une autre question : la souffrance et la vulnérabilité attirent-elles toujours la compassion ? Ou, au contraire, notre capacité de compatir n’est-elle pas immédiatement limitée et déterminée par ce que chacun et chacune estime être une souffrance et une vulnérabilité vertueuses. Autrement dit, toutes les personnes qui souffrent, de quelque ordre et raison que ce soit, ou plutôt celles immédiatement ou aisément rentables économiquement et socialement parlant, ou encore celles symboliquement « dignes » ? Le « prendre soin » interpelle bien évidemment les critères d’intervention, sachant que nombre de personnes pauvres souffrantes et vulnérables n’atteignent même plus nos regards (pensons ici aux personnes sans abri dans les grandes mégalopoles, ou aux victimes du trafic humain dans nos sociétés de consommation).
Même si nous en oublions certainement, si le « prendre soin » est affaire compassionnelle et donc don de soi pour les autres, la question redoutable de la reconnaissance des personnes chargées du prendre soin ne se pose plus. Mais, le « prendre soin » des personnes les plus pauvres, les plus malades, les plus vulnérables, hors institution sociale ou médicale, est souvent affaire de groupes sociaux eux-mêmes peu favorisés. À titre d’exemple, les aidant.e.s à domicile ou les proches-aidant.e.s, prenant soin des personnes âgées, des enfants en bas âge, etc., ont, au mieux, une formation professionnelle de base. Ainsi, dans une logique de reproduction sociale, la majorité des personnes oeuvrant dans ce domaine sont peu formées, peu rémunérées, peu reconnues, alors même qu’elles constituent un élément clé de la vie sociale et du bien-être social. Notre monde contemporain, aux inégalités sociales croissantes entre les plus riches et les plus pauvres, s’avère particulièrement élitiste en oubliant ces métiers pourtant essentiels au bien-être collectif.
Un dernier élément explicatif à la possible auto-qualification compassionnelle réfère à la volonté de contrecarrer une vie marquée par les nécessaires performance et réussite qui supposent de « vaincre » Autrui. Avec la « nouvelle » guerre des places, liée aux délocalisations, à la numérisation, à la robotisation, etc., être compatissant peut être vu et lu comme une sorte d’action-réaction à ces exigences contradictoires et injonctions paradoxales peuplant le monde contemporain[16] et comme une sorte d’attention à l’Autre souvent marquée par ces épreuves de vie sociale, économiquement définie. Mais, quand le développement de soi est posé comme exigence sociétale, il est aisé de se penser compassionnel, tant cette attitude rencontre les théories de l’image de soi valorisant le bien, la bienveillance, l’inquiétude pour Autrui. Toutefois, dans cette version de la compassion soumise au développement de soi, n’y a-t-il pas illusion de l’inquiétude pour Autrui ? Le développement de soi supposant une préoccupation auto-centrée, la définition de ses propres besoins et envies, l’épanouissement personnel dans ses relations sociales et professionnelles, la recherche du bien-être pour soi d’abord, l’Autre peut être plus ou moins source de contrainte, plus ou moins source de stress, plus ou moins source de dévalorisation, plus ou moins source d’instrumentalisation, etc.
L’appel à la compassion marque aussi le grand retour des émotions dans l’espace médiatique, donné à voir dans les réseaux sociaux, comme monde du paraître à la fois par le biais de la mise en scène de soi (dont les selfies ne sont qu’un avatar), et par le biais des commentaires où le moi disparaît derrière un pseudonyme, laissant place alors à un déversement peu compassionnel de la vindicte ou du discours haineux. Et aujourd’hui, dans le langage du Web, les emoji, smiley et autres émoticônes, tendent à remplir le vide des relations sociales en imageant le ressenti, en transmettant par le biais d’un pictogramme son émotion, remplaçant en quelque sorte le verbe, le geste, la mimique dans une conversation de face à face. Comme si finalement l’image remplaçait l’acte même de compatir et d’agir.
Ainsi, la compassion se révèle comme une thématique toujours actuelle qui interroge notre pratique d’être humain et notre responsabilité (individuelle et collective) face à la souffrance, à la vulnérabilité, à la violence de notre monde globalisé, à la capacité indéfinie de l’homme à faire souffrir, qui fait souvent fi des plus fragiles pour laisser place à l’idéologie de la réussite. Le contexte mondial actuel qui, dans des formes variées et sous des registres variables, force le requestionnement du rapport à l’autre et l’interrogation des pratiques d’entraide et de support envers Autrui, constitue ainsi un de ces moments d’ébranlement de notre souci-pour-l’autre.
Comment définir la compassion ?
Dans un passage des Formes élémentaires de la vie religieuse[17], Émile Durkheim, rappelle, non sans acuité, que les passions et les émotions individualisent, alors que la pensée réfléchie et rationnelle tourne vers l’Autre. Un enjeu majeur de la compassion devient alors son inscription sans précaution dans une banalité pratique, comme si, parce que compassionnel, l’être humain ne pouvait faire que le bien. Il nous semble important de clarifier cette notion tant dans son évidence socio-philosophique idéelle que dans sa version pratico-pratique afin d’ouvrir sur les contributions des auteur.e.s.
La compassion comme notion socio-philosophique idéelle ne s’impose pas d’emblée. Et pourtant, de l’état de nature à l’état de société, de la cité grecque (dans laquelle le tragique aide à la compréhension des souffrances humaines, telle la figure d’Antigone face à celle de Créon), à la société contemporaine (dans laquelle l’émotion guide les pratiques), des visages différents de la compassion se dessinent. Ne conviendrait-il pas de relire Jean-Jacques Rousseau qui fait, dans une construction idéale-typique de l’homme, un homme naturellement bon, corrompu par la société et les vices qui vont avec ? Mais si l’homme est naturellement bon dans l’état de nature, il est aussi bête et stupide, selon les termes du philosophe. Aussi, celui-ci s’efforce-t-il de montrer une société qui, d’un côté, corrompt l’âme humaine (par le développement des vices associés à la disjonction de l’être et du paraître) et, de l’autre, permet la perfectibilité de l’homme (par le truchement de l’éducation et du contrat social).
Il serait intéressant ici de se requestionner sur la place de la compassion dans la société afin de donner à voir les différences fondamentales dans l’appréhension de ce qui nous relie à l’Autre, et notamment de cette tentation toujours très grande d’être compassionnel, mais non tous les jours et non avec tout le monde. La compassion permet en quelque sorte de re-poser la question du lien social au travers des émotions, comme support possible ou non de l’être-ensemble et même du pouvoir-vivre-ensemble. Nous pouvons aisément penser, au vu de certaines réactions hostiles à la critique ou à la caricature, que l’émotion génère plus de haine que de respect de l’Autre, et ne permet guère de construire un être-ensemble respectueux de tous, qui passe par des institutions justes.
L’opposition entre vision rationnelle et vision émotionnelle des comportements, qui s’incarne notamment dans le regard du politique lors de drames individuels, dont les effets d’annonce dépassent souvent sa propre compétence ou capacité à comprendre la souffrance de la victime, constitue une démonstration trompeuse du « souffrir-avec ». Notre société, à tout moment et dans toutes circonstances, bruit de ces voix compassionnelles et de ces appels à la vengeance. Mais, et c’est un principe clair de nos sociétés démocratiques et modernes, le droit empêche ces logiques de vengeance de s’exercer. Autrement dit, le droit fait appel à la juste distance entre la violence exercée et la nécessaire confrontation du procès, par la restauration du langage, comme moment pour l’auteur.e notamment de rendre des comptes, non seulement à la victime mais aussi à la société, et pour la victime d’être vraiment reconnue dans sa souffrance. La victime attend une « narration intelligible et acceptable de ce qui s’est passé[18] ». Quand l’émotion appelle à la vengeance (et l’histoire sociale et judiciaire montre avec acuité les désastres créés quand la foule crie vengeance), la victime et sa souffrance disparaissent derrière une violence qui n’entend au final ni reconnaissance ni compassion, alors que « Derrière la clameur de la victime, se trouve une souffrance qui crie moins vengeance que récit », comme l’affirmait Paul Ricoeur en février 1999[19]. Mais le monde de l’émotion, à l’état brut et dans l’immédiateté de l’événement douloureux (ou de la confrontation avec celui-ci), ne suppose guère le détour par le langage. Il est immédiatement ressenti, et s’il anime quelquefois des volontés de changement, il apparaît aussi gratuité plus que praticité et souci-pour-l’Autre. Ces deux logiques se côtoient et se superposent, parfois se complètent et souvent s’opposent, créant des espaces de contradictions, politiques, sociales, et individuelles.
Si la compassion exprime ou se veut dénonciation, encore faut-il, nous dit Léo Kaneman (fondateur du Festival du film et forum international sur les droits humains[20]), transformer cet acte dénonciateur en un combat politique qui vise à redonner force et sens à ce standard minimum qui, par-delà les conditions socioculturelles d’existence, fait l’humanité de chacun.e. « Dénoncer les atteintes à la dignité humaine, défendre les victimes est nécessaire, mais cela doit être complété par un combat politique. […] des chemins existent pour défendre la dignité humaine ; ils ne sont pas seulement humanitaires, ils sont politiques[21]. »
En France, la Fondation Abbé Pierre récompensant les dispositifs les plus indignes et les plus inhumains installés dans les villes contre les SDF (Sans domicile Fixe), récompensant en quelque sorte l’imagination débordante de l’(in-)humain face à l’Autre dérangeant et vulnérable, évoque en quelque sorte ce combat[22]. Comme l’écrivait la sociologue Marie Loison-Leruste, à propos de ces dispositifs anti-SDF : « Parfois, [les SDF] nous émeuvent, parfois ils nous dégoûtent : les pauvres suscitent la peur, d’où cette tentative de criminalisation[23]. » Il est certes nécessaire d’éprouver de la compassion avec les plus faibles et les plus fragiles, mais il est aussi nécessaire de transformer ce ressenti en un acte plus politique de dénonciation, ce que l’initiative de la Fondation Abbé Pierre tente, avec plus ou moins de réussite, de faire. S’indigner, oui, mais encore faut-il s’engager, disait ainsi Stéphane Hessel[24]. Si la compassion peut aider à la préoccupation pour l’Autre, elle nécessite un surcroît de réflexion rationnelle et de pensée critique pour être ou pour supporter une action morale et politique. Susan Sontag allait dans ce sens quand elle écrivait que les images
ne peuvent guère faire plus que nous inviter à prêter attention, à réfléchir, à apprendre, à examiner les rationalisations par lesquelles les pouvoirs établis justifient la souffrance massive. […] Tout cela assorti de la conscience que l’indignation morale, pas plus que la compassion, ne peut nous dicter une manière d’agir[25].
La compassion comme pratique sociale
Dans une autre perspective, nombre d’analyses donnent à la compassion un pouvoir d’action pratique, voire une exigence pratique. La compassion, comme notion pratico-pratique, construit les interventions sociales et humanitaires. Ainsi, serait-elle à la racine de l’engagement des humanitaires ou des aidants de toute sorte ? À titre d’exemple, pour de nombreux intervenant.e.s et acteurs.trices, l’engagement (humanitaire ou social) est affaire de compassion, d’aide, de support aux autres par la mise à disposition de ses compétences dans un monde où la demande se multiplie[26].
Pourtant, dans le monde de l’humanitaire comme dans celui de l’aide en général, de l’intervention communautaire et sociale, la question de la compassion revient régulièrement dans les débats, et notamment quand on évoque l’aide d’urgence, avec des enjeux comme la concurrence des victimes, des enjeux de sortie/non-sortie de l’espace de l’aide ou encore des enjeux idéologiques d’une globalisation des bons sentiments[27]. Ces questions sont certes d’actualité et le resteront, dans le temps et l’espace. Plus spécifiquement, le monde de l’aide, qu’elle soit humanitaire (en pays lointain) ou caritative (en territoire local), est régulièrement sujet à des soubresauts sur sa légitimité, au regard de son efficacité et de sa finalité.
Une partie du débat se situe entre une aide et une coopération pour lutter contre les inégalités nécessitant des moyens et des ressources importantes et une autre qui prône un altruisme efficace pouvant servir de modèle à une prolifération de l’aide qu’elle soit plus proche ou plus lointaine. Entre ces mondes, la compassion semble se perdre dans un no man’s land de bonnes intentions.
Plus spécifiquement, dans le monde de l’humanitaire, certains dénoncent les sommes astronomiques investies. Aider oui, mais en étant attentif à ce que l’intervention ne fasse pas plus de mal que de bien, ce qui aujourd’hui se retrouve certes dans le concept (plutôt réducteur) de non-malfaisance, mais qui, dans la pratique, constitue un défi permanent et persistant, tant l’aide, même en réponse compassionnelle à un besoin criant, modifie les interactions locales, les rapports de pouvoir entre familles ou entre villages. L’aide même théoriquement bienveillante se révèle très vite malveillante, vue d’un autre angle, par exemple vue des yeux de celles et ceux qui n’en bénéficient pas.
Dans le monde dit caritatif, c’est la faiblesse des ressources monétaires investies qui fait l’objet de dénonciation. L’altruisme, comme valeur et pratique centrales, amène le questionnement sur le fondement ou sur les motifs réels de l’action. Autant la reconnaissance de la participation volontaire et désintéressée est-elle célébrée, autant les enjeux idéologiques ou d’endoctrinement sont-ils peu soulevés. La préséance de l’agir compassionnel dans un tel cadre ne se soustrait pas à la question des rapports de pouvoir (in-)visibles ou de l’emprise psychologique qui risquent de faire dévier de sa première mission la relation d’aide… compassionnelle.
Ainsi, la question de la compassion, dans sa version pratico-pratique, revêt-elle parfois des atours qui ne sont pas toujours très charitables. Elle invite à des interrogations peut-être plus techniques, mais non moins importantes, par exemple des questions sur son mécanisme d’action (renvoie-t-elle à l’humanitaire, à la solidarité, à l’entraide ?), des questions sur son efficace (est-elle réalité ou simplement alibi ?), des questions sur son « agenda » politique (constitue-t-elle une nouvelle arme au regard des réelles possibilités d’action ?), et même, en allant plus loin, des questions sur sa vitalité politique (une politique de la compassion pourrait-elle faire sens ?).
Des propositions riches et diverses
Dans ce numéro des Cahiers de recherche sociologique, deux blocs de textes se déclinent, suivis d’une sorte de survol plus historique de la construction de cette notion et du développement de cette pratique dans le champ du travail social au Québec. Si les réflexions produites ne tiennent pas compte de l’actuelle réalité de la pandémie, elles y font implicitement référence, tant la question de la compassion dépasse largement les applications techniques. Tous les textes, chacun à leur manière, bien que dégagés des enjeux actuels, des inquiétudes et des angoisses vécues, formulent, à bonne distance sociologique des faits bruts, des points d’ancrage utiles pour lire et relire la relation sociale dans des contextes de crise, en quelque sorte pour suivre et poursuivre une réflexion qui subit, en direct l’épreuve du feu.
Ainsi, un premier bloc de textes, intitulé « Une notion à explorer », s’inscrit dans une visée d’appréhension et de compréhension de la compassion. Les deux premiers textes, ceux de Marc-Henry Soulet et de Michelle Clément, cherchent, chacun à sa manière, à répondre à la nécessité d’une réflexion conceptuelle dans son environnement sociologique. Patrick Savidan et Vivianne Châtel, pour leur part, reprennent cette question du passage entre l’indignation et l’action, cet entre-deux de la compassion comme émotion ou comme force politique d’action.
S’il ne mobilise pas pour autant la notion d’agir faible, Marc-Henry Soulet s’attache à qualifier sociologiquement la notion de compassion en tant que relation sociale à la fois singulière et paradoxale. Relation sociale singulière d’abord, parce qu’expression d’une horizontalité dans l’asymétrie (le souffrant et le spectateur qui souffre à distance de la souffrance), bien que non génératrice d’une identité entre les « interactants ». Et relation sociale paradoxale ensuite, parce que action in-agissante, sa capacité à faire, venant de son impossibilité même à changer la situation de l’autre souffrant. Dans cette version singulière et paradoxale, la relation sociale, que concrétise la compassion, ré-interroge les ressorts de l’action que nous pouvons qualifier à la fois pour le souffrant et pour le compatissant d’agir faible, parce que faiblement véhicule de changement.
Michèle Clément, dans une perspective sociologique davantage optimiste, souligne le déplacement de la considération de l’autre qui, si elle était bien là, en demi-teinte, dans des approches macrosociales, comme celle de l’exclusion sociale ou de la vulnérabilité, n’en demeurait pas moins, à ses yeux, impensée. La mobilisation de la compassion, en articulant un triple registre, celui de la relation, celui des émotions et celui de la responsabilité, augurerait une promesse d’une meilleure problématisation de la souffrance, en véhiculant un appareillage analytique plus en phase avec l’expérience concrète de ce que celle-ci recouvre et en offrant les conditions analytiques d’une attention à l’autre.
Quant aux contributions de Patrick Savidan et de Vivianne Châtel, elles interpellent la notion de compassion dans une approche plus idéelle en en questionnant les apories, notamment au regard de son application pratique, souvent pensée comme intrinsèque et comme allant de soi, comme si être compatissant suffisait à changer le monde.
Ainsi, Patrick Savidan examine la compassion comme manifestation du souci de l’autre dans le cas d’une injustice distributive et en souligne, ce faisant, la dimension (ici aussi) paradoxale. En partant de la question du comment être si moralement sensibles aux inégalités, notamment quand elles s’incarnent dans des conditions indignes, et en même temps, nous engager si peu pour remédier à ces états de fait, il passe en revue différentes explications et privilégie l’hypothèse d’une disjonction entre deux niveaux de solidarités, celui manifestant le souci des siens et celui caractérisant le souci des autres. Dès lors, la difficulté à traduire le souci (devant l’inégalité, l’injustice, la souffrance) en termes politiques, c’est-à-dire au-delà de la sphère familière et affective, éclaire le paradoxe démocratique d’une sensibilité durable aux inégalités non suivie d’une réduction effective de celles-ci, paradoxe qui fait de la revendication de compassion une vanité sans nom et sans appel.
Viviane Châtel, dans un registre un peu différent, évoque cette inefficacité de la compassion, et nous convie à faire un retour sur cette notion-émotion, en mettant en contrepoint la sélectivité et l’impuissance qui la caractérise avec son évidence indiscutable et, partant, à en pointer les limites. Pour dépasser cette aporie et ne pas voir dans ce à quoi invite la compassion, i.e. la reconnaissance de l’autre souffrant, un simple alibi, un substitut acceptable à la résignation ou un seul évitement de la confrontation à la souffrance, elle suggère de lui substituer une notion moins équivoque et plus engageante, celle de responsabilité-pour-Autrui qui offre, à ses yeux, le mérite d’être plus expressément politique.
Un deuxième bloc de textes, intitulé « Des pratiques à analyser », invite à quelques pas de côté, notamment en interpellant des champs d’absence réelle ou supposée de compassion. Jean-Philippe Bouilloud, Svetla Koleva, Paul Bouvier et Serge Daneault, chacun dans des contextes différents, enrichissent le débat autour d’un questionnement issu de l’expérience compassionnelle.
En interrogeant le champ inhabituel des ressources humaines et du management, plus connu comme support de souffrance au travail[28] que comme univers de compassion, Jean-Philippe Bouilloud provoque une rupture d’évidence. Considérer la place de la compassion dans les activités ordinaires de l’univers de la gestion managériale (hors donc celle des activités de care et d’humanitaire), ne manque pas de surprendre, en insistant sur la compassion non pas tant comme un simple outil de bien-pensance managériale, mais comme une promesse en creux d’une volonté de ré-humanisation du monde du travail devant les apories du tout économique.
Dans une autre perspective, mais dans un univers tout aussi étrange parce qu’inattendu, Svetla Koleva s’intéresse au double vide de la compassion dans les thématiques de la sociologie bulgare. Sous emprise communiste et donc d’un régime totalitaire où la reconnaissance sociale de la compassion n’existe tout simplement pas, ou depuis la transition démocratique et la reconstruction libérale où la compassion est excédentaire (ou presque), à travers un détour linguistique, historique et empirique, l’auteure nous propose l’idée que ce double impensé se révèle aussi bien un puissant analyseur des rapports sociaux dans différents régimes politiques qu’un évident révélateur de la dépendance du travail sociologique à ces régimes.
Paul Bouvier, à distance de son action de longue durée dans l’humanitaire, nous immerge dans les contradictions pratiques de la compassion, avec la question pendante : pouvons-nous compatir de quiconque ? La compassion, si elle demeure une valeur intangible et universelle devant la souffrance de l’autre – même si, dans la pratique, elle est plutôt à géométrie variable –, se heurte à la singularité d’autrui, notamment quand celui-ci a été générateur délibéré de souffrance. Comment, pourquoi, jusqu’où compatir avec des détenus, emprisonnés dans des conditions indignes aujourd’hui, mais qui hier pouvaient être des bourreaux sanguinaires ? C’est cette tension entre humanisation et déshumanisation qu’interroge cette mise en perspective pratique de la compassion comme guide de l’acte humanitaire ; jusqu’où en quelque sorte faire fi de la différence entre victime et auteur ?
Il est un autre champ dans lequel la compassion exerce avec radicalité, c’est le monde du soin. Ainsi, Serge Daneault examine la manière dont l’appel à la compassion est un révélateur de la crise que connaît ce monde de la santé, que ce soit par réduction ou par manque draconien de personnel, par croyance excessive en la toute-puissance de la médecine ou par scepticisme avéré. L’appel à la compassion dans les systèmes de soin tendrait à compenser un tropisme exacerbé pour l’efficience professionnelle, alors que, très souvent, la logique même de la professionnalité appelle le soignant à se protéger de ses émotions, afin d’éviter justement la fatigue de compassion. Mais, dépasser cette convocation paradoxale de la compassion supposerait une véritable révolution paradigmatique en imposant une reconnaissance effective de la souffrance du patient, ce qui paraît difficilement envisageable dans la configuration actuelle du champ médical.
Toutefois, ce numéro des Cahiers de recherche sociologique, sur un thème, aussi passionnant que complexe, qu’est la compassion, aurait été incomplet sans un retour, quoique rapide, sur l’historique de cette notion. La compassion est, sans doute aucun, une composante de la condition d’humanité. Bien que s’exprimant probablement sous des formes très diverses dans l’histoire humaine, elle a revêtu, à un certain moment de l’histoire malmenée et mouvementée de l’humanité, une importance particulière dans la genèse et le déploiement du travail social, au Québec notamment. Le dernier article, signé Henri Dorvil, Sarah Boucher Guèvremont et Vincent Marzano-Poitras, revient sur cet historique en prenant appui sur l’exemple de la professionnalisation du travail social qui aurait fortement contribué à cacher, à mettre sous le boisseau, ce motif d’action qu’est la compassion, par trop entaché de relents religieux, et dans ses débuts notamment, par trop entaché de charité sélective.
L’actualité, aussi sinistre soit-elle, a voulu rattraper ce numéro des Cahiers de recherche sociologique, en mettant à l’épreuve notre humanité et notre exercice de la compassion. Les réflexions ici proposées, sans avoir évoqué dans leurs analyses la pandémie de la Covid 19 qui sévit actuellement, font preuve d’une évidente pertinence tant elles tiennent compte d’une réalité, clairement observée et bien ancrée dans nos sociétés contemporaines. Leur acuité permet ainsi de justifier, d’une manière ou d’une autre, l’incertitude quant au devenir de nos socialités. L’exercice du confinement, de la « distanciation sociale » – expression qu’il aurait sans doute mieux valu remplacer par « gestes sanitaires de prudence » ou encore « distanciation physique » – permettra-t-il de développer un autre rapport aux Autres, plus humain, plus soucieux, plus empathique, plus sympathique, plus compassionnel ? Ou, au contraire, cette expérience inédite, de confinement et de ré-organisation des relations sociales, culturelles, professionnelles, familiales et amicales va-t-elle permettre, au nom de la sécurité, de sa sécurité, d’entamer les revendications des droits de l’Homme ? Comme chacun sait, chaque crise crée ses opportunités, ouvre le champ des possibles, que ce soit pour le pire (une société plus déshumanisée, encore) ou pour le meilleur (une société plus solidaire, voire solidariste). Aussi, la question reste-t-elle ouverte.
La connaissance scientifique demandant du temps, ce numéro sur la compassion ne cherchait pas, avant même l’actualité, à clore un débat sur une thématique aussi cruciale du rapport à l’Autre. Mais plus encore avec la pandémie actuelle et ses enjeux non seulement en termes de santé et d’économie, mais aussi d’aide sociale et humanitaire, voire simplement humaine, il servira, nous l’espérons, au contraire, à enrichir la réflexion centrée sur les rapports à l’Autre qui émergent de manière brûlante avec le coronavirus. Rarement l’actualité sociale et politique aura été si fortement coordonnée avec nos réflexions sociologiques. Bien que cette publication ne traite en rien de la question de l’heure, nous ne pouvions pas rater l’occasion de l’inscrire en fond de scène, car celui-ci constitue l’horizon inévitable où chacun et chacune tentera de décoder ou de relire le thème de la compassion.
Appendices
Notes biographiques
Viviane Châtel est enseignante-chercheure à l’Université de Fribourg (CH), à la Chaire de travail social et politiques sociales, et Responsable du Master spécialisé en Éthique, responsabilité et développement. Elle collabore au Comité de recherche 30 (inégalités, identités et liens sociaux) de l’AISLF, au Genobs (Trent University – Ontario), au Centre interdisciplinaire de sciences sociales (Cics-nova, Universidad nova de Lisboa).
Shirley Roy est professeure titulaire à l’UQAM et cofondatrice et codirectrice du Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale (CRI) depuis 1996. Elle a dirigé le département de sociologie de l’UQAM de 2013 à 2016 et dirige les Cahiers de Recherche sociologique depuis 2017.
Notes
-
[1]
Pensons à nombre de pays comme la Chine, la Russie, l’Iran qui restreignent désormais, voire éteignent, l’accès à Internet pour leur population.
-
[2]
Paul Ricoeur, Le Juste 2, Paris, Éditions Esprit, 2001, p. 229.
-
[3]
« happiness, n. : an agreeable sensation arising from contemplating the misery of another ». Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary, 1906. [En ligne], http://thedevilsdictionary.com/?h=#!
-
[4]
Parmi les cinq articles du journal LeMonde.fr les plus lus en 2018, hors nécrologies, trois concernaient des faits divers. [En ligne], https://lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/01/02/les-articles-du-monde-les-plus-lus-en-2018_5404354_3236.html, mis en ligne 02 janvier 2019. Le site Contents insight, entreprise d’analyse des médias, met en avant l’idée de « régime informatif » ou « diète de nouvelles » évoquant les 58% de personnes interrogées qui déclarent éviter les nouvelles parce que cela les met de mauvaise humeur. Goran Mirković, « The toxicity of modern news what can publishers do to stop people avoiding the news ? », Content insights, [En ligne], https://contentinsights.com/toxicity-modern-news-what-can-publishers-do-to-stop-people-avoiding-news/, mis en ligne le 18 décembre 2019. Voir aussi : https://laboratoriodeperiodismo.org/10-temas-mas-seguidos.
-
[5]
Cité par Fabrice Dubault, « La guerre, la souffrance, l’horreur et le témoignage à Visa pour l’image », France 3 Occitanie, [En ligne], https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/perpignan/la-guerre-la-souffrance-l-horreur-et-le-temoignage-visa-pour-l-image-313395.html, mis en ligne le 06.09.2013, mis à jour le 30.07.2015). Il s’agit du rendez-vous annuel du photojournalisme qui a lieu à Perpignan, France.
-
[6]
Sandra Hoibian et al., Les Français en quête de lien social. Baromètre de la cohésion sociale 2013, Paris, Éditions du Crédoc, 2013, p. 28.
-
[7]
Ari Gounongbé, La Fatigue de la compassion, Paris, Presses universitaires de France, 2014. « La compassion, parce qu’elle procède d’un consentir est une force dévouée… »
-
[8]
Charles Figley, « Compassion fatigue : coping with secondary Traumatic Stress Disorder in those who treat the traumatized », New York, Routledge, 2013. Voir aussi Carla Joinson, « Coping with compassion fatigue », Nursing, vol. 22, no 4, 1992, p. 116-122 ; Jeffrey Kottler, Compassionate Therapy : Working with Difficult Clients, San Francisco, Jossey-Bass, 1992 ; Charles Figley, « Compassion Fatigue : an Introduction », Gift from Within _PTSD. Resources for Survivors and caregivers, [En ligne], https://www.giftfromwithin.org/html/What-is-Compassion-Fatigue-Dr-Charles-Figley.html, 2003.
-
[9]
Susan Sontag, Devant la douleur des autres, Paris, Éditions Christian Bourgois, 2003.
-
[10]
Riss, Une minute quarante-neuf secondes, Paris, Actes Sud, 2019, p. 162.
-
[11]
Sara Mesa, « Caso Julen : la emoción al servicio del espectáculo », El País, 11 avril 2019.
-
[12]
Carol Gilligan, Une Voix différente. Pour une éthique du care, Paris, Flammarion, 2008 [1982].
-
[13]
Joan Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care, Paris, La Découverte, 2009 [1993] ; Pascale Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman, Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Paris, Payot, 2009 ; Sophie Bourgault et Julie Perreault (dir.), Le Care. Éthique féministe actuelle, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2015. Caroline Ibos, Aurélie Damamme, Pascale Molinier et Patricia Paperman, Vers une société du care. Une politique de l’attention, Paris, Le cavalier bleu éditions, 2019 ; Pascale Molinier, Le Travail du care, Paris, La Dispute, 2020.
-
[14]
Michael J. Sandel, Ce que l’argent ne saurait acheter. Les limites morales du marché, Paris, Seuil, 2014 [2012].
-
[15]
Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 223.
-
[16]
Vivianne Châtel et Shirley Roy (dir.), Penser la vulnérabilité. Visages de la fragilisation du social, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2008.
-
[17]
Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse Paris, Presses universitaires de France, 1912.
-
[18]
Paul Ricoeur, Le Juste 2, Paris, Éditions Esprit, 2001, p. 297.
-
[19]
Selon Paul Ricoeur, lors de sa comparution comme témoin dans le cadre du procès du sang contaminé en février 1999. Une partie de l’intervention de Paul Ricoeur lors de ce procès est reprise dans le dernier article intitulé « Citation à témoin : la malgouvernance », publié dans Le Juste 2, ibid.
-
[20]
Fondé en 2003 à Genève.
-
[21]
Léo Kaneman, « Droits humains : de la compassion à l’action politique », Le Temps, [En ligne], https://www.letemps.ch/opinions/droits-humains-compassion-laction-politique, mis en ligne le 3 décembre 2018.
-
[22]
Ces « prix » sont nommés Les pics d’or.
-
[23]
Cité par Pierre Bouvier, « Pics d’or » : La fondation Abbé-Pierre distingue les dispositifs anti-SDF », Le Monde, 14 février 2019.
-
[24]
Stéphane Hessel, Indignez-vous!, Montpellier, Indigène éditions, 2010 ; Stéphane Hessel, Engagez-vous! (Entretiens avec Gilles Vanderpooten), La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2013.
-
[25]
Susan Sontag, Devant la douleur des autres, Paris, Éditions Christian Bourgois, 2003, p. 125.
-
[26]
À titre d’exemple lire aussi : Tichaona Mashodo, « L’aide humanitaire : une histoire de compassion », Handicap international, [En ligne], https://handicap-international.ch/fr/actualites/l-aide-humanitaire-une-histoire-de-compassion-, mis en ligne le 14 août 2019.
-
[27]
Signalons, pour exemple, les textes suivants : Jean-Michel Chaumont, La Concurrence des victimes, Paris, La Découverte, 1997 ; Bernard Hours, L’Idéologie humanitaire ou le spectacle de l’altérité perdue, Paris, L’Harmattan, 1998 ; Michel Agier, Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion, 2008.
-
[28]
Le film Ressources humaines de Laurent Cantet (1999) et, plus récemment, le film Nos batailles de Guillaume Senez (2018) illustraient à l’envi cet univers peu compassionnel du monde du travail, et notamment, et plus spécifiquement, celui des ressources humaines, dans lequel le salarié est plus vu et pensé comme une ressource corvéable à merci qu’un être humain de chair, de sang et d’émotions. Les analyses en psycho-dynamique du travail, comme celles de Christophe Dejours, n’en sont qu’une confirmation.