Article body
L’hétérogénéisation des salles de classe et la diversification des profils d’apprenantes et d’apprenants amènent bon nombre de défis pour le personnel enseignant et les professionnelles et professionnels de l’éducation. Ces défis ont été relevés avec l’émergence d’approches plus universelles de l’enseignement et de l’apprentissage inspirées par la conception universelle (Universal Design), une approche de la conception d’espaces physiques avec l’accessibilité pour toutes et tous comme principe central (p. ex. : rampes d’accès). Les liens conceptuels avec la pratique en milieu éducatif, nés de cette focalisation sur l’accessibilité physique universelle, se sont développés pour faire place à l’idée que l’apprentissage doit également être accessible à toutes et à tous, et qu’une variété de méthodes d’enseignement peut être utilisée pour éliminer les obstacles à l’apprentissage et à l’égalité des chances de réussite. Une variété de concepts est souvent utilisée de manière interchangeable, telles la conception universelle pour l’enseignement, la conception pédagogique universelle et la conception universelle pour l’apprentissage. Ce qui distingue la pédagogie universelle de l’Universal Design for Instruction, une approche s’intéressant à l’aménagement de la classe, des évaluations, du matériel pédagogique et des méthodes d’enseignement pour rejoindre le plus grand nombre d’élèves et réduire le besoin d’accommodements individualisés, c’est le fait de considérer tous les aspects de l’apprentissage, et non seulement les lieux physiques ou l’environnement d’apprentissage (Rose et Meyer, 2002). Suivant cette logique, il sera question, dans ce numéro thématique, de l’Universal Design for Learning, auquel on fera référence sous l’appellation de « pédagogie universelle ». Il est de notre avis que le terme pédagogie universelle permet de mieux tenir compte de la notion de pédagogie pour toutes et tous et de celle d’universalité d’accès à l’apprentissage (Desmarais, 2019). Ainsi, contrairement à la conception universelle de l’apprentissage, la pédagogie universelle considère la planification de l’enseignement et la créativité requise dans la planification de pratiques pédagogiques différenciées (Rousseau et Angelucci, 2014).
Roberts et al. (2011) ont publié une revue d’articles empiriques liés à ces concepts; leur examen s’est transformé en un appel à l’action pour opérationnaliser davantage ces idées. Plus récemment, l’UNESCO (2020) a interpelé les écoles de partout dans le monde à mettre en oeuvre les principes de la pédagogie universelle pour favoriser l’établissement d’écoles inclusives. Effectivement, la pédagogie universelle est vue comme une approche holistique de l’apprentissage, allant au-delà des forces et faiblesses des apprenantes et des apprenants en considérant les conditions et les approches pédagogiques pour les rendre plus efficaces et accessibles à toutes et à tous (UNESCO, 2020).
Le concept de pédagogie universelle prévaut dans la recherche et les pratiques anglophones, particulièrement aux États-Unis. Bien qu’il existe un nombre croissant de projets de recherche et de pratiques francophones liés à la pédagogie universelle, les écrits francophones sont peu nombreux. Ainsi, nous avons choisi cette revue expressément en raison de son accent sur la francophonie et sur la mise en valeur des contextes francophones pour la recherche et la pratique. Notre objectif principal, en présentant ce numéro spécial consacré à la pédagogie universelle, est de catalyser l’éducation inclusive à travers l’opérationnalisation de la pédagogie universelle ou l’Universal Design for Learning (Rose et Meyer, 2002), en raison de ses liens directs avec les sciences de l’enseignement, de l’apprentissage et des neurosciences. En ce sens, les sciences cognitives reconnaissent que les fonctions et les caractéristiques cérébrales s’inscrivent sur un continuum de variabilité chez tous les individus, et la pédagogie universelle met de l’avant que les différences individuelles sont plutôt une force active de l’apprentissage au sein d’un groupe (Meyer et al., 2014). Dès lors, il est pertinent de les considérer et de les intégrer dans les programmes d’études (UNESCO, 2020).
Le Higher Education Opportunity Act (2008) définit la pédagogie universelle comme une structure qui guide la mise en oeuvre de pratiques éducatives favorisant la flexibilité dans la façon dont l’information est présentée, dans la façon dont l’apprenante ou l’apprenant répond aux apprentissages et arrive à démontrer ses habiletés, et dans la façon de susciter son engagement et sa motivation. Elle est considérée comme une approche inclusive permettant de répondre aux besoins éducatifs de toutes les personnes apprenantes. Effectivement, Rousseau et al. (2015) mettent en évidence que la pédagogie universelle correspond à « un type de pédagogie reposant sur l’actualisation de l’inclusion par l’outillage médiatique et technologique facilitant toutes les étapes de l’apprentissage de tous les élèves » (p. 500) et qu’elle est de plus en plus abordée comme une piste de solution prometteuse pour mieux répondre aux besoins grandissants de cette diversité d’apprenantes et d’apprenants, et d’innover dans la prestation pédagogique. Cette approche inclusive est perçue comme un outil de démocratisation et de diversification de l’enseignement contribuant au bienêtre et à la réussite des personnes apprenantes, en plus d’offrir à toutes et tous l’occasion de dévoiler son plein potentiel (Katz, 2013). Ainsi, dans cet esprit de légitimation de la diversité des personnes apprenantes qui composent les salles de classe, les principes de flexibilité de la pédagogie universelle sont reconnus dans les recherches américaines (Meyer et al., 2014; Rappolt-Schlichtmann et al., 2012; Rose et Meyer, 2002) et canadiennes (Batool et Flanagan, 2017; Belleau, 2015; Bergeron et al., 2011; Desmarais, 2019; Fovet, 2020) comme une piste d’action intéressante pour les milieux éducatifs désirant être plus inclusifs.
Dans ce contexte de la promotion de l’inclusion, la pédagogie universelle se présente comme un moyen pour mieux répondre aux besoins éducatifs variés des personnes apprenantes de tous les ordres d’enseignement ainsi que de leurs enseignantes et enseignants, ou encore de leurs professeures et professeurs. Elle permet notamment la création d’un environnement d’apprentissage accessible et innovant pour toutes les personnes apprenantes, en plus de leur offrir toute la flexibilité nécessaire. Sans être considérée comme une approche nouvelle, la pédagogie universelle correspond à la mise en commun des meilleures pratiques pédagogiques en matière d’enseignement destiné à une diversité de personnes apprenantes, comme la différenciation pédagogique, l’enseignement explicite ou l’apprentissage coopératif. La flexibilité et la grande place qu’elle laisse à la créativité offrent aux enseignantes et enseignants la possibilité d’offrir de véritables occasions d’apprentissage à leurs apprenantes et apprenants tout en les motivant (Davies et al., 2013).
De manière plus précise, la pédagogie universelle ou l’Universal Design for Learning, a émergé à la fin des années 1990 (Rose et Meyer, 2002) dans le but de répondre à deux défis du contexte éducatif, soit enseigner à une importante diversité de personnes apprenantes et maintenir des standards élevés en éducation (Meyer et al., 2014; Rose et Meyer, 2002). Le Higher Education Opportunity Act (2008) précise que la flexibilité offerte par la pédagogie universelle permet de réduire les obstacles à l’apprentissage en offrant le soutien nécessaire au moment opportun à tous les apprenantes et apprenants. Ce faisant, la pédagogie universelle, au sein d’un curriculum flexible, propose aux personnes apprenantes un apprentissage en profondeur à travers une variété de matériels, de méthodes d’enseignement et de méthodes d’évaluation (Rappolt-Schlichtmann et al., 2012). Essentiellement, la pédagogie universelle met de l’avant trois principes de flexibilité : (1) offrir divers moyens d’engagement, (2) offrir divers moyens de représentation, et (3) offrir divers moyens d’action et d’expression (Meyer et al., 2014). Ces trois principes de flexibilité, chacun décomposé en trois lignes directrices (voir Tableau 1), peuvent être envisagés dans toutes les disciplines enseignées, et ce, peu importe l’ordre d’enseignement.
Tableau 1
Traduction des lignes directrices de la pédagogie universelle du CAST (2018) par Desmarais (2019)
Comme le montre le Tableau 1, en suivant ces principes de flexibilité, les enseignantes et enseignants, de même que les professeures et professeurs, planifient une multitude de modalités d’enseignement, d’évaluations et d’activités d’apprentissage. Ces modalités se transcrivent, pour les personnes apprenantes, par une multitude d’occasions d’apprendre selon leurs besoins et leurs préférences en faisant des choix qui leur permettent de mieux apprendre. Ces choix leur sont offerts dans le but de favoriser, entre autres, leur engagement et leur motivation. Considérée comme une approche proactive (Burgstahler, 2013) et collective plutôt qu’individuelle (CAST, 2011), la pédagogie universelle réduit la nécessité d’offrir des accommodements de manière individuelle en rendant l’apprentissage accessible simultanément à un plus grand nombre d’apprenantes et d’apprenants.
Les recherches actuelles sur la pédagogie universelle, très majoritairement anglophones et en provenance des États-Unis, font ressortir son apport dans la réduction du nombre d’accommodements individuels qui doivent être mis en place (Smith, 2012; Burgstahler, 2013), dans un apprentissage répondant mieux aux besoins et aux intérêts variés de toutes les personnes apprenantes (Meyer et Rose, 2005; Meyer et al., 2014) ainsi que dans la création d’une expérience d’apprentissage plus positive, motivante et inclusive (Bergeron et al., 2011; Desmarais, 2019; Katz, 2015). Bien documentée sur le plan théorique et pratique en contexte anglophone, la pédagogie universelle l’est très peu en contexte francophone. C’est pourquoi ce numéro thématique est novateur puisqu’il s’inscrit comme le premier rassemblement d’écrits francophones sur la pédagogie universelle. Il s’agit d’une occasion pour documenter les conditions de mise en oeuvre de la pédagogie universelle et les défis qui y sont associés, notamment en contexte francophone canadien.
Le numéro La pédagogie universelle : la recherche au service de la pratique, comprend neuf articles, dont des réflexions critiques et des textes empiriques faisant état de recherches en lien avec la pédagogie universelle dans le contexte de l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire.
Le premier article, Mise en oeuvre des principes de la pédagogie universelle : étude sur la perception du personnel enseignant à l’égard de leur bienêtre en contexte minoritaire franco-manitobain, est issu d’une recherche-action. Rédigé par Marie-Pier Forest et Marie-Élaine Desmarais, il vise à documenter la perception du personnel enseignant à l’égard de l’influence de la pédagogie universelle sur son bienêtre. Cet écrit présente des résultats mettant en évidence les différents éléments ayant influencé le bienêtre du personnel enseignant dans un contexte de mise en oeuvre de la pédagogie universelle, et ce, en pleine pandémie de COVID-19.
Le deuxième article est rédigé par Élisabeth Boily et Chantal Ouellet. La mise en oeuvre des principes de la pédagogie universelle par des enseignantes et des orthopédagogues du premier cycle du primaire dans une perspective de réponse à l’intervention porte sur la mise en relation entre les principes de flexibilité de la pédagogie universelle et la réponse à l’intervention (RAI). Il se base sur une analyse secondaire d’une étude portant sur les rôles d’enseignantes et d’orthopédagogues en contexte d’implantation de la RAI.
L’article suivant, Communautés d’apprentissage professionnelles auprès du personnel enseignant au primaire en contexte francominoritaire : moyen prometteur pour faciliter la mise en oeuvre de la pédagogie universelle, est rédigé par Marie-Élaine Desmarais et Marie-Pier Forest. Il s’intéresse aux résultats d’une recherche-action voulant documenter la formation continue sur la pédagogie universelle par le biais de communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) de personnes enseignantes du primaire en contexte francominoritaire.
L’article qui suit pose la question des points de convergence entre l’évaluation des compétences et la pédagogie universelle. Dans Convergences entre l’évaluation des compétences et la pédagogie universelle : une réflexion théorique pour orienter la pratique enseignante dans les écoles primaires et secondaires au Québec, Nadine Talbot et Sandra Chiasson Desjardins proposent une réflexion de nature théorique sur les conditions gagnantes pour la mise en oeuvre de l’évaluation des compétences tout en respectant les principes de la pédagogie universelle.
Pour sa part, le cinquième article propose une mise en relation des propositions issues d’une étude qualitative exploratoire visant à mieux comprendre ce qui contribue (ou pourrait contribuer) à l’engagement scolaire des personnes apprenantes avec les principes de la conception universelle de l’apprentissage. Rédigé par Nadia Rousseau, il a pour titre Soutenir l’engagement scolaire après la COVID-19 : mise en relation de propositions émises par des élèves québécois avec les principes de flexibilité de la conception universelle de l’apprentissage.
L’article L’utilisation des principes de la conception universelle de l’apprentissage pour le développement d’un programme d’interventions basées sur la présence attentive pour les personnes adolescentes de 12 à 19 ans a été rédigé à la suite d’une recherche-développement portant sur la création d’un programme d’intervention basée sur la présence attentive (mindfullness). Caroline Duranleau, Nadia Rousseau et Frédérik Dionne y présentent un exemple d’application de la conception universelle de l’apprentissage dans le développement d’activités pédagogiques qui s’adressent à des élèves d’âges, de parcours et de profils scolaires variés.
Dans l’article Comment les champs de la didactique des sciences et de la technologie et de la pédagogie universelle peuvent-ils s’enrichir et contribuer à couvrir leurs angles morts respectifs?, la chercheuse Audrey Groleau propose une réflexion critique sur les apports de la pédagogie universelle à la didactique des sciences et de la technologie, puis des pistes d’enrichissement de la pédagogie universelle à la lumière des travaux réalisés en didactique des sciences et de la technologie.
Le texte suivant, Vers une approche institutionnelle : favoriser la réussite éducative par la conception universelle de l’apprentissage et l’accessibilité universelle, propose quant à lui une réflexion critique centrée sur la réussite éducative et l’inclusion des personnes marginalisées ou en situation de handicap en contexte collégial québécois. Cet écrit d’Emmanuel Martin-Jean souhaite promouvoir le besoin d’approfondir la recherche sur l’application, au niveau institutionnel, des modèles inspirés par la pédagogie universelle.
Le neuvième et dernier article, La pédagogie universelle dans l’enseignement postsecondaire : un état de la question, est de Diane Querrien. Dans celui-ci, la chercheuse propose un état de la question portant sur les perceptions des communautés enseignante et apprenante en matière de pédagogie universelle, ainsi que sur la formation à l’enseignement et la mise en oeuvre des principes de la PU dans les milieux postsecondaires francophones.
Appendices
Bibliographie
- Batool, A. et Flanagan, T. (2017). Developmental review of Universal Design educational models in K-12 and higher education. Conference proceedings of the 2017 UDL-IRN Summit, Floride.
- Belleau, J. (2015). La conception universelle de l’apprentissage (CUA) : une approche de l’enseignement et de l’apprentissage visant l’inclusion de tous. CAPRES. https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34460/capres-belleau-conception-universelle-apprentissage-2015.pdf
- Bergeron, L., Rousseau, N. et Leclerc, M. (2011). La pédagogie universelle : au coeur de la planification de l’inclusion scolaire. Revue Éducation et francophonie, 39(2), 87-104.
- Burgstahler, S. E. (2013). Equal access: Universal Design of Instruction. Université de Washington. http://www.washington.edu/doit/Brochures/PDF/equal_access_udi.pdf
- Center for Applied Special Technology (CAST). (2011). Universal Design for Learning guidelines version 2.0. National center on universal design for learning.
- Center for Applied Special Technology (CAST). (2018). Universal Design for Learning Guidelines Version 2.2. http://udlguidelines.cast.org.
- Davies, P. L., Schelly, C. L. et Spooner, C. L. (2013). Measuring the effectiveness of Universal Design for Learning intervention in postsecondary education. Journal of Postsecondary Education and Disability, 26(3), 195-220.
- Desmarais, M.-É. (2019). L’appropriation et la mise en oeuvre des principes de flexibilité de la pédagogie universelle en contexte universitaire québécois : mieux comprendre le passage d’un paradigme de normalisation à un paradigme de dénormalisation [Thèse de doctorat]. Université du Québec à Trois-Rivières.
- Fovet, F. (2020). Universal Design for Learning as a tool for inclusion in the higher education classroom: Tips for the next decade of implementation. Education Journal, 9(6), 163-172.
- Higher Education Opportunity Act. (2008, august 14th), PUBLIC LAW 110-315. https://www2.ed.gov/policy/highered/leg/hea08/index.html
- Katz, J. (2013). The three block model of Universal Design for Learning (UDL): Engaging students in inclusive education. Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l’éducation, 36(1), 153-194.
- Katz, J. (2015). Implementing the three block model of universal design for learning: Effects on teachers self-efficacy, stress and job satisfaction in inclusive classrooms K-12. International Journal of Inclusive Education, 19(1), 1-20.
- Meyer, A. et Rose, D. H. (2005). The future is in the margins: The role of technology and disability in educational reform. Dans D. H. Rose, A. Meyer et C. Hitchcock (dir.). The universally designed classroom: Accessible curriculum and digital technologies (p. 13-25). Harvard Education Press.
- Meyer, A., Rose, D. H. et Gordon, D. (2014). Universal Design for Learning: Theory and practice. CAST Professional Publishing.
- Rappolt-Schlichtmann, G., Daley, S. G. et Rose, L. T. (2012). A research reader in Universal Design for Learning. Harvard Education Press.
- Roberts, K., Park, H., Brown, S. et Cook, B. (2011). Universal Design for Instruction in postsecondary education: A systematic review of empirically based articles. Journal of Postsecondary Education and Disability, 24(1), 5-15.
- Rose, D. H. et Meyer, A. (2002). Teaching every student in the digital age: Universal Design for Learning. ASCD.
- Rousseau, N., Paquet-Bélanger, N., Stanké, B. et Bergeron, L. (2015). Pédagogie universelle et technologie d’aide : deux voies complémentaires favorisant le soutien tantôt collectif, tantôt individuel aux apprentissages. Dans N. Rousseau (dir.), La pédagogie de l’inclusion scolaire : un défi ambitieux et stimulant (3e éd., p. 453-490). Presses de l’Université du Québec.
- Smith, F. G. (2012). Analyzing a college course that adheres to the Universal Design for Learning (UDL) framework. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 12(3), 31-61.
- UNESCO. 2020. Global education monitoring report 2020 : Inclusion and education: All means all. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718
List of tables
Tableau 1
Traduction des lignes directrices de la pédagogie universelle du CAST (2018) par Desmarais (2019)

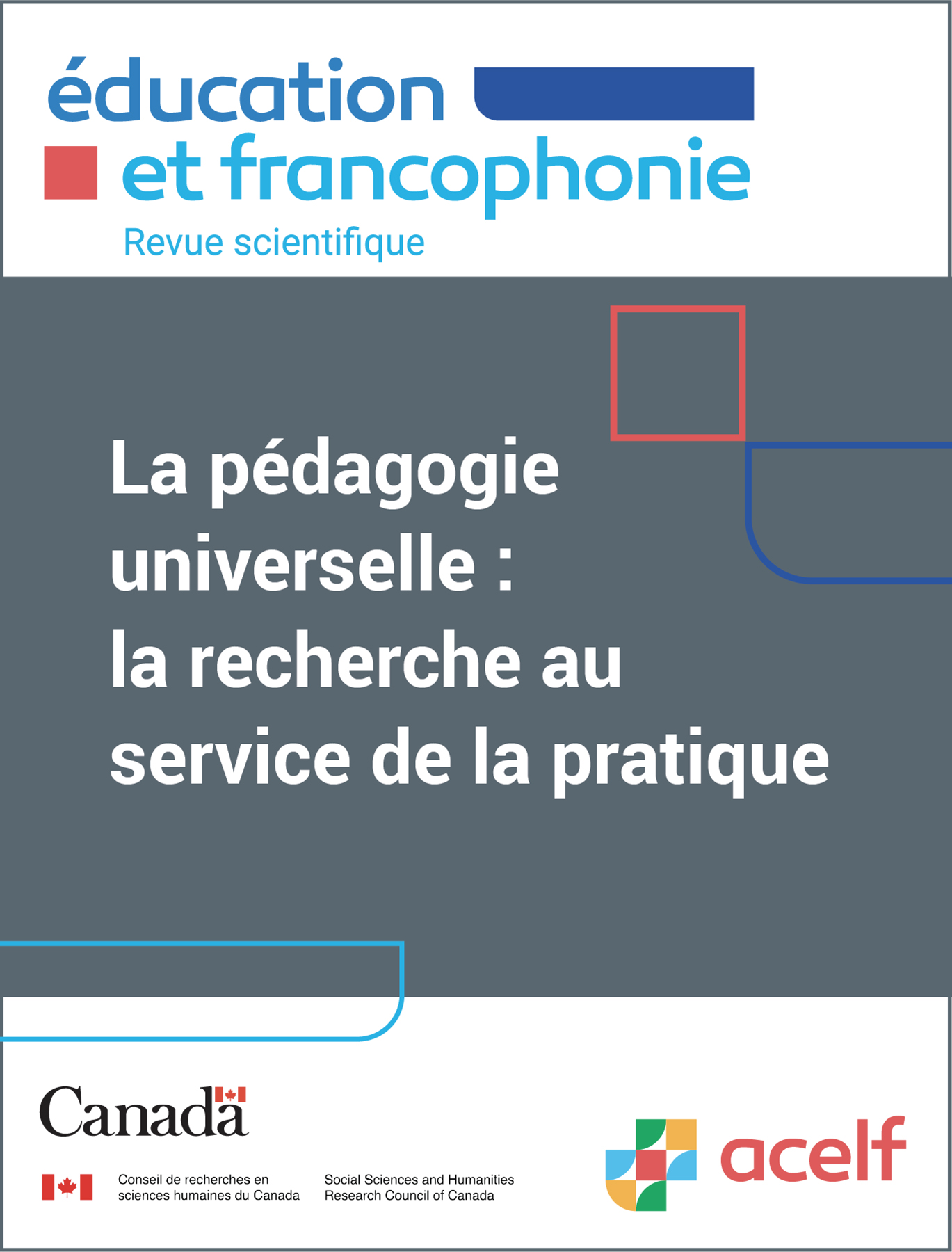

 10.7202/1007729ar
10.7202/1007729ar