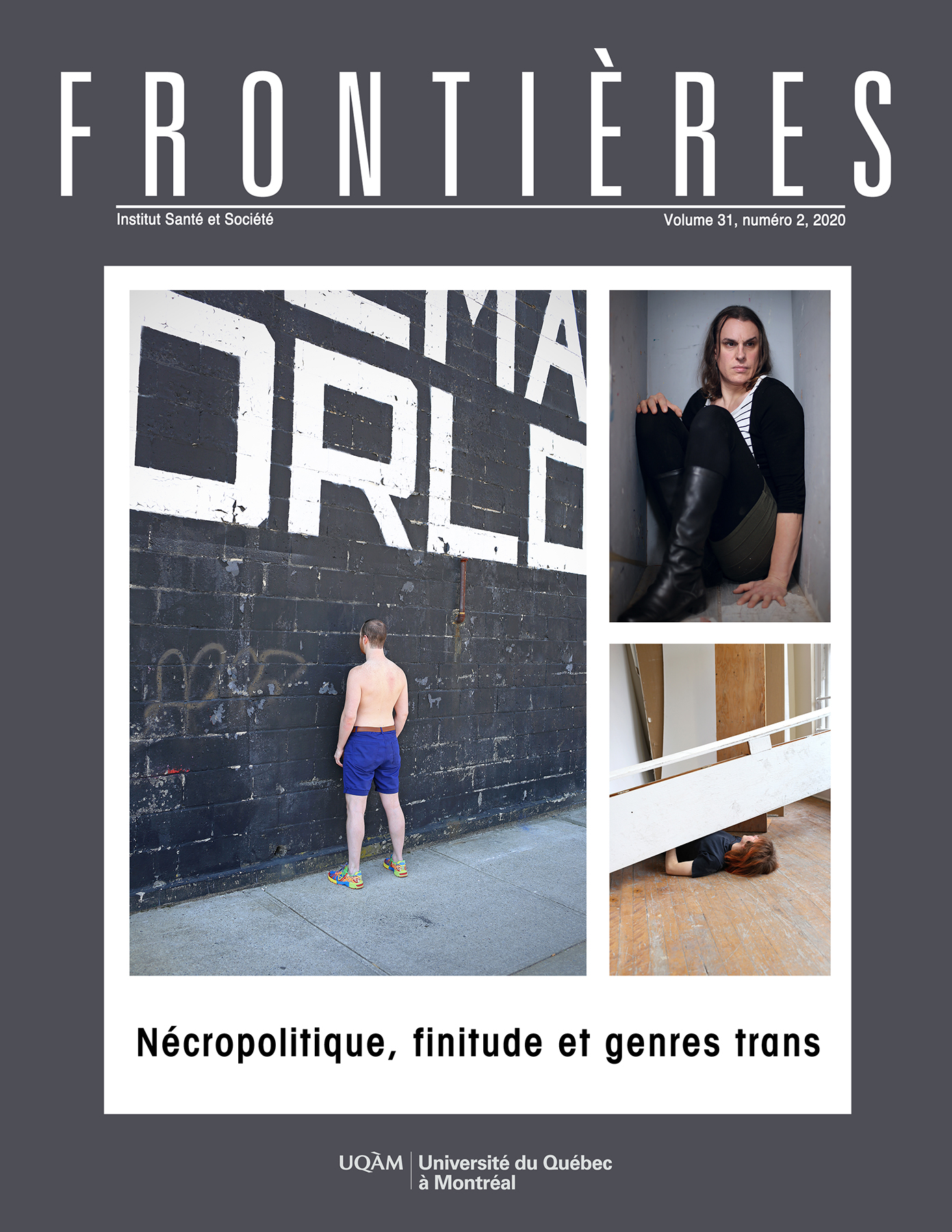Abstracts
Résumé
Au coeur de l’approche psychothérapeutique humaniste, plus particulièrement de son courant existentiel, réside la recherche d’authenticité. La clinique témoigne de l’intensité de la souffrance, pouvant aller jusqu’à prendre la forme d’idéations suicidaires, lorsque l’être est entravé dans ce cheminement. Nous croyons que l’entrave à pouvoir être soi-même est centrale dans le vécu des personnes trans. Dans cet article, nous nous proposons de présenter certaines conditions jugées essentielles dans l’accompagnement de la recherche identitaire du genre à travers la perspective de la psychologie humaniste-existentielle, qui fait de la capacité d’actualisation de la personne un élément central du travail thérapeutique. Le texte, sous la forme d’un essai théorique et herméneutique, présente des réflexions sur la clinique trans qui laissent également place à la réflexivité des autrices, toutes trois travaillant en psychologie clinique (la première autrice de ce texte s’identifiant comme femme transgenre et les deux autres autrices comme femmes cisgenres).
Mots-clés :
- identité trans,
- psychologie humaniste-existentielle,
- traumatisme développemental,
- authenticité,
- finitude
Abstract
At the heart of humanistic psychotherapy, especially in the existential approach, lies the search for authenticity. The clinical literature reports the intensity of traumatic suffering, which may even take the form of suicidal ideation, when a being is hindered in this journey. We believe that this theme is central to the lives of trans people. In this article, we present some conditions considered to be essential for accompaniment of the gender identity research process, through the perspective of the humanistic psychology of the self, in which the capacity for self-actualization is a central element of the therapeutic work. Using a combination of theoretical essay and hermeneutic methodology, the following text will present theoretical reflections on these themes, adding the reflexivity of the authors, all three of whom work in clinical psychology (the first identifying as a transgender woman and the other two as cisgender women).
Keywords:
- trans identity,
- humanistic self-psychology,
- developmental trauma,
- authenticity,
- finitude
Resumen
En el centro del enfoque psicoterapéutico humanista, más precisamente su corriente existencial, yace la búsqueda de la autenticidad. La clínica demuestra la intensidad del sufrimiento, el que puede llegar hasta tomar forma de pensamientos suicidas mientras el sujeto está inhibido en tal camino. Creemos que la dificultad de ser uno mismo es fundamental en las experiencias vividas por las personas trans. En este artículo, proponemos presentar ciertas condiciones que juzgamos esenciales durante el proceso de acompañamiento a la persona en su búsqueda de identidad de género a través de la perspectiva de la psicología humanista-existencial. Desde tal perspectiva, se ve la capacidad de la actualización de la persona como un elemento central del trabajo terapéutico. El texto, en forma de ensayo teórico y hermenéutico, presenta reflexiones acerca de la clínica trans, la cuales dan lugar a reflexiones sobre el tema por parte de las tres autoras, quienes trabajan en el campo de la psicología clínica (la primera autora de este texto se identifica como una mujer transgénero en tanto que las otras dos como mujeres cisgénero).
Palabras clave:
- identidad trans,
- psicología humanista-existencial,
- traumatismo en el desarrollo,
- autenticidad,
- finitud
Article body
« Comment s’écouter mieux tout en faisant taire les voix qui nient que nous existons? Poser la question “qui suis-je pour moi” m’a conduit à des réponses qui m’ont enhardie. Ces réponses sont les fondations qui me permettent maintenant de m’affirmer avec assurance dans ma vérité. L’authenticité a été le chemin de briques jaunes menant vers une vie réussie. Qui suis-je pour moi? Là est la question. »
Janet Mock, 2017; traduction libre[1]
Quiconque se familiarise avec la réalité des personnes trans et laisse aller son imaginaire à un exercice d’association avec les thèmes de la finitude ou de la mort pense inévitablement aux nombreuses statistiques de violence et de mortalité qui affectent cette communauté. Il suffit de jeter un coup d’oeil à la plus importante étude canadienne sur le sujet, le projet Trans PULSE[2] (Bauer et Scheim, 2015[3]). Nous pouvons citer en exemple des statistiques qui témoignent des nombreuses violences transphobes ou celles qui font la démonstration de la discrimination qui affecte le quotidien des personnes trans. Cependant, nous retenons surtout que cette réalité sociale est vécue par l’intériorisation d’une quasi-interdiction d’exister pour cette population. En fait, selon cette étude, 96 % de la population trans se serait fait dire ou aurait senti, à un moment ou à un autre de son existence, que son identité n’était pas « valable ». Ainsi, que l’on pense aux propos qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui refusent de reconnaitre l’existence de ces identités, ou encore à la prise de conscience d’un danger réel pour l’intégrité physique, les possibilités de vivre cette violence sont nombreuses pour les individus.
Toutefois, la statistique liée à la finitude des personnes trans qui frappe le plus souvent l’imaginaire est celle qui concerne le suicide. En effet, toujours selon le projet Trans PULSE, environ 43 % des personnes s’identifiant à des identités trans ou non binaires en Ontario auraient été habitées de façon importante, au cours de l’année qui précède, par l’idée de mettre fin à leurs jours.
Plusieurs chercheurs et chercheuses qui s’opposent à l’idée de laisser les personnes concernées s’actualiser par une transition de genre, qu’elle soit sociale ou médicale, se réfèrent souvent à ce taux élevé de pensées suicidaires pour défendre l’idée selon laquelle les individus qui souhaitent entreprendre ce parcours seraient d’abord des personnes malades qui devraient être guéries de leurs pensées irrationnelles. S’appuyant souvent sur l’étude du Karolinska Institute en Suède (Dhejne et al., 2011), qui présentait dans sa conclusion un lien persistant entre les problèmes de santé mentale et l’identité trans, même une fois la transition complétée, cette position clinique argumente que laisser les personnes s’autodéterminer dans leur identité de genre n’est pas la solution à la détresse que cette clientèle peut vivre. Or, ces conclusions peuvent être remises en cause si l’on prend en considération les nombreuses études subséquentes à cette observation, notamment celle réalisée par Zeluf et al. en 2016 et dont la conclusion semble assez claire :
Les résultats de cette étude démontrent que la santé générale des répondants trans est reliée à des vulnérabilités qui sont spécifiques aux personnes trans, incluant une identité de genre non binaire, un historique d’expériences négatives rattachées à des soins de santé et le fait que le genre ne fasse pas l’objet d’une reconnaissance légale, en plus des déterminants de santé bien connus comme le statut d’emploi, le revenu, l’âge et le soutien social.
p. 14; traduction libre[4]
Les résultats de l’étude Trans PULSE citée précédemment vont également dans ce sens alors que l’on peut observer un lien clair entre le niveau de discrimination vécue et la présence d’idées suicidaires. Dès lors, il semble possible d’arriver à une autre lecture, sans mettre d’emblée en doute le bien-fondé de l’autodétermination du genre, en examinant notamment l’hypothèse que le désir de mettre fin à ses jours soit le résultat final du sentiment de mort psychique vécu par le sujet. En d’autres mots, le fait de ne pas avoir le droit d’exister dans son identité au regard des autres rendrait l’existence insupportable au point d’en arriver à des agirs autodestructeurs pouvant prendre plusieurs formes, de l’automutilation jusqu’au suicide. Par conséquent, la « morbidité » psychologique ainsi que les idées suicidaires auraient été précédées par une mise à mort du Soi à la suite d’une accumulation de rencontres invalidantes avec le monde. Selon cette perspective, le désir de s’enlever la vie, tout comme le sentiment dysphorique que l’on retrouve chez plusieurs personnes trans, pourrait survenir lorsque l’individu a perdu de vue la question posée par Janet Mock (2017) et citée en début de texte, « Qui suis-je pour moi? », au-delà des discours intériorisés.
Dans ce contexte, comment peut-on intervenir pour que le désir de mort laisse place à la vie ou la côtoie? Plusieurs possibilités semblent prometteuses pour surmonter ce défi. La première, souhaitable et nécessaire, est celle de l’activisme social afin de diminuer les nombreuses discriminations qui répriment le désir d’actualisation des personnes trans ainsi que les entraves (gatekeeping[5]) à l’accès aux ressources facilitant la transition.
En ce qui concerne le travail de thérapie, nous estimons que, pour contribuer à l’émergence de l’authenticité et du désir de vie, l’approche psychologique du Soi, elle-même ancrée dans les postulats de la psychologie humaniste-existentielle ainsi que dans ceux de l’approche psychodynamique intersubjective, peut fournir des appuis théoriques et cliniques par sa compréhension du lien entre la souffrance psychique, la finitude et le désir d’actualisation authentique de l’individu. En outre, nous soutenons que les pistes de réflexion suggérées dans cet essai font écho au principe fondateur du World Professional Association of Transgender Health (WPATH), soit celui de l’humilité culturelle (Hook et Watkins, 2015).
Cet article s’articule donc autour de l’idée selon laquelle le désir de mort chez les personnes trans prend d’abord racine dans la non-reconnaissance de leur identité et la violence qui l’accompagne, de même que dans un sentiment de finitude psychologique découlant de ces invalidations. Utilisant la forme de l’essai théorique soutenu par des exemples cliniques, nous présentons cette perspective à partir des postulats de la psychologie humaniste-existentielle du Soi. Par la suite, nous identifions les traumatismes développementaux vécus par les personnes trans, en intégrant également les liens entre ceux-ci et la finitude existentielle. Dans un dernier temps, nous décrivons les attitudes relationnelles thérapeutiques prônées par cette approche, attitudes qui demeurent essentielles afin de redonner un élan de vie à la personne qui fait la démarche de se présenter en thérapie. Plus précisément, nous évaluons comment le principe d’humilité culturelle, plus qu’un simple guide éthique, peut s’actualiser comme moyen thérapeutique face au traumatisme de la finitude.
La psychologie du Soi et l’identité de genre
Dans sa théorie de la personnalité, le Soi a été présenté par Rogers comme la tendance de chaque individu à agir dans le but de s’actualiser, amenant l’être à s’individualiser au travers de ses expériences vécues (Ismail et Tekke, 2015). Pour l’approche gestaltiste, le Soi est présenté comme un système d’action flexible par lequel on entre en contact avec l’environnement, ce qui demande nécessairement des ajustements créateurs de la part de l’organisme et de l’environnement (Perls, Hefferline et Goodman, 1979). Treuniet (1980) définit pour sa part le Soi comme « un univers de sentiments conscients et inconscients que l’individu a de lui-même comme centre de son expérience » (p. 325; traduction libre). Lynch (2006) précise, quant à lui, que ce sentiment, qui se développerait dès le 18e mois de notre existence, serait par définition ancré dans notre relation au monde, c’est-à-dire fondamentalement de nature intersubjective.
De ces définitions, nous retenons que le Soi peut être compris comme le sentiment que chaque personne entretient intimement vis-à-vis de sa propre vision identitaire en relation avec le monde. Un élément central à cette approche de la psychologie clinique concerne le fait que ce sens identitaire se développe en relation avec l’environnement. Également, il convient de préciser que cette intersubjectivité ne saurait être dissociée de l’expérience du corps vécu et affectif (Stolorow et Atwood, 1992). Ainsi, avant même que l’enfant ne développe la capacité de parole, elle ou il rencontre le monde via ses sensations corporelles. Toutefois, cette rencontre sensorielle du monde dès les premiers moments de l’enfance est souvent teintée par l’assignation de genre et de sexe que l’on a attribué à cet enfant, fille ou garçon. Par exemple, ceci peut aller du choix de couleur de la chambre de l’enfant au comportement du père osant plus d’audace physique avec celui perçu comme un garçon. Dès lors, il est légitime de se demander ce qui arrive à l’ajustement du Soi, à la base du développement identitaire de la personne, lorsque l’identité intime de l’individu quant à son genre se heurte à une perspective différente, imposée par son environnement.
Cette question introduit l’autre caractéristique commune à toutes les définitions que l’on retrouve chez les autrices et auteurs cités précédemment, soit l’idée que la souffrance psychologique survient lorsque s’établit une dissonance entre la volonté d’actualisation de ce Soi et les expériences relationnelles vécues : « La description de la santé et de la maladie psychologiques est relativement simple. C’est une question d’identifications et d’aliénations du Moi[6] » (Perls, Hefferline et Goodman, 1979, p. 19). Ainsi, lorsque ce Soi se heurte à des invalidations constantes et répétées, la personne aurait tendance à développer une souffrance psychologique et se sentirait particulièrement affectée par ce déni constant de son existence. Lynch (2006) parle même d’un désordre structurel[7]. En fait, le manque de réponses bien adaptées de la part de son entourage empêcherait une saine intégration de son identité propre (Nicholson, 2006). Dès lors, ces observations donneraient du poids à l’affirmation de Zeluf et al. (2016) voulant que la psychopathologie survienne chez les personnes trans en réponse à un contact avec l’environnement qui ne serait pas en harmonie avec le genre par lequel la personne se définit comme sujet. Par conséquent, la dysphorie qui est souvent considérée comme un élément quasi ontologique, caractéristique intrinsèque de l’identité trans, pourrait être envisagée, dans la perspective de la théorie du Soi, comme une conséquence des failles dans la reconnaissance, par les autres, de l’identité de genre de l’individu.
La psychologie du Soi s’intéresse à la manière dont l’individu se sent exister dans le monde; le postulat qui oriente cet article présume que l’identité de genre fait partie intégrante de ce sentiment. En fait, une fois l’intériorisation et la compréhension de l’identité de genre établies, les enfants transgenres de six ans auraient la même identité explicite et implicite que les enfants cisgenres (Olson, Key et Eaton, 2015). En outre, ces enfants auraient une vision différente de la constance du genre, en comparaison avec celle de leurs pairs, la comprenant comme plus flexible (Fast et Olson, 2018). À cet âge, il ne serait par conséquent pas question de dysphorie, mais d’identité vécue, le mal-être émergeant plutôt lorsque l’enfant se rend compte que son sentiment identitaire ne concorde pas avec le reflet que l’environnement lui renvoie, ou lorsqu’on lui impose une vision rigide du genre qui ne concorde pas avec son sentiment ou encore lorsqu’on lui ajoute des obstacles à l’accès à des soins de transition. Dès lors, il est légitime de penser que les enfants, garçons ou filles, affichant ouvertement et de façon stable une identité trans ne vivent pas tant de la confusion que de la cohérence avec un sentiment identitaire authentique, jusqu’à ce que l’environnement en vienne à invalider celui-ci. Le corps vécu peut aussi jouer un rôle important durant cette période de l’enfance où l’identité de genre se développe, et tout au long de l’existence de l’individu. En effet, Merleau-Ponty (1945) a pu montrer combien le corps vécu est un corps phénoménal, existant autant pour soi que pour autrui. Le sens qu’il prend pour l’enfant se vit dans l’interaction sociale et, notamment, à travers la perception de ses pairs : « [Son] existence comme subjectivité ne fait qu’un avec [son] existence comme corps » (p. 437). Ainsi, le fait d’empêcher l’accès à une transition médicale, notamment sous forme de bloqueurs d’hormones à l’adolescence, ou d’insister sur une identité assignée à l’enfant en fonction de nos préjugés concernant le rapport entre le sexe apparent et le genre, peut contribuer à l’émergence de ce sentiment de mal-être persistant chez l’enfant trans.
Traumatisme développemental complexe et finitude
La notion de trauma développemental complexe fait partie de plusieurs modèles théoriques de psychologie relationnelle (Cloitre et al., 2011) et se trouve au coeur de la psychologie existentielle (Stolorow, 2011). Elle nous apparait également déterminante dans la compréhension de ce que peuvent vivre les personnes trans en lien avec la finitude. L’idée centrale serait celle d’une exposition répétée à des relations malsaines et des attachements problématiques qui amèneraient l’individu à un évitement expérientiel (Mlotek et Paivio, 2017). Plus précisément, dans la théorie du Soi, ce type de traumatisme se développerait à partir d’expériences récurrentes de mauvais ajustements, l’enfant assimilant une conviction inconsciente que ses besoins développementaux et sa souffrance sont des manifestations d’une défectuosité vécue comme répugnante (Stolorow, 2011). Lorsque cette conviction est intériorisée au plus profond de l’être à travers la rencontre d’un monde cisnormatif[8], la personne trans peut en arriver à penser qu’elle doit lutter contre son propre sentiment identitaire pour pouvoir exister, surtout si l’invalidation vient d’un donneur de soins significatif. Ainsi, selon ce point de vue, la psychopathologie prendrait naissance dans la dissonance entre le développement de l’identité et l’expérience relationnelle vécue dans le monde et s’ancrerait plus profondément dans l’individu lorsque cette dissonance se répète tout au long du développement de la personne, notamment dans ses relations significatives.
Pour les personnes trans, les occasions de traumatismes s’avèrent nombreuses et souvent difficiles à éviter dans une société cisnormative. Pour un garçon trans, cela peut être de vivre l’insensibilité de parents qui ne perçoivent pas son malaise lorsqu’ils lui disent à quel point « elle est belle » dans sa petite robe neuve. Pour l’adulte, cela pourrait être de revivre ces invalidations au travers de petits gestes comme le fait d’être désigné par un pronom qui ne lui correspond pas, qui plus est dans des situations de vulnérabilité comme une visite médicale pour des soins de santé. La première autrice de ce texte, elle-même une femme trans, se rappelle plusieurs situations vécues comme des coups de poing au coeur, se faisant appeler « monsieur » au téléphone à cause de sa voix à la tonalité plus basse. Ceci résonne avec l’observation de Curtin, Diamond et McHugh (2016) voulant que ces situations associées au stress de minorité vécues par les personnes trans restent susceptibles d’entrainer une détresse pouvant notamment se traduire par une difficulté à réguler ou contenir des affects douloureux.
Cette adaptation problématique peut prendre plusieurs formes complexes et ne concerne pas toujours le seul sentiment identitaire, mais peut aussi inclure la gamme d’émotions vécues et réprimées dans le contact frustrant avec un environnement cisnormatif. Par exemple, alors que les parents de l’autrice principale lui témoignaient leur déception de ne pas avoir été informés plus tôt de sa transition, celle-ci a ressenti de la culpabilité, faisant ainsi passer au deuxième plan ses propres émotions, notamment la peur d’être rejetée, ou même la colère de ne pas avoir été entendue auparavant. Ainsi, plusieurs personnes trans peuvent en venir à sentir qu’elles doivent ménager leur famille et leur entourage. Ceci peut aller jusqu’à s’attribuer la responsabilité de l’expérience émotionnelle des parents au détriment de la leur. Que faire avec cette charge affective restante qui n’a pas pu être exprimée?
La notion d’évitement expérientiel évoquée plus tôt (voir Mlotek et Paivio, 2017) doit aussi être soulignée. Que ce soit en ne vivant pas pleinement son identité de genre ou en n’ayant pas l’espace pour exprimer les émotions complexes liées à une absence de validation, sens de Soi et sentiment d’authenticité en viennent à se dissocier, exposant l’individu de manière anticipée à la question de sa finitude. En effet, selon l’approche existentielle de la psychologie, la conscience de la mort comme condition de notre existence, avec le sens qu’elle donne à nos choix, est souvent occultée à la fois socialement, mais aussi existentiellement. La confrontation brutale à la possibilité de ne pas être soi, avant la fin de son existence, peut amener l’individu à souhaiter que sa vie se termine prématurément, par manque de sens (Stolorow, 2011). Si ces expériences relationnelles sont vécues comme une forme de violence ontologique, la personne en viendra à se protéger en tuant l’identité non acceptée, pour introjecter[9] un faux Soi modelé sur les attentes de son entourage. La mise à mort de l’identité de genre devient donc l’ultime protection pour survivre dans un monde où cette identité ne peut s’exprimer ouvertement. En outre, l’évitement devient encore plus nécessaire comme mécanisme de survie lorsqu’il y a une relation d’attachement qui place l’enfant en position de dépendance matérielle ou affective avec un donneur de soins (Lynch, 2006). Dès lors, l’enfant qui développe une identité de genre non conforme avec les attentes des parents en vient à parfois devoir faire un choix déchirant entre l’amour de ceux-ci, nécessaire à sa survie, et l’actualisation de son Soi, choix possiblement traumatique que l’on doit éviter de reproduire en situation thérapeutique.
L’apport actuel des neurosciences témoigne de l’impact neurologique des traumatismes. L’expérience d’invalidations successives vécues à travers les relations d’attachement laisse des traces dans le développement du cerveau, surtout au plan des régulateurs des émotions (Schore, 2008). Par ailleurs, ces failles empathiques répétées peuvent facilement paver le chemin à un sentiment de honte, introjecté par le sujet (Orange, 2008). Or, la honte est un sentiment qui serait très présent chez les personnes de la communauté trans (Petrocchi et al., 2016).
Stolorow (2011) explique ce lien grâce aux fondements existentialistes de la psychologie du Soi. Pour lui, une exposition répétée à la non-reconnaissance de son expérience risque d’amener la personne à réaliser la possibilité d’une non-actualisation de son Soi, c’est-à-dire la finitude.
La réponse adéquate à ces traumatismes nécessiterait, toujours selon Stolorow, de s’approprier un chemin vers l’authenticité; pour y parvenir, il faut que cette démarche se réalise à l’intérieur d’un espace relationnel tout aussi authentique que bienveillant : « Les expériences émotionnelles douloureuses s’enracinent de façon traumatisante en l’absence d’un contexte intersubjectif dans lequel elles peuvent être contenues et intégrées » (p. 28; traduction libre). Dans un cadre thérapeutique, l’intervenant ou l’intervenante doit manifester certaines attitudes particulières pour permettre et favoriser, jusque dans son identité de genre, l’actualisation du Soi de sa cliente ou son client.
Retrouver l’authenticité du genre à travers la relation thérapeutique
La morbidité psychologique qui précède les agirs autodestructeurs comme l’automutilation ou le suicide peut, de fait, être liée à une invalidation traumatique répétée de la part de l’environnement affectif et social du Soi. Dans le contexte de l’identité de genre, nous avançons l’hypothèse que la dysphorie est la conséquence de ces traumatismes, et non pas une forme de fondement ontologique de l’identité trans, ce que le monde médical utilise pour valider le droit à l’accès à certains traitements. La solution évoquée serait de mettre en place un cadre relationnel permettant au Soi de se redécouvrir authentiquement ou, pour reprendre la métaphore de l’activiste Janet Mock, il faut comme au pays d’Oz suivre le chemin de briques jaunes. La psychologie humaniste-existentielle et la psychologie psychodynamique intersubjective ont toutes deux élaboré des conditions qui favorisent l’émergence de l’authenticité nécessaire à l’atteinte de cette actualisation du Soi. Nous estimons que ces valeurs et positions relationnelles sont d’autant plus essentielles dans l’accompagnement de la personne dans son devenir et dans l’actualisation de son identité de genre. L’autrice principale se souvient d’ailleurs du grand apaisement vécu lors d’une première rencontre avec une sexologue qui a accueilli son sentiment identitaire. Toutefois, recevoir avec empathie l’expérience de dévoilement de la personne trans implique une conscience de toute la complexité affective qui émerge des traumatismes antérieurs de l’invalidation de l’identité de genre, et surtout du conflit entre les besoins relationnels affectifs et le besoin d’actualisation authentique. En effet, si le déni de l’identité de genre est vécu de façon aussi traumatique par la personne trans, c’est surtout parce qu’elle a besoin, pour exister, de ce monde qui pourtant l’invalide. Voici quelques attitudes susceptibles d’insuffler un élan de vie euphorique dans le Soi dysphorique de plusieurs personnes trans. Ces attitudes ont pour finalité de permettre une expérimentation du Soi potentiel à l’intérieur d’une relation thérapeutique ressentie comme sécuritaire par la personne qui consulte (Rogers, 1968).
De l’acceptation inconditionnelle à l’herméneutique de confiance
La première attitude favorisant le retour de l’authenticité vitale de toute personne, incluant les individus trans, est de valider le droit d’exister via l’acceptation inconditionnelle de la personne qui consulte. Cette attitude semble essentielle, surtout lorsque l’on sait que le simple fait de respecter les choix de prénom d’une personne trans peut avoir un effet d’apaisement des idées et des agirs suicidaires (Russel et al., 2018). Cela peut paraitre simple en apparence, mais la mise en application peut se heurter à de nombreux écueils si on prend en considération la complexité des deux subjectivités qui se rencontrent, celle de la personne thérapeute et celle de la personne trans qui demande de l’aide.
Pour Kahn (1991), le succès d’une thérapie dépend de la capacité de la personne thérapeute à ne pas perdre de vue la valeur de l’être humain qui est devant elle, et ce même si la personne qui consulte va « inévitablement révéler des sentiments qui entrent en conflit avec les valeurs ou l’esthétisme du thérapeute » (p. 46). Et ces conflits restent inévitables, peu importe notre niveau d’ouverture, car la réalité subjective de l’autre ne sera jamais la nôtre. L’autrice principale de ce texte a beau être une femme trans, elle reste habitée par une culture du genre binaire propre à sa génération et il lui est arrivé à plusieurs reprises en clinique d’être mise en présence de manifestations de valeurs qui confrontaient ses propres intériorisations de ce qu’est l’identité de genre, notamment avec des personnes se réclamant d’une identité de genre fluide ou non binaire.
Pour Orange (2002), le simple fait de travailler, en collaboration avec la personne qui consulte, à créer une atmosphère de permission émotive permet de commencer à déconstruire le sentiment de honte que l’on sait très présent chez les personnes trans : « Les mondes d’expérience sont transformés seulement dans une atmosphère d’acceptation radicale » (p. 96; traduction libre[10]). Ce manque de validation est tellement écrasant chez les personnes trans que l’une des autrices raconte avoir été fortement sollicitée dans sa clinique lorsque la rumeur s’est répandue qu’elle accueillait avec respect les questionnements sur l’identité de genre. Mais il ne suffit pas d’accepter; il faut aussi communiquer de façon claire et authentique cette acceptation (voir Rogers, 1968).
Pour ce faire, les approches humanistes favorisent un processus appelé le dialogue herméneutique. Dans la relation thérapeutique, l’herméneutique est l’art de l’interprétation, interprétation suffisamment créatrice pour restaurer la capacité à construire du sens avec l’altérité (Hamel, 2012). L’objectif de ce dialogue est de soutenir l’exploration du Soi par un questionnement ou des hypothèses qui favorisent l’émergence de réflexions nouvelles qui tiennent compte de la complexité du vécu affectif de la personne qui consulte. Par exemple, dans le cas d’une personne trans, cela peut être de réfléchir sur le sens d’un évitement des professionnelles et professionnels de la santé et cela, sans jugement préconçu.
Orange (2011) identifie deux formes d’herméneutique pouvant se présenter en situation thérapeutique. L’une de ces formes est ancrée dans le doute, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur des théories déterministes afin de lire les motivations de l’autre de manière hermétique. En psychologie de la santé trans, on retrouve sous cette vision plusieurs interprétations théoriques, notamment l’hypothèse qu’une identité trans pourrait être le résultat d’un conflit oedipien, ou encore qu’elle est la conséquence d’une pulsion autogynéphilique, qu’elle n’est possiblement qu’un effet de mode, ou toute autre théorie explicative qui prétend en savoir davantage sur le vécu que la personne qui l’expérimente. Orange oppose cette herméneutique à celle de la confiance. Cette dernière façon d’interpréter exige de la personne thérapeute de garder à la conscience le fait que, dans un cadre thérapeutique, elle entre avec sa subjectivité dans un monde déjà existant qui n’est pas le sien et qui risque de bouleverser ses convictions.
Cette forme d’herméneutique, qui est celle par laquelle peut se communiquer l’acceptation, aurait pour effet, selon Orange (2011), de diminuer la position défensive du Soi et de favoriser l’émergence de son authenticité. L’objectif des interprétations ne serait pas tant ici d’être justes que d’encourager la personne à s’approprier son vécu, à le mentaliser et ce, dans le but d’en favoriser l’actualisation (Hamel, 2012). Nous retrouvons dans cette position l’écho de la notion d’humilité culturelle, favorisée par le WPATH, conceptualisée comme « un respect et une considération pour l’autre, un intérêt sincère pour celui-ci, une ouverture à explorer et une volonté de comprendre la perspective de l’autre sans préconceptions, sans se donner des airs supérieurs, sans prendre pour acquis ce qui est connu d’emblée culturellement à propos de l’autre » (Hook et Watkins, 2015, p. 661; traduction libre[11]).
L’empathie et la complexité de l’expérience de l’identité trans
Le médium favorisé par la psychologie humaniste pour l’accompagnement est sans équivoque l’empathie (Kahn, 1991). Or, l’empathie implique pour Kahn une capacité de se plonger dans le monde expérientiel et affectif de l’autre sans pour autant se perdre de vue comme individu. L’objectif est de permettre au Soi en développement d’entrer en contact avec toute la complexité de son expérience affective et relationnelle.
Par exemple, bien que son premier contact avec une sexologue ait permis à l’autrice principale la prise de conscience fondamentale qu’elle était accueillie dans son être propre, elle a tout de même vécu des moments qui, avec le recul, ont été ressentis comme des failles empathiques de la part de sa thérapeute. En effet, elle exprimait sa volonté de transition, son désir d’être acceptée dans son identité propre, mais également de nombreuses émotions conflictuelles. Celles-ci pouvaient inclure une culpabilité face à un sentiment d’égocentrisme, la peur des conséquences ou même une transphobie intériorisée (telle que décrite par Curtin, Diamond et McHugh, 2016) comme une forme d’intériorisation du stress de minorité. Ainsi, l’autrice, dans sa position de cliente, a ressenti que la sexologue tentait de la rassurer trop rapidement sans prendre le temps de véritablement accueillir pleinement cette partie de son expérience dans laquelle se trouvent possiblement les racines de sa honte. La sexologue aurait alors en partie failli à ces questions que pose Rogers (1968) comme condition de l’accompagnement d’autrui : « Puis-je pénétrer dans son univers intérieur assez complètement pour perdre tout désir de l’évaluer ou de le juger? Puis-je entrer avec assez de sensibilité pour m’y mouvoir librement, sans piétiner des conceptions qui lui sont précieuses? » (p. 42). Par conséquent, il faut comprendre que la condition d’authenticité du Soi pour la personne trans consiste à pouvoir explorer toutes les facettes de son expérience, ce qui peut inclure de la culpabilité, de la peur ou encore de la honte.
À titre d’exemple, l’une de ces facettes pourrait prendre la forme d’un conflit entre l’expérience de non-acceptation et une opinion qui se généralise voulant que d’être une personne trans ne soit plus un problème aujourd’hui. En effet, un sondage Angus Reid (2016) dévoilait que près de 80 % des répondantes et des répondants canadiens estimaient que cette question était maintenant réglée. Or, on le sait, la réalité est loin d’être aussi simple. Confrontée au clivage entre ce discours et l’expérience vécue teintée d’invalidations, la personne trans pourrait en venir à ressentir comme un échec le fait de ne pas être capable de passer outre une transphobie intériorisée.
L’autrice trans a vécu ce conflit durant son coming out, un moment marquant pour toute personne issue des minorités sexuelles et de genre. En fait, alors que cette dernière vivait avec grande anxiété son propre dévoilement, elle se faisait refléter par plusieurs que son sentiment n’était pas justifié considérant les progrès actuels dans l’acceptation sociale, alors que pourtant celle-ci était confrontée à un discours transphobe de façon presque hebdomadaire sur les réseaux sociaux. Une des conséquences fut un mélange entre la colère de ne pas se sentir considérée dans cette épreuve et la culpabilité de ne pas arriver à surmonter cette peur. Cet exemple autobiographique permet de souligner le rôle réparateur de l’accordage affectif de la personne thérapeute. En effet, il s’agit de favoriser l’authenticité de la personne en permettant à l’entièreté de son expérience de coming out d’exister en thérapie, notamment en acceptant toute la complexité conflictuelle de ce vécu.
La conscience réflexive et le cissexisme
L’acceptation et l’empathie au service de l’élaboration d’une l’identité de genre authentique est un principe en apparence simple, mais qui exige de développer une bonne conscience réflexive en relation (Lecomte et al., 2004). En effet, l’ajustement créateur nécessaire au Soi en devenir peut se heurter à des invalidations répétitives, et ce même dans les thérapies les plus bienveillantes. Peu importe notre ouverture, comme thérapeutes, nous faisons partie intégrante de ce monde cissexiste qui contribue à invalider et à traumatiser le Soi dans son identité de genre. Cela se produit lorsque la personne thérapeute utilise sans s’en rendre compte des termes renforçant une culture normative du genre, par exemple en tenant pour acquis des aprioris quant à ce que représente le fait d’être un homme ou une femme.
Selon Rogers (1968), la personne thérapeute doit pouvoir se poser la question : « Ma sécurité interne est-elle assez forte pour lui permettre, à lui [autrui], d’être indépendant? » (p. 41). Mais pour réussir à bâtir cette sécurité contenante, la personne thérapeute doit d’abord apprendre à s’écouter et à se connaitre, peu importe la clientèle. Mais le travail avec des personnes trans exige de la personne thérapeute de se poser certaines questions spécifiques. Est-ce que l’identité de genre que présente la personne qui consulte vient confronter des fragilités en moi? Est-ce que l’existence de la non-binarité du genre me bouscule dans mes propres fondements existentiels? Dans le cas d’une personne qui exprime une résistance à la rencontre thérapeutique souvent imposée par le monde médical, est-ce que je peux accueillir son doute pour ce qu’il est, c’est-à-dire l’expression d’un Soi qui cherche à s’actualiser et non comme une attaque vis-à-vis de mes compétences de thérapeute? Ces éléments, propres à tout processus thérapeutique, prennent d’autant plus de sens face à une personne trans, en raison d’expériences d’invalidations personnelles et culturelles si fréquemment subies.
Pour Donna Orange (2002), la conscience réflexive en relation thérapeutique devient surtout importante lorsque vient le temps de travailler la honte, sentiment au coeur des idées autodestructrices de plusieurs personnes trans. En fait, elle explique que la honte se manifesterait dans la thérapie de façon intersubjective, c’est-à-dire qu’elle serait vécue autant par la personne thérapeute que la personne qui demande de l’aide. Pour que la personne qui consulte puisse intérioriser qu’être soi, de manière authentique, n’est pas quelque chose d’inadéquat, il faut qu’il y ait une réparation qui prend en considération la part de honte que porte la personne thérapeute. Il s’agit donc d’une responsabilité conjointe qui exige de la personne thérapeute d’être consciente de sa propre honte à tout moment, et surtout de ne pas l’agir. Elle se pose alors des questions : Ai-je honte de ne pas accepter l’autre dans son identité au point de compenser par de la réassurance? Est-ce que je suis sur la défensive face au constat que je fais aussi partie de cette société cisnormative? Est-ce que je suis capable d’entendre que la personne devant moi est frustrée dans son autodétermination lorsque je me vois dans l’obligation de mettre en place un processus d’évaluation pour permettre l’accès à certains services médicaux? Comment est-ce que je réagis face à mon sentiment d’impuissance lorsque la personne devant moi me raconte avoir été rejetée par sa famille, ou qu’elle a perdu son emploi en raison de sa transition? Si la personne trans devant moi corrige mon vocabulaire, vais-je agir ma honte en reprenant ma position toute puissante et en utilisant mon expertise pour corriger à mon tour cette personne? C’est dans cette perspective humaniste que la notion d’humilité culturelle prônée par le WPATH semble prendre tout son sens et qu’elle peut être comprise non pas comme un simple principe éthique, mais comme un savoir-être qui est thérapeutique en soi.
De la dysphorie vers l’euphorie
Les théories du Soi en psychologie humaniste-existentielle aident à saisir que le risque suicidaire chez les personnes trans peut être compris comme le résultat de traumatismes relationnels répétés et intériorisés. La dissociation de l’authenticité serait, selon cette perspective, une protection contre une finitude existentielle qui résulterait d’une non-reconnaissance du Soi par l’environnement. Ainsi, la dysphorie pourrait être interprétée plutôt comme un résultat d’un blocage dans l’actualisation de l’authenticité. C’est pourquoi nous insistons sur l’importance des attitudes propices à rétablir un contact avec l’authenticité identitaire chez la personne trans. Cette façon de voir l’accompagnement nous semble en effet susceptible de permettre l’émergence d’un désir de vie auparavant dissocié.
La question que nous posons en terminant est la suivante : comment réconcilier les exigences d’évaluations, souvent nécessaires pour avoir accès à certains traitements médicaux ou sociaux de transition, avec une perspective humaniste proposant une lecture plus fondamentale et existentielle? Si la dysphorie peut apparaitre comme la réponse adaptative à un traumatisme existentiel, celui de la confrontation brutale à la finitude, suite à la non-acceptation fondamentale de sa propre identité par l’autre, doit-on nécessairement attendre qu’elle se manifeste pour permettre ces traitements? Ne pourrait-on pas prévenir, ou du moins atténuer, les impacts de son émergence en étant davantage à l’écoute de l’actualisation des individus? Et quels impacts ce gatekeeping aurait-il sur l’alliance thérapeutique et le travail d’herméneutique dans l’acceptation décrite ci-haut? Ces questions témoignent du fait que cette réflexion n’est pas terminée et qu’il y a beaucoup à faire pour donner toute sa portée à la richesse de la conceptualisation humaniste en lien avec la complexité de l’actualité clinique.
Appendices
Notes
-
[1]
« How do we better listen to ourselves and start shutting out the voices that rebut us? Asking question “who am I to me” led me to answers that embolden me. Those answers are the foundations into which I stand here today assured and affirmed in my truth. For me, authenticity was my yellow brick road leading me to success in life. Who I am to me? That’s the question. » Dans cet extrait, le chemin de briques jaunes fait référence au pays d’Oz.
-
[2]
Trans PULSE est un projet de recherche communautaire longitudinal qui récolte de l’information sur la réalité des personnes trans depuis 2004. Il a pour but d’identifier et de répondre aux enjeux de santé et de services sociaux qui concernent la communauté de personnes trans.
-
[3]
Le présent article a été rédigé en 2017. Depuis, l'équipe de Trans PULSE Project a publié de nouvelles données récoltées en 2019 et qui iraient sensiblement dans le même sens. Nous notons également que le vocabulaire consensuel en santé des personnes trans et non binaires a évolué suite à un effort de sensibilisation de la communauté pour devenir plus inclusif. Si nous avions à rédiger cet article en 2020, certaines formulations plus inclusives, comme le langage non binaire, seraient à privilégier.
-
[4]
« The results of this study demonstrate that the general health of trans respondents is related to vulnerabilities that are unique for trans people and include nonbinary gender identity, history of negative health care experiences and not accessing legal gender recognition, in addition to well-known health determinants such as employment status, income, age and social support. »
-
[5]
Le gatekeeping fait référence aux exigences formulées envers les personnes trans pour avoir accès à des ressources de transition, par exemple des traitements hormonaux ou des chirurgies, ou encore l’accès à un changement d’identité sur les documents officiels.
-
[6]
Dans la littérature humaniste, la notion de « Moi » est parfois utilisée de façon interchangeable avec celle de « Soi ». Dans le contexte de cette citation, le « Moi » est associé à la même définition que celle déjà présentée pour le « Soi ».
-
[7]
« The person who experiences pervasive empathic failures in one or all sectors of selfobject needs is likely to develop a disorder of the self structure. »
-
[8]
La cisnormativité fait référence à la supposition presque automatique de la société que tous les humains sont considérés comme cisgenres (c’est-à-dire confortables avec le genre assigné à leur naissance). Par exemple, elle se manifeste dans le fait de ne penser les toilettes publiques qu’en fonction d’une binarité du genre sans prendre conscience de l’existence de personnes s’identifiant au genre non binaire.
-
[9]
L’introjection est décrite par la psychologie humaniste comme une forme d’intériorisation forcée d’idées, de valeurs ou d’émotions.
-
[10]
« Experiential worlds, I believe, are transformed only in an atmosphere of radical acceptance… »
-
[11]
« … being respectful and considerate of the other; being genuinely interested in, open to exploring, and wanting to understand the other’s perspective; not making foreordained assumptions; not acting superior; and not assuming that much is already culturally known about the other. »
Bibliographie
- Angus Reid INSTITUTE (2016). Transgender in Canada: Canadians Say Accept, Accommodate, and Move On, 7 septembre, http://angusreid.org/transgender-issues/.
- BauEr, G. R. et A. I. Scheim (2015). Transgender People in Ontario, Canada. Statistics from the Trans PULSE Project to Inform Human Rights Policy, London (ON), Trans PULSE, http://transpulseproject.ca/wp-content/uploads/2015/06/Trans-PULSE-Statistics-Relevant-for-Human-Rights-Policy-June-2015.pdf.
- Cloitre, M., C. A. COURTOIS, A. CHARUVASTRA, R. CARAPEZZA, B. C. STOLBACH et B. L. GREEN (2011). « Treatment of complex PTSD: Results of the ISTSS expert clinician survey on best practices », Journal of Traumatic Stress, vol. 24, no 6, p. 615-627.
- Curtin, A., L. Diamond et L. McHugh (2016). « Self and perspective taking for sexual minorities in heteronornative world », dans M. Skinta et A. Curtin, Mindfulness & Acceptance for Gender & Sexual Minorities. A Clinician Guide to Fostering Compassion, Connection & Equality Using Contextual Strategies, Oakland (CA), Context Press, p. 11-27.
- DHEJNE, C., P. LICHTENSTEIN, M. BOMAN, A. L. V. JOHANSSON, N. LÅNGSTRÖM et M. LANDÉN (2011). « Long-term follow-up of transsexual persons undergoing sex reassignment surgery: Cohort study in Sweden », Plos One, vol. 6, no 2, p. 1-8.
- Fast, A. A. et K. R. Olson (2018). « Gender development in transgender preschool children », Child Development, vol. 89, no 2, p. 620-637.
- Hamel, C. (2012). « Le dialogue herméneutique, la régulation affective et la mentalisation », dans L. Girard et G. Delisle, La psychothérapie du lien : genèse et continuité, Montréal, Les Éditions du CIG, p. 134-168.
- Hook, J. N. et C. E. Watkins (2015). « Cultural humility: The cornerstone of positive contact with culturally different individuals and groups? », American Psychologist, vol. 70, no 7, p. 661-662.
- Ismail, N. A. et M. Tekke (2015). « Rediscovering Roger's self theory and personnality », Journal of Educational, Health and Community Psychology, vol. 4, no 3, p. 143-150.
- Kahn, M. (1991). Between Therapist and Client: The New Relationship, New York, W. H. Freeman and Company.
- Lecomte, C., R. SAVARD, M.-S. DROUIN et V. GUILLON (2004). « Qui sont les psychothérapeutes efficaces? Implications pour la formation en psychologie », Revue québécoise de psychologie, vol. 25, no 3, p. 73-102.
- Lynch, V. J. (2006). « Basic concepts », dans H. Jackson (dir.), Using Self Psychology in Psychotherapy, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, p. 15-25.
- Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard.
- Mlotek, A. E. et S. C. Paivio (2017). « Emotion-focus therapy for complex trauma », Person-Centered & Experiential Psychotherapies, vol. 16, no 3, p. 198-214.
- Mock, J. (2015). « Sharing the stage with Oprah: My super soul sessions speech », Janet Mock, 15 décembre, http://janetmock.com/2015/12/15/sharing-the-stage-with-oprah-my-super-soul-sessions-speech/.
- MOCK, J. (2017). Surpassing Certainty: What My Twenties Taught Me, New York, Astria Book.
- Nicholson, B. L. (2006). « Narcissism », dans H. Jackson (dir.), Using Self Psychology in Psychotherapy, Lanham (MD), Rowman & Littlefield, p. 27-49.
- Olson, K. R., A. C. Key et N. R. Eaton (2015). « Gender cognition in transgender children », Psychological Science, vol. 26, no 4, p. 467-474.
- Orange, D. M. (2002). « There is no outside: Empathy and authenticity in psychoanalytic process », Psychoanalytic Analysis, vol. 19, no 4, p. 686-700.
- Orange, D. M. (2008). « Whose shame is it anyway? Lifeworlds of humiliation and systems of restoration (or “The analyst's shame”) », Contemporary Psychoanalysis, vol. 44, no 1, p. 83-100.
- Orange, D. M. (2011). The Suffering Stranger: Hermeneutics for Everyday Clinical Practice, New York / Londres, Routledge.
- Perls, F., R. E. Hefferline et P. Goodman (1979). Gestalt thérapie : vers une théorie du Self, Montréal, Alain Stanké.
- PETROCCHI, N., M. MATOS, S. CARVALHO et R. BAIOCCO (2016). « Compassion-focused therapy in the treatment of shame-based difficulties in gender and sexual minorities », dans M. Skinta et A. Curtin (dir.), Mindfulness & Acceptance for Gender & Sexual Minorities. A Clinician Guide to Fostering Compassion, Connection & Equality Using Contextual Strategies, Oakland (CA), Context Press, p. 69-86.
- ROGERS, C. R. (1968). Le développement de la personne, Paris, Dunod.
- RUSSELL, S. T., A. M. POLLITT, G. LI et A. H. GROSSMAN (2018). « Chosen name use is linked to reduced depressive symptoms, suicidal ideation, and suicidal behavior among transgender youth », Journal of Adolescent Health, vol. 63, no 4, p. 503-505.
- Schore, A. (2008). La régulation affective et la réparation du Soi, Montréal, Les Éditions du CIG.
- Stolorow, R. D. (2011). World, Affectivity, Trauma: Heidegger and Post-Cartesian Psychoanalysis, New York / Londres, Routledge.
- Stolorow, R. D. et G. E. Atwood (1992). Contexts of Being: The Intersubjective Foundations of Psychological Life, New York, The Analytic Press.
- Treuniet, N. (1980). « On the self », TheInternational Journal of Psychoanalysis, vol. 61, p. 325-333.
- ZELUF, G., C. DHEJNE, C. ORRE, L. NILUNGER MANNHEIMER, C. DEOGAN, J. HÖIJER et A. EKÉUS THORSON (2016). « Health, disability and quality of life among trans people in Sweden – a web based survey », BMC Public Health, vol. 16, no 903, p. 1-15.