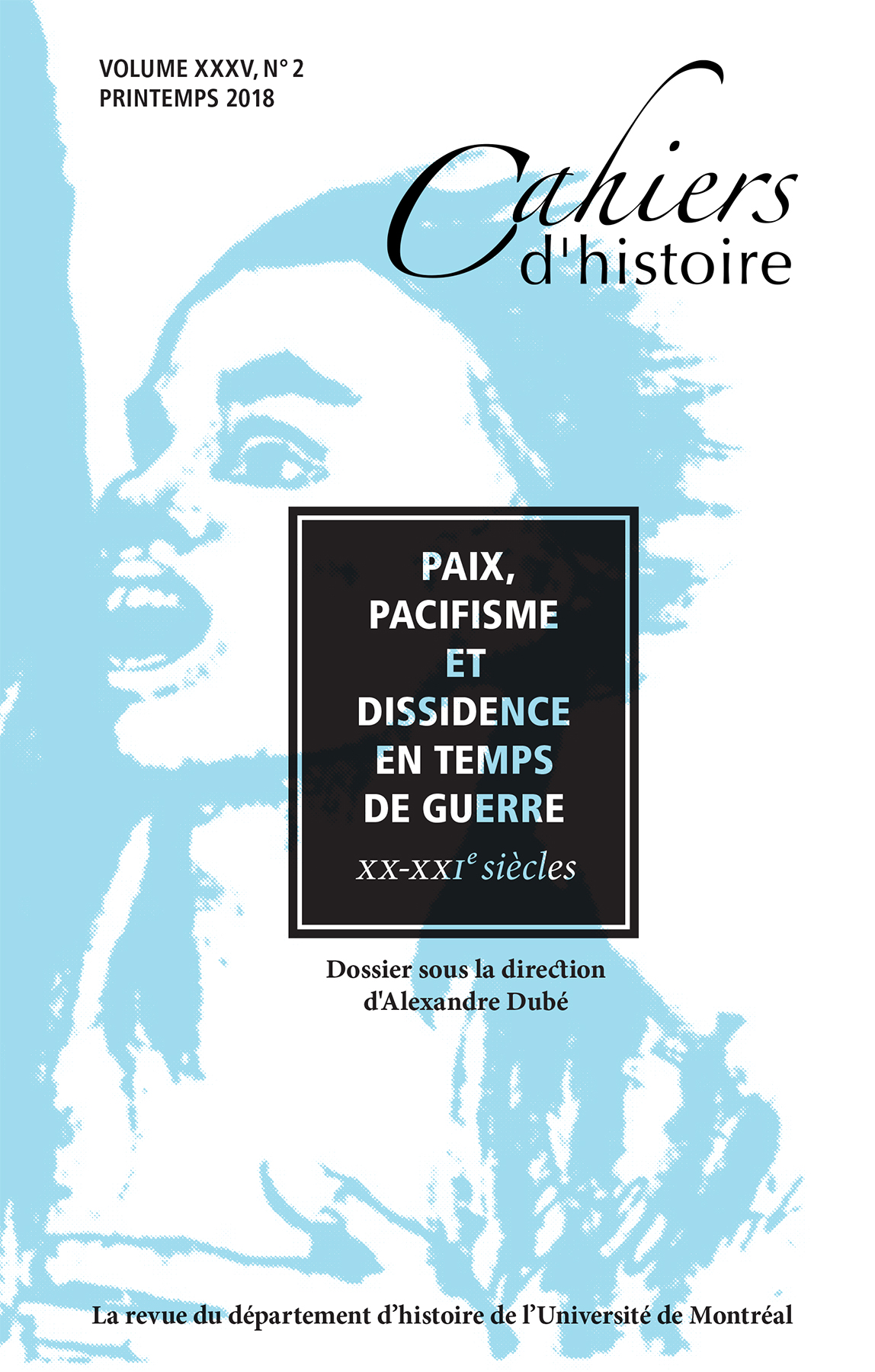Article body
L’interdisciplinarité : créer un espace de dialogue
Le 2 décembre 2015, c’était avec fébrilité que je regardais du coin de l’oeil entrer les derniers auditeurs avant l’ouverture du colloque interdisciplinaire Paix, pacifisme et dissidence en temps de guerre, XX-XXIe siècles—j’ignorais encore que cet événement allait être l’élément déclencheur de ce numéro. Qu’allait-il se passer pendant cette journée ? En fait, quelle langue allions-nous parler entre nous ?
D’abord, je redoutais certains écueils plutôt prévisibles. Il est bien établi que la spécialisation mène souvent à une compartimentation des savoirs et à l’édification d’un jargon bien évidemment nécessaire. Plus largement, au-delà des mots s’ajoute une « grammaire » disciplinaire, à savoir : la rigueur ou la flexibilité des cadres théoriques ; l’art de l’analyse et de l’argumentation d’un sujet ; le degré de liberté par rapport au devoir d’inscrire ses idées à l’intérieur d’écoles ou de courants de pensée ; les périodes et sujets de prédilection ; … la liste pourrait s’allonger indéfiniment.
Ensuite, pour qu’une discussion interdisciplinaire fructueuse ait lieu, il faut que les participants arrivent à vulgariser leurs idées pour qu’elles soient simples à comprendre sans pour autant devenir simplistes, dépouillées de leur richesse et de leur finesse. Simplement placer côte à côte un historien et un sociologue n’a aucune plus-value ; ce qui est recherché, c’est l’élargissement, voire le bouleversement des perspectives au contact d’experts oeuvrant dans une autre discipline sur une problématique donnée. Un exercice beaucoup plus facile à prescrire dans une introduction qu’à mettre en oeuvre.
Le 2 décembre 2015, la plupart des chercheurs ont trouvé le juste langage et ce faisant, certains—dont quelques-uns qui se sont ultimement retirés du projet, ou y ont participé uniquement pour la réflexion—ont voulu poursuivre. J’en fais partie. Un premier appel a donc été lancé aux participants du colloque à l’hiver 2016, puis, plusieurs mois plus tard, le numéro a été ouvert à des chercheurs n’ayant pas participé à l’événement. Ce deuxième appel est tout sauf anecdotique, car entretenir l’esprit de collégialité et l’expérience acquise au colloque était autrement plus difficile à faire à distance. J’y reviendrai.
Les lignes qui suivent ne portent donc pas sur l’historiographie de la paix ou de la guerre, mais se veulent plutôt une réflexion sur la « mécanique » du dialogue interdisciplinaire. Comme directeur de ce numéro, j’ai joué le rôle d’intermédiaire entre les collaborateurs et leurs diverses interprétations de la thématique. Il me fallait aussi clairement établir la pertinence d’utiliser des méthodes d’autres disciplines que celle historienne, même s’il s’agissait de publier dans une revue d’histoire. Je vous propose ici mes réflexions, que j’ai tenté d’enrichir de témoignages et d’entrevues menées avec des participants du colloque de décembre 2015 ainsi qu’avec des collaborateurs n’y ayant pas participés mais qui ont permis à ce numéro d’exister. Pour leurs rétroactions et leurs commentaires sincères, parfois même quasiment intimes, je les remercie chaleureusement ; par ces échanges informels, nous avons pu ainsi poursuivre le dialogue sur les thèmes et sur la méthode[1].
Le dialogue interdisciplinaire : quelques difficultés
La conception du thème, de sa déclinaison et de sa plage temporelle se voulaient aussi ouverts et rassembleurs que possibles. La dissidence, la paix, la guerre sont des sujets à portée plutôt universelle ; quant au choix d’accorder des espaces spécifiques aux idées, aux mouvements sociaux et aux institutions, le but était d’offrir un espace tant aux études littéraires qu’à la philosophie ou à des courants spécifiques de l’histoire ou des sciences sociales. La plage temporelle des XX-XXIe siècle se voulait également un compromis pour que temporellement, les chercheurs issus diverses disciplines puissent se sentir en terrain familier. L’une de mes craintes, si j’ouvrais la discussion du Moyen Âge à nos jours, par exemple, était d’envoyer le signal que l’exercice ne s’adressait qu’aux historiens. Bien que regrettable, cette exclusion était à mon sens nécessaire dans le cadre de l’expérience pour que des spécialistes de conflits civils comme celui impliquant Boko Haram au Mali se sentent les bienvenus.
Les propositions des participants et collaborateurs étaient de qualité, le terrain apparemment travaillé en amont pour faciliter la vulgarisation. Pourtant, il est rapidement apparu évident que ces précautions ne suffisaient pas à encourager naturellement le décloisonnement disciplinaire. Une petite anecdote pour expliquer la chose : l’un des participants, maintenant docteur en science politique, regrettait initialement ne pas pouvoir participer au colloque parce que ses recherches portaient sur un thème trop ancien—c’est-à-dire une question liée aux débuts de l’OTAN, plus particulièrement dans les années 1950. Il a pu m’expliquer par la suite que cette période était perçue comme « ancienne » par plusieurs de ses pairs, et que mon discours emphatique sur la « modernité » du colloque—si flagrante sous mes yeux d’historien !—entrait ainsi en conflit avec sa propre perception du temps. Mon expérience personnelle en sciences humaines et la sienne en sciences sociales entraient déjà en conflit avant même que l’on ait même songé à discuter.
Il était question d’une autre forme de différence dans le langage : ce que j’ai nommé la « grammaire disciplinaire », soit l’ensemble des méthodologies, de la théorisation, de la conceptualisation, et des divers autres postulats structurant à des degrés variables l’analyse. Adopter une autre « grammaire », c’est perdre ses repères habituels. Bien que la chose puisse être paralysante, selon l’expérience d’un participant, c’était au contraire une source inattendue de liberté. Ce chercheur, finissant à la maîtrise en sociologie au moment de l’entrevue, se sentait parfois étouffé dans sa créativité par la rigidité méthodologique de sa discipline en sciences sociales. Le dialogue interdisciplinaire, disait-il, l’avait déstabilisé : il indiquait ressentir une richesse en termes de connaissances plus grande chez les historiens, qu’il percevait comme plus libres de leur apprentissage. Dans son propre parcours, il avait jugé l’accent trop marqué sur les outils théoriques et pas assez sur ce qu’ils peuvent produire comme résultat. Dans son cas personnel, le portrait plus large dressé par les historiens lors du colloque sur sa période d’étude lui a permis de mieux recadrer ses recherches en les inscrivant dans des dynamiques plus profondes ; cela l’a mené à changé l’approche de sa thèse et à améliorer sa propre pratique de sociologue.
Je dois préciser ici qu’il s’agissait d’un participant au colloque, et que son expérience du dialogue était plus concrète. Pour les participants qui travaillaient à distance et qui n’avaient pas eu ce genre de discussions sur le thème du numéro, les réactions diffèrent. Un élément a été souligné par plusieurs, plus ou moins directement : bien que le numéro soit clairement identifié comme interdisciplinaire, il n’en demeure pas moins que la revue est intitulée Les Cahiers d’histoire. Certains participants ont indiqué parfois ressentir la discipline historique, dans ce dialogue, en position d’autorité ; or, si un chercheur d’une autre discipline sent qu’il doit devenir historien, il y a impossibilité d’établir un dialogue bidirectionnel. Sans compter que l’on risque ainsi de rater l’occasion de profiter de la couleur distincte de l’approche d’une autre discipline.
J’ai été témoin, très schématiquement, de deux grands types de réactions. Le premier, peut-être plus revendicateur, est que le chercheur annonce clairement dans son texte la singularité de sa méthodologie et de sa compréhension du sujet : ainsi, en donnant au lecteur les clés pour comprendre les prémisses de l’analyse, il est possible pour les autres participants de comprendre la démarche et de s’en inspirer. La seconde, c’est, pour reprendre la formule d’un participant, « d’adapter [s]on travail pour rencontrer l’historien à mi-chemin : comprendre ses codes, savoir lorsqu’il faut contextualiser le propos, user d’une plus grande rigueur formelle alors que [l’on] aime profiter d’une certaine latitude stylistique […] »[2].
Dans les deux cas, j’ai rapidement senti qu’il fallait que je sois prudent dans les commentaires que j’adressais lors de ma première lecture des textes pour préserver le caractère bilatéral de la discussion, et qu’il me fallait me demander à chaque intervention si je ne projetais pas, justement, mes propres biais disciplinaires sur le travail des participants. La solution que j’ai adoptée a été de travailler en amont, en analysant et commentant copieusement les textes (sous forme, souvent, de suggestion ou de questionnement plutôt que de critique) avant de les faire évaluer formellement. Avant toutefois de faire parvenir mon appréciation, j’ai pris soin de faire vérifier mes remarques par des collègues, lorsque possible issus des disciplines des collaborateurs ; s’ajoute à cela un travail de médiation pour respecter une certaine cohérence nécessaire au numéro. Cette démarche a été plus lourde, mais je l’ai estimée nécessaire et fructueuse pour que le résultat soit un dialogue réellement interdisciplinaire, et non un collage de textes—je laisse au lecteur la liberté d’en apprécier la réussite. Ouverture d’esprit, invitation à la critique, introspection : de mon expérience de direction, en particulier lorsqu’on ne peut discuter à vive voix avec un collaborateur dans le cadre d’une journée d’étude ou d’un colloque, je retiens qu’il faut rester humble dans son rôle de critique. J’en garde comme expérience une grande réflexion qui m’a aidé à mieux comprendre ma pensée « d’historien », et de mieux apprécier ses forces et ses limites.
Limites du dialogue interdisciplinaire
J’ai mentionné plus haut les grands points de réflexion qui ont guidé ma conception d’abord du colloque, puis de la prolongation de l’expérience dans le numéro. C’est que j’estime que tous les sujets ne se prêtent pas au dialogue interdisciplinaire. Comme le résume élégamment un collaborateur :
[…] La tentation de traiter la problématique en mettant chacune des disciplines côte à côte est tentante et constitue un risque, mais il va sans dire qu’une analyse multidisciplinaire digne de ce nom est plus que cela. En effet, l’analyse multidisciplinaire implique de mettre plusieurs disciplines à contribution de telle manière que leurs perspectives respectives s’en trouvent changées. Autrement dit, il faut qu’il y ait échange véritable entre les disciplines, et non seulement une mise en commun horizontale où chacune des perspectives pourrait tout aussi bien être traitée séparément des autres sans que son propos ne s’en trouve affecté.
Ce même chercheur ajoute que certaines méthodologies sont carrément incompatibles, ou elles le sont à tout le moins pour explorer une problématique particulière. Dans le cadre de ce numéro, la problématique était déjà formulée et posée à tous : le fait qu’elle soit volontairement flexible a rendu la collaboration possible. Si, comme un chercheur sur la propagande pourrait le muser, l’on voulait établir un dialogue entre psychologues et historiens—pour donner un exemple fortuit—il aurait fallu un sérieux travail de préparation afin de rendre la problématique conséquente et apte à enrichir mutuellement les perspectives. Il aurait aussi fallu que les participants aient profondément le goût de s’impliquer et de consacrer beaucoup d’énergie dans le projet. Plusieurs questions formelles sur le type de collaboration optimale se seraient alors posées.
J’estime qu’il importe aussi de s’interroger sur qui initie le dialogue. J’ai pu constater que les participants et collaborateurs historiens n’ont eu aucune peine à s’intégrer au projet. Ceux issus d’autres disciplines ont parfois fait état de difficultés variables d’adaptation de leur analyse, et ce plus spécialement lorsqu’ils n’avaient pu participer au colloque. Incidemment, après avoir interrogé les participants sur l’impact du dialogue, les historiens semblent avoir moins profité d’un enrichissement, et encore moins d’un changement de perspective, que les non-historiens. Il y a lieu de se questionner. Le premier doute est évidemment que l’expérience a été coordonnée, conçue et dirigée par un historien ; si le biais est avéré, alors il semble logique que les chercheurs de cette discipline soient moins sortis de leur zone de confort que les chercheurs des autres disciplines, et en prenant ainsi moins de risque n’ont peut-être pas été suffisamment défiés dans leurs positions. J’oserais hasarder une autre piste de réflexion—qui pourrait mériter une longue discussion interdisciplinaire en elle-même—c’est-à-dire que l’histoire est peut-être une discipline plus facile à vulgariser que d’autres fortement structurées par des codes ou des méthodes qui rebuteraient le non-initié. Ou sans être plus « facile » à comprendre (le terme est gros), peut-être apparaît-elle plus accessible par son jargon moins développé et son style plus narratif, ce qui pourrait faciliter la participation des discutants. Mon questionnement à ce sujet est nourri par plusieurs commentaires de collaborateurs d’autres disciplines qui soulignaient, particulièrement dans le cadre du colloque, que les « vastes connaissances » des intervenants historiens les avaient amenés à se plonger dans des dynamiques plus larges. Peut-être que certaines disciplines sont plus propices à la discussion, du moins dans le cadre d’une discussion de l’ampleur de celle présentée dans ce numéro ; néanmoins, je doute fort que cela importe si la volonté de faire du dialogue une expérience mutuellement enrichissante n’est pas au rendez-vous.
Avantages du dialogue interdisciplinaire
Plusieurs avantages ont été effleurés ; il convient de revenir sur quelques-uns plus en détail, et de réfléchir sur les implications qu’ils soulèvent.
L’un des participants du colloque, comme raconté plus haut, a été capable de concevoir son sujet d’étude autrement : les perspectives de participants historiens sur les courants pacifistes de la première moitié du XXe siècle lui ont permis de recadrer son histoire de cas dans un plus vaste mouvement social. Dans ce cas très positif, le sociologue a été capable de mieux maîtriser les outils appropriés de sa propre discipline pour produire une meilleure analyse sociologique. Le contact d’une autre perspective disciplinaire l’a fait progresser dans son propre domaine en éprouvant sa vision.
Un autre participant a livré un témoignage portant sur la manière dont sa propre discipline, la science politique, aborde la théorie et la pratique. Une même notion, utilisée en philosophie, en histoire, en science politique, en sociologie (et probablement d’autres disciplines), est théorisée différemment selon chaque champ d’études. Or, au moment de performer une analyse au moyen de ce concept abstrait, ce collaborateur a réalisé que c’était précisément en appliquant l’idée que l’on pouvait la comprendre—puis, par la suite, la théoriser. Cela l’a poussé à réfléchir sur le lien entre la théorie et la pratique, mais aussi sur la porosité des disciplines—selon sa formule, cela l’a aidé à « [réaliser] ce que le cloisonnement [disciplinaire] peut receler d’artificiel ». Au terme de ses réflexions sur l’interdépendance de la science politique et de l’histoire (dans son cas), il conclut que « la démarche interdisciplinaire est d’abord une expérience d’humilité, un moyen fructueux pour se déprendre soi-même (et l’analyse) du provincialisme disciplinaire. Elle est donc aussi, peut-être, une condition nécessaire à la réflexivité du chercheur sur sa propre pratique (théorique) »[3].
J’aimerais conclure cette réflexion par un commentaire formulé par Carl Bouchard dans son mot de conclusion lors du colloque de décembre 2015. Carl Bouchard avait insisté sur la présence des « absents ». Le colloque, comme ce numéro, ont permis d’aborder le concept de la paix sous plusieurs angles : d’aucuns ont étudié les catalyseurs de conflits (économiques, diplomatiques, institutionnels…), d’autres l’impact de la guerre sur les sociétés (démobilisation, discours de guerre, bouleversements de la vie politique nationale et internationale…) ; etc. Toutefois, il y a encore énormément de terrain à défricher ainsi que de sujets qui peuvent devenir l’objet d’événements interdisciplinaires futurs, et dont la teneur thématique pourrait changer la composition des participants. Centrer l’analyse de la paix et de la guerre en s’intéressant aux inégalités sociales pourrait attirer des économistes sociaux, peut-être davantage de politologues et sociologues, des démographes, géographes. Les espaces de paix à l’intérieur des guerres pourraient aussi pousser le dialogue dans une autre direction. Carl Bouchard mentionnait un exemple physique de paix pendant la guerre, en parlant du camp de repos de Grünewald, espace extraordinaire conçu pour éloigner psychologiquement la guerre des esprits de soldats allemands de la Première Guerre mondiale ; il y a là un champ d’exploration fertile pour des anthropologues et, qui sait, si l’on peut sortir des sciences sociales et humaines, peut-être des spécialistes du domaine de la santé mentale ?
Il faudrait, pour repousser sans cesse nos perspectives comme chercheurs, donner chasse constamment à ces « absents », qu’ils soient thématiques ou méthodologiques. Ce numéro est un exercice en ce sens. Il est à souhaiter qu’il invite à la multiplication des événements de ce genre, et, osons l’espérer, qu’il en résulte des initiatives de longue haleine.
—
Ce numéro est divisé en trois blocs. Le premier, « la société mobilisée pour la paix », est couvert par Marie-Michèle Doucet (histoire) et Geoff Keelan (histoire). Marie-Michèle Doucet, dans son article « Faire la paix par l’humanitaire. Les pacifistes françaises au secours des enfants d’Allemagne : un premier pas vers un rapprochement franco-allemand (1919-1925) », explique que pour des groupements féministes pacifistes français de l’après-guerre, l’engagement dans le domaine humanitaire permet l’action politique au moment même où elles sont dépourvues du droit de vote. Des comités féminins pacifistes vont défendre l’idée qu’une paix durable avec l’Allemagne passe par le « désarmement moral », et ces sociétés utiliseront l’aide aux enfants, terrain plus neutre politiquement, pour faire avancer leur projet pacifiste qui va à contre-courant d’une opinion publique française beaucoup plus revancharde. Geoff Keelan, dans son article « Dissenting in the First World War : Henri Bourassa and Transnational Resistance to War », conteste le récit convenu comme quoi le directeur du Devoir et ténor nationaliste Henri Bourassa n’est qu’une voix dissidente isolée dans le Canada de la Première Guerre mondiale. Élargissant l’analyse du national à l’international, il suggère que les analyses et les préoccupations de Bourassa, notamment sur l’ordre mondial d’après-guerre, sur les effets négatifs du militarisme, ainsi que sur les dévastations morales et matérielles de la guerre, sont partagées par d’autres acteurs à l’international, pour des raisons qui diffèrent toutefois largement.
Le deuxième bloc, « la paix comme idée », comprend les textes d’Andréa Mercier (philosophie) et Joëlle Rousseau Rivard (littérature). Andréa Mercier, dans son article « Bertrand Russell : pour une philosophie de l’action en temps de guerre », s’intéresse au parcours singulier du philosophe logicien Bertrand Russell qui se démarque de ses contemporains en développant une « philosophie de l’action ». Pour Russell, l’urgence de rétablir la paix et de l’ancrer solidement dans l’avenir impose que la pensée de la paix prenne une forme existentielle, et que le philosophe incarne lui-même ses idées par l’harmonie entre sa pensée pacifiste rationnelle et ses agissements. Joëlle Rousseau Rivard, dans « L’otage, vecteur de guerre ou de paix ? », propose une analyse de deux textes portant sur la fatalité de la guerre et se faisant écho—la pièce de théâtre de 1935 La guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux et l’essai de Jean Baudrillard de 1991 La guerre du Golfe n’aura pas lieu. Par la figure de l’otage, mythique dans la pièce, concrète dans l’essai, l’auteure analyse l’articulation floue entre paix et guerre en la considérant comme un espace de négociation et de tensions apaisant ou accélérant la violence.
Le dernier thème, « l’institutionnalisation (in)formelle de la paix », est exploré par les articles de Florence Prévost-Grégoire (histoire) et François Clec’h (science politique). Florence Prévost-Grégoire, dans « Le Comité national d’études sociales et politiques, une expérience pacifique au service de la nation française », argumente que pour Albert Kahn—philanthrope et pacifiste actif français de l’entre-deux-guerres—et le comité qu’il fonde (CNESP), la paix durable passe par un droit international fondé sur une connaissance positive du monde et de ses enjeux. Ce savoir pensé comme objectif doit servir de base à un arbitrage international rappelant celui des grands congrès de paix du XIXe siècle, mais étendu aux enjeux modernes et infiniment plus larges du monde entier. Le critère d’objectivité est toutefois épineux dans cette tentative de faire le pont entre le monde connu de l’avant-Première Guerre mondiale et celui inconnu d’un après-guerre sans précédent. François Clec’h, dans « Quand la mémoire s’en va-t’en “guerre”. Penser les marges de la commémoration des victimes du national-socialisme dans l’Allemagne du XXIe siècle », analyse la problématique de la commémoration grâce à la « théorie des champs mémoriels » de Bourdieu. Au terme de sa démonstration, l’auteur permet d’enrichir la compréhension de la construction de la mémoire de l’Holocauste, en ce qu’elle révèle des luttes très concrètes pour la reconnaissance du statut de victime selon des règles spécifiques établies par des acteurs particuliers.
—
Cette préface serait incomplète sans de chaleureux remerciements à tous ceux et celles qui ont participé à ce numéro, tant en soumettant des textes qu’en contribuant à la réflexion sur la question de l’interdisciplinarité. Nous exprimons une pensée particulière à tous ceux qui ont donné de leur temps pour nous aider, notamment en évaluant les articles, et remercions le Département d’histoire de l’Université de Montréal pour son soutien financier. En tant que directeur, je tiens à témoigner une reconnaissance toute spéciale pour l’aide assidue de Florence Prévost-Grégoire, dont l’immense appui m’a été essentiel pour accomplir mon rôle. Enfin, nous remercions les auteurs pour leur travail et leur coopération qui ont rendu ce numéro possible.