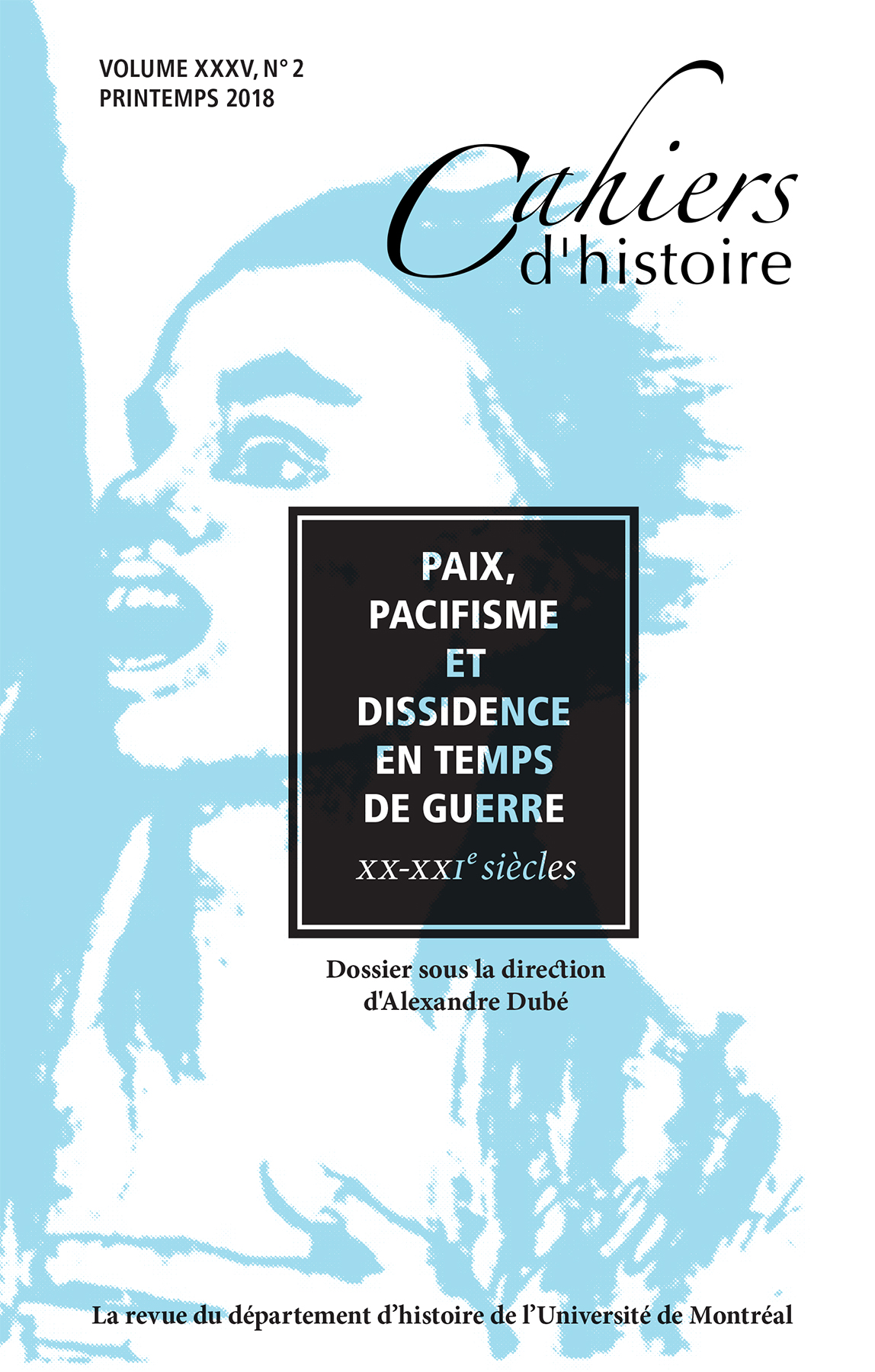Abstracts
Résumé
Pour les pacifistes françaises, la paix après la Grande Guerre passe par un rapprochement franco-allemand. Privées du droit de vote jusque dans les années 1940, ces femmes utilisent l’action humanitaire comme moyen de contribuer à la vie politique. La création du Comité français de secours aux enfants en 1919 et de l’Action fraternelle pour les enfants de la Ruhr en 1923 leur offre l’opportunité de travailler directement auprès des enfants allemands, tâche qui va toutefois à contre-courant de l’opinion générale de la population française. Nous montrerons dans cet article que le secours offert par les pacifistes françaises aux petits d’Allemagne s’insère dans un processus que l’on appelle « sortie de guerre ». En leur permettant de prendre position politique, ou du moins d’agir symboliquement, en faveur de la réconciliation franco-allemande, l’humanitaire apparaît comme un moyen de travailler concrètement à l’établissement de la paix, dont le rapprochement entre les ennemies d’hier constitue une première étape.
Article body
« Le rapprochement franco-allemand, l’entente franco-allemande, c’est la paix assurée en Europe »[1], écrivait la pacifiste Madeleine Vernet en 1934 dans sa revue La Mère éducatrice. Après la Première Guerre mondiale, bon nombre de pacifistes françaises estiment que la paix passe d’abord et avant tout par la réconciliation entre la France et l’Allemagne. Il s’agit toutefois d’un travail long et complexe, car ceux et celles qui luttent pour un rapprochement franco-allemand après la guerre naviguent à contre-courant de l’opinion générale de la population française[2]. Pour de nombreux Français, la réconciliation avec l’« ennemi héréditaire » est soit dangereuse, soit difficilement envisageable, voire même impossible. La victoire de 1918 n’a réduit en rien la méfiance et le sentiment d’insécurité envers l’Allemagne. Les partisans d’un rapprochement sont donc constamment confrontés à un discours anti-allemand très présent dans l’espace public et qui trouve un écho favorable auprès de l’ensemble de la population.
Pour les femmes pacifistes, la tâche est d’autant plus ardue, car, privées du droit de vote et donc exclues de la sphère politique au sens traditionnel, elles doivent trouver des terrains d’action qui leur permettent de faire passer leur message de paix et leurs voeux de réconciliation. Dans l’historiographie, les actions et les points de vue des femmes ont longtemps été définis, et par le même fait rejetés, comme « moraux » plutôt que « politiques ». Des études sur le genre ont toutefois souligné l’importance de revoir le concept d’action politique pour y inclure les types d’actions qui sortent des cadres traditionnels[3]. L’aide humanitaire apparaît rapidement comme un espace privilégié d’intervention dans la sphère publique et un moyen pour ces femmes de contribuer à la vie politique tant nationale qu’internationale. La création du Comité français de secours aux enfants (CFSE) en 1919, puis de l’Action fraternelle pour les enfants de la Ruhr (AFPER) en 1923, leur offre la possibilité de travailler activement auprès des enfants allemands. Misant sur les qualités féminines de la compassion et du maternage, l’aide humanitaire apparait à l’époque comme une tâche naturellement féminine[4].
Depuis quelques années, l’aide humanitaire prend de l’ampleur dans l’historiographie. Les travaux d’Annette Becker, et plus récemment ceux de Bruno Cabanes, ont insisté sur le rôle important que jouent la Grande Guerre et l’après-guerre dans la redéfinition de l’aide humanitaire[5]. En effet, ils montrent que face à l’expérience du conflit, le secours humanitaire devient une intervention politique et diplomatique. Dans le cadre d’une conférence donnée à l’Université de Montréal en avril 2016, Cabanes souligne que « le nouvel esprit humanitaire issu du conflit constitue l’une des modalités essentielles du processus de “sortie de guerre” »[6]. Prenant appui sur cette nouvelle historiographie, nous montrerons dans cet article que l’aide humanitaire des pacifistes françaises auprès des enfants allemands au lendemain guerre s’insère dans ce processus de « sortie de guerre ». En permettant à ces femmes de prendre position politique, ou du moins d’agir symboliquement en faveur de la réconciliation franco-allemande, l’humanitaire apparaît comme un moyen de travailler concrètement à l’établissement de la paix, dont le rapprochement entre les ennemies d’hier constitue une première étape.
La « sortie de guerre » des pacifistes françaises
Les historiens qui se sont intéressés au concept de « sortie de guerre »[7] ont montré toute la complexité des processus de démobilisation dans les sociétés d’après-guerre où persistent toujours les représentations haineuses forgées durant le conflit. La « sortie de guerre » doit passer par la démobilisation militaire certes, mais elle nécessite également la démobilisation des esprits. L’historien John Horne montre que si les démobilisations militaires et économiques sont des conditions préalables à l’établissement de la paix, c’est la démobilisation culturelle, c’est-à-dire la pacification des esprits et le rétablissement progressif des relations entre les nations ennemies, qui détermine, « de quel genre de paix il s’agira »[8]. En ce sens, l’armistice et les traités de paix ne sont plus suffisants pour garantir l’établissement d’une paix durable. La « culture de guerre » persiste souvent dans les mentalités bien au-delà du conflit rendant ainsi difficile toute forme de relations avec les anciens ennemis.
Toutefois, la « sortie de guerre » envisagé par un petit nombre de femmes pacifistes ne correspond pas à celle de la majorité de la population française. Dès 1919, elles vont à contre-courant de l’opinion générale en parlant de rapprochement franco-allemand alors que la France entière souhaite garder le plus loin possible de soi l’ex-ennemi. Dans son rapport sur son activité pendant l’hiver 1923-1924, la section française de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (SFLIFPL) rappelle qu’elle n’a cessé depuis la fin du conflit de « concentrer [son] action sur le point où le danger est actuellement le plus grave : c’est-à-dire sur les rapports franco-allemands »[9]. Pour ces femmes, le premier pas vers un rapprochement entre la France et l’Allemagne passe toutefois par un changement de mentalité. Dans l’immédiat de l’après-guerre, les souvenirs du conflit, encore bien présents chez les Français, alimentent les propos haineux envers l’ennemi allemand : « Écoutez causer le peuple de Paris », écrit Madeleine Vernet dans sa revue La Mère éducatrice en décembre 1918, un mois à peine après la signature de l’armistice, « notez les conversations échangées dans les rues, sur les tramways, dans les restaurants. Vous en serez effrayés. Ce qui m’épouvante, voyez-vous, c’est la montée de la haine »[10]. Il faut donc trouver un moyen de désarmer les esprits en éradiquant cette haine qu’entretiennent les Français envers l’Allemagne.
En ce sens, l’action humanitaire apparaît pour ces femmes comme une façon d’apporter une aide immédiate aux enfants allemands qui souffrent toujours des misères de la guerre, mais également d’agir de façon concrète sur le désarmement de la haine.
L’enfance et l’humanitaire
Depuis quelques années, des historiens se sont intéressés à « construction de l’enfance comme objet des relations internationales »[11] durant l’entre-deux-guerres. Certes, dans les années 1920, les oeuvres de charité axées sur l’enfance n’ont rien de nouveau. Déjà au 19e siècle, plusieurs organisations avaient misé sur l’aspect sentimental qu’évoquait la misère des enfants pour obtenir des dons[12]. Toutefois, l’historienne Dominique Marshall souligne que l’idée de concevoir l’enfance comme objet de coopération internationale doit son origine au Commission for Relief in Belgium, fondé et dirigé par Herbert Hoover, futur président des États-Unis, qui permit le ravitaillement, jusqu’en 1917, des régions belges occupées par les troupes allemandes[13]. Pour Hoover, comme pour le Save the Children Fund (SCF) qui prendra sa relève après la guerre, l’enfance représente « un terrain neutre qui facilite les rencontres »[14]. Comme le souligne Yves Denéchère, « passer par l’enfance encourage la mobilisation du public, favorise la neutralisation des actions et institue un investissement vers le futur »[15].
En ce sens, il n’est pas surprenant de voir le travail des pacifistes françaises se tourner principalement vers l’enfance. Dans son rapport pour l’année 1920-1921, la SFLIFPL rappelle que « c’est surtout pour l’oeuvre au secours aux enfants qu’elle a pu agir le plus utilement[16] ». Selon Andrée Jouve, membre active de la Section française, la Ligue avait « toujours affirmé le droit imprescriptible de l’enfant à vivre, de l’enfant innocent des crises de la politique »[17]. C’est donc en reprenant ce discours et en implorant la pitié des mères françaises que les pacifistes vont lancer leur appel en faveur des enfants allemands. « Vous êtes les Mères et c’est en vous qu’est la source de vie. Pitié pour les petits, tous les petits du monde », écrit Madeleine Vernet en 1923, « Ils sont innocents ; et pourtant nous en faisons les parias. Nous leur donnons la vie, ne les vouons pas à la haine et à la mort »[18]. L’immédiat après-guerre voit ainsi apparaître en France deux comités visant à venir en aide aux enfants qui souffrent des répercussions sociales et économiques du dernier conflit.
Le premier, le Comité français de secours aux enfants (CFSE), est créé en 1919 par Marguerite de Saint-Prix, Gabrielle Duchêne, Séverine et Andrée Jouve, quatre pacifistes bien connues des milieux français. Filiale indépendante du Save the Children Fund, le CFSE a comme objectif de ramasser des fonds, de la nourriture et des vêtements afin de venir en aide aux enfants des pays d’Europe aux prises avec des problèmes économiques graves et une situation de famine. Le Comité propose « l’adoption »[19] d’enfants par le biais de « photo-cartes » : « Avec 5 francs, vous nourrissez un enfant pendant plus d’une semaine. Avec 12 francs, vous nourrissez un enfant pendant un mois. Avec 100 francs, vous pouvez lui sauver la vie », est-il possible de lire sur leurs appels aux dons. Le premier pays visé par cette aide humanitaire est la Russie. Dans son rapport pour la période allant de février à août 1922, le CFSE affirme avoir recueilli 1 839 000 francs en faveur des enfants russes, lui permettant ainsi d’ouvrir des cantines en Ukraine et à Saratov, et à y envoyer plus de neufs convois, totalisant près de 35 tonnes de vivres et de vêtements[20]. « Les dons ont afflué de tous les points du pays et même des colonies, montrant combien la souffrance de ces enfants avait ému les coeurs français » [21], explique le Comité. L’aide aux enfants allemands se fait toutefois plus lente et connaît, comme nous allons le constater, certaines difficultés importantes.
Au début de l’année 1923, l’Occupation de Ruhr offre à la SFLIFPL la possibilité de s’engager de façon plus concrète en Allemagne[22]. Créée en collaboration avec la Croix-Rouge, l’Action fraternelle pour les enfants de la Ruhr (AFPER), a pour but de parrainer pendant six mois plus de 500 enfants de la ville de Duisbourg en Allemagne. « Que les enfants innocents ne se croient pas voués à la mort », explique l’AFPER dans un communiqué, « que les enfants et les femmes de la Ruhr sachent au moins que les femmes françaises connaissent leur détresse et veulent les aider »[23]. À l’instar du CFSE, l’AFPER propose donc d’« adopter » un enfant allemand en donnant 30 francs par mois afin qu’il puisse être nourri et habillé convenablement : « Avec un franc par jour, 30 par mois, vous l’empêcherez de mourir de faim[24] ».
Ces deux comités ont la mission d’offrir à la fois un secours matériel, mais également un soutien moral aux populations affligées, sans distinction de classe, de religion ou de nationalité. Il s’agit pour les pacifistes d’un moyen de fraterniser avec le peuple allemand tout en travaillant à apaiser les souffrances causées par la guerre et par l’occupation française.
Travailler à la réconciliation
Pour les pacifistes, l’aide humanitaire servira de premier pas vers un rapprochement franco-allemand. En décembre 1923, alors qu’elle invite les lectrices de La Mère Éducatrice à venir en aide aux enfants allemands, Madeleine Vernet explique que ce geste doit être compris comme « un geste de réconciliation et d’apaisement » :
Il dira que par-dessus les frontières et malgré les dirigeants intéressés à maintenir la haine entre les peuples, que les petits et les humbles savent qu’ils sont frères. Il sera, ce geste, le vrai traité de Paix, et le symbole du vrai désarmement : celui des coeurs[25].
Quelques mois plus tard, lors du Congrès de Washington de la LIFPL en mai 1924, Andrée Jouve explique, dans la même optique que Vernet, que l’aide apporté aux enfants allemands « avait été entrepris, non dans une optique philanthropique, mais politique, à la fois comme une protestation et un geste de réconciliation et d’humanité »[26]. Reprenant des propos similaires, Jouve souligne en décembre 1924 que « cette action [l’aide humanitaire offert aux enfants allemands] doit être considérée avant tout comme une protestation contre la politique de la haine et comme un geste symbolique de réconciliation »[27].
Nous retrouvons un discours similaire chez les donateurs. En effet, les lettres envoyées par des « parrains » au CFSE ou à l’AFPER témoignent avant tout d’un désir de paix et de réconciliation. « C’est notre façon de protester contre l’occupation de la Ruhr »[28] écrit une donatrice qui demande à « adopter » deux enfants allemands. Des cheminots de la gare de Vaugirard, à Paris, qui se cotisent pour parrainer un enfant, indiquent dans leur lettre qu’ils désirent « bien marquer [leur] désir de paix et [leur] volonté de lutter contre cette épouvantable chose qu’est la guerre »[29]. Pour une autre, c’est la charité chrétienne qui la pousse à agir : « Bien que très ardente Française, » écrit cette donatrice, « mon amour pour ma chère patrie réprouve toute haine à l’égard de celle qui l’a fait cruellement souffrir, le grand et rayonnant amour de Jésus Christ planant bien au-dessus de nos tristes sentiments »[30].
Concrètement, l’impact de l’aide humanitaire en Allemagne est plutôt restreint. Le CFSE parle de 500 francs envoyés à la section allemande de la LIFPL en 1920[31]. Il ne s’agit là que d’une infime fraction des 113 000 francs recueillie par le Comité durant cette même année. La majorité de ces fonds sont envoyés en Russie et à Vienne où le CFSE participe à la création d’un hôpital pour les enfants rachitiques. Divers éléments peuvent expliquer ces résultats. Il est clair que l’affinité de plusieurs membres du CFSE, particulièrement de Gabrielle Duchêne, avec la Russie et le communisme influence largement le travail du Comité lorsqu’il est question des enfants russes. À la lumière des sources, il nous parait évident que l’aide aux enfants russes a bénéficié d’une plus grande propagande que celle aux petits Allemands[32]. Mais il faut également y voir le reflet d’une certaine familiarité entre la France et la Russie depuis l’établissement de l’entente franco-russe à la fin du 19e siècle. Après la Grande Guerre, malgré le retrait des forces russes du conflit après la révolution de 1917, le terme « ennemi » reste trop fort pour décrire le peuple russe[33]. Il apparaît plutôt comme une « victime » de son gouvernement, ce qui favorise le sentiment humanitaire à son égard. De son côté, le cas de l’aide aux enfants autrichiens est assez particulier. Membre de la Triple Alliance au côté de l’Allemagne, l’Autriche est également ennemie de la France pendant la guerre. Cependant, le fait qu’elle ne partage pas une longue histoire d’animosité avec la France, comme c’est le cas avec l’Allemagne, et qu’elle n’exerce pas une menace directe sur sa sécurité après le conflit, facilite sans doute l’oeuvre humanitaire entreprise auprès de l’Autriche dès 1919.
De son côté, l’AFPER récolte une somme totale de 16 981 francs pour les enfants de la Ruhr. Cela correspond à l’« adoption » de 408 enfants allemands à 30 francs par mois[34]. Si une minorité de parrainages se poursuit jusqu’au début de l’année 1925, l’entrée en vigueur du plan Dawes en juillet 1924, entente qui mène à l’évacuation de la Ruhr, marque, de façon générale, la fin du travail de l’AFPER.
Malgré la portée relativement faible de leur travail, les pacifistes insistent sur l’effet positif de leur action en Allemagne. Dans son rapport pour l’hiver 1923-1924, la SFLIPL note à cet égard :
Nous avons reçu de touchantes lettres témoignant de la joie des enfants affamés et de la surprise attendrie des mères à qui l’on racontait que tout cela leur était adressé par des femmes françaises, en un geste de réconciliation. On ne saurait imaginer, nous disent nos camarades allemandes, l’efficacité d’un tel geste pour faire baisser la marée de haine qui menace ici de tout submerger. Ainsi, ces femmes et ces enfants comprennent que tout le peuple de France n’est pas solidaire à la politique de son gouvernement et qu’il y a partout des êtres qui souffrent et sympathisent[35].
Ces propos font échos à ceux tenus par l’Allemande Gerda Stoffel en décembre 1923. Elle explique que l’initiative des pacifistes françaises après des enfants de Duisbourg est accueillie avec enthousiasme par les magistrats et par la presse régionale : « On regarde [l’aide humanitaire] comme une action qui permettra la paix, la réconciliation et la réparation qui aidera à modifier la haine contre la France »[36]. De son côté, le directeur des écoles sans confession de la ville de Duisbourg écrit au sujet de l’action de l’AFPER : « Nous voulons l’éducation d’une nouvelle génération qui ne connaît pas la haine ni la vengeance »[37]. Leurs actions trouvent même des échos jusqu’en Autriche, où une membre de la section autrichienne de la Ligue indique dans une lettre adressée à Andrée Jouve : « Cette preuve d’amitié française, pas encore hélas dans toute la France, nous ne manquerons pas de la faire circuler dans notre pays d’Autriche, où il y a aussi beaucoup de nationalistes qui n’ont jamais eu l’occasion de savoir combien d’âmes nobles il y a en France »[38].
« Sauvez les petits Boches! »
En France, la portée de leur geste est difficilement mesurable. En décembre 1932, Madeleine Vernet en dresse un bilan positif :
Je veux revenir aux oeuvres de secours franco-allemandes, qu’un pacifisme intelligent et constructif a entreprises. […] Pour ma part, j’y vois l’action la plus efficace pour le rapprochement franco-allemand. Et le rapprochement franco-allemand, l’apaisement des esprits dans les deux pays qu’on a excité l’un contre l’autre par des fables grossières ou de savants mensonges, ce rapprochement est à la base même de la paix[39].
Mais si les pacifistes sont prêtes à secourir les enfants d’Allemagne, on ne peut en dire autant pour la majorité de la population française. À cette époque, les actions de soldats « boches » durant le conflit sont encore gravées dans la mémoire collective. L’idée d’aider les enfants allemands-de « sauver les petits boches »-est loin de faire l’unanimité au sein de la population française. Certains, comme cette institutrice, refusent carrément de venir en aide aux enfants de l’ennemi et voient dans leur souffrance un « juste retour des choses » ;
Pendant quatre ans et demi, nos enfants français du Nord de la France et de la Belgique ont souffert atrocement de la domination allemande. Les enfants allemands souffrent aujourd’hui. Juste retour des choses : dure et sévère et peut-être une nécessaire leçon pour ce peuple. Voilà la pensée instinctive de la plupart de nos compatriotes. C’est cruel, c’est barbare, c’est odieux, mais hélas, c’est humain[40].
De son côté, Madeleine Vernet note les commentaires haineux de ces mères qui refusent de venir en aide aux enfants d’Allemagne : « “Y pensez-vous ?”, disent-elles, “Sauver les Petits Boches! Qu’ils crèvent donc, ce sera de la vermine en moins” »[41].
Emporter la conviction de la population française est une tâche lourde, d’autant que les internationalistes et les pacifistes eux-mêmes peinent à emprunter le chemin de la réconciliation. En mai 1920, Théodore Ruyssen, président de l’Association de la Paix par le Droit, écrit au sujet la souffrance des enfants d’Allemagne qu’il a pitié du petit qui souffre de famine « même si son père est coupable, parce que c’est une double misère que d’être affamé et aussi le fils d’un assassin ou d’un voleur »[42].
Le même constat peut être fait pour le mouvement féministe français. Dans l’immédiat après-guerre, la très grande majorité des féministes, qui pendant le conflit avait cessé tout militantisme afin de consacrer leur énergie à l’effort de guerre, ne sont pas prêtes à oublier ni à pardonner les actions des troupes allemandes. Interrogées à savoir si elle allait intervenir en faveur de la population allemande pour arrêter le blocus allié en novembre 1918, la revue féministe La Française, le journal hebdomadaire du Conseil national des femmes françaises (CNFF), adopte un ton accusateur envers les femmes allemandes :
Non, nous n’interviendrons pas auprès de notre Gouvernement pour adoucir les conditions de l’Armistice qui ne sont que trop justifiées par la façon dont l’Allemagne a conduit la guerre. Au cours de ces années tragiques, les femmes allemandes, sûres de la victoire, se sont tues devant les crimes de leur Gouvernement, de leur armée, de leur marine. […] Pourquoi donc interviendrions-nous aujourd’hui contre des conditions qui n’ont pour objet que de rendre impossible toute reprise de la guerre ? Notre pitié va d’abord au-devant des victimes innocentes […] si haineusement pillées et maltraitées. Que les femmes allemandes se souviennent et elles comprendront notre silence[43].
La position adoptée par La Française en 1918 diffère donc largement de celle prise par les membres de la SFLIFPL à la même époque.
Au début de l’année 1924, un conflit interne éclate au sein du CFSE alors que deux membres de son Comité d’honneur, les professeurs Léon Bernard[44] et Albert Calmette[45], annoncent leur démission. Dans une lettre datée du 3 janvier 1924, Léon Bernard explique à Mme René Dubost, la présidente de l’époque :
Je vous prie de me considérer comme démissionnaire du Comité français de secours aux enfants. Je ne pourrais, sans trahir ma conscience, continuer à vous apporter mon concours moral. Je me refuse en effet à approuver que l’argent français soit drainé pour aider à nourrir les enfants d’un peuple, qu’on élève dans la haine des Français et dans l’espoir du massacre des nôtres. Je ne saurais, à aucun degré, m’associer à une action dont nos propres enfants risquent de devenir les victimes[46].
À l’instar de Bernard, Albert Calmette souligne dans une lettre datée du 12 janvier 1924, que : « La propagande actuellement faite dans le Bulletin du Comité en vue de recueillir en France des fonds pour secourir les enfants allemands ne me permet plus de donner à cette oeuvre mon appui moral et m’oblige à vous adresser ma démission »[47]. Il poursuit en expliquant :
J’ai eu la douleur, pendant les quatre ans que j’ai dû vivre à Lille, sous le régime de l’occupation militaire ennemie, d’être le témoin d’un trop grand nombre d’actes contraire aux plus élémentaires devoirs d’humanité […] pour oublier et pardonner à un peuple auquel les dirigeants ne parlent que de revanche et qui s’obstine dans la mauvaise foi et dans la haine[48].
Il peut paraître surprenant de voir des membres du Comité d’honneur tenir ce genre de propos. N’est-ce pas justement contre ce discours anti-allemand que lutte le CFSE ? À ces deux hommes, Mme Dubost répond : « Ne croyez-vous pas que ce geste généreux d’un groupement servira à la cause de la réconciliation et aidera à dissiper l’esprit de haine, trop vrai, hélas! dont vous me parlez »[49].
À la même époque, l’AFPER connaît également certains problèmes internes. Yves Denéchère note dans un article sur le parrainage d’enfants dans la Ruhr que des réserves sont invoquées jusque dans les milieux pacifistes[50]. Michel Alexandre et son épouse Jeanne (née Halbwachs) demandent certaines précisions quant à la réelle misère des enfants de la Ruhr et estiment que les cas individuels présentés par l’AFPER sont peu convaincants. Au final, leurs noms ne figureront pas sur la liste des parrains[51]. De son côté, la Paix par le droit, après avoir d’abord soutenu l’initiative, retire son appui devant ce qui lui apparaît comme un geste essentiellement politique[52]. Il faut noter qu’à l’époque les pacifistes françaises sont parmi les seules à s’opposer ouvertement à l’occupation française de la Ruhr.
Ces conflits internes au sein du CFSE et de l’AFPER témoignent du caractère délicat et controversé que représente le travail effectué auprès les enfants allemands dans la période qui représente la « sortie de guerre ».
Force est de constater que la portée de ce travail humanitaire est plutôt restreinte et se limite souvent à quelques donateurs et bénéficiaires. Après la guerre, et durant toute la période de l’entre-deux-guerres, le discours réconciliateur mis de l’avant par les femmes pacifistes appartient à une minorité de la population française. Au début des années 1920, il est difficile de convaincre la population française de venir en aide aux enfants allemands. Au terme de la Grande Guerre, les souvenirs du conflit sont encore frais dans les mémoires et de nombreux Français refusent de porter secours aux « petits boches ». Cela ne signifie toutefois pas que le travail de ces quelques femmes n’a pas eu d’importance. Au contraire, il est possible de croire, qu’à une échelle individuelle du moins, leur travail à participer au désarmement de la haine, en particulier chez ceux qui ont été directement touchés les efforts de secours. Comme le souligne l’éminent pacifiste français Romain Rolland dans une lettre envoyée à la section français de la LIFPL en 1924 : « la valeur de l’aide humanitaire n’est pas seulement dans les secours matériels […] elle est, plus encore dans le réconfort moral »[53].
Pour ces femmes, l’aide humanitaire apparaît également comme un moyen de faire entendre leur voix dans la sphère politique et de prendre position sur des questions d’ordres nationales et internationales, et ce tout en respectant le rôle et la place associée à leur sexe. Cette prise de position est d’autant plus intéressante que l’occupation de la Ruhr soulève très peu de réactions du côté des associations pacifistes « masculines »[54]. Selon l’historienne Ilde Gorguet, l’originalité de la position féminine face à l’occupation de la Ruhr (et sans doute également dans le pacifisme en général) est justement son action concrète auprès des enfants allemands[55]. Il serait toutefois illusoire, comme le souligne Yves Denéchère, « de penser que l’enfance ait pu constituer une voie de dialogue entre la France et l’Allemagne au niveau des États »[56]. Les exemples présentés dans cet article ont montré que, du point de vue moral, l’effort déployé ne donne pas toujours les résultats espérés. Les pacifistes, quant à elles, demeurent convaincues de jouer un rôle primordial dans le désarmement de la haine et dans le rapprochement des peuples. L’historien Norman Ingram souligne d’ailleurs que le travail des pacifistes françaises en vue de la réconciliation franco-allemande dans les années 1920, à une époque où les dirigeants politiques ne semblaient s’intéresser qu’au respect des paiements de réparations par l’Allemagne, était à la fois courageux et radical[57]. En effet, ces pacifistes font preuve de courage, car elles sont convaincues d’avoir leur mot à dire dans l’établissement de la paix durable malgré leur exclusion de la vie politique. Elles agissent également, à bien des égards, comme les pionnières de la réconciliation franco-allemande en parlant de rapprochement à une époque où la très grande majorité de la population française, et ce même jusque dans les milieux pacifistes, est réticente à restaurer toutes formes de relations avec l’Allemagne.
Appendices
Notes
-
[1]
Madeleine Vernet, « Si nous parlions de l’Allemagne et des Allemands », La Mère éducatrice, 17, n° 11-12, (novembre-décembre 1934).
-
[2]
Sophie Lorrain, Des pacifistes français et allemands pionniers de l’entente franco-allemande, 1871-1925, Paris, Éditions L’Harmattan, 1999, p. 167.
-
[3]
Guida West, Rhoda Lois Blumberg, « Reconstructing Social Protest from a Feminist Perspective », dans Women and Social Protest, Guida West et al. (dir.), New York, Oxford University Press, 1990, p. 11.
-
[4]
Jo Vellacott, « Feminism as if all People Mattered : Working to Remove the Causes of War, 1919-1929 », Contemporary European History, vol. 10, n° 3, (2001), p. 385.
-
[5]
Annette Becker, Oubliés de la Grande Guerre. Humanitaire et culture de guerre, Paris, Éditions Noêsis, 1998 ; Bruno Cabanes, The Great War and the Origins of Humanitarianism, 1918-1924, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
-
[6]
Bruno Cabanes, « L’humanitaire comme “sortie de guerre” (1919-1924) », Conférence organisée par le CEPSI, Université de Montréal, 2 avril 2016.
-
[7]
Bruno Cabanes, La victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français, 1918-1920, Paris, Seuil, 2004 ; Stéphane Audoin-Rouzeau, Christophe Prochasson, Sortir de la Grande Guerre, le monde et l’après 1918, Paris, Tallandier, 2008.
-
[8]
John Horne, « Demobilizing the Mind : France and the Legacy of the Great War, 1919-1939 », French History & Civilisation, vol. 2, (2009), p. 102.
-
[9]
« L’activité de la Ligue pendant l’hiver 1923-1924 », Bibliothèque historique de la ville de Paris (BHVP), Fonds Jeanne Mélin, Boîte 38.
-
[10]
Madeleine Vernet, « Noël », La Mère éducatrice, 2, no 3, décembre 1918.
-
[11]
Dominique Marshall, « The Construction of Children as an Object of International relations : The Declaration of Children’s Right and the Child Welfare Commitee of the League of Nations, 1900-1924 », The International Journal of Children’s Right, no 7, (1999), p. 103-147.
-
[12]
Linda Mahood, Feminism and Voluntary Action. Eglantyne Jebb and Save the Children, 1876-1928, Palgrave MacMillan, 2009, p. 167.
-
[13]
Dominique Marshall, « Humanitarian Sympathy for Children in Times of War and the History of Children’s Rights, 1919-1925 », dans James Marten & Robert Coles, dir., Children and War. A Historical Anthropology, NYU Press, 2002, p. 184.
-
[14]
Le Save the Children Fund cité dans Ibid., p. 187.
-
[15]
Yves Denéchère, « Au carrefour des causes des enfants, des femmes et de la paix : des parrainages français contre l’occupation de la Ruhr (1923-1924) », Allemagne d’aujourd’hui, no 296, (octobre-décembre 2013), p. 2.
-
[16]
« Extraits du rapport sur l’action de la Section française au cours du dernier exercice, 1920-1921. Adresse au Comité Central de la Ligue », mai 1921, Bibliothèque de documentation international contemporaine (BDIC), Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 208.
-
[17]
Cité dans Ibid. p. 3.
-
[18]
Madeleine Vernet, « Vers la Réconciliation », La Mère Éducatrice, 6, no 12, (1923).
-
[19]
Il ne s’agit pas ici « d’adoption » au sens juridique du terme, mais plutôt de « parrainage ». Yves Denéchère « Au carrefour des causes des enfants … », p. 5.
-
[20]
Rapport du Comité français de secours aux enfants. Compte endu moral pour la période février-août 1922. BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 228/3b.
-
[21]
Ibid.
-
[22]
Devant le retard de l’Allemagne dans le payement des réparations qui lui avaient été imposées par le Traité de Versailles, le premier ministre français Raymond Poincaré envoie, le 11 janvier 1923, des troupes occuper le coeur industriel de l’Allemagne : la Ruhr.
-
[23]
« Au secours des enfants allemands ! », Action fraternelle des enfants de la Ruhr, Section française de la LIFPL. BHVP, Fonds M.-L. Bouglé, Fonds Jeanne Mélin, Boîte 36.
-
[24]
Ibid.
-
[25]
Madeleine Vernet, « Vers la Réconciliation », La Mère Éducatrice, 6e année, no 12, (1923).
-
[26]
« Cooperation for the Relief of Children », Report of the Fourth Congress of Women’s International League for Peace and Freedom, Washington, May 1 to 7, 1924.
-
[27]
Andrée Jouve, « Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté », 9 décembre 1924. BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 208.
-
[28]
« Cooperation for the Relief of Children… ».
-
[29]
Lettres de parrains, janvier 1924, BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 245.
-
[30]
Ibid.
-
[31]
Gabrielle Duchêne, « Rapport du Comité français. Exercice 1920 ». BDIC, Fons Gabrielle Duchêne, F delta res 226. Le CFSE mentionne également l’ouverture d’une cantine dans le quartier de Neukaölln à Berlin à l’hiver 1923-1924 dans son rapport sur les enfants secours depuis la création du Comité. Nous ne possédons toutefois pas d’information supplémentaire sur cette initiative. « Enfants secourus depuis la fondations (décembre 1919) », Comité française de secours aux enfants. BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 226.
-
[32]
Bruno Cabanes (The Great War…, p. 361) fait un constat similaire pour le travail du Save the Children Fund en Angleterre.
-
[33]
Raymond Blanchard, D’allié à ennemi : stéréotypes et représentations des combattants russes dans les magazines illustrés français de la Première Guerre mondiale (1914-1919), Thèse de Maîtrise, Université de Moncton, Département d’histoire mai 2011.
-
[34]
Dans son rapport envoyée à l’AFPER, Roger Soltau donne le bilan suivant : 32 « adoptions » pour le mois de décembre 1923, 59 en janvier 1924, 70 en février, 73 en mars, 68 en avril, 58 en mai et 47 en juin. Lettre de Roger Soltau, 30 juin 1924. BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 245.
-
[35]
« L’activité de la Ligue pendant l’hiver 1923-1924 », Section Français de la LIFPL, 1er mars 1924. BHVP, Fonds M.-L. Bouglé, Fonds Jeanne Mélin, Boîte 38.
-
[36]
Lettre de Gerda Stoffel, 13 décembre 1923. BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 245.
-
[37]
Lettre de M. Hodemann, 2 décembre 1923. BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 245.
-
[38]
Lettre datée du 17 décembre 1923. BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 245.
-
[39]
Madeleine Vernet, « France-Allemagne. Entr’aide, coopération, réconciliation », La Mère éducatrice, 15, no 11-12, (1932).
-
[40]
BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 245.
-
[41]
Madeleine Vernet, « Vers la Réconciliation », La Mère Éducatrice, 6e année, no 12, (1923).
-
[42]
Théodore Ruyssen, « Réponse à quelques objections », Paix par le droit, Mai 1920.
-
[43]
« Les Françaises refusent d’intervenir en faveur des Allemands », La Française, 30 novembre 1918.
-
[44]
Léon Bernard est l’un des fondateurs de l’Organisation sanitaire de la Société des Nations.
-
[45]
Médecin et biologiste français, il a développé en 1921, avec Camille Guérin le premier vaccin efficace contre la tuberculose.
-
[46]
Dix lettres du dossier du Comité français de secours aux enfants, 1924. BDIC. O pièce 45100.
-
[47]
Ibid.
-
[48]
Ibid.
-
[49]
Ibid.
-
[50]
Yves Denéchères, « Au carrefour des causes des enfants… », p. 6.
-
[51]
Ibid.
-
[52]
Lettre de l’Association française pour la Société des Nations, 21 décembre 1923, 4 janvier 1924. BDIC, Fonds Gabrielle Duchêne, F delta res 245.
-
[53]
Adresse de Romain Rolland envoyée au meeting organisé par la Section française de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, 15 janvier 1924. BHVP, Fonds M.-L. Bouglé, Fonds Jeanne Mélin, boîte 38.
-
[54]
Sophie Lorrain, Des pacifistes français et allemands pionniers de l’entente franco-allemande, 1871-1925, Paris, Éditions L’Harmattan, 1999, p. 199.
-
[55]
Ilde Gorguet, Les mouvements pacifistes et la réconciliation franco-allemande dans les années vingt (1919-1931), Bruxelles, Peter Lang, 1999, p. 65.
-
[56]
Yves Denéchère, « Au carrefour des causes des enfants… » p. 1.
-
[57]
Norman Ingram, « Gender and the Politics of Pacifism, Feminist Pacifism and the Case of the French Section of Women’s International League for Peace and Freedom», dans Eva Schöck-Quinteros, Anja Schüler, Annika Wilmers, Kerstin R. Wolff, Politische Netzwerkerinnen : Internationale Zusammanarbeit von Frauen, 1830-1960, Berlin, Trafo Verlag, 200 , p. 274.