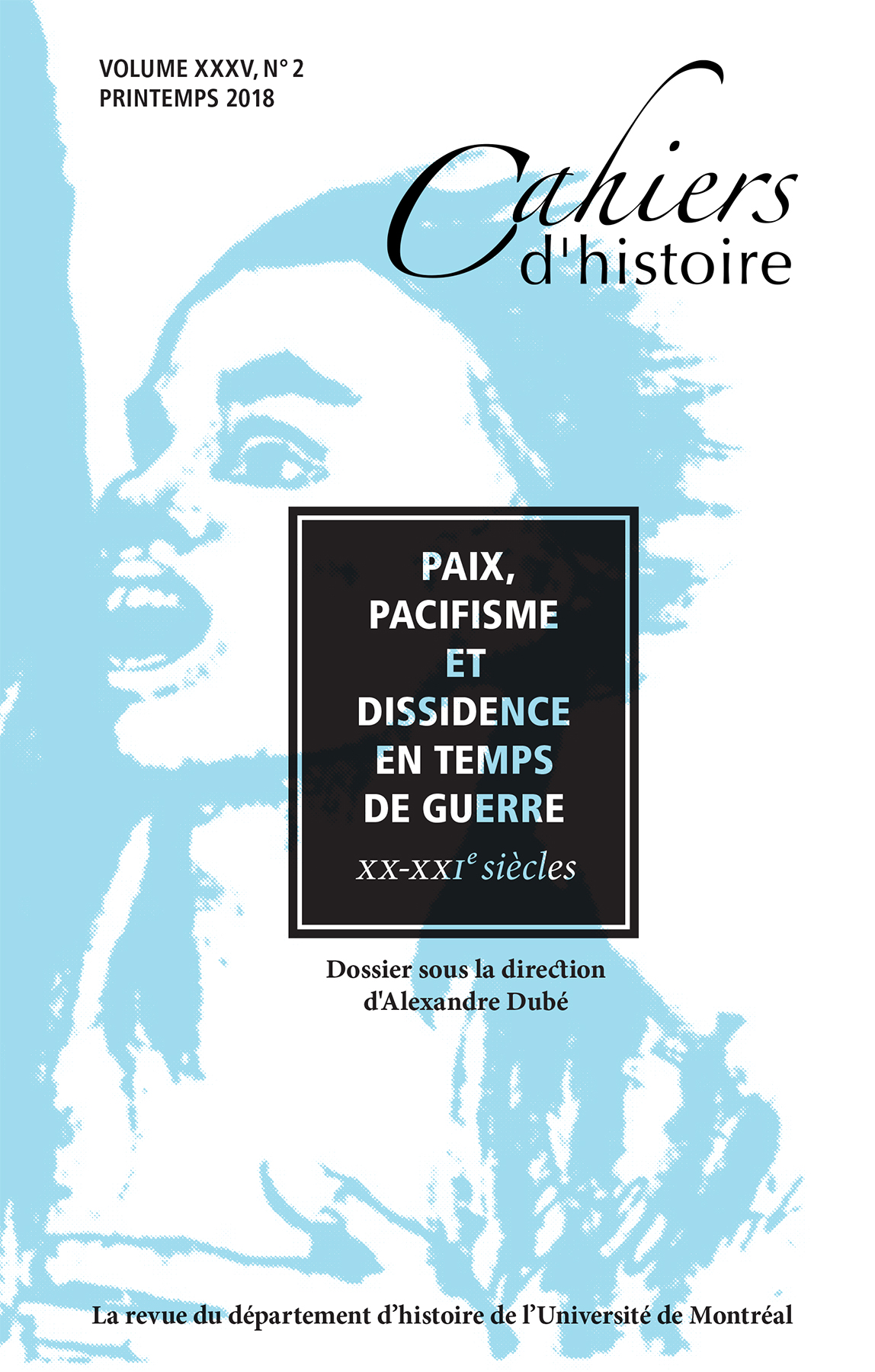Abstracts
Résumé
Comment penser les inégalités et les marges de la commémoration des victimes du national-socialisme dans l’Allemagne contemporaine ? Ne plus concevoir la mémoire « officielle », ni même celle des groupes de victimes comme un donné constitue une condition nécessaire à toute tentative de réponse. C’est pourquoi le présent article propose une conception plus dynamique, plus précise sans doute, en convoquant la notion de « champ » développée par Pierre Bourdieu*. L’idée est alors de dégager une intelligence relationnelle et spatiale, nécessairement interactive, de la production de la mémoire ; d’identifier les acteurs (individuels ou collectifs), les discours et les pratiques impliqués dans sa constitution ; en un mot : de considérer chaque mémoire particulière dans sa pluralité.
Abstract
How should we apprehend the gaps and the inequalities present within the commemoration of the victims of National Socialism in present-day Germany? Approaching neither the “official” memory nor the memories of specific groups as a given represents a preliminary condition to any further elucidation. That is why the present article suggests an alternative, perhaps more operational but certainly more precise approach by referring to Pierre Bourdieu’s so-called “field theory”. The idea is to inform a relational, necessarily interactive, understanding of memory production, to identify the agents (individual or collective), the discourses, and the practices at work in its constitution; in a word, to consider each particular memory in its plurality.
Article body
La tâche de la conscience est de comprendre ce qui s’est passé, et cette compréhension, selon Hegel, est la manière pour l’homme de se réconcilier avec la réalité ; sa fin réelle est d’être en paix avec le monde. L’ennui est que si la conscience est incapable d’apporter la paix et de produire la réconciliation, elle se trouve immédiatement engagée dans son genre propre de guerre[1].
Hannah Arendt
La centralité de la mémoire du national-socialisme et de la commémoration des victimes de la Shoah au sein de l’espace public en Allemagne témoigne d’un « travail de mémoire » (Paul Ricoeur) exemplaire. Celui-ci est sans doute la manifestation d’un engagement pérenne de l’État fédéral et des groupes de la société civile en faveur de la paix, ne serait-ce que sous la forme d’un horizon, le « plus jamais… ». Il participe aussi d’un souci d’inclusion, d’une volonté de tirer des enseignements d’une catastrophe qui ne fut pas qu’allemande. Pourtant, la culture du souvenir (Erinnerungskultur) dans l’Allemagne contemporaine est loin d’être consensuelle. D’une part, elle n’est pas uniforme à l’échelle du pays. La mémoire à Berlin n’est pas la même qu’à Munich ou Nuremberg, par exemple. Ce qui revient à dire que les acteurs (individuels ou collectifs) ne s’impliquent pas tous de la même façon ici et là, ou d’un enjeu à l’autre. Cela signifie également que certaines mémoires ont une portée géographique et/ou symbolique plus grande que d’autres qui opèrent à une échelle moindre, régionale ou locale.
C’est dire aussi, d’autre part, que les mémoires particulières se démarquent entre elles par des inégalités de fait, ce dont témoigne la comparaison entre mémoriaux à Berlin comme à l’échelle de l’Allemagne. Il y a l’exemple, parmi d’autres, du Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe (Denkmal für die ermordeten Juden Europas), inauguré en 2005. En soi, ce mémorial—situé au coeur de Berlin, en face du Bundestag, la Chambre des députés allemands—est certainement la manifestation par excellence de la volonté de l’Allemagne de reconnaître les victimes du national-socialisme, ainsi que sa responsabilité face aux crimes nazis. Cependant, la différence d’investissement financier et symbolique entre le monument aux victimes juives et les autres mémoriaux des alentours—respectivement dédiés aux homosexuels, aux Roms et Sintis, et aux victimes de l’opération T4[2]—est telle qu’elle porte à croire que les victimes ne bénéficient pas d’une reconnaissance à parts égales au sein de la mémoire officielle : la mise en scène y est moins imposante et l’emplacement plutôt discret, situé en retrait par rapport à l’axe touristique de la ville.
Et puis, soulignons l’existence d’angles-morts dans la commémoration des victimes du national-socialisme en Allemagne, des « trous de mémoire » pour ainsi dire. Il y a notamment l’exemple de ce camp de concentration sur le site de l’ancien aéroport international de Berlin-Tempelhof, à Shöneberg. Situé près de la Columbia-Haus—une prison de la Gestapo ayant aussi servi de lieu de formation pour les cadres de la Schutzstaffel (SS)— , ce camp fut le premier du genre en Allemagne, le seul jamais construit dans la ville de Berlin. Après une courte période d’activité (1934-1937), il fut démoli et remplacé par des camps de travail forcé (Arbeitslager) en vue de la construction du nouvel aéroport, puis pour assembler et entretenir les avions militaires pendant la guerre. Jusqu’en 1945, des milliers de civils, principalement originaires des pays d’Europe de l’Est et d’URSS, y ont soutenu l’effort de guerre de la Lufthansa et de la Weser Flug. Des fouilles archéologiques sont en cours afin de retrouver les vestiges de ces camps[3]. Il y a bien un petit monument commémoratif à cet effet, mais il est aujourd’hui vétuste, abandonné à lui-même au coin d’une rue déserte longeant l’aéroport. Du coeur de la « ville-mémoire », on est passé à la marge de la mémoire urbaine en quelques kilomètres à peine.
Une mémoire inclusive, certes, mais pas pour tout le monde semble-t-il. La mémoire des victimes de la guerre et de la persécution contient, en soi et pour soi, une demande de reconnaissance. Celle-ci est parfois même la seule justice possible, l’ultime recours des victimes contre l’impunité des bourreaux. Dans ce sens, la mémoire des crimes peut être aussi une mémoire de paix. Mais quand la demande de reconnaissance contenue dans chaque mémoire particulière est ignorée, en tout ou en partie ; ou lorsque la reconnaissance des uns a pour effet de minorer celle des autres, qu’elle institue l’inégalité entre les morts et que, ce faisant, elle est incapable de produire le consensus et la réconciliation ; alors cette même mémoire risque de se trouver engagée dans « son genre propre de guerre »—et la demande de reconnaissance de devenir compétition.
Comment penser les marges de la commémoration des victimes du national-socialisme en Allemagne ? Comment rendre compte de la constitution d’une mémoire « officielle », de ses enjeux et de ses bénéficiaires ? Comment sont-ils définis et par qui ? Ne plus concevoir cette mémoire officielle, ni même celle du groupe comme un donné constitue une condition nécessaire à toute tentative de réponse. Parler d’une « mémoire juive » du national-socialisme en Allemagne par exemple, voire d’une mémoire juive « berlinoise » ou « munichoise » est problématique en ce qu’on ignore les dissensions existant au sein de ces groupes. C’est aussi présumer d’une unicité que les contemporains n’ont pas connue (sauf à adopter la perspective de leurs bourreaux). Et puis, la mémoire collective n’est pas statique, sa définition et ses enjeux changent au fil du temps, selon les exigences de chaque présent successif.
C’est pourquoi le présent article propose de substituer à l’approche qu’on pourrait nommer « typologique » de la mémoire—c’est-à-dire toute démarche qui tend vers une classification par « types », selon les différents groupes, et qui, prenant acte de la pluralité des cultures mémorielles et du caractère socialement construit de celles-ci, n’en fait pas pour autant le principe de l’analyse elle-même[4]—une conception plus dynamique, plus précise sans doute, en convoquant la notion de « champ » développée par Pierre Bourdieu. Il s’agit alors d’identifier les acteurs (individus, groupes ou institutions) impliqués dans la production de la mémoire à un moment donné dans le temps ; de comprendre les discours, les pratiques, les savoirs—ce que Bourdieu appelle les « systèmes symboliques »[5]—qui la sous-tendent, à la fois dans leur fonction, leur structure et leur genèse ; en un mot : de considérer chaque mémoire particulière dans sa pluralité. L’avantage d’appréhender les politiques du souvenir (Erinnerungspolitik) en Allemagne en termes d’« espace » réside dans la possibilité de saisir cette réalité de manière « relationnelle », de circonscrire l’implication des acteurs en fonction de leurs « positions relatives dans un espace de relations »[6]. Précisons ici que les notions de « position » et de « champ » sont interdépendantes, que la première est ce qui permet l’analyse de la seconde en termes de structure. Tout champ peut ainsi être défini comme un « système de lignes de force » : c’est-à-dire « que les agents ou systèmes d’agents qui en font partie peuvent être décrits comme autant de forces qui, en se posant, s’opposant et se composant, lui confèrent sa structure spécifique à un moment donné du temps »[7]. Suivant Bourdieu, chaque enjeu mémoriel, chaque mémorial peut être alors conçu comme la cristallisation d’un rapport de forces dans lequel diverses instances de l’État fédéral allemand, les administrations régionales et urbaines, les individus et les groupes de la société civile (artistes, intellectuels, historiens, associations de victimes, médias, etc.) sont tous parties prenantes, à des degrés variables—et de manière à chaque fois renouvelée—en fonction des intérêts de leurs membres et des ressources (culturelles, financières, politiques, etc.) à leur disposition.
Comme l’écrit Walter Benjamin, la mémoire est la « scène » (Schauplatz) du passé en même temps qu’un médium. Or, le terme allemand Schauplatz signifie à la fois un endroit d’où l’on est exposé à la vue de tous et un lieu contesté, imbu de relations de pouvoir[8]. De fait, un champ donné se constitue à partir d’un type spécifique de pouvoir (culturel, économique, symbolique, etc.), ou de « capital ». Le capital est « un type déterminé de biens rares »[9], il octroie une légitimité aux acteurs, leur permettant d’accéder au champ, et sa « possession commande l’accès aux profits spécifiques qui sont en jeu dans le champ »[10]. La position plus ou moins avantageuse des acteurs dans le champ est ainsi fonction de leur plus ou moins grande « dotation en capital » et, par conséquent, ceux-ci ont « une propension à s’orienter activement, soit vers la conservation de la distribution de capital, soit vers la subversion de cette distribution »[11]. Expression d’un rapport de forces qu’il s’agit pour chacun des agents impliqués de préserver ou de modifier selon leur position relative en son sein, un champ est donc un champ de lutte dont l’un des principaux enjeux consiste pour chacun d’eux à imposer aux autres sa propre « définition des objectifs et des moyens légitimes de la lutte »[12]. La notion s’avère ainsi pertinente à l’étude des politiques mémorielles en ce que la question de la lutte à l’intérieur d’un champ se rapporte toujours plus ou moins à une lutte pour sa délimitation. Comme l’écrit Reinhart Koselleck à propos des monuments aux morts :
Toute fonctionnalisation de la mort tourne visiblement autour de possibilités visuelles d’identification ; c’est pourquoi il s’agit là tout autant d’exclure les autres, de maintenir dans l’ombre, de passer sous silence—proposition qui est, plus ou moins, applicable à tous les monuments nationaux[13].
Autrement dit, les politiques de la mémoire se comprennent autant par ce qu’elles contiennent que par ce qu’elles excluent. Comment alors interpréter ce qui est hors champ ?
Interroger en quoi un champ est exclusif, c’est lui retirer son caractère d’évidence. Pourquoi ce type de commémoration et pas tel autre ? Dans cette perspective, il convient d’élucider d’abord la centralité de la commémoration des victimes de la Shoah—et la position privilégiée que semble occuper la mémoire juive au sein de cet ensemble—dans l’espace mémoriel de l’Allemagne, ce que nous nous proposons de faire à travers deux moments charnières, soit celui de la constitution du champ dans l’après-guerre et celui de la réunification allemande. Nous verrons en ce sens que la manière dont a été défini l’enjeu dans les années 1950 s’est avérée décisive et qu’elle a déterminé dans une large mesure la forme de la mémoire allemande jusqu’à aujourd’hui. Plutôt qu’une application systématique de la théorie bourdieusienne des champs à chacun de ces épisodes—on peut douter qu’un article puisse suffire à l’analyse d’un seul—, l’exposé qui suit vise, pour l’essentiel, à démontrer la pertinence de la notion de champ appliquée aux politiques de la mémoire, et en particulier pour en penser les écarts. Nous terminerons donc par une brève réflexion sur le traitement accordé à la mémoire des travailleurs forcés sous le nazisme dans l’Allemagne actuelle.
L’Holocauste comme paradigme mémoriel
Pour qu’il y ait commémoration des victimes, encore faut-il que celles-ci soient reconnues comme telles. Cela suppose à son tour d’établir des responsabilités. Or, le champ des politiques de la mémoire en Allemagne a été marqué dès l’origine par ce qu’on pourrait qualifier de « barrières à l’entrée », c’est-à-dire des critères de compétence ou d’appartenance (tacites ou institutionnalisés) qui en contrôlent l’accès. Celles-ci constituent les frontières du champ[14]. D’un enjeu à l’autre, l’existence de telles barrières peut être envisagée comme une tendance structurante du champ : à travers elles se profile déjà la lutte.
Dans l’après-guerre, l’enjeu d’une mémoire allemande centrée sur la commémoration des victimes du national-socialisme n’allait pas de soi. Les procès de Nuremberg avaient jugé les principaux responsables des crimes de guerre, certes, mais il n’en demeurait pas moins difficile de se remémorer un passé où virtuellement tout le monde se trouvait impliqué de près ou de loin. La première décennie post-1945 est ainsi marquée par le silence public, un malaise prégnant autour des victimes des camps de la mort[15]. En témoignent les mémoires héroïques qui prévalent de part et d’autre du rideau de fer dans les années 1950, symbolisées par la figure du « résistant » : entre le récit d’une résistance communiste idéalisée à l’Est et celui d’une résistance conservatrice malheureuse mais héroïque à l’Ouest, le peuple allemand était considéré comme la première victime du national-socialisme[16]. À ce manque de volonté politique s’ajoutent les enjeux de la guerre froide. D’emblée, la question déjà délicate de la responsabilité des crimes et de la reconnaissance des victimes a été étroitement subordonnée aux exigences de la guerre en légitimité que se livraient les deux États allemands à partir de 1949[17]. Éludé de manière commode par une mise à distance idéologique du passé en République démocratique (RDA), la responsabilité officielle des réparations de guerre a été assumée par la République fédérale (RFA), et consécutivement celle des crimes sous régime nazi.
C’est dans ce climat peu propice à la mémoire de l’autre qu’un premier groupe de victimes est monté aux créneaux afin d’obtenir reconnaissance et réparation (Wiedergutmachung, littéralement « rendre bon à nouveau ») : les Juifs. Dès le début des années 1950, une coalition formée de la Conference on Jewish Material Claims Against Germany (ou la Jewish Claims Conference, JCC)—le regroupement d’une vingtaine d’associations juives, d’origine américaine principalement—et d’organisations israélites a été constituée en vue d’opposer un front uni au gouvernement fédéral allemand. Leur cause a d’ailleurs trouvé un puissant relai politique auprès des États-Unis (et d’autres gouvernements alliés), dont l’appui a été décisif au cours des négociations. Bien que circonstancielle, cette coalition d’intérêts est d’autant remarquable qu’elle s’est avérée relativement durable à travers le temps et a maintes fois prouvé son efficacité par la suite. On pourrait d’ailleurs étendre l’analyse à un autre niveau et montrer en quoi l’implication de certains individus—celle du chancelier Konrad Adenauer en premier lieu, qui était étroitement lié aux communautés juives de sa Cologne natale—s’est avérée décisive au cours des négociations[18]. Au terme de celles-ci, et malgré une opinion publique et un parlement divisés, Adenauer a donc consenti à dédommager les survivants victimes de persécution politique, raciale, religieuse ou idéologique sous l’ancien régime nazi. On a promulgué à cet effet diverses lois compensatoires (Bundesentschädigungsgesetz) dès 1953.
Précisons d’emblée que ce cadre légal est volontairement restreint. Ce qui résulte entre autres de la gestion interétatique des réparations prévues par les accords de Londres (1953) sur la dette extérieure allemande, ainsi que de l’état des connaissances et des perceptions du IIIe Reich dans les années 1950. Hormis les États signataires au traité, le paiement des réparations aux autres pays (et leurs ressortissants) dévastés par la guerre, incluant « le coût de l’occupation allemande », est reporté « jusqu’au règlement définitif du problème des Réparations »[19], c’est-à-dire jusqu’à la réunification de l’Allemagne. Par là même, la vaste majorité des victimes originaires du bloc de l’Est—les travailleurs forcés (Zwangsarbeiter) en particulier, expressément visés par l’exclusion des « créances sur les Reichskreditkassen [les caisses publiques du Reich][20] »—s’est vue privée de facto de toute reconnaissance officielle directe par l’Allemagne, au moins jusqu’en 1989.
De plus, l’expression « victimes de la persécution nazie » ne recouvre en réalité qu’une minorité de groupes parmi l’ensemble des individus ayant souffert sous le régime hitlérien—elle n’inclut pas, par exemple, les détenus des camps de concentration libérés par les Alliés—et s’applique pour l’essentiel aux Juifs allemands ayant émigré avant la guerre[21]. La RFA y reconnaît une responsabilité générale à l’égard des victimes du nazisme, certes, mais ce cadre n’en constitue pas moins une forme de reconnaissance indirecte, au mieux implicite, qui suppose d’obtenir réparation pour être validée. Pour ce faire, il fallait notamment être en mesure de démontrer qu’il y avait bien eu persécution—une preuve qui, concrètement, s’est avérée loin d’être évidente à produire. Outre les ressources financières et judiciaires que suppose une telle démarche, il y avait le problème de la documentation, souvent détruite ou inexistante. Ainsi, la crédibilité de la preuve reposait surtout sur la capacité à mobiliser, à réunir et à recouper entre eux les témoignages des victimes survivantes. Il va sans dire que cette difficulté, déjà considérable en soi, n’a fait que croître au fil du temps.
Les négociations ont néanmoins profité aux principaux acteurs impliqués, comme en témoigne les accords du Luxembourg (Wiedergutmachung Agreement) conclus entre la RFA, Israël et la JCC en 1953. Adenauer s’y est engagé à verser une somme substantielle aux Israélites en guise de dédommagement pour l’accueil de réfugiés juifs, des survivants des camps d’Europe de l’Est pour la plupart, et à offrir (via la JCC) des compensations financières individuelles pour les pertes matérielles et morales encourues suite aux lois raciales de Nuremberg. Ces réparations se voulaient un geste hautement symbolique, la reconnaissance par l’Allemagne de sa responsabilité dans la persécution des Juifs sous régime nazi. Significatif, ce geste est aussi d’une insuffisance éloquente, en ce que les réparations ne sont destinées en fait qu’à certaines communautés juives et ne soulignent aucunement la perte de millions d’autres vies humaines sous régime nazi. Cette reconnaissance symbolique ne s’étend pas concrètement, par exemple, au sort des victimes juives d’origine polonaise—à l’exception notable des victimes du Dr Mengele à Auschwitz.
La restriction de l’accès au champ doit être mise en perspective avec le souci d’économie du gouvernement fédéral, qui entendait éviter la sollicitation à outrance de ses caisses—et celles des industries ouest-allemandes, en ce qui concerne les travailleurs forcés en particulier—et ainsi éviter de grever la reconstruction économique de l’après-guerre[22]. Au vu de cette difficulté, les négociations autour de l’enjeu des réparations ont inauguré un argumentaire qui a aussi servi la lutte pour la reconnaissance des victimes juives allemandes et a pu être étendu à d’autres groupes par la suite : l’exceptionnalité juive. Celle-ci découle de la thèse—la singularity thesis—selon laquelle l’Holocauste est un événement unique, sans équivalent dans l’histoire, et mérite de ce fait un statut singulier, lequel devrait par conséquent s’étendre aux victimes. Parmi ces dernières, les Juifs représentent sans aucun doute le groupe dont l’ampleur de la persécution a été sans égale, ne serait-ce qu’en termes de pertes humaines. Sur cette base, les victimes juives de la Shoah ont pu réclamer un traitement à part et, par voie de conséquence, empêcher les autres groupes de revendiquer une expérience comparable[23]. D’emblée, l’enjeu de la reconnaissance des persécutés sous régime nazi a été articulé à une logique d’exclusion—par la voie d’un « inconscient culturel »[24] dirait Bourdieu : c’est-à-dire en conséquence de la conviction des Juifs, internalisée dans leur culture mémorielle (voire même dans celle d’autres groupes ensuite) de leur propre exceptionnalité en tant que victimes. Les prémisses d’une hiérarchisation des victimes étaient donc déjà posées, en même temps que celles d’une compétition entre victimes sur l’échelle de la souffrance. En d’autres mots, l’exception devait être justifiée par la règle, et avec elle la différenciation du statut des victimes.
À travers la question des réparations, c’est donc l’enjeu symbolique de la reconnaissance des victimes du national-socialisme qui se joue—le « capital spécifique » au champ mémoriel, suivant Bourdieu. L’indemnisation financière signifie en quelque sorte le mea culpa officiel, elle signe la légitimité des acteurs et permet de prendre position dans le champ des politiques de la mémoire. Mais l’entrée y a été contingentée dès l’origine, par des modalités d’accès dont l’enjeu et les termes ont été définis dans et par la lutte initiée par Israël et les cercles juifs américains. Leur stratégie s’est avérée particulièrement efficace. On peut d’ailleurs en juger l’économie à l’aune de l’usage communément admis des termes « Holocauste » et « Shoah ». Bien qu’il soit d’utilisation plus courante en anglais, le terme d’Holocauste est aussi contestable en ce qu’il connote l’idée d’un sacrifice religieux. C’est pourquoi les Juifs eux-mêmes ne l’utilisent pas et lui préfèrent le terme Shoah (« catastrophe naturelle » en hébreux). Toujours est-il que ces deux expressions ont d’abord été appliquées au génocide juif sous le national-socialisme spécifiquement et, par là, se sont vues attribuer d’emblée une charge hautement symbolique. Cependant, leur acception est désormais plus « libérale », du moins chez la plupart, et elles sont généralement admises—voire même revendiquées par les autres groupes—pour désigner l’ensemble des victimes des exterminations de masse perpétrées par les Nazis.
C’est dire à quel point la mémoire juive a marqué les esprits et a été l’objet de réappropriations diverses, plus ou moins conscientes, en Allemagne et ailleurs : credo de la mémoire juive d’abord, le discours sur la singularité de l’Holocauste s’est imposé peu à peu comme le paradigme mémoriel par excellence, d’abord aux États-Unis puis en Europe. À partir des années 1960, il a bénéficié d’une médiatisation internationale croissante—notamment dans la foulée des grands procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem et d’Auschwitz à Francfort—qui en a fait l’objet de représentations populaires largement diffusées dans les oeuvres cinématographiques et littéraires au cours des années 1970-80. À l’instar de la série américaine Holocauste (1978), qui a d’ailleurs popularisé l’expression, la plupart de ces succès—le Journal d’Anne Frank, Shoah (1985), Schindler’s List (1993), etc.—entretient plus ou moins directement l’idée d’une exceptionnalité juive[25].
À la généralisation de l’Holocauste en tant que paradigme mémoriel à l’international correspond une évolution parallèle des pratiques commémoratives en RFA, dont le point focal s’est progressivement déplacé vers les victimes des camps de concentration. Dans un premier temps, la lutte pour la reconnaissance (principalement initiée par des groupes non-juifs) qui s’est cristallisée autour de l’enjeu des commémorations dans les anciens camps de concentration en RFA au cours des années 1950 a résulté en l’officialisation de l’asymétrie qui avait déjà cours entre victimes juives et non juives sur le terrain. Devenues un enjeu public médiatisé et porté par divers groupes politiques et sociaux, les commémorations dans les camps sont progressivement institutionnalisées à partir du milieu des années 1960[26]. On remarque d’ailleurs un déplacement correspondant au sein du champ historiographique allemand (et européen) au cours des années 1970-80, où le renouvellement des méthodes et de la recherche participe d’un intérêt croissant pour l’étude des camps et des détenus. Motivés par la disparition progressive des témoins directs de l’expérience concentrationnaire, de même que par l’état d’abandon, voire la disparition de nombreux anciens camps, les historiens se lancent alors à la recherche des « lieux authentiques », des preuves matérielles et orales de la Shoah[27]. Leur expertise est aussi rendue de plus en plus accessible, de même qu’elle est fréquemment sollicitée sur la place publique par les tribunaux, les associations de victimes, les musées locaux, etc. On assiste donc à partir du milieu des années 1970 à la constitution de la recherche historiographique en tant qu’« auxiliaire » de la mémoire (et vice versa), une évolution qui est allée dans le sens d’une démocratisation et d’une hétérogénéité croissantes du champ des politiques mémorielles[28].
Les politiques de la Vergangenheitbewältigung à l’ère la réunification
Apparue au cours des années 1950, l’expression « maîtrise du passé » (Vergangenheit-bewältigung) a revêtu dès le départ une signification polémique et utilitaire. Elle désigne à la fois la volonté de promouvoir une mémoire critique et l’inévitable intrication entre pouvoir et mémoire. Elle connote ultimement l’idée d’une répression du passé—d’où la fameuse critique de Theodore W. Adorno, qui propose plutôt de « s’accorder avec le passé » (Aufarbeitung), évoquant l’idée d’un travail de mémoire[29]. Aussi l’expression est-elle d’utilisation peu courante, sinon teintée d’ironie. Elle évoque particulièrement bien l’ambivalence du champ des politiques de la mémoire, le lieu d’une remise en question qui engendre par ailleurs d’autres spectres d’exclusion.
L’ouverture progressive du discours mémoriel en RFA a permis à de nouveaux acteurs d’y entrer, notamment des historiens ou des groupes politiques, tout autant de positions de point d’appui dans la lutte pour la reconnaissance officielle. Dans un même temps, elle a aussi permis aux associations de victimes juives, envisagées dans leur ensemble, de se positionner en tant que « classe dominante » du champ mémoriel—laquelle tend, malgré ses antagonismes et ses divisions, à se constituer en « corps », nous dit Bourdieu, en tant qu’elle comprend « l’ensemble des agents qui occupent de fait les positions de pouvoir sur le capital, c’est-à-dire sur le fonctionnement même d’un champ ou sur le système des instruments de reproduction de ce champ »[30]. C’est en ce sens, du moins, qu’on peut expliquer que la brèche ouverte par la reconnaissance officielle de certains groupes de victimes juives au début des années 1950 ait pu être investie par leurs homologues allemands d’abord, et seulement ensuite par d’autres groupes. D’une part, les victimes juives d’Allemagne pouvaient en appeler (devant les tribunaux entre autres) à la reconnaissance générale déjà accordée au groupe dans son ensemble. D’autre part, les instances de représentation constituées par les cercles juifs américains et israélites dès les années 1950 ont pu servir en tant que courroies de transmission (et comme leviers de financement) pour relayer les revendications plus ou moins localisées des diverses associations juives allemandes auprès des gouvernements régionaux et fédéral.
C’est aussi dans cette perspective qu’on peut interpréter le fait que la mémoire juive des camps et de la persécution sous le nazisme soit devenue progressivement un modèle de reconnaissance pour les autres groupes de victimes (en Allemagne et ailleurs)[31], dont le succès—par exemple, la reconnaissance officielle obtenue par les Roms et Sintis en 1982, et par les homosexuels en 1985—a été fonction de la capacité à reproduire les formes préalables de mémoire institutionnalisée de la persécution juive (centralisation des ressources disponibles, recherche d’appuis à l’international, recours aux tribunaux, accroissement de la visibilité médiatique par des manifestations publiques, etc.). Dans le cas des Roms et Sintis, le soutien de figures de proue des communautés juives allemandes s’est même avéré décisif, d’autant qu’un des enjeux de la lutte était de faire reconnaître l’assassinat de 500 000 d’entre eux sous le national-socialisme comme un génocide, et non seulement comme la répression de groupes étiquetés par les nazis comme criminels[32].
Par-delà les réparations, la lutte pour la reconnaissance est donc aussi, de manière plus ou moins immédiate, une lutte pour le pouvoir, un pouvoir dont la portée symbolique permet non seulement d’influencer le rapport de forces à l’intérieur du champ des politiques de la mémoire, mais aussi d’intervenir dans d’autres champs. Dans les termes de Bourdieu, toute lutte à l’intérieur d’un champ, en tant que lutte aux frontières portant sur la définition même des enjeux, s’inscrit plus largement dans une lutte pour le « champ du pouvoir », c’est-à-dire « l’espace des positions à partir desquelles s’exerce un pouvoir sur le capital sous ses différentes espèces »[33]. En d’autres mots, le champ du pouvoir est ce qui donne un pouvoir sur le pouvoir, c’est-à-dire sur la forme spécifique de capital en jeu au sein du champ, et permet de convertir celui-ci en d’autres formes de capital pour intervenir dans d’autres champs. Par exemple, la reconnaissance officielle par le chancelier Helmut Schmidt du génocide des Roms et Sintis a marqué le groupe comme acteur légitime du champ et a pavé la voie à leur reconnaissance en tant que minorité nationale au sein de l’espace allemand, finalement obtenue en 1995 après que le parti social-démocrate (SPD) ait endossé l’enjeu au niveau fédéral[34]. Leur reconnaissance dans le champ mémoriel a rendu possible celle dans le champ politique.
C’est pourquoi l’État doit être à la fois conçu comme un acteur et l’un des enjeux du champ mémoriel. Il est un acteur dans la mesure où certains de ses agents (individus ou institutions) interviennent plus ou moins directement dans le champ et, ce faisant, en modifient le rapport de forces. Mais il représente aussi un enjeu en ce que les acteurs du champ mémoriel, à la recherche d’une position stable, tentent de s’y ménager une « niche » pour sécuriser leur propre position à l’intérieur du champ[35]. La capacité plus ou moins grande des groupes d’accéder au pouvoir fédéral est en quelque sorte synonyme d’une présence plus ou moins marquée dans la mémoire officielle. Or, comme on l’a vu, l’antécédence de fait des instances de représentation politiques rattachées aux associations de victimes juives avait déjà marqué le groupe comme interlocuteur légitime des gouvernements fédéral et régionaux avant même l’entrée en lice des autres groupes de victimes[36].
Le cas du Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe (MJE) est sans doute l’illustration la plus évidente de l’immédiateté politique de la mémoire. Le dénouement de cette controverse prolongée qui a eu cours pendant les années 1990 résulte de négociations complexes, parfois hostiles, parmi une constellation d’acteurs politiques et sociaux. Dès le départ, le monument a été envisagé comme un projet non-juif, d’abord destiné aux descendants des bourreaux, une manière de rappeler aux Allemands des deuxième et troisième générations leur responsabilité historique à l’égard des victimes de la Shoah. Porté par une association citoyenne—le mouvement Perspektive Berlin, initié en 1989—, le projet a trouvé un soutien immédiat dans l’opinion publique, obtenant l’appui d’intellectuels et de politiques de premier plan. Au cours de la même année, le projet est approuvé par le gouvernement fédéral et le sénat de Berlin. Cependant, un représentant du Comité central des Roms et Sintis en Allemagne (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, ZDSR), Romani Rose, publie dès 1988 une série d’articles et de pétitions dans divers journaux berlinois pour s’y opposer, dénonçant l’exclusion des victimes non juives du projet du MJE. Ce faisant, il a initié une vive opposition au projet qui a pris une ampleur sans précédent.
Bien que remarquables, les implications diverses des groupes de la société civile et du grand public se situent plutôt en marge de l’enjeu, dont le dénouement a été tranché en amont. Celui-ci résulte d’une lutte de pouvoir entre Rose et le ZDSR d’un côté, et le Comité central des Juifs en Allemagne (Zentralrat der Juden in Deutschland, ZJD) de l’autre. Or, les décisions successives des autorités berlinoise et fédérale sont constamment allées dans le sens des volontés du ZJD, représenté par Heinz Galinski puis Ignatz Bubis à partir de 1992. Les propositions de Rose et du ZDSR pour l’érection d’un mémorial commun aux Juifs et aux Roms et Sintis, puis pour situer les deux mémoriaux sur un site partagé, ont été repoussées tour à tour, tant par le ZJD que par le gouvernement fédéral et le sénat berlinois[37]. Il faut souligner par ailleurs que la controverse coïncide avec la réunification, un moment de redéfinition identitaire pour l’Allemagne qui ajoutait une signification supplémentaire aux débats. Dès lors, la question n’était plus seulement de savoir comment il faut se souvenir, mais bien plutôt de déterminer ce que doit inclure la mémoire de la « nouvelle Allemagne », pour elle-même et aux yeux du reste du monde. Les polémiques sur le MJE s’insèrent en ce sens dans un processus plus large, amorcé dès le début des années 1980, qui participe d’un renouvellement de l’espace social et de la création de nouveaux lieux de mémoire en Allemagne[38], notamment des musées historiques nationaux à Bonn (ouvert en 1994) et Berlin (1987) et la Topographie de la terreur (Topographie des Terrors)[39].
Le caractère politiquement sensible de l’enjeu élucide en partie son dénouement. L’instant décisif de cette lutte acrimonieuse entre les leaderships juif et romani pour l’espace politique, symbolique et physique est survenu en 1993, au moment où le chancelier Helmut Kohl a rejeté officiellement l’idée d’un mémorial commun, insistant sur l’établissement de deux sites de commémoration distincts. Cette décision était avant tout un calcul politique, principalement en ce que l’appui des Juifs allemands conférait une certaine légitimité à l’agenda mémoriel du chancelier, par ailleurs objet d’une contestation soutenue dans les médias et les milieux académiques. En effet, sous l’administration Kohl (1982-1998), la chancellerie (Bundeskanzleramt) a entretenu des liens étroits avec les communautés juives d’Allemagne, notamment le ZJD, qui est devenu un interlocuteur privilégié du gouvernement fédéral, l’un des rares groupes de la société civile ayant son mot à dire dans les projets muséaux à Berlin et à Bonn[40]. Or, la réouverture de la Neue Wache (littéralement « Nouvelle garde »)—un mémorial construit par la RDA—prévue au cours de la même année représentait sans doute le projet le plus controversé du chancelier. Mais Kohl tenait à ce mémorial en ce qu’il symbolisait la réconciliation des deux Allemagnes et de leurs mémoires respectives. Pour éviter le soufflet qu’aurait signifié l’opposition de la communauté juive à ce projet, Kohl a dû satisfaire aux pressions exercées par Bubis et le ZJD à propos du MJE, qui a alors fait office de monnaie d’échange : la mémoire juive gardera l’exclusivité sur l’espace mémoriel qui lui est dédié, et en retour elle ne constituera pas un obstacle au renouvellement de la mémoire allemande telle qu’envisagée par le chancelier[41].
Bien entendu, Rose et le ZDSR ont vivement réagi à cette décision, entre autres en publiant une série d’articles incendiaires. Dès lors, leur stratégie a consisté à égaler les discours mémoriels sur la victimisation des Juifs en insistant sur le caractère partagé et la singularité commune des persécutions juive et romani. Plutôt que de chercher une niche mémorielle à part, on a ainsi tenté de se « greffer » à la mémoire juive pour partager sa position centrale dans le discours officiel allemand. Autrement dit, Rose a adopté la stratégie d’exclusion utilisée par les cercles juifs avant lui comme modèle de reconnaissance pour son propre groupe. Dès lors, les débats déjà virulents à propos des « formes appropriées » de représentation historique s’en sont trouvés amplifiés, avec l’implication parallèle des médias, des intellectuels, des politiciens, du grand public, de même que des personnes en charge du projet du MJE. Les éditoriaux de l’époque reprenaient souvent l’expression de « guerre religieuse » (Glaubenskrieg) afin de caractériser les polémiques du moment. D’aucuns considéraient l’idée d’ériger des mémoriaux séparés comme l’affirmation visuelle et concrète d’une hiérarchie des victimes. Ainsi, selon Reinhart Koselleck : « Les différents triangles de couleur portés par les prisonniers des camps de concentration reviennent après cinquante ans, sous forme de mémoriaux » [42].
Au final, le Bundestag a entériné l’idée de construire des monuments séparés sur des sites distincts en 1999, mais tout en maintenant celle de créer un « quartier mémoriel ». Le conflit a alors été partiellement résolu par la création de la Fondation du MJE (Siftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas), une institution indépendante de droit public devant s’assurer que « toutes les victimes du national-socialisme soit remémorées et honorées de manière appropriée »[43]. On a ainsi décidé d’institutionnaliser l’ensemble des mémoires allemandes de la Shoah à travers le centre d’information aménagé sous le MJE. En 2009, le Bundestag a décidé de placer les monuments respectivement dédiés aux homosexuels et aux Roms et Sintis sous le contrôle de la Fondation du MJE, en vue de centraliser les fonds alloués par le gouvernement fédéral ainsi que les initiatives de recherche et pédagogiques. Bien que la prise de décision ait été envisagée à l’origine comme une collaboration entre les différentes associations de victimes (sept en tout pour les Roms et Sintis seulement), rien n’indique à ce jour que tel est effectivement le cas, tandis que la vaste majorité des activités en cours à la fondation du MJE sont expressément dédiées à la mémoire juive[44].
À Tempelhof vous dites… ?
On entend souvent dire que se souvenir c’est oublier par ailleurs, que la mémoire et l’oubli vont de pair. Mais selon Henry Rousso, il faudrait dire plutôt qu’oublier c’est taire : l’oubli n’est pas le signe d’une mémoire défaillante, mais celui d’un « déficit de parole »[45]. Pour qu’on s’en souvienne, toute mémoire doit être dite et entendue, une synchronisation qui n’a pas toujours été évidente. Ceci s’applique particulièrement bien aux victimes des camps de travail forcé sous régime nazi. Comme le dit Bourdieu, dans une remarque aussi valable pour l’espace mémoriel allemand pris dans son ensemble, le champ du pouvoir est un « système opaque à lui-même de relations objectives entre des positions et des intérêts à la fois concurrents et convergents »[46]—un pouvoir qui ne se reconnait pas tel et, par là même, méconnait ce qu’il a d’arbitraire.
Certes, dans la foulée de l’ouverture du discours mémoriel au moment de la réunification, des négociations tenues entre 1998 et 2001 ont abouti à la création d’un programme fédéral pour verser des compensations financières aux survivants des camps de travail à travers le monde. Résultats de pressions exercées par l’administration Clinton[47], ces réparations financées en commun par l’État fédéral et l’industrie allemande (plus de 6 000 compagnies en tout) ont servi à dédommager à ce jour plus de 1.7 millions d’individus à travers le monde. Tout en concédant que rien n’avait été fait auparavant en ce sens, le président fédéral allemand Horst Koehler déclarait en 2007 : « Au moins, avec ces paiements symboliques, les souffrances des victimes ont été publiquement reconnues après des décennies d’oubli »[48]. Cependant, le monument esseulé et vétuste à l’aéroport de Tempelhof donne à entendre une autre version, qui rappelle que la reconnaissance officielle est certes un premier pas significatif mais ne se traduit pas nécessairement en actes durables.
En tout et partout, on estime à plus de sept millions le nombre d’individus déportés en Allemagne. Des dizaines de milliers de camps de travail (dont 3 000 à Berlin) qui ont été en activité pendant la guerre dans l’espace allemand, la plupart ont été oubliés, sans laisser de traces ni d’eux-mêmes ni de leurs victimes[49]. C’est dire que l’exemple de Tempelhof n’en est qu’un parmi d’autres. Il y aurait certainement beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais contentons-nous d’évoquer quelques pistes explicatives à ce manque au vu des éléments d’analyse dégagés ci-haut.
Il y a d’abord le fait que les règles du jeu, ou mieux les « régularités »[50] du champ mémoriel en Allemagne, telles qu’elles ont été définies historiquement dans et par la lutte pour la reconnaissance des victimes de la Shoah, cadrent plus ou moins bien avec la situation des victimes des camps de travail. Leur persécution était économique et, en un sens, « aléatoire », non pas dirigée contre un groupe identifiable mais plutôt due aux hasards de la guerre et des conquêtes. Dispersés à travers l’Europe de l’Est, ces victimes ne constituaient pas un groupe homogène et aisément mobilisable non plus, d’autant que, dans le contexte de l’URSS, elles détenaient une expérience qu’il valait mieux taire, au risque de se faire envoyer dans les goulags pour « coopération avec l’ennemi ».
On peut aussi évoquer le fait que la recherche historique au sujet des camps de travail n’a commencé que sur le tard, vers le milieu des années 1980, et qu’elle demeure lacunaire à ce jour. La majorité de la documentation à propos des conditions de vie des travailleurs forcés sous régime nazi est toujours en attente d’un traitement scientifique, enfouie dans les archives des compagnies allemandes concernées. Or, l’accès public à ces documents est considérablement restreint, lorsqu’il n’est pas simplement interdit : leur consultation est soumise à des heures d’ouverture prohibitives, ou encore les informations trouvées ne sont pas autorisées pour publication. L’interdit de publication s’applique même à des travaux commandités par les industries elles-mêmes—comme ce fut le cas pour l’histoire de la Lufthansa écrite par Budraß—lorsqu’ils ne servent pas à les exempter de toute responsabilité. Les témoignages oraux des travailleurs forcés se font plutôt rares aussi (entre autres pour les raisons évoquées plus haut) en comparaison avec l’abondance des témoignages rendus disponibles par les banques de données sur les victimes de la Shoah[51].
Pour ce qui est du site de Tempelhof comme tel, il faut dire que la mémoire du site est avant tout une mémoire heureuse et fière, celle de la guerre froide et du pont aérien, laquelle est difficilement conciliable avec cet autre souvenir, lugubre et triste. Pour les mentalités ouest-berlinoises, l’aéroport de Tempelhof est devenu symbole de liberté dans les années 1950, une victoire arrachée à l’oppresseur communiste, comme en témoigne d’ailleurs la désignation officielle de l’endroit : Tempelhof Freiheit (littéralement « Tempelhof Liberté »). Cette mémoire heureuse permet d’expliquer pourquoi, parmi tous les groupes locaux qui ont protesté contre la destruction de l’ancien aéroport ou sa reconversion en quartier industriel (ou en condos), le travail de sensibilisation mené depuis 1992 par l’Association pour une commémoration des crimes nazis à l’aéroport de Tempelhof (Föderverein für ein Gedenken an die Naziverbrechen auf dem Tempelhofer Flugfeld) est demeuré lettre morte ou presque. On peut aussi évoquer en passant les difficultés liées au travail en cours des archéologues : l’idée même de conduire des fouilles archéologiques sur le passé allemand contemporain ne va pas sans susciter des résistances académiques et le parrainage institutionnel du projet en milieu universitaire fait toujours défaut[52].
Pour résumer, la mémoire des travailleurs forcés sous le national-socialisme n’a pu se prévaloir des mêmes conditions que celles d’autres groupes pour se faire reconnaître. Est-ce une raison valable pour reléguer leur mémoire à la marge de l’espace mémoriel ? Non, sans aucun doute. Mais c’est du moins ce que suggère implicitement la décision (2005) d’institutionnaliser leur mémoire non pas avec celles de la Shoah, au centre d’information sous le MJE, mais à travers la Fondation de la Topographie de la terreur (Siftung Topographie des Terrors), dans un centre de documentation (NS-Zwangsarbeit Dokummentationszentrum) à Shöneweide (Berlin). Cette fondation est en charge du centre d’information du même nom (cf. note 40), non loin du quartier mémoriel—un site dédié à la mémoire des bourreaux, question de rappeler que la capitale de l’Allemagne réunifiée était autrefois celle du IIIe Reich. Ce n’est sans doute qu’une coïncidence malheureuse mais qui, en un sens, parle d’elle-même. Concevoir la mémoire officielle, ou même celle des groupes, comme un donné, ce serait méconnaître la part d’arbitraire qui préside à sa constitution.
Bien entendu, le présent article comporte plusieurs zones d’ombre, parmi lesquelles l’omission de la figure du « résistant » dans la mémoire allemande du national-socialisme est sans doute la plus grande. Cette question pointe par ailleurs vers des avenues de recherche intéressantes, notamment en ce qui a trait aux disparités géographiques de la mémoire évoquées en introduction. Par exemple, la différence de traitement du passé national-socialiste entre Berlin et Munich est tangible, entre autres dans la gestion du patrimoine bâti datant de la période nazie, et en particulier dans la place attribuée à la mémoire de la résistance allemande à Hitler : les écarts sont tels que la mémoire « officielle » ne semble pas être la même ici et là, nous invitant à en faire une analyse plus localisée. Dans tous les cas, et malgré les manques de la démonstration elle-même, nous estimons avoir suffisamment plaidé ici pour un instrument de saisie adapté à son objet, où la réalité de la mémoire collective telle qu’elle se donne à lire concrètement, en termes d’espaces et de relations pluriels, constitue le principe même de l’analyse.
Les politiques de la mémoire sont un champ de bataille où n’entre pas qui veut, et où le choix des armes est imposé par d’autres. La mémoire du national-socialisme et la commémoration des victimes de l’Holocauste manifestent l’engagement assumé et exemplaire de l’Allemagne envers la paix et la démocratie, certes, mais on doit déplorer qu’elles n’aient pas encore permis une réconciliation durable. En témoigne la mémoire des travailleurs forcés, parmi d’autres. Pourtant, cette mémoire est d’une actualité criante, elle renvoie à la question de la démocratie dans l’Europe contemporaine. Elle concerne l’Allemagne en particulier, alors même que la reconstruction économique de l’après-guerre a été rendue possible, entre autres, par l’accueil de millions de travailleurs étrangers qui, à la troisième génération, peinent à être considérés comme des citoyens à part entière. Encore une fois, Reinhart Koselleck rend très bien compte de cette actualité de la mémoire quand il écrit, à propos des monuments aux morts d’une autre guerre :
L’érection de monuments se fait par l’intermédiaire de groupements politiques qui, par cet acte même, prennent leur distance par rapport aux autres. En ce sens déjà la fonctionnalisation des monuments aux morts tend vers une religion civile au sens rousseauiste du terme et par là vers une légitimité démocratique. Mais par-delà ce principe démocratique et national, la place de chaque individu change elle aussi sur les monuments aux morts[53].
Dans ce sens, le fait d’accorder aux victimes des camps de travail forcé sous régime nazi leur juste place dans la mémoire officielle du national-socialisme constituerait sans doute un geste significatif, peut-être le gage d’une meilleure intégration, plus inclusive, des travailleurs étrangers dans les démocraties en Allemagne et ailleurs en Europe.
Appendices
Notes
-
[1]
Hannah Arendt, La crise de la culture, trad. Patrick Lévy, Paris, Gallimard, 1972 [1968], p. 17.
-
[2]
L’Aktion T4 est le programme d’exécutions par soi-disant « euthanasie » des handicapés mentaux sous le régime nazi, officiellement entre janvier 1940 et août 1941 mais officieusement jusqu’à la fin de la guerre.
-
[3]
Cf. Susan Pollock et Reinhard Bernbeck, « A gate to a darker world: Excavating at the Tempelhof Airport », dans Alfredo González-Ruibal et Gabriel Moshenska, dir., Ethics and the Archaeology of Violence, vol. 2, New York, Springer, 2015, p. 137-152.
-
[4]
Par exemple, cf. Anette Fuchs, Phantoms of War in Contemporary German Literature, Films and Discourse. The Politics of Memory, New York, Palgrave Macmillan, 2008 ; Konrad H. Jarausch et Michael Geyer, Shattered Past: Reconstructing German Histories, Princeton, Princeton University Press, 2003.
-
[5]
Yves Patte, « Sur le concept de “champ” : L’approche “more geometrico” d’un débat public, la prostitution en Belgique », Sociologie et sociétés, vol. 38, no 1 (2006), p. 245.
-
[6]
Bourdieu (1994), cité dans Ibid., p. 241.
-
[7]
Bourdieu (1966), p. 865-866, cité dans Ibid., p. 242.
-
[8]
Karen Till, The New Berlin: Memory, Politics, Place, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005, p. 10-11.
-
[9]
Pierre Bourdieu, « Séminaires sur le concept de champ, 1972-1975. Introduction de Patrick Champagne », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 5, no 200 (2013), p. 21.
-
[10]
Bourdieu (1992, p. 72-73), cité dans Patte, « Sur le concept de “champ”… », p. 248.
-
[11]
Bourdieu (1992, p. 84) cité dans Ibid., p. 241.
-
[12]
Bourdieu, « Séminaires sur le concept de champ… », p. 36-37.
-
[13]
Reinhart Koselleck, « Les monuments aux morts. Contribution à l’étude d’une marque visuelle des temps modernes », dans M. Vovelle, dir. Iconographie et Histoire des Mentalités, Paris, Éditions du CNRS, 1979, p. 120.
-
[14]
Pierre Bourdieu et Loïc J. D. Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Paris, Seuil, 1992, p. 76.
-
[15]
Harold Marcuse, « Memorializing Persecuted Jews in Dachau and Other West German Concentration Camp Memorial Sites », dans Bill Niven et Chloe Paver, dir., Memorialization in Germany since 1945, New York, Palgrave Macmillan, 2010, p. 196.
-
[16]
Cf. Fuchs, « Narrating Resistance to the Third Reich: Museum Discours, Autobioraphy, Fiction and Film », dans Fuchs, Phantoms of War…, p. 109-160.
-
[17]
Cf. Geoffrey Herf, Divided Memory. The Nazi Past in the Two Germanys, Cambridge, Harvard University Press, 1997.
-
[18]
Andreas Mink, Challenging “Wiedergutmachung”: The Slave Labor Negotiations of 1998-2001, Prague, Institute of International Relations, 2012, p. 19.
-
[19]
Royaume-Uni, Agreement on German External Debts, Londres, HMSO, 1959 [1953], art. 5, par. 2, p. 26.
-
[20]
Ibid.
-
[21]
Mink, Challenging “Wiedergutmachung”…, p. 18.
-
[22]
Susan Pollock et Reinhard Bernbeck, « The limits of experience: Suffering, Nazi Forced Labor Camps, and Suffering », Archeological Papers of the American Anthropological Association, vol. 27, no 1 (2016), p. 25-26.
-
[23]
Nadine Blumer, « Disentangling the Hierarchy of Victimhood: Commemorating Sinty and Roma and Jews Germany’s National Narrative », dans Anton Weiss-Wendt, dir., The Nazi Genocide of the Roma : Reassessment and Commemoration, vol. 17, New York, Berghan Books, 2013, p. 206.
-
[24]
Patte, « Sur le concept de “champ”… », p. 242.
-
[25]
Blumer, « Disentangling the Hierarchy of Victimhood… », p. 206.
-
[26]
Marcuse, « Memorializing Persecuted Jews in Dachau… », p. 192-204.
-
[27]
Jennifer A. Jordan, Structures of Memory: Understanding Urban Change in Berlin and Beyond, Stanford, Stanford University Press, 2006, p. 45.
-
[28]
Cf. Geoff Eley, « The Past Under Erasure? History, Memory, and the Contemporary », Journal of Contemporary History, vol. 46, no 3 (2011), p. 555-573.
-
[29]
Cf. T. W. Adorno, « What Does Coming to Terms with the Past Mean ? » [1959], dans Geoffrey H. Hartman, dir., Bitburg in Moral and Political Perspective, Bloomington (É-U), Indiana University Press, 1986, p. 114-129.
-
[30]
Pierre Bourdieu, « Champ du pouvoir et division du travail de domination. Texte manuscrit inédit ayant servi de support de cours au Collège de France, 1985-1986 », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 5, no 190 (2011), p. 128.
-
[31]
Henry Rousso, « Vers une mondialisation de la mémoire », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 94 (2007), p. 9.
-
[32]
En ce sens, l’appui de Simone Veil, survivante juive des camps, et présidente du Parlement européen (1979-1982), en tant que porte-étendard de la cause des Roms et Sintis est significatif. Blumer, « Disentangling the Hierarchy of Victimhood… », p. 210-11.
-
[33]
Bourdieu, « Champ du pouvoir… », p. 128.
-
[34]
Blumer, Ibid., p. 211.
-
[35]
Bourdieu et Wacquant, Réponses…, p. 89-90.
-
[36]
Précisons ici que, dans le contexte de la guerre froide, la place accordée à la mémoire juive dans les mémoires officielles du national-socialisme de part et d’autre du Mur était aussi, de manière immédiate, une prise de position à l’égard d’Israël. Cf. Geoffrey Herf, Divided Memory…, et en particulier le chapitre 9, p. 334-372.
-
[37]
Blumer, « Disentangling the Hierarchy of Victimhood… », p. 211-214.
-
[38]
Till, The New Berlin…, p. 20.
-
[39]
Un emplacement au coeur de Berlin où était situé l’appareil de répression du IIIe Reich (le quartier général de la Gestapo, entre autres), objet d’une exposition en 1987, et dont le centre d’information a été inauguré en 2010.
-
[40]
Wulf Kansteiner, « Losing the War, Winning the Memory Battle. The Legacy of Nazism, World War II, and the Holocaust in the Federal Republic of Germany », dans Richard N. Lebow, Wulf Kansteiner, et Claudio Fogu dir., The Politics of Memory in Postwar Europe, Durham, Duke University Press, 2006, p. 127-128.
-
[41]
Blumer, « Disentangling the Hierarchy of Victimhood… », p. 215.
-
[42]
Traduction libre : « The variously colored triangles worn by concentration camp inmates are returning after fifty years, re-created in memorials. » Cité dans Ibid., p. 219.
-
[43]
Traduction libre. Cf. Ibid., p. 221.
-
[44]
Ibid., p. 221.
-
[45]
Henry Rousso, Face au passé. Essais sur la mémoire contemporaine, Paris, Belin, 2016, p. 54.
-
[46]
Bourdieu, « Champ du pouvoir… », p. 136.
-
[47]
Pollock et Bernbeck, « The limits of experience… », p. 25.
-
[48]
Traduction libre. Cf. Erik Kirschbaum, « Germany Ends War Chapter with “Slave Fund” Closure » [en ligne], Reuters, http://uk.reuters.com/article/life-germany-nazi-fund-dc-idUKL126092920070612 (page consultée le 24 octobre 2016).
-
[49]
Pollock et Bernbeck, « The limits of experience… », p. 23-24.
-
[50]
Bourdieu et Wacquant, Réponses…, p. 73.
-
[51]
Pollock et Bernbeck, « The limits of experience… », p. 25-26.
-
[52]
Pollock et Bernbeck, « A gate to a darker world… », p. 138.
-
[53]
Koselleck, « Les monuments aux morts… », p. 121.