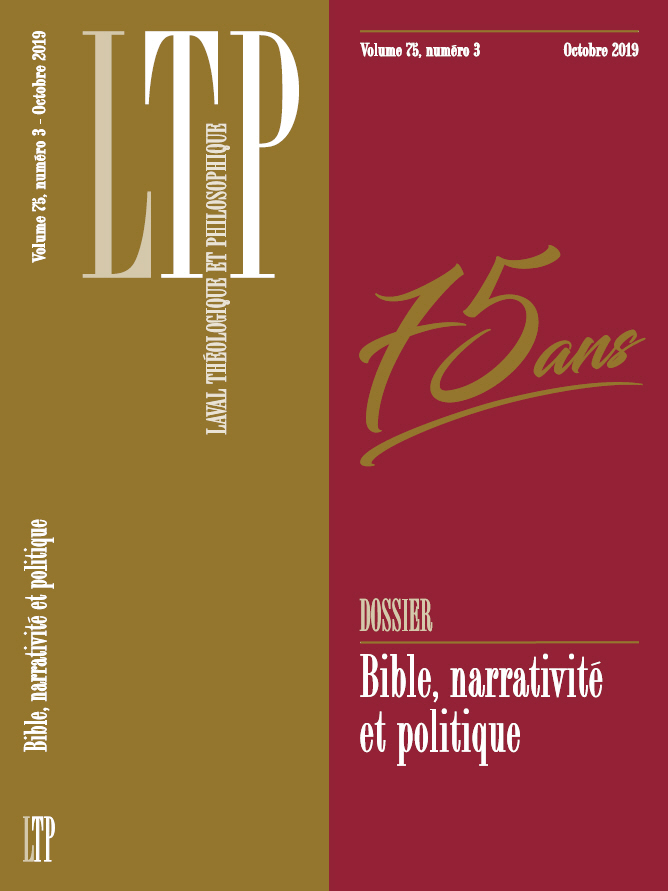Abstracts
Résumé
L’interprétation politique du NT a rencontré de sérieuses objections dans l’histoire de l’exégèse. Contre cette tendance, l’auteur tente ici une interprétation des récits néotestamentaires à l’aide de la critique idéologique. Plus spécifiquement, il interprète les évangiles comme contre-récit du récit dominant impérial en juxtaposant le Christ et l’empereur, les pratiques instituées de l’ekklēsia et celles de l’Empire. Cette comparaison s’appuie sur une analyse originale des rapports pouvant exister entre narrativité, religion et politique. La première étape de cette recherche consiste en une analyse de l’utilisation du genre narratif par des acteurs politiques ou religieux pour convaincre leur public de la viabilité de leur vision d’avenir.
Abstract
Biblical critics have traditionally objected to political interpretations of the NT. Bucking this trend, the author uses ideological criticism to interpret NT narratives from a political perspective. More specifically, he interprets the Christian story as a counter-story to the dominant narrative of imperial Rome, juxtaposing Christ and emperor, the institutionalized practices of ekklēsia and empire. This comparison is based on an original analysis of the relationships between narrative, religion and politics. As a first step, the author considers the use of the narrative genre by political or religious actors to convince an audience of the viability of their vision for the future.
Article body
La politique consiste dans la volonté de conquête et de conservation du pouvoir ; elle exige, par conséquent, une action de contrainte ou d’illusion sur les esprits, qui sont la matière de tout pouvoir[1].
Si Julian Jaynes a raison, le genre narratif serait la structure de base de la conscience humaine. Dans son livre The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, Jaynes soutient de façon convaincante que la mémoire humaine ne fonctionne pas simplement par l’emmagasinage et l’extraction de données à la manière d’un ordinateur[2]. Ce qui se passe dans l’esprit serait plutôt la recréation imaginative des choses comme elles ont dû se passer au moment même où nous en avons fait l’expérience. Chaque fois que nous nous rappelons quelque chose, nous recréons l’événement sous forme de récit, une série d’images mentales mises en relation les unes avec les autres. Cette capacité naturelle de l’esprit humain à créer des histoires s’exerce grâce à une version vicariale du moi, un moi analogique, qui permet le rappel d’événements auxquels nous avons déjà participé. C’est ce que Jaynes appelle la narrativisation. L’alter ego, le moi narratif, permet à une personne de faire, par procuration, quelque chose qu’elle n’est pas actuellement en train de faire. Cette version vicariale du moi joue dans la conscience le rôle du protagoniste dans les récits de la vie. De sorte qu’on peut dire que la construction d’une personnalité ou l’émergence d’une identité est en quelque sorte la fiction fondatrice.
Si la conscience peut être comprise comme l’effet narratif le plus fondamental, le rapport à soi étant tributaire de la capacité à créer des récits, le rapport à tout ce qui n’est pas soi demeure tout autant tributaire de la narrativisation. La transcendance du soi n’est possible que grâce à une mise en intrigue du monde. Nous intégrons des récits entendus et en racontons à notre tour. Dans d’innombrables récits de complexités diverses, en compagnie d’une foule de personnages qui incluront toujours le moi analogique, l’être humain fictionnalise, met en intrigue ou narrativise son rapport à lui-même, à ceux qui l’entourent, au monde et, éventuellement, à Dieu. En tant qu’êtres tributaires du processus narratif, nous sommes interpellés par des histoires que nous lisons/entendons, des histoires qui sollicitent notre attention, suscitent nos sympathies ou nous incitent à participer à une action collective[3].
Parmi les récits que nous apprenons et qui servent de principe structurant de notre existence, les récits religieux et les récits politiques figurent de façon prééminente. Ils nous permettent de donner sens à notre vie, d’organiser ce qui nous arrive. Cependant, religion et politique sont deux thèmes qu’il vaut mieux éviter dans les soupers de famille, et pour cause. Intégriste ou athée, partisan de gauche ou de droite, rares sont les individus qui ne s’investissent pas complètement dans des débats sur la religion et la politique. Que l’on parle d’idéologie[4] ou d’actions concrètes, tout le monde appartient à des communautés religieuses ou politiques dont les intérêts divergent.
Dans ce qui suit, je me propose d’examiner en trois temps certains rapports pouvant exister dans les évangiles chrétiens entre narrativité, religion et politique. La première étape consiste en une analyse de l’utilisation du genre narratif par des acteurs politiques ou religieux pour convaincre leur public de la viabilité de leur vision pour l’avenir, qui sera complétée par des remarques sur la mise en récit du discours politique, avec des exemples tirés du 1er siècle et des 20e et 21e siècles. L’interprétation politique du NT a rencontré de sérieuses objections dans l’histoire de la critique biblique. Dans la section suivante, c’est l’état de cette question de recherche qui sera examiné. Enfin, à partir d’une comparaison entre le Christ et l’empereur, puis entre les pratiques fondatrices de l’ekklēsia chrétienne et de l’Empire, je tenterai une interprétation des histoires évangéliques comme contre-récits du récit dominant dans l’Empire romain.
Dans leur grande majorité, les exégètes qui s’intéressent aux pensées et aux pratiques de l’ekklēsia primitive comme expression d’une option politique réfléchie ont recours à la sociologie, à l’anthropologie, à la politologie ou à la psychologie pour (re)construire de diverses façons les mondes suggérés par ces histoires bibliques. Toutes ces disciplines seront mises à contribution dans l’explication de l’interaction dans les évangiles entre récit, croyance et organisation de la vie commune.
I. Le pouvoir des récits
Récit et politique. Pourquoi ? Outre les propositions de Jaynes, je crois qu’il y a encore d’autres facteurs qui aident à comprendre les effets persuasifs du genre récit, des facteurs qui relèvent du fonctionnement même de la conscience humaine. En analysant ces dernières années un certain nombre de textes bibliques, je me suis interrogé sur la place du récit parmi les stratégies rhétoriques employées pour convaincre le lecteur. À ma connaissance, les critiques littéraires et les exégètes qui s’intéressent à cette question spécifique ne sont pas légion. Tel n’est toutefois pas le cas de certains chercheurs en psychologie sociale et en communication qui étudient le caractère persuasif du genre narratif dans le cadre du discours public.
En effet, depuis le début du siècle, un nombre croissant d’études est consacré à la capacité persuasive du récit en communication publique. Ces adeptes des sciences sociales ne s’intéressent pas d’abord et avant tout à l’étude des mécanismes littéraires déployés dans le récit pour créer des effets esthétiques, mais plutôt à la capacité du genre narratif à convaincre le public de changer ses croyances ou d’agir, surtout lorsqu’on le compare à d’autres genres de discours public. Certains récits peuvent inciter les gens à élire un Emmanuel Macron, à acheter une bière au nom aussi suggestif que La fin du monde, à cesser de fumer, ou encore à descendre dans la rue pour protester contre l’homophobie.
Plutôt que d’enquêter sur les intentions de l’auteur, ces empiristes essaient de mesurer les effets produits par des récits spécifiques sur un public cible. Comment se fait-il qu’un récit arrive à convaincre là où le discours argumentatif laisse le public sceptique, ou pire, inerte ? Est-ce que le récit possède des caractéristiques qui manquent à d’autres genres de discours — littéraires ou oratoires — par ailleurs, impeccables du point de vue logique, alors même qu’il est livré par des orateurs respectés et qu’il fait appel aux émotions ? C’est la question que je me propose d’explorer très brièvement.
Gustave Flaubert fait la lumière sur une des caractéristiques de la grande littérature qui explique sa capacité à convaincre :
Ce qui me semble à moi le plus haut dans l’art (et le plus difficile), écrit Flaubert, ce n’est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous mettre en rut ou en fureur, mais d’agir à la façon de la nature, c’est-à-dire de faire rêver. Aussi les très belles oeuvres ont ce caractère, elles sont sereines d’aspect et incompréhensibles quant au procédé, elles sont immobiles comme des falaises, houleuses comme l’océan, pleines de frondaisons, de verdures et de murmures comme les bois, tristes comme le désert, bleues comme le ciel […][5].
Cette capacité à faire rêver, nous le verrons, nous rapproche beaucoup des intérêts des chercheurs en sciences expérimentales.
Flaubert serait peut-être d’accord avec le pragmatiste américain Stanley Fish, qui comprend le texte non pas comme un objet, mais plutôt comme un événement, un événement qui n’a lieu qu’à la condition qu’un lecteur accepte l’invitation à participer à l’acte de réécriture. Quand il s’agit d’un récit, l’événement narratif prend la forme d’une invitation à rêver. Comment décrire autrement cet acte de construction imaginative du lecteur ?
Il arrive qu’un lecteur ait l’impression d’avoir été transporté dans le monde du récit qu’il lit, de s’être tellement absorbé dans l’univers narratif qu’il perd le contact avec le monde qui existe au-delà des marges de la page. En psychologie, on parle du phénomène de la « transportation narrative », un processus mental convergent qui focalise l’attention, toutes les capacités et tous les systèmes mentaux, sur ce qui se passe dans le monde narré. En l’an 2000, Melanie C. Green et Timothy C. Brock ont publié une étude qui constitue désormais un document de référence dans le domaine. Green et Brock empruntent la métaphore du voyage à Richard Gerrig, qui s’en est servi pour décrire ce qui se passe quand on se plonge dans un scénario captivant.
Moyennant certaines actions, écrit Gerrig, une personne (« le voyageur ») est transportée par un mode de transport quelconque. S’éloignant du monde d’où il vient, le voyageur n’a plus accès à certains aspects de ce monde d’origine. Il revient dans le monde d’où il est parti, un peu changé par le voyage[6].
Les réponses de l’individu qui s’absorbe ainsi dans un univers narratif se présentent, entre autres, sous forme d’émotions suscitées, d’images mentales produites et de perte d’accès (partielle au moins) au monde réel. Sur la base des résultats provenant d’essais expérimentaux répétés avec de multiples histoires, Green et Brock identifient trois caractéristiques distinctives de la transportation narrative, un processus qui produit des effets sur les plans de l’affect, de l’imagerie et de la cognition[7].
Cette triade d’éléments rappelle la description que donne Paul Ricoeur du processus métaphorique dans son article « The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling[8] ». Les conclusions de Green et Brock permettent d’établir, je crois, une correspondance entre les activités cognitives et imaginatives du lecteur emballé par un récit, d’une part, et celles de la personne qui contemple la comparaison au coeur d’une métaphore, d’autre part. Pour produire des effets « durables », la personne qui active le processus métaphorique et celle emportée par l’expérience de la transportation narrative doivent s’impliquer à un niveau profond.
Les résultats des expériences menées par Green et Brock permettent en même temps d’affirmer que les croyances associées aux thèmes mis en intrigue dans le récit sont largement tributaires de la sympathie que le lecteur ressent à l’égard des protagonistes. Plus la sympathie est grande, plus il est probable que le lecteur en arrive à modifier ses croyances. Et la sympathie dont il est ici question émerge des interactions imaginatives qui ont lieu entre lecteur et protagonistes pendant la lecture.
Il est intéressant de noter que ces effets peuvent se produire, que le récit soit fictif ou factuel. Leur recherche a proposé une échelle pour mesurer l’ampleur des effets produits[9] et les résultats indiquent que les lecteurs « profondément » absorbés dans un récit ont moins tendance à entendre des notes discordantes, et qu’ils évaluent les protagonistes de façon plus favorable que des lecteurs qui sont moins transportés. Parfois, un lecteur est tellement absorbé qu’il passe de lecteur à participant, avec un intérêt personnel à voir aboutir l’action narrative de façon moralement acceptable.
Ces descriptions de la transportation narrative présentent certains des traits caractéristiques d’un autre phénomène étudié en psychologie. Je parle de l’expérience que Mihaly Csikszentmihalyi désigne sous le vocable flow. La notion de flow de Csikszentmihalyi pointe dans la direction d’une expérience, aussi éphémère soit-elle, marquée par la transcendance des limites du temps et de l’espace. Le flow est un état mental atteint par une personne complètement absorbée dans son occupation, entièrement concentrée sur ce qu’elle fait, pleinement engagée dans un processus créatif où elle perd la notion du temps et où elle a l’impression que ses habiletés sont à la hauteur du défi présenté par l’activité[10]. Csikszentmihalyi parle aussi d’être dans la zone et de vivre une expérience optimale[11]. Parmi les exemples du flow que donne le psychologue hongrois figure justement celui de se perdre dans un bon livre. Une des questions qu’il pose afin d’aider ses lecteurs à identifier des expériences du flow révèle des ressemblances remarquables entre transportation narrative et flow :
N’avez-vous jamais fait quelque chose alors que votre concentration était si intense, votre attention si exclusive et si prise par ce que vous faisiez que vous finissiez par ignorer des choses que, normalement, vous auriez remarquées (par exemple, les conversations ambiantes, des bruits forts, le passage du temps, la faim ou la fatigue, un rendez-vous, quelque inconfort physique)[12] ?
La puissance d’attraction du genre récit comme outil de persuasion serait donc attribuable en partie à sa capacité d’engager le lecteur à un niveau profond, créatif et intemporel : un coup réussi grâce à sa capacité à établir une distance entre le monde familier et le monde narré, et un lien de sympathie entre le lecteur et les protagonistes du récit. Dans la mesure où cette identification avec le héros est réussie, les chances sont bonnes pour que le lecteur soit enclin à accepter, sans grande hésitation ou circonspection, les valeurs et les croyances véhiculées par le récit.
II. Le discours politique mis en récit
Sciemment ou non, l’écrivain et le critique des récits du 1er siècle sont engagés dans une entreprise politisée. De bien des manières, les premiers chrétiens voulaient remodeler la société gréco-romaine dans laquelle ils vivaient et leur programme d’action pour cette transformation était idéologique et politique[13]. Pour leur part, la posture des critiques de cette littérature n’est pas neutre elle non plus (peu importent leurs prétentions). En m’inspirant de la tradition pragmatiste américaine, je dirais volontiers que l’exégète ou l’historien défend toujours les intérêts et les valeurs de la communauté interprétative dont il est l’agent.
Ainsi, en créant ce que Hayden White appelle une « image verbale de la réalité[14] », celui qui écrit le passé produit une sorte d’artefact littéraire qui, en plus des données vérifiables, contient des éléments fictifs. La mise en intrigue des données qu’effectue l’historien, c’est-à-dire l’ordre dans lequel il raconte les actions et les liens qu’il crée entre elles, ne relèvent pas des événements en eux-mêmes, mais plutôt de l’inventivité de cet écrivain[15]. Par exemple, un exégète qui rejette toute politisation de la religion dans son monde à lui est peu enclin à tisser des liens entre le christianisme naissant et la vie politique du 1er siècle. White écarte la possibilité d’une historiographie scientifique et objective et maintient que les écrits historiques ressemblent à bien des égards aux écrits littéraires, les deux genres ayant recours à la narration pour faire sens. L’historien emploie des stratégies narratives d’un écrivain littéraire, de la façon dont celui-ci met une histoire en intrigue. Que ce soit en raison des influences de notre communauté interprétative ou des contraintes mêmes de l’acte historiographique, il ne paraît pas possible d’offrir une interprétation objective d’une réalité aussi complexe que la posture politique du mouvement chrétien au 1er siècle.
Pourtant, au 1er siècle, religion et politique demeurent inséparables autant chez les Romains que chez les Juifs. Dans le cas d’Israël, il est clair que ses citoyens désirent ardemment rétablir une théocratie ethnique. Et même si la religion de Rome avait peu en commun avec celle pratiquée à Jérusalem, il est clair que les politiciens impériaux ne pouvaient guère passer à côté des prêtres et des augures. John Scheid décrit les rapports entre ces deux offices publics :
Les prêtres contrôlaient la légalité des consécrations publiques. Chaque collège sacerdotal avait également un domaine de compétence […] : les augures s’occupaient de la consultation des dieux, obligatoire avant chaque décision publique importante […]. Car ces actes divinatoires témoignaient de la participation des dieux, et notamment du plus politique d’entre eux, Jupiter, aux décisions publiques et de leur assentiment avec la décision prise[16].
Que dire alors du pouvoir du récit lorsqu’il est utilisé dans un contexte public et politisé ? Comment peut-on qualifier les effets politiques produits par les récits évangéliques alors qu’ils proposent un programme d’action pour la construction d’une nouvelle société ? Est-ce que ces récits bibliques font vivre au lecteur une expérience de transportation narrative marquée par le flow ? Est-ce qu’ils veulent faire sortir le lecteur de son monde pour le faire entrer dans le seul vrai monde narré par le texte[17] ? Pour comprendre les mécanismes déployés dans les textes néotestamentaires, il serait instructif de regarder l’utilisation du récit dans des contextes politiques plus près de nous.
Dans un livre sur la politique narrative, Frederick W. Mayer explore l’utilisation de récits pour faire avancer des projets d’action collective[18]. Le livre s’ouvre en évoquant le discours de Martin Luther King, prononcé en 1963 devant le Lincoln Memorial alors qu’il s’adressait à plus de 200 000 personnes. Au coeur de ce discours qui a fait époque, King parle du rêve américain, un récit qui véhicule les aspirations américaines d’être la cité sur la colline[19], la nouvelle Jérusalem[20], une République de promesses et d’espoir. Avec quatre mots, et même sans mentionner son nom, King ressuscite Abraham Lincoln d’entre les morts et lui confère le rôle de protagoniste de sa nouvelle histoire. Le « Five score years ago » (il y a cent ans) de King renvoie immanquablement au « four score and seven years ago » de Lincoln à Gettysburg. Mayer présente quelques extraits du discours de King qui permettent de mesurer les effets produits par le récit qu’il racontait à cette immense foule, le récit de l’échec du projet social et politique de Lincoln. Cet échec ne s’avère pas une tragédie seulement pour l’Afro-américain, mais pour tout Américain :
Mais, cent ans plus tard, le Noir n’est toujours pas libre. Cent ans plus tard, la vie du Noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. Cent ans plus tard, le Noir vit à l’écart sur son îlot de pauvreté au milieu d’un vaste océan de prospérité matérielle[21].
Le discours serait sans doute tombé dans l’oubli, laisse entendre Mayer, si King n’avait pas effectué un virage dramatique, un déplacement vers l’avenir et le projet qui était toujours à accomplir.
Ne croupissons pas dans la vallée du désespoir. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que, oui, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd’hui, pour demain je fais toujours ce rêve : c’est un rêve profondément ancré dans l’idéal américain. Je rêve qu’un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo : « Nous tenons pour une vérité évidente par elle-même que tous les hommes sont créés égaux »[22].
Le récit qu’il a raconté, dit Mayer, a emballé le public et entraîné une nation.
Ce ne sont pas tous les récits racontés par nos voisins du sud qui sont aussi édifiants. Les élections présidentielles de 2016 offrent un bel exemple du pouvoir persuasif de récits qui produisent des effets tout autres que l’histoire de King. Mark McKinnon, qui écrit pour The Daily Beast, un site américain de nouvelles en ligne, attribue la victoire de Donald Trump à sa capacité de raconter un bon récit, alors que Hilary Clinton a essayé de convaincre à l’aide d’arguments habilement raisonnés et bien structurés. Le récit de Trump, conclut McKinnon, est destiné à un public cible. Et la rhétorique de Trump réutilise les stratégies employées par les fascistes européens au 20e siècle[23].
-
Trump identifie une menace et une opportunité — la menace : des forces extérieures qui essaient de modifier le style de vie américain ; l’opportunité — Make America Great Again !
-
Il désigne des victimes de la menace ou de l’opportunité ratée — des ouvriers qui ont perdu leurs emplois ou qui ont connu une baisse du niveau de vie.
-
Il nomme les méchants qui constituent une menace ou qui privent les victimes d’une telle opportunité — des immigrants mexicains, la Chine, les élites de l’establishment, les musulmans.
-
Il propose des solutions — construire un mur, déchirer les accords commerciaux inéquitables, déporter les immigrants illégaux.
-
Il révèle le héros — nul autre que Trump lui-même.
Le récit de Martin Luther King et celui de Trump sont ancrés dans des visions fort différentes de la société idéale et de la distribution de la richesse. Ces récits reposent sur des histoires diamétralement opposées qui illustrent les intérêts de groupes d’électeurs différents. Je suis convaincu que, dans les récits du NT, écrits dans un autre contexte impérialiste (semblable à certains égards), nous assistons aussi à une mise en intrigue de deux grands récits qui se font concurrence. Les récits racontés par les Romains et ceux racontés par les chrétiens, deux concurrents inégaux sur le plan du pouvoir, sont informés par des valeurs différentes, des croyances différentes, des projets de société différents, des anthropologies différentes.
Pour le philosophe Éric Weil, le concept de pouvoir est au coeur de toute réflexion sur la politique[24]. « Seul le pouvoir, écrit-il, la possibilité d’un seul ou d’un groupe particulier de prendre des décisions effectives au nom de la communauté, garantit l’unité et l’indépendance de la communauté[25]. » Depuis ses débuts dans les villes de la Grèce antique, la philosophie politique cherche à élucider la structure fondamentale de la polis[26]. Plus généralement, on peut dire qu’elle cherche à comprendre la vie des êtres humains en communauté, ce qui présuppose une anthropologie philosophique et, dans le cas de notre littérature, une anthropologie théologique. Changer d’anthropologie c’est changer d’organisation sociopolitique.
Mais quel régime est le meilleur pour maintenir la paix ? Cette question est une préoccupation centrale dans la pensée politique de Platon (La République et Le Politique) et d’Aristote (Politique). Le plus célèbre disciple de Socrate place l’intérêt de la collectivité au-dessus de l’intérêt individuel, cette voie étant la seule qui permette le maintien de la paix à l’intérieur de l’État. Pour y arriver, il faut éduquer les citoyens qui ont un sens de l’honneur et contraindre à obéir ceux qui sont régis par « le plaisir des sens et les satisfactions de l’amour de soi, la richesse […][27] ». La hiérarchisation de la République va de soi, la majorité des habitants de l’État ne disposant d’aucun droit politique[28].
Dès le premier chapitre de la Politique, Aristote se préoccupe de l’exercice du pouvoir par des décideurs naturels. Et puisque ces maîtres naturels auraient de la difficulté à vivre sans des gens à dominer, Aristote décrit les relations que ceux-ci entretiennent avec leurs subalternes.
C’est la nature qui […] a créé certains êtres pour commander, et d’autres pour obéir. C’est elle qui a voulu que l’être doué de raison et de prévoyance commandât en maître ; de même encore que la nature a voulu que l’être capable par ses facultés corporelles d’exécuter des ordres, obéît en esclave […][29].
Pour Aristote, les hommes civilisés dominent les femmes et les esclaves grâce à leur intelligence supérieure. Aussi, la violence demeure un mal nécessaire, le maître devant se servir de son intelligence pour acquérir des esclaves, soit à la suite de victoires militaires soit en les chassant[30]. La violence impunément infligée aux femmes dans le monde gréco-romain est également bien documentée[31].
À partir de principes qui ressemblent beaucoup à ceux établis par Platon et Aristote, l’Empire romain se structure selon une hiérarchie pyramidale méritocratique, rigidement stratifiée, où la mobilité sociale est sévèrement restreinte. Les Romains se comprennent eux aussi comme les maîtres naturels du monde, et c’est à ce titre qu’ils jouissent des fruits du travail des esclaves et du tribut des peuples conquis. Si, dans la république imaginée par Platon, l’existence d’une armée ne se justifie qu’à des fins défensives, les Romains déclenchent des « guerres préventives » pour éliminer toute menace à la paix ! Si vis pacem, para bellum[32] est le mot d’ordre. Menées par les redoutables légions romaines, ces guerres garantissent la pax romana, une paix reconnaissable dans un premier temps par le silence qui règne sur le champ de bataille lorsque les ennemis combattants sont anéantis[33].
Pour les Anciens, le lien entre politique et violence constitue une caractéristique fondamentale de la société humaine, la menace ou le recours à la violence étant regrettablement nécessaire pour garantir la paix sociale. Dans la mesure où l’on accepte cette compréhension de la politique, il est clair que le christianisme naissant ne peut être qu’un mouvement foncièrement apolitique. Là où le réalisme grec tempère son idéalisme politique, l’ekklēsia naissante insiste sur le caractère non violent de sa koinōnia. Et c’est peut-être en partie pour cette raison que plusieurs générations d’exégètes néotestamentaires ont refusé de reconnaître dans le pacifisme chrétien un mouvement à caractère politique.
III. L’histoire du débat autour du statut politique de l’ekklēsia primitive
Les objections à une interprétation politisée des intentions des membres de l’Église primitive, telles qu’elles se laissent appréhender dans les écrits néotestamentaires, ne sont pas récentes. Selon l’idée novatrice de Hermann Samuel Reimarus, un historien allemand, l’ekklēsia primitive a abandonné les objectifs politiques de la mission de Jésus[34]. Cette intuition a inspiré le travail de plusieurs générations d’exégètes. Un siècle après Reimarus, David Friedrich Strauss distingue le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi[35]. Une trentaine d’années plus tard, Wilhelm Wrede décrit le leitmotiv du secret messianique comme la projection inconsciente de la foi postpascale sur le Jésus de l’histoire[36]. L’eschatologie conséquente d’Albert Schweitzer, qui part de la notion de dépolitisation chrétienne développée par Reimarus, considère les conceptions judéo-apocalyptiques comme un cadre d’interprétation essentiel pour comprendre la signification de Jésus[37]. Toujours préoccupé par l’annonce du Christ, Schweitzer s’interroge sur le gouffre qui sépare le monde de Jésus et le monde de son siècle. Rudolf Bultmann, qui partage l’idée de Schweitzer sur la distance entre le monde du 1er siècle et le monde du 20e siècle, reconnaît un virage important au moment où le proclamateur (le Jésus de l’histoire) devient le proclamé (le Christ de l’ekklēsia primitive)[38]. À l’instar de Schweitzer, Bultmann est convaincu que l’exégèse à elle seule ne peut franchir la distance entre la Palestine du 1er siècle et le monde moderne. Je compléterai cette liste partielle d’auteurs qui croient à la dépolitisation de la mission postpascale par un livre de Douglas Oakman paru en 2012. The Political Aims of Jesus défend une proposition très proche de celle de Reimarus[39].
À côté du projet existentialiste de Bultmann, qui a dominé l’exégèse pendant une bonne partie du 20e siècle, certaines voix discordantes en appellent à une approche politique de la mission de Jésus, et cela à partir du début des années 1960[40]. Mentionnons Jésus-Christ et la révolution non violente d’André Trocmé[41], Jesus and the Zealots de Samuel George Frederick Brandon[42], Was Jesus a revolutionist ? de Martin Hengel[43], The Politics of Jesus de John Howard Yoder[44], Jesus, Politics, and Society de Richard J. Cassidy[45]. Évidemment, il faudrait aussi mentionner le travail ultérieur de John Dominic Crossan[46] et du Jesus Seminar.
Ce sont des auteurs tels que Norman Karol Gottwald[47] et Gerd Theissen[48] qui ont préparé le terrain pour l’exégèse politique. À l’instar de Gottwald et de Theissen, une nouvelle génération d’exégètes se sert d’intuitions sociologiques et anthropologiques pour examiner les textes bibliques. Ces chercheurs analysent le contexte antique à la lumière de situations analogues modernes mieux documentées et minutieusement analysées.
Ferdinand Segovia, un théoricien postcolonial qui s’intéresse aux études bibliques, réunit quatre formes de critique biblique sous le titre plus général de critique idéologique. Chaque méthode qui relève de la critique idéologique examine à sa façon la question du pouvoir : la critique féministe met au premier plan la politique des sexes ; la critique de la libération, la question de classe ; la critique minoritaire, celle de l’ethnicité ou de la race ; et la critique postcoloniale, celle de la géopolitique[49]. Toutes ces préoccupations critiques sont présentes dans les ouvrages de l’un ou de l’autre chercheur associé à cette piste interprétative. Je m’attarderai ici à deux de ces sous-catégories de la critique idéologique : les études postcoloniales et les Empire Studies[50].
Richard A. Horsley est une figure de proue de la nouvelle orientation exégétique que Stephen Moore a qualifiée d’Empire Studies. Horsley et la plupart des auteurs regroupés sous cette bannière étudient le NT sur la toile de fond de l’Empire romain, de sa propagande, de ses institutions, de son organisation sociopolitique et économique, de son anthropologie et de ses cultes.
Pour d’autres interprètes sensibles à des questions postcoloniales, il est clair que l’homme et la femme ne portent pas attention aux textes de la même façon, le riche et le pauvre non plus. L’Africain manifeste des sensibilités interprétatives différentes de celles de l’Européen et de l’Américain. En effet, l’exégèse politique et l’exégèse postcoloniale critiquent la manière complexe dont le texte biblique a été et est encore employé pour soutenir des injustices ou, inversement, la manière dont il a été ou est encore utilisé pour imaginer une utopie viable, moteur de changement socioéconomique, politique, religieux et spirituel[51]. Ces préoccupations politiques se rapprochent de celles qui animent la théologie de la libération en Amérique du Sud (cf. la recherche de Jon Sobrino[52]) et certains travaux qui émergent de l’Afrique postcoloniale comme ceux de l’exégète féministe, Musa W. Dube Shomanah[53] ou du théologien Jean-Marc Ela[54].
Alors que les thèses développées par Gottwald dans The Tribes of Yahweh s’appuient sur des théories sociologiques, on doit reconnaître que l’exégèse postcoloniale s’inspire bien plus de la critique littéraire de la seconde moitié du 20e siècle. Les principaux promoteurs de ce mouvement étaient des exégètes avec un profond intérêt pour la critique des littératures modernes, pour la théorie littéraire, pour la théorie critique et pour la théorie culturelle. La perspective postcoloniale émerge des pays de l’ancien Empire britannique. Au moment où les anciennes colonies accèdent à l’indépendance dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, des écrivains autochtones s’engagent dans une quête identitaire qui cherche à repenser leur propre histoire et à déconstruire les modèles culturels hérités du pouvoir colonial. Ces critiques littéraires réaffirment la dignité des peuples infériorisés par les impérialismes de tout acabit, depuis les idéologies explicites du paternalisme culturel du 19e siècle, jusqu’à l’eurocentrisme de la France et de l’Empire britannique de la première moitié du 20e siècle[55]. C’est le récit, et plus particulièrement le roman, qui est devenu le véhicule préféré pour porter le message postcolonial.
L’influence de la géopolitique sur la réception actuelle de la Bible trouve écho aussi dans la recherche des auteurs des Empire Studies. Dans Paul and Empire, Religion and Power in Roman Imperial Society, Richard A. Horsley regroupe des articles et des chapitres de livres publiés par des exégètes et des historiens. On y trouve des spécialistes de la fin de la République romaine et de la période du principat comme Peter A. Brunt, Simon R.F. Price, Peter Garnsay et Richard Saller, et des exégètes chevronnés tels que Helmut Koester[56], Dieter Georgi[57], Neil Elliott[58], Elisabeth Schüssler Fiorenza[59], Karl P. Donfried et John K. Chow. Horsley collige les résultats de ces recherches dans le but d’illustrer la manière dont Paul utilise dans ses lettres un vocabulaire et des concepts politiques qu’il tire de la propagande romaine et des institutions impériales. Si l’on peut qualifier l’utilisation de ces emprunts de subversive, le but du nouveau regroupement théopolitique n’est pas de renverser l’Empire, mais de vivre en son sein comme si le nouvel âge annoncé par le Christ était déjà arrivé, le but ultime étant la conversion de l’Empire. Quand on lit les lettres de Paul comme des textes composés à l’ombre de l’Empire, on y trouve d’immanquables critiques des valeurs et des pratiques impériales. Le mouvement dont on voit les traces dans les lettres pauliniennes et dans les évangiles se veut résolument pacifiste, égalitaire, inclusif et multiethnique. Même si certains historiens peuvent penser que le mouvement n’était pas à la hauteur de ses ambitions, il est quand même tout sauf apolitique. Son message et la vie commune qu’il inspire commencent par modifier la compréhension que les classes opprimées ont d’elles-mêmes et de leurs oppresseurs ; c’est-à-dire qu’il formule une nouvelle anthropologie théopolitique. Aux contributeurs à l’ouvrage collectif dirigé par Horsley, il faut ajouter les noms de Philip F. Esler[60], Bengt Holmberg[61], Stephen D. Moore[62], Nicholas T. Wright[63] et Brigitte Kahl[64], pour ne mentionner que quelques autres figures de proue.
Revolt of the Scribes. Resistance and Apocalyptic Origins est un deuxième livre de Horsley qui mérite d’être signalé dans ce contexte. Cet ouvrage est particulièrement pertinent pour notre analyse étant donné qu’il joint « intérêt politique » et « méthode littéraire ». Dans les intrigues de textes apocalyptiques de la fin de la période du Second Temple, Horsley décode des références à l’oppression impériale et à la résistance à cette violence jusqu’au martyre[65]. « [I]l est sûrement significatif, écrit-il, qu’aucun texte de la période du Second Temple classifié comme “apocalyptique” n’ait survécu qui ne mette au premier plan le règne impérial et la résistance à ce règne[66]. » Il faut encourager, dit-il, l’analyse des structures politico-religieuses et économiques de la société judéenne si l’on veut mieux comprendre la littérature qu’elle a produite[67]. Un texte, insiste-t-il, n’est écrit ni par un peuple, ni par une collectivité quelconque, mais par un individu qui joue un rôle social et qui a des intérêts personnels[68]. Plutôt que de regarder ces textes à partir des thèmes que l’on associe normalement au genre apocalyptique, Horsley se propose d’en faire une analyse littéraire élémentaire et étudie l’intrigue principale, la source du conflit, les personnages principaux, les préoccupations fondamentales de l’histoire et le message global qu’on y transmet[69]. De concert avec les critiques postcoloniaux, il s’intéresse et aux aspects littéraires et aux aspects politiques et économiques de la littérature biblique qu’il étudie. Ces deux formes de critique idéologique (Empire Studies et les études postcoloniales) partent d’un même souci pour les conditions matérielles de la vie des gens du milieu d’où émerge le texte, celles des personnages mis en intrigue dans les fictions bibliques et celles des lecteurs et des lectrices.
Cette tendance critique qui consiste à replacer les textes néotestamentaires à l’intérieur du contexte politique de l’époque, celui de l’Empire romain, provoque une opposition musclée de la part des commentateurs évangéliques et conservateurs. Seyoon Kim, professeur au Fuller Theological Seminary, une Faculté évangélique américaine, présente ce qu’il considère comme trois faiblesses de la méthode. 1) Kim dénonce, entre autres, ce qu’il appelle la parallélomanie : il accuse les critiques d’Empire de fonder leur théorie sur quelques parallèles entre textes néotestamentaires et propagande romaine[70]. Dans cette veine, Kim cite Christopher Bryan qui soutient que malgré l’utilisation d’une terminologie identique, les écrivains du NT et les propagandistes impériaux n’ont pas écrit dans le même contexte[71]. 2) Plusieurs opposants aux Empire Studies soutiennent encore que la raison d’être des textes néotestamentaires est purement théologique. Selon eux, ces textes viseraient la transformation personnelle plutôt qu’une transformation collective ou politique. 3) Enfin, certains de ces commentateurs prétendent que les critiques d’Empire surimposent leurs propres préjugés sur le Nouveau Testament, des textes qui se situent en dehors de toute préoccupation politique. Bref, l’opposition aux Empire Studies vient principalement des critiques conservateurs évangéliques et fait partie d’une vision exégétique qui rejette l’idée que les écrits néotestamentaires aient une intention politique et recherchent une transformation sociale et collective.
IV. Le récit impérial et le contre-récit chrétien
La critique postcoloniale et les Empire Studies découvrent dans les textes du NT une forme de résistance implicite aux structures et aux valeurs des régimes impériaux et, plus rarement, une possible collusion avec l’oppressif régime romain[72]. En études néotestamentaires, par exemple, lorsque l’on compare la mission de Jésus et celle de l’ekklēsia primitive avec les normes politique, religieuse, sociale, économique, ethnique et sexuelle de l’Empire, on constate les multiples façons dont les chrétiens entrent en conflit avec ces valeurs. Les premiers chrétiens se considèrent comme membres d’une ekklēsia, c’est-à-dire d’une assemblée politique[73], d’une cité céleste (Ap 21,2), d’un politeuma de citoyens (Ph 3,20) avec un roi (messie) héritier du trône davidique et supérieur à l’empereur (Mt 16,16). Leur style de vie, basé sur de nouveaux principes sociaux et économiques, ne fait de place ni à la réciprocité ni au clientélisme romain, si nécessaires au fonctionnement de l’Empire[74]. Ce n’est qu’après quelques décennies que les autorités de l’État finissent par comprendre que la promotion d’un certain style de vie au sein de cette secte représente une menace aussi grande à la survie de l’Empire que les attaques militaires d’ennemis externes ; un style de vie où les pyramides méritocratiques sont aplaties (du moins sur le plan politique), où forts et faibles, maîtres et esclaves, hommes et femmes, citoyens et étrangers vivent tous sur un pied d’égalité dans l’assemblée délibérante (l’ekklēsia) des fidèles.
Il y a de nombreux exemples de vocabulaire, de pratiques et de concepts que les chrétiens ont empruntés au culte impérial romain et qui permettent d’établir l’opposition de ce mouvement théopolitique au régime au pouvoir. À titre d’exemple, on peut parler de 1 Th 4,13-18 où Paul parle d’un seigneur qui arrive sur les nuées dans une cérémonie calquée sur l’arrivée de César dans une ville impériale[75]. Les termes techniques employés, apantēsis et parousia, ne laissent aucun doute. Ce vocabulaire et cette mise en scène évoquaient la visite de l’empereur lui-même. Le terme kurios (seigneur) dans ce contexte est celui qui était employé pour désigner l’empereur dans l’espace de la mission de Paul. Et ce n’est pas un accident si Paul choisit « seigneur » plutôt que Christ ou Jésus dans ce contexte. Dans 1 Th, Jésus est appelé fils de Dieu (cf. 1 Th 1,10), un statut que l’on associe aussi à César Auguste qui, à la suite de l’apothéose de son père adoptif, devient par le fait même le fils d’un dieu. Quelques versets plus tard, en 1 Th 5,1-4, le texte met le lecteur en garde contre les promesses vides du principat. Le slogan augustéen, eirēnē kai asphaleia, paix et sécurité, est présenté sous un jour fort ironique en 1 Th 5,4-7. À la différence des défenseurs de l’Empire qui invoquent le slogan, les destinataires de Paul ne sont pas créatures des ténèbres. Ils ne sont pas ivres, endormis comme eux, mais vigilants et sobres. Le conflit entre ces deux visions ne pouvait pas être plus clair.
Il y a bien d’autres termes, concepts et pratiques tirés de la propagande impériale auxquels les chrétiens donnent de nouvelles significations. Cette liste inclut entre autres termes et expressions foi (pistis), justice (dikaiosunē), paix (eirēnē), salut (sōtēria), sauveur (sōtēr), patronage (euergesia), bonnes nouvelles (euaggelia)[76]. Même si ces mots sont assez communs à l’époque, la recherche qui les associe spécifiquement à la propagande romaine est approfondie et convaincante. Ces emprunts sont utilisés de manière subversive et appliquent au Christ et à la foi chrétienne des attributs et des accomplissements normalement réservés à l’empereur et à l’Empire.
Il y a d’autres indications d’un récit globalisant chez les chrétiens qui serait en compétition avec le récit globalisant porté par la propagande romaine. Les valeurs de Rome se transmettent sous diverses formes : des lois, des us et coutumes, des inscriptions, certains documents de propagande, la poésie des bardes, la rhétorique des hommes d’État, l’architecture et l’art impériaux. Le clivage entre récit et contre-récit deviendra évident lorsque l’on compare la construction imaginaire du monde selon leurs littératures respectives.
Rome et les sociétés qu’elle domine se structurent selon des principes timocratiques. Bien plus que la richesse économique, les dirigeants de ces sociétés cherchent la gloire, la gloire personnelle et la gloire de Rome elle-même. Celui qui cherchait la gloire pouvait l’acheter avec des actes de largesse : travaux publics, patronage d’une ville, distribution de nourriture, parrainage de compétitions sportives et de jeux gladiatoriaux, etc. Ce système de patronage structure la vie entière de l’Empire de sorte que l’évergétisme était essentiel pour n’importe qui voulant monter dans l’échelle sociale de même que pour le maintien de la paix sociale. Le principe de la réciprocité était à la base des rapports patron-client, le patron pouvant attendre de son client qu’il rembourse, au moins symboliquement, le don reçu[77]. Dans le cas des villes, il est possible que le patron brigue l’élection à un poste municipal important. Dans le cas des individus, il pouvait s’attendre à ce que le client loue sa magnanimité sur la place publique de façon à accroître sa réputation et de multiplier les honneurs auxquelles il avait droit. En Luc 22,24-27, Jésus interdit explicitement à ses disciples la participation à ce système d’évergétisme. De même, en Lc 14,12-14, Jésus rejette le principe de réciprocité qui sous-tend la pratique du patronage. Il incite plutôt son hôte à inviter des gens qui n’ont rien à lui rendre : les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Au verset 11 de ce même chapitre, Jésus dénonce la recherche de la gloire : « […] tout homme qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé. »
Le Romain justifie l’organisation sociale et économique du monde par la volonté des dieux eux-mêmes. Brigitte Kahl décrit les liens entre bienfaisance et religion impériale, entre sacerdoce civique et évergétisme sacrificiel :
Le don et la performance des sacrifices par l’élite satisfaisaient un besoin fondamental, à savoir le maintien des bons rapports avec les dieux desquels dépendait le bien-être de la cité. […] [L]a fusion des systèmes de sacrifice et d’évergétisme dans le cadre du sacerdoce civique […] a pour effet non seulement de dissimuler la hiérarchie et l’inégalité qui sous-tendaient la société, mais aussi de les présenter comme des réalités bénéfiques, découlant de la nature et divinement ordonnées. […] Le rapport proposé par le système sacrificiel entre dieu et les êtres humains (infériorité, réciprocité entre inégaux, la bienfaisance providentielle, immuabilité) est implicitement offert comme modèle du rapport entre l’élite et le reste de la société[78].
Tout comme Aristote croit que certaines personnes sont nées avec une âme d’esclave et d’autres avec une âme de maître, Cicéron considère que les dieux eux-mêmes ont placé les paysans et les esclaves à la base de l’impériale pyramide romaine[79].
Lorsque l’on pense à la construction des figures centrales de la cité terrestre (l’empereur), et de la cité céleste (le Christ roi), on identifie facilement d’autres comparaisons révélatrices de différences entre les deux régimes et les récits qui expriment ces différences. Regardons d’abord un important récit impérial à la lumière des déclarations évangéliques et pauliniennes.
Les Res gestae (Les actes du divin Auguste) commencent par l’affirmation qu’Auguste avait soumis toute la terre à la souveraineté (imperio) du peuple romain[80]. Selon 1 Co 15,24, le Christ à son retour réduira « à rien tout principat, toute autorité, toute puissance ». Au paragraphe 34 de cette chronique, Auguste raconte comment le sénat et le peuple romain lui ont attribué par décret le titre d’Auguste, dérivé d’« augus » au sens de « plénitude de la force sacrée ». Dans le même paragraphe des Res gestae, Auguste informe son lecteur qu’il a excellé en toute auctoritas, un concept qui va bien au-delà de l’idée de l’autorité politique, incluant aussi la notion d’une autorité morale. En koinè, c’est le mot exousia qui traduit le terme auctoritas. Est-il possible qu’il faille sous-entendre une contre-prétention à l’auctoritas d’Auguste dans les paroles de la grande commission en Mt 28,18-19 : « Tout pouvoir (exousia) m’a été donné au ciel et sur la terre » ?
Price attire l’attention sur un autre texte de la propagande impériale qui offre certains parallèles avec des récits chrétiens[81]. Vers 29 avant l’ère commune, l’assemblée de la province d’Asie a décidé d’offrir une couronne à la personne qui trouverait la meilleure façon d’honorer le dieu Auguste. Dans le décret qui en résulte, on décide de faire de l’anniversaire du princeps le jour du nouvel an. En plus de la désignation de dieu (theos), on donne à César le titre de sauveur (sōtēr). De plus, on désigne le jour de sa naissance comme « le commencement des bonnes nouvelles (euaggelia) […] pour le monde ». De toutes les occurrences du mot sōtēr et des mots apparentés dans le NT, le texte qui offre le meilleur point de comparaison avec l’inscription Priène est celui de Luc 2 qui parle de la naissance d’un autre fils de dieu, d’un autre sauveur : « N’ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle (euaggelizomai, cf. euaggelia) d’une grande joie qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur (sōtēr), qui est le Christ, le Seigneur (kurios) ». Les événements tels qu’imaginés par Luc se déroulent dans le contexte d’un décret de César Auguste qui exige un recensement de toute la terre habitée (Lc 2,1). Quelle meilleure façon d’exprimer sa domination sur le monde que d’ordonner le recensement de l’oikoumenē, un inventaire qui aurait sans doute servi à préciser la base d’imposition.
Une des plus grandes expressions de l’écart entre le roi chrétien et l’empereur romain est à chercher dans les rapports de l’un et l’autre avec les classes inférieures, et plus particulièrement avec les esclaves. Les empereurs romains étaient les plus grands propriétaires d’esclaves de l’Empire[82], et le système de clientélisme faisait de César Auguste l’homme jusque-là le plus riche de l’histoire romaine[83]. Dans les termes les plus énergiques, Ph 2 renonce à la domination et à la gloire en mettant en scène un roi qui accepte la condition servile et une mort ignominieuse. Ce rejet de la quête de gloire, cette proclamation d’un roi esclave et les fréquentes déclarations de Jésus dans les évangiles concernant l’inversion des rôles sociaux (les derniers seront les premiers) contrastent vivement avec les principes structurants de l’Empire. C’est cet abaissement volontaire du roi chrétien qui mérite une sanction divine positive en Ph 2 et c’est l’humilité qui devient la marque distinctive du Christ et des chrétiens. Par contraste, Cicéron félicite Rome en disant qu’aucun autre peuple n’a jamais eu une aussi grande ambition pour la gloire (De republica 5,9).
La vie commune des premiers chrétiens est organisée selon une nouvelle anthropologie théologique[84]. Les récits évangéliques offrent une description de la mission de Jésus qui établit un nouveau rapport au pouvoir. La politique n’est pas l’équivalent de la militaro-politique qui sous-entend la pensée de Platon, d’Aristote, de Cicéron. Plutôt que de vouloir dominer les autres, cette nouvelle vision invite les puissants à prioriser les intérêts des faibles, à considérer les autres comme supérieurs à eux (Ph 2). Cette nouvelle Voie est celle de l’empowerment, c’est-à-dire de l’autonomisation et de l’émancipation des classes opprimées et des exclus. On invite les dirigeants de la nouvelle ekklēsia à ne plus privilégier les intérêts des puissants, des gens de bonne famille et des instruits (cf. 1 Co 1,26-67 ; Lc 14,7-14), c’est-à-dire de ne plus privilégier leurs propres intérêts. Cette vision pacifiste mais révolutionnaire s’oppose à l’impérialisme romain et, de son propre aveu, refuse toute manifestation de violence physique, sexuelle, verbale ou morale. Un recours à la violence reviendrait à remplacer un empire par un autre. Limiter le concept de « politique » à la militaro-politique impérialiste serait rendre invisibles les expressions claires d’une nouvelle proposition pour structurer la vie de la koinōnia. Cette nouvelle anthropologie comporte une vision de l’être humain qui n’est plus basée sur les attributs de l’individu, mais plutôt sur leur statut comme enfants de Dieu (Ga 3,26 ; Jn 1,12).
Dans les recherches sur la première politique chrétienne, de nombreux exégètes politisés ont recours à la recherche de l’anthropologue James C. Scott, un spécialiste de la vie politique de groupes paysans[85]. À partir d’une étude approfondie des rapports de classes qu’il a effectuée dans un village de Malaisie, Scott a trouvé des formes de domination structurellement similaires aux systèmes d’esclavage, de féodalité, de colonisation et de castes[86]. Son analyse des religiosités populaires illustre le rôle important joué par les récits d’utopies messianiques et de mouvements millénaristes, où les dominés peuvent néanmoins imaginer un renversement de la hiérarchie, voire une absence totale de hiérarchie (cf. Mt 20,16). Scott ajoute donc à son étude de terrain une analyse de la mise en récit de cet espoir des personnes opprimées dans les oeuvres de fiction anglaises.
La référence au discours subalterne qui figure dans le sous-titre de la version française du livre de Scott fait allusion à l’article « Can the Subaltern Speak ? » de Gayatri Chakravorty Spivak. Dans un texte qui a fait époque, celle-ci présente en effet une perspective postcoloniale de la critique littéraire occidentale et s’engage dans une lutte pour faire entendre la voix des victimes d’oppression de l’impérialisme européen[87]. Le subalterne ne peut pas être entendu, car il y a toujours d’autres personnes qui parlent à sa place — des universitaires, des chefs religieux ou d’autres personnes puissantes dans le monde[88].
Scott prétend que, dans les histoires composées avec une sensibilité de subalternes conscients que ces histoires sont également entendues par les classes dominantes, deux niveaux de discours se chevauchent. Le « texte caché » du récit présente un message audible ou visible seulement par les victimes de la violence sociale, raciale, religieuse, économique, sexuelle, culturelle ou linguistique, alors que la classe dirigeante peut lire dans le « texte public » un message qui confirme leurs propres préjugés et leurs croyances hégémoniques. Il me semble que les récits évangéliques fonctionnent eux aussi sur ce double plan. Ailleurs dans le NT, la lettre de Jacques et les lettres de Paul ne sont adressées qu’aux membres de la secte de la Voie, et l’Apocalypse de Jean s’exprime dans un langage tellement chiffré que les gens d’en dehors risquent de n’y rien comprendre du tout. Selon cette théorie, les évangiles veulent ouvrir un espace où les subalternes peuvent s’exprimer et partager leurs idées entre eux avec des signes cachés. Plusieurs récits évangéliques sont écrits à partir du point de vue du pauvre, de l’esclave, du malade, de la femme. Cependant, les hommes riches et puissants passent aveuglément à côté du texte caché.
Que les récits chrétiens aient refaçonné le visage de l’Occident n’est pas à discuter. Il y a fort à parier que les gens infortunés qui écoutaient[89] ces histoires bibliques au 1er siècle ont été transportés par ces « fictions » qui mettaient en scène des figures qui leur ressemblaient en toutes lettres. La solidarité d’un roi esclave aurait étonné n’importe quelle personne asservie. Et il faut croire que certaines de ces personnes conscientisées aient pu vivre une expérience fondatrice qui les a accompagnées jusqu’au martyre.
Conclusion
Pendant des décennies, les exégètes les plus réputés ont prétendu que l’ekklēsia primitive avait abandonné le programme politique de Jésus de Nazareth. De nos jours, une nouvelle génération de critiques conteste cette conclusion, et pour cause. Dans leur grande majorité, les chercheurs en critique idéologique — les critiques féministes, les critiques de la libération, les critiques postcoloniaux et leurs collègues en Empire Studies — insistent pour dire que les récits et les discours post-pascaux renferment un programme politique[90]. Et malgré les hésitations que certains chercheurs peuvent émettre concernant la réussite ou la direction de ce programme, il est évident que cette vision est assez cohérente pour attirer de nouveaux membres à une vitesse surprenante. Parmi ces nouveaux adhérents, les paysans exploités, les femmes méprisées, les esclaves, les étrangers résidents, les membres de l’élite avec un statut mitigé[91] occupent une position prépondérante. Si la théorie de Jaynes tient la route, il est inévitable que ces gens narrativisent l’expérience de conscientisation où ils ont découvert une nouvelle identité exprimée en termes de paternité divine et de citoyenneté dans une cité céleste. Cette expérience contraste vivement avec la philosophie gréco-romaine qui explique que le statut infériorisé de ces catégories de personnes correspond à leur âme et à la volonté des dieux.
Le salut que l’ekklēsia chrétien offre à ces membres est bien plus qu’un message spiritualisant qui remet à la vie dans l’au-delà l’espoir de trouver tout ce qui manque à la vie présente. Selon l’idéologie (théologie) de cette nouvelle assemblée, chaque membre de la koinōnia a la même valeur ultime, peu importent ses habilités, peu importe son statut dans la société gréco-romaine, son sexe ou son ethnicité. Dans les récits que l’on raconte sur le chef suprême de la secte, celui-ci a assumé la condition d’esclave, il a accueilli des femmes dans son entourage, il a loué les actions d’étrangers, il a parlé souvent de l’injustice faite aux paysans et il a été présent aux gens sans espoir.
Au moment où la génération des premiers disciples de Jésus commence à mourir, il devient urgent de composer des récits qui essaient de recréer l’expérience d’avoir été trouvé et accueilli. Le défi était grand. Est-il possible de raconter un récit qui a le pouvoir de transformer l’autocompréhension du lecteur et de la lectrice ? Un récit qui transporte le lecteur/auditeur et lui fait vivre une expérience du flow ? Il n’est sans doute pas le fruit du hasard que les récits néotestamentaires mettent souvent en intrigue des personnages qui ressemblent aux lecteurs/auditeurs infériorisés du monde où ces histoires sont lues. Sous le signe de l’espoir pour l’avenir, le récit chrétien engage son lecteur et sa lectrice dans un projet de libération hic et nunc.
Cependant, le simple fait d’écouter un récit n’explique pas les effets produits par les histoires de salut qu’il raconte. Pour que ces textes aient la possibilité de transformer la vie, il faut qu’ils soient lus au coeur d’une assemblée qui actualise la nouvelle anthropologie et qui rejette l’infériorisation essentielle à la hiérarchisation concurrentielle de l’Empire (cf. 1 Co 11,17-34). Le récit ne peut être transformateur qu’à la condition que l’ekklēsia donne une voix à ceux qui n’ont pas de droits dans l’Empire[92]. Sans un changement dans le rapport au pouvoir au sein de la communauté, ces récits seraient demeurés lettre morte. Pour cette première génération, les récits évangéliques proclamés dans le contexte des agapes permettent le discernement d’un nouveau « corps » théopolitique.
Cette révolution religieuse, socioéconomique et pacifiste commence par des changements politiques ad intra. La création d’un macro-récit à partir des logia, des paraboles et des actions provocatrices du messie, fournit à ce groupe un outil puissant qu’il utilise dans son opposition contre les abus du pouvoir ad extra.
Dans le meilleur des cas, le récit lu dans l’assemblée délibérante doit produire des effets similaires au discours prononcé par Martin Luther King devant le Lincoln Memorial. Le récit doit faire rêver à la manière décrite par Flaubert. Mais, avant tout, le récit doit faire agir, c’est-à-dire engager les auditeurs/lecteurs dans une action collective.
On peut imaginer l’expérience de « salut » vécu par l’esclave, le paysan indigent, la femme méprisée ou rejetée, l’étranger résident qui est reçu dans l’ekklēsia. Il s’agit avant tout pour ces gens de la découverte de leur propre valeur. Mais, on y trouve bien plus. Les premiers chapitres des Actes des apôtres décrivent une communauté où les injustices économiques ont été corrigées. La question de la réforme de l’économie paysanne qui se lit dans plusieurs des paraboles de Jésus incluses dans les écritures de la génération postpascale, souligne encore la fidélité de la première génération postpascale de chrétiens au projet de justice du prophète Jésus[93].
Religion et politique sont inéluctablement liées dans les écritures chrétiennes de la première génération postpascale. Dans un récit de salut globalisant, les chrétiens incorporent, de manière subversive et parfois ironique, de multiples symboles et pratiques tirés de la propagande romaine. Choisis avec soin, ces emprunts sont incorporés dans des contre-récits qui ont pour objectif de saper les fondements mêmes des pratiques impérialistes et ceux de l’anthropologie hiérarchique sur laquelle elles sont basées.
Appendices
Notes
-
[1]
Paul Valéry, « La liberté de l’esprit », dans Regards sur le monde actuel et autres essais, Paris, BoD, 2018, p. 173.
-
[2]
Julian Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, London, New York, Penguin, 1993.
-
[3]
Frederick W. Mayer, Narrative Politics. Stories and Collective Action, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 7.
-
[4]
Sur la question de l’idéologie, j’opte pour une acception neutre, c’est-à-dire une posture à partir de laquelle l’on interprète ce qui est et imagine ce qui est souhaitable sur le plan social et politique. Plutôt qu’employer le terme idéologie pour dénoncer la pensée politique de l’autre, je m’en sers pour désigner le véhicule qui porte la conscience authentique de la classe dont il porte les intérêts. Voir Joseph Gabel, « Idéologie », Encyclopaedia Universalis [en ligne], consulté le 20 février 2019 : http://www.universalis-edu.com.acces.bibl.ulaval.ca/encyclopedie/ideologie/.
-
[5]
Gustave Flaubert, Pensées de Gustave Flaubert, Paris, Conard, 1915, p. 42.
-
[6]
Richard J. Gerrig, Experiencing Narrative Worlds, New Haven, Yale University Press, 1993, p. 10-11 (nous traduisons).
-
[7]
Melanie C. Green, Timothy C. Brock, « The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives », Journal of Personality and Social Psychology, 79, 5 (2000), p. 718.
-
[8]
Paul Ricoeur, « The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling », Critical Inquiry, 5, 1 (Autumn 1978), Special Issue on Metaphor, p. 143-159.
-
[9]
M.C. Green, T.C. Brock, « The Role of Transportation », p. 701.
-
[10]
Voir Mihaly Csikszentmihalyi, Beyond Boredom and Anxiety, San Francisco, Jossey-Bass, 1975, p. 35-36.
-
[11]
Voir Id., Isabella S. Csikszentmihalyi, dir., Optimal Experience. Psychological Studies of Flow in Consciousness, New York, Cambridge University Press, 1988, p. 3 et passim.
-
[12]
Mihaly Csikszentmihalyi, Kevin Rathunde, Samuel Whalen, Talented Teenagers. The Roots of Success and Failure, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 275 (nous traduisons).
-
[13]
Voir, entre autres, Helmut Koester, Paul and His World. Interpreting the New Testament in Its Context, Minneapolis, Fortress Press, 2007 ; Richard A. Horsley, dir., Paul and Empire. Religion and Power in Roman Imperial Society, Harrisburg, Trinity International Press, 1997.
-
[14]
Hayden White, L’histoire s’écrit. Essais, recensions, interviews, textes traduits et présentés par Philippe Carrard, Paris, Éditions de la Sorbonne (coll. « Libres cours »), 2017, p. 64.
-
[15]
Voir Id., « The Historical Text as Literary Artifact », dans Hazard Adams, Leroy Searle, dir., Critical Theory Since 1965, Tallahassee, University of Florida Press, 1986, p. 396.
-
[16]
John Scheid, « Politique et religion dans la Rome antique. Quelle place pour la liberté de culte dans une religion d’État ? », La vie des idées (28 juin 2011), consulté le 1er mars 2019, http://www.laviedesidees.fr/Politique-et-religion-dans-la-Rome.html.
-
[17]
Voir Hans W. Frei, « Introduction », dans The Eclipse of Biblical Narrative. A Study of Eighteenth and Nineteenth Century Hermeneutics, New Haven, Yale University Press, 1974, p. 1-16.
-
[18]
Voir Frederick W. Mayer, Narrative Politics, p. 1.
-
[19]
En 1630, John Winthrop employait cette image tirée de Mt 5,14 pour parler des intentions des premiers colons américains. Voir « A Modell of Christian Charity » (1630), dans Collections of the Massachusetts Historical Society (Boston, 1838), 3rd Series, Vol. 7, p. 31-48, https://history.hanover.edu/texts/winthmod.html.
-
[20]
Voir Ryan S. Gardner, A History of the Concepts of Zion and New Jerusalem in America From Early Colonialism to 1835 with a Comparison to the Teachings of the Prophet Joseph Smith, Thesis, Brigham Young University, 2002. Consulté le 20 février 2019, https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5705&context=etd.
-
[21]
Martin Luther King, « I have a dream », trad. fr., consulté le 23 février 2019, http://lesgrandsdiscours.arte.tv/fr/i-have-a-dream-martin-luther-king.
-
[22]
Ibid.
-
[23]
Voir, entre autres, Geoff Eley, « Is Trump a Fascist ? », Historians for Peace & Democracy, Broadsides for the Trump Era, Issue 5, consulté le 1er mars 2019, https://www.historiansforpeace.org/wp-content/uploads/2018/02/Eley-Fascism-1.pdf.
-
[24]
Éric Weil, « Politique. La philosophie politique », Encyclopaedia Universalis, consulté le http://www.universalis-edu.com.acces.bibl.ulaval.ca/encyclopedie/politique-la-philosophie-politique/.
-
[25]
Ibid.
-
[26]
Weil retrace les origines de cette branche de la philosophie à un moment dans l’histoire de la cité grecque où aucune des unités politiques n’était assez puissante pour soumettre les autres et où, par conséquent, elles ont dû débattre la question de la meilleure forme de gouvernement (voir ibid.).
-
[27]
Ibid.
-
[28]
Par exemple, les femmes, les gens qui manient l’argent, les commerçants et les paysans, les étrangers (metoikoi), les homosexuels passifs (pathikoi) et les esclaves, sont exclus de la vie politique.
-
[29]
Aristote, Politique, Livre I, Chapitre I, § 4.
-
[30]
Voir ibid., Chapitre II, § 23.
-
[31]
Voir Werner Riess, « Introduction », dans Id., Garret G. Fagan, dir., The Topography of Violence in the Greco-Roman World, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2016.
-
[32]
« Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre ».
-
[33]
Voir P.A. Brunt, « Laus imperii », dans R.A. Horsley, dir., Paul and Empire, p. 29. Brunt cite Virgile qui définit la mission de Rome en ces termes : parcere subiectis et deballare superbos, « épargner les faibles, abattre les superbes » (Énéide, VI, 853). En réalité, dit Brunt, un général tel Germanicus pouvait se vanter d’avoir écrasé les Germains et d’avoir exterminé une communauté entière sans égard à l’âge ou au sexe des victimes (Tacite, Annales, 2,21 sq.).
-
[34]
Hermann Samuel Reimarus, Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger. Noch ein Fragment des Wolfenbüttelschen Ungenannten, Braunschweig, sans éd., 1778. Publication posthume.
-
[35]
David Friedrich Strauss, Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte. Eine Kritik der Schleiermacher’schen Lebens Jesu (1865), éd. Hans-Jürgen Geischer, Gütersloh, G. Mohn, 1971.
-
[36]
Wilhelm Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1901.
-
[37]
Albert Schweitzer, Von Reimarus zu Wrede. Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Tübingen, Mohr Siebeck, 1906.
-
[38]
Rudolf Bultmann, Jesus and the Word, London, Fontana, 1958, p. 14.
-
[39]
Douglas E. Oakman, The Political Aims of Jesus, Minneapolis, Fortress Press, 2012, p. 4 : « […] aux yeux de ses contemporains palestiniens, les intérêts et les activités historiques de Jésus étaient essentiellement politiques. Après sa mort, ceux qui sont restés fidèles à la mémoire de Jésus ont commencé à le placer au centre d’un nouveau culte religieux gréco-romain, d’abord dans l’espace syro-palestinien et ensuite dans les villes romaines orientales » (nous traduisons).
-
[40]
Voir David Hawkin, « Albert Schweitzer and the Interpretation of the New Testament », Churchman, 125, 4 (Winter 2011), p. 297-314, ici p. 302.
-
[41]
André Trocmé, Jésus-Christ et la révolution non violente, Genève, Labor et Fides, 1961.
-
[42]
Samuel George Frederick Brandon, Jesus and the Zealots. A Study of the Political Factor in Primitive Christianity, New York, Charles Scribner’s Sons, 1967.
-
[43]
Martin Hengel, Was Jesus a Revolutionist ?, Minneapolis, Fortress Press, 1971.
-
[44]
John Howard Yoder, The Politics of Jesus, Grand Rapids, Eerdmans, 1972.
-
[45]
Richard J. Cassidy, Jesus, Politics, and Society. A Study of Luke’s Gospel, Eugene, Wipf and Stock, 1978.
-
[46]
John Dominic Crossan, God and Empire. Jesus Against Rome, Then and Now, San Francisco, HarperSanFrancisco, 2007 ; Id., Jesus. A Revolutionary Biography, San Francisco, HarperSanFrancisco, 1994 ; Robert B. Stewart, The Resurrection of Jesus. John Dominic Crossan and N.T. Wright in Dialogue, Minneapolis, Fortress Press, 2006.
-
[47]
Norman K. Gottwald, The Tribes of Yahweh. A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250-1050 b.c.e., Maryknoll, NY, Orbis, 1979.
-
[48]
Gerd Theissen, Histoire sociale du christianisme primitif. Jésus, Paul, Jean, traduit par I. Jaillet et A.-L. Fink, Genève, Labor et Fides, 1996.
-
[49]
Fernando F. Segovia, « Mapping the Postcolonial Optic in Biblical Criticism. Meaning and Scope », dans Id., Stephen D. Moore, dir., Postcolonial Biblical Criticism, Interdisciplinary Intersections, London, T&T Clark, 2005, p. 23-78, ici p. 23.
-
[50]
Dans la mesure où l’on peut distinguer les Empire Studies des études postcoloniales. Les deux approches se ressemblent énormément. Moore a inventé le nom à partir de la mention du mot « empire » dans les titres de plusieurs livres et articles consacrés à ces questions.
-
[51]
Voir Eric Thurman, « Politics », dans Andrew Keith Malcolm Adam, dir., Handbook of Postmodern Biblical Interpretation, St. Louis, Chalice Press, 2000, p. 174-181, ici p. 174.
-
[52]
Jon Sobrino, Jesus the Liberator. A Historical-Theological Reading of Jesus of Nazareth, Maryknoll, Orbis Books, 1993.
-
[53]
Musa W. Dube Shomanah, Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible, St. Louis, Chalice Press, 2000.
-
[54]
Jean-Marc Ela, Repenser la théologie africaine. Le Dieu qui libère, Paris, Karthala, 2003.
-
[55]
Pour l’émergence de cette critique dans l’espace francophone voir Jean-Pierre Durix, Jean-Louis Joubert, « Postcoloniales littératures », Encyclopaedia Universalis [en ligne], consulté le 1er mars 2019, à l’adresse : http://www.universalis-edu.com.acces.bibl.ulaval.ca/encyclopedie/litteratures-postcoloniales/.
-
[56]
Helmut Koester, Paul and His World ; Id., From Jesus to the Gospels. Interpreting the New Testament in its Context, Minneapolis, Fortress Press, 2007.
-
[57]
Dieter Georgi, Remembering the Poor. The History of Paul’s Collection for Jerusalem, Nashville, Abingdon Press, 1992.
-
[58]
Neil Elliott, The Arrogance of Nations. Reading Romans in the Shadow of Empire, Minneapolis, Fortress Press, 2008.
-
[59]
Elisabeth Schüssler Fiorenza, The Power of the Word. Scripture and the Rhetoric of Empire, Minneapolis, Fortress Press, 2007 ; Id., Jesus and the Politics of Interpretation, New York, Continuum, 2000 ; Id., In Memory of Her. A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins, New York, Crossroads, 1983.
-
[60]
Philip F. Esler, New Testament Theology. Communion and Community, Minneapolis, Fortress Press, 2005.
-
[61]
Bengt Holmberg, Paul and Power. The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles, Lund, Liber Läromedel/Gleerup, 1978.
-
[62]
Stephen D. Moore, Postcolonial Biblical Criticism. Interdisciplinary Intersections, London, New York, T&T Clark International, 2005.
-
[63]
Nicholas T. Wright, The Original Jesus. The Life and Vision of a Revolutionary, Grand Rapids, Eerdmans, 1997.
-
[64]
Brigitte Kahl, Galatians Re-Imagined. Reading with the Eyes of the Vanquished, Minneapolis, Fortress Press, 2010.
-
[65]
Voir Richard A. Horsley, Revolt of the Scribes. Resistance and Apocalyptic Origins, Minneapolis, Fortress Press, 2010, p. 3.
-
[66]
Ibid. (Nous traduisons.)
-
[67]
Voir ibid., p. 8 et passim.
-
[68]
J’ajouterais ici que les intérêts des écrivains bibliques ne sont pas seulement personnels, mais représentent aussi les intérêts de la communauté dont ils sont les agents.
-
[69]
Voir R.A. Horsley, Revolt of the Scribes, p. 7-8.
-
[70]
Voir Seyoon Kim, Christ and Caesar. The Gospel and the Roman Empire in the Writings of Paul and Luke, Grand Rapids, Eerdmans, 2008, p. 28.
-
[71]
Voir Christopher Bryan, Render to Caesar. Jesus, the Early Church and the Roman Superpower, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 90. Cependant, Bryan n’y spécifie pas ce qu’il veut dire par « contexte ». Contexte historique ? Contexte littéraire ? Contexte religieux ? Contexte politique ?
-
[72]
Voir, par exemple, Sheila Briggs, « Can an Enslaved God Liberate ? Hermeneutical Reflections on Philippians 2:6-11 », Semeia (1989), p. 137-153.
-
[73]
Voir P. Koester, Paul and His World, p. 5.
-
[74]
Voir Koenraad Verboven, « Cité et réciprocité. Le rôle des croyances culturelles dans l’économie romaine », Annales. Histoire, Sciences sociales 67, 4 (2012), p. 913-942, surtout p. 928.
-
[75]
Pour tous les exemples tirés de 1 Th, voir Karl P. Donfried, « The Imperial Cults of Thessalonica and Political Conflict in 1 Thessalonians », dans R.A. Horsley, dir., Paul and Empire, p. 215-223, ici p. 217.
-
[76]
Voir Dieter Georgi, « God Turned Upside Down », dans R.A. Horsley, dir., Paul and Empire, p. 148 et passim.
-
[77]
La réciprocité était fondamentale dans la culture romaine. « Dons et faveurs réciproques étaient attendus entre membres d’une même famille, entre amis, ou entre patrons et clients. Ils affirmaient et fortifiaient les relations sociales, permettant la consolidation de réseaux de solidarité et de confiance. L’éthique de la réciprocité reposait sur trois normes sociales qui mettaient l’honneur en jeu : la benignitas (obligeance), la gratia (reconnaissance) et la fides (loyauté, crédibilité) […]. La fides était le fondement des relations de réciprocité : elle signifiait la loyauté et la crédibilité du respect de ses obligations sociales (officia) ; elle permettait de nouer et de renforcer des relations de solidarité et de confiance entre des personnes non liées par la parenté » (K. Verboven, « Cité et réciprocité », p. 928).
-
[78]
B. Kahl, Galatians Re-Imagined, p. 197 (nous traduisons).
-
[79]
Voir P.A. Brunt, « Laus imperii », p. 29-30.
-
[80]
Res gestae divi Augusti. L’édition Loeb (1924) contient le texte latin original, la traduction grecque faite dans l’Antiquité, et la traduction anglaise faite à l’époque moderne. Consulté le 28 février, à l’adresse suivante : http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Augustus/Res_Gestae/home.html.
-
[81]
Voir Simon R.F. Price, « Rituals and Power », dans R.A. Horsley, dir., Paul and Empire, p. 47-71, ici p. 53.
-
[82]
Voir William Linn Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Philadelphia, American Philosophical Society, 1955, p. 111.
-
[83]
Voir « Introduction », dans R.A. Horsley, dir., Paul and Empire, p. 15.
-
[84]
Voir supra, n. 24, la définition de la politique chez Éric Weil.
-
[85]
James C. Scott, La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, trad. fr. Olivier Ruchet, Paris, Amsterdam, 2009.
-
[86]
Ibid., p. 11.
-
[87]
Gayatri Chakravorty Spivak, « Can the Subaltern Speak ? », dans Patrick Williams, Laura Chrisman, dir., Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A Reader, New York, Columbia University Press, 1994, p. 66-111.
-
[88]
Ibid., p. 70.
-
[89]
En règle générale, les pauvres ne pouvaient pas lire, ni dans l’Antiquité ni dans le monde.
-
[90]
En regroupant ces divers chercheurs dans une même catégorie, je ne veux pas suggérer que chacun d’eux partage les mêmes idées concernant l’inscription politique de la nouvelle secte chrétienne. Je soutiens seulement qu’ils sont unis dans la conviction que les intentions et les effets produits par les textes de l’ekklēsia primitive sont manifestement à caractère politique.
-
[91]
Voir Wayne A. Meeks, The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul, New Haven, London, Yale University Press, 1983, surtout le chapitre 1. Meeks fait valoir que certaines personnes, par exemple les femmes riches ou les hommes libres qui avaient des esclaves dans leur arbre généalogique, avaient un statut social mitigé qui aurait pu les rendre plus sensibles au lot des classes inférieures. Dans ces conditions, il se peut que ces personnes aient été attirées par les valeurs prônées par la nouvelle secte.
-
[92]
Il est clair, comme Gerd Theissen l’a montré dans Histoire sociale du christianisme primitif, que les textes néotestamentaires sont destinés d’abord à l’élite des communautés qui les ont utilisés comme écritures saintes. Cela dit, ces textes incitent l’élite à changer de perspective, à voir le monde depuis le lieu d’inscription des plus vulnérables, des plus faibles. Et la façon d’y arriver était de raconter des récits qui faisaient découvrir à ces personnes qui exerçaient du pouvoir dans la communauté l’importance d’un comportement correct et d’une attitude humble.
-
[93]
Voir John Dominic Crossan, The Birth of Christianity. Discovering What Happened in the Years Immediately After the Execution of Jesus, San Francisco, HarperSanFrancisco, 1998.