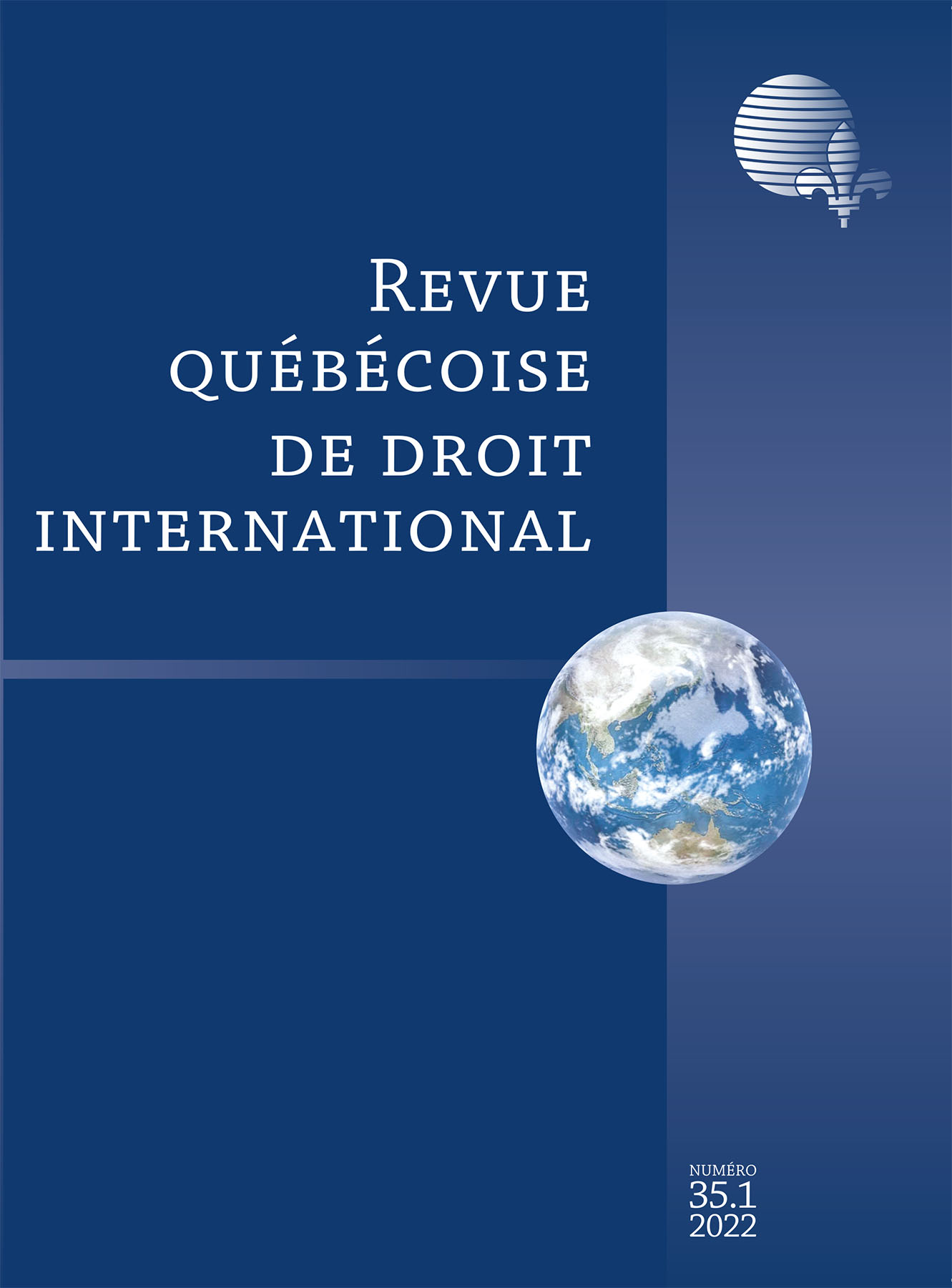Article body
Loin de se limiter à des réductions tarifaires et des concessions sectorielles, la politique commerciale s’investit désormais dans tous les domaines de la société[1]. Instituée comme vecteur de la croissance et du développement, l’insertion au commerce international se double d’un passage quasi obligé vers un modèle étatique néolibéral soumis à une logique de concurrence[2]. Les répercussions sociales de la mondialisation inquiètent, comme en témoignent les contestations multiples[3] et débats animés sur la question.
Arrimer ouverture commerciale et progrès social[4], c’est donc ce que les codirecteurs de Vers une politique commerciale socialement responsable dans un contexte de tensions commerciales — Sylvain Zini (économiste et politologue de formation, chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université de Montréal et l’Université du Québec en Outaouais), Éric Boulanger (directeur adjoint du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), codirecteur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est et chargé de cours à l’UQAM) et Michèle Rioux (directrice du CEIM et professeure titulaire au Département de science politique de l’UQAM) — ont voulu explorer.
Publié en 2021, l’ouvrage fait état des activités organisées entre 2017 et 2019 par le CEIM sur le thème « Vers une politique commerciale socialement responsable : un défi pour le Canada et ses partenaires commerciaux ». Ces activités comprennent notamment des consultations publiques pancanadiennes et ont été réalisées dans le cadre du projet Gouvernance globale du travail[5].
La démarche des codirecteurs de l’ouvrage s’inscrit dans un triple objectif : informer le public sur la dimension sociale des activités économiques mondiales, animer une discussion pancanadienne sur les moyens de mise en oeuvre d’une politique socialement responsable et produire des recommandations à l’intention du gouvernement canadien[6].
L’ouvrage est divisé en trois parties, articulées autour des questions suivantes : 1) Qu’est-ce qu’une politique commerciale socialement responsable ? 2) À qui incombe la responsabilité d’une mondialisation plus juste ? Et 3) Quels sont les dysfonctionnements de la politique commerciale actuelle et quelles modalités permettraient de les résoudre[7] ? Les chapitres sont rédigés par des experts issus de milieux différents et oeuvrant à travers le Canada : économistes, politologues, juristes, chercheurs universitaires, représentants syndicaux, etc.
La première partie présente les thèmes abordés lors des consultations pancanadiennes, qui sont par le fait même les « outils » ou instruments identifiés par les directeurs de l’ouvrage comme susceptibles d’entériner une politique commerciale socialement responsable. Le premier chapitre, rédigé par Heysee Verdal[8], porte sur les accords commerciaux ; le deuxième, rédigé par Maud Boisnard[9], se penche sur les systèmes généralisés des préférences (SPG) ; et le troisième chapitre, présenté par Hugues Brisson[10], discute du bannissement de produits issus du travail forcé. Pour chacun de ces instruments, les auteurs expliquent leurs possibles mobilisations, commentent la pratique des États en la matière et soulignent les arguments en faveur et en défaveur de leurs différentes utilisations.
La deuxième partie comporte trois chapitres. Le chapitre quatre, rédigé par Michèle Rioux et Sylvain Zini, est consacré à la présentation du rapport des consultations pancanadiennes qui se sont déroulées à l’été et l’automne 2017[11]. Sur la base des résultats obtenus, les auteurs formulent dix recommandations pour une politique commerciale socialement responsable. Certaines recommandations créent de nouvelles obligations pour les partenaires commerciaux du Canada, tandis que d’autres exigent une modification de la législation canadienne. Certaines appellent à la consolidation des mécanismes existants et d’autres encore à la création de nouvelles institutions[12].
Les deux autres chapitres de la deuxième partie regroupent les commentaires d’universitaires[13] (chapitre cinq) et de personnes issues du monde syndical et de la société civile (chapitre six) vis-à-vis du rapport présenté au chapitre quatre. Ces commentaires, rédigés par différents experts, se succèdent dans les deux chapitres avec peu d’ordre apparent et seront ici présentés suivant sensiblement la même base.
Pour Robert Finbow[14], les recommandations formulées dans le rapport constituent surtout une base d’exigences minimales que le Canada se doit d’atteindre pour s’engager véritablement dans une politique commerciale socialement responsable[15]. Pour Isabelle Martin, Mélanie Dufour-Poirier et Francisco Villanueva[16], la formulation actuelle de certaines recommandations est plutôt limitante : ils invitent à une plus grande élaboration et précision des termes. Les trois auteurs soulignent également le silence du rapport sur certains aspects pourtant intrinsèques au « social », par exemple l’environnement ou les droits des communautés autochtones et locales[17]. Anil Hira[18] rappelle d’ailleurs qu’une production durable exige la protection des droits des travailleurs autant que celle de l’environnement. Il relève aussi l’absence de stratégies visant l’adhésion du secteur privé aux clauses sociales, alors que l’engagement des entreprises est un facteur déterminant à la réussite des initiatives gouvernementales[19]. Kelly Pike[20] souligne à cet effet l’intérêt du modèle Better Work[21] qui engage travailleurs, entreprises et société civile dans le dialogue[22]. Les contributions de Gavin Fridell[23] et de Kristine Plouffe-Malette[24] se concentrent chacune sur un des thèmes des consultations, soit les accords commerciaux et le bannissement de produits issus du travail forcé. Fridell discute des façons de rendre les clauses sociales réellement exécutoires et déconstruit plusieurs arguments en défaveur de leur intégration dans les accords de commerce, arguments par ailleurs identifiés dans le premier chapitre[25]. Plouffe-Malette retrace les fondements et implications juridiques de l’interdiction de l’importation de produits issus du travail forcé. Elle s’interroge également sur les incidences d’une mobilisation de la clause de moralité publique sur le consommateur moyen[26]. Enfin, l’analyse de Paul Kellogg[27] appelle à des transformations systémiques du système commercial international, jugé profondément inégalitaire par essence[28].
Du côté de la société civile et du monde syndical (chapitre six), le commentaire de Ronald Cameron[29] suit une trajectoire en certains points semblable à celle de Kellogg : améliorer les conditions de vie et de travail doit passer par un recul des politiques néolibérales[30]. Jean Dalcé[31] souligne quant à lui l’écart entre le discours et la pratique du libre-échange, et ce, en dépit des revendications portées par des organisations de la société civile[32]. Angelo DiCaro[33] s’interroge sur la capacité du Canada, une économie relativement petite, à amorcer une réforme sociale de la politique commerciale mondiale[34]. Mentionnons ici que l’une des recommandations formulées par Anil Hira visait précisément la nécessité d’une alliance entre le Canada et ses partenaires globaux pour induire un changement des normes internationales[35].
La troisième partie de l’ouvrage se décline en cinq chapitres (sept à onze), axés sur les moyens de mettre en oeuvre une politique commerciale socialement responsable. Ces moyens ont été présentés et débattus dans le cadre d’une conférence du CEIM en février 2019[36]. Au chapitre sept, Simon-Pierre Savard-Tremblay[37] présente une perspective critique des accords de libre-échange, les assimilant à des instruments d’un processus de « constitutionnalisation du modèle néolibéral »[38]. Les nouveaux accords commerciaux sont structurants dans la vie interne des États, et induisent la mise en place d’un régime réglementaire basé sur la concurrence[39]. Ils entraînent en ce sens un nivellement par le bas des conditions de travail, ce que Jean Dalcé n’aura pas manqué de souligner dans son commentaire[40]. Gavin Fridell suggère au chapitre huit une solution, celle de déplacer le favoritisme (« bias ») existant pour les entreprises vers les travailleurs[41]. Au chapitre neuf, Jean Dalcé propose trois moyens de mise en oeuvre d’une politique commerciale plus « humaine » : mise en place d’un filet social, protection accrue des secteurs clefs de l’économie et retrait pour les entreprises de la possibilité de poursuivre l’État lorsque les politiques publiques affectent leurs investissements[42]. Au dixième chapitre, Kevin Kolben[43] rappelle le pouvoir des consommateurs — via leur sensibilisation à la dimension sociale du commerce international — sur le comportement des entreprises[44]. Au chapitre onze, le dernier de la troisième partie, Karen Curtis[45] offre un aperçu des défis de gouvernance globale du point de vue de l’Organisation internationale du travail (OIT) et appelle à une meilleure synergie des organisations internationales du commerce avec l’OIT[46].
En guise de conclusion, Michèle Rioux et Sylvain Zini discutent de l’ensemble des commentaires et réflexions, engageant ainsi un dialogue avec les contributeurs de l’ouvrage.
Vers une politique commerciale socialement responsable dans un contexte de tensions commerciales présente une feuille de route réaliste pour l’élaboration au Canada d’une politique commerciale respectueuse des conditions de vie et de travail. S’adressant à la fois à des chercheurs, des « policy-makers », des représentants syndicaux et à la société civile, l’ouvrage parvient à dégager des recommandations claires pour induire une prise en considération du « social » dans les accords commerciaux.
Réunissant un vaste réseau d’experts issus de domaines différents, l’ouvrage se veut multidisciplinaire et permet au lecteur d’apprécier une variété de points de vue sur la relation entre responsabilité sociale et commerce. Les codirecteurs adoptent également une approche critique, en intégrant par exemple des remises en question systémiques du néolibéralisme et de ses outils de diffusion. Leur approche propose aussi une lecture nuancée ; des auteurs s’interrogent sur la correspondance même entre politique commerciale et responsabilité sociale[47]. De plus, la première partie de l’ouvrage présente un aperçu à la fois des avantages et des désavantages de l’utilisation des accords commerciaux, des SPG et de l’interdiction des produits issus du travail forcé comme instruments d’une politique commerciale socialement responsable.
Si l’on peut apprécier la transparence avec laquelle les codirecteurs abordent la question des conditions de travail, il convient de s’interroger sur l’absence de l’environnement ou des droits des peuples autochtones dans ce qui a été retenu comme relevant du « social »[48]. Les accords commerciaux peuvent inclure les droits des peuples autochtones, en témoigne par exemple le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTGP) — bien que l’on puisse critiquer la faiblesse de l’engagement en la matière[49]. L’une des recommandations formulées par Rioux et Zini au chapitre quatre vise à « élever le niveau d’obligation et d’engagement des pays partenaires [du Canada][50] » vis-à-vis des normes du travail. Pourquoi ne pas proposer d’exiger également aux partenaires commerciaux l’équivalent en ce qui concerne la reconnaissance des droits de peuples autochtones ? Élargir la définition de la dimension sociale aurait sans doute produit des recommandations à l’intention du Canada qui répondent à un éventail plus vaste d’enjeux sociaux — c’est d’ailleurs ce que soulignent plusieurs experts au chapitre cinq.
De plus, l’ouvrage est publié en 2021, mais reprend en partie des activités organisées par le CEIM entre 2017 et 2019. Des commentaires sont conséquemment plus récents que d’autres : on retrouve par exemple à la fois un auteur qui s’inquiète d’un aboutissement des renégociations de l’ALENA et un auteur qui commente le contenu de l’ACEUM[51]. Cela témoigne du dynamisme de la thématique traitée par l’ouvrage, et de la pertinence de celui-ci dans un contexte en évolution rapide.
Enfin, notons que l’ouvrage est rédigé majoritairement en français, bien que les contributions d’auteurs de langue anglaise n’aient pas été traduites. L’ouvrage est novateur en ce sens que la littérature française récente semble plutôt muette sur le sujet, ou du moins exclure le Canada de son champ d’analyse.
Appendices
Notes
-
[1]
Jean-Baptiste Velu, « Préface » dans Sylvain Zini et al, dir, Vers une politique commerciale dans un contexte de tensions commerciales, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2021, VII à la p VII .
-
[2]
Simon-Pierre Savard-Tremblay, « Chapitre 7/ Le libre-échange comme constitutionnalisation du modèle néolibéral? » dans Zini et al, supra note 1, 197 aux pp 197 et 199.
-
[3]
Velu, supra note 1 aux pp VII-VIII.
-
[4]
Michèle Rioux et Sylvain Zini, « Conclusion générale/ Arrimer ouverture commerciale et progrès social » dans Zini et al, supra note 1, 281.
-
[5]
« Back Matter » dans Zini et al, supra note 1 à la p 296.
-
[6]
« Vers une politique commerciale socialement responsable ? » (dernière consultation le 3 décembre 2022), en ligne : Gouvernance globale du travail <ggt.uqam.ca/spip.php?article1139&lang=fr>.
-
[7]
Velu, supra note 1 aux pp IX-X.
-
[8]
Heysee Verdal possède une vaste expérience en droits de la personne et droit international et a occupé différents postes dans les secteurs privé et public au Canada, au Mexique et en France.
-
[9]
Maud Boisnard est politologue de formation et doctorante au département de communication de l’Université de Montréal.
-
[10]
Hugues Brisson est titulaire d’une maîtrise en droit international et relations internationales de l’UQAM et participe à divers projets de recherches en économie politique internationale à titre de chercheur indépendant.
-
[11]
Michèle Rioux et Sylvain Zini, « Chapitre 4/ Pour une politique commerciale socialement responsable. “Un défi pour le Canada et ses partenaires : rapport de synthèse et consultations publiques” » dans Zini et al, supra note 1, 97 [Rioux et Zini, « Chapitre 4 »].
-
[12]
Voir l’ensemble des dix recommandations, ibid à la p 100.
-
[13]
Il s’agit d’experts invités lors d’un séminaire organisé par le CEIM en 2018.
-
[14]
Robert Finbow est professeur de science politique à l’Université Dalhousie et directeur adjoint du Centre d’excellence Jean-Monnet de l’Union européenne.
-
[15]
Robert Finbow, « The necessity of socially responsible trade » dans Zini et al, supra note 1, 119 à la p 126.
-
[16]
Isabelle Martin et Mélanie Dufour-Poirier sont professeures agrégées à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal et co-chercheures au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Francisco Villanueva est professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et docteur en droit de l’Université de Montréal.
-
[17]
Isabelle Martin, Mélanie-Dufour-Poirier et Francisco Villanueva, « Concilier la politique commerciale et la responsabilité sociale des entreprises dans le cadre des Accords de libre-échange : quels arrimages possibles quant aux droits des travailleurs ? » dans Zini et al, supra note 1, 152.
-
[18]
Anil Hira est professeur de science politique à l’Université Simon Fraser et directeur du Energy Research Group.
-
[19]
Anil Hira, « Comments on summary report, “Canada : Towards a Socially Responsible Commercial Policy” » dans Zini et al, supra note 1, 134 à la p 135.
-
[20]
Kelly Pike est professeure en relations industrielles à l’École de gestion des ressources humaines de l’Université York et membre actif du Groupe consultatif interne du Canada sur le travail dans l’Accord économique et commercial global.
-
[21]
Better Work est un programme global qui regroupe tous les niveaux de l’industrie dans le but d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs tout en renforçant la compétitivité.
-
[22]
Kelly Pike, « Comments on the Public Consultations Summary Report “Towards a Socially Responsible Trade Policy” : A Challenge for Canada and Its Partners » dans Zini et al, supra note 1, 162 à la p 165.
-
[23]
Gavin Fridell est professeur à l’Université Saint Mary’s d’Halifax, siège au Conseil consultatif du Réseau canadien du commerce équitable et est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études du développement international.
-
[24]
Kristine Plouffe-Malette est codirectrice de la Revue québécoise de droit international, professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et professeure associée à l'UQAM.
-
[25]
Gavin Fridell, « Enforcing Social Responsibility and the Red Herring of Comparative Advantage » dans Zini et al, supra note 1, 128 aux pp 128 et 131-33; Heysee Verdal, « Chapitre 1 : Les accords de commerce et le travail » dans Zini et al, supra note 1, 9 à la p 12.
-
[26]
Kristine Plouffe-Malette, « De l’OIT à l’OMC. L’interdiction d’importation des produits intégrant le travail forcé et les pires formes de travail des enfants : un appel à la morale? » dans Zini et al, supra note 1, 168.
-
[27]
Paul Kellogg est professeur au Centre pour les études interdisciplinaires de l’Université Athabasca.
-
[28]
Paul Kellogg, « Trade policy in a world of protectionism and non-equivalent exchange » dans Zini et al, supra note 1, 137 à la p 150.
-
[29]
Ronald Cameron a notamment coordonné le Réseau québécois sur l’intégration continentale au cours des négociations de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).
-
[30]
Ronald Cameron, « Les négociations de l’ALENA et le néolibéralisme 2.0 » dans Zini et al, supra note 1, 181 à la p 183.
-
[31]
Jean Dalcé est économiste de formation et conseiller syndical au Service de recherche et de condition féminine de la Confédération des syndicats nationaux.
-
[32]
Jean Dalcé, « Les commentaires sur le Rapport du CEIM » dans Zini et al, supra note 1, 183.
-
[33]
Angelo DiCaro est directeur de la recherche pour Unifor et a représenté le syndicat à titre de membre du Groupe consultatif canadien durant les négociations de l’ACEUM.
-
[34]
Angelo Dicaro, « Unifor's response to the Summary Report » dans Zini et al, supra note 1, 188 aux pp 191-92.
-
[35]
Hira, supra note 19 à la p 135.
-
[36]
Michèle Rioux, Sylvain Zini et Éric Boulanger, « Introduction » dans Zini et al, supra note 1, 1 à la p 4.
-
[37]
Simon-Pierre Savard-Tremblay est titulaire d’un doctorat en socio-économie du développement, député de Saint-Hyacinthe-Bagot et porte-parole en commerce international au sein du caucus du Bloc Québécois.
-
[38]
Savard-Tremblay, supra note 2 à la p 197.
-
[39]
Ibid à la p 200.
-
[40]
Dalcé, supra note 32 à la p 188.
-
[41]
Gavin Fridell, « Chapitre 8/ Corporate Preference or People's Preference? Shifting the Bias in Trade Agreements » dans Zini et al, supra note 1, 225 à la p 247.
-
[42]
Jean Dalcé, « Chapitre 9/ Pour une véritable politique commerciale socialement responsable au Canada » dans Zini et al, supra note 1, 253 à la p 262.
-
[43]
Kevin Kolben est professeur à la Rutgers Business School et agit à titre de consultant, entre autres pour l’OIT.
-
[44]
Kevin Kolben, « Chapitre 10/ The Consumer Imaginary » dans Zini et al, supra note 1, 265 à la p 270.
-
[45]
Karen Curtis travaille au sein de l’OIT depuis 1998.
-
[46]
Karen Curtis, « Chapitre 11/ The International Labour Organization in the Global Governance at its 100th Anniversary » dans Zini et al, supra note 1, 271 à la p 279.
-
[47]
Voir Verdal, supra note 25; Finbow, supra note 15.
-
[48]
Voir par ex Hira, supra note 19 et Martin, Dufour-Poirier et Villanueva, supra note 17.
-
[49]
Scott Simon, « How Canada can advance Indigenous rights through trade agreements : Scott Simon in the Hill Times » (4 mai 2021), en ligne : Macdonald-Laurier Institute <macdonaldlaurier.ca/indigenous-rights-trade-agreements/>.
-
[50]
Rioux et Zini, « Chapitre 4 », supra note 11 à la p 100.
-
[51]
Kellogg, supra note 28 à la p 138; Savard-Tremblay, supra note 2 à la p 217.