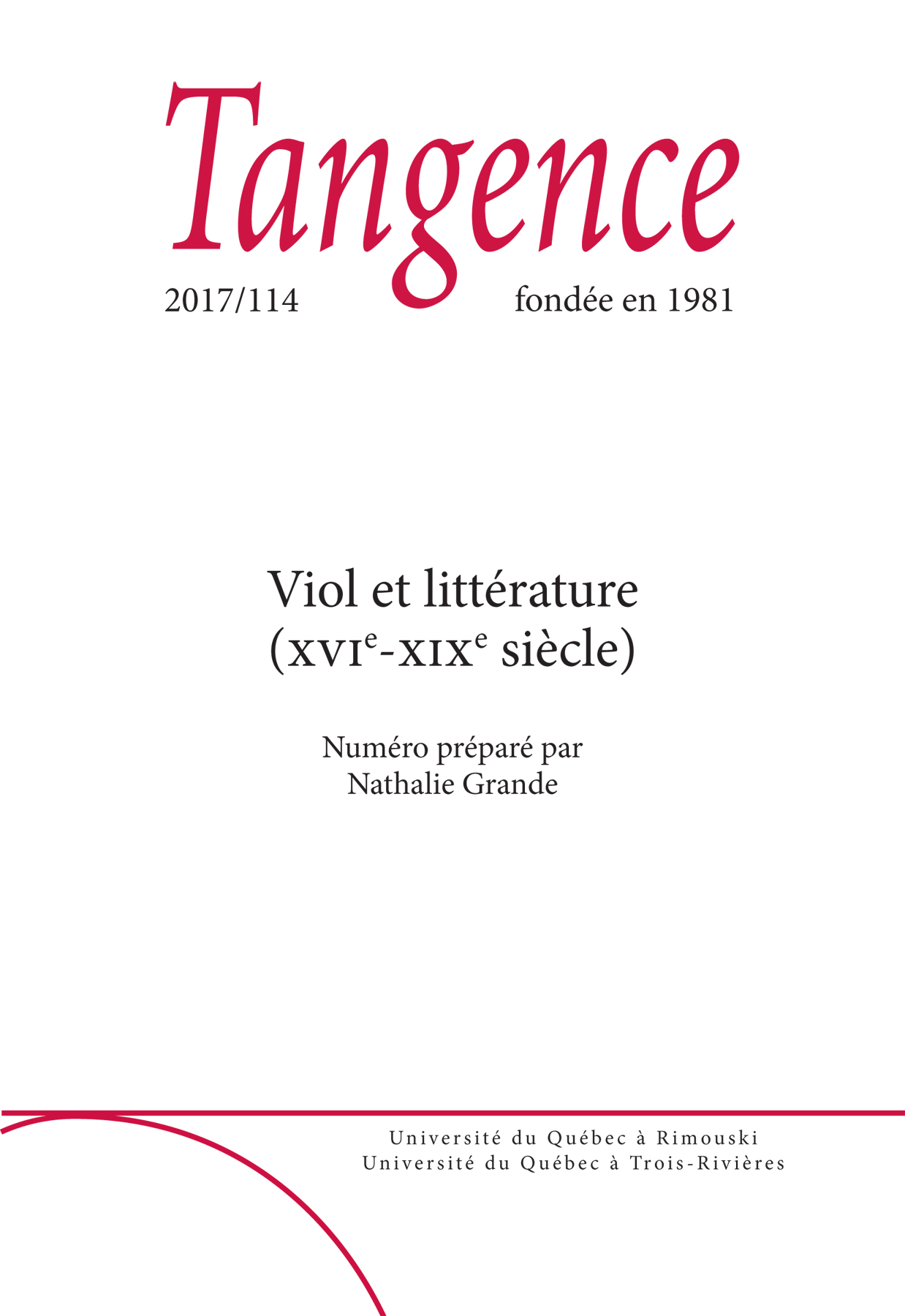Abstracts
Résumé
Les histoires tragiques, parce qu’elles sont un genre chargé de dire les abominations du monde, semblent particulièrement adéquates pour raconter le viol, en explorer les circonstances pas toujours atténuantes, en dévoiler les enjeux humains, individuels et pas seulement collectifs. L’étude d’un tel corpus permet de désigner les caractéristiques qui autorisent ce crime à devenir objet de récit, mais aussi de faire entendre le discours que tient la représentation des victimes sur le forfait lui-même, et d’en saisir les enjeux moraux et sociaux. Alors que des formes de consentement a posteriori et des procédures judiciaires de réparation tendent souvent à édulcorer le viol, certains auteurs, comme Jean-Pierre Camus, mettent au contraire en évidence le dilemme qui pèse sur la victime entre sauver sa chasteté ou sauver sa vie : c’est par le choix de la mort que la victime est invitée à prouver la violence subie, toujours douteuse. Quand la société ignore ou minore le crime, cette insistance d’un évêque humaniste sur le point de vue des victimes montre un souci de révéler publiquement la gravité de l’attentat sexuel.
Abstract
Because their task is to recount the world’s atrocities, tragic stories seem a genre particularly well suited to the subject of rape, to exploring its not always extenuating circumstances, to uncovering not only its collective ramifications but its human and individual challenges as well. The study of such a corpus helps identify the characteristics that make this crime a narrative subject; it also draws attention to the victims’ representation of the issue itself and fosters an understanding of its moral and social aspects. Whereas forms of a posteriori consent and judicial reparations often tended to downplay rape, certain authors like Jean-Pierre Camus chose, rather, to focus on the dilemma faced by the victim: saving her chastity or saving her life. The victim was invited to choose death to prove she had suffered an attack, always in doubt. In a society that ignored or minimized the crime, this humanist bishop’s insistence on the viewpoint of the victim reflects a concern with publicly demonstrating the seriousness of sexual assault.
Article body
Selon les archives du Parlement de Paris, ce ne sont que 49 viols qui auraient été commis dans sa juridiction entre 1540 et 1692 : 49 viols pour une période de plus de 150 ans, c’est-à-dire en moyenne — si l’on ose le calcul — moins d’un viol tous les trois ans[1]… Un tel chiffre ne peut se comprendre que comme le signe de la non-prise en compte par les autorités judiciaires des plaintes pour viol, ce déni expliquant que les victimes s’abstenaient de porter plainte par anticipation de leur incapacité à se faire entendre ; car ce n’est vraisemblablement pas parce qu’il n’y a eu aucun viol, ou presque, commis dans la ville de Paris aux xvie et xviie siècles, mais bien parce que l’institution judiciaire ne reconnaissait que très difficilement ce crime qu’aucune plainte ou presque n’était déposée. Les travaux de l’historien Georges Vigarello ont en effet montré comment, excepté lors des agressions sexuelles contre les enfants, le viol n’était reconnu et puni que s’il entraînait le déshonneur, voire la spoliation d’une famille entière par la dégradation d’une femme particulière. Attentat contre une victime individuelle et singulière, le viol n’était pris en compte que s’il suscitait un préjudice collectif et un désordre social. Pourtant, si la loi du silence pesait sur les victimes dans la société, la littérature quant à elle ne se taisait pas, et le récit bref, la nouvelle, et plus précisément les histoires tragiques, parce qu’elles prétendent donner à voir au lecteur les horreurs du monde tel qu’il va, apparaissent comme des lieux privilégiés pour raconter le viol, en explorer les circonstances, pas toujours atténuantes, en dévoiler les enjeux humains, individuels et pas seulement collectifs. C’est ce corpus que nous voudrions interroger pour mettre en évidence les caractéristiques qui permettent à ce crime de devenir objet de récit, de manière à entendre le discours que la représentation des victimes tient sur le crime lui-même, et à saisir les enjeux moraux et psychologiques qu’impliquent ces représentations.
Des viols, mais pas n’importe lesquels
Les histoires tragiques, ces brefs récits mettant en scène des événements particulièrement frappants issus de l’histoire ou de l’actualité à destination d’un lectorat souvent mondain, ne font pas du viol un motif privilégié parmi les différents crimes qu’elles peuvent évoquer (sorcellerie et possessions démoniaques, conjurations politiques, crimes passionnels, vengeances et jalousies meurtrières, incestes, infanticides, fratricides et parricides…) et il est même plutôt peu commun[2]. Dans le recueil par lequel Boaistuau fait entrer en France le genre des « histoires tragiques », un seul des six récits qui le composent évoque un tel événement ; et encore il apparaît comme une menace et n’est jamais réalisé[3]. Chez Matteo Bandello, le conteur italien chez qui Boaistuau a puisé son inspiration, il en va de même : trois nouvelles sur les 97 qui constituent son recueil mettent en scène un viol : viol suivi d’un suicide (I, 8) ; tentative de viol par un abbé sur une jeune fille qui se sauve en se jetant dans une rivière (II, 7) ; viol de Lucrèce par Sextus Tarquin (II, 21)[4]. Chez François de Rosset, sur les 23 nouvelles qui composent le recueil de ses Histoires tragiques de notre temps, une seule met en scène un viol : « De l’abominable péché que commit un chevalier de Malte assisté d’un moine, et de la punition qui s’ensuivit[5]. » Ainsi les récits mettant en scène le viol sont relativement rares ; on doit constater que, si le motif de viol est présent, c’est seulement accompagné de circonstances aggravantes ou spectaculaires. Chez Boaistuau, qui apparaît comme atypique, le viol (non commis) fait accéder la victime potentielle au statut de reine : on est dans un schéma qui ressemble à un conte de fées, où « l’épreuve qualifiante » de la résistance féminine au désir du roi prouve les qualités héroïques de la femme, qui préfère conserver sa chasteté plutôt que de satisfaire son ambition en accédant au rôle de favorite, ce qui justifie in fine son élection comme épouse et comme reine. Mais chez tous les autres conteurs, la circonstance spectaculaire est de nature à particulièrement effrayer le lecteur. Chez Jean-Pierre Camus par exemple, le viol est aggravé par différents facteurs : parce qu’il est commis par un ami du mari, qui abuse de la confiance qu’on lui témoigne et profite de l’intimité que lui ouvrent les droits de l’amitié pour commettre son forfait[6] ; ou parce qu’il est accompagné d’esclavage sexuel et entraîne la mort de la victime[7] ; ou parce que la jeune fille, pour échapper à son persécuteur, préfère s’immoler par le feu[8]. Cela se vérifie dans les canards du temps, ces brèves parutions occasionnelles qui viennent fournir à un lectorat « populaire » une moisson de faits divers extraordinaires : sur les 142 canards que signale le répertoire des Fictions narratives en prose (1611-1623), deux seulement racontent des viols ; mais ces viols sont perpétrés par des criminels dont l’identité aggrave considérablement le crime : l’inceste d’un père sur sa fille dans le « Discours véritable de Toussaint Letra, lequel a été brûlé tout vif dans la ville d’Aix, le 26 d’août dernier, pour avoir violé sa propre fille » (Lyon, Fr. Evrard, 1618) ; le viol commis, selon l’expression convenue — mais malheureuse à notre sens — « en réunion », et par des femmes qui plus est, et suivi de la mort de la victime, laquelle est en outre une enfant : « Discours véritable du viol et assassin [sic] commis par quatre femmes sorcières à l’endroit d’une jeune fille âgée de dix ans ou environ, lesquelles ont été exécutées dans la ville du Hâvre de Grâce […] le 28. jour de juin 1611 » (Lyon, Aimion, 1611)[9]. Ces circonstances aggravantes se retrouvent chez Rosset, et portées à leur paroxysme en quelque sorte. Car, si le conteur ne retient dans son recueil qu’un seul exemple de viol pour illustrer son leitmotiv de la déchéance du monde chrétien, où le comble des péchés a été atteint, son exemple cumule les facteurs à charge puisque le viol est commis sur la personne d’un gentilhomme par deux religieux. Le crime sexuel est ainsi aggravé de plusieurs manières : par sa nature (la sodomie, alors considérée comme un crime contre la Nature, donc contre le Créateur, une sorte de blasphème en acte) ; par l’état de vie des criminels (un chevalier de Malte et un moine, qui transgressent les voeux de la vie religieuse et dégradent ainsi l’Église entière) ; enfin, par la personne de la victime : un homme (et nul doute que les mentalités de l’époque considèrent que le traumatisme est infiniment plus violent pour un homme que pour une femme) et un gentilhomme de surcroît (là, c’est le préjugé social qui aggrave le crime : le déshonneur est considéré comme plus grand pour un noble que pour un homme du peuple). Et Rosset d’introduire sa nouvelle en écrivant : « Je m’étonne que la justice de Dieu n’extermine le monde comme il fit du temps du déluge universel, puisque le vice y est monté en un si haut degré qu’il est impossible que la patience du Ciel le puisse plus longtemps supporter[10]. »
Il faut donc constater que ce qui constitue l’horreur du crime ne tient pas à la nature même de celui-ci (la violence sexuelle), mais souvent aux circonstances qui l’accompagnent : âge, sexe et statut social de la victime aussi bien que du violeur. On comprend ainsi que le faible nombre des récits de viol que nous soulignions d’abord est révélateur d’une sorte de sélection opérée par les conteurs dans le matériau brut que leur livrent l’histoire ou l’actualité. La rareté du sujet ne confirme pas forcément la rareté des actes que le petit nombre de procès pourrait laisser supposer, et même au contraire. Les facteurs aggravants qui accompagnent le crime dans les récits des conteurs peuvent en effet être interprétés comme un signe de la banalité du viol « standard », celui commis par un homme sur une femme, adulte, socialement inférieure, et sans autre forme de violence que sexuelle. Ce viol-là, qui ne se va pas devant les tribunaux, n’apparaît pas non plus dans les histoires tragiques ou les canards, qui se limitent aux viols « extra-ordinaires », ce qui donne sans doute une idée de la tolérance sociale à l’égard du viol « ordinaire[11] ».
Victimes vengeresses
De cette méconnaissance fréquente de la société à l’égard du crime témoignent un certain nombre de réparations entreprises par les victimes, en l’absence de réponse adéquate du corps social. Dans la nouvelle de Camus, « Le violement », quand l’épouse prévient son mari du crime commis par son ami intime, il a « de la peine à le croire » :
Au lieu donc de courir après [le violeur] pour se venger d’un si notable affront, il ne daigna pas seulement en faire instance en Justice, peut-être pour ne publier sa honte, qui était connue de peu de gens, peut-être aussi pour ne pouvoir et ne vouloir prêter la main à la ruine de cet Ami, et peut-être encore pour être cette offense de celles que la Noblesse tient ne se pouvoir réparer que par l’épée. Tant y a que Ménodore [l’épouse], voyant que son mari ne faisait point état de tirer sa raison d’un tel outrage, s’en plaint à ses parents qui, blâmant la stupidité et insensibilité de ce mari, entreprennent l’affaire en Justice, font confisquer tous les biens d’Antonian [le violeur] adjugés à Ménodore pour réparation du tort, et le font condamner à perdre la tête[12].
Ce que dit le récit, c’est que le mari, par amitié, par lâcheté ou pour sauvegarder son honneur à lui, est prêt à oublier le préjudice subi par sa femme, manifestant une « insensibilité » incompatible avec la qualité d’époux. Si c’est la famille de l’épouse violée qui prend les choses en main et dépose plainte, c’est peut-être le signe que la famille de la victime est plus sensible au tort subi et à la demande de justice de cette dernière : le point de vue de la victime l’emporte alors sur les autres considérations sociales.
Camus présente un autre exemple où c’est l’épouse victime qui prend en charge la réparation du tort, en l’absence de la réponse attendue de la part de l’époux. Là encore, c’est un ami proche du mari qui profite de sa fréquentation intime du couple pour se glisser, en se faisant passer pour l’époux, dans le lit conjugal. Mais la femme évente le piège, le déjoue et le dénonce à un mari plutôt complaisant : « Néanmoins il [le mari bafoué] lui jura [au violeur potentiel] qu’il lui pardonnait, puisque son impudent attentat n’avait servi que pour rendre illustre la pudicité de sa femme. La parole qu’il donna, il la tint ; et Tammar [le violeur] s’étant rendu à sa discrétion n’en reçut aucun mauvais traitement[13]. » C’est donc alors la femme qui, n’ayant pas trouvé réparation à l’attentat subi, se fait elle-même justice :
Mais Juliane [l’épouse], irritée outre mesure, ne le [Tammar] quitta pas à si bon marché : car ayant dit à son mari qu’il pouvait pardonner le tort qu’il lui avait voulu faire, mais que pour cela elle n’en était pas satisfaite, elle fit donc saisir ce misérable par des valets ; et après lui avoir fait lier les pieds et les mains, elle se met avec ses femmes et filles à le fouetter si démesurément qu’il n’y avait partie sur son corps dont le sang ne sortît. Après cela, elles lui crevèrent les yeux avec leurs aiguilles et, avec leurs ciseaux et autres ferrements de leurs étuis, lui firent tant d’incisions et de balafres au visage et par tout le corps qu’il n’était plus reconnaissable. Après cela, elles versèrent dans ses plaies du sel et du vinaigre, ne pouvant s’assouvir de ses douleurs. Certes, il n’y avait pas une de ces plaies qui d’elle-même ne fût mortelle, mais toutes ensemble le versèrent au tombeau[14].
La vengeance féminine, collective et sadique, peut sembler disproportionnée à l’attentat, d’autant que l’agresseur n’était pas allé jusqu’à la réalisation du crime. Camus met là en scène le sentiment d’honneur d’une femme contre le comportement d’un homme qui, « violant les droits d’hospitalité et les lois d’un sacrement honorable et sans tache, ne méritait pas un moindre châtiment » ; mais on peut aussi y lire l’application de la justice par une femme menacée, qui entend faire subir à son agresseur l’équivalent du crime qu’il allait commettre en vertu de la loi du talion. En effet, on observe, d’une part, que la vengeance est exercée par un groupe de femmes, « femelles irritées » selon l’expression de Camus, ce qui donne à l’acte une dimension communautaire, ressortissant à une communauté de genre, comme si toutes les femmes de la maison, et non une seule, étaient concernées par l’attentat, comme si cette vengeance disait quelque chose d’un sentiment partagé entre les femmes de la nécessité d’une justice pour un acte qui ne peut se pardonner. D’autre part, la modalité de la vengeance semble symbolique d’un retournement du crime contre celui qui s’apprêtait à le commettre : les femmes font saigner le corps de l’homme ; elles lui infligent des plaies avec leurs instruments de couture sortis de leurs étuis, ouvrent des blessures, fendent la peau, percent les orifices (oculaires), y versent un liquide acide (le vinaigre)… Cette scène, qui évoque la violence sexuelle à laquelle elle répond, confirme le besoin d’une reconnaissance par les femmes de l’attentat subi, besoin que les hommes, les maris en l’occurrence, ne comprennent pas et n’éprouvent pas, sans doute à cause de la tolérance sociale déjà mentionnée. Qu’une femme, une épouse, donc une adulte et non pas une enfant, connaissant la sexualité et non pas vierge, se fasse violer par un homme qui n’est pas de sa parenté mais qui est de son niveau social, le mal n’est pas si grand qu’il mérite qu’on en fasse une affaire judiciaire, semble-t-il. C’est en tout cas, dans ces deux exemples, le point de vue de l’époux, qui apparaît plein d’indulgence à l’égard de l’agresseur, et qui est prêt à pardonner l’offense qui lui a été faite, sans se soucier de la violence subie par son épouse (sans doute par souci de sauver par le silence son honneur de mari ?).
Victimes anéanties
On comprend alors qu’il faut, pour que le viol fasse scandale et mérite récit, qu’il soit particulièrement effrayant par rapport à la… « norme », qu’il s’accompagne d’éléments susceptibles de choquer la morale (inceste, pédophilie), ou de transgresser l’ordre social ou religieux (mort violente de la victime, déshonneur d’un-e noble, perte de la virginité qui entraîne la perte de la valeur d’une jeune fille sur le marché matrimonial, atteinte à l’ordre voulu par le Créateur). Et c’est pourquoi les conteurs, s’ils n’hésitent pas à surenchérir dans l’horreur, savent aussi faire appel à l’empathie du lecteur pour la victime, qui devient un modèle : le gentilhomme victime chez Rosset, terrassé par le déshonneur et la honte, choisit de quitter le monde pour devenir ermite ; sa fiancée, désespérée à son tour, se retire dans un couvent pour faire pénitence et y vit deux ans, « exerçant sur son corps toutes sortes de rigueurs pour acquérir l’héritage du Ciel, où son âme s’envola au bout de cet espace de temps[15] » ; la Sicilienne esclave des Turcs devient une sorte de sainte martyre, une « généreuse fille » qui « mourant mille fois de déplaisir chaque jour, racheta tant de morts par une seule, qui la tira de l’infamie et de l’esclavage pour la mettre en la gloire et en la liberté des enfants de Dieu[16] » ; la « chaste fille » qui préfère s’immoler par le feu plutôt que céder à la violence « fait voir que les vertus héroïques ne logent pas toujours dans les coeurs de ceux dont les qualités sont les plus éminentes dans le monde » (SH, p. 97). Il nous semble que la littérature se distingue clairement en cela de la réalité sociale, puisqu’elle offre une vision positive, sublimée pourrait-on dire, des victimes. En effet, le viol est le seul crime dont les victimes se sentent paradoxalement honteuses[17], comme si elles partageaient la responsabilité du crime commis, comme si la contrainte subie les avait dégradées en tant que personnes. Or les récits, en se centrant sur des viols particulièrement épouvantables, redonnent une forme de dignité aux victimes, qui ne sont plus seulement de pauvres malheureux-ses soumis-es aux hasards d’une mauvaise rencontre, voire des personnes dont on doute de la résistance face à la « tentation » sexuelle. Les victimes des récits deviennent, par leur résistance qui peut aller jusqu’à la mort choisie, de véritables héro-ïne-s.
Les histoires tragiques se distinguent en effet des canards non seulement par l’élaboration littéraire ou la publication en recueil, mais aussi par le discours édifiant qui accompagne les récits. Or, la qualité chrétienne que mettent en valeur les récits de viol, c’est la chasteté invincible des victimes : ce qui leur permet d’entrer dans le panthéon sanglant des « histoires tragiques » est clairement le fait de préférer conserver leur chasteté plutôt que leur vie… ou de préférer la mort, une fois leur chasteté perdue. C’était déjà le cas dans les trois nouvelles de Bandello narrant un viol, qui toutes trois se terminaient par le suicide (ou la tentative de suicide) de la victime : la jeune fille va se noyer dans l’histoire de Giulia de Gazzuolo (BNo, i, 8, p. 109-116) ; elle se jette aussi à l’eau pour échapper à son agresseur mais surnage dans la nouvelle 7 du deuxième volume (BNo, ii, 7, p. 15-25) ; enfin, le troisième récit reprend le récit du viol par Sextus Tarquin de la chaste Lucrèce, qui elle aussi met fin à ses jours (BNo, ii, 21, p. 163-178). Comme on le remarque, seule survit celle qui a pu échapper au viol, comme si la victime devait forcément expier le forfait. C’est ce que confirme Boaistuau : la comtesse de Salberic survit, et est même couronnée reine, mais c’est parce qu’elle n’a pas cédé et a mis sa vie en jeu :
Puis, tirant un grand couteau tranchant, tout baigné de larmes, qu’elle avait sous sa robe, tournant ses yeux piteux vers le Roi, plein d’étonnement et de merveille, lui dit : « Sire, le don que je vous requiers et pour lequel votre foi m’est demeurée obligée, c’est que je vous supplie très humblement, plutôt que de me ravir l’honneur, avec cette épée que portez ceinte donner fin à ma vie, ou permettre maintenant qu’avec ce couteau tranchant moi-même me défasse, afin que mon sang innocent me servant d’honneur funéral porte témoignage devant Dieu de ma chasteté incontaminée, étant si résolue de mourir avec l’honneur que, ainçois [avant] que je le perde, je me meurtrirai moi-même devant vous de ce glaive[18] ».
La comtesse de Salberic, cachant le poignard dans sa robe comme Lucrèce l’avait fait, devient une nouvelle Lucrèce ; mais elle a la chance de tomber sur un autre que Sextus Tarquin, et d’un roi violeur et assassin en puissance, elle peut alors faire un époux. Chez Rosset et Camus aussi, le viol entraîne une déchéance de la victime, qui doit réparer le crime par l’expiation. Mais ils tiennent à réprouver la tentation du suicide, car celui-ci est contraire à la foi chrétienne ; aussi leurs victimes choisissent-elles préférentiellement le cloître : « sans la peur qu’il [le gentilhomme violé] a de perdre son âme, il se donnerait cent fois la mort de sa propre main », souligne Rosset[19]. Quant à Camus, il fait imaginer à la Sicilienne razziée par les Turcs un stratagème pour être tuée de la main de ses violeurs, et sa mort, même volontaire, sciemment organisée et recherchée par elle, ne peut être stricto sensu qualifiée de suicide. Et quand le romancier célèbre la « brillante chasteté » de cette autre qui choisit de s’immoler par le feu pour échapper à son agresseur, il met en garde le lecteur : « en ce Spectacle […] vous verrez une fille chaste avec clarté et dont la mémoire mérite d’être transmise à ceux qui viendront après nous, encore que son exemple soit de ceux qui doivent être plutôt admirés qu’imités » (SH, p. 95).
Même pour un humaniste chrétien comme Camus, nul doute que le viol subi met en cause l’intégrité de la victime, et que celle-ci doit rechercher, dans le fond d’un couvent ou dans la mort, à expier un crime qu’elle n’a pas commis : le prototype laissé par Lucrèce[20] est à cet égard significatif de l’état des mentalités traditionnelles, qui affectent la victime sinon d’une part de culpabilité, en tout cas d’une part d’infamie. De ce point de vue, la persistance d’un modèle venu de l’Antiquité montre que le christianisme n’a pas fondamentalement modifié dans les mentalités une représentation bien plus ancienne que lui. Même si la valorisation de la chasteté par le christianisme a pu contribuer à criminaliser la violence sexuelle, et en dépit de l’invitation chrétienne à la compassion et de l’idéal éthique de maîtrise des passions, le regard porté sur la victime reste ambivalent et Camus témoigne de cette ambiguïté par son incapacité à résoudre de telles contradictions. Ainsi, pour lui, la dégradation de la victime se manifeste physiquement : « Et à dire le vrai, qui ne sait pas le fait de la romaine Lucrèce, que la femme ou la fille dont le corps est pollué, quoique par force, ne voit plus le jour qu’à regret, et ne traîne la vie qu’avec douleur[21]. »
La généralisation médicale qu’opère Camus à propos du syndrome dépressif qui frappe la victime suppose le principe d’une « pollution » du corps, d’une dégradation effective de la victime, alors même que celle-ci n’est pas responsable de l’attentat subi. Le corps meurtri conserve une flétrissure qui le rendrait impur et dégraderait l’ensemble de l’être. Cela montre bien que la chasteté n’est pas seulement conçue comme une qualité morale, une vertu cardinale du chrétien, et surtout de la chrétienne, mais aussi comme une qualité physique, garantie par la virginité avant le mariage et par la fidélité sexuelle exclusive à l’époux après le mariage. Cette valorisation de la chasteté, que les titres de Camus soulignent volontiers[22], peut se comprendre dans le cadre de la répression sexuelle qui marque l’évolution des moeurs au cours des xvie et xviie siècles. Elle rend ainsi compte de l’influence des idées du Concile de Trente, que l’évêque de Belley, en champion de la Contre-Réforme, diffuse volontiers ; mais le discours de l’évêque témoigne aussi de la traduction sociale de nouvelles exigences politiques posées par un pouvoir monarchique centralisateur : selon les historiens, ces deux mouvements convergeraient alors pour contraindre à une répression des pulsions sur laquelle a pu se fonder le nouveau pacte de « civilisation des moeurs[23] ». Montrer des femmes définitivement anéanties par le viol subi permet d’insister sur la valeur de la chasteté, non plus seulement comme valeur morale ou vertu conforme à l’idéal chrétien, mais aussi comme garante d’un ordre social : le viol devient un attentat contre cet ordre, qui exclut l’agresseur par son crime mais aussi la victime par sa douleur, l’être féminin ne pouvant supporter physiquement et psychiquement le mal qui lui est arrivé. On constate alors que la position de l’évêque romancier, tout en répercutant la valeur chrétienne de la chasteté, laisse aussi entendre une vraie prise en compte de la douleur de la victime. Sa mort n’est pas seulement un moyen de réparer la faute : elle devient aussi l’échappatoire recherchée par une personne qui n’en peut mais. Dans cette perspective, la terrible alternative qui pèse sur les victimes (conserver sa chasteté au prix de la mort ou sauver sa vie au prix de la violence subie) ne tient pas seulement à une injonction d’ordre moral : elle donne au viol le statut d’un crime effectivement épouvantable, tel qu’on lui préfère la mort ou qu’il est suivi de mort.
Cette représentation du viol, qui insiste sur l’abomination du crime et peint une victime pitoyable, est particulièrement remarquable par rapport aux usages judiciaires qui envisageaient ce crime comme réparable moyennant compensation, c’est-à-dire par un dédommagement rachetant le préjudice subi[24]. C’est clairement ce qui motive l’agresseur dans « Le ravisseur », un des Spectacles d’horreur de Camus :
Voyant donc que les prières ni les offres ne lui servaient de rien, changeant ses caresses en fureur, mais fureur amoureuse, quoique brutale, il [le seigneur] fait empoigner cette vertueuse fille [de paysan] par ses valets, et avec leur aide il obtint d’elle par force ce qu’il ne pouvait attendre ni espérer autrement. […] Le Gentilhomme, ou plutôt le bourreau de son honnêteté se moquait de ses plaintes et de ses larmes, s’assurant que pour une simple paysanne le Duc ne voudrait pas le condamner à autre chose qu’à lui donner quelque somme pour aider à la marier.
SH, p. 73
Et de fait, dans un premier temps, c’est ce qui semble se profiler car « étant de retour il [le duc] fut prié par les parents du Gentilhomme de lui pardonner cette folie de jeunesse et cet excès d’Amour, promettant d’apaiser cette villageoise en la mariant richement » (SH, p. 73). Cependant, le dénouement de la nouvelle est bien différent de ce qu’avait imaginé le gentilhomme violeur : non seulement il doit épouser la fille qu’il a violée, mais sitôt le mariage accompli, il est condamné à être décapité. Et le duc de Bourgogne d’expliquer ce châtiment exemplaire : « Il disait pour sa défense, que le coupable en épousant la fille n’avait satisfait qu’à sa faute particulière, et à l’offense commise contre une personne privée, mais que le public qu’il avait scandalisé en tant de façons devait aussi être contenté par une réparation solennelle, et qui fut faite à la vue d’un chacun » (SH, p. 74).
Le choix que fait Camus de raconter une histoire de viol banal (une simple paysanne violée par un seigneur de passage) pour lui donner une fin judiciaire spectaculaire (mésalliance puis mort du gentilhomme coupable ; fille qui recouvre non seulement son honneur par le mariage, mais aussi les biens du défunt) montre comment l’évêque entend insister sur le préjudice effectif subi par la victime, quel que soit son statut social. Parmi tous les narrateurs de récits de viol, si tous crient au scandale et à l’abomination, Camus nous semble le seul à avoir cherché à adopter le point de vue de la victime, ayant conscience qu’il n’est pas besoin de circonstances aggravantes pour dénoncer le crime, et présentant des victimes dignes de pitié autant que de respect pour leur douleur[25].
Victimes consentantes
On peut mesurer l’originalité de la position de Camus quand on l’examine au regard des paroles que prononce un des protagonistes de Boaistuau dans sa sixième histoire. Un comte, amoureux d’une duchesse mais éconduit par elle, décide de se venger en la faisant passer pour adultère. Il convainc pour cela son jeune neveu qu’il devrait aller la voir nuitamment, car elle n’attend que cela :
« Mon enfant, je prévois en moi-même que tu es l’un des plus heureux gentilshommes de l’Europe si tu sais entretenir ton heur, car la Duchesse non seulement est amoureuse de toi, mais elle se consomme à vue d’oeil pour la trop furieuse amitié qu’elle te porte ; mais comme tu sais, les femmes sont honteuses et veulent être priées en secret, et se plaisant d’être trompées par les hommes, à celle fin qu’il semble que avec tromperie ou force, elles soient contraintes accorder aux hommes ce que de leur bon gré elles offriraient volontiers, sans un peu de honte qui les retient. Et me crois hardiment, l’ayant par plusieurs fois expérimenté avec mon très grand contentement[26] ».
Certes il s’agit du discours d’un fourbe, qui tend un piège sordide à la femme qui l’a refusé. Mais son neveu « simple jouvenceau » croit à la validité de ce « traître et abominable commandement[27] » d’autant plus facilement que les propos de son oncle s’appuient sur une croyance bien établie, qui voulait que la femme ne cherchât à se dérober aux poursuites amoureuses que par une pudeur hypocrite, étant en fait très désireuse de ce que son « honneur » lui commandait de fuir. Comme l’a montré Audrey Gilles-Chikhaoui[28], le viol, depuis Lucrèce, n’est pas exempt du soupçon récurrent d’un plaisir partagé, et la qualification de la violence sexuelle en viol apparaît alors problématique : aussi paradoxal que cela puisse paraître, le viol a pu être conçu par certains esprits comme un moyen de ménager la pudeur féminine[29].
Cet état d’esprit explique la minoration fréquente dans les mentalités de ce crime particulier, et justifie par conséquent la prédilection des récits pour des viols à la cruauté indéniable, des viols non douteux, si l’on ose dire. L’histoire de Boaistuau, où la résistance féminine transforme le violeur potentiel en époux effectif, participe de la même logique : entre un violeur et un époux, la différence ne semble tenir qu’aux circonstances, comme le montre aussi la nouvelle de Camus où la fille de paysan se retrouve femme de noble (et bientôt veuve). Du viol à l’amour, le retournement semble toujours possible… C’est ce que met en évidence magistralement un des « épitomes » d’Alexandre Sylvain. Cet auteur flamand de la seconde moitié du xvie siècle a laissé un recueil de procès imaginaires, où il traite tour à tour de différents cas judiciaires. Or, l’épitome 61 propose à la sagacité du lecteur un double cas de viol : « De deux filles violées, dont l’une demande la mort du violateur et l’autre le veut pour mari[30] ». Il s’agit d’une sorte de cas-limite judiciaire, puisque le droit d’Ancien Régime prévoit de fait pour le viol deux peines alternatives et a priori exclusives[31] : soit condamnation à mort, soit réparation du crime par le mariage. Que se passe-t-il dans le cas où l’agresseur a violé deux femmes, dont l’une demande la tête du coupable quand l’autre souhaite l’épouser ? ! La première victime évoque le scandale d’un crime redoublé et fait remarquer l’absurdité de la situation, qui ouvre une échappatoire à un double criminel qui n’aurait bénéficié d’aucune hésitation sur son sort s’il n’était responsable que d’un seul crime. La deuxième femme fait entendre un tout autre discours :
Néanmoins, considérant que la clémence est plus naturelle à notre sexe [que] la cruauté, je dis que, [là] où les prééminences ou prétentions sont de force égale, que la plus humaine doit être préférée à la plus rigoureuse ; et si vous m’alléguez les exemples de Lucrèce et Virginia, je vous alléguerai les Sabines et autres non moins honnêtes, mais plus discrètes et en plus grand nombre desquelles est venu plus grand bien[32].
La structure même du « procès », qui fait entendre d’abord l’accusation avant de laisser parler la défense, indique bien dans quelle direction le lecteur est invité à aller. Si l’acte d’accusation souligne le scandale du crime, la plaidoirie finale semble l’excuser, en tout cas le minorer, en vertu, d’une part, d’une prédilection féminine pour la clémence et, d’autre part, en raison de l’utilité sociale de la réparation matrimoniale. On comprend qu’indirectement la femme qui réclame une justice rigoureuse pour le crime commis est subrepticement accusée de manquer de discrétion et de sens de l’intérêt général : elle fait passer son intérêt personnel avant le bien public. Et on lui reproche aussi de manquer d’humanité, préférant la roide justice à la douce clémence. On voit clairement comment le procès est retourné, et comment ce n’est plus le « violateur » qui se trouve jugé et condamné, mais celle qui ose réclamer justice pour crime de viol. Ce que dit aussi ce procès imaginaire, c’est comment la femme est censée accepter la violence sexuelle. Et la référence aux Sabines donne même une touche de prestige historique/mythologique à cet acquiescement imposé.
***
En définitive, la représentation du viol dans les histoires tragiques, si elle permet de valoriser les victimes jusqu’à les transformer en potentiel-le-s héro-ïne-s, ne va pas jusqu’à dispenser ces victimes du soupçon d’avoir participé, nolens volens, au crime lui-même. Dans ces récits qui renvoient assez clairement un écho des mentalités de l’époque, et au-delà des caractéristiques littéraires qu’impose le genre, si la violence subie n’est pas cachée, le passage par le philtre chrétien amène souvent à la conclusion que, dans l’alternative entre la mort et le viol, la victime devrait préférer la mort, puisque le fait qu’elle survive au viol semble entraîner de facto la minoration du crime, voire le doute sur la réalité de celui-ci. Dans ce « préjudice du doute » qui pèse sur les femmes, il est facile de lire la pression d’une société qui ne peut comprendre ni admettre la résistance au désir masculin, parce que cette société place au centre de ses valeurs une représentation de la virilité comme puissance omnipotente. Cependant, l’insistance d’un Camus sur la douleur de la victime témoigne aussi d’une évolution des moeurs : montrer les conséquences tragiques d’un viol révèle publiquement la gravité de l’attentat sexuel. Qu’une femme, pour prouver ou sauver sa chasteté, n’ait d’autre choix que la mort, manifeste combien ce crime attente non seulement à la morale, mais à la paix et à l’ordre d’une société qui se veut chrétienne. Plus que la condamnation subreptice des victimes, nous voyons, dans l’alternative entre chasteté ou mort, la pression d’un humaniste chrétien pour changer mentalités et moeurs, et pour faire entendre que c’est par la prise en compte (et en conscience) de l’autonomie du désir de l’autre qu’une société peut se libérer de la malédiction de la violence.
Appendices
Note biographique
Professeure à l’Université de Nantes, Nathalie Grande s’intéresse depuis sa thèse (Stratégies de romancières, de Scudéry à Lafayette, 1999) à la question de l’accès des femmes à l’écriture, aux genres qu’elles pratiquent, à leur place dans le champ littéraire du xviie siècle. Pour aider à la connaissance des autrices, elle a organisé différents colloques (en particulier sur Mme de Villedieu) et a édité certaines de leurs oeuvres, par exemple Mathilde de Madeleine de Scudéry (Honoré Champion, 2002) ou, plus récemment, Les amours des grands hommes de Mme de Villedieu (STFM, 2016). Mais la question des femmes en littérature l’a aussi amenée à s’interroger plus généralement sur les liens réciproques entre littérature et société, sur la manière dont la mixité pouvait changer la culture, en particulier à travers l’étude du phénomène galant (Le rire galant. Usages du comique dans la fiction narrative de la seconde moitié du xviie siècle, 2011). Autrice d’une cinquantaine d’articles, présidente de la SIEFAR (Société internationale d’étude des femmes d’Ancien Régime) depuis 2015, elle oriente actuellement ses recherches vers la question de la représentation des autrices dans l’histoire littéraire française.
Notes
-
[1]
Edmond Locard (Le xviie siècle médico-judicaire, Lyon, A. Storck, 1902), cité par Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xxe siècle, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 1998, p. 37.
-
[2]
Nous avons choisi d’exclure de notre étude les nouvelles de Marguerite de Navarre, où plusieurs cas sont évoqués, car une thèse a été consacrée à ce sujet : Patricia Cholakian, Rape and writing in the Heptaméron of Marguerite de Navarre, Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press, 1991.
-
[3]
Dans la première nouvelle, le roi Édouard iii d’Angleterre tente d’abord de séduire la comtesse de Salberic, en vain ; alors, usant tour à tour des prières et des menaces, il fait pression sur elle en faisant intervenir son père, puis sa mère ; enfin, il réussit à la mettre en son pouvoir, et c’est parce qu’elle lui demande, l’épée à la main, de la tuer, qu’il renonce à son projet criminel pour… lui proposer le mariage (Pierre Boaistuau, Histoires tragiques [1559], éd. Richard A. Carr, Paris, Société des Textes Français Modernes, 2008, p. 11-46).
-
[4]
Matteo Bandello, Novelle, Paris, Les Belles Lettres, 2008. Aux viols pourraient être ajoutés les enlèvements, puisque le rapt est souvent un euphémisme pour désigner le viol. Dans ce cas, ce sont trois nouvelles supplémentaires qu’il faut mentionner : i, 20 ; ii, 6 ; ii, 15. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle BNo, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[5]
François de Rosset, Histoires tragiques [1614], éd. Anne de Vaucher Gravili, Paris, Librairie générale française, 1994, p. 353-364. Cette édition reproduit la troisième édition du recueil, la dernière revue, corrigée et augmentée par Rosset.
-
[6]
Jean-Pierre Camus, « Le violement », L’amphithéâtre sanglant [1630], éd. Stéphan Ferrari, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 360-366.
-
[7]
Jean-Pierre Camus, « L’amour de la liberté », Divertissement historique [1632], éd. Constant Venesoen, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2002, p. 188-190. Il s’agit d’une jeune Sicilienne, enlevée lors d’une razzia par les Turcs, qui, par sa ruse, réussit à se faire donner la mort, évitant ainsi très chrétiennement le péché de suicide.
-
[8]
Jean-Pierre Camus, « La brillante chasteté », Les spectacles d’horreur [1630], éd. Nicolas Cremona, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 95-97. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle SH, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
-
[9]
Franck Greiner (dir.), Fictions narratives en prose de l’âge baroque. Répertoire analytique (1611-1623), Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 1213.
-
[10]
François de Rosset, Histoires tragiques, ouvr. cité, p. 353.
-
[11]
Sur cette tolérance, voir Stéphanie Gaudillat Cautela, « Le corps des femmes dans la qualification du “viol” au xvie siècle », dans Cathy McClive et Nicolle Pellegrin (dir.), Femmes en fleurs, femmes en corps. Sang, sexualités, du Moyen Âge aux Lumières, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, coll. « L’école du genre », 2010, p. 249-276.
-
[12]
Jean-Pierre Camus, L’amphithéâtre sanglant, ouvr. cité, p. 364.
-
[13]
Jean-Pierre Camus, « La vengeance féminine », Les entretiens historiques [1639], dans Christian Biet (dir.), Théâtre de la cruauté et récits sanglants en France (xvie-xviie siècle), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2006, p. 300.
-
[14]
Jean-Pierre Camus, Les entretiens historiques, ouvr. cité, p. 300.
-
[15]
François de Rosset, Histoires tragiques, ouvr. cité, p. 364.
-
[16]
Jean-Pierre Camus, Divertissement historique, ouvr. cité, p. 190.
-
[17]
Et dont les auteurs ont facilement tendance à se croire innocents. Voir Jean-Claude Chenais, Histoire de la violence en Occident, Paris, Robert Laffont, 1981, p. 145.
-
[18]
Pierre Boaistuau, Histoires tragiques, ouvr. cité, p. 44.
-
[19]
Comme nous avons vu, le gentilhomme victime fait le choix de quitter le monde, tandis que sa fiancée va chercher la pénitence et la mort dans un couvent. C’est encore le cas pour l’héroïne du « Violement » chez Camus.
-
[20]
Lucrèce explique son geste en disant que si elle se disculpe de la faute, elle ne s’exempte pas du châtiment (« Ego me etsi peccato absolvo, supplicio non libero », Tite-Live, Histoire romaine, livre i, chapitre lviii, 10).
-
[21]
Jean-Pierre Camus, Divertissement historique, ouvr. cité, p. 190.
-
[22]
Outre « La brillante chasteté » évoquée dans cet article, on trouve aussi « La sanglante chasteté », dans L’amphithéâtre sanglant, ouvr. cité, p. 192-199 ; et Camus avait déjà donné ce titre à un de ses premiers romans : Parthénice, ou peinture d’une invincible chasteté, histoire napolitaine (Paris, C. Chappelet, 1621). La chasteté en tant que valeur fondatrice de la vie chrétienne, manifestant par le renoncement aux satisfactions immédiates le désir d’un accomplissement de l’être dans l’au-delà, a toujours été valorisée par la théologie morale, qui l’a placée très haut dans sa hiérarchie des valeurs. Dans sa forme radicale, la virginité, elle a été présentée comme une forme de réalisation terrestre accessible de l’idéal chrétien ; selon Thomas d’Aquin, « l’état de virginité » présenterait des « convenances surnaturelles et [… une] intime relation avec l’état de perfection » (voir l’article « chasteté » dans Jean Michel Alfred Vacant et Eugène Mangenot (dir.), Dictionnaire de théologie catholique, Paris, Letouzey et Ané, 1902-1950).
-
[23]
Pour éclairer les débats autour des causes de ce changement, voir Franck Greiner, Les amours romanesques de la fin des guerres de religion au temps de L’Astrée (1585-1628). Fictions narratives et représentations culturelles, Paris, Honoré Champion, 2008, p. 57-82.
-
[24]
Juridiquement, le viol a même pu être assimilé à un vol commis par un homme sur une propriété [la femme !] appartenant à un autre homme. Voir Stéphanie Gaudillat Cautela, « Questions de mot. Le “viol” au xvie siècle, un crime contre les femmes ? », Clio. Histoire femmes et sociétés [En ligne], no 24, 2006, mis en ligne le 1er décembre 2008, consulté le 13 mars 2017, URL : http://clio.revues.org/3932).
-
[25]
Ainsi Rosset ne semble pas partager autant de sollicitude pour la victime, et semble même reprocher au gentilhomme agressé de ne pas avoir choisi de mourir plutôt que de subir : « Hélas, disait-il, que je fus bien couard et pusillanime quand, pour crainte d’une chose qu’il faudra que j’éprouve un jour nécessairement [il était menacé de mort par ses agresseurs], j’ai perdu mon honneur ! Aurais-je bien le courage de me présenter désormais à mes parents, ayant fait une telle brèche à ma réputation ? Non ! Il faut que j’expie par une autre pénitence un si grand défaut, puisque j’ai fait perte de la gloire qu’avec tant de travaux j’avais recherchée » (François de Rosset, Histoires tragiques, ouvr. cité, p. 363-364).
-
[26]
Pierre Boaistuau, Histoires tragiques, ouvr. cité, p. 196.
-
[27]
Pierre Boaistuau, Histoires tragiques, ouvr. cité, p. 196.
-
[28]
Audrey Gilles-Chikhaoui, « Se souvenir du viol de Lucrèce : plaisir et chasteté chez Lorenzo Valle, Castiglione et Marguerite de Navarre », Le Verger [En ligne], no iv, juin 2013, p. 1-19, consulté le 14 mars 2017, URL : http://cornucopia16.com/blog/2014/07/28/audrey-gilles-chikhaoui-se-souvenir-du-viol-de-lucrece-plaisir-et-chastete-chez-lorenzo-valla-castiglione-et-marguerite-de-navarre/.En particulier, A. Gilles-Chikhaoui montre comment « l’ambivalence du viol ne vient pas tant de celle qui le subit, mais de celui qui le juge » (p. 9).
-
[29]
Voir par exemple dans Francion : « Quoiqu’elle déguisât sa volonté, je connus bien où elle voulait tendre, et lui donnai tant d’assauts qu’à la fin elle se rendit » (Charles Sorel, Histoire comique de Francion [1623], dans Romanciers du xviie siècle, éd. Antoine Adam, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1958, p. 266). Sur ce sujet, voir Christophe Martin, « De la théorie du moment à l’hypothèse du viol », dans Susan Van Dijk et Madeleine Van Strien-Chardonneau (dir.), Féminités et masculinités dans le texte narratif avant 1800 : la question du “gender”. Actes du xive colloque de la SATOR, Louvain, Éditions Peeters, 2002, p. 308-317 ; ainsi que Stéphanie Gaudillat Cautela, « Le corps des femmes dans la qualification de “viol” au xvie siècle », dans Cathy McClive et Nicole Pellegrin (dir.), Femmes en fleurs, femmes en corps. Sang, santé, sexualités du Moyen Âge aux Lumières, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 2010, p. 270. Pour information, on ajoutera que, selon une enquête IPSOS de novembre-décembre 2015 pour l’association « Mémoire traumatique et victimologie », deux Français-es sur dix estiment que beaucoup de femmes disent « Non » alors qu’elles veulent dire « Oui », et le même pourcentage pense qu’une femme peut avoir du plaisir à être forcée (mis en ligne le 2 mars 2016, consulté le 14 mars 2017, URL : http://www.franceinter.fr/depeche-viol-les-non-que-les-francais-nentendent-pas).
-
[30]
Alexandre Sylvain Van Den Bussche, Épitomes de cent histoires tragiques [1581], dans Christian Biet (dir.), Théâtre de la cruauté, ouvr. cité, p. 90-91.
-
[31]
A priori seulement, puisque la nouvelle de Camus, « Le ravisseur », a montré qu’on pouvait cumuler les deux peines : faire épouser puis faire exécuter.
-
[32]
Alexandre Sylvain Van Den Bussche, Épitomes de cent histoires tragiques, dans Théâtre de la cruauté, ouvr. cité, p. 91.