Résumés
Résumé
Le concept de développement durable s’est considérablement popularisé depuis la parution du rapport Brundtland il y a presque 25 ans. S’il faut sans doute l’opérationnaliser pour le faire entrer dans le quotidien des agents, il reste au fond un concept mou aux origines aussi lointaines que protéiformes. L’objet de cet article est de faire état de la longue série de débats sur le rapport de l’homme à la nature en économie : de Malthus aux conceptions faibles et fortes du développement durable. On verra que si ces débats illustrent l’opposition maintes fois renouvelée entre partis de l’optimisme et du pessimisme, tous ont surtout régulièrement fait valoir des arguments sensés ou intelligibles, au point de contribuer ensemble à faire progresser l’analyse économique du développement durable autour de ce que l’on peut désormais concevoir comme deux traditions s’enrichissant in fine l’une de l’autre : l’économie de l’environnement et des ressources naturelles d’un côté, et la plus récente écologie économique de l’autre.
Abstract
Since the publication of the Brundtland Report more than 20 years ago, sustainable development became always more popular. If it is probably necessary to operationalize it more effectively in order to foster its daily perception by people, sustainable development remains a soft concept since the beginning because its sources are both old and various. Our purpose in this paper is, first of all, to reconstitute the long history about relationship between men and nature in economics, from Malthus writings up to weak and strong conceptions of sustainability. We shall see that these debates exhibit a continuous opposition between optimistic and pessimistic parties and, moreover, considering that each party has reasonable arguments to oppose to the other, each of them had finally contributed to foster the economic analysis of sustainable development around which can be now considered as two kind of traditions: environmental and resources economics on one hand, and ecological economics on the other.
Corps de l’article
Introduction
Le développement durable tel qu’il a été popularisé depuis la parution du rapport Brundtland (1987) est sans conteste un concept mou. Son ambition générale consiste à réunir trois dimensions dans les faits souvent contradictoires qui le prêtent inévitablement à toutes les critiques : (1) l’efficacité et la sécurité économiques, (2) l’équité et la justice sociale et enfin et surtout (3) l’intégrité écologique. Comme le relèvent Sneddon, Howarth et Norgaard (2006 : 260), il est successivement perçu comme « une ruse, autrement dit une façon de détourner de leurs aspirations et besoins légitimes les populations marginalisées du monde au nom d’un développement vert » et sous-entendu : qui ne profiterait qu’aux riches; ou comme un concept naïf qui ignore « les rapports de pouvoir et la structure du système économique international, contraignant et déformant même les politiques les mieux intentionnées »; ou enfin, comme un concept « anthropocentrique incapable de dissoudre l’illusoire barrière que l’on a érigée entre la sphère humaine des activités économiques et sociales et celle écologique qui les porte ».
S’il faut de fait l’opérationnaliser davantage pour le faire entrer dans le quotidien des agents et espérer infléchir le regard de ses détracteurs les plus radicaux (Howarth, 2007)[1], cela n’exclut pas de tenter d’en situer les origines lointaines, dans une longue tradition d’interrogations maintes fois renouvelées sur le rapport de l’homme à la nature.
En effet, si les craintes concernant la dégradation de l’environnement se sont accrues depuis le rapport Brundtland (1987), au point d’occuper aujourd’hui une place centrale, les premières interrogations remontent à l’époque déjà ancienne qui vit une partie du monde entrer dans une phase remarquable de son histoire, qualifiée depuis de révolution, avec son lot de conséquences humaines et sociales mais aussi et déjà environnementales. Les premières réflexions quant aux effets de ce bouleversement sans précédent sur la nature et sa capacité à soutenir durablement une telle « accélération de l’histoire », datent de cette même époque où l’économique, alors économie politique, s’affirme en tant que discipline, portée par ce phénomène unique sur tous les plans. Ainsi, dès l’origine l’économique doit affronter la question du rapport de l’homme à l’environnement, même de façon détournée, et cette question dut-elle être longtemps restée au second plan, en creux d’une question sociale alors légitimement première. Signe pourtant que la discipline est bien née avec cette problématique, c’est sur la conviction que la terre ne pourrait porter l’humanité industrieuse naissante que Malthus (1798) nous interpellait il y a plus de 200 ans.
Le premier objet de ce travail sera de faire état, même sommairement, de l’évolution de la question du rapport de l’homme à l’environnement dans le champ de l’économie au cours des deux siècles passés. Nous tenterons de faire ressortir les figures maintes fois renouvelées de l’optimisme ici et du pessimisme là, optimisme et pessimisme n’ayant, sans surprise, jamais quitté le débat, plus encore qu’autour de la question sociale. Nous nous abstiendrons de trancher dans ce débat qui n’admet pour l’heure aucune solution tant l’incertitude est grande et tant il est au fond encore souvent affaire de conviction : entre une vision clairement confiante du rapport de l’homme à son milieu et une autre bien plus pessimiste, parfois fataliste.
Ce faisant, et ce sera notre objet principal, nous essaierons plutôt de montrer que si l’économie de l’environnement et des ressources naturelles peut mettre ses connaissances au service du débat démocratique sur « notre avenir commun », pour reprendre les termes du rapport Brundtland, en offrant analyses, études, méthodes et, à travers elles, en ouvrant un espace de discussions raisonnées à opposer aux discours simplistes en faveur de la croissance ou de la décroissance, elle doit toutefois continuer à s’enrichir de sa confrontation avec l’économie écologique en attendant de percevoir pour l’heure ce à quoi pourrait ressembler une possible synthèse.
Partant, nous adhérerons à l’avertissement lancé par Fitoussi et Laurent (2008 : 11) pour qui, « ici comme ailleurs, il est nécessaire de se défaire du fantasme d’une science économique intégrée, cohérente et disposant d’une réponse unique aux problèmes qui lui sont posés », partageant l’idée que la nécessité de trouver des modes de « régulation externe », faisant intervenir la puissance publique et en amont le jeu démocratique, par opposition à la seule « régulation interne » ou autorégulation oblige à situer la question du développement durable dans le champ de l’économie politique au moins autant que dans celui de l’analyse moderne.
L’article est organisé de la façon suivante. Dans une première partie nous exposons les thèses des tenants des approches les plus fortes de la soutenabilité et nous tentons d’extraire les traits saillants de ce qu’on pourrait appeler le « parti du pessimisme », des origines à nos jours. La deuxième est dévolue à l’exposé des approches les plus faibles et de ce que l’on pourrait appeler le « parti de l’optimisme ». Par-delà la lecture critique que nous en proposerons dans les deux cas, nous verrons que chaque camp ayant des arguments à faire valoir, on comprend que chacun ait trouvé ses partisans et, mieux, que dépassés les excès chacun ait évolué vers plus de mesure en s’enrichissant des critiques faîtes par l’autre.
Mais avant, nous voulons clore cette introduction en positionnant clairement la problématique soulevée par le concept de développement durable de façon à mieux faire ressortir ensuite les oppositions entre « optimistes » et « pessimistes » quant à la préservation des ressources et de l’environnement en général.
L’analyse économique à l’épreuve de la durabilité : position du problème
Compte tenu du nombre considérable de définitions données au concept de développement durable — Pezzey (1989) en recensait déjà près d’une quarantaine[2], avant que Godard (1994) ne tente d’en dresser un premier « paysage » et que Vivien (2003) n’en pose les premiers « jalons » —, le plus raisonnable est sans doute de renvoyer à celle lancée il y a plus de 20 ans sur la scène internationale par la commission Brundtland : le développement durable devait permettre de « répondre aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Si l’on notera avec Rotillon (2008) que cette définition est vague puisque la notion de besoin reste délicate à circonscrire, on reconnaîtra que la transcription qu’en a faîte Pezzey (1989) dans des termes plus familiers de l’économie n’en reste pas moins large et en tout cas ouverte : est durable tout sentier le long duquel le bien-être de chaque génération est au moins égal à celui de la précédente (Ut ≥ Ut-1 ∀t). Au-delà du glissement sensible du registre des besoins à celui du bien-être, une telle définition soulève en effet à ce stade autant de questions qu’elle n’apporte de solutions.
Si elle permet d’éviter de faire des conjectures sur le bien-être des générations non encore nées, puisqu’il suffit de connaître les niveaux de bien-être atteints par chaque paire successive (t, t – 1) pour se prononcer, la situation reste en réalité complexe. Il est une première difficulté qui tient à la possibilité même de mesurer le bien-être des générations présentes. On peut bien sûr tenter de lever cette difficulté en sondant les agents, avec les limites classiques d’un tel exercice. On peut de même se livrer à une analyse de leurs motifs de satisfaction et procéder alors à une estimation de l’état des grandeurs qui y contribuent. Quoi qu’il en soit, et levés les obstacles techniques, reste la question consistant à savoir s’il est vraiment possible de procéder à des comparaisons d’utilité intergénérationnelles, l’économie s’interdisant ailleurs de faire des comparaisons interpersonnelles.
En admettant qu’on en fasse partager l’idée aux générations vivant à une même date, au motif, (1) que les techniques employées pour évaluer leur bien-être sont les mêmes, (2) que sans comparaisons entre générations, toute question sur la durabilité d’un processus semble vaine, et (3) qu’il y a déjà une procédure d’agrégation quand on raisonne sur un collectif, une génération, et donc sur une préférence sociale qui masque des différences interpersonnelles, on reste soumis au risque suivant : constater à un moment donné qu’une génération subit une baisse de bien-être mais sans qu’on n’y puisse plus rien. Observer en effet, le long d’un sentier, que Ut est régulièrement supérieur à Ut – 1 n’indique pas que les niveaux futurs le seront toujours.
Confronté alors à ce double principe de réalité qui veut, (1) que l’on ne peut spéculer sur la forme que prendra le bien-être des générations futures et, (2) qu’une comparaison empirique pas à pas du bien-être des générations n’offre aucune garantie de durabilité, une façon d’aborder le problème tient alors dans l’adhésion à un principe de responsabilité vis-à-vis des générations futures (Jonas, 1979), articulé à un critère de justice empruntant un raisonnement analogue à celui imaginé par Rawls (1971), mais ici dans un cadre intergénérationnel. En clair, chaque génération doit successivement se plier à l’exigence consistant à se placer « sous le voile de l’ignorance », donc à faire abstraction de sa position et à imaginer qu’elle aurait pu apparaître n’importe quand dans le futur, pour se poser alors la question suivante, qui revient à l’impératif moral classique consistant « à se mettre à la place d’autrui » : de quelles conditions minimales aimerions-nous hériter pour avoir la chance la plus élevée de jouir de telles et telles opportunités? Et réciprocité oblige : de quoi aimerions-nous que chaque génération hérite à son tour pour jouir d’un espace d’opportunités au moins aussi appréciable que le notre (Howarth, 1997)? Questions qui obligent alors à arbitrer entre impératifs éthiques et économiques (Toman, 1994) et à concevoir l’environnement comme une « copropriété entre générations » (Henry, 1990).
Ces questions qui interpellent chaque individu et chaque génération posent bien en tout cas celle de notre responsabilité partagée pour préserver « l’espace des possibles » de celles et ceux qui nous succèderont, ce que résume très justement Godard (2005 : 21) : « la responsabilité des générations présentes n’est pas de préjuger des préférences des générations futures, mais de préserver la possibilité pour ces générations d’exercer leurs propres préférences ».
Là où les différences apparaissent…
Si l’idée d’un principe de responsabilité vis-à-vis des générations futures peut être partagée par le plus grand nombre, là où les différences apparaissent tient aux réponses que les uns et les autres apporteront aux questions suivantes : que faut-il, au fond, transmettre aux générations futures? Doit-on en particulier se fixer des normes ou des règles, par exemple de préservation de tels et tels stocks de ressources, forme de « capital naturel critique » à conserver? Peut-on à l’inverse compter seulement sur l’accumulation et la transmission d’artefacts et de connaissances pour écarter une issue défavorable? Question qui renvoie à la croyance, ou non, en la capacité des progrès scientifique et technique à écarter toute trajectoire qui compromettrait à un moment ou à un autre l’avenir des générations futures.
Au-delà, quand on se livre à une forme d’introspection des convictions des uns des autres, là où les différences apparaissent tient dans l’opposition entre la plus ou moins grande incrédulité des uns quant à la possibilité même que l’humanité puisse s’autoréguler pour éviter une dure correction de la nature et, à l’inverse, dans la plus ou moins grande confiance des autres quant au fait qu’elle trouvera les moyens d’échapper à ce destin.
On verra ainsi émerger un « camp » optimiste, allant d’un optimisme forcené à un optimisme plus mesuré mais néanmoins convaincu que l’homme a les ressources pour se déjouer de la nature; les premiers comptant uniquement sur le génie humain et les forces spontanées du marché, les autres sur l’action publique tout en demeurant globalement confiants.
À l’inverse, on verra émerger et perdurer à des degrés divers et variés un camp pessimiste, allant des plus résignés et fatalistes aux plus simples incrédules, convaincus dans l’ensemble que l’humanité sera tôt ou tard rattrapée par la nature, sauf si, et dans le meilleur des cas, elle accepte des changements radicaux. C’est de ce côté que se situe Malthus, raison pour laquelle nous entamerons la partie suivante consacrée à la présentation des principales figures du camp pessimiste par l’exposé de ses idées.
1. Du pessimisme ou de la raison? Complémentarités, irréversibilités, capital naturel critique, éthique et soutenabilité forte
Nous le disions en introduction, les préoccupations de l’économie quant aux capacités de la terre à répondre durablement aux besoins humains remontent à l’époque même où elle s’est instituée en tant que discipline. Si tout n’a pas commencé par là, et si cette préoccupation n’a ressurgie de façon prégnante qu’à intervalles irréguliers, elle fût pourtant très tôt au coeur de la discipline. En atteste la parution de l’essai retentissant de Malthus (1798) qui reste bien, par-delà les vives polémiques qu’il suscita dès le XIXe siècle (Proudhon, 1849), le premier d’une série qui dessineront ensemble une vision pessimiste du rapport de l’homme à la nature.
Ainsi, de Malthus (1798) à Meadows et al. (1972), en passant par Jevons (1865) ou encore Georgescu-Roegen (1971) et ses épigones partisans de la décroissance (Ariès, 2005, 2007; Grinevald, 2005; Latouche, 2006, 2007; Cheynet, 2008), on en reviendra toujours à la même crainte, voire à la même conviction : que la nature ne puisse porter tous les hommes avec leur multitude de désirs sans cesse renouvelés car savamment entretenus et qu’il faille alors, au risque que la nature n’opère une tragique correction, s’imposer diverses formes d’autocontrôle, voire de décroissance, tant démographique que matérielle; et sans certitude d’ailleurs que cela suffise. Que ces formes soient alors conformes à l’austère esprit malthusien ou qu’elles soient la source d’une vie véritablement heureuse, comme chez Stuart Mill (1848) puis Daly (1972, 1974, 1977), apparaîtra presque secondaire.
Voyons cet ensemble de réflexions que l’on peut toutes qualifier, même à des degrés divers, de pessimistes, et dont l’aboutissement institutionnel sera la naissance de cette nouvelle branche de l’hétérodoxie qu’est l’économie écologique (Costanza, 1989), campée sur une vision forte du développement durable (Bergh, 2001).
1.1 Malthus–Jevons–Meadows et al. : une trilogie désolée sur les limites de la terre
Parmi les pères fondateurs de l’économie, Malthus (1798) est le premier à avoir abordé, sinon le problème des limites absolues de la terre, en tout cas celui de la possible inconséquence humaine. Son Principe de population expose ainsi que « lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle, elle (…) croît selon une progression géométrique » (p. 10), alors même que « les moyens de subsistance (…) ne peuvent jamais augmenter à un rythme plus rapide que celui qui résulte d’une progression arithmétique » (p. 11).
On connaît alors le moyen que prêchait Malthus pour éviter une résolution naturelle (la famine) ou politique (la guerre) de ce premier conflit envisagé entre l’homme et la nature : la vertu. Vertu ainsi indispensable sans laquelle, écrivait-il dans la première édition de son essai (Dostaler, 2000), qu’« un homme (…) né dans un monde déjà possédé, s’il ne peut obtenir de ses parents la subsistance qu’il peut justement leur demander, et si la société n’a pas besoin de son travail, n’a aucun droit de réclamer la plus petite portion de nourriture et, en fait, il est de trop ». Avant de clore par une formule restée célèbre : « au grand banquet de la nature, il n’y aura pas de couvert vacant pour lui. Elle lui commande de s’en aller (…) » (p. 112).
À travers cette position contre ceux jugés alors en surnombre, il y a très tôt l’idée que si l’humanité ne s’autocontrôle pas, soit si elle ne se fixe aucune limite a priori, elle sera de toute façon rattrapée par celles de la terre. En ce sens, Malthus est bien le premier à avoir engagé une réflexion sur la capacité de la terre à soutenir durablement les activités humaines, dût-il n’avoir envisagé le problème qu’au niveau de ses capacités nourricières, ce qui est compréhensible à l’époque. Notons toutefois que Malthus n’a pas envisagé que la population et la terre puissent avoir des limites en tant que telles, puisque si la population devait s’en tenir à croître au rythme des denrées, la terre devait pouvoir accueillir une infinité d’êtres humains. Et si ayant été témoin de la transition démographique il lui était difficile d’imaginer qu’elle ne serait justement que transitoire, comme le dit Georgescu-Roegen (1975) « son erreur réside dans l’hypothèse implicite que la population peut croître au-delà de toute limite (…) pour autant qu’elle ne croisse pas trop rapidement » (p. 366).
Ce qui fait alors de Malthus le fondateur du camp pessimiste, c’est surtout sa conviction que science et technique seules resteront impuissantes face à la démographie et au désir plus large de l’humain de s’étendre toujours plus. Et si on élargit les notions de science et technique à celles que peut offrir l’économie en tant que discipline, son pessimisme inspirera la conviction des tenants des acceptions fortes du développement durable, et a fortiori de la décroissance, qu’elles n’éviteront pas plus aux hommes un destin tragique si on ne les éduque pas ou, tout au moins, si on ne les amène pas philosophiquement à une autolimitation rapide et forte. C’est en ce sens que le plaidoyer de Malthus pour l’enseignement d’une morale religieuse stricte, seul moyen de contrer les penchants inconsidérés de l’humanité (Vilquin, 1998), sera annonciateur des approches les plus fortes qui reproduiront toutes cette peur du « nombre incontrôlé » qui traverse au fond l’humanité depuis toujours (Le Bras, 2009).
Dépassées, au moins provisoirement, les premières inquiétudes au plan alimentaire, la question des limites de la terre va resurgir au XIXe siècle, mais cette fois, et signe des temps, au plan industriel. Compte tenu de l’urgence du besoin de développement, après que nombre d’agents soient venus nourrir les agglomérations en formation, la perspective que la société industrielle naissante soit stoppée en plein cours constituait alors une menace certaine pour la stabilité du corps social. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre les craintes exprimées aux Communes anglaises à propos du traité Chevalier-Cobden de 1860, dont certains redoutaient qu’il ruine l’Angleterre en accélérant inutilement l’épuisement de ses réserves en charbon. C’est ce que l’on nomma la Coal Question et qui inspira le titre d’un célèbre ouvrage à Jevons (1865).
Jevons partit du constat en apparence paradoxal que la consommation de charbon du Royaume-Uni n’avait cessé d’augmenter à mesure que la machine de Watt prenait place dans le paysage industriel britannique, en remplacement de celle pourtant moins efficace inventée 57 ans avant par Newcomen. Compte tenu du saut technique les séparant, il s’attendait à ce que le besoin par machine baissant, la demande et le prix du charbon en firent autant. Or, constatant une hausse et reprenant un raisonnant ricardo-malthusien, Jevons fit le pronostic que la couronne irait s’appauvrissant, car si la hausse créait bien une incitation à découvrir/exploiter de nouveaux gisements, ceux-ci seraient toujours plus pauvres et/ou moins rentables, les hommes exploitant en premier les plus riches et/ou faciles d’accès, et le prix du charbon ne cesserait de monter. Il (Jevons, 1865 : 213) en tirait la conclusion que l’avance de l’Empire « [était]physiquement intenable », terminant en ces termes : « nous avons aujourd’hui à faire le choix entre une brève période de grandeur et une autre, plus longue, de médiocrité continue » (en italiques dans le texte). Propos au ton alarmiste, dans la continuité de Malthus, et que l’on retrouvera presque intact dans le rapport Meadows et al. (1972) dont nous allons désormais évoquer les tenants et aboutissants.
C’est à la demande du Club de Rome qu’une équipe du MIT se constitue en 1970 pour évaluer les limites naturelles à la croissance. Les résultats seront réunis dans un rapport qui paraît en 1972 et qui prend fait et cause pour un arrêt de la croissance. Cette conclusion retentissante repose sur un modèle conçu alors pour appréhender cinq tendances jugées d’intérêt mondial : l’accélération de l’industrialisation, l’accroissement de la population, la progression de la malnutrition, l’épuisement des ressources et la détérioration de l’environnement. Ce qu’il faut retenir, c’est que les simulations conduisent toutes à des prédictions pessimistes sur l’avenir du système mondial, même dans le cas de scenarii optimistes en matière d’économie de ressources ou de recyclage. Au mieux serait-il viable jusqu’en 2100, mais au-delà, l’humanité connaîtrait un déclin, voire un effondrement, traduit par une baisse de la population et une dégradation des conditions de vie des survivants. Les conclusions sont ainsi sans appel (Meadows et al., 1972 : 23) : « si les tendances actuelles (…) restent inchangées, les limites de la croissance (…) seront atteintes en gros dans les 100 prochaines années. Le résultat le plus probable sera une forme de déclin soudain et incontrôlable, à la fois de la population et des capacités industrielles ».
S’il est prématuré d’avancer qu’ils se sont totalement trompés puisque leur pronostic porte sur la fin du siècle[3], relevons un trait qui les inscrit dans le camp pessimiste, c’est la certitude que les progrès scientifique et technique n’y changeront rien :
nous avons montré (…) que l’emploi de la technologie sur les problèmes apparents de l’épuisement des ressources, de la pollution ou encore de la pénurie alimentaire n’aura aucun impact sur le problème clé qu’est celui d’une croissance exponentielle dans un système fini et complexe. Mêmes nos tentatives (…) les plus optimistes (…) n’ont pas permis de repousser l’effondrement du système au-delà de 2100
Meadows et al., 1972 : 145
Et les auteurs de préconiser alors d’aligner la natalité sur la mortalité dès 1975, de limiter la consommation de ressources et l’émission de polluants au ¼ du niveau de 1970, de transférer des capitaux vers l’agriculture pour conserver les sols, de recycler les déchets, d’étendre la durée de vie des machines, de domestiquer l’énergie solaire et enfin de stopper la croissance industrielle dès 1990. En cela, Meadows et al. (1972) renouvèlent-ils le voeu fait 130 ans avant par Stuart Mill en faveur d’un étatstationnaire, point de départ de la section qui vient.
1.2 Stuart Mill—Daly : une parenthèse enchantée autour de l’État stationnaire
Compte tenu de notre ancrage dans une réalité qui s’est caractérisée presque sans discontinuer par un prélèvement croissant sur la nature, on peine à matérialiser ce que peut être un tel état. Conceptuellement, l’idée est de parvenir à un état où toutes les grandeurs naturelles, économiques, démographiques, sont en situation de maintien indéfini et où l’homme ne prélève que les flux requis pour maintenir, de fait indéfiniment, tant son niveau de capital et sa consommation que les stocks de ressources; ce qui suppose que les prélèvements n’excèdent jamais ou pas durablement les capacités de renouvellement du milieu.
Si la possibilité d’un état stationnaire reste concevable, on a surtout construit autour de cette figure des rêves de société idéale et conviviale à la manière de Stuart Mill, voire de Daly, et moins souvent donné un contenu précis à ces projets. Ainsi comprend-t-on Georgescu-Roegen (1979 : 117) quand il écrit, renvoyant à Robbins (1930), que « (…) l’état stationnaire est enveloppé de tant d’ambiguïtés que chacun devrait aller jusqu’à spécifier le niveau particulier d’un tel état ».
Voyons néanmoins ce qu’en ont dit Stuart Mill et Daly, le premier il y a plus de 160 ans sur fond de révolution industrielle, le second dans le contexte qui entoura la parution du rapport Meadows, après quoi nous rendrons compte de l’apport radical de Georgescu-Roegen (1979) en faveur de la décroissance.
Le livre IV, chapitre VI des Principles of Political Economy de Stuart Mill (1848) s’intitule précisément « De l’état stationnaire ». Il s’y emploie à exposer les raisons d’ordre éthique et philosophique qui militent en faveur d’un arrêt de la croissance matérielle, au profit d’une vie alors tournée vers la contemplation et l’épanouissement personnel, grâce à la poursuite d’activités spirituelles et culturelles rendues possibles par l’emploi des progrès scientifique et technique à la réduction du temps de travail. Stuart Mill entame son propos en regrettant que l’économie se soit attelée à comprendre le développement pour mieux l’accélérer, mais sans jamais s’être arrêtée sur sa finalité. Ainsi écrit-il (Stuart Mill, 1848 : 452) : « en contemplant n’importe quel mouvement progressif (…), l’esprit ne peut se satisfaire de retracer simplement les lois de ce mouvement; il ne peut l’être qu’en se posant la question qui vient après : dans quel but? ». Poursuivant la réflexion ouverte par la question du pourquoi, il fait alors entendre sa différence en se montrant critique envers ses homologues du passé et en affirmant que l’état stationnaire est aussi souhaitable qu’incontournable. Ainsi regrette-t-il que (idem : 452) « l’impossibilité finalement d’échapper à l’état stationnaire (…) [ait] été vue par les économistes politiques des deux dernières générations comme une décourageante et déplaisante perspective », indiquant alors que (idem : 452) « ce serait dans l’ensemble un progrès considérable en regard de notre condition actuelle », avant d’ajouter (idem : 453) : « (…) le meilleur état pour la nature humaine est celui dans lequel, alors que plus personne n’est pauvre, plus personne ne désire non plus être plus riche, ni n’a aucune raison de craindre d’être relégué à l’arrière par les efforts déployés par d’autres pour se propulser devant ».
On notera alors le caractère socialement figé de l’état stationnaire rêvé par Stuart Mill, où non seulement les grandeurs économiques devront être stables, mais où la structure sociale devra elle-même l’être à terme, ce qui suppose de mettre fin en amont à la compétition/rivalité entre individus. Cette incidence est cohérente avec le désenchantement qu’il éprouvait face à la lutte à laquelle se livrait sous ses yeux l’humanité industrieuse naissante, écrivant ainsi :
je confesse que je ne suis guère enchanté par l’idéal de vie défendu par ceux qui pensent que l’état normal de l’humanité est de lutter sans cesse pour s’en sortir, et que cette mêlée où l’on se foule aux pieds, où l’on se coudoie, où l’on s’écrase, où l’on se marche sur les talons et qui forme le type de la société actuelle, soit le lot désirable du genre humain, au lieu de n’être rien d’autre qu’un ensemble de symptômes désagréables d’une des phases du progrès industriel
Stuart Mill, 1848 : 453
Après avoir exposé les joies que l’homme pourrait éprouver à occuper son temps d’une autre façon qu’à travailler pour s’enrichir, il réaffirme son désir de voir se réaliser l’état stationnaire comme meilleure garantie contre des pertes naturelles irréversibles et comme garde-fou contre une vie peut-être plus riche matériellement, mais moins heureuse humainement :
si la terre doit perdre une large part des aménités qu’elle tient de choses qu’une accumulation illimitée de richesses et de population lui extirperaient dans le seul but de soutenir une plus grande, mais pas meilleure, ni plus heureuse population, j’espère sincèrement pour la postérité que [les hommes] seront contents de parvenir à la stationnarité bien avant que la nécessité ne les y soumette
Stuart Mill, 1848 : 454
Poursuivant la réflexion ouverte par Stuart Mill sur le sens du développement et la nécessité d’aboutir à une forme choisie d’état stationnaire, Daly en sera le nouveau soutien à travers une série d’articles (Daly 1972; 1974a et b), puis à travers un livre manifeste (Daly, 1977). Pour Daly (1974a : 15),
un état stationnaire (…) est défini par des stocks constants de richesse physique (ou artefacts) et par une population constante, tous deux maintenus à des niveaux choisis désirables par de faibles flux — c’est-à-dire par un faible taux de natalité, équivalent au taux de mortalité, et par de faibles taux de production physique, équivalents aux taux d’usure —, de sorte que la longévité de la population et la durabilité des stocks physiques soient élevées
À travers l’idée de taux nuls auxquels doivent croître les stocks, on retient surtout qu’il s’agit d’une vision normative portée par un dessein qualitatif : faire durer en somme le plus possible, et la richesse matérielle, le capital, et chaque génération, la vie, sans en augmenter le nombre. Au final, il apparaît que l’état stationnaire de Daly est, comme chez Stuart Mill, un idéal-type relevant plus de l’impératif moral et de la direction à prendre que de la définition précise d’un état réellement stable de l’économie. C’est ce que trahit ici l’idée de « niveaux choisis désirables » et ce que confirme le rapprochement qu’il fait ailleurs avec le stade de stationnarité, également supposé, des êtres vivants arrivés « à maturité » (Daly, 1972) : maturité naturelle chez ceux du règne animal et végétal, consciente et réfléchie, et donc à fondement éthique, chez l’humain, même s’il entretient sans cesse une confusion biologisante à ce sujet, mais qui n’est pas surprenante si on se souvient que l’économie fait pour lui partie des sciences de la vie (Daly, 1968). C’est dans ce cadre en tout cas qu’on doit comprendre sa charge contre l’obsession d’une croissance quantitative indéfinie, qu’il qualifie de « manie », et dont serait affublée la plupart des économistes; ceux qu’il range en tout cas, pour mieux les brocarder, sous le qualificatif d’orthodoxes, taxés de dogmatisme obscurantiste, au-delà de leur nécessaire conservatisme politique (Daly, 1974b).
Sans aborder ici la difficile question consistant à savoir si tous les descendants de l’École néo-classique, ou plus simples tenants du marginalisme et de l’individualisme méthodologique si décriés par Daly, sont conservateurs, relevons au moins, par-delà le flou de ses écrits, qu’il reste intéressant car les critiques qu’il adresse à « l’orthodoxie » constitueront, avec celles de Georgescu-Roegen que nous allons voir, le point de départ de l’économie écologique (Costanza, 2003; Røpke, 2004).
1.3 Georgescu-Roegen et ses épigones militants de la décroissance : d’une conviction aux joies d’une « obligation »
Georgescu-Roegen (1975) va aller plus loin en dénonçant à la suite de Robbins (1930), nous le disions, l’incapacité des promoteurs de l’état stationnaire à le qualifier précisément, de Stuart Mill jusqu’à Daly ou Meadows et al. Nicholas Georgescu-Roegen (NGR par la suite) le qualifiera ainsi de « mythe du salut par l’écologie » et pis, « d’erreur cruciale » qui « consiste à ne pas voir que non seulement la croissance, mais même un état de croissance nulle, voire un état déclinant qui ne convergerait pas à l’annihilation, ne peut durer dans un environnement fini (p. 367) ».
Tentons de saisir sa position résolument pessimiste où l’on voit que même la décroissance restera un pis-aller qui ne pourra qu’ajourner la fin inéluctable de l’humanité. NGR part du principe que la terre peut au mieux offrir un montant S fini de ressources. Notant si le flux prélevé chaque année au profit de chaque habitant et Pi la population mondiale de l’année i, il relève à juste titre que le cumul des prélèvements mondiaux jusqu’à l’infini (Σ Pi ⋅ si avec i = 0 à ∞) ne peut excéder le montant S offert à la surface de la terre : ΣPi ⋅ si ≤ S. Posant alors que le montant prélevé chaque année par habitant ne pourra jamais s’annuler ni même tendre vers 0 (si >> 0, ∀i), il ne peut qu’en déduire qu’il arrivera fatalement une date n, sur l’infini, où la population Pi devra disparaître (Pn = 0, ∀i ≥ n) pour respecter ladite contrainte (Σ Pi ⋅ si ≤ S). On comprend dans ces conditions que l’état stationnaire soit pour lui un leurre et, pire encore, que la décroissance qu’il appellera pourtant de ses voeux, faute de mieux, n’y pourra rien.
Sa démonstration n’est pourtant guère convaincante dans la mesure où il entreprend de raisonner sur un horizon infini tout en évacuant les possibilités mêmes ouvertes par un tel horizon; alors qu’elles sont de fait elles-mêmes infinies. En effet, si à observer la marche suivie par l’humanité depuis l’industrialisation et la consommation de masse on est tenté de le suivre, puisqu’on peine à imaginer qu’un jour le prélèvement par tête pourra tendre vers 0, conceptuellement pourtant, rien ne l’exclut. S’agissant notamment de l’énergie, rien indique que dans un futur même assez éloigné, mais par définition antérieur à l’infini, l’énergie ne sera pas totalement renouvelable. Et si on peine davantage à voir comment on pourra pratiquement cesser un jour de prélever des ressources minérales, conceptuellement au moins, on peut également envisager que dans un futur éloigné mais toujours et nécessairement inférieur à l’infini, elles seront remplacées par des matières issues du vivant, potentiellement indéfiniment renouvelables.
Ainsi, NGR a-t-il voulu nous alerter sur le fait que l’homme prélève en l’état trop de matières, au risque d’être un jour confronté à de graves difficultés. Mais sa conviction que la disparition de l’humanité est programmée repose sur un argument qui n’exploite pas les possibilités mêmes qu’il ouvre. Sans doute faut-il y voir la marque de son adhésion au second principe de thermodynamique qui stipule l’irréversibilité des phénomènes physiques (NGR, 1971 et 1975), ou sa conviction que toutes les espèces devant disparaître, l’homme n’a a priori aucune raison d’y échapper (NGR, 1975), subsiste en tout cas une incohérence interne à sa démonstration qui étonne pour un mathématicien de formation; au point de trahir un degré de pessimisme et plus, de fatalisme, sans égal jusqu’ici. Pour autant, par-delà le caractère intenable de sa position à l’échelle de l’infini qui réduit la portée de son plaidoyer en faveur d’un « état déclinant » ainsi qu’en faveur d’une « bioéconomie » (NGR, 1975 et 1978), sa pensée reste le point de départ des partisans de la décroissance que nous allons désormais évoqués.
Il n’est pas simple de camper les positions des tenants de la décroissance dans la mesure où il s’agit d’abord souvent d’appels à changer nos modes de vie en profondeur, à travers l’adoption de nouvelles « philosophies du quotidien », tournées vers la sobriété ou la simplicité volontaire. Au-delà de l’objectif général consistant à cesser de produire, consommer et accumuler toujours plus, pour réduire au contraire nos productions, consommations et autre accumulation de biens et services, il n’est pas de cadre d’analyse théorique vraiment construit, ou au moins mobilisé, pour montrer quels pourraient être les voies de la décroissance et surtout, pour en évaluer les effets. Un grand nombre veut éviter les accès idéologiques qui ont conduit aux aberrations que l’on sait et se refuse de proposer un système de pensée et de valeurs totalement abouti. Ainsi, veulent-ils souvent en rester au rang des exemples à suivre pour léguer aux générations futures une terre qui leur permette d’éprouver la joie d’une « vie authentiquement humaine » (Jonas, 1979). Ainsi Martin (2007 : 19) indique que « (…) la décroissance [lui] apparait comme un concept purement pédagogique », ajoutant « [qu’elle] a le mérite de frapper les esprits et de remettre en lumière l’ineptie suicidaire sur laquelle repose la société industrielle et marchande ».
Pour autant, par-delà ces déclarations compréhensibles, voyons plus avant les positions des promoteurs les plus remarqués de la décroissance pour avoir dépassé le seul stade du réveil des consciences.
Au-delà de répéter à l’envi l’argument de NGR consistant à dire qu’une croissance infinie est impossible dans un monde fini (position discutable sauf à poser une hypothèse qui n’a guère de sens sur horizon infini), les principaux tenants de la décroissance essayent d’abord de dire ce qu’elle est ou n’est pas. Le fait de se placer dans une perspective résolument politiste comme Ariès (2005, 2007), voulant déséconomiser nos modes de pensée, ou de naviguer entre économie et politique en condamnant la première mais sans jamais vraiment trancher au profit de la seconde comme Latouche (2006, 2007), qui oppose ainsi économique et politique comme au fond marché et démocratie, n’aidera pas à sortir de la confusion dans laquelle leur parti pris ou leur incapacité de trancher les a enfermés sous couvert de dénonciation de l’économisme[4].
Suite à un premier ouvrage très polémique (Ariès, 2005), et voulant porter plus loin les bases d’un projet politique, Ariès (2007 : 11) prend soin de préciser que la décroissance n’est ni une idéologie, ni un modèle économique de plus, mais « d’abord un mot-obus pour pulvériser la pensée économiste dominante ». Pour autant, et contraint à la nécessité de préciser sa pensée compte tenu des limites associées à ses définitions par la négative (ce que la décroissance n’est pas), il ajoute : « le seul moyen est de réduire l’économie elle-même (…) ». Bien qu’il reste assez confus sur le fond, il y a bien l’idée qu’il faut nous préparer à réduire nos niveaux de vie matériels, soit accepter une décroissance quantitative. Cela parait évident sachant ses charges violentes contre la croissance, même s’il faisait valoir dans un précédent ouvrage (Ariès, 2005), et sans se démentir ici, qu’il était d’accord avec Latouche pour dire que la décroissance n’est pas une croissance négative[5].
Si Latouche (2006 : 16-17) assume d’emblée que « la décroissance n’est pas un concept (…) mais un slogan politique », ajoutant qu’elle est la « bannière derrière laquelle se regroupent ceux qui ont procédé à une critique radicale du développement (…) », il livre dans son opus suivant une définition par la négative qui soulève maintes interrogations. Ainsi indique-t-il (Latouche, 2007 : 21) que « la décroissance (…) n’est pas la croissance négative (…) » et qu’« [on] imagine quelle catastrophe engendrerait un taux de croissance négatif! ». Compte tenu là aussi de ses charges contre la croissance où il n’est question que d’« enfer », nous offrant à ce titre un catalogue de tous les maux dont elle serait seule responsable[6], son intention est-elle plus simplement de dénoncer notre dépendance à la croissance, ce que l’on peut penser quand il écrit plus loin : « de même qu’il n’y a rien de pire qu’une société travailliste sans travail, il n’y a rien de pire qu’une société de croissance dans laquelle [elle] n’est pas au rendez-vous ».
À défaut d’être très limpide sur la qualification précise de la décroissance, Latouche expose un programme en 8 R où il est question de réévaluer, reconceptualiser, redistribuer, restructurer, relocaliser, réduire, réutiliser et recycler, problématiques néanmoins pas toutes antiéconomiques par définition, au sens où l’économie n’aurait rien à dire sur ces questions, même si les pratiques restent en effet souvent en deçà des enjeux.
Il ressort au final qu’Ariès et Latouche peinent à définir clairement la décroissance, pris au piège de leur parti pris antiéconomique leur interdisant de penser l’économique dans toute sa complexité et ses conséquences, par crainte d’être alors eux-mêmes taxés d’économisme. Et si Latouche (2004) avait tôt fait de prévenir « qu’il n’y a pas (…) “de théorie de la décroissance” comme les économistes ont pu élaborer des théories de la croissance », on peut regretter que ses ouvrages ultérieurs, comme ceux d’Ariès d’ailleurs, aient poursuivi dans cette dénonciation de l’économie et appelé en réaction à la décroissance sans jamais prendre le temps d’une analyse rigoureuse de ce qu’elle est et, surtout, de ce qu’elle pourrait entraîner.
Sur ce point, accordons à Cheynet (2008) d’être plus limpide quand il assume clairement que « la décroissance, c’est d’abord la décroissance économique » (p. 59). Ayant probablement senti qu’après avoir décrit la planète dans un état quasi apocalyptique, il ne pouvait plus être question d’hésitations, il plaide pour une décroissance physique au Nord; sans quoi on sera rattrapé par les lois de la nature, avec à la clé une régression sans égal et, tropisme malthusien ou simple réalisme, la perte de la partie la plus pauvre de l’humanité, donc surtout au Sud.
Si cette perspective est d’ailleurs redoutée par de nombreux tenants de la décroissance, la façon dont ils souhaitent nous en prémunir, c’est en tout cas limpide chez Martin (2007) et Latouche (2004, 2006 et 2007), sera de conseiller au Sud de ne pas succomber à la tentation occidentale de la croissance et de l’enrichissement matériels.
Mais avant d’y revenir, Latouche fait valoir qu’un premier moyen de décroître globalement sans subir de décroissance individuelle serait bien entendu que la population mondiale baisse. Ainsi évoque-t-il (Latouche, 2006) que la bonne taille démographique pour la planète serait, comme en 1960, de 3 milliards, quand l’empreinte écologique de l’humanité s’élevait à 1[7]. Sachant que la terre en porte déjà plus du double et qu’elle devrait en compter trois fois plus d’ici 40 ans, on comprend qu’un tel recul mènerait, toutes choses égales par ailleurs, à une décroissance sensible de la pression exercée sur la terre. Pour autant, peut-on imaginer que la population mondiale puisse revenir à une échéance aussi brève à son niveau de 1960, sans que cela n’ait d’autre conséquence que celle positive de soulager la planète? Latouche ne dit rien sur ce que pourrai(en)t être la (les) raison(s) de revenir en douceur à ce chiffre de 3 milliards. Et sauf à penser qu’il croît en la possibilité d’une baisse considérable en raison d’une prise de conscience soudaine et alors inouïe de l’humanité d’être (a priori) en surnombre, on voit mal ce qui nous ramènerait vers cet « idéal ». Le « retour en douceur » s’avère en tout cas si compliqué que la question du « comment » est évacuée.
Ainsi, comme Partant (1988), Latouche ne croît plus, et depuis longtemps, au développement (Latouche, 1989, renouvelé en 2001 et 2004). Il l’honnit au moins autant que la croissance, pour ne plus les distinguer d’ailleurs, dans la mesure où ce serait le moyen « d’occidentaliser le monde », achevant le travail ouvert par la colonisation (Latouche, 1989). Questionnant les notions de richesse et de valeur propres à l’économie, et en profitant au passage pour écorner les indicateurs alternatifs ou complémentaires au PIB que sont l’indice de développement humain, l’indice global de pollution ou encore l’indice de santé sociale (dont on trouvera une présentation dans Gadrey et Jany-Catrice, 2005), il récuse l’idée qu’« une “société hors-croissance” au Sud » la condamnerait nécessairement à la misère, vantant l’idée d’« un projet de construction de sociétés conviviales, autonomes et économes, au Nord comme au Sud » (Latouche 2006 : 242). Et c’est en ce sens qu’on doit saisir ce propos assumé très tôt (p.27) : « Oser la décroissance au Sud, c’est tenter d’enclencher un mouvement en spirale pour se placer sur l’orbite du cercle vertueux des 8 “R” ».
Martin (2007 : 190) est plus explicite encore quand il écrit :
Que pourrait-il arriver de mieux aux habitants des pays pauvres que de voir leur PIB baisser? (...) La hausse de leur PIB ne mesure rien d’autre que l’accroissement de l’hémorragie. (…) Décroître pour les habitants des pays pauvres signifierait donc préserver leur patrimoine naturel, quitter les usines à sueur pour renouer avec l’agriculture vivrière, l’artisanat et le petit commerce, reprendre en main leur destinée commune
On voit bien ce qu’il dénonce ici : la croissance telle qu’on l’a connue et connaît encore est porteuse de nombreux coûts écologiques, outre ceux sociaux et humains liés aux mutations techniques et sociales qui lui sont inhérentes. Mais par-delà cette glorification du passé, son propos reste surtout d’une naïveté désarmante, dans le meilleur des cas d’ailleurs. En effet, n’en déplaisent à Martin ou à ceux plus influents à qui l’on doit ce type d’arguments, au-delà du fait qu’on ne voit pas comment figer le cours de l’histoire — sauf à prendre le risque de dérives autoritaires — la croissance n’a pas que les aspects négatifs qu’on lui prête ici. S’il est clair que lorsque qu’elle est exclusivement quantitative elle s’accompagne inévitablement de pertes écologiques continues, et s’il ne fait aucun doute que l’heure est aux actions d’envergure pour préserver/restaurer ce qui peut l’être et écarter toute issue dramatique, l’antienne selon laquelle elle n’est que destruction, et donc que négative, est aussi stérile que celle consistant à dire qu’elle n’est que bienfait, et donc uniquement positive.
Par-delà la vision radicale et déstabilisante de certains partisans de la décroissance vis-à-vis du développement, où le maintien d’un état de pauvreté paraît être la solution, nous voudrions conclure sur le fait qu’il eut au fond été assez simple pour les tenants de la décroissance d’être bien plus clairs en affirmant qu’ils militent pour une décroissance quantitative, tout en se faisant les défenseurs d’une croissance alors exclusivement qualitative. De ce point de vue, leur slogan « Moins de biens, plus de liens! » est une façon de dire en termes imagés ce que l’économiste résumerait ainsi : oui à la décroissance quantitative — donc moins de biens[8] —, et oui aussi à la croissance mais qualitative — plus d’environnement et de loisirs pour plus de liens[9]. Ce, en gageant qu’il soit possible de parvenir à ce « tout » rapidement sans provoquer de récession durable aux dépens d’abord des plus pauvres, risque suffisamment important pour que certains partisans de la décroissance aient concédé, par précaution, qu’elle ne pouvait être attendue de ces derniers et notamment pas du « Sud ». Comment d’ailleurs pourrait-il en aller autrement, sauf à les exhorter à préférer cette situation plutôt que de céder à « l’enfer de la croissance » sur fond de rejet des notions de progrès et de développement mêlé de « principes philosophiques » audibles mais qui restent, qu’on le veuille ou non, éloignés des préoccupations quotidiennes des plus pauvres.
Au final et comme le note Rotillon (2008), il apparaît que si les tenants de la décroissance ont le mérite d’attirer l’attention sur les dérives de sociétés plongées tout entières, ou presque, dans l’accumulation et l’épanouissement matériels, ils offrent peu de réponses quant aux moyens et rythmes qu’il conviendrait d’emprunter pour sortir de l’enfer qu’ils décrivent. Plus ennuyeux, il est des postures qui restent inaudibles quand on sait, par exemple, que près de 1,1 milliard d’individus, pour l’essentiel au « Sud », n’ont toujours pas accès à l’eau potable et que plus du double ne bénéficient d’aucun système d’assainissement (OMS-Unicef, 2005); systèmes coûteux pour lesquels le préalable est bien d’accepter un certain enrichissement.
Enfin, considérer que l’économie et ceux qui y contribuent, avec une variété d’approches et une richesse de débats souvent ignorées des auteurs de la décroissance, font en quelque sorte partie du problème, comme si une société de sobriété choisie pouvait nous dispenser de penser totalement, malgré les limites de l’analyse, en termes de coûts/avantages, ou comme si cela devait abolir tout système de prix, relève de l’illusion. À ce titre, leur condamnation en bloc du PIB passe totalement sur le fait que c’est d’abord un agrégat, si bien que si certaines de ses composantes sont en effet nocives, d’autres restent utiles à la collectivité. Et l’économie dispose désormais d’un vaste outillage pour montrer comment pénaliser au mieux les premières et soutenir les secondes, de sorte que la croissance soit durablement plus « verte », bref plus qualitative et moins quantitative ou « prédatrice ». De ce point de vue, les attaques répétées des tenants de la décroissance, à la fois contre le PIB et sa croissance, mais aussi, très souvent, contre toute tentative visant à établir de nouveaux indicateurs de richesse par l’amélioration, voire le dépassement, du PIB, sont non seulement peu originales — les inspirateurs de l’EcologicalEconomics comme Daly et NGR en avaient posé les bases dès les années soixante-dix —, mais au-delà, elles ne sont guère constructives et n’aident pas fondamentalement à la décision publique. La naissance de l’économie écologique comme aboutissement institutionnel du camp pessimiste et comme remise en cause de la traditionnelle économie de l’environnement et des ressources naturelles (Bergh, 2001) a de ce point de vue ouvert un espace de débats scientifiques plus argumentés et propres, en tout cas, à interpeller nombre des tenants des approches faibles.
Si les fondements de l’économie écologique restent assez largement holistes et se veulent résolument (éco-)systémiques et interdisciplinaires (Costanza, 1989), la contradiction que l’économie écologique n’a cessé de porter à l’économie dite « stantard » autour de la notion de substituabilité — et par suite, autour de l’idée de capital naturel critique — ou ailleurs quant au rôle et à l’importance du progrès technique, a été d’une efficacité supérieure pour produire, même tardivement, une inflexion sensible du discours jusqu’ici plutôt très optimiste des tenants des approches faibles.
2. De l’optimisme ou de la déraison? Substituabilité, progrès, forces du marché, optimalité et soutenabilité faible
Si l’on considère que l’on a bien quelques obligations vis-à-vis des générations futures — ce que nous laissions entendre en introduction malgré les difficultés soulevées par le principe consistant à s’assurer au mieux que ces dernières ne subiront pas de pertes d’utilité —, on doit alors aborder la question clé de la substituabilité entre ressources naturelles et capital artificiel.
À travers cette question : jusqu’où les ressources et plus largement l’environnement peuvent être remplacés par du capital artificiel ou d’autres ressources naturelles mais alors renouvelables, se joue celle des diverses formes de capital, englobant le matériel (capital physique), l’immatériel (capital humain, connaissances) et le naturel (ressources, environnement), qu’il convient de léguer à chaque génération pour être sûr, à tout le moins au maximum, qu’elles disposeront de l’opportunité d’atteindre un niveau de bien-être au moins équivalent à celui des précédentes. Si on est acquis à l’idée que l’accumulation de capital artificiel en particulier pourra suppléer à la disparition de ressources ici et la dégradation de l’environnement là, sans qu’aucune génération ne subisse de futur appauvrissant ou ne souffre de cette dégradation, on admettra alors que tous ces capitaux sont fongibles et qu’il n’est finalement aucun capital naturel critique à conserver a priori pour le transmettre impérativement aux générations futures.
Sans aller jusqu’à dire que les tenants des approches les plus faibles de la soutenabilité adhèrent aveuglément à l’idée selon laquelle, finalement, on pourrait compenser sans discontinuer toute perte de ressources naturelles ici et, plus encore, toute dégradation de l’environnement là, par l’accumulation sans fin de capital et de connaissances produits à partir de ces ressources au sens large, il reste qu’ils partagent tous l’idée d’une fongibilité élevée des diverses formes de capital et donc d’une substituabilité forte entre ressources naturelles et capital reproductible, physique ou humain[10]. C’est sans nul doute ce qui permet de les classer dans le camp optimiste, acquis à l’idée que le système économique et donc l’humanité sont capables de surmonter la finitude des ressources épuisables et plus encore qu’on trouvera toujours les ressources, et notamment celles de l’économie (Solow, 1974a), pour affronter le problème de la dégradation plus large de l’environnement. Les plus radicaux ou optimistes feront alors totalement confiance à la capacité du marché pour écarter toute issue préjudiciable, en particulier si les droits de propriétés sont clairement définis sur l’ensemble des actifs naturels. Les plus mesurés resteront eux persuadés que cela passe par une action publique mêlant aux institutions juridiques (règles de responsabilité et autres réglementations) diverses incitations pour contenir et/ou corriger les défauts et autres défaillances de/du marché.
L’objet de cette partie consiste à restituer les principaux résultats produits par les tenants de ce que l’on a convenu d’appeler la soutenabilité faible, même s’il faut relever que les premiers travaux dont nous rendrons compte n’évoquaient pas directement le concept de développement durable qui s’est imposé depuis. Leur attention se situait d’abord du côté offre du marché, dans le but premier de trouver une réponse aux défis soulevés par la parution du rapport Meadows sur les limites à la croissance. Comment donc s’assurer qu’on pourra maintenir une production par tête croissante, condition sine qua non de la progression, ou au moins du maintien, de la consommation dans le temps, le bien-être étant alors réduit à sa plus simple expression : satisfaire des besoins de quantité et non de qualité, la durabilité se limitant donc à la non-décroissance du bien-être tiré de la consommation.
Par l’intermédiaire de ces premiers travaux se dessinera toutefois une vision assez optimiste du rapport plus large de l’homme à la nature, au sens où on verra que s’il peut se déjouer de l’épuisement inévitable de certaines ressources, il pourra a priori plus facilement encore gérer la question des ressources renouvelables (forêts, poissons, etc.), ou ailleurs la dégradation de son environnement au sens large (eau, air, sols). Et ce, dût-il y avoir des arbitrages initialement préjudiciables aux ressources ou à l’environnement mais en théorie limités si on pose que les agents sont aussi sensibles à leur environnement. Tel est le fil conducteur qui unifie, même partiellement, les travaux des tenants des approches faibles du développement durable.
Les plus optimistes s’en remettront alors, nous le disions, aux seules forces du marché pour écarter spontanément toute issue préjudiciable et éviter toute perte irréversible, en tout cas dès lors que les agents le veulent; ce qui supposera qu’ils y soient assez sensibles et, en particulier, que leur horizon de calcul s’étende bien au-delà de leur durée de vie sans déprécier par trop le futur pour écarter tout risque de catastrophe tellement imminente qu’elle deviendrait inévitable. Et ce qui supposera, en outre, qu’il n’y ait ni défaut, ni défaillance de marché, donc que les marchés, l’information, les contrats soient parfaits et complets, ensemble de conditions dont on mesure à leur seul énoncé qu’il est peu raisonnable d’attendre qu’elles soient remplies.
Les plus mesurés, bien qu’également assez optimistes sur les capacités de l’homme face à la nature, compteront toutefois sur l’action régulatrice de l’État et/ou sur toute forme d’action organisée pour écarter tout risque de trajectoire insoutenable.
Voyons donc les principaux résultats offerts par le camp optimiste, depuis les travaux fondateurs sur la gestion de ressources épuisables jusqu’aux débats sur de l’existence, ou non, d’une courbe environnementale à la Kuznets.
2.1 Dasgupta et Heal – Stiglitz – Solow : du concours de la substituabilité des facteurs et du progrès technique ou de l’éthique pour déjouer le piège de la finitude des ressources
Les trois articles fondateurs parus en 1974 dans un numéro spécial de la Review of Economic Studies consacré à l’épuisement des ressources fossiles et minérales, sont le fait de Dasgupta et Heal (1974), Stiglitz (1974) et Solow (1974b). Dans chacun de leurs modèles, les ressources sont à la fois indispensables et épuisables, mais le capital leur est indéfiniment substituable. Elles peuvent donc en théorie tendre vers 0 sans nécessairement induire de baisse de la production et in fine, de baisse de la consommation dans le temps. C’est en tout cas possible sous certaines hypothèses que nous allons voir.
Dasgupta et Heal (1974) offrent une excellente introduction au problème, montrant que sans croissance démographique, mais sans progrès technique, une économie qui maximise la somme actualisée au taux ρ > 0 des bénéfices tirés de l’exploitation d’une ressource finie et essentielle à la production est optimalement vouée à sa perte, et ce bien que les conditions de sa durabilité puissent en théorie exister. À une hausse continue de la consommation succèderait donc une baisse régulière, offrant pour horizon indépassable une consommation asymptotiquement nulle à long terme (graphique 1), l’investissement optimal en capital étant insuffisant à contrer l’effet négatif de l’épuisement de la ressource (Pezzey et Withagen, 1998).
Graphique 1
Déclin inéluctable d’une économie dépendante d’une ressource épuisable et maximisant la somme actualisée des niveaux de bien-être des générations
Un tel résultat allait rouvrir le débat déjà ancien sur l’actualisation du bien-être des générations, objet de critiques incessantes depuis Ramsey (1928), Pigou (1932) et Harrod (1948)[11]. Sans entrer dans ce long débat, notons que l’approche de l’utilité escomptée telle que formalisée en premier par Samuelson (1937) a toutefois le mérite d’assurer la consistance dynamique (ou cohérence temporelle) des choix de l’agent (Koopmans, 1960) : ses préférences futures confirment celles exprimées dès à présent en maximisant la somme actualisée de ses utilités; et aucune autre séquence que celle ainsi initialement choisie ne peut alors lui procurer plus de bien-être. En résumé, elle est Pareto-optimale, en tout cas dans cet univers déterministe.
Or, le futur éloigné étant en réalité incertain, Weitzman (1998) a cherché à montrer qu’il n’est pas si incohérent que les agents l’escomptent en réalité souvent à des taux inférieurs à ceux qu’ils appliquent au futur proche (c.-à-d. quand l’horizon de prévision a encore un sens net pour eux). Ainsi, et bien que frappée d’inconsistance temporelle, l’actualisation hyperbolique représente mieux le raisonnement fait par les agents à propos du très long terme et ce pour la raison, note Weitzman (1998), que tout est incertain à cet horizon. L’incertitude la plus fondamentale porte sur le taux d’intérêt, qui reste intrinsèquement imprévisible tant on ignore ce que pourra être la productivité du capital, taux qui n’a au fond aucune raison d’être inféré du passé, ou du présent. Weitzman montre alors que passé un terme au-delà duquel l’incertitude est incontestable, cas courant en matière environnementale, le facteur d’actualisation devrait décliner; et le long terme être alors escompté au taux le plus faible possible ayant une probabilité non nulle de survenir[12].
Pour en revenir au résultat de Dasgupta et Heal (1974), attendu le caractère fort de l’hypothèse consistant à ignorer le progrès technique, Stiglitz (1974) avance de son côté qu’il y a toujours eu accumulation de connaissances, et donc progrès technique, au point qu’il est raisonnable d’imaginer que cela devrait continuer. Si le progrès technique économisant la ressource est alors assez élevé pour compenser les effets liés à son épuisement, ce qui dans le modèle exige qu’il croisse à un taux supérieur au taux d’escompte de l’utilité des générations (ĝ > ρ), alors le sentier de croissance optimale sera forcément durable. Aucune génération ne connaîtra de futur appauvrissant et la consommation ira croissante (graphique 2).
Graphique 2
Croissance optimale d’une économie dépendante d’une ressource épuisable mais bénéficiant d’un taux de progrès technique suffisant
Sous couvert que ĝ > ρ, optimalité intertemporelle et durabilité sont donc conciliables, malgré l’intégration d’une croissance démographique pourtant écartée par Dasgupta et Heal (1974). En outre, on suppose ici tous les gisements connus, ce qui n’est pas toujours vrai. Dasgupta et Heal (1979) travaillerons de fait à la prise en compte de la découverte possible d’un nouveau gisement, Pindyck (1978) ayant même imaginé qu’on en découvre à échéances régulières. Pour autant, le problème de fond demeure : la finitude de ressources pour l’heure essentielles et la nécessité d’enregistrer alors un progrès technique suffisant faute d’alternatives (Solow, 1974a).
Le message rassurant de Stiglitz reste ainsi contesté en raison des hypothèses clés du modèle : celle consistant à postuler, comme souvent alors, un progrès technique exogène allant à un rythme exponentiel[13] et, plus encore, celle considérant que le recours aux ressources dans la production peut tendre vers 0. Si on peut le concevoir à un horizon non nécessairement très éloigné s’agissant des ressources fossiles dans la production d’énergie, c’est plus difficile, en tout cas sur un terme raisonnable, pour d’autres productions. D’aucuns, comme Daly (1997a) ou Cleveland et Ruth (1997) ayant même argué, prolongeant la position de NGR (1971 et 1975) que nous avons discutée, que toute production requerra toujours un minimum de matière et d’énergie non renouvelables et engendrera de même toujours un minimum de rejets/déchets ni assimilables, ni recyclables.
Il semble donc in fine que la vraie question consiste à savoir si la nature laissera le temps à l’humanité de franchir une forme de frontière où l’usage de ressources renouvelables (en remplacement de celles épuisables) et les pollutions émises, seront respectivement durables et assimilables sans qu’on ait à subir de choc violent entre-temps[14].
À défaut de compter sur le progrès technique et plus encore sur la découverte de nouveaux gisements qui ne font que repousser le problème, peut-on envisager de recourir à un principe éthique qui éviterait aux générations futures de connaître l’issue préjudiciable mise en avant par Dasgupta et Heal (1974)? Se plaçant au plan éthique, Solow (1974b) cherche ainsi les conditions qui permettraient, non pas de déboucher sur un sentier de croissance optimale où le bien-être serait toujours croissant (Stiglitz, 1974), mais tel qu’il assurerait a minima un niveau de bien-être maximal à la génération la moins favorisée (principe du maximin). Se disant alors plus « rawlsien que le Rawls », puisqu’il en étend le principe de justice à un cadre intergénérationnel contre l’avis même de Rawls (1971 et 1974), il montre qu’en dépit de l’épuisement progressif d’une ressource essentielle on peut maintenir indéfiniment la consommation d’une population certes stationnaire mais ne bénéficiant d’aucun progrès technique, à condition de mettre en place une dynamique d’accumulation du capital adéquate (graphique 3)[15].
Graphique 3
Maintien de la consommation d’une économie sans progrès technique et dépendante d’une ressource épuisable mais adoptant le principe du maximin
Une condition doit toutefois être remplie : que les ressources contribuent pour moins de moitié à la création de richesse intégrant également du capital[16]. Précisons par ailleurs que c’est en fait à Hartwick (1977) qu’on doit d’avoir explicité la règle d’investissement à suivre pour maintenir ainsi la consommation. Reprenant l’hypothèse d’une production dépendant à moins de 50 % des ressources et renvoyant à Hotelling (1931) quant à l’évolution du prix de ces dernières à mesure qu’on les épuise, il montre que si on investit le montant exact des rentes d’exploitation dans l’accumulation de capital artificiel, on peut garantir indéfiniment aux générations futures un niveau de bien-être matériel égal au nôtre. Cette règle sera étendue au cas de plusieurs ressources par Hartwick (1978a et b) lui-même et le principe fera alors son chemin. Des pays pétroliers comme la Norvège et le Koweït ont en effet créé des fonds d’investissement pour prolonger, même imparfaitement, les bénéfices tirés d’un tel don[17].
Solow (1986) montrera que cette règle revient in fine à « maintenir intact le capital » au cours du temps, quelle qu’en soit les formes : naturelle et/ou artificielle, l’investissement en artefacts devant compenser stricto sensu le désinvestissement lié à l’extraction/usage de la ressource[18]. Et Solow (1986) de renouveler ainsi le vieil adage selon lequel on ne touche pas au capital et on n’en consomme que les intérêts. Pour autant, Svensson (1986) soulignera que Solow pose un taux d’intérêt du capital constant en rupture avec le modèle de Dasgupta et Heal (1974) et, surtout, en rupture avec Solow (1974b). Intégrant bien la baisse de la productivité marginale du capital avec son accumulation, Asheim (1986) montrera de son côté les difficultés liées à la décentralisation de la solution macroéconomique de Hartwick, faisant écho à l’avertissement lancé par Becker (1982) sur la complexité des transferts à mettre en oeuvre.
Avant d’aller plus loin en abordant le cas de travaux qui, par-delà le côté offre du marché, ont tenu compte du fait que les ressources naturelles et plus largement l’environnement peuvent impacter directement l’utilité, revenons sur le fait signalé plus haut que Rawls (1971 et 1974) était contre l’idée d’étendre son principe de justice à un cadre intergénérationnel. À travers cette position s’ouvre un débat utile sur le fait qu’au nom de la volonté d’écarter toute « dictature du présent » telle que mise en avant par Dasgupta et Heal (1974), renouvelant en cela le débat ancien, on l’a vu, sur l’actualisation du bien-être des générations futures, on peut encourager une « dictature du futur » tout aussi discutable.
Ainsi, et abstraction faîte de toute considération environnementale, Rawls (1971 et 1974) fait valoir que l’extension de son principe de justice à l’équité entre générations est inconsistante, car les premières générations étant historiquement les moins favorisées, cela conduirait à les privilégier en permanence par itération, empêchant finalement toute dynamique d’accumulation et donc tout développement. On ne peut alors saisir la volonté de Solow (1974b) de l’avoir étendu à un cadre intergénérationnel que dans la mesure où les générations présentes font a contrario peser un risque sur les suivantes, à mesure qu’elles accumulent du capital : celui de leur léguer un capital naturel toujours plus déprécié du fait même de cette accumulation. Ainsi, si chaque génération successive ne prête aucun égard aux effets environnementaux de ses actes parce que son seul but est de nourrir une accumulation qui lui est d’abord profitable (même si elle profite à toutes), chacune fait alors tour à tour porter le risque aux autres que cette dynamique ne s’arrête un jour pour des raisons écologiques, aux dépens des générations d’alors. Et la situation d’être la plus délicate quand il s’agit d’une ressource non renouvelable, raison pour laquelle Solow (1974b) s’est voulu plus rawlsien que Rawls en étendant quand même son principe à un cadre intergénérationnel, la conséquence dût-elle être, comme Rawls l’avait senti, d’arriver à une situation sans croissance tout aussi problématique.
Voulant sortir de ce piège où pour écarter une dictature du présent on en viendrait à en imposer une à toutes, autrement dit à toutes celles tour à tour suivante et présente qui jouiraient certes d’un environnement durablement préservé mais également durablement pauvre, d’aucuns ont alors cherché les moyens d’éviter de sombrer dans cet excès de précaution et finalement cette « dictature du futur » annihilante. Car s’il est impératif de ne pas compromettre le sort des générations futures, on ne peut toutefois imaginer refuser toute forme de croissance au nom de ce principe, et ce d’autant moins que sous certaines conditions elle demeure possible et sans préjudices futurs (Stiglitz, 1974). L’argument s’entend d’autant plus que si l’humanité future supporte assurément le risque de lourdes pertes, si tel n’est pas le cas en revanche, autrement dit si on s’est montré suffisamment responsable pour écarter a minima le pire sans renoncer à croître, les générations futures bénéficieront en outre de l’accumulation des connaissances passées pour restaurer davantage encore la qualité de leur environnement.
Prenant acte de la nécessité de ne pas tout sacrifier au nom du futur, Chichilnisky (1996) se fixe comme but de trouver un critère qui écarte à la fois la « dictature du présent », mais aussi celle « du futur ». Elle démontre que toute relation de préférence qui respecte un double axiome de non-dictature du présent et de non-dictature du futur peut prendre la forme d’une moyenne pondérée de deux termes : l’un, à hauteur de β ∈ ]0, 1[, est la somme actualisée de l’utilité des générations qui se succèdent indéfiniment; l’autre, à hauteur de 1 – β, est une mesure de l’utilité instantanée à l’infini[19]. Son axiomatique permet de trouver des sentiers de croissance qui évitent le sacrifice des générations futures, sans en imposer un qui soit excessif à celles qui les ont devancées.
Avant d’en venir à l’application de ce critère aux questions qui nous importent ici, puisque le traitement de Chichilnisky (1996) est général, relevons plusieurs limites qui réduisent sa portée. La première tient à la pondération des intérêts présents et futurs : jusqu’où pondérer les uns et les autres? Cette pondération demeurant exogène, les trajectoires pour atteindre le niveau de la règle d’or verte sont aussi nombreuses que les pondérations possibles (Costes, Martinet et Rotillon, 2008). Lecocq et Hourcade (2004) font en outre valoir que le critère de Chichilnisky n’évite pas le sacrifice des générations intermédiaires, quand le système bascule en somme dynamiquement d’une situation où il est surtout tiré par les intérêts présents vers une situation survenant à un terme très éloigné où il est davantage tiré par les intérêts futurs. Au-delà, il ne permet généralement pas d’expliciter des sentiers de croissance optimale, obligeant à recourir à des approches « non standards » (Ayong Le Kama, Le Van et Schubert, 2008 : 4). Il en va ainsi pour trouver une solution au cas des ressources non renouvelables qui nous occupe ici, ce qu’Asheim (1996) avait très tôt montré.
Pour autant, malgré les limites du critère de Chichilnisky (1996), dont l’usage conduit en effet à des sentiers de croissance seulement proches de la trajectoire optimale, reconnaissons avec Figuières et Tidball (2006 : 3) que « (…) c’est de loin le seul (…) qui combine avec succès, Pareto-optimalité au sens faible d’un côté et souci minimal d’équité intergénérationnelle de l’autre ». Enfin, notons que son critère n’a été employé par elle-même (Chichilnisky, 1997) ou par Beltratti, Chichilnisky et Heal (1993; 1994; 1998) qu’à des cas où les ressources sont un argument à part entière du bien-être, et non un simple intrant comme avant.
De fait, venons-en à cette configuration plus en phase avec la notion de développement durable où les ressources affectent explicitement le bien-être des agents, pour voir si le concours de leurs valeurs aménitaires permet de déboucher sur des trajectoires de développement durables. Le premier à avoir envisagé cette possibilité est Krautkraemer (1985). Nous débuterons donc la section qui vient par le rappel de sa contribution qui occupe une place importante dans le paysage campant les visions faibles du développement durable.
2.2 Krautkraemer — Beltratti, Chichilnisky et Heal : du concours des aménités pour préserver les ressources à l’affirmation d’une vision faible du développement durable
Jusqu’à l’article séminal de Krautkraemer (1985), les ressources naturelles n’ont d’autre fin que de servir la production et par suite la consommation, voire plus directement la consommation : modèle de partage du gâteau entre générations à la Hotelling (1931). Mais elles n’entrent pas comme argument à part entière du bien-être des générations. Seuls comptent les flux prélevés à des fins productives (consommations intermédiaires) ou parce qu’ils alimentent directement la consommation finale. Mais les stocks restants en tant que tels n’ont aucun effet sur le bien-être. Il est donc le premier à les intégrer dans l’utilité au même titre que la consommation.
Pour autant, s’intéressant seulement aux ressources non renouvelables, typiquement fossiles et minérales, le fait que les stocks puissent contribuer directement au bien-être ne se comprend qu’ainsi : plus le stock de ressources est élevé, moins les prélèvements l’ont été, et donc moins on a attenté aux paysages à des fins extractives et moins on a généré de pollutions via leur utilisation. Que les stocks contribuent au bien-être jouera donc mécaniquement comme force de rappel pour qu’on en conserve.
C’est donc bien avec Krautkraemer (1985) que le concept de développement durable sera soumis à l’épreuve de l’analyse néo-classique, là où les auteurs précédents se souciaient avant tout, nous l’avons vu, de pérennité de la croissance dans un monde fini. Avoir intégré le fait que les ressources peuvent avoir une valeur d’existence, et non plus seulement instrumentale, ouvrira en effet la voie à des recherches qui renverront mieux au concept de développement durable devant concilier a minima l’économique et l’écologique. Elles montreront en tout cas qu’il n’est pas forcément optimal d’épuiser les ressources et a contrario qu’il est possible, sous certaines conditions, d’en conserver indéfiniment, comme on le verra avec D’Autume et Schubert (2008) ou grâce aux travaux antérieurs de Chichilnisky et ses coauteurs.
Ainsi, alors que les auteurs précédents, Stiglitz (1974) et Solow (1974b) en premier, se voulaient déjà rassurants en montrant que face à une contrainte de finitude absolue des ressources non renouvelables, il est possible d’assurer une croissance continue de la consommation (Stiglitz, 1974) ou au moins de la maintenir dans le temps (Solow, 1974b) — et ce fusse au prix d’une hypothèse de substituabilité indéfinie intelligible seulement sur le long terme —, Krautkraemer montre que si on attache assez de valeur aux stocks restants, et plus précisément aux aménités qui leurs sont indirectement associées, il n’est pas exclu que les générations successives veuillent en conserver indéfiniment. En résumé, Krautkraemer montre que si des ressources ont une dimension aménitaire par-delà leur valeur productive, il est possible qu’on débouche sur des sentiers de croissance optimale qui ne les sacrifient pas intégralement. Pour autant, son résultat ne tient que dans le cas où ces ressources ne sont pas essentielles. Si bien que lorsqu’elles le sont, il reste sous-optimal d’en conserver à long terme et on en revient au résultat de Dasgupta et Heal (1974) : une consommation asymptotiquement nulle et un stock épuisé à long terme, signe d’une utilité nulle pour les générations concernées (graphique. 4).
Graphique 4
L’apport utile mais insuffisant de la dimension aménitaire des ressources quand elles sont indispensables
L’intégration des aménités associées au stock préservé ralentit le rythme auquel on extrait/épuise la ressource, laissant ainsi plus de temps pour trouver une alternative. À défaut d’y parvenir ou encore de bénéficier d’un progrès technique régulier et suffisant, l’issue est donc la même que chez Dasgupta et Heal (1974).
Pour autant, si le planificateur adopte le critère du maximim, il est possible, comme chez Solow (1974b) et Hartwick (1977), de maintenir le bien-être dans le temps. Il faut toutefois à nouveau que les ressources contribuent pour moins de moitié à la création de richesse. Enfin, précisons que l’utilité dépendant de la consommation et du stock de ressources [U(C, S)], les trajectoires des deux arguments pourront prendre des directions opposées sans attenter au maintien de l’utilité dans le temps. En l’occurrence, la consommation ira croissante alors qu’elle restait stable chez Solow/Hartwick, et le stock de ressources ira lui décroissant jusqu’à être de nouveau épuisé à long terme. Les désaménités iront donc forcément croissantes mais les générations futures jouiront en contrepartie d’une évolution favorable de la consommation au cours du temps. En clair, à niveau de bien-être équivalent, les premières seront plus pauvres mais jouiront d’aménités supérieures, alors que les suivantes trouveront dans une consommation supérieure une forme de compensation aux désaménités également supérieures.
Ce résultat est suffisa mment important pour qu’on s’y arrête. Il a d’un côté, et plus encore que le précédent (où l’on notait que l’intégration des aménités pouvait différer la date d’épuisement d’une ressource, laissant plus de temps pour s’y préparer), une dimension rassurante : à défaut d’être assuré de disposer un jour d’une backstop technology[20], on sait au moins que face à la contrainte indépassable de finitude de certaines ressources essentielles, on pourra garantir un niveau constant d’utilité aux générations, comme chez Solow/Hartwick. A contrario, il a cela de préoccupant qu’on en est à nouveau réduit à épuiser la ressource et à accepter de facto que les désaménités soient maximales et seulement compensées par plus de confort matériel. Ce résultat, pour l’heure assez réaliste historiquement, pose en tout cas parfaitement les bases de la durabilité faible où on s’accommode de plus de richesses et de moins d’environnement. Et l’issue ne pourra alors différer que si les agents ont des préférences à élasticité de substitution entre consommation et stock de ressources (ou capital naturel) très faible.
Ainsi, et toujours sous l’hypothèse d’adhésion au maximin, D’Autume et Schubert (2008) montrent que si l’utilité est à élasticité de substitution constante et faible, on débouche sur des sentiers dont l’issue n’est pas d’épuiser la ressource; et cet effet conservatoire d’être d’autant plus net que l’utilité tend davantage vers la forme Leontief où la consommation et les ressources apparaissent toujours plus complémentaires aux agents.
En résumé, sous couvert, (i) d’adopter un principe éthique comme le maximin, (ii) que les ressources non renouvelables soient une source de bien-être à part entière et plus, (iii) que leur destruction ne puisse être compensée aisément aux yeux des agents, on peut déboucher sur la préservation indéfinie d’une part des ressources, soit sur une forme de développement durable. Il ressort donc de ces recherches une impression rassurante qui les positionne du côté optimiste puisque la destruction des ressources, et donc la conjonction plus de consommation/moins d’environnement, n’est pas inéluctable. Disons au moins que si la conservation d’un stock de capital naturel n’est toujours pas une fin en soi — puisqu’elle reste tributaire ici des goûts des générations, en tout cas telles qu’on se les représente — ces travaux ont le mérite de montrer, et c’est déjà significatif, qu’il n’y a pas d’incompatibilité formelle entre bien-être économique et écologique à long terme. Soulignons en outre que les ressources prises en compte jusqu’ici sont non seulement essentielles à l’atteinte d’un certain niveau de bien-être matériel, mais elles n’ont de surcroît aucune capacité d’autorégénération; à quoi on devrait ajouter qu’on a, en plus, ignoré ici toute forme de progrès technique.
Tenir compte du simple fait que moultes ressources prélevées à des fins productives se caractérisent par un renouvellement naturel donnera une raison supplémentaire de croire qu’il est possible, sinon de les préserver avec certitude, disons d’y parvenir en théorie plus facilement dès lors qu’on ne les sollicitera pas continûment au-delà de leurs capacités à se régénérer[21].
Beltratti, Chichilnisky et Heal (1993, 1998[22]) abordent ainsi le cas de ressources renouvelables servant la production industrielle comme consommations intermédiaires et sources de bien-être à part entière. En supposant qu’elles se renouvellent suivant une loi logistique définie entre 0 (la ressource est épuisée) et Smax (son maximum), la régénération atteint son plus haut quand le stock vaut Smax/2. Les auteurs établissent alors les conditions sous lesquelles on peut converger, le long d’un unique sentier, vers un état stationnaire ayant les propriétés d’un point de selle caractérisé de la façon suivante : les prélèvements y sont indéfiniment égaux au renouvellement, assurant de fait le maintien indéfini du stock à un niveau positif, et même supérieur à Smax/2 sous conditions[23]. Le stock préservé S* surclassera en l’occurrence d’autant plus Smax/2 que le taux d’escompte de l’utilité des générations futures sera faible et/ou que les générations valoriseront fortement la ressource dans leur utilité. Et si l’actualisation devait même être nulle, on convergerait vers l’état stationnaire de la règle d’or verte, où (cf. graphique 5) le stock préservé serait d’autant plus élevé (S*rov > > Smax/2) et la consommation d’équilibre d’autant plus faible (C*rov < C*).
Graphique 5
L’effet positif du caractère renouvelable de certaines ressources indispensables à la production et sources d’aménités
Ainsi est-il possible, sous conditions, de déboucher sur un état où on préserve indéfiniment un niveau positif de ressources à des fins écologiques (S*), tout en bénéficiant d’un niveau positif de consommations matérielles (C*).
Soulignons toutefois que le processus de convergence n’opère que si la productivité marginale des ressources prélevées baisse fortement, configuration possible mais incertaine. Autant on conçoit qu’il puisse en aller ainsi pour le capital ou le travail — dont les productivités peuvent parfois baisser assez fortement à mesure qu’on les emploie —, autant on en est moins sûr pour certaines ressources, en tout cas pour celles qui alimentent les procédés industriels. Entendons ici que si en matière agricole par exemple, la productivité marginale des terres peut chuter rapidement avec l’extension des surfaces cultivées — c’est d’ailleurs à partir de ce constat que Ricardo (1817) formula sa théorie de la rente différentielle —, s’agissant en revanche de nombreuses ressources renouvelables comme le bois par exemple, qui entre dans la production de papier, ou ailleurs de biens mobiliers et immobiliers, on voit mal ce qui pourrait expliquer que sa productivité chute fortement à mesure qu’on l’emploie comme simple consommation intermédiaire. Ces ressources ont en effet une productivité marginale constante en tant que matières « inertes » incorporées aux procédés, si bien que seul un large gaspillage pourrait expliquer que leur productivité chute fortement, condition requise ici pour gagner l’état stationnaire, alors même que le gaspillage ne devrait en théorie pas exister en situation optimale.
Si paradoxal qu’apparaisse ce résultat, où la convergence vers l’état préservant indéfiniment des ressources ne pourrait se produire que si les premières générations devaient durablement en gaspiller, il reste à certains égards assez réaliste et donne lieu alors à deux lectures : l’une réaliste mais optimiste, l’autre plus critique. Du côté du réalisme, il est vrai que c’est souvent après avoir dénoncé des gaspillages qu’on a tenté d’y remédier. À ce titre Beltratti, Chichilnisky et Heal (1993; 1998) sont assez rassurants puisqu’ils montrent qu’en dépit de ces gaspillages, on converge vers un état stationnaire où le stock de ressources préservé est au moins égal à la moitié de celui que la nature pourrait au mieux supporter. Cette vision fait écho à ce que l’on nomme courbe environnementale à la Kuznets, mais nous y reviendrons. À l’inverse, ce résultat peut être perçu négativement puisque c’est finalement grâce au gaspillage de ressources qu’on converge vers l’état qui les préserve indéfiniment; au risque alors de franchir un seuil critique irréversible sans qu’on le mesure toujours (cf.infra).
Si l’explicitation des conditions sous lesquelles écarter le risque d’extinction d’espèces par surexploitation fait partie des préoccupations placées au coeur du développement durable, une autre dimension tient à l’accumulation de polluants dont les effets sont souvent moins immédiats mais aussi néfastes à la préservation à long terme des espèces en question.
C’est à cette question que se sont attelés Beltratti, Chichilnisky et Heal (1994), prenant acte du fait que si des ressources/espèces peuvent disparaître par surexploitation, d’autres, parfois les mêmes, le peuvent également mais sans qu’on les prélève, des seules suites de la pollution. Leur travail aborde ainsi le cas d’une ressource-espèce dont le stock affecte le bien-être pour ses valeurs aménitaires, et plus largement écologiques, qui est dégradée par les pollutions liées à la consommation[24]. On notera l’analogie avec le cas précédent où l’épuisement partiel de la ressource (sa « dégradation ») tenait aux prélèvements opérés sur son stock. La modélisation étant proche, les enseignements le seront aussi. Ainsi, l’étude à long terme de l’économie fait ressortir qu’on peut conserver indéfiniment un niveau positif de la ressource amoindrie par la pollution, sous réserve que cette dégradation, et la pollution qui en est à l’origine, n’excèdent pas sa capacité à se régénérer. Pour autant, cette issue n’est pas plus automatique qu’avant et ne se réalisera que si l’attention portée au futur est assez élevée. On mesure donc à nouveau les risques liés à un excès de négligence des intérêts futurs, en tout cas au plan éthique. En effet, la production étant en effet ici indépendante des ressources, les générations futures ne seraient au fond pas acculées à un futur appauvrissant. Elles seraient même plus riches. En revanche, elles n’auraient pas d’autre choix que de trouver dans ce surcroît matériel une forme de compensation à l’extinction de la ressource.
Si la pollution reste une menace pour la biodiversité, elle l’est aussi à travers ses effets plus immédiats sur la santé : gênes, voire maladies, liées à la pollution de l’air, de l’eau, des sols et donc des aliments. Cette question s’est de fait imposée comme objet d’étude à part entière, abstraction faîte des canaux par lesquels la pollution attente aux agents. Ce sera l’objet du point suivant, en notant au préalable que si Chichilnisky, Beltratti et Heal (1995) ont eux-mêmes abordé cette question de la pollution au niveau global, et non plus à travers ses seuls effets sur telle ou telle espèce, le traitement reste moins convaincant que dans leurs autres travaux. Reprenant le même type de modèle, mais conférant aux ressources environnementales, à l’eau, l’air, la terre, le double statut de ressources productives et d’actifs environnementaux — au sens où elles servent dans tous les procédés de production et sont, ensemble, constitutives de notre environnement en tant que tel —, ils intègrent ces actifs à la fois dans l’utilité des agents et dans la production. La difficulté provient néanmoins du fait qu’on ne sait pas vraiment ce que recouvre la grandeur qui entre ainsi intégralement dans la production et l’utilité. Présentée comme un stock d’actif environnemental (eau, air, terre) dégradé par les pollutions liées à la consommation, on reste gêné par le fait que la production dépende alors de (au sens de : utilisé chaque année) l’intégralité desdits stocks et non seulement des flux prélevés sur ces derniers, tels ceux opérés sur les ressources/espèces évoquées auparavant. Leur modèle conçu pour traiter du risque d’extinction d’espèces par surexploitation et/ou surpollution supporte ainsi assez mal l’extension à l’étude de la préservation de l’environnement au sens large, question traitée dans la section qui vient, réservée à des travaux mieux outillés sur ce point.
2.3 De la dégradation de l’environnement par voie de pollution à l’amorce d’une inclination du parti optimiste en direction d’approches plus fortes du développement durable
C’est à Keeler, Spence et Zeckhauser (1972) que l’on doit d’avoir ouvert ce champ de recherche considérable consistant à étudier les liens entre croissance économique d’un côté et dégradation de l’environnement par la pollution de l’autre. Ils devancent d’ailleurs les premiers travaux sur la gestion optimale et si possible durable des ressources non renouvelables dus à Dasgupta-Heal, Solow et Stiglitz en 1974, travaux que nous avons abordés en premier pour la raison qu’ils eurent initialement plus d’écho, en lien avec les préoccupations du moment : la crainte que l’essor industriel soit stoppé par l’épuisement de certaines ressources, notamment fossiles; à quoi il faudrait ajouter qu’ils eurent un retentissement très fort parce qu’ils ouvraient de façon saillante la voie aux acceptions faibles du développement durable au terme desquelles, on l’a vu, il ne devait pas nécessairement y avoir de capital naturel à conserver a priori.
Ce bref rappel fait, soulignons, comme l’indiquent Brock et Taylor (2004 : 2), que « la littérature étudiant le lien entre croissance et environnement est énorme », si bien que « toute revue doit faire des choix d’exclusion difficiles ». Le nôtre consistera à nouveau à préférer mettre en perspective quelques travaux importants, tant historiquement que parce qu’ils dessinent ensemble le cheminement d’une recherche foisonnante, plutôt que de risquer l’empilement de nombreuses références que leur rapprochement en une courte section rendrait artificiel.
Nous procéderons alors au découpage suivant : nous débuterons par l’analyse d’articles ayant intégré le fait que les flux polluants peuvent nuire au bien-être des agents. Nous poursuivrons avec ceux qui tiennent compte du fait que nombre d’entre eux (CO2, SO2, NOx...) s’accumulent dans l’environnement. Nous verrons ensuite, comme nous l’avions fait s’agissant des ressources, en quoi le progrès technique ou l’éthique peuvent permettre de déboucher sur des sentiers de développement durable. Nous étendrons alors la revue aux travaux qui notent que s’il est effectivement des externalités négatives, il en est d’autres, positives et sources de croissance endogène, qui donnent quelques raisons d’être optimiste. Nous nous arrêterons enfin sur deux derniers ensembles de travaux qui ont pour caractéristique d’être plus complexes, mais aussi et surtout, propres dans certains cas à tempérer l’optimisme, même relatif, qui pourrait se dégager des travaux précédents. L’un renverra à des articles faisant le lien entre pollution et ressources naturelles, qu’il s’agisse de lier explicitement la première à l’usage des secondes (le problème de l’extraction se doublant ici de celui de la pollution) ou encore de voir comment la pollution peut nuire à des ressources-espèces utiles à la production et/ou sources d’aménités. L’autre aura trait à des travaux qui soulignent que la nature est faite de non-linéarités et autres discontinuités (effets de seuil et de cliquet) dont les conséquences possibles (hystérèse et irréversibilités) sont propres à juguler tout excès d’optimisme. Enfin, un dernier point abordera la littérature, surtout empirique, relative à l’existence ou non de courbes environnementales à la Kuznets, de manière à avoir une première impression des risques réels d’insoutenabilité à moyen/long terme.
2.3.1 Flux de pollution et bien-être
Commençons avec Forster (1973) qui aborde la question du contrôle optimal de flux polluants à l’aide d’un modèle où la production dépend in fine du capital et sert à la fois à la consommation, à l’investissement et enfin à la réduction des émissions liées à l’accumulation du capital. La pollution est donc consubstantielle au développement économique, elle est un produit fatal, puisque toutes choses égales par ailleurs, et hors dépenses de dépollution en particulier, les flux vont sans cesse croissants avec la dynamique d’accumulation menant à l’état stationnaire. Ces flux sont naturellement nuisibles au bien-être des agents qui prennent a contrario plaisir à consommer. Le fait que les générations éprouvent ainsi une désutilité liée à la pollution conduit l’économie à converger vers un état stationnaire où la consommation et le capital d’équilibre sont inférieurs à ceux associés à une situation où elle serait purement ignorée. Reste ensuite à décentraliser l’optimum social pour financer le niveau requis de dépollution.
Gruver (1976) cherche la partition optimale entre investissement à réserver à l’accumulation de capital et investissement devant servir au contrôle des émissions. Il pose, comme Forster, que seuls les flux impactent le bien-être mais les relie de son côté à la production, la pollution restant ainsi un produit fatal de l’activité économique. La politique optimale consiste alors à diriger en premier lieu l’investissement vers l’accumulation de capital, puis à le réorienter vers la lutte contre la pollution, à mesure de sa progression avec le développement de l’économie.
2.3.2 Stock de pollution et bien-être
Le problème plus épineux encore de l’accumulation de nombreux polluants conduit à se tourner vers Keeler, Spence et Zeckhauser (1972) qui l’ont abordé en premier. La pollution y est aussi un sous-produit inéluctable de l’activité et, plus encore, elle entretient une relation 1 à 1 avec la production selon l’idée que l’économie crée des biens qui finiront tôt ou tard en déchets. Si ceux-ci sont alors en partie assimilés par l’environnement, ils peuvent aussi l’être socialement. En clair, par-delà leur dégradation naturelle pure et simple, une partie peut être traitée grâce à des dépenses de dépollution. Leur travail fait ressortir l’émergence de deux états stationnaires également optimaux mais diamétralement opposés : l’un dit « d’âge sombre » fait apparaître un niveau de capital (et donc de production) élevé, associé à une dépense nulle en dépollution. Si la consommation n’en est que plus grande, le stock de pollution l’est aussi. L’autre, dit « d’âge d’or », a des caractéristiques inverses : la dépollution étant positive et la consommation de fait inférieure, le stock de pollution stationnaire n’en est que plus faible.
Ce qui fixe l’issue entre ces deux équilibres tient à la productivité marginale de la technologie de dépollution. Si elle est élevée, cela vaut en somme la peine de dépolluer et l’on débouche sur la configuration d’« âge d’or »; et inversement si elle est faible. Bien que l’article n’en traite pas explicitement, on mesure l’importance de la qualité de la R&D en matière de traitement des polluants et déchets. Plus elle est élevée, plus l’on dispose de techniques efficaces, et plus la probabilité de dépollution effective et donc d’« âge d’or » à long terme est élevée.
Pour mieux se représenter ce qu’induit le fait de tenir compte de la pollution, recourons à Ploeg et Withagen (1991), où les émissions dépendent de la production et s’accumulent en un stock assimilé naturellement à un taux s qui peut artificiellement être impacté par des dépenses en dépollution[25]. L’utilité étant positivement liée à la consommation et négativement à la pollution, ils offrent la solution à deux problèmes d’optimisation : dans le premier les générations ne sont sensibles qu’aux flux polluants, dans le second aux stocks. Pour autant, les conclusions restent qualitativement proches : les consommation et capital d’équilibre sont plus faibles que ceux de la règle d’or modifiée du modèle de Ramsey (c.-à-d. sans considération de la pollution), résultats que l’on peut résumer par la figure 6 où l’indice P distingue la situation avec prise en compte de la pollution par les agents (qu’il s’agisse de flux ou de stocks).
Graphique 6
L’effet de l’intégration des dommages liés à la pollution : moins de capital, moins de production, moins de consommation et donc moins de pollution à long terme
Plus la production sera intense en pollution (taux d’émission élevé), moins le capital de l’état stationnaire K*P sera important et plus faibles seront à la fois les production et consommation stationnaires mais aussi, et pour la même raison, la pollution d’équilibre à ce même état. Par ailleurs, plus l’environnement aura une capacité d’assimilation élevée, plus on pourra accumuler du capital et atteindre indéfiniment un niveau de consommation C*P supérieur sans augmenter pour autant la pollution à cet état. Enfin, plus les agents seront sensibles à la pollution, moins ils seront enclins à consommer et plus faible sera finalement le niveau du capital indirectement à l’origine de la pollution.
Ainsi, quand les émissions sont un produit fatal de l’activité (qu’elles soient liées au capital, à la production ou à la consommation étant secondaire), la croissance est indissociable d’une certaine dégradation de l’environnement le long du sentier conduisant à l’état stationnaire. Et à l’image de ce qui s’est effectivement produit, les générations trouvent dans l’accès à un certain confort matériel un moyen de compenser les pertes liées à l’émission/accumulation de polluants avant stabilisation.
Pour autant, rien n’indique ici que ces flux ou stocks n’induiront pas de pertes irréversibles. Si leur stabilisation s’établit forcément à des niveaux inférieurs à ce qu’ils devraient être en dehors de toute considération pour la pollution, rien ne dit que ces niveaux seront compatibles avec la préservation de tels espèces ou milieux naturels. En effet, seul a été pris en compte l’effet direct de la pollution sur le bien-être des agents mais sans lien précis avec certaines espèces ou milieux naturels auxquels ils pourraient également être sensibles et qui pourraient eux-mêmes souffrir de la pollution au point d’en disparaître à long terme. Cet argument, à l’image de ceux avancés par les tenants des approches fortes du développement durable, plaide en tout cas pour une certaine prudence, voire pour la conservation a priori de capitaux naturels critiques.
2.3.3 Du concours du progrès technique
Si le dernier argument est de taille, il découle aussi du fait que la pollution est une conséquence inéluctable de l’activité. Si on la conçoit sous un autre angle, revenant in fine implicitement à introduire du progrès technique, les conclusions seront plus nuancées.
Brock (1977) opère à ce titre un changement substantiel en considérant que la pollution n’est pas un sous-produit fatal de l’activité, quelle qu’en soit l’origine (production, consommation, capital), mais un facteur de production à part entière. En clair, l’usage polluant et le plus souvent gratuit que l’on fait de l’environnement opère comme si les productions domestique et a fortiori industrielle disposaient librement/gratuitement d’un facteur en plus : la pollution.
La production est donc ici une fonction croissante du capital et de la pollution et ces facteurs sont, de surcroît, considérés comme des substituts partiels. On peut ainsi générer une même production avec des combinaisons capital/pollution différentes, mais à des coûts différents. Ainsi, si une première combinaison mobilise peu de capital mais sollicite fortement l’environnement, donc émet beaucoup de polluants, alors qu’une autre mobilise plus de capital mais sollicite moins fortement l’environnement, donc émet moins de polluants, le coût associé à la seconde sera supérieur à celui de la première. Le capital est donc un substitut, coûteux, à la pollution, gratuite, ce qui sous-entend qu’il augmente qualitativement ou, dit encore autrement, qu’il y a plusieurs générations de capital, de plus en plus coûteux, car toujours moins polluant. Le fait est que les émissions peuvent alors tendre vers 0 et la qualité du capital aller sans cesse croissant en contrepartie, signifiant qu’on pourrait se maintenir économiquement, voire croître, tout en polluant toujours moins. Cette substitution n’étant toutefois pas gratuite, il faut donc inciter les firmes à choisir le niveau de pollution (et donc de capital) socialement optimal, sans quoi si le facteur pollution reste gratuit, elles optent pour le niveau auquel sa productivité marginale s’annule, autrement dit, elles émettent infiniment dès lors que la technologie de Brock vérifie les conditions d’Inada. L’aspect irréaliste de cette éventualité conduira d’ailleurs Tahvonen et Kuuluvainen (1993) à poser plus tard une limite maximale à l’émission des firmes.
Quoi qu’il en soit, si l’on reste confronté au problème consistant à savoir si le niveau optimal de pollution est compatible avec la préservation des espèces et autres milieux constitutifs de notre environnement, le changement opéré par Brock autorise à l’envisager plus facilement. En effet, comme il est ici possible de ramener la pollution à des niveaux toujours plus faibles et en limite infinitésimaux, il n’y a plus de limite à une substitution capital/pollution indéfinie permettant de mettre hors de danger les espèces et milieux en question. La seule limite viendra du désir réel des agents de le faire et, disons alors, de la possibilité pratique de substituer ainsi assez rapidement les facteurs capital et pollution sans conduire à un tel appauvrissement qu’il aurait toute chance d’être refusé. Cette configuration fait en tout cas écho à celle évoquée quant à l’épuisement des ressources non renouvelables. Plus forte sera la substituabilité entre pollution et capital, comme ailleurs entre ressources et capital, plus élevée sera la probabilité de déboucher sur un sentier le long duquel les émissions iront sans cesse et suffisamment décroissant au point de ramener la pollution stockée à 0. À l’inverse, plus il sera ardu/onéreux de substituer du capital payant aux émissions gratuites plus celles-ci seront durablement élevées jusqu’à stationnarisation, au point que l’on se rapprochera alors du cas où la pollution est un produit fatal, avec une part irréductible à long terme et un risque accru que certaines ressources/espèces et autres milieux en soient fortement affectés, voire n’y résistent pas.
Si Brock (1977) suppose implicitement que le capital est toujours moins polluant à mesure qu’il s’accumule, ouvrant la voie à une dynamique vertueuse, Stokey (1995) introduit explicitement l’idée d’un progrès technique exogène pouvant permettre à l’économie de déboucher sur un sentier de croissance continue et durable. Aussi, de même que Stiglitz (1974) avait envisagé qu’un progrès technique économisant assez les ressources pouvait permettre d’échapper au piège lié à leur finitude, Stokey envisage un progrès technique qui permet de produire en économisant toujours plus l’environnement, donc en émettant toujours moins. Sans entrer dans le détail, elle distingue la production effective de la production potentielle, ces deux grandeurs étant liées par une indicatrice de la qualité plus ou moins polluante de la technologie. Une indicatrice nulle serait signe d’une technologie non polluante mais si coûteuse que cela équivaudrait finalement à ne rien produire, alors qu’une indicatrice égale à l’unité serait signe d’une technologie libre de toute contrainte environnementale au point que la production réelle atteindrait son maximum possible. Une indicatrice comprise entre 0 et 1 représenterait donc un cas intermédiaire.
Attendu que la production potentielle évolue au gré de l’accumulation du capital et du progrès technique mais que la pollution dépend in fine de l’écart entre les productions potentielle et effective, la pollution ira décroissant si l’évolution des techniques économisant l’environnement supplante la tendance haussière liée à la croissance potentielle. Si rien n’est donc impossible, rien n’est automatique non plus, d’autant que pour arriver à ce résultat ouvert Stokey a entre autres posé que la désutilité marginale de la pollution est décroissante. Autrement dit, une unité polluante en plus génère bien une désutilité mais celle-ci décroît avec l’augmentation des flux, comme si les agents y étaient toujours moins sensibles, par résignation en quelque sorte. Or, bien qu’en apparence évidente, cette hypothèse reste discutable dans la mesure où en général, plus la pollution augmente, moins on en supporte en plus.
2.3.4 Du concours de l’éthique
À défaut de compter sur le progrès technique pour déboucher sur un sentier offrant toujours plus de consommation tout en préservant/restaurant toujours plus l’environnement, on peut de nouveau, comme l’avait envisagé Solow (1974b) avec les ressources épuisables, en appeler à l’adoption d’un principe éthique visant à écarter toute dictature du présent. Ce sera le cas si on étend à nouveau le principe de justice de Rawls à un cadre intergénérationnel, appliqué ici à la préservation de l’environnement dégradé par la pollution.
Ainsi Asako (1980) étudie les interactions entre accumulation de capital et pollution quand le planificateur impose que l’utilité, fonction de la consommation et de la pollution stockée, reste constante au cours du temps. La pollution est ici un produit fatal qui tient à la production, à la consommation ou encore à l’accumulation de capital et qui s’accumule dans l’environnement, lequel peut très classiquement en traiter une partie à taux constant. Il est à nouveau possible d’assurer le maintien indéfini de l’utilité à un niveau constant, mais comme ses arguments (la consommation et la pollution) sont ici des substituts parfaits, les trajectoires de ces arguments pourront être variées. Tout dépendra des conditions de départ, au moment où l’on adopte le maximin pour écarter le sacrifice des générations futures. En clair, selon la valeur des stocks de pollution et de capital hérités de l’ère précédente, par exemple industrielle, on débouchera sur un état stationnaire au terme de trajectoires qui assureront le maintien de l’utilité dans le temps mais à des niveaux de consommation et de pollution potentiellement très contrastés. Certaines générations jouiront d’une consommation élevée mais souffriront de la pollution alors que d’autres seront moins riches mais jouiront d’un environnement préservé. Conclusion en un sens rassurante, puisque l’utilité peut être maintenue indéfiniment, mais qui reste dans le registre de la soutenabilité faible, puisque la pollution peut se stabiliser à des niveaux très élevés.
2.3.5 Du concours des externalités positives
Si la substitution évoquée par Brock (1977) entre pollution et capital est possible et favorable à l’environnement, c’est que le capital, on l’a vu, est toujours moins polluant plus on l’accumule, intégrant implicitement du progrès technique. Au lieu de considérer alors comme Stokey (1995), mais au fond dans une longue tradition, que le progrès technique est exogène, l’idée a été de considérer avec les théoriciens de la croissance endogène (Romer, 1986 et 1990; Lucas, 1988; Rebelo, 1991) que ce progrès est consubstantiel au développement, porteur de et porté par ce dernier et tout ce qui y contribue, en particulier les externalités positives liées aux institutions, aux infrastructures, à la recherche, à l’éducation et finalement à la diffusion/dissémination publique de connaissances autant qu’à leur intégration/accumulation immédiatement privée. Cette diffusion et ce partage, et par suite cette accumulation de connaissances, sont propres à entretenir indéfiniment la croissance dès lors que la connaissance n’a pas de limite absolue et ne s’épuise pas quand on l’utilise. Et comme le note parfaitement Smulders (1995 : 324), « les nouvelles connaissances peuvent abaisser les niveaux (…) de finitude ou d’indisponibilité de l’énergie et de la matière », car « la loi de l’entropie ne s’applique pas à [leur] diffusion ».
La littérature couplant externalités positives (sources de croissance endogène) et externalités négatives (sources de décroissance et/ou de désutilité) est aujourd’hui très vaste[26]. Retenons par conséquent surtout qu’une croissance endogène ne s’accompagne pas fatalement d’une dégradation continue de l’environnement dès lors qu’on accumule assez de capital immatériel et ailleurs de capital humain propres à lutter contre la loi des rendements décroissants, et dès lors notamment qu’on investit assez en éducation et qu’on fait assez de R&D pour développer des technologies et/ou conduites toujours plus propres et/ou économes en ressources naturelles. La baisse ou, a minima, la maîtrise de la pollution n’est toutefois possible qu’avec des formes précises des techniques préventives et/ou curatives. S’agissant par exemple des papiers insistant sur les activités curatives, la majorité suit Gradus et Smulders (1993) dont la fonction d’émission nette est homogène de degré 0 par rapport aux émissions brutes et à la dépollution.
Enfin, si la croissance est purement qualitative, par exemple à travers un goût croissant pour la qualité écologique des biens, la baisse du stock de pollution est intrinsèque au développement : les agents ont indéfiniment le même niveau de vie mais il procède de biens toujours plus propres, si bien que croissance et amélioration continue de l’environnement sont indissociables.
En clair, tout en restant suspendu à certaines formes des technologies préventives ou curatives, la présence d’externalités positives, par exemple de connaissance, à opposer à celles négatives liées à la pollution, accroît la probabilité de déboucher sur des sentiers de développement durable le long desquels les générations pourraient consommer toujours plus sans attenter à leur environnement, en tout cas ici, sans accumuler concomitamment plus de polluants.
2.3.6 Des liens entre pollution et ressources naturelles
Évoquons alors quelques travaux qui ont pour ambition de lier explicitement la pollution à sa source (l’usage de ressources), et, au-delà, qui ont donc pour avantage de coupler les problèmes d’extraction et de pollution, ou plus intéressant encore, ceux qui intègrent le fait que la pollution ne nuit pas seulement au bien-être en raison des simples désagréments qu’elle peut occasionner ou ailleurs en raison de ses effets sur la santé, mais aussi parce qu’elle attente à de nombreuses ressources/espèces aussi vitales pour l’économie qu’essentielles à la biodiversité qui la sert.
Prolongeant l’argument de D’Arge et Kogiku (1973 : 68) pour lesquels « le « pur » problème d’extraction doit être couplé au « pur » problème de pollution », s’interrogeant alors sur ce qui serait épuisé en premier (« l’air que l’on respire ou les réserves fossiles qui polluent l’air que l’on respire? »), Withagen (1994) entreprend de les lier explicitement là où Krautkramer ne l’avait fait que de façon détournée. Ainsi, des émissions clairement liées à la consommation de ressources fossiles viennent grossir un stock de polluants qui nuit au bien-être des générations. Si l’intégration de deux variables d’état reliées entre elles, le stock de ressources d’un côté et celui de polluants de l’autre, ajoute au réalisme, la conclusion reste toutefois semblable à celle de Krautkraemer : la prise en compte de pollutions explicitement liées à l’usage de ressources ralentit bien le rythme de leur extraction. Mais l’issue n’en est pas moins la même à long terme : une consommation nulle que la perspective lointaine d’un stock de polluants ramené alors lui-même progressivement et naturellement à zéro ne suffit pas à compenser. La seule issue tiendrait alors dans l’accumulation de capital venant se substituer aux ressources et couplée en outre à du progrès technique ou, a minima, dans l’adhésion au principe de justice de Rawls (Asako, 1980).
Tahvonen et Kuuluvainen (1993) abordent un cas plus intéressant où la pollution s’accumule et est, comme chez Brock (1977), un facteur de production à part entière, mais où elle attente à la capacité de régénération d’une ressource-espèce servant à la production. La ressource est ainsi prélevée pour alimenter le circuit et subit en même temps l’effet de la pollution. Le résultat de ce modèle à trois variables d’état que sont les stocks de capital, de pollution et de ressource naturelle est alors le suivant : alors que chez Keeler, Spence et Zeckhauser (1972), réduire la pollution pour augmenter le bien-être à « l’équilibre d’âge d’or » impliquait de réduire le capital et la consommation par tête, réduire ici la pollution qui perturbe l’autorégénération de la ressource peut in fine accroître le capital et la consommation d’équilibre, stratégie alors gagnante sur tous les plans.
Si l’on devait tenter de tirer les principaux enseignements des travaux évoqués jusqu’ici, on noterait d’abord que selon que la pollution est un produit fatal de l’activité ou un facteur de production à part entière, les conclusions diffèrent assez sensiblement. Dans le premier cas, la pollution est une conséquence à laquelle il faut se résoudre. Même contrôlée dès lors qu’elle nuit au bien-être des agents, il en reste fatalement dans l’environnement. Toute la question est alors de savoir si ces stocks, tolérés sur la base de leurs effets sur le bien-être, sont, ou non, durablement supportables par la nature.
Dans le second cas, où la pollution est un facteur de production à part entière, alors selon le degré de substituabilité entre la pollution et le capital, on arrivera plus ou moins rapidement à réduire la pollution au point d’épargner potentiellement l’intégralité des espèces. Le travail de Tahvonen et Kuuluvainen (1993) en particulier, a cela de rassurant qu’il montre, à tout le moins dans un cadre à la Brock (1977), que les ressources n’ont pas nécessairement lieu de disparaître, en tout cas pas si l’effet nocif des polluants sur leur autorégénération est pris en compte.
Pour autant, subsiste un doute : certaines ressources n’en viendront-elles pas à dépérir plus indirectement parce que la capacité plus large du milieu à assimiler certains polluants aura elle-même été affectée par leur accumulation? Le taux d’assimilation a en effet jusqu’ici été posé invariablement constant, si bien que plus l’environnement accumule des polluants, plus il peut en traiter des volumes importants. Avant d’en venir alors à la littérature qui relâche cette hypothèse et dont les conclusions seront forcément plus nuancées, on doit enfin souligner, dernier enseignement tiré jusqu’ici, que l’intégration du progrès technique (exogène ou endogène) reste bien la raison d’être, sinon totalement optimiste, en tout cas pas nécessairement aussi pessimiste que la plupart des tenants des approches fortes; disons au moins à ce stade, car les travaux qui suivent, bien qu’émanant d’auteurs à l’origine plutôt optimistes ou confiants, marquent un infléchissement sensible de la littérature « standard » ou « d’orthodoxe » vers plus de prudence. Signe que l’optimisme des débuts a définitivement fait place à la mesure.
2.3.7 Effet de seuil et de cliquet, hystérèse et irréversibilité
Ainsi, d’aucuns ont pris acte que les phénomènes écologiques se caractérisent par des dynamiques plus complexes que celles couramment postulées dans les modèles économiques. En particulier, les hypothèses de linéarité, par exemple du taux d’assimilation naturelle, ou encore de continuité, telle la convexité des coûts et, en amont, des dommages écologiques, ignorent la possibilité d’effets de seuil ou de cliquet propres à générer hystérèse et pertes irréversibles (Cesar et de Zeeuw, 1994; Dasgutpa et Mäler, 2003). Xepapadeas (2005 : 1225) écrit ainsi qu’
ignorer les non-linéarités peut masquer des caractéristiques très importantes (…), telles des bifurcations d’un système naturel entre différents états alternatifs, des phénomènes irréversibles et d’autres hystérétiques, lesquels peuvent s’avérer essentiels quand on étudie la vraie nature des liens entre croissance et environnement
Bien que les travaux restent minoritaires en raison des difficultés de modélisation, certains économistes ont pourtant très tôt cherché à intégrer ce degré supérieur de complexité et donc de réalisme écologique. Ainsi Forster (1975) envisageait-il déjà que l’accumulation de polluants puisse nuire à terme à la capacité du milieu à les traiter, envisageant alors une relation logistique entre polluants stockés dans l’environnement (SP) et volume assimilé par ce dernier (VP(SP)) :
Graphique 7
Fonction d’assimilation naturelle de Forster (1975)
Jusqu’au niveau SP˜, par exemple de CO2 dans l’air, le polluant accroît la capacité du milieu, par exemple en favorisant la croissance des arbres fixant toujours plus de CO2. Mais passé ce seuil critique, le milieu a toujours plus de mal à assimiler le polluant, au point qu’en SPm plus une unité ne l’est; et la pollution ne cesse alors de s’accumuler ceteris paribus.
Forster (1975) établit dans ce cadre l’existence de plusieurs états stationnaires, dont l’un est signe de destruction de la capacité d’assimilation naturelle. Tout dépend du niveau atteint par le stock de pollution au moment où le planificateur établit son programme d’optimisation autour d’une utilité comprenant, comme souvent, un goût pour la consommation et un dégoût pour la pollution. Si le stock accumulé à l’ère industrielle, ou disons « préécologique », a déjà franchi un certains seuil (ŜP), la capacité d’assimilation sera définitivement détruite.
Tahvonen et Salo (1996) abordent un cas où l’assimilation naturelle a dans un premier temps une forme concave comme chez Forster, mais où passé un niveau maximal (SP~), elle décroît selon une forme convexe. Tout en reconnaissant qu’il n’est pas sûr qu’elle soit mieux fondée empiriquement, ils notent qu’elle est continûment différentiable et qu’elle écarte donc l’éventualité propre à la forme de Forster où on passerait d’une situation (à gauche de SPm) où la chute de l’assimilation est (à la marge) infinie, à une situation où elle s’annule brutalement (en SPm).
Graphique 8
Fonction d’assimilation concave-convexe de Tahvonen et Salo (1996)
Tahvonen et Salo (1996) montrent également qu’il est de multiples trajectoires et équilibres localement optimaux mais, à l’inverse de Forster (1975), que celui qui l’est globalement à l’état stationnaire peut être indépendant du stock de pollution initial tel qu’hérité, par exemple, de l’ère industrielle. Et les auteurs de montrer enfin qu’il peut exister une trajectoire conduisant à la destruction de la capacité d’assimilation du milieu.
Plus intéressant encore, Mäler, Xepapadeas et de Zeeuw (2003) démontrent, outre la possibilité d’effets irréversibles, celle d’effets hystérétiques. Attendu la complexité du modèle, nous nous limitons à la reproduction de leur simulation graphique qui relie le stock de pollution (Sp*) aux émissions (P*) de l’état stationnaire (pour des paramètres donnés de l’économie). Voir graphique 9.
Graphique 9
Hystérèse et irréversibilité chez Mäler, Xepapadeas et de Zeeuw (2003)
Le premier cas représente une situation classique où à tout niveau d’émission stationnaire P* est associé un unique stock de pollution SP*, si bien que plus on maintient bas le niveau des émissions stationnaires, plus le stock SP* l’est également (cas a). Les deux autres cas sont plus intéressants car ils représentent les situations d’hystérèse et de pertes irréversibles.
Dans le cas de l’hystérèse (cas b), si le niveau d’émission stationnaire P* franchit le seuil P1* même de très peu, on entre dans le bassin attracteur F2 conduisant inéluctablement au stock de pollution SP2*. Pour revenir alors à un niveau inférieur à SP1*, il faudra réduire durablement les émissions bien en deçà du seuil P1*, et a minima en P2*, ce qui sera très coûteux.
L’irréversibilité (cas c) est encore plus critique : si P* surclasse P3*, SP* est irrémédiablement attiré vers SP3*, cette fois sans retour possible. Les forces centrifuges l’emportent, en somme, sur celles centripètes, au sens où passés certains seuils, les dégâts sont tels qu’ils induisent une spirale inextinguible aux effets alors imprévisibles et irréversibles. En clair, dans l’éventualité même où les émissions seraient indéfiniment ramenées à 0, hypothèse extrêmement forte, la pollution accumulée dans le milieu ne redescendrait jamais en deçà de SP3*, signe que la faculté originelle du milieu naturel à traiter/assimiler lentement, mais sûrement, les polluants en question stockés dans l’environnement aurait définitivement disparu.
Nous souhaitons toutefois apporter une nuance à ces résultats. Que les dynamiques naturelles soient parfois chaotiques et en tout cas plus complexes qu’on ne le pense parfois ne fait aucun doute. Mais que le milieu, dans son ensemble, puisse perdre toute faculté à assimiler certains polluants pose question. En effet, on conçoit que des phénomènes hystérétiques et plus encore irréversibles surviennent pour des espèces surexploitées (surpêche/surchasse/surcoupe), voire suite à l’accumulation de polluants les menaçant directement. En revanche, on peine davantage à imaginer que la capacité d’assimilation du milieu au sens large puisse non seulement être durablement affectée (sauf revirement majeur) comme dans le cas b, mais plus encore, totalement et définitivement détruite (cas c). Cela n’a de risque d’arriver qu’à l’échelle de milieux bien délimités et très isolés[27]. Retenons donc que le risque que la capacité d’assimilation du milieu soit définitivement affectée, voire détruite, ne fait sens que localement. Ce qui n’enlève rien au fait qu’il est des changements de régime si soudains et brutaux qu’ils revêtent une dimension catastrophique au sens où il est extrêmement difficile, et parfois même impensable, de sortir d’états écologiquement pauvres (Scheffer et al., 2001; Scheffer et Carpenter, 2003).
2.3.8 Du côté de l’empirie : la croissance obstacle ou solution?
À défaut de connaître l’issue du rapport croissance/environnement sur la base de conjectures théoriques, peut-on alors s’en faire une idée au plan empirique? Existe-t-il en particulier des courbes environnementales à la Kuznets (Panayotou, 1993) reliant le revenu par tête au niveau d’émission selon une relation en U inversé, à l’image de celle décelée en son temps par Kuznets (1955) entre revenus et inégalités? Si tel est le cas, doit-on alors en déduire que la croissance amènera à terme la « restauration » de l’environnement qu’elle aura longtemps dégradé?
Prolongeant le modèle de Forster (1973), mais en supposant que la productivité marginale de la dépollution ne s’annule pas quand celle-ci tend vers l’infini, Selden et Song (1995) montrent qu’on peut déboucher sur deux situations le long de la dynamique optimale : soit les dépenses de dépollution restent définitivement nulles, situation naturellement la pire en présence d’un polluant produit fatal de l’activité; soit elles deviennent positives à partir d’un certain stade, mettant en exergue la possibilité que l’environnement se dégrade d’abord avec le revenu avant qu’un retournement favorable n’opère.
Si cette démonstration étaye l’intuition première de Beckerman (1992), elle fait surtout écho à diverses études empiriques, dont celles de Selden et Song eux-mêmes (cf.infra), tendant ainsi à montrer qu’il y aurait une relation en U inversé entre le niveau de développement des pays, appréhendé à travers leur revenu par tête, et leur niveau d’émission par tête. Tant et si bien que si les populations nationales devaient rester stables, ou au moins se stationnariser après leur transition démographique, et plus encore si elles devaient baisser, comme c’est déjà le cas pour certains pays riches, la pollution et, par suite, l’ensemble des dégradations environnementales, devraient elles-aussi connaître une évolution en U inversé. En clair, à population stabilisée (et a fortiori décroissante) on devrait avoir :
Graphique 10
Courbe environnementale à la Kuznets « type »
S’intéressant aux effets environnementaux de l’Alena, Grossman et Kruger (1991) sont les premiers à avoir identifié l’existence d’une telle relation concernant le dioxyde de soufre. Leur résultat suggérait alors que si l’économie mexicaine devait croître plus vite grâce à l’Alena et la délocalisation d’entreprises nord-américaines sur son territoire, les émissions iraient sans doute croissant au début, mais finiraient par décliner au fur et à mesure de son enrichissement[28]. Et l’explication d’être résumée ensuite en ces termes par Grossman et Krueger (1993 : 17) : « à mesure qu’une société s’enrichit, ses membres peuvent intensifier leur demande pour un environnement plus sain et soutenable, configuration propre à inciter les gouvernements à imposer des contrôles environnementaux plus stricts ».
Par-delà leur travail séminal de 1991, étendu d’ailleurs par la suite (Grossman et Kruger, 1995), de nombreux autres viendront émailler les débats sur l’automacité de ce lien à long terme entre enrichissement et réduction des atteintes à l’environnement. Parmi eux, et pour n’en citer que quelques-uns tant la question a depuis ouvert un champ d’investigations à part entière, citons ceux de Hettige, Lucas et Wheeler (1992), Shafik et Bandyopadhyay (1992), Panayotou (1993), Shafik (1994), Selden et Song (1994; 1995), Holtz-Eakin et Selden (1995) ou encore de Stern et Common (2001). Si certains font alors état d’une relation en U inversé pour le dioxyde de soufre, pendant que d’autres, parfois les mêmes, l’établissent pour les oxydes d’azote et/ou les particules en suspension, nul doute que les résultats dans leur ensemble, tant pour ces polluants que pour d’autres et plus largement pour les atteintes à l’environnement (comme la déforestation dans les pays émergeants), restent contrastés et de fait sujets à controverses.
En effet, les situations étudiées ainsi que les spécifications économétriques utilisées sont très nombreuses et donc très discutées, entre données de panel d’un côté et données individuelles sur longue durée de l’autre, ou entre formes de régression : cubique, quadratique, etc. D’aucuns ont alors avancé qu’il était plausible que les relations soient plus complexes et finalement même négatives, faisant écho au débat plus large rouvert par Georgescu-Roegen et les fondateurs de l’Ecological Economics autour de l’idée d’un effet rebond perpétuel, tel qu’il avait déjà été mis en lumière par le paradoxe de Jevons sur la consommation d’énergie (cf.supra) et tel qui n’a cessé d’être réinvesti depuis plus de trente ans (Madlener et Alcott, 2009), sous l’appellation que lui a donné Saunders (1992) de postulat de Khazzoom-Brookes[29].
Pour en rester à la pollution, De Bruyn, Bergh et Opschoor (1998) s’étaient déjà montrés très dubitatifs quant à l’émergence de CEK au sein de pays pourtant riches (Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis). Et Common et Stern (2001) n’avaient imaginé en trouver trace pour les pays en voie de développement, que passés des niveaux de revenus considérables, de l’ordre du million de dollars par tête, soit près de dix fois supérieurs à ceux estimés au sein de l’OCDE. Harbaugh, Levinson et Wilson (2002) devaient même livrer des résultats infirmant très largement ceux de Grossman et Krueger, pendant que Friedl et Getzner (2003) mettaient en évidence une relation en N, et que Lantz et Feng (2006) faisaient état d’une relation en simple U, avec donc, dans ces deux derniers cas, une reprise de la pollution après un temps de rémission.
Tous ces résultats montrent en tout cas que l’histoire (récente) des courbes environnementales à la Kuznets reste faite « de hauts et de bas », pour reprendre le mot habile de Stern (2004)[30]. Surtout, ils confirment la position émise très tôt par Arrow et al. (1995 : 92) selon laquelle,
alors que [certaines études empiriques] indiquent que la croissance économique peut être associée à l’amélioration de certains indicateurs environnementaux, elles n’impliquent pas pour autant que la croissance suffit en elle-même à induire une amélioration de l’environnement en général (…)
Position sans ambigüité dans le débat suscité par l’émergence possible de CEK, répondant en tout cas clairement au questionnement initial consistant à savoir si la croissance, néfaste à l’environnement aux premiers stades du développement, peut amener d’elle-même la restauration de ce dernier; réponse par la négative d’Arrow et al. (1995) à laquelle on ne peut que souscrire encore aujourd’hui.
Au-delà des travaux sur la CEK, et faisant suite aux interrogations déjà anciennes de Nordhaus et Tobin (1971) sur le sens et la mesure de la croissance[31], une série d’indicateurs alternatifs au PIB a été développée pour apprécier la distance qui sépare notre richesse matérielle, telle qu’estimée par le PIB, avec l’idée que l’on peut se faire du bien-être social ou sociétal; lequel reste forcément une combinaison complexe, arrêtée alors par convention, qui mêle au bien-être purement matériel ceux d’ordre social et/ou environnemental. En ce sens d’ailleurs, ces indicateurs renvoient davantage au « bulletin de santé » d’un pays à un instant t, tel qu’on se le représente à travers un choix de pondération entre les dimensions économique, sociale et environnementale, plus qu’ils n’offrent de vraie évaluation de leur durabilité à long terme; au même titre qu’un bilan médical ne préjuge pas parfaitement de la longévité d’un individu[32].
Parmi les indicateurs à consonance plus proprement environnementale que nous ne alors qu’évoquer tant un exposé plus complet conduirait bien au-delà de ce travail portant sur la durabilité de nos économies (et non sur les évaluations du bien-être des agents à un instant donné), mentionnons les plus connus, selon qu’ils sont des indicateurs de flux ou de stock[33]. L’indicateur de bien-être économique durable (IBED) et l’indicateur de progrès véritable (IPV) sont deux mesures des flux de richesse annuelle créée, corrigés des pertes de ressources naturelles et environnementales liées à nos productions/consommations matérielles; pertes que l’on peut espérer monétariser puis comptabiliser, mais non sans difficulté (Piriou, 2004). Enfin, l’indice d’epargne véritable (IEV) se veut être l’indicateur du stock des richesses réellement accumulées/épargnées après déduction des pertes estimées en capital naturel.
Par-delà les modalités de calcul de ces indices (cf. Gadrey et Jany-Catrice, 2005), on notera surtout que les pays se distinguent selon que tout ou partie de leurs indicateurs évoluent, ou non, parallèlement à leur PIB. C’est le cas notamment de la Suède, dont l’IBED et le PIB ont suivi en gros la même évolution depuis un demi-siècle. Alors que le Royaume-Uni serait dans une situation opposée, avec un décrochage de plus en plus net de l’IBED par rapport au PIB depuis 1970 (Jackson et Stymne, 1996). La Suède suivrait ainsi pour l’heure une trajectoire préférable sur la base de cet indice, mais sans toutefois avoir la certitude que sa trajectoire sera forcément durable sur longue durée.
Au-delà, si l’empirie devait offrir quelque message rassurant en montrant notamment que la croissance ne s’accompagne pas fatalement d’une augmentation indéfinie de la pollution, il reste que même si cela devait sembler clair (courbes à la Kuznets), elle s’accompagne bien au départ d’une hausse potentiellement soutenue de la pollution. En raison des effets irréversibles qu’elle peut avoir, il reste à ce stade toujours aventureux de considérer que l’humanité est délestée du risque d’accuser des pertes telles qu’elle en serait menacée. Ce risque est d’autant plus à craindre que les pays riches sont encore assez loin d’avoir passé un possible point de retournement pour divers polluants et atteintes à l’environnement et, de surcroît, qu’on ne peut attendre du « reste du monde », en nombre plus grand encore, qu’il limite le rythme auquel il semble avoir enfin entamé sa croissance ou qu’il la convertisse rapidement sous une forme plus qualitative alors même qu’il commence à en retirer les premiers avantages.
De ce point de vue, l’ouvrage de Diamond (2005) nous rappelle que si l’effondrement peut être évité, il n’est jamais à exclure totalement. Et c’est même dans cette perspective, à la lumière en somme d’un « catastrophisme éclairé » (Dupuy, 2002), qu’il faut travailler à se doter des outils et institutions appropriés. C’était d’ailleurs la conclusion à laquelle étaient parvenus Brander et Taylor (1998) à l’issue de leur étude sur le cas aussi emblématique qu’énigmatique de l’Île de Pâques, cas ayant d’ailleurs largement participé à la popularité ultérieure de Diamond[34].
Retenons en tout cas qu’au niveau précis de la modélisation qui a retenu l’essentiel de notre attention dans cette section, la prise en compte des risques liés à la présence de non-linéarités a conduit l’économie « standard », jusqu’ici plutôt optimiste ou confiante face à l’avenir, à plus de nuances et de prudence, l’amenant en particulier à s’ouvrir aux critiques qui lui a adressées de longue date l’économie écologique (Dasgupta, 2008).
Conclusion
Si l’on devait tenter d’opérer la synthèse des principaux points d’achoppement entre optimistes et pessimistes, et par suite entre acceptions faibles ou fortes du développement durable, nous retiendrions les suivants.
Ce que l’on a convenu d’appeler les approches faibles admettent l’hypothèse de substituabilité indéfinie du capital aux ressources naturelles dans la production et ne se fixent aucune limite intrinsèque à l’épuisement des stocks. Si un stock doit être conservé ad infinitum, cela relève d’un calcul coût-avantage sur horizon infini, entre avantages procurés par l’extraction/utilisation des ressources et coûts ou pertes associés, et non parce que quelque impératif extérieur, tel un seuil en deçà duquel il serait jugé immoral de descendre, l’impose a priori.
Si le problème semble de prime abord anodin dans le cas des ressources non renouvelables, en particulier quand elles sont en sous-sol, puisqu’on peut effectivement s’interroger sur le caractère impérieux d’en conserver indéfiniment sauf en termes d’externalités évitées, le principe vaut toutefois aussi pour les ressources renouvelables. Il est au fond possible de les détruire totalement, et pas forcément par négligence ou ignorance mais optimalement, dès lors que les générations n’attachent aucun intérêt aux aménités et/ou fonctions qui leur sont associées mais seulement à ce qu’elles représentent en tant que ressources valorisables après transformation.
La probabilité d’une destruction totale serait toutefois faible pour la raison que de nombreuses ressources participent au bien-être des agents. Et plus encore, parce que ce bien-être d’ordre naturel (et plus largement environnemental) demeurerait inaliénable en totalité ou, dit autrement, parce qu’il resterait imparfaitement remplaçable par du bien-être matériel. En clair, dotées de valeurs écologiques, aménitaires, voire de pure existence et pas seulement instrumentale, il n’y aurait pas de raison pour qu’on aille jusqu’à les détruire totalement. En outre, ajoutent souvent les partisans des approches faibles, il y a toujours eu du progrès technique pour économiser les ressources (et plus largement l’environnement), si bien qu’ajouté au fait que le plus grand nombre de celles qui entrent dans l’utilité sont naturellement renouvelables, il y aurait davantage de raisons de rester serein que l’inverse.
En résumé, en comptant sur l’intérêt des agents quant à la pérennité de nombreuses ressources et plus largement quant à la qualité de leur environnement, et en comptant tout à la fois sur le progrès technique et le renouvellement naturel, il y aurait des raisons de penser qu’on devrait pouvoir écarter le pire sans recourir à une approche normative nécessitant la définition amont d’une multitude de seuils à ne pas franchir.
Si les tenants des approches fortes restent emprunts du pessimisme originel de Malthus, ils font toutefois valoir divers arguments audibles, opposés à un camp optimiste taxé de naïveté. On y trouve en particulier les suivants (Pearce, Markandya et Barbier, 1989), teintés de réalisme ou d’empirisme et mobilisés ailleurs en économie par les tenants d’une hétérodoxie in fine utile à l’orthodoxie.
S’agissant d’abord de la substituabilité entre capital et ressources non renouvelables dans la production, ou ailleurs entre ressources renouvelables et non renouvelables, il reste raisonnable de penser, et même logiquement imparable, qu’elle est indéfinie sur le long terme et, pour être plus précis, infinie sur horizon infini.
Pour autant, et pour paraphraser Keynes en d’autres domaines, nous serons tous morts à long terme. Manière de rappeler que si un raisonnement peut s’avérer imparable sur horizon infini, rien ne dit toutefois que le chemin sera lisse et qu’on ne connaîtra pas un ou plusieurs épisodes de reflux majeurs. Encore faut-il en effet trouver dans les faits les moyens d’opérer en continu cette indispensable substitution entre capital et ressources non renouvelables, ou entre ressources renouvelables et non renouvelables, devant ainsi permettre de se passer un jour des dernières; au moins en limite.
On rejoint ici la question du progrès technique et la croyance, ou non, en la faculté de l’homme à trouver sans cesse les moyens de se déjouer des contraintes naturelles. Et on comprend alors le scepticisme, sinon le pessimisme, de certains dans la mesure où s’il y a effectivement toujours eu du progrès technique encore faut-il qu’il soit à l’avenir assez important et, plus encore ici, qu’il soit correctement orienté attendu l’ampleur des défis qui nous attendent.
Comme le suggère la conjecture de l’effet rebond et, au fond, avant elle, le paradoxe de Jevons, si la concurrence incite bien à rechercher sans cesse les moyens d’économiser des ressources et donc à développer des procédés permettant de gagner en efficience, notamment énergétique, rien n’indique pour autant que les économies réalisées ici, par essence génératrices de richesse supplémentaire, ne généreront pas in fine un surcroît de consommation (directe et indirecte) plus néfaste encore que les économies initialement réalisées.
Au-delà des innovations de procédés, qu’elles soient techniques ou managériales, on sait que le progrès technique s’incorpore également dans les biens de consommation finale (innovation produit) et que l’objectif est plus souvent de susciter/d’entretenir des désirs d’équipement/de renouvellement que de rendre les produits finaux toujours plus économes en matières, énergie, déchets. Si bien qu’on peut parfois s’interroger sur la direction du progrès technique quand sa destination est laissée à la seule appréciation des producteurs en quête de débouchés.
Si d’aucuns feront valoir que la fiabilité et la durée de vie des nouveaux produits augmente parfois dans le temps, au point qu’on ne les use ni ne les renouvelle plus forcément aussi souvent, on sait aussi que dans certains pays, plusieurs marchés sont quantitativement arrivés à maturité si bien que les producteurs écourtent volontairement la durée de vie des produits (obsolescence programmée) pour pérenniser leurs débouchés. Enfin, la course croissante à la différenciation des produits, levier parmi d’autres pour précipiter leur changement, n’est pas le signe d’une rationalisation croissante de l’offre au plan écologique. Et s’il est évident que la contrainte budgétaire des agents les limite au point qu’ils ne peuvent changer sans cesse leurs équipements, on notera que le pays qui a sans doute poussé le plus loin les logiques de réduction du cycle de vie des produits et de différenciation est les États-Unis, et qu’il faut peut-être trouver ici le fait qu’ils consomment et polluent davantage que nous, consommant une part plus élevée de leurs revenus, pourtant déjà supérieurs. Ces différenciations et réduction incessantes du cycle de vie des produits ne cesseraient d’entretenir une forme de boulimie consumériste aussi risquée pour les équilibres macroéconomiques du globe que pour ceux proprement naturels qui nous ont occupés ici. Leur modèle est en effet souvent pointé du doigt pour être le moins durable de tous les pays riches, signe qu’un pays aussi avancé économiquement, et habile technologiquement, n’oriente pas toujours ses efforts scientifique et technique, ou pas assez, en direction d’une économie de ressources susceptible de le rendre viable à long terme.
Plus fondamentalement, et pour poursuivre avec les critiques adressées au parti optimiste et en tout état de causes aux approches faibles du développement durable, l’une revient souvent : se peut-il que les agents éprouvent un intérêt intrinsèque pour les ressources et l’environnement à ce point suffisant pour éviter une perte irréversible, si elle n’a de risque de survenir que dans un futur éloigné? Plus encore, peuvent-ils éprouver un intérêt pour les ressources et l’environnement à ce point suffisant pour éviter telle perte si celle-ci n’a de risque de se produire que suite à une surexploitation mal estimée ou, plus probablement sans doute, suite à une suraccumulation de polluants aux effets mal évalués? En clair, jusqu’où compter sur l’attachement des agents à préserver certaines ressources, et plus largement leur environnement, quand l’information est souvent imparfaite et les connaissances nécessairement discutées en ces matières, soit en fin de compte quand on est le plus souvent en « univers controversé » (Godard, 1998)[35]?
La première de ces questions renvoie au problème classique du taux auquel l’agent représentatif des modèles de contrôle optimal déprécie le futur. Les théoriciens qui recourent à cette forme de modélisation ont parfaitement conscience de l’acuité de cette question au point d’avoir eux-mêmes démontré les effets délétères d’un taux d’actualisation élevé. S’en est d’ailleurs suivi une littérature à part entière. Il n’empêche, cela doit nous alerter sur le fait qu’une succession de générations, celles que le planificateur est supposé camper et qui déprécieraient par trop le futur, pourraient optimalement conduire l’économie à sa perte ou tout au moins à des pertes écologiques considérables et alors sans retour.
S’agissant de notre dépendance à l’égard de ressources non renouvelables, et à l’heure actuelle encore indispensables, Krautkraemer (1985) a bien montré que les intégrer à l’utilité n’était pas une garantie contre leur épuisement. Et s’il est des raisons de croire, nous le disions, que grâce au progrès technique on devrait pouvoir écarter ce risque, il reste, nous l’indiquions aussi, qu’il faut non seulement qu’il soit suffisant mais aussi intégralement tourné vers l’économie de matières et d’énergie tout autant que vers le recyclage des premières pour espérer y parvenir.
S’agissant de même de notre lien au vivant et plus largement à notre environnement, bien que la problématique soit a priori moins complexe en raison de leur caractère renouvelable et de leur faculté à traiter nombre de polluants, rien n’indique que l’on ne minimisera pas par trop les effets de nos actions sur le futur pour écarter avec certitude telle extinction d’espèces ou telle perte plus large par suite de surexploitation ou de suraccumulation de polluants. La plupart des modèles de contrôle optimal sur lesquels se fonde le camp optimiste, et en tout cas les tenants d’une vision faible de la durabilité, consacrent l’idée que les ressources et bien plus largement l’environnement entrent de façon inséparable, avec la consommation, dans l’utilité. À tel point qu’en théorie les ressources ne devraient jamais disparaître, ni la qualité de l’environnement se dégrader à jamais, mais tendre dans le pire des cas vers 0, laissant toujours espérer un possible retour en arrière.
Or, par-delà le fait que ce retour en arrière n’a rien de mécanique — à tel point qu’Asako (1980) a montré que l’adoption d’un principe normatif visant à écarter la dictature du présent pouvait se satisfaire d’une dégradation continue de l’environnement dès lors qu’elle serait compensée par une hausse du bien-être matériel, en tout cas en l’absence de progrès technique — il reste que c’est l’idée même d’une telle réversibilité qui pose question. Elle conduit au fond à exclure toute incertitude face à la nature, alors même qu’on ignore encore largement les discontinuités et autres non-convexités qui lui sont propres, et trahit en creux un sentiment d’infaillibilité déraisonnable.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les tenants des approches fortes plaidèrent très tôt pour une vision normative fondée sur l’obligation de préserver tels et tels niveaux de capitaux naturels critiques, en dehors de tout calcul économique. Et on notera que leur critique plus large à propos des modèles sur lesquels reposent les positions des tenants des approches faibles ont eu assez d’écho pour pénétrer le champ de l’économie dite standard ou orthodoxe, puisque des auteurs comme Mäler, Xepapadeas et de Zeeuw (2003) ont rouvert récemment la voie initiée par Forster (1975) et longtemps restée sans suite, consistant à établir la possibilité de pertes irréversibles ou a minima d’effets hystérétiques.
Ainsi, par-delà la question classique consistant à savoir quel est l’effet de la préférence pour le présent sur les choix d’allocation/exploitation/préservation des ressources au cours du temps et, par suite, comment cet effet peut supplanter l’effet d’un goût pourtant élevé pour la nature, se pose le problème de l’incertitude, captée en partie seulement par le taux de dépréciation du futur. La réalité de notre environnement étant souvent faite d’incertitudes encore radicales, que seule une lente et longue accumulation de connaissances permet de combler progressivement, cela ne doit pas, bien sûr, nous conduire à l’inaction la plus totale par excès de précaution. Pour autant, il resterait aventureux d’affirmer que l’on peut être résolument confiant sur la base de modèles qui excluent tout défaut d’information, comme c’est bien le cas à travers la fiction du planificateur omniscient à durée de vie infinie.
En effet, force est de reconnaître que ces modèles opèrent en information parfaite et si cela se comprend pour des raisons évidentes de complexité de modélisation, ils restent déterministes : à conditions de départ données, tant sur les niveaux de capital artificiel et naturel que sur les caractéristiques de l’utilité, on connaît à l’avance avec certitude toute la séquence des optima qui en découle. Et dans tous les cas (sauf bien sûr celui des ressources épuisables), il n’est par essence aucune perte irréversible à craindre parce qu’on aurait ignoré tels phénomènes faute d’information disponible ou suffisante (Howarth, 1995).
Si ces modèles restent qualitativement indispensables puisqu’on peut apprécier les effets d’une variation des conditions de départ ou des paramètres caractéristiques du bien-être des agents ou de l’économie, on exclut cependant la possibilité même de l’imprévue en des matières où elle subsiste incontestablement. Et si par souci de réalisme on souhaite introduire une dimension stochastique pour manifester qu’une variable peut prendre aléatoirement diverses valeurs sur une plage donnée, il reste inévitable de postuler qu’on connaît lesdites plages et distributions de risques associées. Si l’on n’a pas d’autre choix, sauf à affirmer d’emblée que rien n’est modélisable et encore moins probabilisable, il est utile de ne pas oublier, ici comme ailleurs, que les résultats de nos modèles, si subtiles soient-ils, restent liés aux hypothèses de départ, précaution un peu trop souvent oubliée par certains partisans des approches faibles (Dasgupta, 2008).
Enfin, et ce sera la dernière critique des partisans des approches fortes que nous relèverons ici, il est clair que si la fiction de l’agent représentatif vivant sur un horizon infini est utile pour caractériser les relations de long terme entre économie et environnement, elle admet également des limites. Elle est notamment discutée quant à sa faculté à appréhender avec finesse les rapports qui lient les générations entre elles. À tel point que de nombreux auteurs, dont Howarth et Norgaard (1990, 1992), Howarth (1991, 1996, 1998), Mourmouras (1991, 1993), John et Pecchenino (1994), Gerlagh et Keyzer (2001) ou Koskela, Ollikainen et Puhakka (2002) par exemple, lui ont préféré une autre fiction : celle de générations imbriquées d’agents mortels telle que mise au point par Allais (1947).
Pour autant, même dans ce cadre qui permet d’analyser plus finement les rapports contradictoires entre parents et enfants successifs quant à l’environnement qu’ils partagent et exploitent au moins un temps, la question des rapports entre agents au sein d’une même génération est à nouveau écartée. Partant, celle de la décentralisation de l’optimum intertemporel entre agents d’une société composée de générations différentes mais aussi et surtout, d’agents différents en leur sein est évacuée. En clair, si l’équité intergénérationnelle est bien appréhendée par les modèles de contrôle optimal, et a fortiori par ceux à générations imbriquées, la question de l’équité intragénérationnelle est généralement éludée alors qu’elle impacte forcément l’équité entre générations; au point d’avoir d’ailleurs été, dès l’origine, au coeur de la problématique du développement durable (Brundtland, 1987)[36].
À ce titre aussi, on comprend les appels des partisans des approches fortes à discuter les analyses mobilisées pour camper les visions faibles ou optimistes du développement durable dans la mesure où la plupart n’abordent pas en effet la question clé de la décentralisation de l’optimum intertemporel au sein même de chaque génération. Question pourtant essentielle quand on sait que les mesures de régulation généralement conçues dans un cadre statique ne garantissent pas, si subtiles soient-elles, la durabilité à long terme de nos économies, par-delà le fait d’être par essence dynamiquement sous-optimales. À cet égard, Farzin (1996) a bien montré que le simple fait de tenir compte des externalités liées à l’accumulation de pollutions et au franchissement possible de seuils critiques devait déjà conduire à des actions plus ambitieuses que celles qu’induirait la seule considération (et donc) taxation des externalités de flux.
Attendu toutefois qu’un tel problème, et en amont la question consistant à s’interroger de façon plus large sur les meilleurs moyens de décentraliser les solutions dynamiquement optimales, mériteraient un traitement dans une contribution à part entière, retenons au moins ici que le fait que certaines pollutions n’induisent de dommages que passés certains seuils devrait ôter définitivement toute illusion que l’on peut, au fond, toujours intervenir « après coup »; au risque de devoir en réalité se limiter alors à la seule lutte contre les émissions nouvelles, mais sans plus rien pouvoir contre les pertes irréparables induites par le dépassement de ces seuils[37]. Et c’est au fond un conseil de prudence d’ordre ancestral, même s’il est rarement suivi d’effets, que d’en appeler les pouvoirs publics à oeuvrer d’emblée contre la pollution, même quand elle impacte encore peu la collectivité, plutôt que de laisser s’accumuler des stocks et prendre le risque, alors déraisonnable, de franchir un point de non-retour.
Parties annexes
Remerciements
L’auteur tient à remercier les trois rapporteurs de la revue pour une lecture très attentive de la première version du manuscrit, de même qu’il tient à remercier sa collègue Virginie Forest de l’Université de Lyon, pour ses remarques également constructives. L’auteur reste naturellement le seul responsable des éventuelles erreurs et inévitables omissions.
Notes
-
[1]
Entre ceux pour lesquels il est une nouvelle « ruse du capital » (Fernando, 2003) ou une « imposture » (Latouche, 2003) et ceux, partisans d’un « environnementalisme de marché » radical (Lajoie et Blais, 1999), comme Rothbard (1982), Lepage (1985), Anderson et Leal (1991) ou Machan (1995), dont on sent qu’ils craignent qu’il devienne la future idéologie totalitaire.
-
[2]
Pezzey fait précisément état de 37 définitions, attendu que 7 ans après, Dobson (1996) en dénombrera déjà plus de 300.
-
[3]
On sait que leur étude fît l’objet de vives critiques (Beckerman, 1972) et que nombre de prédictions ont déjà été démenties. Pourtant, à lire le dernier opus de trois d’entre eux (Meadows, Randers et Meadows, 2004), leurs estimations d’alors seraient en deçà de la réalité, s’avouant ainsi « bien plus pessimistes [qu’ils ne l’étaient] en 1972 » (p. 5).
-
[4]
Si on sait, s’agissant de la confrontation marché vs démocratie, que l’un n’est pas synonyme de l’autre, il semble toutefois réducteur de les opposer presque systématiquement. Ces institutions se sont souvent avérées plus complémentaires dans le temps que vraiment substituables et ce, malgré les limites propres à la démocratie comme à l’économie de marché (Fitoussi, 2004).
-
[5]
Ce flou se retrouve chez Grinevald (2005) qui écrit de même que « la décroissance n’est pas une croissance économique négative, c’est une autre logique, une autre politique dans tous les domaines » (p. 37), mais sans plus de détails analytiques.
-
[6]
Ainsi serait-elle responsable des inégalités, du stress, des troubles psychosomatiques et alimentaires, des allergies, du diabète, des cirrhoses, des cancers et autres maladies cardiovasculaires, même si on pourra discuter de la ténacité du lien puisqu’il n’est pas sûr et certain que les générations des Trente Glorieuses furent aussi malades et stressées des excès de la croissance d’alors.
-
[7]
Due à Rees (1992) et Wackernagel et Rees (1996), l’idée d’empreinte écologique a connu un fort succès. Il s’agit toutefois d’un indice physique qui a fait l’objet de critiques en économie, notamment s’agissant de l’agrégation de l’impact des activités via leur degré de pression sur les ressources, et non via leur prix de marché (qui ont pourtant, sous conditions, un sens en termes de bien-être), ou encore de la pondération dans l’indice, sans plus de correspondance sociétale (Bergh et Verbruggen, 1999).
-
[8]
En tout cas assurément de biens non durables.
-
[9]
Voire plus de biens au fond, dès lors qu’ils seraient durables et viendraient en remplacer d’autres qui ne le sont pas.
-
[10]
L’idée d’une substituabilité infinie à long terme n’est pas incongrue côté offre. Moins que d’affirmer qu’on peut de même substituer indéfiniment des biens matériels aux actifs naturels côté demande. C’est ainsi que Solow (1992 : 9) écrit que la « substituabilité a sa place en des termes raisonnables », même s’il est clair que le terme « raisonnable » n’a pas le même sens pour tous.
-
[11]
Frederick, Loewenstein et O’Donoghue (2002) livrent une remarquable synthèse des arguments opposant l’actualisation « standard » (exponentielle) à ses alternatives, notamment hyperbolique.
-
[12]
Weitzman (2001) offrira ensuite une spécification en forme de loi gamma du processus d’actualisation auquel les agents se livrent souvent quand on leur demande d’apprécier le futur éloigné. Bien que tout y soit très incertain, ils surestiment souvent le pire, au point qu’utiliser des facteurs d’actualisation décroissants avec le temps (c.-à-d. revalorisant le futur) n’est pas si incohérent.
-
[13]
L’escompte du bien-être des générations futures à un taux de même exponentiel réduit la portée de cette critique.
-
[14]
Question au fond plus pratique et empirique que théorique. C’est le sens des réponses de Stiglitz (1997) et Solow (1997) à Daly (1997a), suite à sa énième charge contre leurs travaux de 1974, réponses contre lesquelles sa propre réplique (Daly, 1997b) reste peu convaincante. L’idée d’Ayres (2007) d’établir les limites pratiques à la substituabilité est, à ce titre, plus séduisante.
-
[15]
Riley (1980), puis Dasgupta et Mitra (1983) prolongeront le débat ouvert par Solow (1974b), tandis que Takayama (1985) montrera que sa solution peut s’obtenir dans le cadre du contrôle optimal, en actualisant la somme des biens-êtres instantanés à un taux ρ continûment décroissant (actualisation hyperbolique).
-
[16]
Soit β < 0,5 < α dans le cas de la fonction Cobb-Douglas Y = KαRβ envisagée par Solow.
-
[17]
Imparfaitement puisqu’en raison de l’imperfection des marchés de capitaux et de matières, les fluctuations de cours rendent impossible une gestion aussi rationnelle des ressources sur le long terme (Mäler, 1986). Asheim, Buchholz et Withagen (2003) ont d’ailleurs montré depuis qu’un sous-investissement des rentes n’est pas incompatible avec un maintien de la consommation.
-
[18]
Dixit, Hammond et Hoel (1980) avaient montré au préalable, mais dans un cadre élargi à diverses formes de capital, que l’équité intertemporelle serait assurée si l’investissement net en capital, net du désinvestissement lié à l’extraction, restait constant dans le temps mais pas forcément nul.
-
[19]
Techniquement, il s’agit de placer un poids non nul (1 – β ≠ 0) sur le comportement limite de l’utilité à l’infini. Comme le note Asheim (1996 : 58), « ce second terme (…) agit comme un instrument pour conserver des stocks positifs ».
-
[20]
Backstop technology n’a pas de traduction immédiate. On peut proposer « technologie coup d’arrêt » puisqu’il s’agit d’une technologie de substitution qui, si elle devient accessible, met un terme à l’emploi de l’ancienne.
-
[21]
Ce, même si les cas d’extinction sont légion, avec des effets parfois dramatiques si on en suit la thèse de Diamond (2005), thèse toutefois contestée par les historiens, archéologues et anthropologues réunis autour de McAnany et Yoffee (2010).
-
[22]
L’ouvrage de Heal (1998) reprend tous leurs travaux sur un mode pédagogique.
-
[23]
Le taux d’escompte de l’utilité des générations doit être inférieur au produit du taux marginal de substitution entre la ressource préservée et la consommation et l’inverse de la productivité marginale de la ressource à l’état stationnaire (ρ < UmS/UmC × 1/FR).
-
[24]
Le stock A de ressource évolue conformément à Åt = – α Ct + R(At), où R(At) est son renouvellement naturel, classiquement selon une loi logistique, et où sa dégradation par la pollution tient à la consommation (-α Ct) de biens produits avec du capital [Y = F(K)].
-
[25]
Le stock évolue ainsi : ŚP = α Y – σ(A) SP, où les émissions dépendent de la production (αY) et où le taux σ d’assimilation des polluants stockés SP peut être impacté à la hausse par le niveau A des dépenses en dépollution σ(A).
-
[26]
Smulders (1995) confrontait déjà une quinzaine de références, auxquelles on peut ajouter celles d’Elbasha et Roe (1996), Stokey (1998) ou Carraro (1998) par exemple. D’autres (cf. Chevé, 2000), croisent en plus cette littérature avec celle introduisant des discontinuités ou des non-linéarités, par exemple sur les dommages écologiques ou l’assimilation naturelle des polluants.
-
[27]
C’est d’ailleurs bien le centre d’intérêt du travail de Mäler, Xepapadeas et de Zeeuw (2003), qui porte sur les lacs en eaux peu profondes, alors que c’est moins clair chez Forster (1975) ou Tahvonen et Salo (1996), faute de précisions.
-
[28]
L’article d’Antweiller, Copeland et Taylor (2001), tout comme l’ouvrage des deux derniers (cf. Copeland et Taylor, 2003), poursuivent sur cette voie en montrant, toujours pour le SO2 mais au plan mondial, que l’échange international serait plutôt favorable à l’environnement et que le Sud ne se serait pas spécialement la terre d’élection des activités les plus polluantes.
-
[29]
En lien avec les travaux/réflexions de Khazzoom (1980; 1987; 1989) et Brookes (1978, 1990, 1993, 2000), économistes de l’énergie ayant réinvesti le paradoxe de Jevons et la question de la hausse de la consommation énergétique globale induit par l’adoption de procédés, moyens, et autres innovations, à l’efficacité énergétique pourtant supérieure.
-
[30]
Dinda (2004) en offre également un très bon aperçu, de même qu’Aslanidis (2009) s’agissant du cas particulier du CO2 à propos duquel l’émergence d’un consensus autour d’une CEK semble éloignée vu la succession de résultats contraires.
-
[31]
Ce travail ouvrit la voie à la comptabilité verte et donc aux indicateurs de « PNB verts » devant intégrer les ressources naturelles et environnementales qui s’épuisent/se dégradent.
-
[32]
Notre avis rejoint celui de Neumayer (1999) dans sa critique de l’indice de bien-être économique durable (cf.infra).
-
[33]
Signalons ici le travail séminal de Weitzman (1976) sur le produit national net comme mesure pertinente, ou non, du bien-être et comme approximation de la consommation maximale qu’il est possible de maintenir indéfiniment. Question émaillée de débats sur la pertinence d’utiliser un flux (revenu net) ou un stock (valeur des stocks de ressources) pour évaluer le bien-être d’un pays et tenter d’en apprécier la soutenabilité (cf. Mäler, 1991; Asheim, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007; Dasgupta et Mäler, 2000; Asheim et Weitzman, 2001; Mäler, 2007 et 2008, ou Dasgupta, 2009).
-
[34]
Brander et Taylor simulent l’évolution démographique du peuple polynésien ayant colonisé l’Île de Pâques et qui, après une croissance spectaculaire (× 250), aurait disparu faute d’avoir trouvé les arrangements institutionnels susceptibles de juguler la surexploitation des ressources. Le modèle pose toutefois une absence de progrès technique discutable (Decker et Reuveny, 2005).
-
[35]
Question posant forcément celle de la nécessité, ou non, de règles amont s’imposant à tous, fusse par précaution et dussent-elles être naturellement débattues démocratiquement et non imposées sans discussion.
-
[36]
Qu’on songe ici à la corrélation souvent supposée entre sociétés plus inégalitaires, soulevant la question de l’équité au sein des générations, et leur possible propension accrue à négliger l’environnement, soulevant celle de l’équité entre générations.
-
[37]
Farzin (1996) livre d’ailleurs une simulation intéressante pour le CO2 et le réchauffement climatique, invitant à agir tôt et non seulement quand on aura passé un certain stock fatidique dans l’atmosphère; et ce, même si son modèle et sa simulation reposent sur une hypothèse clairement forte d’absence totale d’assimilation naturelle du carbone.
Bibliographie
- Allais, M. (1947), Économie et intérêt, Imprimerie Nationale et Librairie des Publications Officielles, Paris, 800 p. (2 vol.).
- Anderson, T.L. et D.R. Leal (1991), Free Market Environmentalism, Pacific Research Institute for Public Policy, San Francisco, 208 p. [Version augmentée rééditée en 2001 chez Palgrave, New York, 241 p.].
- Antweiler, W., B.R. Copeland et M.S. Taylor (2001), « Is Free Trade Good for the Environment? », American Economic Review, 91(4) : 877-908.
- Ariès, P. (2005), Décroissance ou barbarie, Golias, Villeurbanne, 162 p.
- Ariès, P. (2007), La décroissance. Un nouveau projet politique, Golias, Villeurbanne, 362 p.
- Arrow, K., B. Bolin, R. Costanza, P. Dasgupta, C. Folke, C.S. Holling, B-O. Jansson, S. Levin, , K-G. Mäler, C. Perrings, et D. Pimentel (1995), « Economic Growth, Carrying Capacity, and the Environment », Ecological Economics, 15(2) : 91-95.
- Arge (D’), R. et H. Kogiku (1973), « Economic Growth and the Environment », Review of Economic Studies, 40(1) : 61-77.
- Asako, K. (1980), « Economic Growth and Environmental Pollution under the Max-Min Principle », Journal of Environmental Economics and Management, 7(3): 157-183.
- Asheim, G.B. (1986), « Hartiwck’s Rule in Open économies », Canadian Journal of Economics, 19(3) : 395-402.
- Asheim, G.B. (1994), « Net National Product as an Indicator of Sustainability », Scandinavian Journal of Economics, 96(2) : 257-265.
- Asheim, G.B. (1996), « Ethical Preferences in the Presence of Resource Constraints », Nordic Journal of Political Economy, 23 : 55-67.
- Asheim, G.B. (1997), « Adjusting Green NNP to Measure Sustainability », Scandinavian Journal of Economics, 99(3) : 355-370.
- Asheim, G.B. (2000), « Green National Accounting: Why and How? », Environment and Development Economics, 5(1) : 25-48.
- Asheim, G.B. (2003), « Green National Accounting for Welfare and Sustainability: A Taxonomy of Assumptions and Results », Scottish Journal of Political Economy, 50(2) : 113-130.
- Asheim, G.B. (2007), « Can NNP Be Used for Welfare Comparisons? », Environment and Development Economics, 12(1) : 11-31.
- Asheim, G.B., W. Buchholz et C. Withagen (2003), « The Hartwick Rule: Myths and Facts », Environmental & Resource Economics, 25(2) : 129-150.
- Asheim, G.B. et M.L. Weitzman (2001), « Does NNP Growth Indicate Welfare Improvement? », Economics Letters, 73(2) : 233-239.
- Aslanidis, N. (2009), « Environmental Kuznets Curves for Carbon Emissions: A Critical Survey », Document de travail n°7/2009 du Département d’économie de l’Université Rovira i Virgili, Reus.
- Autume (D’), A. et K. Schubert (2008), « Hartwick’s Rule and Maximin Paths When the Exhaustible Resource Has an Amenity Value », Journal of Environmental Economics and Management, 56(3) : 260-274.
- Ayong Le Kama, A., C. Le Van et K. Schubert (2008), « A Non-dictatorial Criterion for Optimal Growth Models », Document de travail n°2008/30 du CES (Sorbonne), Paris.
- Ayres, R.U. (2007), « On the Practical Limits to Substitution », Ecological Economics, 61(1) : 115-128.
- Becker, R.A. (1982), « Intergenerational Equity: The Capital-Environment Trade-off », Journal of Environmental Economics and Management, 9(2) : 165-185.
- Beckerman, W. (1972), « Economists, Scientists and Environmental Catastrophe », Oxford Economic Papers, 24(3) : 327-344.
- Beckerman, W. (1992), « Economic Growth and the Environment: Whose Growth? Whose Environment? », World Development, 20(4) : 481-496.
- Beltratti,A., G. Chichilnisky et G. Heal (1993), « Sustainable Growth and the Green Golden Rule », NBER Working Paper n°4430 (Aug.).
- Beltratti,A., G. Chichilnisky et G. Heal (1994), « The Environment and the Long Run: A Comparison of Different Criteria », Ricerche Economiche, 48(3/4) : 319-340.
- Beltratti,A., G. Chichilnisky et G. Heal (1998), « Sustainable Use of Renewable Resources », inChichilnisky, G., G. Heal et A. Vercelli (éds), Sustainability: Dynamics and Uncertainty, Kluwer Academic Publishers, Boston, 334 p.
- Bergh (van den), J.C.J.M (2001), « Ecological Economics: Themes, Approaches, and Differences with Environmental Economics », Regional Environmental Change, 2(1) : 13-23.
- Bergh (van den), J.C.J.M. et H. Verbruggen (1999), « Spatial Sustainability, Trade And Indicators: An Evaluation of the ‘Ecological Footprint’ », EcologicalEconomics, 29(1) : 61-72.
- Brander, J.A. et M.S. Taylor (1998), « The Simple Economics of Easter Island: A Ricardo-Malthus Model of Renewable Resource Use », American Economic Review, 88(1) : 119-138.
- Brock, W.A. (1977), « A Polluted Golden Age »; texte original reproduit aux pages 201-214 de : Scientific Essays of William A. Brock : Growth Theory, Non Linear Dynamics and Economic Modelling, paru en 2001 sous la direction de W. Dechert, Edward Elgar – Economists of the 20th Century, Cheltenham.
- Brock, W.A et M.S. Taylor (2004), « Economic Growth and the Environment: A Review of Theory and Empirics », NBER Working Paper n°10854 (Oct.).
- Brookes, L.G (1978), « The Energy Price Fallacy and the Role of Nuclear Energy in the UK », Energy Policy, 6(2) : 94-106.
- Brookes, L.G. (1990), « The Greenhouse Effect: The Fallacies in the Energy Efficiency Solution », Energy Policy, 18(2) : 199-201.
- Brookes, L.G (1993), « Energy Efficiency Fallacies: The Debate Concluded », Energy Policy, 21(4) : 346-347
- Brookes, L.G (2000), « Energy Efficiency Fallacies Revisited », Energy Policy, 28(6-7) : 355-366.
- Brundtland, G.H. (1987), Our Common Future. World Commission on Environment and Development Report, Oxford University Press, New York [version franç. : Notre avenir à tous – Rapport de la commission mondiale sur l’environnement et le développement, Editions du Fleuve, 1988, Montréal, 432 p.].
- Carraro, C. (1998), « New Economic Theories. Impacts on Environmental Economics », Environmental and Resource Economics, 11(3-4) : 365-381.
- Cesar, H. et A. de Zeeuw (1994), « Sustainability and the Greenhouse Effect: Robustness Analysis of the Assimilation Function », in Filar J. et C. Carraro (éds), Control and Game Theoretical Models of the Environment, Birkhäuser, Boston.
- Chevé, M. (2000), « Irreversibility of Pollution Accumulation », Environmental and Resource Economics, 16(1) : 93–104.
- Cheynet, V. (2008), Le choc de la décroissance, Seuil – L’histoire immédiate, Paris, 214 p.
- Chichilnisky, G. (1996), « An Axiomatic Approach to Sustainable Development », Social Choice and Welfare, 13(2) : 231-257.
- Chichilnisky, G. (1997), « What is Sustainable Development? », Land Economics, 73(4) : 467-491.
- Chichilnisky, G., G. Heal et A. Beltratti (1995), « The Green Golden Rule », Economic Letters, 49(2) : 175-179.
- Cleveland, C.J. et M. Ruth (1997), « When, Where and by How Much Do Biophysical Limits Constrain the Economic Process? A Survey of Nicholas Georgescu-Roegen’s Contribution to Ecological Economics », Ecological Economics, 22(3) : 203-223.
- Copeland, B.R. et M.S. Taylor (2003), Trade and the Environment: Theory and Evidence, Princeton University Press – Princeton Series in International Economics, Princeton, 304 p.
- Costanza, R. (1989), « What is Ecological Economics? », Ecological Economics, 1(1): 1-7.
- Costanza, R. (2003), « The Early History of Ecological Economics and the International Society for Ecological Economics (ISEE) », ISEE Internet Encyclopaedia of Ecological Economics [Disponible à : www.ecoeco.org/education_encyclopedia.php].
- Costes, F., V. Martinet et G. Rotillon (2008), « Lois de conservation économiques et développement durable », Annales d’économie et de statistique, n°90 (avril/juin) : 103–127.
- Daly, H.E. (1968), « On Economics as a Life Science », Journal of Political Economy, 76(3) : 392-406.
- Daly, H.E. (1972), « In Defence of a Steady-State Economy », American Journal of Agricultural Economics, Proceeding Issue, 54(5) : 945-954.
- Daly, H.E. (1974a), « The Economics of the Steady State », American Economic Review, AEA P&P., 64(2) : 15-21.
- Daly, H.E. (1974b), « Steady-state Economics vs. Growthmania: A Critique of the Orthodox Conceptions of Growth, Wants, Scarcity, and Efficiency », Policy Sciences, 5(2) : 149-167.
- Daly, H.E. (1977), Steady-State Economics: The Economics of Biophysical Equilibrium and Moral Growth, Freeman & Co., NY, réédité en 1991 sous le titre : Steady-State Economics: 2nd Edition with New Essays, Island Press, Washington DC, 297 p.
- Daly, H.E. (1997a), « Forum - Georgescu-Roegen vs. Solow/Stiglitz », Ecological Economics, 22(3) : 261-266.
- Daly, H.E. (1997b), « Forum - Reply to Solow/Stiglitz », Ecological Economics, 22(3) : 271-273.
- Dasgupta, P. (2008), « Nature in Economics », Environmental and Resource Economics, 39(1) : 1-7.
- Dasgupta, P. (2009), « The Welfare Economic Theory of Green National Accounts », Environmental and Resource Economics, 42(1) : 3-38.
- Dasgupta, P. et G. Heal (1974), « The Optimal Depletion of Exhaustible Resources », Review of Economic Studies, 41(Symposium on the Economics of Exhaustible Resources) : 3-28.
- Dasgupta, P. et K-G. Mäler (2000), « Net National Product, Wealth, and Social Well-Being », Environment and Development Economics, 5(1) : 69-93.
- Dasgutpa, P. et K-G. Mäler (2003), « The Economics of Non-convex Ecosystems: Introduction », Environmental and Resource Economics, 26(4) : 499–602.
- Dasgupta, P. et T. Mitra (1983), « Intergenerational Equity and Efficient Allocation of Exhaustible Resources », International Economic Review, 24(1) : 133-153.
- De Bruyn S.M., J.C.J.M. van denBergh et J.B. Opschoor (1998), « Economic Growth and Emissions: Reconsidering the Empirical Basis of Environmental Kuznets Curves », Ecological Economics, 25(2) : 161-175.
- Decker, Ch.S. et R. Reuveny (2005), « Endogenous technological progress and the Malthusian Trap: Could Simon and Boserup Have Saved Easter Island? », Human Ecology, 33(1) : 119-140.
- Diamond, J. (2005), Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Viking Press, New-York [version franç. : Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Gallimard - Nrf Essais, Paris, 648 p.].
- Dinda, S. (2004), « Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey », Ecological Economics, 49(4) : 431–455.
- Dixit, A., Hammond P. et M. Hoel (1980), « On Hartwick’s Rule for Regular Maximin Paths of Capital Accumulation and Resource Depletion », Review of Economic Studies, 47(3) : 551-556.
- Dobson, A. (1996), « Environmental Sustainabilites: An Analysis and a Typology », Environmental Politics, 5(3) :401-428.
- Dostaler, G. (2000), « De la domination de l’économie au néo-libéralisme », Possibles, 24(2-3) : 11–26.
- Dupuy, J-P. (2002), Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, Paris, 216 p.
- Farzin, Y. H. (1996), « Optimal Pricing of Environmental and Natural Resource Use with Stock Externalities », Journal of Public Economics, 62(1-2) : 31-57.
- Fernando, J. (2003), « The Power of Unsustainable Development: What Is to Be Done? — Preface to the Special Issue ‘Rethinking Sustainable Development’ », Annals of the American Association of Political and Social Science, 590(1) : 6-34.
- Figuières, Ch. et M. Tidball (2006), « Sustainable Exploitation of a Natural Resource: A Satisfying Use of Chihilnisky’s Criterion », Document de recherche 2006/03 du Lameta.
- Fitoussi, J-P. (2004), La démocratie et le marché, Grasset – Nouveau Collège de Philosophie, Paris, 104 p.
- Fitoussi, J-P. et E. Laurent (2008), La nouvelle écologie politique, Seuil – La République des Idées, Paris, 120 p.
- Forster, B.A. (1973), « Optimal Consumption Planning in a Polluted Environment », Economic Record, 49(4) : 534-545.
- Forster, B.A. (1975), « Optimal Pollution Control with a Nonconstant Exponential Rate of Decay », Journal of Environmental Economics and Management, 2(1) : 1-6.
- Frederick, S., G. Loewenstein et T. O’Donoghue (2002), « Time Discounting and Time Preference: A Critical Review », Journal of Economic Literature, 40(2) : 351-401.
- Friedl, B. et M. Getzner (2003), « Determinants of CO2 Emissions in a Small Open Economy », Ecological Economics, 45(1) : 133-148.
- Gadrey, J. et F. Jany-Catrice (2005), Les nouveaux indicateurs de richesse, La Découverte – Repères, n°404, Paris, 128 p. [Issu d’un Rapport pour la Dares (Paris, mars 2003), signé des mêmes auteurs et intitulé : Les indicateurs de richesse et de développement. Un bilan inter-national en vue d’une initiative française].
- Georgescu-Roegen, N. (1971), The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge, 450 p.
- Georgescu-Roegen, N. (1975), « Energy and Economic Myths », Southern Economic Journal, 41(3) : 347-381.
- Georgescu-Roegen, N. (1978) « De la science économique à la bio-économie », Revue d’économie politique, 88(3) : 357-382.
- Georgescu-Roegen, N. (1979), Demain la décroissance, Editions Pierre-Marcel Favre, Paris & Lausanne, 157 p. (morceaux choisis d’écrits de NGR traduits par J Grinevald et I. Rens); réédité en 1995 sous le titre : La décroissance. Entropie–Écologie–Économie, Editions Sang de la Terre, Paris, 254 p. [Disponible à www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html].
- Gerlagh, R. et M.A. Keyzer (2001), « Sustainability and the Intergenerational Distribution of Natural Resource Entitlements », Journal of Public Economics, 79(2) : 315-341.
- Godard, O. (1994), « Le développement durable : paysage intellectuel », Natures, Sciences, Sociétés, 2(4) : 309-322.
- Godard, O. (1998), « Le principe de précaution : renégocier les conditions de l’agir en univers controversé », natures, sciences, sociétés, 6(1) : 41-45.
- Godard, O. (2005), « Le développement-durable, une chimère, une mystification? », Mouvements, 41(sept/oct.) : 14-23.
- Gradus, R. et S. Smulders (1993), « The Trade-off Between Environmental Care and Long-term Growth. Pollution in Three Prototype Growth Models », Journal of Economics, 58(1) : 25-51.
- Grinevald, J. (2005), « La décroissance n’est pas une croissance économique négative, c’est une autre logique », in P. Matagne (dir.), Les enjeux du développement durable, L’Harmattan, Paris, 216 pages.
- Grossman, G.M et A.B. Krueger (1991), « Environmental Impact of a North American Free Trade Agreement », NBER WP N°3914; reproduit en 1993, p. 13-56 in Garber, P. (dir.) The Mexico-US Free Trade Agreement, MIT Press, Cambridge.
- Grossman, G.M et A.B. Krueger (1995), « Economic Growth and the Environment », Quarterly Journal of Economics, 110(2) : 353–377.
- Gruver, G.W. (1976), « Optimal Investment in Pollution Control Capital in a Neoclassical Growth Context », Journal of Environmental Economics and Management, 3(3) : 165-177.
- Harrod, R.F. (1948), Toward a Dynamic Economics. Some Recent Developments of Economic Theory and their Application to Policy, Macmillan, Londres, 168 p.
- Hartwick, J. (1977), « Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources », American Economic Review, 77(5) : 972-974.
- Hartwick, J.M. (1978a), « Investing Returns from Depleting Renewable Resource Stocks and Intergenerational Equity », Economics Letters, 1(1) : 85-88.
- Hartwick, J.M. (1978b), « Substitution Among Exhaustible Resources and Intergenerational Equity », Review of Economic Studies, 45(2) : 347-354.
- Harbaugh, W.T., A. Levinson et D.M. Wilson (2002), « Reexamining The Empirical Evidence For An Environmental Kuznets Curve », Review of Economics and Statistics, 84(3) : 541-551.
- Heal, G. (1998), Valuing the Future. Economic Theory and Sustainability, Columbia University Press — Economics for a Sustainable Earth Series, New York, 226 p.
- Henry, C. (1990), « Efficacité économique et impératifs éthiques : l’environnement en co-propriété », Revue économique, 41(2) : 195-214.
- Hettige, H., R. Lucas et D. Wheeler (1992) « The Toxic Intensity of Industrial Production: Global Patterns, Trends, and Trade Policy », American Economic Review, AEA P&P, 82(2) : 478-481.
- Holtz-Eakin, D. et T.M. Selden (1995), « Stoking the Fires? CO2 Emissions and Economic Growth », Journal of Public Economics, 57(1) : 85-101.
- Hotelling, H. (1931), « The Economics of Exhaustible Resources », Journal of Political Economy, 39(2) : 137-175.
- Howarth, R.B. (1991), « Intertemporal Equilibria and Exhaustible Resources: An Overlapping Generations Approach », Ecological Economics, 4(3) : 237-252.
- Howarth, R.B. (1995), « Sustainability under Uncertainty: A Deontological Approach », Land Economics, 71(4) : 417-427.
- Howarth, R.B. (1996), « Climate Change and Overlapping Generations », Contemporary Economic Policy, 14(4) : 100-111.
- Howarth, R.B. (1997), « Sustainability as Opportunity », Land Economics, 73(4) : 569-579.
- Howarth, R.B. (1998), « An Overlapping Generations Model of Climate-Economy Interactions », Scandinavian Journal of Economics, 100(3) : 575-591.
- Howarth, R.B. (2007), « Towards an Operational Sustainability Criterion », Ecological Economics, 63(4) : 656–663.
- Howarth, R.B. et R.B. Norgaard (1990), « Intergenerational Resource Rights, Efficiency, and Social Optimality », Land Economics 66(1) : 1-11.
- Howarth, R.B. et R.B. Norgaard (1992), « Environmental Valuation Under Sustainable Development », American Economic Review, AEA P&P., 82(2) : 473-477.
- Jackson, T. et S. Stymne (1996), « Sustainable Economic Welfare in Sweden: A Pilot Index 1950–1992 », Stockholm Environment Institute [sei-international.org/Policy/sustainable_economic_welfare_sweden.pdf]
- Jevons, W.S. (1865), The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation and the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines, Macmillan and Co., Londres, 467 p. [2nde éd. datée de 1866 : www.econlib.org/LIBRARY/YPDBooks/Jevons/jvnCQ1.html].
- Jonas, H. (1979), Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Insel Verlag, Francfort, 423 p. [Version franç. : Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, 1990, Editions du Cerf – Passages, Paris, 345 p.].
- John, A et R. Pecchenino (1994), « An Overlapping Generations Model of Growth and the Environment », Economic Journal, 104(427) : 1393-1410.
- Khazzoom, J.D. (1980), « Economic Implications of Mandated Efficiency Standards for Household Appliances », Energy Journal, 1(4): 21-40.
- Khazzoom, J.D. (1987), « Energy Saving Resulting from the Adoption of More Efficient Appliances », Energy Journal, 8(4): 85-89.
- Khazzoom, J.D. (1989), « Energy Savings from More Efficient Appliances: A Rejoinder », Energy Journal, 10(1): 157-166.
- Keeler, E., M. Spence et R. Zeckhauser (1972), « The Optimal Control of Pollution », Journal of Economic Theory, 4(1) : 19-34.
- Koopmans, T.C. (1960), « Stationary Ordinal Utility and Impatience », Econometrica, 28(2) : 287-309.
- Koskela, E., M. Ollikainen et M. Puhakka (2002), « Renewable Resources in an Over-lapping Generations Economy Without Capital », Journal of Environmental Economics and Management, 43(3) : 497-517.
- Krautkraemer, J.A. (1985), « Optimal Growth, Resources Amenities and Preservation of Natural Environment », Review of Economic Studies, 52(1) : 153-170.
- Kuznets, S. (1955), « Economic Growth and Income Inequality », America Economic Review, 45(1) : 1–28.
- Lajoie, N. et F. Blais (1999), « Une réconciliation est-elle possible entre l’environnement et le marché? Une évaluation critique de deux tentatives », Politique et Sociétés, 18(3) : 49-77.
- Lantz, V. et Q. Feng (2006), « Assessing Income, Population, and Technology Impacts on CO2 Emissions in Canada: Where’s the EKC? » Ecological Economics, 57(2) : 229-238.
- Latouche, S. (1989), L’occidentalisation du monde. Essai sur la signification, la portée et les limites de l’uniformisation planétaire, La Découverte – Agalma, Paris, 214 p.
- Latouche, S. (2001), « Les mirages de l’occidentalisation du monde. En finir, une fois pour toutes, avec le développement », Le Monde Diplomatique, n° de mai : 6-7.
- Latouche, S. (2003), « L’imposture du développement durable ou les habits neufs du développement », Mondes en Développement, 31(121) : 23-30.
- Latouche, S. (2004) « Contre l’ethnocentrisme du développement. Et la décroissance sauvera le Sud... », Le Monde Diplomatique, n° de novembre : 18-19.
- Latouche, S. (2006), Le pari de la décroissance, Fayard, Paris, 302 p.
- Latouche, S. (2007), Petit traité de la décroissance sereine, Mille et une nuits, Paris, 171 p.
- Le Bras, H. (2009), Vie et mort de la population mondiale, Le Pommier/Cité des Sciences et de l’Industrie – Le collège de la cité, Paris, 192 p.
- Lecocq, F. et J-Ch. Hourcade (2004), « Le taux d’actualisation contre le principe de précaution? Leçons à partir du cas des politiques climatiques », L’Actualité économique – Revue d’analyse économique, 80(1) : 41-65.
- Lepage, H. (1985), « Capitalisme et écologie : privatisons l’environnement! », in Pourquoi la propriété, Hachette – Pluriel, Paris, 465 p.
- Lucas, R.E. (1988). « On the Mechanics of Economic Development », Journal of Monetary Economics, 22(1) : 3-42.
- McAnany, P.A. et N. Yoffee (2010), Questioning Collapse. Human Resilience, Ecological Vulnerability and the Aftermath of Empire, Cambridge University Press, New York, 374 p.
- Machan, T. (1995), Private Rights and Public Illusions, Transaction Publishers, New Brunswick, 379 p.
- Madlener, R. et B. Alcott (2009), « Energy Rebound and Economic Growth: A Review of the Main Issues and Research Needs », Energy, 34(3) : 370-376.
- Mäler, K-G. (1986), « On the Intergenerational Allocation of Natural Resources: Comment », Scandinavian Journal of Economics, 88(1) : 151-152.
- Mäler, K-G. (1991), « National Accounts and Environmental Resources », Environmental and Resource Economics, 1(1) : 1-15.
- Mäler, K-G. (2007), « Wealth and Sustainable Development: The Role of David Pearce », Environmental and Resource Economics, 37(1) : 63-75.
- Mäler, K-G. (2008), « Sustainable Development and Resilience in Ecosystems », Environmental and Resource Economics, 39(1) : 17-24.
- Mäler, K-G., A. Xepapadeas et A. de Zeeuw (2003), « The Economics of Shallow Lakes », Environmental and Resource Economics, 26(4) : 603-624.
- Malthus, Th. (1798), An Essay On The Principle Of Population; trad. franç. : Essai sur le principe de population, Gonthier – Médiations, 1963, Paris, 236 p. [versions anglaise et franç. disponibles à : www.econlib.org/library/Malthus/malPop.html et www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiquesdessciencessociales/index.html].
- Martin, H-R. (2007), Éloge de la simplicité volontaire, Flammarion, 275 p.
- Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. Randers et W.W. Behrens III (1972), The Limits to Growth. A Report to The Club de Rome; trad. franç. : Rapport sur les limites de la croissance, Fayard – Ecologie, 1972, Paris, 317 p.
- Meadows, D.H., J. Randers et D.L. Meadows (2004), Limits to Growth: The 30-Year Udpate, Chelsea Green Publishing, White River Junction, 368 p.
- Mill, J-S. (1848), Principles of Political Economy, with some of their Applications to Social Philosophy, John W.Parker, Londres [7e éd. Post-mortem : www.econlib.org/library/Mill/mlP1.html].
- Mourmouras, A. (1991), « Competitive Equilibria and Sustainable Growth in a Life-Cycle Model with Natural Resources », Scandinavian Journal of Economics, 93(4) : 585-591.
- Mourmouras, A. (1993), « Conservationist Government Policies and Intergenerational Equity in an Overlapping Generations Model with Renewable Resources », Journal of Public Economics, 51(2) : 249-268.
- Neumayer, E. (1999), « The ISEW – Not an Index of Sustainable Economic Welfare », Social Indicators Research 48(1) : 77-101.
- Nordhaus, W.D. et J. Tobin (1971), « Is Growth Obsolete? », Cowles Foundation DiscussionPapers n°319, Yale, 24 p. [http://ideas.repec.org/p/cwl/cwldpp/319.html].
- Oms-Unicef (2005), Water for Life: Making It Happen — Report of the Who/Unicef Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, WHO Press, 44 p.
- Panayotou, T. (1993), « Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development », WP N°238 du BIT (Technology & Employment Program), BIT, Genève.
- Partant, F. (1988), La ligne d’horizon. Essai sur l’après-développement, La Découverte – Cahiers Libres, Paris, réédité en 2007 chez le même éditeur, Poche/Essai n°246, 238 p.
- Pearce, D., Markandya, A. et E. Barbier (1989), Blueprint for a Green Economy, Earthscan Publications Ltd, Londres, 212 p.
- Pezzey, J.C. (1989), « Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development », World Bank Environment Department WP N°15 [reproduit en 1992 sous le titre : « Sustainable Development Concepts: An Economic Analysis » (WB Environment Paper N°2) et disponible ici : www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menu PK=64187510&searchMenuPK=64187283&siteName=WDS&entityID=000178830_98101911160728].
- Pezzey, J.C. et C.A. Withagen (1998), « The Rise, Fall and Sustainability of Capital-Resource Economies », Scandinavian Journal of Economics, 100(2) : 513-527.
- Pigou, A.C. (1932), The Economics of Welfare (4th ed.), Macmillan & Co., Londres [disponible à l’adresse suivante : www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html].
- Pindyck, R.S. (1978), « The Optimal Exploration and Production of Non-renewable Resources », Journal of Political Economy, 86(5) : 841-861.
- Piriou, J-P. (2004), La comptabilité nationale (12e éd.), La Découverte – Repères, n°57, Paris, 128 p.
- Ploeg (van der), F. et C. Whithagen (1991), « Pollution Control and the Ramsey Problem », Environmental and Resources Economics, 1(2) : 215-236.
- Proudhon, P-J. (1849), « Les Malthusiens », Fac-similé de l’édition originale datée du 10 août 1848 et parue ainsi un an après aux Editions Boulé, Paris, 6 p. [disponible à l’adresse suivante : www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiquesdessciencessociales/index.html].
- Ramsey, F.P. (1928), « A Mathematical Theory of Saving », Economic Journal, 38(152) : 543- 559.
- Rawls, J. (1971), A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 607 p.
- Rawls, J. (1974), « Some Reasons for the Maximin Criterion », American Economic Review, AEA P&P, 64(2) : 141-146.
- Rebelo, S. (1991), « Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth », Journal of Political Economy, 99(3) : 500-521.
- Rees, W.E. (1992), « Ecological Footprints and Appropriated Carrying Capacity: What Urban Economics Leaves Out », Environment and Urbanization, 4(2) : 121-130.
- Ricardo, D. (1817), On the Principles of Political Economy and Taxation, John Murray, Londres [2nde éd. de 1821 : www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html].
- Riley, J.G. (1980), « The Just Rate of Depletion of a Natural Resource », Journal of Environmental Economics and Management, 7(4) : 291-307.
- Robbins, L. (1930), « On a Certain Ambiguity in the Conception of Stationary Equilibrium », Economic Journal, 40(158) : 194-214.
- Romer, P.M. (1986), « Increasing Returns and Long-run Growth », Journal of Political Economy, 94(5) : 1002-1037.
- Romer, P.M. (1990), « Endogenous Technological Change », Journal of Political Economy, 98(5) : 71-102 [Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems; pp. S71-S102].
- Røpke, I. (2004), « The Early History of Modern Ecological Economics », Ecological Economics, 50(3-4) : 293-314.
- Rothbard, M. (1982), « Law, Property Rights and Air Pollution », Cato Journal, 2(1) : 55-99 [disponible ici : http://mises.org/rothbard/lawproperty.pdf].
- Rotillon, G. (2008), Faut-il croire au développement durable?, L’Harmattan – Questions Contemporaines, Paris, 220 p.
- Samuelson, P.A. (1937), « A Note on Measurement of Utility », Review of Economic Studies, 4(2) : 155-161.
- Saunders H.D. (1992), « The Khazzoom-Brookes Postulate and Neoclassical Growth », Energy Journal, 13(4) : 131-148.
- Scheffer, M., S.R. Carpenter, J.A. Foley, C. Folke et B. Walkerk (2001), « Catastrophic Shifts in Ecosystems », Nature, 413(Oct.) : 591–596.
- Scheffer, M. et S.R. Carpenter (2003), « Catastrophic Regime Shifts in Ecosystems: Linking Theory to Observation », Trends in Ecology and Evolution, 18(12) : 648-656.
- Selden, T.M. et D. Song (1994), « Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions? », Journal of Environmental and Economics Management, 27(2) : 147-162.
- Selden, T.M. et D. Song (1995), « Neoclassical Growth, the J Curve for Abatement, and the Inverted U Curve for Pollution », Journal of Environmental and Economics Management, 29(2) : 162-168.
- Shafik, N. (1994), « Economic Development and Environmental Quality: An Econometric Analysis », Oxford Economic Papers, 46(0-Supl.) : 757-773.
- Shafik, N. et S. Bandyopadhyay (1992), « Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-Country Evidence », World Bank Policy Research WP Series, N°904, Banque Mondiale, Washington-DC.
- Smulders, S. (1995), « Entropy, Environment, and Endogenous Economic Growth », International Tax and Public Finance, 2(2) : 319-340.
- Sneddon, C., Howarth, R. et R. Norgaard (2006), « Sustainable Development in a Post-Brundtland World », Ecological Economics, 57(2) : 253-268.
- Solow, R.M. (1974a), « The Economics of Resources or the Resources of Economics », American Economic Review, 64(2) : 972-974.
- Solow, R.M. (1974b), « Intergenerational Equity and Exhaustible Resources », Review of Economic Studies, 41(Symposium on the Economics of Exhaustible Resources) : 29-45.
- Solow, R.M. (1986), « On the Intergenerational Allocation of Natural Resources », The Scandinavian Journal of Economics, 88(1) : 141-149.
- Solow, R.M. (1992), « An Almost Practical Step Toward Sustainability. An Invited Lecture on the Occasion of the Fortieth Anniversary of Resources for the future », RFF Press (Oct.), Washington-DC, 28 p. [Reproduit en 1993 dans Resources Policy, 19(3) : 162-172].
- Solow, R.M. (1997), « Georgescu-Roegen vs. Solow/Stiglitz — Reply », Ecological Economics, 22(3) : 267-268.
- Stern, D.I. (2004), « The Rise and Fall of the Environment Kuznets Curve », World Development, 32(8) : 1419-1439.
- Stern, D. et M. Common (2001), « Is There an Environmental Kuznets Curve for Sulphur? », Journal of Environmental Economics and Management, 41(2) : 162-178.
- Stiglitz, J.E. (1974), « Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Optimal Growth Paths », Review of Economic Studies, 41(Symposium on the Economics of Exhaustible Resources) : 123-137.
- Stiglitz, J.E. (1997), « Georgescu-Roegen vs. Solow/Stiglitz — Reply », Ecological Economics, 22(3) : 269-270.
- Stokey, N.L. (1995), « R&D and Economic Growth », Review of Economic Studies, 62(3) : 469-489.
- Stokey, N.L. (1998), « Are There Limits to Growth? », International Economic Review, 39(1) : 1-31.
- Svensson, L.E. (1986), « On the Intergenerational Allocation of Natural Resources: Comment », Scandinavian Journal of Economics, 88(1) : 153-155.
- Tahvonen, O. et J. Kuuluvainen (1993), « Economic Growth, Pollution, and Renewable Resources », Journal of Environmental Economics and Management, 24(2) : 101-118.
- Tahvonen, O. et S. Salo (1996), « Nonconvexities in Optimal Pollution Accumulation », Journal of Environmental Economics and Management, 31(2) : 160-177.
- Takayama, A. (1985), Mathematical Economics — 2nd Ed., Cambridge University Press, Cambridge, 737 p.
- Toman, M.A. (1994), « Economics and “Sustainability”: Balancing Trade-Offs and Imperatives », Land Economics, 70(4) : 399-413.
- Vilquin, E. (1998), « Les valeurs morales de Malthus », Cahiers Québécois de Démographie, 27(2) : 181-198.
- Vivien, F-D. (2003), « Jalons pour une histoire de la notion de développement durable », Mondes en Développement, 31(2003/1) : 1-21.
- Wackernagel, M. et W.E. Rees (1996), Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth, New Society Publishers — The New Catalyst’s Bioregional Series of Books (n°9), Gabriola Island (BC), 160 p.
- Weitzman, M.L. (1976), « On the Welfare Significance of National Product in a Dynamic Economy », Quarterly Journal of Economics, 90(1) : 156-162.
- Weitzman, M.L. (1998), « Why the Far-Distant Future Should Be Discounted at Its Lowest Possible Rate », Journal of Environmental Economics and Management, 36(3) : 201-208.
- Weitzman, M.L. (2001), « Gamma Discounting », American Economic Review, 91(1) : 260-271.
- Withagen, C. (1994), « Pollution and Exhaustibility of Fossils Fuels », Resources and Energy Economics, 16(3) : 235-242.
- Xepapadeas, A. (2005), « Economic Growth and the Environment », Chap. 23 in K.G. Mäler et J.R. Vincent (éds), Handbook of Environmental Economics, vol. 23, 1re éd., , North Holland – Elsevier, Amsterdam, 556 p.
Liste des figures
Graphique 1
Déclin inéluctable d’une économie dépendante d’une ressource épuisable et maximisant la somme actualisée des niveaux de bien-être des générations
Graphique 2
Croissance optimale d’une économie dépendante d’une ressource épuisable mais bénéficiant d’un taux de progrès technique suffisant
Graphique 3
Maintien de la consommation d’une économie sans progrès technique et dépendante d’une ressource épuisable mais adoptant le principe du maximin
Graphique 4
L’apport utile mais insuffisant de la dimension aménitaire des ressources quand elles sont indispensables
Graphique 5
L’effet positif du caractère renouvelable de certaines ressources indispensables à la production et sources d’aménités
Graphique 6
L’effet de l’intégration des dommages liés à la pollution : moins de capital, moins de production, moins de consommation et donc moins de pollution à long terme
Graphique 7
Fonction d’assimilation naturelle de Forster (1975)
Graphique 8
Fonction d’assimilation concave-convexe de Tahvonen et Salo (1996)
Graphique 9
Hystérèse et irréversibilité chez Mäler, Xepapadeas et de Zeeuw (2003)
Graphique 10
Courbe environnementale à la Kuznets « type »



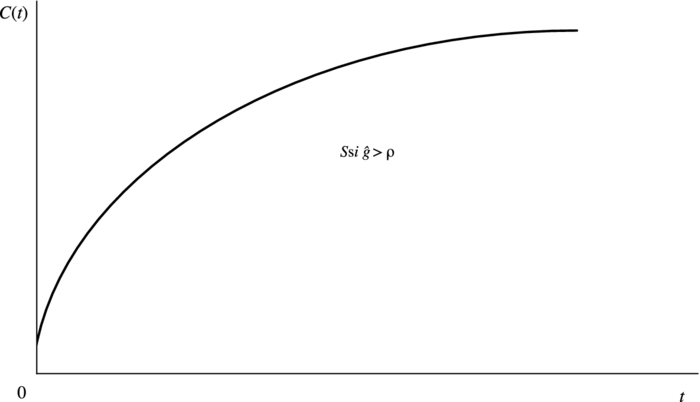




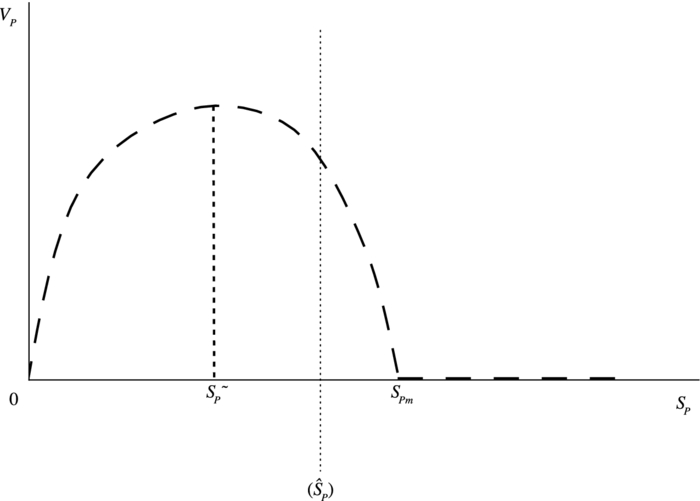



 10.7202/040191ar
10.7202/040191ar