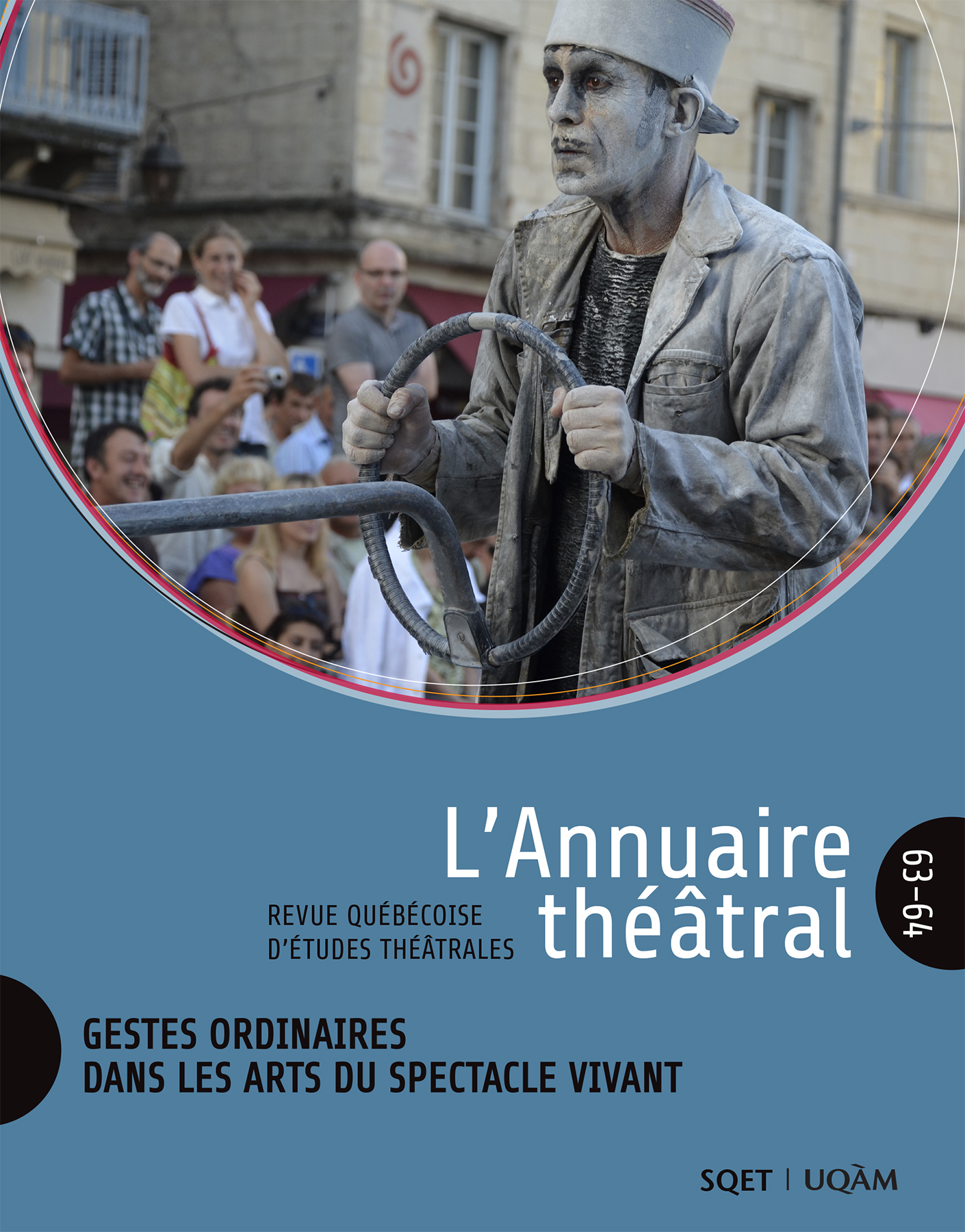Corps de l’article
Sophie Lucet : Cet entretien[2] aura pour thème la façon dont tu mets en jeu, dans Les bas-fonds de Maxime Gorki notamment, nos gestes ordinaires, ainsi que ta manière de les penser et de les transfigurer. Pourrais-tu tout d’abord esquisser une typologie des gestes ordinaires dans ton travail? Quels sont ceux que tu utilises le plus fréquemment et pourquoi?
Éric Lacascade : Il faut être précis sur le vocabulaire : quelle est la différence, par exemple, entre geste et mouvement, geste et action? Parlons du geste en tant qu’action. Les déplacements : s’asseoir, se lever, marcher; les gestes que nous accomplissons seuls : boire un verre, s’éponger le front… Ceux que nous accomplissons vers les autres ou contre eux, ou pour eux, et encore les gestes « à deux » : serrements de main, baisers, étreintes… En fait, je distinguerais deux types de gestes : les gestes intimes, personnels, solitaires, individuels, et les gestes qui tendent vers l’autre, qui amènent vers l’autre, sans doute plus nombreux dans mon théâtre, car c’est principalement le rapport à l’autre ou au groupe qui me conduit. Mon théâtre, constat sur la vie sans jugement moral, état des lieux de l’époque et de la société à un temps T, utilise donc tous les gestes de cette société, qu’ils aient une finalité ou qu’ils s’agencent dans un rituel. Dans la vie, le plus souvent, nous les exécutons en état de semi-conscience; or, je considère le plateau comme un terrain d’étude, et le théâtre comme un laboratoire de vie. Les gestes du quotidien sont l’expression directe de cette vie, ils sont le vocabulaire des situations que nous traversons, la grammaire physique de nos pulsions, de nos passions, etc. Je place ces gestes sous la loupe, sous le microscope, et je les dissèque. Je les « réveille » : d’où viennent-ils? Comment et pourquoi se produisent-ils? Que révèlent-ils? Comment se prolongent-ils? Car l’acteur a besoin de passer de la mécanicité à la pleine conscience pour articuler son jeu. Un geste est l’expression d’une multiplicité, l’étudier permet de préserver cette multiplicité, de ne pas « l’écraser »; en ne réduisant pas le geste, on y trouve une puissance, sa puissance. Se serrer la main, par exemple, c’est se dire bonjour, certes, mais c’est aussi une prise de pouvoir sur l’autre, on y ressent de la chaleur et c’est évidemment un contact physique qui peut être très agréable ou désagréable. Le plateau permet de travailler ce geste ordinaire en profondeur, et de le déployer dans toute sa palette.
Une fois que je les ai étudiés, compris, placés en situation, ces gestes sont, sur le plateau, un constat de l’époque et ils provoqueront, chez celui qui regarde, un système de reconnaissance. Nous sommes faits du « même ». Nous partageons, acteurs et spectateurs, un même langage physique. Celui-ci est notre soubassement commun. La différence avec la vie de tous les jours est que nous, les acteurs, exécutons ce vocabulaire, en pleine conscience. Ce n’est qu’à partir de là que nous pourrons transformer le geste, le formaliser, le défigurer, le transfigurer. Pour résumer ce que je viens de dire : après étude, je demande à mes acteurs d’exécuter le geste clairement, puis, une fois cette première marche franchie, nous formalisons, faisons évoluer, transformons. Par exemple, je peux essayer de rendre le geste surprenant. Nous fonctionnons par imitation, nous repérons, neurones miroirs obligent, ce que l’autre va faire : s’il y a une chaise et que je m’avance vers elle, le spectateur va rapidement lire que je vais m’y asseoir. Le metteur en scène conscient de l’état du spectateur peut jouer avec le geste pour le ralentir ou l’accélérer, pour le décaler, créer un stop, etc. Je ne cherche pas pour autant un univers fantasmagorique : mon objectif est de surprendre l’oeil qui regarde, mais avec un geste qui reste quotidien. À partir de gestes pauvres issus du réel, je cherche une poésie, un développement de l’imaginaire; dans une société de plus en plus virtuelle, je fais le pari du réel, la fonction du théâtre étant de le convoquer. C’est pour cela que je travaille sur des comportements banals, sur des gestes du quotidien.
S. L. : Le paradoxe du geste dans ton théâtre serait donc d’être attaché à la plus grande banalité pour devenir le lieu même de l’étonnement et de la surprise… Revenons un peu en arrière : tu dis que tu étudies d’abord le geste. Qu’est-ce que c’est, précisément, étudier un geste? Tu dis ensuite que lorsque tu as étudié un geste, tu l’intègres dans le spectacle. Peux-tu revenir sur ces deux phases, et sur la définition de ce que tu nommes « l’étude »?
É. L. : Dès que je fais une proposition d’exploration d’une situation pour le comédien, je visualise un rythme et un espace pour son geste. L’étude, c’est d’abord découvrir la raison du geste, sa causalité, toute action ayant à voir avec le sens, car nous agissons toujours pour ou contre (quelqu’un, quelque chose, un état…). J’étudie ensuite quelle conséquence aura ce geste sur la situation, tant pour ceux qui l’exécutent que pour ceux qui regardent. En fait, étudier un geste, par-delà le soubassement primitif qui l’a vu naître, c’est étudier ses différentes causes et conséquences en situation. J’examine enfin concrètement avec l’acteur ce que ce geste produit sur le plateau et quelles sont ses incidences sur la situation et sur l’action globale de la pièce, ou sur la ligne d’action du personnage. Il s’agit de déterminer ce que crée le geste dans la ligne du personnage, mais aussi, et plus globalement, ce que produit le geste dans la ligne du récit. Est-ce un geste répétitif, un toc? Ou bien un geste exceptionnel? En quoi est-il directement lié à l’action? De quelle manière la nourrit-il? Etc.
S. L. : Peux-tu donner des exemples précis de ce que tu dis à partir des Bas-fonds?
É. L. : Dans Les bas-fonds, celui que nous nommons « l’acteur » a un vrai problème avec l’alcool. Le geste de boire est donc fondamental dans sa partition physique. Nous avons essayé toutes ses déclinaisons possibles : dans un verre, avec différentes tailles de verre possible, dans des tasses, dans des bols, à la bouteille, boire seul, en cachette ou, au contraire, avec les autres, de manière conviviale ou provocante, boire sans s’en rendre compte, boire de manière objective en travaillant à sa propre destruction… et ces différentes approches, ces différentes études suivant les situations traversées par Jérôme Bidault qui jouait l’acteur, ont créé, de surcroît, un moment du spectacle non prévu par le texte : une scène clownesque, inventée par Jérôme, parodie de son état d’alcoolique à travers la déformation des différents gestes-toc de l’homme qui boit.
Autre geste exemplaire dans le spectacle : Satine, joué par Christophe Grégoire, casse très violemment un balai sur le bar dès le début du spectacle; c’est un geste de violence et le spectateur va longtemps se demander pourquoi il agit ainsi. Est-ce un geste quotidien? Un geste ordinaire? Un acte gratuit? Et d’où vient-il? La cause en est-elle la colère? Une colère soudaine? Ou nourrie de longue date? Tout cela reste obscur et opaque, mais ce geste prend sens dans la ligne du personnage même si le spectateur devra attendre le dernier acte pour en comprendre le fondement.
Travailler avec l’acteur sur le geste, c’est travailler à la création d’une partition physique très précise dans laquelle les différents gestes exécutés se déclinent en des lignes et des niveaux différents : ils nourrissent l’acteur ici et maintenant de manière concrète et réelle, ils créent aussi la ligne du récit à partir des situations et se développent enfin de manière autonome dans la ligne du rituel. Pour l’acteur, et sans doute pour le spectateur, le geste possède plusieurs niveaux de lecture.
S. L. : J’en reviens au début de notre propos, et à la question de l’altérité que tu décrivais pour commencer : je trouve que dans Les bas-fonds, Christophe Grégoire (Satine), comme d’autres acteurs, n’adresse pas ses gestes à d’autres. Le geste n’est donc pas forcément opérant dans le cadre de la seule altérité, et ce qui fait sûrement l’originalité de ton spectacle par rapport à ceux qui l’ont précédé est la force de cette ligne de mouvements individuels.
É. L. : Oui. J’ai souhaité pour Les bas-fonds ce que j’ai nommé des « bulles de gestes ». Des moments solitaires – même si l’ensemble du groupe est présent sur le plateau –, une succession de gestes exécutés pour soi-même, sans aucune volonté de communication et de connexion avec l’autre. Des gestes autosuffisants, autocentrés. J’ai aussi bien évidemment cherché les gestes qui tendent à percer les bulles des autres et à favoriser l’intrusion d’un monde dans un autre. Il y a quinze comédiens sur le plateau et quinze univers, planètes différentes. Mon travail de metteur en scène fut d’harmoniser ces planètes, qu’elles tournent et jouent ensemble, sans pour autant perdre de leur singularité. Ici, les comédiens sont à leur propre service et non au service de la grande histoire. C’est l’agencement de ces quinze univers singuliers qui crée, en fin de compte, un paysage global. C’est l’une des différences d’avec mes précédents spectacles.
S. L. : Revenons au propos central : ce qui est intéressant est de voir comment on passe du geste ordinaire et quotidien au geste donné sur le plateau. Le geste devient-il extraordinaire dès lors qu’il est posé sur le plateau? Comment le geste ordinaire peut-il sembler surprenant sur le plateau? Comment la marche d’un acteur peut-elle devenir le lieu d’une surprise?
É. L. : Le geste devient extraordinaire quand vous l’étudiez : si vous avez conscience du geste et que vous êtes en train de l’étudier, vous sortez de l’ordinaire. En définitive, nous cherchons ce qui est absent du geste, ce qui n’est pas là ou plus là. C’est bien l’un des champs du théâtre que de montrer ce qui est caché ou de dire ce qui est tu.
S. L. : Je crois que, dans ton travail, c’est également la dimension chorégraphique qui donne ce sentiment de surprise aux spectateurs. Tu parlais tout à l’heure de répétition de ces gestes, n’est-ce pas là une des clés de l’étonnement?
É. L. : On fume une cigarette : d’abord la sortir du paquet, la prendre avec tels ou tels doigts, la porter aux lèvres, sentir l’âpreté du tabac, le trajet de la fumée à l’intérieur du corps, comment elle se disperse vers l’extérieur… Si vous êtes à l’étude de tous ces détails, vous mettez en place un double regard sur votre comportement, vous ne subissez pas le geste : vous l’inventez en l’étudiant et vous rendez ce geste non pas extraordinaire, mais subtil, d’une qualité autre que celui que nous exécutons simplement et mécaniquement dans la vie. Il y a en effet une subtilité, un degré supplémentaire d’âme qui doit apparaître sur le plateau. Vous avez pris le temps de comprendre ce geste, vous l’avez disséqué, vécu, vous pouvez maintenant le répéter à l’infini et, pourquoi pas, le chorégraphier, le démultiplier, en le distendant, en changeant son rythme… En fait, vous êtes libre dans le geste et c’est ce qui le rend scénique. Par ailleurs, vous comprenez que le plus petit des changements sur ce même geste aura des conséquences. Cette recréation qui advient encore une fois par l’étude précise et rigoureuse vous donne la liberté. Cette liberté après laquelle nous courrons dans tous nos spectacles.
S. L. : Je prends volontairement un exemple en dehors du théâtre : quand nous faisons du yoga, on nous demande de travailler sur notre conscience et cette fine perception transforme l’appréhension que nous avons de nous-même et du monde. Quelle différence vois-tu avec ce que tu racontes de l’expérience théâtrale?
É. L. : C’est exactement la même chose, car le théâtre suppose une mise en conscience. C’est ce qui donne la présence ici et maintenant, réellement au présent, en pleine conscience. C’est cet état que je recherche avec l’acteur.
S. L. : Il y a le fait de chercher à être présent, mais aussi à mettre en perspective nos codes sociaux, à montrer ce qu’on ne perçoit pas forcément dans l’espace quotidien, ou ce qu’on ne voit plus par la force de l’habitude.
É. L. : C’est ce que Pierre Sansot appelle les « rituels du quotidien » dans son livre Les gens de peu (2009), qu’il s’agisse des rituels du camping ou de l’apéritif, par exemple. Certains gestes sont donc des rituels culturels. Pour faire théâtre des gestes ordinaires, il y a donc quatre niveaux : l’étude concrète (nous sommes comme des chercheurs), la pleine conscience (nous sommes près du yoga), la place que le geste occupe au sein du rituel (nous devenons des anthropologues) et, enfin, sa part dans l’inconscient (individuel et collectif). Il me semble qu’il faut travailler ces quatre lignes ensemble et les articuler. Le quatrième niveau, l’inconscient, est proche de ce que j’appellerai « l’imaginaire du geste » : quel corpus inconscient convoque-t-il quand je l’exécute face à vous? Quelles portes de nos inconscients individuels ou de notre inconscient collectif ouvre-t-il? Dans ce cas, ce sont certains de nos soubassements communs, pas forcément culturels, qui sont révélés par le geste théâtral.
S. L. : Dans le domaine de l’anthropologie théâtrale, Eugenio Barba et Nicola Savarese évoquent la notion d’« invariants » pour décrire les gestes théâtraux (Barba et Savarese, 1995). Ils ont eu pour principe de concevoir la présence scénique sous un angle transculturel, en repérant, dans ce qu’ils ont nommé l’anthropologie théâtrale, les invariants[3] du corps de l’interprète scénique (acteur, danseur, mime, acrobate). Est-ce une notion que tu reprendrais à ton compte? D’autant que de nombreux hommes de théâtre ont parlé du langage du corps comme d’un langage universel…
É. L. : Je ne crois pas en un langage universel, ni par la langue ni par les corps. Si cela existait, il y a longtemps que nous l’aurions adopté; l’échec de l’espéranto est là pour s’en faire l’écho… Je me méfie des invariants. La vie, qu’est-ce d’autre que le mouvement et la transformation? Donc, non, je n’adhère pas du tout à ce que dit Barba, notamment en raison de ce que nous vivons aujourd’hui : une évolution stupéfiante de nos signes communicants, de nos pratiques de vie au quotidien, des connaissances explosant nos habitudes, une précarité croissante mettant à mal tout projet à long terme… Bref, nous connaissons une époque obscure et violente, innovante et virtuelle, avec ce réel qui ne cesse de nous échapper. Moi-même, je suis traversé par l’époque en en faisant partie et je suis transformé par elle. Il en est de même pour le théâtre que je pratique. Quand le réel, dont je parle de manière obsessionnelle puisqu’il est mon champ d’investigation, ne cesse de s’obscurcir, quand sa construction idéologique et politique est aberrante, de quoi peut être fait mon théâtre, sinon de données locales et variables?
S. L. : Trouvons un exemple de ce que tu dis : est-ce qu’il y a des gestes de tes premiers Tchekhov[4] qui ne seraient plus justes aujourd’hui?
É. L. : Je dirais comme toi tout à l’heure que mon théâtre est devenu la recherche d’un art du déséquilibre. De la précarité formelle et idéologique. Dans mes premiers spectacles, j’étais en quête de formes stables, de points d’ancrage fixes, de figures géométriques précises, renvoyant à une conception architecturale du monde quasi stable, ce que je fais beaucoup moins aujourd’hui…
S. L. : À cette époque, il y avait quelque chose de chorégraphique et de formel dans ton travail; aujourd’hui, on sent plutôt les hésitations dans les interactions, et une indécision plus globale sur le sens même.
É. L. : En effet, je suis plus en quête de chaos que d’harmonie, et j’aurais tendance à aggraver la crise plutôt que de tenter de la résoudre… Je cherche le multiple plutôt que l’unique et, dans les gestes simples, la logique de l’incohérence dans la précarité.
S. L. : C’est peut-être pour cela que tu as, pour la première fois, fait appel à la gestuelle du clown dans Les bas-fonds. Le clown rompt avec les gestes ordinaires en les exagérant : comment as-tu amorcé ce passage du réalisme poétique à l’univers du clown et pourquoi?
É. L. : Dans Les bas-fonds, nous passons d’une forme à l’autre et donc nous traversons un moment cette forme. Le clown, c’est le jaillissement de la vie, l’échappée, le dérapage, la déglingue, l’excès, la provocation, le politiquement incorrect… Et même si je n’ai effectivement jamais mis de clown, avec la référence formelle du jeu clownesque, dans mes spectacles, sa transgression libertaire et excessive m’a toujours excité. J’essaie d’être un homme du geste radical : geste ascétique ou minimaliste et excessif ou démesuré. J’essaie de me donner la liberté de passer de l’un à l’autre, comme lorsque je fais travailler aux acteurs une scène d’amour d’abord dans la plus grande proximité, puis dans le plus grand éloignement. Je passe du minimalisme à l’excès. Les deux m’agitent, les deux m’excitent… Et ce n’est pas seulement au théâtre, dans la vie même, je suis dans l’entre-deux.
Pour revenir aux Bas-fonds, le texte nous emmène vers l’excès, d’où le quatrième acte : énorme beuverie faite de violences physiques où se mêlent excès du verbe, excès des gestes, excès des corps, excès du rapport au public, tout cela nous entraînant irrémédiablement vers la chute, car il n’y a pas d’excès sans chute, autre problématique qui traverse l’ensemble de mon travail. En cela, je rejoins le travail du clown.
S. L. : Est-ce que le geste du clown part du geste quotidien pour le radicaliser? Ou bien est-ce par essence un autre type de geste?
É. L. : Quand on observe des clowns au travail, on remarque qu’ils se servent des gestes quotidiens pour les enfler et les déformer : ce sont des gestes hyperboliques, des gestes répétitifs et obsessionnels. Le clown joue avec le quotidien pour nous le révéler. Partant de la vie même, il crée un espace critique, qui a ses propres règles, bousculant le conformisme du réel. Le clown est une mise en question du geste quotidien.
S. L. : Est-ce que le clown ne fait pas le chemin inverse de celui de l’acteur de théâtre? Le clown exagère en effet les gestes du quotidien jusqu’à les rendre étranges, et l’on retrouve pourtant dans cet excès les traces d’une humanité; alors que l’acteur partirait du réel pour le styliser et le poétiser, ceci pour représenter la communauté.
É. L. : Notre source commune, c’est la vie. Nous parlons, nous bougeons, nous nous exprimons depuis la vie; que l’on soit clown ou comédien. Cela étant, chaque acteur a son système de travail et les formes théâtrales sont multiples. Chacun a son chemin créatif pour rendre compte de l’état du monde, de son état personnel et de la possibilité d’autres mondes à bâtir. Le processus de travail a juste besoin d’être… juste! C’est-à-dire adapté à la situation : situation économique des répétitions, qualité des acteurs en présence, objectif commun, etc. Pendant les répétitions des Bas-fonds, le très court moment clownesque joué par les acteurs ne les a pas obligés à modifier ou à inverser leur chemin créatif; cette forme leur a permis de basculer vers des états de corps proches des personnages des Bas-fonds, aux antipodes d’un théâtre réaliste et pourtant avec des états de corps bien réels, construits ici et maintenant, directement sur le plateau, à la vue des spectateurs.
S. L. : Tu fais la différence entre gestes fabriqués et gestes nés du plateau : du coup, la gestuelle est également le produit du regard du spectateur.
É. L. : Oui, bien sûr, le geste peut tout à fait être perçu comme une coproduction entre l’acteur et le regard du spectateur. Il se fabrique en direct, émerge comme trace commune et non comme illustration personnelle.
S. L. : Prenons un dernier exemple autour des Bas-fonds : l’acte III, où l’on pénètre dans l’univers du dortoir d’un asile de nuit pour personnes déshéritées.
É. L. : J’ai conçu cet acte comme un arrière-plan qui donne au spectateur de la profondeur de champ : cinquante lits dressés côte à côte dans le fond du théâtre, et des acteurs agissant dans cet espace réduit. Pour cet acte, je voulais un paysage très lisible, avec nombre de gestes ordinaires issus de la vie d’un asile de nuit : plier des couvertures, remettre un oreiller, se déshabiller, se laver, lire et fumer sur son lit… et cela avec un minimum de connexion entre les acteurs. Je cherchais à travailler l’image et, de fait, lorsque douze ou quinze personnes exécutent les mêmes gestes, chacun dans son îlot, avec des gestes hyperréalistes, cela crée un paysage poétique et chorégraphique. Mais ce sont encore et toujours des gestes simples du quotidien. Pour les spectateurs, c’est comme une respiration dans le spectacle. Pour les acteurs, c’est un grand travail individuel et collectif de précision, mais aussi un training leur permettant de passer à l’acte IV, lui beaucoup plus violent, autre exercice formel où la discipline collective doit faire émerger l’indiscipline et l’excès.
S. L. : Tu utilises aussi le terme de « geste » pour désigner l’acte de création, en parlant du geste du metteur en scène fréquemment. Peux-tu préciser ce que veut dire le mot « geste » dans ce contexte?
É. L. : Je veux dire que le metteur en scène est mouvement. Et action. Qu’il est traversé par une série de situations, dont ses spectacles, et qu’il prend des décisions en fonction de ces situations, et non pas seulement de ses idées. Qu’il est un corps pensant et agi. Traversé. Dont la résultante est un geste physique, un geste inscrit dans une multiplicité qui fera oeuvre.
S. L. : En fait, le geste du metteur en scène est proche de celui de l’écriture?
É. L. : C’est sûr que son geste s’exprime par un vocabulaire de plateau et trace une écriture… Il ne doit pas être une gesticulation bavarde, il doit trouver son propre style, être précis, inventif et tenir en haleine celui qui regarde, être capable de se renouveler. Mais la différence avec le geste de l’écrivain, c’est que le geste du metteur en scène n’existe que pour qu’advienne le geste de l’acteur. Le geste créatif du metteur en scène est donc un geste de révélation qui assure la protection et la mise en liberté de l’acteur.
S. L. : Tu as commencé par la relation entre art et vie opérée par le geste qui relie les deux univers de la scène et du monde. Peux-tu, pour finir, expliciter ce passage?
É. L. : En fait, la relation permanente entre la vie quotidienne et la vie du plateau crée un nouvel organisme constitué de cellules aux membranes poreuses issues de la vie même et produisant de la vie, ou encore, du réel à un moment donné, dans un espace défini, pour une communauté. Le geste du quotidien, posé et étudié sur un plateau de théâtre, génère une réalité qui se fabrique en direct par la mise en batterie de l’acteur et du spectateur. Ce théâtre-là, que j’appelle « théâtre laboratoire de vie », utilise donc les gestes de la vie pour créer du réel.
Parties annexes
Note biographique
Sophie Lucet est professeure en études théâtrales à l’Université Rennes 2 et responsable du laboratoire théâtre au sein de l’équipe d’accueil 3208 Arts : pratiques et poétiques. Elle est la coordinatrice principale du projet européen Argos (Europe Creative, 2018-2021) pour la création d’un observatoire des processus de création européens. Elle a notamment publié Tchekhov / Lacascade : la communauté du doute (L’Entretemps, 2003). Ses publications les plus récentes sont « Mémoires, traces et archives en création dans les arts de la scène » (sous la direction de Sophie Lucet et Sophie Proust, Presses universitaires de Rennes, 2017) et « Fabriques, expériences et archives du spectacle vivant » (sous la direction de Sophie Lucet, Bénédicte Boisson et Marion Denizot, Presses universitaires de Rennes, 2019).
Notes
-
[1]
Pièce créée au Théâtre National de Bretagne le 2 mars 2017.
-
[2]
Cet entretien a eu lieu le 25 mai 2017 au Théâtre National de Bretagne.
-
[3]
« Les invariants sont des principes généraux, structuraux et fonctionnels pouvant s’appliquer aussi bien à un système qu’à un autre » (de Rosnay, 1975 : 92).
-
[4]
Éric Lacascade a créé un cycle de mises en scène de Tchekhov de 1999 à 2014 : Ivanov (1999), Cercle de famille pour trois soeurs (2000), La mouette (2000), Platonov (2003), Oncle Vania (2014).
Bibliographie
- Barba, Eugenio et Nicola savarese (dir.) (1995), « L’énergie qui danse : l’art secret de l’acteur », Bouffonneries, nos 32-33.
- Rosnay, Joël de (1975), Le macroscope : vers une vision globale, Paris, Seuil, « Points - Essais ».
- Sansot, Pierre (2009), Les gens de peu, Paris, Presses universitaires de France, « Quadrige ».