Corps de l’article
Prélude
Ce texte s’inscrit à la suite d’un essai bibliographique publié en 2012 dans lequel j’ai proposé une analyse sur la production des connaissances européennes sur les processus de métissage. Cette étude exhaustive sur la littérature (Giguère 2012a) visait à poser les jalons pour un meilleur dialogue entre diverses écoles théoriques et méthodologiques, entre diverses aires culturelles aussi, dans le vaste domaine de recherche regroupant le métissage, les identités métisses et l’identification métisse. Cette réflexion sur les nouvelles tendances dans la recherche sur le métissage dévoilait de surcroît la formation d’un sous-champ disciplinaire — les processus de métissage — rattaché à celui de l’identité, et ce, dans un grand éventail de disciplines aussi diversifiées et inhabituelles que les mathématiques, la biologie et la philosophie. La publication de cet essai bibliographique proposait un décloisonnement du discours scientifique sur le métissage, une dépolitisation et une déjudiciarisation au profit de fondements plus universels comme les questions identitaires en contextes d’altérité.
Adepte des analyses comparatives et des mises en perspective internationales (Giguère 2006a ; 2010 ; 2012 ; 2014), j’ai souhaité alors contribuer à la mise en relation du développement des connaissances empiriques et théoriques réalisées au Canada au sujet des identités métisses canadiennes avec des travaux principalement réalisés en Europe et basés sur des données empiriques un peu partout dans le monde.
Mon observation première faisait remarquer que les études sur les identités métisses canadiennes étaient, jusqu’à l’aube des années 2010, principalement réalisées par des citoyens canadiens alors que les études réalisées en Europe prenaient ancrage dans divers cas de figure dans le monde et par des intellectuels également issus de divers continents. J’ai moi-même été influencée par cette vague intellectuelle, lors de mon parcours académique en Europe et approfondi des données empiriques dans la région méditerranéenne (Giguère 2005a-c ; 2006b ; 2008a-b ; 2009 ; 2010 ; 2012a-b ; 2014 ; 2015a-b).
Il m’était difficile de mettre le doigt sur la « différence canadienne ». Pour la comprendre, il me fallait ouvrir ces frontières invisibles entre les analyses intellectuelles européennes et canadiennes concernant l’identité métisse. Pourquoi l’approche européenne et comparative était-elle aussi marginale au Canada ? Pourquoi les travaux des Européens étaient-ils aussi peu cités au Canada ou alors limités aux intellectuels déjà marqués par une forte affinité et des collaborations soutenues avec les institutions européennes ? Dans ce dernier registre, je pense notamment à l’impact de François Laplantine et à sa collaboration avec Alexis Nouss (Laplantine et Nouss 1997, 2001). Tous deux ont eu un impact intellectuel important alors que d’autres, comme Jean-Loup Amselle (1999, 2000, 2001), ont eu un impact mitigé au Canada.
Dans ce même article, publié en 2012, j’avais relevé le facteur linguistique et la caractéristique des écoles de pensées françaises, plus républicaines, peu attractives dans le Canada anglais, lequel discute plus ouvertement des Métis de l’Ouest d’un point de vue ethnique et territorialement circonscrit. Dans le cadre des travaux de la Chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse[1] auxquels j’ai participé à titre de chercheure associée, j’ai poursuivi en ce sens par des publications visant à aller plus loin dans le dialogue entre les écoles de pensées et les empiries en publiant des expériences internationales encadrées par une réflexion épistémologique ayant la comparaison avec l’exception canadienne au coeur de ses considérations. Si la situation des identités métisses au Canada est particulière, on doit pouvoir la situer par rapport aux autres réalités et orientations théoriques. Par exemple, en 2014, Denis Gagnon et moi-même (Gagnon et Giguère 2014) dans un numéro thématique de la revue Anthropologie et Sociétés, avons réussi à rassembler des cas fort variés (Madagascar, Nouvelle-Calédonie, La Réunion, Polynésie française, Espagne, Belgique, Brésil, Mexique, Russie). Le cadre de la réflexion était, d’une part, le concept de la catégorisation sociale, laquelle implique une relation dialectique entre l’émique et l’étique, et d’autre part, celui d’agentivité (Ortner 2006).
La pertinence du dialogue entre tous ces cas nous a paru si stimulante qu’une rencontre devenait nécessaire pour échanger directement et porter les réflexions plus loin. Ce fut l’objectif du Quatrième atelier international sur l’identité métisse organisé par la Chaire de recherche sur l’identité métisse à l’Université de Saint-Boniface en août 2015. Cette rencontre visait aussi à stimuler les collaborations multilatérales et à intégrer au coeur des échanges les représentants de diverses associations métisses canadiennes. Ainsi, la perméabilité des expériences intellectuelles et phénoménologiques a renforcé certaines de mes intuitions. Lors de la conférence plénière de clôture que j’ai eu l’honneur de présenter, j’ai pu confirmer ma position de départ qui consistait à défendre l’importance de considérer « les » identités métisses du Canada, et même des groupes culturels Métis du Canada. J’ai également pu démontrer, à la lumière des travaux tenus lors de l’atelier, la pertinence de poursuivre les recherches et les questionnements sur les thématiques suivantes :
la notion de communauté culturelle ;
le processus de judiciarisation des identités métisses au Canada ;
le sens de l’expérience identitaire et de l’interprétation processuelle d’une identité personnelle ;
l’approche méthodologique canadienne visant à privilégier l’usage de sources documentaires historiques pour valider des identités contemporaines.
Cet événement s’est conclu sur un désir partagé de poursuivre ces collaborations soutenues. Toutefois, ces développements escomptés et prometteurs n’ont pu, pour diverses raisons, avoir lieu. Lorsqu’on m’a invitée à rédiger un essai bibliographique sur trois ouvrages récents portant directement ou indirectement sur les Métis du Canada, c’était pour moi une occasion significative de revisiter ce sujet, à partir des travaux publiés après la clôture de la Chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse. Cette Chaire a, sans contredit, donné un élan à ce champ d’études qui semble dorénavant en réel développement.
Introduction
Le présent essai bibliographique s’appuie sur trois ouvrages publiés au Canada qu’il convient de situer en toute transparence dans leurs contextes d’émergence :
Le Canada. Une culture de métissage/Transcultural Canada est un livre publié en 2019 par les Presses de l’Université Laval sous la direction de Paul D. Morris, professeur titulaire de littérature anglaise au Département d’études françaises, de langues et de littératures à l’Université de Saint-Boniface. Sur les 17 collaborateurs/auteurs de cet ouvrage collectif, près de 50 % sont affiliés à l’Université de Saint-Boniface et 50 % à l’international bien que certains soient des Canadiens vivant à l’étranger ou des étrangers ayant étudié au Canada (Chine, Allemagne, Russie, France). Je ne peux poursuivre sans souligner le départ prématuré de feu madame Afef Benessaieh, formée en relations internationales à l’Université de Southern California (2005) et professeure en Études internationales à l’e-université du Québec à Montréal (TÉLUQ) dont la spécialisation sur les questions d’identité, de diversité, de migration et de transculturalisme a contribué substantiellement au débat qui nous intéresse ici. Sa contribution marque l’ouverture du premier ouvrage cité (dirigé par Paul D. Morris), en plus de lui donner l’orientation théorique et même le titre. Cette chercheuse, pour qui on pouvait aisément entrevoir une longue carrière, présentait en 2010 au CELAT — Cultures, Arts, Sociétés, son analyse de la transculturalité (https://vimeo.com/13154683) et sa relecture du concept de culture.
Le statut de Métis au Canada. Histoire, identité et enjeux sociaux a été publié en 2019 aux Presses de l’Université Laval (Collection Mondes autochtones) par Denis Gagnon, anthropologue et professeur titulaire à l’Université de Saint-Boniface où il a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse de 2004 à 2014. De 2013 à 2018, il a aussi été titulaire du programme de recherche Le statut de Métis au Canada : agencéité et enjeux sociaux.
L’identité métisse dans l’Est du Canada. Enjeux culturels et défis politiques a été publié en 2017 aux Presses de l’Université Laval (Collection Mondes autochtones) par Emmanuel Michaux, docteur en anthropologie de l’Université Laval depuis 2014, une thèse dirigée par Frédéric Laugrand et Denis Gagnon. Michaux a collaboré aux travaux de la Chaire de recherche sur l’identité métisse à quelques reprises notamment pour la publication collective L’identité métisse en question. Stratégies identitaires et dynamismes culturels publié en 2012 par les Presses de l’Université Laval et dirigé par Denis Gagnon et moi-même.
Ma réflexion autour de ces publications s’articule donc aussi avec ma connaissance des contextes de chacune de ces publications et de leurs liens institutionnels. Les thématiques abordées sont représentatives de la progression des discours et débats sur l’identité métisse, ou plutôt « les identités métisses », au Canada.
Statut de Métis, catégorie sociale de Métis et identité métisse
Statut, catégorie sociale, identité… par quels concepts et quels vocables aborder la réalité des personnes et des communautés métisses ? Comment s’y retrouver ? D’abord, la distinction légaliste des identités « indiennes » au Canada s’inscrit dans une histoire qui débute avec la Loi sur les Indiens créée en 1876, elle-même héritée des ordonnances coloniales de l’Empire britannique définies dans la Proclamation royale de 1763, dont l’objectif principal vise l’assimilation des Premiers peuples à une culture eurocanadienne. Elle concerne uniquement les Premières Nations. Intimement liée à l’instauration des « réserves », elle garantit certains droits et des devoirs de protection aux membres des Premières Nations, en échange de l’acquisition de leurs terres et définit les obligations du gouvernement envers les membres des Premières Nations. En dépit des amendements répétés à cette loi[2], celle-ci demeure aujourd’hui discriminatoire et source de violations des droits fondamentaux des Premières Nations dans les domaines de la culture, de la santé, de l’éducation, de la gouvernance et du développement économique. Elle génère également des problèmes de perception entre les premiers concernés et le reste de la population canadienne.
Cette loi définira, depuis la formation du Canada jusqu’à nos jours, l’ensemble des droits spécifiques aux personnes considérées comme « indienne », d’un point de vue légal. La distinction entre différentes catégories d’humains habitant les terres canadiennes a donc mené à une définition légale de « l’Indien », générant l’inscription de ces derniers à un registre. Dans cette loi, avant 1951, un Indien était défini par son « sang indien ». À partir de 1951[3], l’Indien sera défini par son inscription à un registre : « Personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être[4] ». L’article 6 détermine les nombreuses conditions selon lesquelles une personne peut s’inscrire à titre d’Indien. Ce « statut d’Indien », pourtant discriminatoire, revêtira progressivement un second sens : celui de continuer, malgré tout, à s’identifier à ses ancêtres, celui d’affirmer son identité. Dans la foulée d’une période marquée par la reconnaissance des droits fondamentaux des peuples autochtones, la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaîtra et affirmera les droits existants ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada. Le terme « peuples autochtones du Canada » comprendra dorénavant les Premières Nations, les Inuit et les Métis du Canada (article 35).
Ainsi, au Canada les catégories juridiques définissant les Premières Nations sont nombreuses : Indien inscrit (au registre des Indiens), non inscrit, vivant en réserve ou hors réserve. Ces catégories juridiques et politiques sont enchâssées dans la Loi sur les Indiens. Les Métis n’échappent pas à ce phénomène.
Le jugement R c. Powley, rendu par la Cour suprême du Canada en 2003, circonscrit l’appartenance à la communauté métisse selon trois critères : la personne doit « s’identifier comme membre de la communauté métisse[5] », démontrer l’existence de liens ancestraux avec une communauté métisse historique et prouver qu’elle « est accepté[e] par la communauté actuelle dont la continuité avec la communauté historique constitue le fondement juridique du droit revendiqué ».
Le Ralliement national des Métis (RNM) représente les Métis au Canada et à l’international. Créé en 1983, le RNM promeut la reconnaissance des Métis en tant que groupe distinct des Premières Nations. Le RNM est composé de cinq organisations provinciales (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba et Ontario). Aucune association métisse à l’Est de l’Ontario n’est reconnue par le RNM et le Gouvernement du Canada. Ceci n’empêche en rien leurs revendications identitaires.
En 1985, le projet de loi C-31 : Loi modifiant la Loi sur les Indiens permettait à de nombreuses personnes de récupérer leur « statut », notamment en raison d’une ascendance culturelle mixte. Mais posséder une ascendance autochtone et une autre allochtone n’est pas un critère pour l’obtention du statut de Métis. Bien des questions sont soulevées par ce cadre restreignant l’expérience humaine à des données d’archives bien précises.
En 2003, la Cour suprême du Canada, dans le jugement R. c. Powley, soutient que les Métis doivent jouir de « leur pleine qualité de peuples distincts, titulaires de droits », une caractéristique qu’ils ont en commun avec les Indiens (Premières Nations) et les Inuit du Canada. Avec cet énoncé, le Canada devient la seule constitution au monde reconnaissant une culture mixte, les Métis, comme un peuple autochtone titulaire de droits.
Le peuple métis est actuellement déterminé par un contexte historique prenant racine dans les années 1700 principalement par l’union « à la façon du pays » d’hommes français et de femmes autochtones (principalement cries et ojibwées), développant une langue créole propre, le mitchif. Ce même phénomène s’observe dans le nord-ouest, avec les marchands écossais qui épouseront des femmes, principalement Denées. Ces descendants formeront une culture distincte, une nation commune avant l’existence de la Confédération canadienne (Murray, 1994)[6].
Ce cadre très limitatif m’a amené à étudier les identités métisses canadiennes sous l’angle de la « catégorie sociale », dans l’objectif de redonner à l’expérience culturelle sa profondeur et sa légitimité (Gagnon et Giguère 2014). Le processus de catégorisation implique la coprésence et l’interpénétration des expériences émiques et étiques du soi, du nous et de l’autre. Projetée dans le contexte des Métis, cette perspective permettait d’étudier les identités métisses au Canada, leurs expériences distinctives incarnant une vision tierce, une vision composée de deux ou plusieurs réalités culturelles historiques. Historiquement, cette expérience métisse a été marquée par la marginalisation de toutes parts. Elle est maintenant débattue pour légitimer l’accès à des ressources et à des pratiques (de pêche, de chasse par exemple) sur des territoires spécifiques. Cette reconnaissance juridique de la catégorie sociale de Métis a eu un effet progressif sur la valorisation d’une histoire métisse, et d’une histoire des Métis. Par effet d’entraînement, d’autres voix hors du contexte historique officiellement reconnu par la RNM de l’Ouest réclament leur reconnaissance avec fierté, dans l’Est du Canada.
Redonner au stigmate historique une valeur positive, symbolique, culturelle et identitaire… La valorisation actuelle d’origines autochtones et mixtes témoigne d’un décloisonnement des appartenances culturelles historiques au Canada et d’une désinhibition du fait autochtone. Ces mouvements identitaires reconnaissent les particularismes, autrefois péjoratifs et marginalisés, pour les réclamer avec fierté. C’est l’observation de ces phénomènes qui m’amène à proposer l’existence d’une interaction continue entre le statut, la catégorie sociale et l’identité des Métis.
Chronologie des ouvrages précités
Emmanuel Michaux a terminé sa thèse de doctorat en 2014, l’année à laquelle se clôturaient les travaux de la Chaire de recherche du Canada auxquels il a aussi contribué. Dans L’identité métisse dans l’Est du Canada, Emmanuel Michaux présente une oeuvre réfléchie, nuancée et bien achevée. Résultat de ses recherches réalisées depuis 2008, il présente un regard ancré dans une importante diversité empirique. C’est là sa grande richesse.
Dans L’identité métisse en question (Gagnon et Giguère 2012), Michaux présentait déjà les prémisses de ses réflexions, plus particulièrement au sujet des Magouas de Yamachiche. Dans son livre publié en 2017, Michaux compare dans des contextes thématiques bien structurés les réalités ethnographiques des Métis acadiens des Maritimes et plus particulièrement du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, les Magouas de Petit-Village de Yamachiche au Québec, les Métis du Saguenay, en faisant régulièrement référence aux Métis du Manitoba. Son approche sur l’identité s’inspire du culturalisme de Marshall Sahlins pour proposer le cadre du culturalisme métis. Le culturalisme métis lui permet « de déconstruire le dualisme eurocanadien/autochtone ou, du moins, l’amène à se repositionner en suggérant que le monde eurocanadien et le monde autochtone se recoupent plus qu’ils ne se repoussent. Il en ressort une logique de synthèse et de réconciliation que l’on peut qualifier, pour répondre d’une certaine convention, de métisse » (Michaux 2017 : 6).
Deux ans plus tard, en 2019, Paul D. Morris et Denis Gagnon publient leurs ouvrages respectifs. L'ouvrage collectif sous la direction de Morris est issu d’un colloque organisé en 2013 à l’Université de Saint-Boniface dont l’argumentaire se rapproche davantage d’une étude sur l’organisation de la diversité culturelle dans un contexte de pluralité identitaire canadienne.
Le livre dirigé par Morris n’est pas une monographie, mais bien une compilation de réflexions autour de la diversité culturelle canadienne et les cadres théoriques et structuraux pour la penser. Dans sa discussion entre les concepts de multiculturalisme, d’interculturalisme et de transculturalisme, Morris présente le concept de transculturalisme comme une sorte de bouée identitaire pour les Canadiens. Parmi les douze contributions proposées, quatre sont plus théoriques (Benessaieh ; Chignier-Riboulon ; Brochu et Sechin ; Fellner), quatre autres s’ancrent dans des exemples manitobains et des dialectiques entre l’Est et l’Ouest (Rivard ; de Moissac, Rokhaya Gueye et Delaquis ; Laugs ; Carrington et Ayala), une étude propose une analyse davantage rattachée aux études autochtones (Seibel) et enfin deux autres présentent un argumentaire se référant aux parcours de l’immigration (Balint ; Croteau). Un des travaux présentés est issu de collaborations avec les travaux de la Chaire de recherche sur l’identité métisse et aboutit enfin à une étude comparative en bonne et due forme entre les Métis de l’Ouest du Canada (et les débats d’appartenance qui s’y rattachent) et les Métis de Iakoutie en Russie — le nom « Métis » est attribué par l’auteur, Mikhail Bashkirov (2019 : 161-178), puisque l’appellation vernaculaire est plutôt « vieux colons russes » —, ce qui s’inscrit dans une heureuse continuité avec le décloisonnement évoqué dans le prélude de ce texte.
La plupart des chapitres de ce livre, écrits en anglais ou en français, concernent par conséquent les Métis du Manitoba et descendants de la rivière Rouge, où des communautés se sont formées avant la première Constitution canadienne (1867). C’est d’ailleurs leur existence et leurs revendications précoces qui ont permis leur reconnaissance officielle dans la Loi constitutionnelle de 1982 (art. 35). L’éditorial du livre ne remet pas en question les débats — pourtant ouverts — concernant la légitimité des uns et des autres. Il se retourne plutôt vers une diversité culturelle canadienne. Par sa prise de position en faveur de la notion de transculturalisme en ouverture, développée par Benessaieh, les ajouts de textes sur l’autochtonie et l’immigration viennent confirmer l’orientation sur une idée de métissage culturel plus étanche aux débats juridiques en cours, dans toute leur diversité, et qui inclurait le phénomène migratoire non autochtone. L’orientation de ce livre n’est pas sans rappeler celui de John Saul (2008) qui définit la mythologie canadienne à partir d’une société qui serait fondamentalement métisse et qui se serait construite sur des principes autochtones de paix, de justice et de bon gouvernement.
Toutefois, le cadre théorique choisi par Morris fait l’économie des réflexions sur le métissage, adaptées aux contextes des personnes issues de l’immigration — dans leurs différents statuts potentiels. Le statut « minoritaire » de plusieurs réseaux culturels permet de créer des situations, des conditions et des revendications partagées — comme celui, bienvenu, d’intégrer l’économie à la culture lorsqu’on évalue les données sur l’intégration culturelle, le racisme systématique et la discrimination (Régnier-Chiboulon : 41 ; de Moissac, Rokhaya Gueye et Delaquis : 90). Néanmoins, la présence dans ce livre de deux réflexions liées à l’immigration, dans le but d’« interroger les identités par-delà des logiques et des histoires nationales » (Régnier-Chiboulon : 41), me semble insuffisante pour établir un dialogue réel et des parallèles substantiels entre la reconnaissance de la profondeur des métissages historiques entre Eurocanadiens et Premiers Peuples et une « culture canadienne du métissage », somme toute assez particulière.
Certains des chapitres semblent d'ailleurs se construirent dans une continuité complice avec les travaux de Denis Gagnon, qui défend la reconnaissance d’un champ d’études à part entière pour les études métisses. Mais de façon simultanée, on entrecroise, un peu à la légère, les parcours d’intégration des nouveaux arrivants à une problématique de double discrimination historique des Métis francophones : minorisés en raison de la langue française ET de la filiation autochtone. Il s’agit là d’une discussion, en soit porteuse qui devrait à mon sens interpeller aussi le processus de « britannisation » du Canada. Au lieu d’aborder de front cette considération qui se révèle dans de nombreux exemples, on choisira plutôt de taire cette réalité en filigrane qui teinte pourtant les rapports de pouvoir au sujet des identités métisses, de l’Est à l’Ouest du Canada. Ce choix de taire les rapports de pouvoir au coeur des identités canadiennes d’est en ouest s’inscrit en continuité avec la logique du multiculturalisme. Morris reconnaît d’ailleurs dans le multiculturalisme la capacité « à diminuer les tensions sociales », mais l’inefficacité « en ce qui concerne l’identification et la définition de formes de relation entre les cultures que comprend le Canada » (2019 : 9). De plus, Morris semble vouloir nourrir ce « multiculturel » par une réflexion non dogmatique et non normative sur le métissage et le transcultural de Benessaieh (chapitre 2), une traduction proposée au concept de métissage.
Par des conférences particulièrement diversifiées allant de l’étude linguistique à l’analyse des expressions culturelles et artistiques et la construction identitaire autochtone, métisse et immigrante, cet ouvrage offre des outils pour analyser la diversité au Canada. La question sous-jacente aux actes de ce colloque est de savoir comment le Canada va gérer le fait social de la diversité.
Si la gestion comme l’expérience de la diversité culturelle au Canada est un réel sujet d’intérêt, le programme ambitieux de ce colloque arrive difficilement à réellement contribuer aux connaissances sur la diversité des identités des Métis du Canada et encore moins sur les métissages issus du long et complexe processus d’immigration. Toutefois, certains phénomènes humains et identitaires expérimentés par ces deux grandes catégories sociales se recoupent, et peuvent rejoindre d’autres communautés similaires dans le monde. Le décloisonnement de la spécificité canadienne et du statut identitaire spécifique proposé dans ce livre m’apparaît courageux et essentiel dans l’exercice d’une telle réflexion.
Le deuxième ouvrage publié en 2019 est celui de Denis Gagnon. Il propose une synthèse de ses travaux sur le statut de Métis au Canada et couronne ainsi 15 ans de travail novateur sur l’identité et le statut des Métis au Canada, d’un océan à l’autre. Je me permettrai de parler d’une publication phare pour deux raisons : d’abord, la densité du corpus de données historiques et ethnographiques est impressionnante. Ensuite, la transparence avec laquelle elle est déployée au sein de l’argumentaire permettra aux chercheurs qui suivront de cibler de nouvelles avenues de recherche grâce à un portrait empirique et documentaire rigoureux. Si certains peuvent éventuellement apporter des analyses plus nuancées ou même remettre en question les conclusions de Gagnon, la densité du corpus de données et l’investissement de ce chercheur sur une période considérable auront de toute évidence eu des retombées positives à long terme pour la recherche au Canada.
Ainsi, les publications de Gagnon (2019) et de Michaux (2017) dialoguent avec fluidité, se complètent et participent au fondement de ce champ de recherche en études métisses, un champ présenté par les deux auteurs comme un sous-champ des études autochtones. Pour eux, l’immigration et son processus d’identification culturelle semblent correspondre à un autre champ, ou, à tout le moins, un autre corpus.
Perspectives juridiques et politiques
Dans son ouvrage, Denis Gagnon réussit à rendre le processus de reconnaissance juridique intelligible, sans prendre position. Il s’agit d’une dimension omniprésente de la problématique des identités métisses au Canada. Il défriche les données statistiques pour donner du sens à la diversité des situations et des revendications de l’identité métisse. Denis Gagnon démontre à quel point il a contribué à documenter et à étoffer un domaine de recherche jusqu’à présent contraint par l’ethnicisation des Métis francophones, uniquement perçus comme une marge dans la marge. Ce que Michaux fera ensuite est presque révolutionnaire pour les Métis : il entreprend une ethnographie profonde des Métis de l’Est dans la reconnaissance de la diversité des contextes spécifiques qui caractérise ces groupes, sans nier la possible instrumentalisation de cette identité. Cette observation franche devrait devenir un point tournant et désinhibant pour le développement de la recherche sur les Métis de l’Est.
L’ampleur des données analysées par Michaux permet de structurer son approche comparative non pas par aire géographique, ce qui serait plus habituel et attendu, mais par thèmes. Ce choix épistémologique prend ses distances avec le modèle d’analyse « communautaire » pour proposer des interprétations culturelles comparatives riches permettant de mieux représenter la communication entre les régions, la mobilité historique et même fondatrice des habitants, Autochtones, Métis et Canadiens français et anglais. Sans qu’il soit pourtant l’objectif de l’ouvrage, le dialogue interrégional émerge par la vision transversale des problématiques analysées. Ce choix enrichit l’analyse et la transmission des données de recherche de Michaux.
Ainsi, l’ouvrage de Michaux, par sa proposition d’analyse transversale de données de première main de sources orales, vient répondre à la demande exprimée verbalement par les Métis présents lors du Quatrième atelier international sur l’identité métisse de la Chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse (2015) : être consultés comme source de données dans le cadre des recherches universitaires actuelles « puisqu’ils sont encore vivants ». C’est en effet dans ces mots que les Métis exprimaient leur grande frustration à se voir constamment décrits sur la base de données issues d’archives (des archives récoltées dans des contextes historiques précis, imprégnés de leurs biais, ayant un accès parfois limité à l’empirie) et non en fonction de leurs expériences contemporaines. La limitation aux approches historiques, souvent sollicitée dans les procédures judiciaires, a contribué à communiquer une vision passéiste et folkloriste des Métis. L’emphase mise sur les dimensions juridiques de l’identité métisse a également contribué à la survalorisation des données historiques au détriment des sources orales contemporaines.
Nouvelle ethnohistoire
Dans sa mise en contexte historique fortement documentée, Gagnon (2019 : 85) précise « que les communautés métisses sont issues des premières vagues de peuplement sur l’immense territoire de la Nouvelle-France, puis du Canada et du Midwest américain. En tant qu’Autochtones, ils ont subi l’ostracisme et la discrimination de la part des colons et des gouvernements. Assimilés aux Indiens sur le territoire des États-Unis, faisant suite à la création de la frontière entre le Canada et les États-Unis au 49e parallèle, les French Indians représentaient une nation distincte à l’époque de la traite des fourrures. L’historiographie américaine a aussi complètement effacé l’histoire des Métis sur son territoire pour la remplacer par le mythe des Mountains Men et des Frontier Men. Malgré le fait qu’ils soient établis dès le 18e siècle autour des Grands Lacs, dans l’Ouest et le Nord-Ouest canadiens, le long du Mississippi, dans le Midwest américain et sur la côte du Pacifique à Fort Vancouver, dans l’actuel état de l’Oregon, c’est le dogme d’une ethnogenèse métisse unique sur le territoire de la rivière Rouge qui est devenu le paradigme dominant », voire ici les descendants d’Eurocanadiens et des Premières Nations crie et ojibwa.
Cette nouvelle ethnohistoire s’emploie à adopter la perspective des marginalisés. La contribution de Denis Gagnon à cet effet présente des données compilées interprovinciales ainsi qu’une analyse des développements juridiques et des revendications politiques de manière diachronique. Ce livre de référence constitue une sorte de tremplin à partir duquel des analyses comme celles de Michaux peuvent être élaborées et avoir un impact positif à la fois pour la recherche et pour les communautés. Même si l’étude de Michaux a été publiée plus tôt que celle de Gagnon, il est clair que le développement de la recherche de Michaux s’inscrit dans une continuité logique de, et même encadrée par, l’investissement de Gagnon, l’un et l’autre s’étant mutuellement nourris en cours de processus, dans le cadre des travaux de la Chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse.
L’anthropologie historique, privilégiée par Gagnon et Michaux, est un cadre de recherche qui permet de revisiter l’histoire du point de vue des groupes minoritaires pour contribuer à la « nouvelle histoire », comme le proposent John et Jean Comaroff, à qui Gagnon et Michaux se réfèrent pour consolider leur approche théorique. Dans cette foulée, Michaux souligne le fait que l’histoire canadienne ait été pensée de façon bipartite : bilingue, colonisée et colonisateurs, indiens et blancs, sauvages et civilisés… L’absence de place pour la zone médiane (je préciserais « les zones médianes » linguistiques, politiques, culturelles et sociales) laisse le vécu des Métis non écrit, non documenté et, finalement, invisible. Cette situation reflète la correspondance entre l’histoire canadienne et la perspective coloniale telle que développée par les Comaroff.
Le chapitre d’Étienne Rivard dans l’ouvrage collectif de Morris (2019) renvoie aussi à cette zone interstitielle qu’il reporte dans le secteur du développement économique régional et de son lien, pourtant fondamental, avec la culture :
On s’interroge volontiers sur les conditions culturelles propices à la croissance, mais rarement sur l’opération inverse, à savoir en quoi le développement économique est propice ou non à se répercuter avantageusement dans le champ symbolique de la culture et des identités collectives. On fait peu de cas du concept de métissage qui, pourtant, s’avère un bon moyen de (sic) comprendre les processus culturels en amont comme en aval du développement. Dans l’état actuel des choses, on continue largement à faire fi — ou à faire l’économie — de la distinction culturelle ou identitaire, restant pour l’essentiel aveugle au caractère dynamique et transactionnel de la culture et des appartenances.
Rivard dans Morris : 81
Rivard poursuit sa pertinente réflexion en s’appuyant sur la spécificité culturelle des francophones de l’Ouest canadien pour qui le statut minoritaire vient exacerber les relations d’altérité, les questions identitaires et les besoins, fondamentaux, de consensus et de cohésion sociale. La diversité interne au sein de cette apparence de groupe culturel fait converger des défis multiples tous liés au développement régional de l’Ouest canadien, soit les Métis, l’immigration francophone contemporaine et la francophonie historique canadienne.
L’histoire racontée par les dominants est à nouveau mise sur la table dans l’ensemble des contributions et la perspective de recherche en études métisses, dans l’est du Canada comme ailleurs, souhaite visiblement s’insérer dans cette zone interstitielle délicate, mais combien essentielle à intégrer pleinement, notamment en développement régional comme le soutient Rivard.
Dans l’esprit de la théorie développée dans Le Métis comme catégorie sociale (Gagnon et Giguère 2014), Michaux ajoute à son approche culturaliste la théorie de l’agencéité. Cette approche est pertinente dans un contexte où les débats juridiques et positions légales dressent des cadres de références politiques rigides. Toutefois, ceux-ci demeurent peu aptes à établir une compréhension dense sur les phénomènes mouvants d’identification et de catégorisation (entre Métis et non-Métis, entre Premières Nations avec ou sans statut, entre Allochtones et Autochtones, etc.[7]). Ces cadres ont créé de nouvelles exclusions, de nouvelles catégories et de nouvelles zones interstitielles, et mené à de nouvelles revendications/contestations.
En lisant Michaux, on se demande pourquoi de telles enquêtes culturelles — riches et instructives sur les histoires de la mobilité et des interactions au sein des populations dans l’est du Canada — n’avaient pas été réalisées plus tôt. Chacune des thématiques proposées (les mouvements politiques, les activités économiques, les évolutions linguistiques) nous permet de lire un récit dans lequel l’ensemble des identités canadiennes joue un rôle. Les microphénomènes deviennent rapidement des universaux transposables, dans bien des cas.
Une telle étude exhaustive comme celle de Michaux devrait ainsi être menée dans chacune des provinces canadiennes, pour documenter le vécu métis et la parole métisse : ces expériences singulières qui contribuent à l’ensemble des richesses culturelles planétaires, comme un témoignage d’une des résultantes du colonialisme, d’une vision de l’autochtonie ainsi que des processus contemporains de formations identitaires en Amérique du Nord.
Champ d’étude scientifique
Denis Gagnon reprend ses positions présentées dans ses travaux antérieurs sur le métissage et les Métis en tant que groupes ni exclusifs ni étanches. Il distingue alors trois courants d’étude :
Métissage ethnique et culturel ;
Anthropologie du métissage ;
Études métisses comme volet des études autochtones.
L’analyse des recensements au Canada permet à Gagnon d’affirmer que le nombre d’individus s’identifiant comme Métis au Canada a subi une augmentation de 334 % en 25 ans (soit 150 % au Québec, 168 % au Manitoba et 195 % en Alberta entre 1991 et 2016). Il s’agirait d’une conséquence directe de la reconnaissance de la nation Métis comme l’un des trois peuples autochtones du Canada dans la Loi constitutionnelle de 1982 (art. 35). Selon Gagnon, les revendications sont partout motivées par « l’éventuelle obtention de droits autochtones ou l’expression d’une fierté d’avoir une ascendance amérindienne… l’un n’excluant pas l’autre » (Gagnon : 85). Gagnon en profite alors pour documenter davantage le phénomène des exclusions, un phénomène qui mériterait à mon avis le lancement de nouvelles recherches : dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, 50 % des Métis ne seraient pas reconnus par le Métis National Council (MNC).
« Le refus des Métis de la rivière Rouge de reconnaître ces “autres Métis” se fonde […] sur une confusion entretenue entre les concepts de peuple et de nation » (voir Gagnon : 86), chacun des termes n’ayant pas les mêmes conséquences d’un point de vue juridique et politique. Dans la littérature juridique, on peut mieux comprendre l’argument de Gagnon :
[…] il n’existe pas de statut juridique du peuple en tant qu’entité distincte de l’État. Cela se vérifie aussi bien en droit international public qu’en droit constitutionnel » (p. 5). […] « Dès lors, le concept de peuple, que le droit international et le droit constitutionnel avaient, en quelque sorte et de concert, recouvert d’un voile d’ignorance, va se trouver investi d’une dimension substantielle et identitaire potentiellement perturbatrice de l’État constitutionnel et de la société interétatique contemporaine.
Stéphane Pierré-Caps, 2014 : 5 ; 15
Dans ce sens, Gagnon (p. 41) rapporte que certains jugements de la Cour suprême du Canada s’appuient sur des définitions de concepts comme « communauté », « nation », « peuple » qui ne font pas l’unanimité chez les scientifiques. Par exemple, celle de « communauté » peut désigner une localité, mais aussi (Gagné, Larcher et Grammond 2014) une organisation communautaire, une identité collective ou une identité englobante et territorialisée. Ainsi, la Loi sur les Indiens et l’arrêt Powley[8] considèrent la « communauté » comme un lieu historiquement habité, occupé. Les communautés métisses, à l’instar des communautés inuit et de celles des Premières Nations, ont développé des relations permanentes, voire rituelles, avec des lieux spécifiques, des espaces et des environnements naturels où elles ne résident pas de façon permanente, mais qu’elles fréquentent régulièrement.
Comme mentionné dans des travaux antérieurs (Giguère 2012), nombreux sont les auteurs européens ayant analysé le métissage en lien avec la notion d’authenticité et d’essentialisme (Laplantine, Amselle, Gruzinski). C’est sans doute l’aspect du portrait théorique européen sur le métissage qui rend le plus inconfortable en Amérique du Nord et la raison la plus probable de la mise à distance, sur le plan théorique du moins. La plupart des auteurs contemporains la considèrent d’une simplicité déconcertante : puisque le mot métissage possède sa propre ethnohistoire, héritage du passé colonial, du racisme et de la croyance révolue en la pureté des espèces humaines, il devient malaisant d’aborder ces questions de mélange, d’hybridation, de créolité, etc. Devant l’impossibilité de contourner ces questions qui soulèvent pourtant des problématiques intersectorielles bien réelles, des métaphores sont proposées pour remplacer le recours à cette emprise du racisme et du colonialisme sur l’histoire des relations humaines.
Pour étudier la situation des Métis du Canada dans des perspectives légale, politique et culturelle, on relaie rapidement l’ensemble de ces vastes développements théoriques internationaux à une inutilité déconcertante, tendance également observée chez Michaux, malheureusement (p. 115). L’exercice historique et théorique visant à déconstruire l’usage de la notion de métissage n’est pas anodin et encore moins inutile. Plusieurs auteurs européens sont en ce sens conscients du processus colonisateur sournoisement réactualisé sous le couvert d’un métissage assimilateur, voire réconciliateur. L’argumentaire d’Amselle permet de reconnaître les processus historiques des identités fluides, radicales, multiples et oscillantes, et son plaidoyer pour la métaphore vise justement à relativiser les catégories ethnicistes strictes, comme celle des Métis de l’Ouest, et pourrait, contrairement à ce que nous lisons souvent au Canada, contribuer à l’étude de l’édification des identités métisses. En ce sens, je me questionne sur l’effet de la judiciarisation des identités canadiennes sur le regard plus culturel, historique et social des chercheurs étrangers.
À l’instar d’autres chercheurs, j’ai déjà suggéré (Giguère 2010) de laisser « évoluer » le sens des mots, dont celui des « identités ». Laurier Turgeon (2002) a aussi abordé l’évolution conceptuelle des mots, à la fois à l’égard des métissages et des Métis canadiens. Michaux (2017 : 241-242) évoque qu’il « demeure un certain positionnement en études métisses qui paraît symptomatique de cette polarisation ethnique ». Pourtant, plusieurs situations de métissages dans le monde ne font pas appel à une dénomination spécifique, mais à un système social et culturel d’inclusion aux cercles existants (Ventura i Oller et al. 2014).
J’aimerais revenir enfin à la notion d’authenticité dans les ouvrages ici analysés. D’un côté, Gagnon rejette d’emblée cette notion et Michaux pose la question sans vraiment y répondre. Du côté de l’ouvrage de Morris, l’article proposé par Seibel (p. 127) affronte cette notion délicate par le biais de la fiction théâtrale dont le processus d’écriture confronte le « réel », en plusieurs aspects. Le recours à la fiction constituerait ainsi une puissante démarche d’analyse sur la notion d’authenticité, mais aussi de « confinement » — une expression à laquelle nous sommes plus sensibles depuis 2020 —, le « confinement culturel » de l’autre, l’espace à l’intérieur duquel « je » lui permets d’exister. Et l’espace qu’« il » semble revendiquer par le simple fait d’exister, de créer, d’exprimer ce qu’il est.
En ce sens, la fiction théâtrale et les métaphores permettent de regarder ces transitions frontalières en d’autres termes que ceux de la catégorisation sociale, juridique ou politique. Dans un champ d’études spécifiquement dédié aux processus de métissage et d’identification à la métissitude, un terme que j’emprunte à Louis-Pascal Rousseau et Étienne Rivard (2007) :
C’est un peu la raison derrière le choix du concept de « Métissitude » dont le suffixe itude vise autant à exprimer l’appartenance au fait métis qu’à signifier les aspects scientifiques de ce fait. Effectivement, embrasser ce concept consiste non seulement à s’attarder à l’exploration des dimensions historique et contemporaine des réalités métisses au pays, mais aussi à se rallier à une démarche scientifique qui se veut autant en aval qu’en amont — et donc « fondamentale » — des besoins de recherche actuels suscités par l’arrêt Powley.
Rousseau et Rivard 2007 : 6
Données de recherche
La transparence des données et des sources présentées par Gagnon encourage et facilite la poursuite d’études métisses sur une base solidement documentée d’un point de vue scientifique. Par exemple, Gagnon répertorie 8 associations et 10 communautés métisses au Québec dont aucune n’est reconnue par le National Metis Council, ainsi que 17 clans familiaux couvrant toutes les régions du Québec. Le même effort de synthèse est réalisé pour toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Certaines de ces données statistiques gagneront à être nourries qualitativement dans des études ultérieures. Par exemple, Gagnon mentionne qu’une seule association fédérale est reconnue sur les cinq existantes, et seulement cinq associations provinciales sur les 35 recensées. Sept associations d’« Indiens non inscrits »[9] demanderaient aussi la reconnaissance de leur statut de Métis pour bénéficier de droits autochtones (en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique), de même que quatre associations fédérales pancanadiennes.
Ces données significatives disent toutefois peu de choses sur les motivations à créer chacune de ces associations métisses. Les regroupements métis ont-ils un avantage à se distinguer les uns des autres ? Les associations défendent-elles des valeurs distinctes ? Revendiquent-elles les mêmes accès, les mêmes droits ? Sont-elles à l’image des communautés des Premières Nations et inuit dont les organisations politiques peuvent différer grandement d’une communauté à une autre ?
Gagnon et Michaux privilégient une approche culturaliste (inspirée de Sahlins) et ethnohistorique afin d’offrir une voie de sortie à la vision ethniciste des Métis qui contribuait à leur minorisation. Cette stratégie vise également à aborder l’expérience métisse en tant que tout culturel complexe. Ainsi, Michaux se positionne en faveur d’une histoire régressive, développée par Nathan Wachtel (1990 : 19 ; 1992 : 40) et qui « consiste à aller vers le moins bien connu à partir de ce que l’on connaît mieux, à savoir, dans le cadre de cette recherche, le culturalisme métis. Cette méthode permet de confronter un présent au passé dont il est issu et dont il se souvient (Revel 2002 : 336) » (Michaux 2017 : 241).
Les données de Michaux se concentrent sur les identités métisses canadiennes face aux contingences normatives et juridiques établissant des critères d’authenticité afin d’en limiter l’usage et l’instrumentalisation. Avoir des origines autochtones ne serait pas suffisant pour être métis. Michaux inscrit son analyse dans le champ des études métisses en développement depuis les années 1980 et également dans celui de l’étude des communautés francophones minoritaires canadiennes. Ses exemples principaux concernent les Métis de l’Est animés par une certaine vitalité linguistique particulière : les Acadiens du sud-ouest de Nouvelle-Écosse, les Magouas de Yamachiche, les Mitchif du Manitoba. Il fournit également quelques autres exemples qui pourraient constituer des points de départ pour des études plus approfondies, à Mingan et au Labrador.
Honte et stigmatisation
Une minorité négocie forcément son présent et son avenir avec les images et les perceptions issues du passé, généralement créées par les dominants. Des images de l’autre arrêtées dans le temps, confrontées à la vitalité des initiatives communautaires sont des sources d’interrogations sur la place donnée à la différence des expériences humaines.
L’impact de la conservation d’images stéréotypées et figées dans le temps des Métis chasseurs de bison aurait grandement nui, selon Gagnon, à la modernisation de l’image de cette culture vivante. Mais la multiplication des associations et la complexification des réseaux communautaires seraient peut-être aussi l’indice d’une vitalité bien contemporaine. Pourrions-nous considérer l’associationnisme métis comme une stratégie contemporaine d’affirmation identitaire ?
Par des références à de nombreux récits oraux, Michaux raconte l’expérience de la honte des origines autochtones et l’assimilation volontaire aux Canadiens français. L’héritage des Autochtones, connu et nommé dans certaines familles, de génération en génération, ne traversait jamais la frontière du cercle privé, intime. « Aujourd’hui, rappelle cet informateur, l’opprobre a laissé place à la fierté quant à l’héritage autochtone, ce qui permet à plusieurs lignées acadiennes connues pour être particulièrement métissées de passer de l’ombre à la lumière » (Michaux 2017 : 230).
Michaux décrit fort bien ce passage de l’ombre à la lumière grâce à des extraits de récits qui interrogent la notion de fierté culturelle. L’insécurité culturelle est un concept fort et porteur que l’on peut tirer de cette étude sur les Métis de l’Est. Discriminés par les francophones, par les Autochtones, par les Métis de l’Ouest… le francophone, déjà soumis à l’autorité britannique, savait que son identité autochtone le dirigeait vers une nouvelle « marginalisation ». Pourquoi en rajouter ?
Gagnon et Michaux choisissent de s’appuyer sur la notion d’agencéité dans le but d’ouvrir les analyses sur le lien entre culture et résistance. Michaux pose d’ailleurs la question d’entrée de jeu sur la « résistance de la culture » et « une culture de la résistance » pour les Métis de l’Est. De plus, l’appui sur le culturalisme de Sahlins permet à Michaux de conclure sur la première proposition : « le culturalisme n’apparait pas être le simple refus des produits et relations de la modernité, mais révèle le besoin des peuples de disposer d’un espace à eux au sein de l’ordre culturel mondial » (Michaux 2017 : 113).
Conclusion
Si la culture et le juridique ne font pas toujours bon ménage, ils peuvent certainement se compléter. La conservation du langage vernaculaire est un flux discursif significatif, une sorte d’artefact du passé encore à notre portée. Il nous permet donc de considérer autrement les hypothétiques récits historiques et identitaires sur le « nous » et sur « autrui ».
Les revendications identitaires, comme je l’ai évoqué dans plusieurs de mes écrits, sont signifiantes et témoignent d’une vitalité culturelle. Est-elle dénuée d’intérêts ? De stratégies ? D’objectifs ? Existe-t-il un groupe, une communauté, un réseau culturel qui soit dénué d’intérêt, de stratégie et d’objectifs ?
Les auteurs présentés dans cet essai bibliographique abordent tous la notion d’identité, laquelle est de plus en plus considérée comme un concept-valise que l’on évite de définir clairement. Pourtant, une définition claire pourrait faciliter les dialogues entre les différentes écoles de pensée :
En retirant l’identité de leur boîte à outils, prenant ainsi leurs distances par rapport à l’idéologie de l’identité (un véritable mythe de notre temps), les anthropologues ont pour tâche de rechercher quelles sociétés produisent cette idéologie, comment elles construisent leurs représentations identitaires, pour quelles raisons, causes ou buts elles développent leurs croyances (même leur « foi » aveugle et aveuglante) en l’identité. Nous découvrirons alors que nous-mêmes, Occidentaux et modernes, nous avons construit, répandu, exporté et inculqué au monde entier des mythes et des concepts identitaires. Nous l’avons fait à partir de l’État-nation aux frontières rigides et insurpassables, de l’idéologie clairement identitaire qu’est le racisme, et pour terminer de la racialisation de la culture qui exalte les traditions locales ou nationales comme substances intouchables, dont la pureté est invoquée et qu’on entend défendre de toutes les manières, contre les menaces extérieures. Passée au niveau du discours social et politique, l’identité révèle tôt toute la violence impliquée dans la coupure des liens et des connexions entre « nous » et les « autres ».
Remotti 2019
Faisant suite à cette remise en question de la notion d’identité, j’aimerais conclure sur celle de parole. Je ne pourrais que remercier sincèrement Régine Robin pour la richesse de ses textes analysés par Adina Balint (chapitre 8) dans l’ouvrage de Paul D. Morris et à qui je dois ma dernière proposition de réflexion. Je ne retiendrai ici que quelques phrases signées de sa main, comme des lettres jetées à la mer au bénéfice du monde, et de toutes ses diversités silencieuses :
La parole immigrante inquiète. Elle ne sait pas poser sa voix. Trop aiguë, elle tinte étrangement. Trop grave, elle déraille. Elle dérape, elle s’égare, s’affole, s’étiole, se reprend sa pudeur […].
La parole immigrante dérange. Elle déplace, transforme, travaille, travaille le tissu même de cette ville éclatée. Elle n’a pas de lieu. Elle ne peut que désigner l’exil. L’ailleurs, le dehors […].
La parole immigrante est insituable, intenable. Elle n’est jamais là où on la cherche, où on la croit. Elle ne s’installe pas. Parole sans territoire et sans attache […].
On ne peut pas l’accrocher.
Régine Robin
Dans son chapitre, Adina Balint vient interroger le mot « autre », le « nous autres » et le « vous autres ». Elle met en exergue l’absence du toi et du moi. La difficile rencontre intime. Pourtant, c’est là, dans ce silence du toi et du moi que l’on prononce étrangement peu dans ce français canadien selon l’autrice du roman La Québécoite, que le Métis revendique son histoire. Sa propre parole.
Parties annexes
Notes
-
[1]
La Chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse a été financée par le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) du Canada. Denis Gagnon, professeur à l’Université de Saint-Boniface, en fut le titulaire de 2004 à 2014.
-
[2]
Parmi ces amendements, rappelons l’interdiction des potlatchs de l’Ouest (1884), de toute célébration et expression culturelle et de la libre circulation hors des réserves (début 1900) et de l’obligation de fréquenter les écoles industrielles (1894) ou les pensionnats « indiens » (1920).
-
[3]
L’année 1951 marque le début de remises en question continues de cette loi qui s’accentuent vers la fin des années 1960 et subsistent aujourd’hui.
-
[4]
Loi sur les Indiens. L.R.C. 1985, ch.1-5. À jour au 22 juin 2011. Ministère de la Justice, gouvernement du Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/I-5/page-1.html#h-323430 (page consultée le 19 février 2022).
-
[5]
R. c. Powley, [2003] 2 R.C.S. 207, 2003 CSC 43. https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2076/index.do (page consultée le 17 juin 2022).
-
[6]
Consulter la Direction des archives gouvernementales à l’adresse suivante : https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/metis/certificats-metis/Pages/introduction.aspx (page consultée le 19 février 2022).
-
[7]
Rappelons que le Canada est la seule ancienne colonie, le seul pays, ayant décrété un « statut d’Indien », se dotant de surcroît du pouvoir de définir et de décider qui était et qui n’était pas Indien.
-
[8]
Jugement de la Cour suprême du Canada du 19 septembre 2003 sur le Droit constitutionnel de chasse des peuples métis du Canada. En 1993, l’Ontario poursuit Steve et Roddy Powley pour chasse illégale. Cette poursuite fait l’objet d’une contestation affirmant des droits autochtones énoncés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui garantissent le droit à la chasse en tant que Métis. L’affaire se termine en 2003 lorsque la Cour suprême du Canada décide que les Powley ont effectivement exercé leur droit de chasse. L’affaire clarifie aussi que les Métis forment un peuple indépendant, distinct des Premières Nations et des Inuit. Cette décision crée un précédent sur les revendications des communautés métisses d’est en ouest au Canada.
-
[9]
Voir note infra.
Références
- Amselle J.-L., 1999, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs. Paris, Payot.
- Amselle J.-L.,2000, « Le métissage : une notion piège », Sciences Humaines, 110, 50-51 : 329-333.
- Amselle J.-L.,2001, Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures. Paris, Flammarion.
- Chanson P., 2014, « Le paradigme du métissage : déclinaisons et combinaisons d’une donne aux pensers multiples », Alterstice, 4, 2 : 13‐23.
- Comaroff J. et J. Comaroff, 1992, Ethnography and Historical Imagination. Boulder, Westview Press.
- Gagné N., C. Larcher et S. Grammond, 2014, « La communauté comme sujet et objet du droit : implications pour les Métis du Canada », Anthropologie et Sociétés, 38, 2 : 151-174.
- Gagnon D. et H. Giguère (dir.), 2012, L’identité métisse en question. Stratégies identitaires et dynamismes culturels. Québec, Presses de l’Université Laval.
- Gagnon D. et H. Giguère (dir.), 2014, « Présentation. Le Métis comme catégorie sociale : agencéité et enjeux sociaux », Anthropologie et Sociétés, 38, 2 : 13-26.
- Giguère H., 2005a, « El flamenco como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad », Música viene del Sur, 6 : 311-320.
- Giguère H., 2005b, « El patrimonio inmaterial y sus apuestas : Estudio comparativo de la politización y de la mercantilización de las culturas del flamenco y de las bodegas en Jerez de la Frontera » : 101-112, in X. C. Sierra Rodriguez et X. Pereiro Pérez (dir.), Patrimonio cultural: politizaciones y mercantilizaciones. Séville, Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, Asociación andaluza de antropología, Fundación El Monte.
- Giguère H., 2005c, « La patrimonialización como estrategía de apropiación política del flamenco en Jerez de la Frontera » : 69-83, in M. Gondar Portosany et L. Méndez Pérez (dir.), Políticas culturales: propuestas de las administraciones, respuestas de los administrados. Séville, Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, Asociación andaluza de antropología, Fundación El Monte.
- Giguère H., 2006a,Des morts, des vivants et des choses. Ethnographie d’un village de pêcheurs au nord de Madagascar. Québec, Presses de l’Université Laval et Paris, L’Harmattan.
- Giguère H., 2006b, « Vues anthropologiques sur le patrimoine culturel immatériel. Un ancrage en basse Andalousie », Anthropologie et Sociétés, 30, 2 : 107-127.
- Giguère H., 2008a., « La producción audiovisual en la promoción de patrimonios culturales “inmateriales”. Impactos de proclamaciones de “obras maestras” en España e Italia» : 93-108, in S. Prado, X. Pereira et H. Takenaka (dir.), Patrimonios Culturales: Educación e Interpretación. San Sebastian, FAAEE.
- Giguère H., 2008b, « Musique ethnique ou musique internationale? Diversité, vivencia et esthétique d’un patrimoine flamenco » : 129-143, in C. Bortolotto, (dir.), Il patrimonio culturale immateriale: analisi e prospettive. Milan, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
- Giguère H., 2009, « Un quart Gitan. Métissage, intégration et citoyenneté à Jerez », Anthropologie et Sociétés, 33, 2 : 255-272.
- Giguère H., 2011, La patrimonialización y el arte del momento presente: antagonistas?I°Congreso internacional de Flamenco. Gobierno de Andalucía, Livre blanc du flamenco, Instituto andaluz del Flamenco.
- Giguère H., 2012a, « Les études européennes sur le métissage. Un essai bibliographique » : 267-314, in D. Gagnon et H. Giguère (dir.), L’identité métisse en question. Stratégies identitaires et dynamismes culturels. Québec, Presses de l’Université Laval.
- Giguère H., 2012b., « Introduction — Le métissage : un processus identitaire incontournable, des enjeux négligés », in D. Gagnon et H. Giguère (dir.), L’identité métisse en question. Stratégies identitaires et dynamismes culturels. Québec, Presses de l’Université Laval.
- Giguère H., 2015a, « Cultural rights and heritages of local and translocal agents. A study of Italian and Spanish cases », Ethnologies, 36, 1-2.
- Giguère H., 2015b, « ¿Una producción vinícola puede crear una identidad cultural? Perspectiva antropológica sobre la cultura vitivinícola en Jerez » : 37-58, inJerez, Cultura y Vino. Madrid, Peripecias Libros.
- Guèvremont V., I. Otasevic, et H. Giguère, 2021. Accéder à soi. Accéder à l’Autre. La Convention de l’UNESCO de 2005, les politiques culturelles et l’intégration des migrants. Québec, Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, CELAT.
- Laplantine F., 2005, « Préface » : 9-13, in R. De Villanova et G. Vermès (dir.), Le métissage interculturel. Créativité dans les relations inégalitaires. Paris, L’Harmattan.
- Laplantine F. et A. Nouss, 1997, Lemétissage. Un exposé pour comprendre. Un essai pour réfléchir. Paris, Flammarion.
- Laplantine F. et A. Nouss, 2001, Métissages, de Arcimboldo à Zombi. Paris, Pauvert.
- Murray J. S., 1994, « Certificats des Métis », Bibliothèque et Archives Canada, consulté sur Internet (https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/metis/certificats-metis/Pages/introduction.aspx) le 10 janvier 2022.
- Ortner S., 2006, Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject. Durham (N. C.), Duke University Press.
- Pierré-Caps S., 2014, « Le peuple à l’interface du droit constitutionnel et du droit international », Civitas Europa, 1, 32 : 5-20.
- Remotti F., 2019, « Culture », Anthropen, consulté sur Internet (https://doi.org/10.17184/eac.anthropen.121) le 10 janvier 2022.
- Rousseau L.-P. et É. Rivard, 2007, « Métissitude », Recherches amérindiennes au Québec, 37, 2-3.
- Saul J., 2008, Mon pays métis : quelques vérités au sujet du Canada. Montréal, Boréal.
- Turgeon L., 2002, Regards croisés sur le métissage. Québec, Presses de l’Université Laval.
- Turgeon L., 2003, Patrimoines métissés contextes coloniaux et postcoloniaux. Paris, Maison des Sciences de l’Homme et Québec, Presses de l’Université Laval.
- Ventura i Oller M., A. Surralés, M. Ojeda Mata, J. L. M. Dieste, M. Martínez Mauri, S. Kradolfer, P. Domínguez, A. Coello, M. Clua i Fainé, A. van der Bogaert et V. Stolcke, 2014, « Métissages : Étude comparative des systèmes de classification sociale et politique », Anthropologie et Sociétés, 38, 2 : 229-246.
- Wachtel N., 1990, Le retour des ancêtres : les Indiens Urus de Bolivie : XXe-XVIe siècle : essai d’histoire régressive. Paris, Gallimard.
- Wachtel N.,1992, « Note sur le problème des identités collectives dans les Andes méridionales », L’Homme, 32, 122-124 : 39-52.

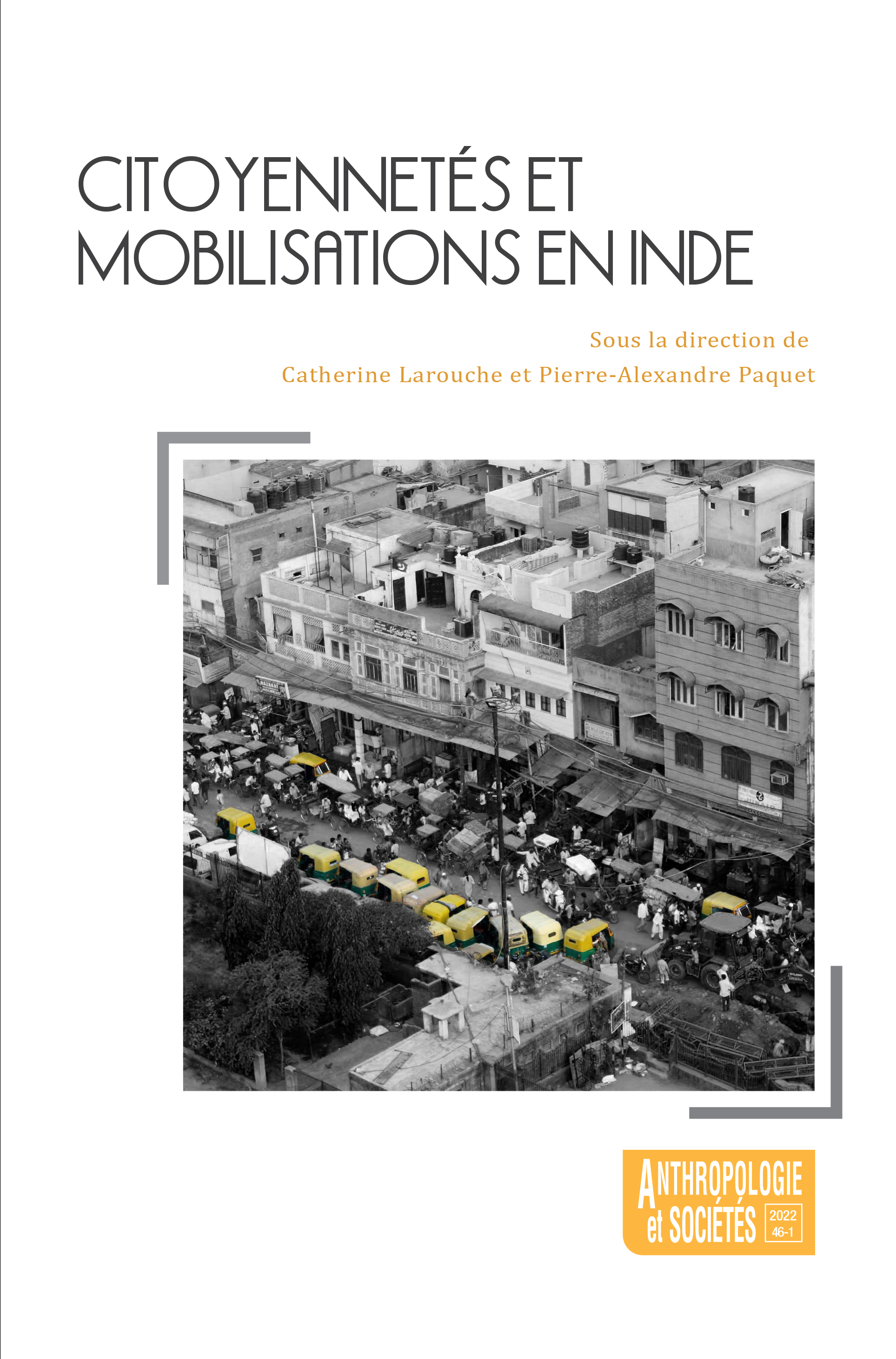
 10.7202/1077422ar
10.7202/1077422ar