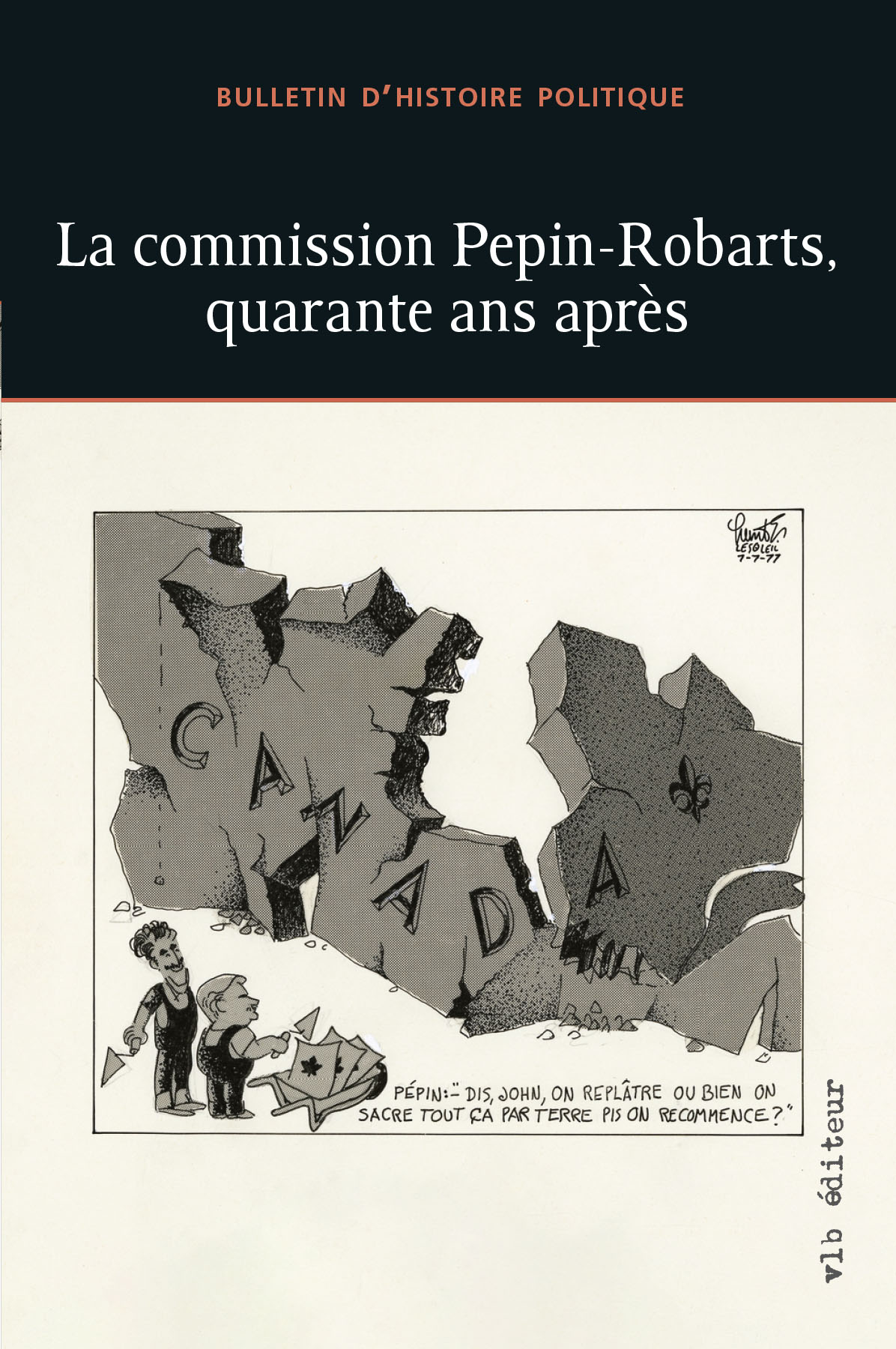Corps de l’article
To me, Ontario was a foreign country.[2]
La montée du mouvement nationaliste et la démocratisation de l’idée indépendantiste dans le Québec des années 1960 ont sans contredit approfondi le fossé entre les collectivités francophones et anglophones de la province. Entre les actions éclatantes du Front de libération du Québec (FLQ), les revendications souverainistes du Parti québécois (PQ) et l’émergence d’une culture francophone forte et originale, les Anglo-Québécoises et les Anglo-Québécois se sont vus progressivement mis à l’écart de la communauté nationale québécoise[3]. C’est dans ce contexte particulier que le cinéaste John Walker a voulu cerner de quelle manière le mouvement indépendantiste a contribué à l’exode de plus d’un demi-million de citoyennes et de citoyens québécois anglophones depuis les débuts de la Révolution tranquille. Son objectif : comprendre les motivations des individus qui ont quitté le Québec, mais aussi cerner les défis qui se dressent encore aujourd’hui du point de vue de la cohabitation entre francophones et anglophones. En résumé, le documentaire présente un récit de l’évolution des relations entre la communauté anglophone du Québec, la communauté francophone et les différents gouvernements qui se sont succédé depuis les années 1960. Le scénario tourne autour de la manière dont les revendications identitaires et politiques des francophones ont approfondi le fossé avec les anglophones, au point où ces derniers en sont venus à se considérer comme des étrangers dans leur propre collectivité.
John Walker est d’ailleurs particulièrement bien placé pour comprendre la complexité de cette cohabitation. Descendant d’une famille d’origine écossaise et irlandaise établie au Québec depuis 250 ans, il a vécu la majorité de sa vie à Montréal, ville qu’il a toujours considérée comme étant sa terre natale. Documentariste reconnu évoluant dans le milieu cinématographique canadien depuis près de quarante ans, Walker a réalisé de nombreux longs-métrages tels que Strand : Under the Dark Cloth (1990), Leningradskaya : The Hand of Stalin (1992) et Utshimassits : Place of the Boss (1996). Il a d’ailleurs remporté plusieurs prix prestigieux pour la qualité de son oeuvre cinématographique, dont un Genie Award (1990), un Gemini Award (1992) et un Fipa d’or (2011), ce qui en fait l’un des grands artisans canadiens du 7e art. Intéressé par les questions de nature historique et culturelle, il n’est donc pas surprenant que Walker ait consacré sa dernière oeuvre documentaire à la question de la cohabitation entre francophones et anglophones au Québec, lui qui est l’un des derniers représentants de sa famille à avoir choisi de demeurer à Montréal. Le film de Walker est d’ailleurs complémentaire à une certaine historiographie qui a mis en lumière les racines du phénomène d’immigration massive ayant marqué l’histoire de la communauté anglo-québécoise dans la seconde moitié du XXe siècle[4]. À l’aide de témoignages et d’entrevues avec des intervenants de différents milieux – peu d’experts sur le sujet, il faut le souligner – et par le biais de son expérience personnelle, Walker propose un regard différent de la Révolution tranquille et de ses suites.
Le documentaire débute par une mise en contexte historique qui met en lumière les transformations qui marquent le Québec durant les années 1960 et 1970, notamment par le biais des politiques sociales du gouvernement libéral de Jean Lesage, mais aussi en lien avec l’activisme des mouvements militants en faveur de la reconnaissance du français comme langue officielle au Québec. Le cinéaste et écrivain Jacques Godbout affirme d’ailleurs que la question de la langue est à la source même de la Révolution tranquille et qu’elle structure les débats sur le devenir de la nation québécoise. Le cinéaste Denys Arcand appuie cette interprétation, affirmant qu’avec le phénomène de sécularisation, la langue en est venue à constituer le marqueur identitaire principal des Québécoises et des Québécois durant la décennie.
Or pour Walker, ces transformations qui reconfigurent la société québécoise ne signifient pas grand-chose, du moins dans l’immédiat. Né en 1952 et issu d’une famille anti-duplessiste de classe moyenne enracinée dans le milieu artistique montréalais, il est encore un enfant lorsque Jean Lesage prend le pouvoir en 1960. Néanmoins, en pratiquant le hockey, il en vient à comprendre peu à peu les dynamiques culturelles particulières entre les « deux solitudes », lui qui évolue dans une équipe entièrement anglophone de Westmount et qui se fait régulièrement traiter de « maudit Anglais » par les joueurs des équipes francophones de la métropole. Toutefois, c’est en 1963 que Walker, comme bon nombre d’anglophones, prend conscience des menaces qui pèsent sur sa communauté. C’est à cette époque que le FLQ pose ses premières bombes à Westmount, dont certaines explosent à quelques maisons seulement de celle des Walker. C’est d’ailleurs au moment des premiers attentats du FLQ que la première vague d’exils des anglophones de Montréal débute, plusieurs milliers d’entre eux décidant d’aller s’établir en Ontario afin de fuir les tensions politiques et sociales qui s’accentuent au fil de la décennie[5]. Plusieurs membres de la famille des Walker iront d’ailleurs s’établir dans la région de Toronto à cette époque.
S’il juge que les actions du FLQ ont contribué à l’aliénation des communautés anglophones du Québec, Walker suggère également que l’effervescence culturelle de la collectivité francophone a elle aussi joué un rôle important dans ce processus de distanciation. Selon lui, les cinéastes de l’ONF (Michel Brault, Denys Arcand, Pierre Perrault), les chansonniers (Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Félix Leclerc) et les écrivains (Michel Tremblay, Jacques Godbout) ont créé un nouveau paradigme culturel dynamique et édifiant pour les francophones, au sein duquel on excluait néanmoins les anglophones d’origine québécoise. Selon Walker, les anglophones du Québec traversent quant à eux une crise identitaire durant la décennie 1960 – une affirmation avec laquelle nous sommes plus ou moins d’accord, nous y reviendrons plus loin –, du fait de leur difficulté à proposer un modèle différent de la culture francophone ambiante, mais aussi de la culture canadienne-anglaise plus généralement. Walker résume ce paradoxe avec éloquence, en affirmant : « French culture was really cool in the 1960’s, you just wanted to be a part of it ».
Du point de vue politique, Walker suggère qu’une partie de la communauté anglo-québécoise n’était pas tout à fait réticente à l’endroit du PQ de René Lévesque. En fait, au tournant des années 1970, plusieurs jeunes anglophones voient d’un bon oeil les politiques avant-gardistes du PQ, notamment en matière de justice sociale. Toutefois, la mise sur pied de la Charte de la langue française (1977) et l’organisation du premier référendum sur la souveraineté du Québec (1980) auraient définitivement rompu les liens entre la communauté anglo-québécoise et le PQ. Cette désaffection à l’endroit du gouvernement Lévesque aurait, selon Walker, contribué à forger le mythe selon lequel la minorité anglophone aurait été historiquement arrogante et méprisante à l’égard de la cause indépendantiste. Cette idée serait d’ailleurs renforcée par l’appui massif de la communauté anglophone au gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau sur la scène fédérale. Pour bien des jeunes de la génération du baby-boom, le gouvernement Trudeau représentait un véhicule politique susceptible de porter certaines de leurs revendications, mais aussi de les protéger contre les politiques « excessives » du gouvernement Lévesque.
Malgré cet optimisme, des milliers de familles anglophones observent avec pessimisme la dégradation du climat social durant la décennie 1970 et décident de quitter le Québec. Walker lui-même, au début des années 1970, décide de tenter sa chance dans la région de Toronto afin de se consacrer à sa carrière de cinéaste. Il faut dire qu’il est à ce moment l’un des derniers membres de sa famille à résider dans la province francophone, ses parents s’étant établis à Toronto quelques années auparavant. Dans le cas de Walker, toutefois, le mal du pays lui fera reprendre le chemin de Montréal, 18 mois seulement après son départ. Son parcours illustre alors le paradoxe identitaire que vivent les jeunes anglophones du Québec, qui constituent une minorité au sein d’une majorité qui est elle-même minoritaire dans la fédération canadienne, et plus largement dans le grand ensemble nord-américain anglophone. Walker souligne que les années 1970 constituent une période difficile pour un grand nombre de familles anglo-québécoises. Plusieurs jeunes ressentent alors une frustration de devoir quitter le Québec en raison de la détérioration du climat social, un certain nombre déclarant même avoir vécu un véritable traumatisme. De nombreuses familles se trouvent également divisées quant à savoir s’il vaut mieux rester ou partir, les conflits générationnels jouant un rôle important dans ces réflexions existentielles.
De ce fait, le point d’orgue à cette crise sociale survient lors de la tenue de la campagne référendaire de 1980. Selon Walker, la campagne aurait eu un effet catastrophique sur les relations entre anglophones et francophones. Il estime que certains tenants du camp du « Oui » ont fait leurs choux gras sur le dos de la minorité anglophone du Québec en accusant celle-ci d’être la cause de tous les maux de la collectivité francophone. Largement relayés par les médias de l’époque, ces discours haineux auraient précipité le départ de milliers de familles anglophones qui décidèrent de définitivement tourner le dos au Québec[6]. Plus encore que les actions du FLQ, la campagne référendaire de 1980 aurait institué une profonde rupture entre les deux communautés linguistiques. Quant au Référendum de 1995, celui-ci ne fera que jeter de l’huile sur le feu, en vertu des propos sur « l’argent et des votes ethniques » tenus par le premier ministre Jacques Parizeau après l’annonce des résultats du vote le soir du 30 octobre[7]. À la suite de cette déclaration malheureuse, le PQ, mais aussi le Bloc québécois sur la scène fédérale, deviendra l’ennemi public de la communauté anglophone, celle-ci craignant par-dessus tout de revivre les affres des campagnes référendaires et de ses débordements partisans.
À ce propos, Walker dresse d’ailleurs des parallèles avec le mouvement indépendantiste écossais qui a, sous la gouverne du Parti national écossais, organisé un référendum sur la souveraineté de l’Écosse en 2014. Selon lui, l’une des grandes différences entre la campagne référendaire écossaise de 2014 et celles observées au Québec en 1980 et 1995 réside dans l’ouverture d’esprit des indépendantistes d’Écosse, notamment à l’égard de l’inclusion des minorités culturelles et linguistiques dans les discours officiels et militants. Confrontant certains groupes qui militent pour l’indépendance du Québec, dont Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Walker affirme que la Charte des valeurs du PQ (2013) illustre la persistance d’une certaine forme de xénophobie dans la mouvance nationaliste contemporaine. Pour ce dernier, il est évident que les communautés culturelles et la minorité anglophone ne pourront jamais adhérer à l’idée indépendantiste tant que le PQ sera le bateau amiral de ce mouvement. D’ailleurs, bien des anglophones de la nouvelle génération associent le PQ à une époque révolue et croient que la question nationale constitue un frein à l’évolution de la société et aux débats d’idées[8].
En conclusion de son documentaire, John Walker se rend dans la région de Lachute, dans les Laurentides, où ses grands-parents se sont établis au début du XXe siècle. Majoritairement anglophone jusqu’au milieu du XXe siècle, Lachute est désormais composée à plus de 90 % de locuteurs et locutrices francophones. Les anglophones qui habitent encore la région sont en fait les derniers représentants de leurs familles et sont, pour la plupart, âgés de plus de 70 ans. Walker s’entretient avec certains d’entre eux, afin de connaître leur opinion sur la situation actuelle des Anglo-Québécois résidant à l’extérieur du West Island. Selon eux, les anglophones du Québec, surtout de la vieille génération, sont généralement plus pauvres et vivent dans des situations financières marquées par la précarité (chômage chronique, faible revenu, difficulté à trouver un emploi). Ils affirment d’ailleurs qu’ils se sentent comme des citoyens de seconde zone et que leurs petits-enfants considèrent qu’il n’y a pas d’avenir – « no future » – pour eux dans la province. Le film se termine sur une note pessimiste, laissant planer le spectre d’un exil continu de la population anglo-québécoise vers l’Ontario et les autres provinces anglophones du Canada, tant et aussi longtemps que la question du statut politique du Québec au sein du Canada ne sera pas réglée.
Dans l’ensemble, le documentaire de John Walker constitue un témoignage éclairant sur le thème de la coexistence entre francophones et anglophones du Québec. Articulant une vision qui tire parti à la fois des faits historiques, de témoignages d’intervenants et d’intervenantes anglophones et francophones et de son expérience personnelle, Walker montre comment les discours politiques et la réalité socioculturelle ambiante tendent à marginaliser les Anglo-Québécois établis au Québec depuis plusieurs générations. Il montre également que le mythe de l’anglophone arrogant et dominant a durablement imprégné la conscience collective francophone, au point de rendre toute volonté de reconnaissance non recevable pour cause de « préjudices historiques ». S’il est moins prompt à reconnaître que ce mythe est basé sur une réalité historiquement observable, notamment dans les milieux économiques d’avant 1960, Walker illustre toutefois de manière remarquable comment ce mythe a pu causer des préjudices à la communauté anglo-québécoise durant la seconde moitié du XXe siècle. Plus largement, il a su rendre compte de manière intimiste de l’attachement dont font preuve les Anglo-Québécois à l’égard de leur région d’origine. La résilience et la persévérance qui ont amené ces individus à demeurer au Québec à l’heure des exils vers Toronto témoignent de l’existence de liens communautaires très forts.
S’il constitue un excellent documentaire, Québec : my country, mon pays comporte néanmoins certains raccourcis intellectuels problématiques. L’un de ces raccourcis est relatif à la période de la décennie 1960, époque durant laquelle Walker affirme que la communauté anglo-québécoise « admirait » l’effervescence culturelle du Québec francophone. Et pourtant, à la même époque, la scène culturelle anglo-québécoise était elle aussi en ébullition. Nous n’avons qu’à penser à la scène musicale (Leonard Cohen, Oliver Jones, Oscar Peterson), littéraire (Mordecai Richler), cinématographique (ONF/NFB) ou théâtrale (organisée autour du Centaur Theatre). À n’en point douter, la culture anglo-québécoise des années 1960 était d’une richesse insoupçonnée et contribuait pleinement au processus de construction de l’identité anglo-québécoise moderne. Et pourtant, le film de John Walker semble plutôt suggérer que le West Island était un désert culturel. Dans un même ordre d’idée, le documentaire est également très avare par rapport aux fondements identitaires de la communauté anglo-québécoise. À l’exception de la question linguistique, Walker ne souligne jamais les autres traits fondamentaux de cette communauté, notamment du point de vue de ses pratiques religieuses, de l’organisation de son système scolaire, de ses réseaux économiques, de son appareil médiatique autonome (presse, télévision, radio). On en vient à se demander si Walker a lui-même conscience des différents paramètres qui sont en constante interaction dans les processus de (re) définition identitaire. Sans nul doute, une réflexion approfondie à ce sujet aurait été de mise.
En terminant, nous nous devons de revenir sur les propos de Walker tenus dans le cadre du référendum écossais de 2014. Les parallèles boiteux qu’il fait en soulignant à grands traits l’ouverture des Écossais et Écossaises et la fermeture d’esprit – voire la xénophobie – des indépendantistes du Québec ont de quoi laisser perplexe. Si les déclarations malheureuses de Jacques Parizeau en 1995 ont terni de manière durable la réputation du mouvement indépendantiste, il ne faudrait pas oublier que ce mouvement a cherché, dès la fondation du PQ, à se rapprocher des différents groupes culturels du Québec. Pensons notamment au travail de Gérald Godin au tournant des années 1980, à titre de ministre des Affaires culturelles puis de l’Immigration, d’ailleurs mis en valeur dans le documentaire Godin (2011)[9]. Associer la volonté d’indépendance d’un groupe culturel à un comportement raciste constitue en somme un raccourci intellectuel qui, selon nous, ne fait qu’approfondir la distance déjà grande entre les communautés québécoises de langues française et anglaise.
Outre ces quelques erreurs regrettables, les lecteurs du Bulletin pourront néanmoins trouver dans le long-métrage de Walker un portrait dynamique et intimiste de l’évolution historique de la communauté anglo-québécoise, des années 1960 à nos jours. Signe de la distance qui règne toujours entre les deux solitudes, Québec : my country, mon pays n’a reçu que peu d’attention de la presse spécialisée et des médias en général lors de sa sortie initiale en 2016[10]. Alors qu’il a reçu un accueil enthousiaste dans le reste du Canada, le film est passé relativement inaperçu au Québec – en milieu francophone à tout le moins – et ce n’est qu’en 2020 qu’il a été diffusé pour la première fois sur ICI-Télé. Nous ne pouvons donc qu’encourager nos lecteurs à visionner ce documentaire afin d’en apprendre davantage sur cette page méconnue de l’histoire sociopolitique et culturelle du Québec.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Le documentaire peut être visionné gratuitement sur la plateforme numérique de la CBC : gem.cbc.ca/media/documentary-specials/episode-100/38e815a-012988af507.
-
[2]
Citation de John Walker, tiré du film.
-
[3]
Sur le sujet, voir Josée Legault, L’invention d’une minorité : les Anglo-Québécois, Montréal, Boréal, 1992, 282 p.
-
[4]
Voir notamment Anne Griffin, Quebec, the challenge of Independence, London, Associated University Presses, 1984, 229 p. ; William D. Coleman, The Independence Movement in Quebec, 1945-1980, Toronto, Toronto University Press, 1984, 274 p. ; Gary Caldwell et Eric Waddell, The English of Quebec : From majority to minority, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1982, 464 p.
-
[5]
Josée Legault, op. cit., p. 106.
-
[6]
Ibid.
-
[7]
Carol-Ann Bellefeuille, « La campagne référendaire de 1995 : un discours racialisé », Cahiers d’histoire, vol. 33, no 2, automne 2016, p. 185-209.
-
[8]
Ce sont notamment les propos émis par le cinéaste Jay Baruchel qui, en mai 2015, avait fait les manchettes en déclarant quitter le Québec pour des raisons politiques, expliquant avoir été dégoûté par la Charte des valeurs du PQ (2013-2015) et en avoir eu assez de vivre continuellement comme un citoyen de seconde zone dû à ses origines anglophones. Sur le sujet, voir notamment Hugo Pilon-Larose, « Critiqué pour ses propos, Jay Baruchel a eu le coeur brisé », La Presse, 31 juillet 2015.
-
[9]
Simon Beaulieu, Godin, Les Films de Gary inc., 2011, 75 min.
-
[10]
André Lavoie, « “Québec : my country, mon pays” – Une histoire parcellaire du Québec », Le Devoir, 24 juin 2017 ; Marc Cassivi, « Le Québec vu par un exilé », La Presse, 15 novembre 2016.