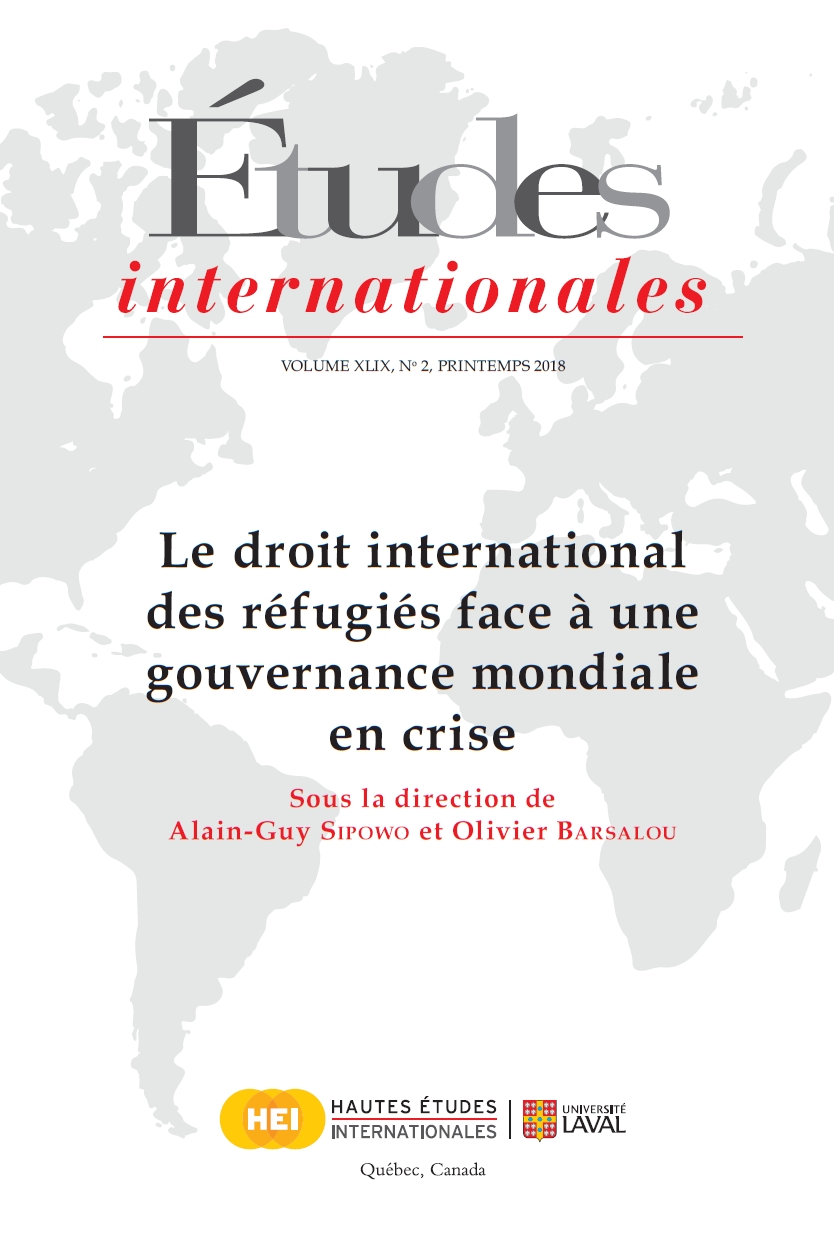Résumés
Résumé
Les personnes qui fuient le conflit armé en Syrie trouvent d’abord refuge dans les pays voisins, en Égypte, au Liban, en Irak, en Jordanie ou en Turquie. C’est ensuite seulement qu’elles décident de poursuivre leur migration vers des destinations lointaines. La présente contribution expose les motifs qui poussent les Syriens réfugiés au Moyen-Orient à entreprendre une migration secondaire. L’auteur soutient que cette migration tient, d’une part, à l’inadéquation de la protection juridique que reçoivent ces réfugiés dans les pays voisins et, d’autre part, à l’instabilité chronique que connaît la région. Il suggère que, dans la mesure où les pays occidentaux ne sont pas exempts de reproches dans la situation en Syrie, la réponse qu’ils apportent à la crise des réfugiés syriens devrait se fonder non uniquement sur un devoir de solidarité à géométrie variable, mais sur un principe de responsabilité en vertu duquel la charge de chacun serait déterminée par son niveau d’implication ou d’omission dans la crise.
Mots-clés:
- réfugiés syriens,
- Moyen-Orient,
- protection juridique,
- partage des charges,
- devoir de solidarité,
- principe de responsabilité
Abstract
People fleeing armed conflict in Syria first find refuge in neighbouring countries like Egypt, Lebanon, Iraq, Jordan, and Turkey. Only then do they decide to move on to other, more distant destinations. This piece explores the reasons that drive Syrian refugees in the Middle East to a secondary migration. The author argues that this migration is due, on the one hand, to the inadequate legal protection they receive in the neighbouring countries and, on the other, to chronic instability in the region. He suggests that, since Western countries are not without blame for the Syrian situation, their response to the Syrian refugee crisis should be guided not only by a duty of variable-geometry solidarity but also a principle of responsibility according to which each party’s burden is determined by its level of engagement or disengagement in the crisis.
Keywords:
- Syrian refugees,
- Middle East,
- legal protection,
- burden sharing,
- duty of solidarity,
- principle of responsibility
Resumen
Las personas que huyen del conflicto armado en Siria encuentran primero refugio en países vecinos, Egipto, Líbano, Irak, Jordania o Turquía. Sólo entonces deciden continuar su migración hacia destinos lejanos. En esta contribución se exponen las razones por las que los sirios refugiados en Oriente Medio a hacer una migración secundaria. El autor sostiene que esta migración se debe, por una parte, a que la protección jurídica que reciben estos refugiados en los países vecinos no es la adecuada, y por otra, a la inestabilidad crónica que prevalece en la región. Sugiere que, dado que los países occidentales tienen parte de responsabilidad de la situación en Siria, su respuesta a la crisis de los refugiados sirios debería basarse no sólo en un deber de solidaridad de geometría variable, sino también en un principio de responsabilidad según el cual la carga de cada parte estaría determinada por su nivel de participación u omisión en la crisis.
Palabras clave:
- refugiados sirios,
- Oriente Medio,
- protección jurídica,
- reparto de cargas,
- responsabilidades,
- deber de solidaridad,
- principio de responsabilidad
Corps de l’article
La crise en Syrie a poussé hors de ce pays plus de 5 millions de personnes selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (hcr 2017a). En août 2014, les Syriens étaient 3 millions à quitter leur pays (Fisher 2014). Leurs déplacements, qui se produisent dans une région du Moyen-Orient déjà en proie à la migration forcée, ont majoritairement eu lieu en direction des pays voisins que sont l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Liban et la Turquie. Cette migration menace directement les Syriens, mais également les ressortissants d’autres pays, tels que l’Irak, l’Afghanistan, le Liban, la Palestine, réfugiés depuis longtemps en Syrie.
La destination de la migration est un enjeu important dans la recherche des solutions au problème des réfugiés à l’échelle mondiale. L’attention médiatique portée sur les pays industrialisés d’Europe, d’Amérique et du Pacifique laisse sous-entendre que ces pays constitueraient le premier choix de destination des demandeurs d’asile, en particulier les demandeurs syriens. Pourtant, la réalité est loin d’être aussi claire et les préjugés rampants au sein de l’opinion ne peuvent seuls expliquer les raisons qui justifient que les personnes en fuite choisissent des destinations aussi lointaines.
À l’épreuve des faits, l’Europe, les Amériques, l’Asie et le Pacifique ne viennent qu’en troisième position des destinations de l’ensemble des 65,6 millions de déplacés de 2016, loin derrière l’Afrique et la région Moyen-Orient–Afrique du Nord (Mena). D’après le hcr, l’Afrique et la région Mena accueillent respectivement 30 % et 26 % des migrants, tandis que l’Europe et les Amériques n’en recevraient que 17 % et 16 %, et l’Asie-Pacifique 11 % (hcr 2017a). La pression migratoire est donc plus forte sur les pays les moins avancés que sur les pays développés, contrairement à ce que laisse souvent croire le discours ambiant.
Dans la nomenclature juridique internationale, ce sont, grosso modo, les personnes victimes de déplacement forcé qui ont besoin de protection, qu’il s’agisse de la protection de leur État avec ou sans l’assistance de la communauté internationale – lorsque le déplacement a lieu à l’intérieur d’un même pays – ou de la protection d’un autre État ou d’une organisation internationale – lorsque le déplacement implique le franchissement de frontières internationales. Ces personnes étaient au nombre de 65,6 millions en 2016. Parmi elles, on compte non seulement les déplacés internes – qui constituent près de la moitié de ce nombre –, mais aussi les réfugiés et les apatrides. Si l’on exclut les déplacés internes et les 5,3 millions de réfugiés palestiniens qui relèvent du mandat de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (unrwa), ce sont 17,2 millions de réfugiés et 10 millions d’apatrides qui, se trouvant en dehors de leur pays d’origine ou étant dorénavant sans nationalité, ont besoin de protection internationale.
La présente contribution ne prétend pas que ce nombre est insignifiant et que les déplacés pourraient aisément se répartir dans l’ensemble des pays du monde. Elle vise plutôt à montrer l’écart qui existe entre la réalité et une pensée qui se généralise au sein de l’opinion et fait monter la xénophobie ou l’intolérance à l’égard des demandeurs d’asile. Cette pensée tranche pourtant avec les faits. Sur les six premiers pays d’accueil indiqués par le hcr en 2017, aucun n’était européen ou américain. La Turquie a en effet accueilli près de 3 millions de déplacés, le Pakistan 1,4 million, le Liban 1 million, l’Iran, l’Ouganda et l’Éthiopie entre 900 000 et 700 000 (hcr 2016 : 15). Au cours de la même période, 55 % des réfugiés venaient de trois pays, à savoir le Soudan du Sud (1,4 million), l’Afghanistan (2,5 millions) et la Syrie (5,5 millions). En croisant les départs et les arrivées, on constate qu’aucun État européen ou américain n’a été en mesure d’accueillir plus de 800 000 demandeurs d’asile. L’Allemagne, seul pays développé à figurer parmi les dix premiers pays d’accueil, n’arrivait qu’en huitième position avec un peu plus de 600 000 réfugiés (hcr 2016 : 15). Plus important, toutefois, les chiffres confirment que les pays voisins sont les premiers touchés par les flux migratoires. Le cas syrien en est la preuve. Selon le hcr, la fuite des Syriens s’est organisée en deux temps : d’abord vers les pays voisins, puis vers l’Europe (hcr 2015a).
L’objet de la présente contribution est de tenter d’expliquer ce qui pousse les personnes réfugiées à entreprendre une migration secondaire vers des destinations aussi lointaines que l’Europe, l’Amérique, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. En effet, de nombreuses personnes déplacées en Syrie ne choisissent pas de rester dans les pays voisins de leur État d’origine. Souvent, aussi, ces pays voisins font clairement entendre à la communauté internationale que leur capacité d’accueil est insuffisante ou qu’ils ne veulent pas recevoir autant de déplacés ni offrir la protection qu’implique l’arrivée massive de personnes réfugiées. Au-delà de l’instrumentalisation politique de la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il est important de prendre du recul face à la situation afin de tenter une explication rationnelle du comportement des acteurs en présence. La prétention des demandeurs d’asile à une migration secondaire est-elle véritablement justifiée ? Un État, à l’exemple des pays voisins de la Syrie, est-il en droit de refuser d’accueillir les demandeurs d’asile et de leur offrir la protection internationale dont ces personnes ont besoin ? Quels enseignements faut-il tirer des pratiques récentes en matière de gouvernance de la crise des réfugiés syriens ? Les décisions et les politiques adoptées aux niveaux national, régional et international répondent-elles suffisamment au besoin de protection des réfugiés syriens ?
Pour répondre à ces interrogations, nous appuyons nos recherches et nos analyses sur des théories des Relations internationales et du droit international. La résistance des pays voisins de la Syrie à la protection des réfugiés doit être comprise dans un double sens. Les pays du Moyen-Orient, par leur conception rigide de la souveraineté, ont souvent fait montre d’une ouverture limitée aux normes relatives à la protection des réfugiés. Une première explication de la tendance à la migration secondaire des réfugiés syriens se trouve ainsi dans la participation insatisfaisante des pays de transit aux instruments internationaux relatifs aux droits des réfugiés (I). En outre, à l’inadéquation de la protection juridique, il faut ajouter la persistance de l’instabilité dans l’ensemble de la sous-région. Les réfugiés syriens retrouvent dans les pays voisins les mêmes circonstances qui ont provoqué leur fuite. Il importera donc d’analyser les impacts de la crise sécuritaire que traversent les pays vers lesquels se dirigent les réfugiés syriens (II). C’est en comprenant mieux les dynamiques du conflit dans la région qu’il est possible de juger si la gouvernance actuelle de la crise des réfugiés syriens est adaptée (III).
I – La crise des réfugiés syriens : une crise du droit des réfugiés au Moyen-Orient
Si l’Europe ou l’Amérique ou, plus généralement, les pays développés exercent une attraction sur les migrants, c’est qu’en plus d’être des pays stables et sécuritaires, ces États garantissent des standards de protection les plus élevés. On ne saurait en dire autant des pays du Moyen-Orient qui subissent l’arrivée massive des réfugiés syriens. Ainsi, quoique certains de ces pays soient parties au régime international des réfugiés, ce dernier n’y a qu’une application limitée (A). Les solutions alternatives n’offrent pour leur part que des réponses parcellaires, qu’il s’agisse de la protection en vertu du Statut du hcr (B), du droit régional (C) ou du droit national et de la coutume internationale (D). La présente section traitera tour à tour ces quatre points.
A – La portée limitée de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés
Les pays voisins de la Syrie ne sont pas, pour la plupart, parties à la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Tel est le cas du Liban, de l’Irak et de la Jordanie, qui n’ont pas signé la Convention, et encore moins son protocole de 1967 en vertu duquel la protection accordée par la Convention est étendue à tout réfugié sans distinction d’origine. Dans ces pays, l’accueil des réfugiés s’est fondé sur d’autres bases, notamment la solidarité et l’hospitalité (Zetter et Ruaudel 2014 : 8). Les Syriens n’ont en général pas besoin de papiers pour entrer en Jordanie. Mais leurs conditions de résidence ou de circulation sont assez restreintes (Zetter et Ruaudel 2014). Tel n’est pas le cas au Liban où un permis de résidence est nécessaire, permis qui n’a qu’une durée de six mois renouvelable de manière arbitraire.
La situation en Irak est encore plus précaire. Le statut juridique des réfugiés n’est pas clairement réglementé et la pratique diverge d’un gouvernorat à l’autre (Zetter et Ruaudel 2014). Dans ces circonstances, la participation à la Convention de Genève offrirait un levier à la recherche de solutions au problème des réfugiés syriens. Non tenu à une quelconque obligation internationale de protection, l’Irak ne peut être mis sous pression comme pourrait l’être un pays signataire de la convention. Or, au 30 novembre 2017, ce pays avait accueilli 247 000 réfugiés syriens pour 81 000 ménages (hcr 2017a). Des chiffres qui sont sans cesse croissants.
La participation à la Convention de Genève n’est pas toujours suffisante. Au contraire. Le cas de l’Égypte et de la Turquie, autres pays vers lesquels se dirigent les Syriens, l’atteste.
L’Égypte est certes partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et à son protocole de 1967, mais elle n’administre aucun système de détermination de la qualité de réfugié. En octobre 2017, elle accueillait pourtant près de 126 000 réfugiés et demandeurs d’asile syriens. En fait, l’Égypte ne reconnaît pas d’autres droits aux réfugiés et demandeurs d’asile que la protection contre le non-refoulement. Pour le reste, les réfugiés et demandeurs d’asile doivent s’en remettre à l’assistance humanitaire du hcr et d’autres organisations de la société civile. La révolution du printemps arabe qui apparaissait comme une occasion de faire évoluer la situation des migrants en Égypte a, au contraire, renforcé le statu quo (Jones 2012).
Quant à la Turquie, bien que signataire de la Convention, elle refuse de lever les limites géographiques et temporelles qui empêchent d’étendre la protection que la Convention offre aux non-Européens et aux réfugiés et demandeurs d’asile dont la situation qui les concerne est survenue depuis 1951. Également non signataire du Protocole de 1967, la Turquie n’est de ce fait pas partie au régime international des réfugiés. Comme la Jordanie, le Liban ou l’Irak, elle maintient une politique d’hospitalité et d’accueil qui change au gré des circonstances. En 2016, le pays accueillait près de 2,5 millions de réfugiés syriens, nombre qui est passé à près de 3,4 millions en 2017. Bien qu’elle ait modifié sa législation pour faciliter l’obtention du permis de travail par les réfugiés et les exempter de visa (Turquie 2013 : articles 4 et 8), la Turquie a récemment durci sa politique d’accueil à l’égard des Syriens (Human Rights Watch 2018). Or, en vertu de la Convention de 1951, les demandeurs d’asile jouissent, outre du droit de ne pas être refoulé à la frontière (Assemblée générale des Nations Unies 1951 : article 32), d’une immunité contre les sanctions pénales lorsqu’ils arrivent dans le pays d’accueil de manière illégale (Assemblée générale des Nations Unies 1951 : article 31) ; immunité que garantit d’ailleurs le règlement turc sur la protection temporaire (hrc 2015b : 2 ; Turquie 2014 : article 5).
Les raisons qui expliquent la participation insatisfaisante des voisins de la Syrie au droit international des réfugiés sont aussi très variées (Janmyr 2017). Le système de protection qui découle de la Convention de Genève est en effet remis en question depuis les premières crises des réfugiés du début des années 1980. Au coeur de ce débat reviennent presque inlassablement les enjeux économiques, mais aussi sécuritaires, entourant la migration forcée ; enjeux auxquels ne répond pas adéquatement la Convention de 1951. Il est aujourd’hui commun dans des discours politiques d’entendre que l’accueil des réfugiés est cause de déséquilibre économique. La Turquie estime, par exemple, avoir déjà investi près de 30 milliards de dollars en soutien aux Syriens en Turquie depuis le début de la crise (hcr 2017b : 10). Or, la Convention de Genève ne répond guère aux impacts économiques, sociaux, politiques et même environnementaux des flux de masse, pas plus qu’elle n’envisage une obligation de partage des charges ou une responsabilité des pays de départ pour le déracinement de leurs citoyens.
Toujours est-il qu’en l’absence de cadre juridique, les victimes du déplacement forcé, qui ne sont pas à blâmer, doivent faire face à des défis immenses. Les acteurs humanitaires qui s’engagent à leur porter secours peuvent à leur tour se sentir désarmés lorsqu’ils doivent intervenir dans des États qui rejettent la Convention de Genève et le Protocole de 1967. Dans ces conditions, se pose clairement la question des voies alternatives à ces instruments internationaux et surtout celle de la valeur juridique de tels moyens, lorsqu’il en existe.
B – Le secours temporaire du Statut du hcr
La Convention de Genève traite abondamment de la définition du réfugié et du régime de droits et obligations que les États doivent mettre en oeuvre. Elle demeure cependant silencieuse sur la reconnaissance du réfugié. La législation diverse des pays du Golfe ne répond pas à cette préoccupation, pas plus qu’on ne peut alléguer que les lois de ces pays constituent des modèles de clarté quant à la protection des réfugiés admis sur leurs territoires. En réalité, ces pays s’en remettent au hcr quant à la fonction de reconnaissance. En ce qui concerne la protection des droits des réfugiés, l’organisation humanitaire et les nombreuses organisations de bienfaisance qui portent secours aux victimes de guerre doivent assumer le rôle des États dans un contexte de dysfonctionnement des institutions politiques et sociales et de difficultés économiques. Le hcr dispose d’une base d’intervention claire : son Statut de 1950, qu’il complète au besoin avec des protocoles d’accord avec les pays hôtes.
Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Statut n’impose pas d’obligations aux États. Dépourvue de force obligatoire, cette résolution a uniquement valeur de recommandation. Elle ne fait rien de plus qu’inviter les États à coopérer avec le hcr sur un ensemble de problématiques, dont la protection et les solutions durables. Quelques États du Golfe ont répondu favorablement à cette invitation, concluant des protocoles d’accord avec le hcr. C’est le cas du Liban (2003), de la Jordanie (1998) et de l’Égypte (1954). La Turquie, qui par un règlement de novembre 1994 a retiré la fonction d’identification des réfugiés au hcr, maintient avec celui-ci un accord-cadre de coopération sur le renforcement des capacités de son personnel (Alborzi 2006 : 156). En Irak, un protocole d’accord a été conclu le 25 décembre 2011 avec la Mission des Nations Unies dans le pays pour reconnaître au hcr, entre autres, le mandat de détermination de la qualité de réfugié et de recherche de solutions durables.
En l’absence d’adhésion au droit international, de tels accords permettent de fixer le cadre de coopération avec le hcr pour la protection et l’assistance des réfugiés. En général, ces accords prévoient que l’État reconnaît les réfugiés désignés comme tels par le hcr et qu’il leur accorde un droit de séjour. Au Liban, ce droit dépasse rarement six mois, le temps qu’une solution durable soit trouvée par l’agence internationale (hcr 2010). Cette approche s’inscrit directement dans l’esprit des conclusions du Comité exécutif du programme du hcr (Comex) qui invite les États, en cas d’arrivée massive, à accorder une protection temporaire aux personnes en quête d’asile (Comex 1980 ; 1981). Véritable obligation dans le cadre de la Convention de l’Union africaine sur les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (oua 1969), la protection temporaire n’aurait aucun fondement juridique en droit international des réfugiés. Pour autant, les conclusions du Comité exécutif du hcr soulignent l’obligation de l’État d’accueil de garantir l’admission et le non-refoulement ainsi qu’un traitement répondant aux normes minimales humanitaires de base (Comité exécutif du programme du hcr 1981). Un devoir de solidarité, de caractère bilatéral ou multilatéral, incomberait en outre aux autres États membres de la communauté internationale. Ce devoir exige de ces membres qu’ils partagent avec les pays d’accueil les charges résultant des arrivées massives. Faute de force juridique certaine, la mise en oeuvre de ces recommandations varie d’un contexte d’afflux massifs à un autre.
C – L’illusion du droit régional des réfugiés
La Convention de l’Organisation de l’Unité africaine (oua) – aujourd’hui Union africaine (ua) – régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, de 1969, est l’une de ces solutions alternatives sur lesquelles il peut s’avérer pertinent de se rabattre. L’Égypte en est partie. La Convention de 1969 a la particularité de s’appliquer dans le respect du principe de non-discrimination. Les États parties se sont engagés à appliquer les dispositions de la Convention « sans distinction de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions politiques ». Ainsi, l’Égypte ne pourrait prétendre que les réfugiés de Syrie ne sont pas des ressortissants du continent africain pour refuser de leur appliquer la Convention. Ce principe de non-discrimination est, avec l’interdiction du refoulement, l’inclusion d’une définition extensive de la notion de réfugié et la protection temporaire, les seuls points forts de la Convention de l’ua qui affiche un régime de droits moins étoffé que la Convention de Genève.
En pratique, bien que l’Égypte accorde l’accès aux services de santé et d’éducation aux réfugiés de Syrie et du Soudan, ils sont nombreux parmi les quelque 120 000 arrivés dans les villes du pays à avoir fait l’objet d’arrestation et détention arbitraires vers le mois de juillet 2013 lorsque les militaires ont pris le pouvoir et que le sentiment anti-syrien s’est répandu au sein de forces de sécurité (hcr 2013a). Cet épisode a également vu le gouvernement militaire durcir sa politique d’accueil des réfugiés syriens, désormais soumis à une obligation de visa et à l’exigence du certificat de sécurité. En juillet 2013, le hcr rapportait qu’environ 475 réfugiés syriens s’étaient vu refuser l’entrée en Égypte ou avaient été déportés vers la Syrie après leur arrivée. Ces pratiques prouvent non pas l’absence de cadres juridiques, mais bien la violation du droit existant. Tant la Convention de l’ua que la Convention de Genève n’apportent à cet égard des réponses satisfaisantes.
L’Égypte, la Jordanie, le Liban, l’Irak et la Syrie sont également les membres fondateurs de la Ligue des États arabes. En raison de la croissance des flux de réfugiés dans cette région, l’organisation a entrepris au début des années 1990, dans le contexte de la première guerre du Golfe, des discussions qui ont abouti à l’adoption de deux instruments juridiques : la Déclaration sur la protection des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde arabe en novembre 1992 et la Convention arabe réglementant le statut des réfugiés dans les pays arabes de 1994 (Sadek 2013). La Convention est la plus avant-gardiste qui existe, puisqu’en plus de définir le terme réfugié au sens de la Convention de l’oua et de la Déclaration de Carthagène en Amérique latine, elle admet la possibilité que la protection internationale soit accordée par les États arabes aux personnes fuyant les catastrophes naturelles (Ligue des États arabes 1994 : article 1(2) ; Elmadmad 2002 : 129). Rejetant l’octroi du statut de réfugié pour des raisons politiques (Elmadmad 2002 : 129), la Convention arabe ressemble pour le reste à la Convention de Genève de 1951 par le régime de traitement des réfugiés qu’elle prévoit.
Les pays arabes doivent reconnaître aux réfugiés admis chez eux un traitement au moins équivalent à celui qu’ils accordent aux étrangers résidant sur leur territoire (article 5). La Convention ne déroge pas au principe de la non-discrimination et à l’interdiction du refoulement. Elle se rapproche de la Convention de l’oua par la consécration d’un droit à la protection temporaire (article 8(2)) et organise l’obligation de partage des charges entre États parties (article 14). Elle est par contre la convention relative aux réfugiés qui impose à ces derniers le plus d’obligations (articles 11 à 13).
En dépit de son caractère progressiste, la Convention demeure lettre morte. Elle n’a pu rassembler le nombre de ratifications requis pour entrer en vigueur. Les raisons de ce manque d’engouement sont sans doute à trouver dans les conséquences de la deuxième guerre du Golfe, en 2003, qui a banalisé le phénomène des réfugiés dans une région où la problématique plus ancienne des réfugiés palestiniens est cause de tensions politiques (Stevens 2013 : 7).
Cela étant, il convient de ne pas déduire de cette réticence à se lier internationalement un désengagement total des pays arabes sur la question des réfugiés. Le droit national et la coutume internationale offrent des alternatives, quoique leur portée soit congrue.
D – Le droit national et la coutume internationale constamment ignorés
Le droit national constituerait un recours utile à la protection des réfugiés syriens dans les pays du Golfe s’il était le résultat de la mise en oeuvre du droit international des réfugiés. Bien que la Jordanie, le Liban, l’Irak n’aient pas ratifié les instruments pertinents, leur tradition d’hospitalité se traduit dans les faits par des dispositions du droit national destinées à accueillir les réfugiés. La portée juridique de ces normes ne vaut que ce que ces pays veulent bien leur conférer. Dans la majorité des cas, les normes nationales apparaissent très rudimentaires.
Par exemple, le droit national des réfugiés en Jordanie est un patchwork de règles que l’on retrouve dans la Constitution, dans la loi sur le séjour des étrangers ou encore dans la loi sur la nationalité (Sadek 2013). Ce régime composite fait la part belle à la seule catégorie de « réfugié politique » qui doit se déclarer à la police 48 heures après son entrée sur le territoire. Bien que l’arrivée illégale ne soit pas sanctionnée, il n’est rien dit des conditions d’accès au statut de réfugié, et les conditions de séjour dépendent de l’acquisition d’un permis de résidence dont la délivrance n’est pas automatique. Pour cette raison, près de 160 000 réfugiés syriens travaillaient illégalement en Jordanie en juin 2013 (Syria Needs Analysis Project 2013 : 2). Dans ces conditions, il est difficile d’envisager des solutions durables, la possibilité de naturalisation n’étant reconnue qu’aux seuls réfugiés palestiniens.
Dans une situation identique, c’est-à-dire d’absence de législation nationale complète sur les réfugiés, le Liban a fait preuve d’ouverture depuis la survenance de la crise syrienne. Il a maintenu ses frontières ouvertes pour accueillir les victimes du conflit et a assoupli sa législation nationale pour favoriser l’accès des réfugiés syriens à certains services essentiels, comme la santé et l’éducation. En février 2013, une résolution ministérielle a, pour la première fois, ouvert aux réfugiés certaines professions, notamment dans le domaine de la construction, de l’électricité et de la vente, alors qu’elles étaient jadis réservées aux seuls citoyens libanais.
Des transformations similaires sont en cours en Irak depuis au moins 2010 lorsque fut créé le ministère de la Migration et du Déplacement, chargé de porter assistance et de fournir des services aux déplacés internes et aux réfugiés étrangers en Irak (Sadek 2013 : 3). À la suite du déclenchement de la crise syrienne en 2011, les autorités du Kurdistan irakien ont décidé d’accorder l’accès aux écoles et au travail aux réfugiés syriens (Zebari 2012). Ces changements conduiront avec un peu de chance à l’adoption du projet de loi sur les réfugiés, actuellement en discussion au Parlement et au Conseil de la Shura. Cette loi remplacera la Loi sur le réfugié politique de 1971 qui, bien que reconnaissant aux réfugiés politiques les mêmes droits en matière de travail, de santé et d’éducation que ceux dont bénéficiaient les Irakiens, se caractérise par sa conception extrêmement réductrice de la notion de réfugié.
Il découle de ce qui précède que les lois nationales des pays du Golfe vers lesquels fuient les réfugiés syriens sont en accord avec certains éléments essentiels du droit international des réfugiés. Il s’agit de ce qu’on pourrait qualifier de normes coutumières. On reconnaît dans la générosité de l’accueil le respect du principe de la Déclaration universelle des droits de l’homme dont l’article 14(1) prévoit que « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ». La Déclaration n’a certes pas force contraignante, mais le caractère coutumier de l’article 14(1) ne fait guère de doute, considérant le nombre de législations nationales, y compris donc ceux des pays du Golfe, qui reconnaissent le droit pour une personne de chercher asile. On peut lire dans la protection temporaire consacrée par les conclusions du Comité exécutif du hcr et les instruments régionaux, une réaffirmation de cette disposition de l’article 14(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
À ce droit il faut ajouter l’interdiction de refouler qui, en dehors de tout lien conventionnel, oblige l’ensemble des États de la communauté internationale. D’ailleurs, en Égypte ou en Jordanie, la loi ou la Constitution interdisent expressément l’extradition du réfugié politique. Pour autant, bien que l’accueil et le non-renvoi constituent sans aucun doute l’épine dorsale du système de protection internationale, celui-ci ne s’y résume pas. La question de la reconnaissance et de la protection, une fois le stade de l’admission dépassé, constitue une problématique à laquelle les législations des pays considérés ne répondent pas suffisamment. L’oeuvre humanitaire du hcr n’est guère suffisante et la nécessité des solutions durables n’est plus à démontrer. Le hcr n’a eu de cesse d’appeler ces pays à signer et à ratifier la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié. Les voisins de la Syrie et la Syrie elle-même demeurent sourds à cet appel. L’instabilité régionale n’est pas étrangère à leur choix de se tenir à l’écart du régime international des réfugiés.
II – La crise des réfugiés syriens : une crise de l’insécurité persistante au Moyen-Orient
En cherchant refuge dans les pays voisins, les déplacés espèrent en général retourner dans leur pays d’origine une fois le conflit terminé (Phillips et Starup 2014 : 27). La décision de chercher un refuge lointain n’est jamais qu’une démarche visant à remplacer le premier pays d’accueil par un second. Étant donné ce qu’implique la migration comme déracinement culturel, social et économique, ce n’est pas par choix, mais bien par nécessité que les personnes fuient. Telle est la perspective dans laquelle il faut comprendre la migration secondaire des réfugiés syriens au Moyen-Orient. Même si les pays voisins de la Syrie avaient tous été parties au droit international des réfugiés, les personnes arrivant de Syrie ne seraient pas pour autant assurées d’une protection adéquate dans un environnement sécuritaire aussi volatile que celui qu’elles retrouvent dans les pays voisins.
À ceux qui, dans les pays occidentaux, se demandent pourquoi les Syriens ne restent pas dans les pays d’où le retour chez eux serait plus facile, il convient de rappeler que les réfugiés trouvent dans ces pays les mêmes causes qui les ont poussés à partir (A) ; causes pour lesquelles les gouvernements occidentaux ne sont pas exempts de tout reproche (B).
A – Des réfugiés qui retrouvent dans les pays voisins les causes de leur départ de la Syrie
Jordanie, Liban, Irak, Libye, Égypte, Turquie, chacun de ces pays a été secoué, dans un passé lointain ou récent, par une crise politique importante. Déjà connus pour leur fermeture aux réfugiés, ces pays ont systématiquement resserré les règles en matière d’immigration et d’accueil des réfugiés pour répondre à la moindre menace à leur sécurité nationale.
On sait que l’Irak traverse une instabilité qui remonte à au moins 2003 lorsqu’il était envahi par les Américains. Depuis lors, la situation peine à se résorber. Au contraire, le groupe armé État islamique a mis le feu aux poudres en occupant une bonne partie des territoires irakien et syrien. En avril 2013, par exemple, le hcr observait des pics de violence semblables à ce que le pays avait connu entre 2006 et 2007 au moment des violences sectaires (hcr 2013b : 2). En 2012, les réfugiés irakiens qui avaient eux-mêmes trouvé refuge en Syrie étaient revenus en Irak à la suite de l’éclatement du conflit syrien (hcr 2013b : 2).
Avec les déplacés internes irakiens, les réfugiés syriens forment une population de plus d’un million de personnes dont le besoin de protection est réel. Ces réfugiés se trouvent ainsi confrontés aux mêmes défis sécuritaires que les nationaux, avec le désavantage que leur accueil peut à tout moment être restreint ou leur renvoi exécuté. En 2013, les autorités de la région du Kurdistan, invoquant des raisons politiques et sécuritaires, ont fermé la frontière, ne la rouvrant qu’en 2014 avec, à la clé, une restriction des conditions d’accueil (hcr 2013b : 3). En plus de ces règles d’accueil, qui changent sans cesse, le hcr a souligné que la restriction de liberté de mouvement et la détention systématique constituaient des défis auxquels les réfugiés syriens devaient faire face (hcr 2013b).
L’accueil ou l’obtention d’un permis de travail ne sont donc pas une garantie de protection suffisante, puisque cette protection est subordonnée aux conditions sécuritaires prégnantes dans le pays d’accueil.
Avec la révolution de 2011, la situation socioéconomique des réfugiés en Égypte s’est détériorée, s’accompagnant d’une recrudescence du taux de criminalité et du trafic des personnes aux frontières (hcr 2014a : 1). Ce sont autant les personnes à protéger que les ong qui ont subi les contrecoups de la révolution, notamment par la limitation de l’accès à l’emploi, à l’école, à la santé, à l’assistance publique et par l’imposition de conditions de travail difficiles aux organisations de la société civile. Alors que les réfugiés syriens entraient jadis dans le pays sans visa, l’Égypte a changé sa politique en 2013 dans le cours des manifestations qui ont abouti au renversement du président Morsi. Au mois de juillet 2013, le gouvernement annonçait des mesures provisoires imposant aux réfugiés syriens d’obtenir, avant leur entrée, un visa et une autorisation de sécurité (hcr 2014a : 2). Ce changement faisait suite à des allégations selon lesquelles quelques réfugiés syriens auraient pris part aux manifestations politiques et à des actes de violence. Fondées ou non, de telles allégations ont eu pour effet de modifier la perception des réfugiés syriens dans les médias et dans l’opinion. De fait, ces réfugiés sont devenus plus vulnérables à des attaques verbales, aux menaces physiques et à des arrestations, détentions et renvois. Le hcr observait ainsi qu’après 2013 on a constaté une chute dans le nombre des arrivants syriens, conséquence du durcissement de la politique de sécurité et de délivrance des visas (hcr 2014a).
Plus que la raison économique, les facteurs sécuritaires, identitaires et même géopolitiques expliquent la réticence des pays du Moyen-Orient à accéder aux instruments juridiques relatifs à la protection des réfugiés. La Jordanie a souvent explicitement fait valoir cet argument qui reflète sa volonté de préserver son identité nationale (Al-Kilani 2014 : 30). Sa population est composée à 40 % d’étrangers, parmi lesquels on comptait 1,3 million de Syriens en 2014. La Jordanie ne reçoit ces déplacés qu’à condition qu’ils ne menacent pas sa sécurité nationale et selon des critères sévères et discutables. Elle les accueille par ordre de priorité : d’abord les blessés et les malades, puis les enfants, les personnes âgées et enfin les adultes en général (Al-Kilani 2014 : 30). Ce faisant, il convient de souligner que des études montrent que les personnes en âge de travailler étaient, avec les jeunes hommes, les plus à risque dans le conflit syrien (Skinner 2014 : 39). La possibilité d’intégration est inexistante, car les autorités craignent une dilution de l’identité nationale jordanienne.
Dans le cas d’Israël, par calcul géopolitique et stratégique, ce pays a adopté à l’égard des Syriens une politique consistant à n’admettre aucun réfugié. Israël entretient avec la plupart de ses voisins des relations acrimonieuses. S’il n’accepte pas les réfugiés syriens, Israël leur apporte tout de même une assistance humanitaire dans les camps en Jordanie, seul pays avec lequel il entretient des relations à peu près paisibles (Plotner 2014 : 32). Le conflit avec la Syrie autour du plateau du Golan place Israël devant un véritable dilemme. Le plateau du Golan a été annexé en 1981 par Israël, mais il continue d’être reconnu par la communauté internationale comme faisant partie de la Syrie. De fait, si Israël affirme sa souveraineté, il devrait traiter les Syriens qui y pénètrent comme des déplacés internes relevant de sa juridiction. À l’inverse, s’il accepte que le plateau du Golan demeure syrien, les personnes qui y arrivent de Syrie seraient des réfugiés qu’il ne doit pas refouler (Plotner 2014 : 34). Dans la région des plateaux qu’il contrôle, Israël a ainsi décidé de ne pas admettre de réfugiés syriens, invoquant des motifs de sécurité nationale pour renforcer la ligne de cessez-le-feu entre la partie occupée du Golan et la Syrie (Plotner 2014 : 33).
Devant ces problématiques de sécurité ou d’identité nationale, il convient de souligner que les réfugiés syriens sont certes, aujourd’hui, les plus nombreux dans les pays voisins de la Syrie, mais ils ne sont pas les seuls à avoir besoin de protection. Les Irakiens, les Afghans et les Iraniens font également partie de la population de réfugiés accueillis en Turquie (hcr 2014b : 2). Le Liban et la Jordanie sont aussi des terres d’accueil des réfugiés palestiniens. À la différence de la Turquie dont l’accord avec l’Union européenne aurait permis d’améliorer le sort des réfugiés syriens (Jebreal 2017), la Jordanie et le Liban ne sont pas disposés à envisager pour ces derniers des solutions favorables. Le ressentiment à l’égard de ces réfugiés est perceptible, même dans les milieux politiques où la promesse de les renvoyer est devenue un enjeu électoral pour le scrutin de 2018 au Liban (Jebreal 2017). Comme l’écrit Jebreal, c’est la charité et non la dignité que reçoivent les réfugiés syriens dans ces pays. Les camps dans lesquels ils se regroupent ne sont d’ailleurs pas reconnus et le hcr n’est pas autorisé à les administrer, de crainte que la situation perdure et que des possibilités d’intégration sur place se réalisent.
En somme, la fuite des Syriens vers les pays voisins marque souvent le commencement et non la fin de leur calvaire. L’instabilité dans ces pays, souvent de longue date, pose de fait autant des défis sécuritaires que des défis socioéconomiques à l’accueil des réfugiés syriens. Il s’ensuit que les pays voisins ne sont que des pays de transit vers l’Europe à travers la Turquie.
B – Quelle responsabilité de l’Occident dans la fuite des réfugiés syriens ?
Il s’agit d’une question pour laquelle l’opinion publique en Occident a besoin d’explications. Or, mis à part le discours sécuritaire sur les réfugiés syriens, il existe un cruel manque de pédagogie autour des causes qui ont poussé 5 millions de personnes en dehors de leur pays.
La notion de responsabilité n’est pas utilisée ici au sens purement juridique. Nous ne traiterons d’ailleurs pas de cette dimension qui, si elle est importante, ne suffit pas à expliquer la crise migratoire sans précédent que vit la communauté internationale. Ce qui est en cause est le rôle qu’ont pu jouer les gouvernements occidentaux dans cette situation, et il faut voir si ce rôle détermine une quelconque responsabilité de leur part dans l’accueil des réfugiés.
D’un point de vue juridique, le régime international de protection des réfugiés n’est pas construit de telle sorte que la responsabilité de l’accueil repose sur celui qui est à l’origine de la fuite. Le juriste suisse Emer de Vattel fondait l’obligation d’accueil de l’État de destination sur ce qu’il appelait le droit de nécessité. Autrement dit, lorsque les raisons d’entrer de l’étranger sont plus fortes que les raisons pour invoquer la souveraineté de l’État, l’admission sur le territoire doit primer le refus d’entrer. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le principe de non-refoulement qu’elle codifie sont fondés sur ce précepte. Au coeur de l’analyse de savoir s’il faut accepter ou refuser la personne qui se présente comme demandeur d’asile se trouve la problématique de sa vulnérabilité ; et non celle de la responsabilité de l’État d’origine ou d’arrivée. L’accueil des réfugiés est donc un véritable acte de solidarité internationale.
Toutefois, sous cet angle, l’approche du problème ne peut être que partielle et les réponses insatisfaisantes. Il y a ainsi, de plus en plus, un appel à reconnaître les responsabilités des États dans la fuite des migrants en vue de parvenir à un partage équitable des charges qu’induit l’arrivée massive de demandeurs d’asile. Si la responsabilité des pays d’origine a souvent été mise en cause, celle des pays d’arrivée pourrait bien aussi être posée dans certaines situations. Le cas du conflit syrien en est un exemple.
À la différence du statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951, qui nécessite que soit établi un motif de persécution résultant de la violation des droits de la personne par l’État ou des acteurs privés sous son contrôle ou avec son acceptation tacite, la protection internationale en cas d’arrivée massive repose sur des circonstances objectives tels des conflits armés (Lambert 2013). L’attribution de responsabilité devient dans ces cas un défi. En Syrie, où interviennent les puissances occidentales dont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie, les fondements juridiques de leur présence, souvent la légitime défense, parfois des représailles au recours à des armes prohibées ou encore en soutien aux parties impliquées dans le conflit, importent peu pour les déplacés et les réfugiés. La guerre, quelle qu’en soit la justification, pousse à la fuite. En changeant sa politique concernant le Moyen-Orient, le Gouvernement canadien faisait à juste titre valoir que « les populations terrorisées quotidiennement […] n’ont pas besoin de notre vengeance, elles ont besoin de notre aide » (Rodineau 2016). Il serait dès lors périlleux de tenter, dans un contexte aussi complexe que la Syrie, de se livrer à un exercice d’attribution de faute dans la décision d’exil des réfugiés syriens.
Pour autant, sur le plan politique, il est difficile de ne pas voir dans l’impuissance des pays occidentaux une faillite qui les tiendrait, quelque part, pour responsables. Comme l’écrit Bertrand Badie, « incapables d’agir, [les puissances occidentales] sont en partie les responsables plus ou moins conscientes du drame » (Badie 2016). De fait, au-delà d’avoir un rôle effectif dans la situation, en termes d’intervention ou de soutien militaires, la responsabilité des États peut résulter aussi de leur défaut d’agir lorsqu’ils en avaient la capacité. Le propos de Badie insiste également sur l’opportunité et le choix des solutions, car si les pays occidentaux interviennent aujourd’hui à la fois par des moyens diplomatiques et militaires, il faut convenir, même s’il n’est jamais trop tard, que cette intervention n’est désormais plus menée en temps utile.
En somme, les causes qui justifient la migration secondaire des réfugiés syriens du Moyen-Orient sont aussi complexes que le rôle que jouent divers acteurs, y compris les puissances occidentales, dans le conflit syrien. Le sentiment de vide de protection qui résulte de la participation insatisfaisante des pays voisins de la Syrie au régime international des réfugiés ne s’explique lui-même que par un contexte politique et sécuritaire explosif. Conscients de l’instabilité de la région, c’est généralement de manière délibérée que les voisins de la Syrie, comme elle-même d’ailleurs, ne signent ni ne ratifient les engagements internationaux relatifs aux réfugiés. Acteurs à part entière de la dynamique de conflit, soit directement, soit par procuration, les pays occidentaux ne sont finalement pas exempts de tout reproche dans l’arrivée massive des réfugiés syriens à leurs portes. Par conséquent, il faudrait, pour répondre à la situation, se placer sous le paradigme non plus de solidarité, mais de responsabilité.
III – La gouvernance de la crise des réfugiés syriens : une question de responsabilité
Il est fréquent, pour expliquer l’accueil des réfugiés syriens, d’entendre les États mettre en avant un devoir de solidarité internationale. Il ne s’agit pourtant pas de solidarité au sens civiliste où deux ou plusieurs personnes seraient comptables de la même obligation. La solidarité dont il est question renvoie au sentiment d’un devoir moral envers ceux avec qui l’on partage la même identité ou des intérêts communs. Se trouvent là également les limites d’une gouvernance de la crise des réfugiés fondée sur la solidarité. En tant que sentiment, la solidarité est, pensons-nous, trop aléatoire pour fonder une politique globale de la migration forcée qui soit efficace.
En effet, il peut arriver que le processus d’identification qu’implique le sentiment de solidarité ne s’établisse pas, parce que la personne qui devrait aider ne s’assimile pas à la personne aidée ou ne partage pas avec cette dernière une communauté d’intérêts. Les Syriens portent, malgré eux, le stigmate d’être associés avec les terroristes et les islamistes, des catégories de personnes dont l’Occident se dissocie. L’histoire de l’humanité est jalonnée d’exemples où les États développés ont été prompts à se dire solidaires de tel ou tel peuple, mais hésitants à l’être autant à l’égard de tel autre. Le régime international des réfugiés, dont la Convention de 1951 est l’épicentre est né de la solidarité internationale à l’égard des déplacés européens de la Seconde Guerre mondiale (Bettati 2013 : 94, 98). Mais depuis lors, malgré les transformations de l’ordre international, accentuées par les conflits armés non internationaux qui produisent des millions de réfugiés, ce régime a subi peu de changements. Or, ces conflits se produisent, sauf pour l’ex-Yougoslavie, à l’extérieur de l’Europe ou de l’Amérique du Nord. Par conséquent, les États ne conçoivent leurs obligations en vertu de ce régime que de manière restrictive. La majorité des réfugiés qui n’en relèvent pas n’ont souvent droit qu’à la charité. Ainsi, l’Allemagne, à la mesure de son sentiment de solidarité, a accepté près d’un million de réfugiés syriens, tandis que le Canada en a reçu à peine 40 000. Ces deux pays devancent les États-Unis et la France. Au mois de septembre 2016, les Américains se vantaient d’accueillir leur 10 000e réfugié syrien, même chiffre que pour la France qui avait pris l’engagement d’en réinstaller 30 000 (Breteau 2016).
Cette solidarité à géométrie variable ne peut clairement constituer une solution satisfaisante. Elle laisse en dehors de la protection internationale de nombreuses personnes vulnérables, et n’est d’aucune façon proportionnelle à la responsabilité des acteurs en cause. Si nous considérons les chiffres relatifs à l’accueil concernant l’Allemagne, le Canada, la France et les États-Unis, force est de constater que ce sont ceux qui n’interviennent pas militairement en Syrie qui portent le plus lourd tribut de l’accueil des réfugiés syriens. Nuançons, cependant, en rappelant qu’en plus d’accueillir des déplacés les États contribuent au budget du hcr, l’Organisation des Nations Unies qui porte assistance aux réfugiés sur le terrain (Wall 2017 : 203). À ce titre, les États-Unis sont le principal contributeur du budget opérationnel du hcr, tandis que le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et la France occupent respectivement les 5e, 7e, 10e et 15e rangs (Bettati 2013 : 107).
Il ne faut toutefois pas se méprendre sur les intentions qui se cachent derrière la propension des États, surtout et uniquement les plus développés, à contribuer avec régularité au budget opérationnel du hcr. Si l’assistance du hcr constitue certes une aide immédiate utile aux réfugiés, elle permet également de réduire ou d’atténuer la pression migratoire sur les pays de destination.
Pour faire face à la crise syrienne, le hcr estimait en 2017 qu’il aurait besoin de près de 5 milliards de dollars (hcr 2017c : 4), un montant record jamais égalé pour une seule crise. Au mois de décembre, 49 % de ce besoin de financement était satisfait, l’équivalent d’environ 2,3 milliards de dollars. À la même date, l’agence humanitaire estimait avoir apporté une assistance alimentaire à 2,5 millions de réfugiés, une aide financière en argent comptant à 1,8 million de déplacés, des soins de santé à 1,5 million, de l’eau potable à 1,1 million de personnes, un accès à l’éducation à 993 000 enfants (hcr 2017c : 4). Il est toutefois frappant qu’à la même date seulement 25 000 demandes de réinstallation aient été soumises aux États.
Si l’assistance humanitaire s’impose par la force des choses, puisqu’il faut répondre aux besoins de base urgents des millions de personnes déracinées, on peut douter qu’il s’agisse d’une stratégie suffisante. La sécurité et le non-refoulement sont au coeur du régime international des réfugiés. Or, ainsi que nous l’avons démontré, la situation particulière de la région du Moyen-Orient où sont déplacés les réfugiés syriens est telle qu’on ne peut se satisfaire de l’assistance humanitaire. L’efficacité de la protection des réfugiés repose sur la recherche de solutions durables. L’assistance humanitaire ne constitue dès lors ni plus ni moins que le traitement des symptômes d’un mal plus profond.
Au fondement du régime international des réfugiés se trouvait le souci de régler de manière définitive la situation de plusieurs peuples déplacés en Europe. L’administration de camps et l’assistance humanitaire étaient des activités préparatoires à l’élaboration des solutions durables. Ainsi, en 1951, lorsque le hcr remplace l’Organisation internationale des réfugiés (oir), celle-ci a réussi à réinstaller près d’un million de réfugiés et à aider environ 70 000 autres à regagner leur pays (Bettati 2013 : 95). L’Organisation des Nations Unies fondait son action, à l’époque, sur la prémisse que « l’ensemble des États devait assurer une responsabilité collective à l’égard de ceux qui tentaient de se soustraire à la persécution » (Bettati 2013 : 94).
Cette idée de responsabilité, à l’analyse, ne semble pas se distancier de la notion de « devoir » et de solidarité. Lors du Sommet mondial de 2016 sur les migrations et les réfugiés, les États ont affirmé :
Pour répondre aux besoins des réfugiés et des États d’accueil, nous nous engageons à promouvoir un partage plus équitable de la charge et des responsabilités que représentent l’accueil des réfugiés du monde et l’aide dont ils ont besoin, compte étant tenu des contributions actuelles et de la diversité des capacités et des ressources entre les États.
Assemblée générale des Nations Unies 2016 : paragraphe 68
Chargé par le Sommet mondial de proposer un Pacte mondial sur les réfugiés, le hcr estime que le cadre d’action globale, qui constituera la première partie du Pacte, visera « à assurer des réponses plus durables pour les réfugiés, en établissant plus tôt, lors des crises, des liens entre l’action humanitaire et l’aide au développement, et en renforçant les approches durables d’investissement dans la résilience des réfugiés et des communautés d’accueil » (hcr 2017d : 3 paragraphe 10).
En d’autres mots, cette stratégie conçoit le déracinement comme une fatalité. Elle n’entend pas s’attaquer aux causes du départ, ce qui contredit d’emblée toute idée de « cadre global ». La solution envisagée fera le lien uniquement entre l’action humanitaire et l’aide au développement, et non entre les causes de départ et les solutions durables. À propos de ces solutions, l’accent mis sur la résilience, sur le pays d’accueil et sur l’aide au développement s’inscrit dans une stratégie basée sur l’hypothèse que de nombreuses situations de déplacement devraient durer dans le temps et qu’il faut très vite préparer les pays d’accueil à en supporter les coûts. Dans le cas des pays voisins de la Syrie, on peut se demander quel effet produira une approche fondée sur l’aide au développement lorsque les raisons mêmes qui sont à l’origine du déracinement ne reçoivent pas la réponse qui s’impose.
Quant à la réinstallation, considérée comme l’une des solutions durables par excellence, sa mise en oeuvre n’est pas sans rencontrer des obstacles. Considérée comme « des modes d’entrées protégées ou des voies d’entrées légales » (Tissier-Raffin 2017 : 2, paragraphe 2), cette solution n’est en effet prisée par les États que parce qu’elle est compatible avec le respect de leur souveraineté. Comme le démontre le chapitre introductif à ce numéro thématique, cela témoigne de ce que le régime international des migrations est hautement tributaire de la raison souveraine. Ainsi que l’écrit d’ailleurs Tissier-Raffin, la réinstallation ou l’admission humanitaire tient à deux facteurs essentiels : « la localisation et la sélection de la personne à l’extérieur des frontières du pays d’accueil et le contournement des obstacles de contrôle migratoire par l’octroi et l’organisation d’un accès légal et sécurisé au territoire national du pays de refuge » (Tissier-Raffin 2017 : 2).
L’ancien rapporteur spécial pour les Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, François Crépeau, reconnaissait que la réinstallation peut certainement contribuer au « développement d’un Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » (Tissier-Raffin 2017 : 2, paragraphe 3). Toutefois, sa mise en oeuvre par les États, à travers des processus bureaucratiques complexes, longs et coûteux, pour des quotas d’admission en fin de compte faméliques, en fait plus un instrument de sanctuarisation du territoire de l’État que de protection de la dignité humaine. En faisant de la réinstallation un moyen de sélection et d’admission, on en vient à détourner cette solution de son objectif premier qui est, historiquement, d’alléger le fardeau des premiers pays d’accueil ou la souffrance des plus vulnérables qui, pour diverses raisons pratiques et humanitaires, ne réussissaient pas leur intégration dans le premier pays d’exil. La réinstallation, telle qu’elle est aujourd’hui conçue et opérationnalisée, par ses critères variés et discrétionnaires, ses procédures multiples, ses bases juridiques diverses (Tissier-Raffin 2017 : 10-13), conduit inéluctablement vers un régime des migrations qui, en raison de l’urgence des solutions ainsi que des caractéristiques propres à chaque situation, s’accommode mal de rigidité et de complexité.
Rappelons, en conclusion, que la présente contribution s’est intéressée à la problématique de la protection des réfugiés syriens dans les pays voisins de la Syrie. Cet intérêt procédait d’une double considération. D’une part, la migration forcée constitue un déracinement dont la victime souhaite en général atténuer les effets. Par conséquent, une migration à proximité de son pays de résidence constitue une préparation au retour. Nous nous sommes demandé à quelle protection le réfugié de Syrie pouvait prétendre dans les pays voisins. La réponse à cette question révèle une crise du droit des réfugiés au Moyen-Orient. La participation de l’Égypte et de la Turquie à la Convention de Genève apparaît presque anecdotique, tant il existe des limites à l’effectivité de la protection qui en découle. La Jordanie, le Liban ou l’Irak, sur la base de législations nationales parcellaires ou obsolètes, offrent un secours temporaire que complètent les accords de coopération et de partenariat avec le hcr.
D’autre part, la migration secondaire des réfugiés syriens du Moyen-Orient vers des États occidentaux lointains nous a conduit à vouloir en comprendre les motifs. Non seulement le droit des réfugiés au Moyen-Orient est en crise, mais la région elle-même est perpétuellement instable. Établissant les facteurs prégnants de cette crise, nous avons analysé quel rôle peuvent y avoir joué les pays vers lesquels s’effectue la migration secondaire des Syriens. Il s’avère ainsi qu’à un titre ou à un autre, les puissances occidentales ne sont pas exemptes de tout reproche pour ce qui se passe au Moyen-Orient. De ce fait, c’est plus que de la simple charité qui est attendue d’elles pour résorber la situation actuelle.
Une gouvernance de la crise des réfugiés ne peut se contenter de gestes de solidarité internationale. Elle doit reposer sur une responsabilité qui signifie plus qu’un sentiment de devoir moral pour comprendre un véritable partage des charges, qu’il s’agisse d’espace d’accueil ou de contribution financière, le tout tenant compte du degré de participation aux circonstances qui ont conduit à la production des réfugiés.
Un cadre d’action globale à la crise des réfugiés ne peut se limiter à juguler les symptômes en apportant l’aide humanitaire aux réfugiés par l’intermédiaire du hcr. Une réponse globale ne saurait non plus se limiter à l’aide au développement des pays d’accueil. L’ampleur de la crise syrienne est telle qu’il sera difficile pour les pays voisins, même au prix d’aides substantielles, d’absorber plusieurs millions de personnes. Il y a lieu d’agir le plus tôt possible sur les causes de la fuite des populations, y compris en invoquant, s’il y a lieu, la responsabilité de protéger.
Parties annexes
Remerciements
L’auteur remercie Jonathan Paquin, le directeur de la revue Études internationales, et ses lecteurs anonymes.
Note biographique
Alain-Guy Sipowo est docteur en droit, avocat au Barreau du Québec et chargé de cours aux universités McGill et Laval.
Bibliographie
- Al-Kilani Saleh, 2014, « A Duty and a Burden on Jordan », Forced Migration Review, no 47, septembre: 30-31.
- Alborzi M. R., 2006, Evaluating the Effectiveness of International Refugee Law: The Protection of Iraqi Refugees, Leiden, Martinus Nijhoff.
- Assemblée générale des Nations Unies, 1951, Convention relative au statut de réfugié, 28 juillet.
- Assemblée générale des Nations Unies, 2016, Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, résolution A/Res/71/1, 16 septembre.
- Badie Bertrand, 2016, « Les impasses occidentales en Syrie », Libération, 14 décembre.
- Bettati Mario, 2013, « Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (hcr) », Pouvoirs, vol. 144, no 1 : 91-111.
- Breteau Pierre, 2016, « Réfugiés syriens : l’Allemagne et le Canada accueillent bien plus que la France », Le Monde, 2 septembre.
- Comité exécutif du programme du hcr, 1981, Conclusions générales no 21 (XXXII), 21 octobre. Page consultée sur Internet (www.refworld.org/docid/3ae68c474.html) le 13 décembre 2017.
- Comité exécutif du programme du hcr, 1980, Asile temporaireno 19 (XXXI), 16 octobre. Page consultée sur Internet (www.refworld.org/docid/3ae68c47c.html) le 13 décembre 2017.
- Elmadmad Khadija, 2002, Asile et réfugiés dans les pays afro-arabes, Casablanca, Eddif.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2010, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report – Universal Periodic Review:The Republic of Lebanon, avril. Page consultée sur Internet (www.refworld.org/pdfid/4bcd705e2.pdf) le 13 décembre 2017.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2013a, Briefing Notes, 26 juillet. Page consultée sur Internet (www.unhcr.org/51f242c59.html) le 13 décembre 2017.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2013b, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report – Universal Periodic Review:The State of Iraq, mars. Page consultée sur Internet (www.refworld.org/docid/5541e00a4.html) le 13 décembre 2017.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2014a, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report – Universal Periodic Review: Egypt, mars. Page consultée sur Internet (www.refworld.org/docid/5541d9c34.html) le 13 décembre 2017.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2014b, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report – Universal Periodic Review: The Republic of Turkey, juin. Page consultée sur Internet (www.refworld.org/docid/5541e6694.html) le 15 décembre 2017.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2015a, unhcr, Syrians Refugee Arrivals in Greece – Preliminary Questionnaire Findings, avril/septembre. Page consultée sur Internet (reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR-Greece_SyrianSurvey%20%281%29.pdf) le 2 avril 2018.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2015b, Syrian Refugees: Frequently Asked Questions, janvier. Page consultée sur Internet (https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/hilfe/syrien/faq-syrians-in-turkey-english.pdf) le 17 octobre 2018.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2016, Global Trends: Forced Displacement in 2016. Page consultée sur Internet (www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html) le 13 décembre 2017.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2017a, Figures at a Glance. Page consultée sur Internet (www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html) le 5 décembre 2017.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2017b, Regional Refugee and Resilience Plan 2018-2019 in Response to the Syria Crisis: Regional Strategic Overview. Page consultée sur Internet (www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2017/12/3RP-Regional-Strategic-Overview-2018-19.pdf) le 13 décembre 2017.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2017c, Regional Refugee and Resilience Plan 2017-2018 in response to the Syria Crisis: 2017 Progress Report. Page consultée sur Internet (www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2017/10/3RP-Progress-Report-17102017-final.pdf) le 13 décembre 2017.
- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2017d, Vers l’élaboration d’un Pacte mondial sur les réfugiés : feuille de route, 17 mai. Page consultée sur Internet (www.unhcr.org/fr/591ae7ab4) le 13 décembre 2017.
- Human Rights Watch, 2018, Turkey Stops Registering Syrian Asylum Seekers, juillet. Page consultée sur Internet (www.hrw.org/news/2018/07/16/turkey-stops-registering-syrian-asylum-seekers) le 17 octobre 2018.
- Janmyr Maja, 2017, « No Country of Asylum: ‘Legitimizing’ Lebanon’s Rejection of the 1951 Refugee Convention », International Journal of Refugee Law, vol. 29, no 3: 438-465.
- Jebreal Rula, 2017, « How to Treat Refugees with Dignity: A Lesson from Turkey », The New York Times, 27 septembre.
- Jones Martin, 2012, « We Are Not All Egyptian », Forced Migration Review, no 39, juin: 16-17.
- Lambert Helene, 2013, « The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for Victims of Armed Conflict and Indiscriminate Violence », International Journal of Refugee Law, vol. 25, no 2: 207-234.
- Ligue des États arabes, 1994, Arab Convention on Regulating Status of Refugees in the Arab Countries. Page consultée sur Internet (www.refworld.org/docid/4dd5123f2.html) le 15 décembre 2017.
- Organisation de l’Unité africaine, 1969, Convention de l’oua régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Page consultée sur Internet (www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=488f08be2) le 13 décembre 2017.
- Phillips Melissa et Katherine Starup, 2014, « Protection Challenges of Mobility », Forced Migration Review, no 47, septembre: 27-28.
- Plotner Crystal, 2014, « If Israel Accepted Syrian Refugees and idps in the Golan Heights », Forced Migration Review, no 47, septembre: 32-34.
- Rodineau Claire, 2016, « Le Canada met fin aux frappes contre l’ei en Syrie et en Irak », afp, 8 février.
- Sadek George, 2013, Legal Status of Refugees: Egypt, Jordan, Lebanon, and Iraq, The Law Library of Congress, décembre. Page consultée sur Internet (www.loc.gov/law/help/refugees/2014-010156%20RPT.pdf) le 13 décembre 2017.
- Skinner Marcus, 2014, « The Impact of Displacement on Disabled, Injured and Older Syrian Refugees », Forced Migration Review, no 47, septembre: 39-40.
- Stevens Dallal, 2013, « Legal Status, Labelling, and Protection: The Case of Iraqi ‘Refugees’ in Jordan », International Journal of Refugee Law, vol. 25, no 1, mars: 1-38.
- Syria Needs Analysis Project, 2013, Legal Status of Individuals Fleeying Syria, juin. Page consultée sur Internet (reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/legal_status_of_individuals_fleeing_syria.pdf) le 13 décembre 2017.
- Tissier-Raffin Marion, 2017, « Réinstallation – Admission humanitaire : solutions d’avenir pour protéger les réfugiés ou cheval de Troie du droit international des réfugiés ? », Revue des droits de l’homme, vol. 13, novembre : 1-33.
- Turquie, 2013, Law on Foreigners and International Protection, avril. Page consultée sur Internet (www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2017/04/LoFIP_ENG_DGMM_revised-2017.pdf) le 17 octobre 2018.
- Turquie, 2014, Règlement sur la protection temporaire, octobre. Page consultée sur Internet (www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf) le 17 octobre 2018.
- Wall Patrick, 2017, « A New Link in the Chain: Could a Framework Convention for Refugee Responsibility Sharing Fulfil the Promise of the 1967 Protocol? », Journal of International Refugee Law, vol. 29, no 2: 201-237.
- Zebari Abdel Hamid, 2012, « Iraqi Kurdistan Region Struggles to Cope with Syrian Refugees », Al-Monitor, 21 juin.
- Zetter Roger et Héloïse Ruaudel, 2014, « Development and Protection Challenges of the Syrian Refugee Crisis », Forced Migration Review, no 47, septembre: 6-10.