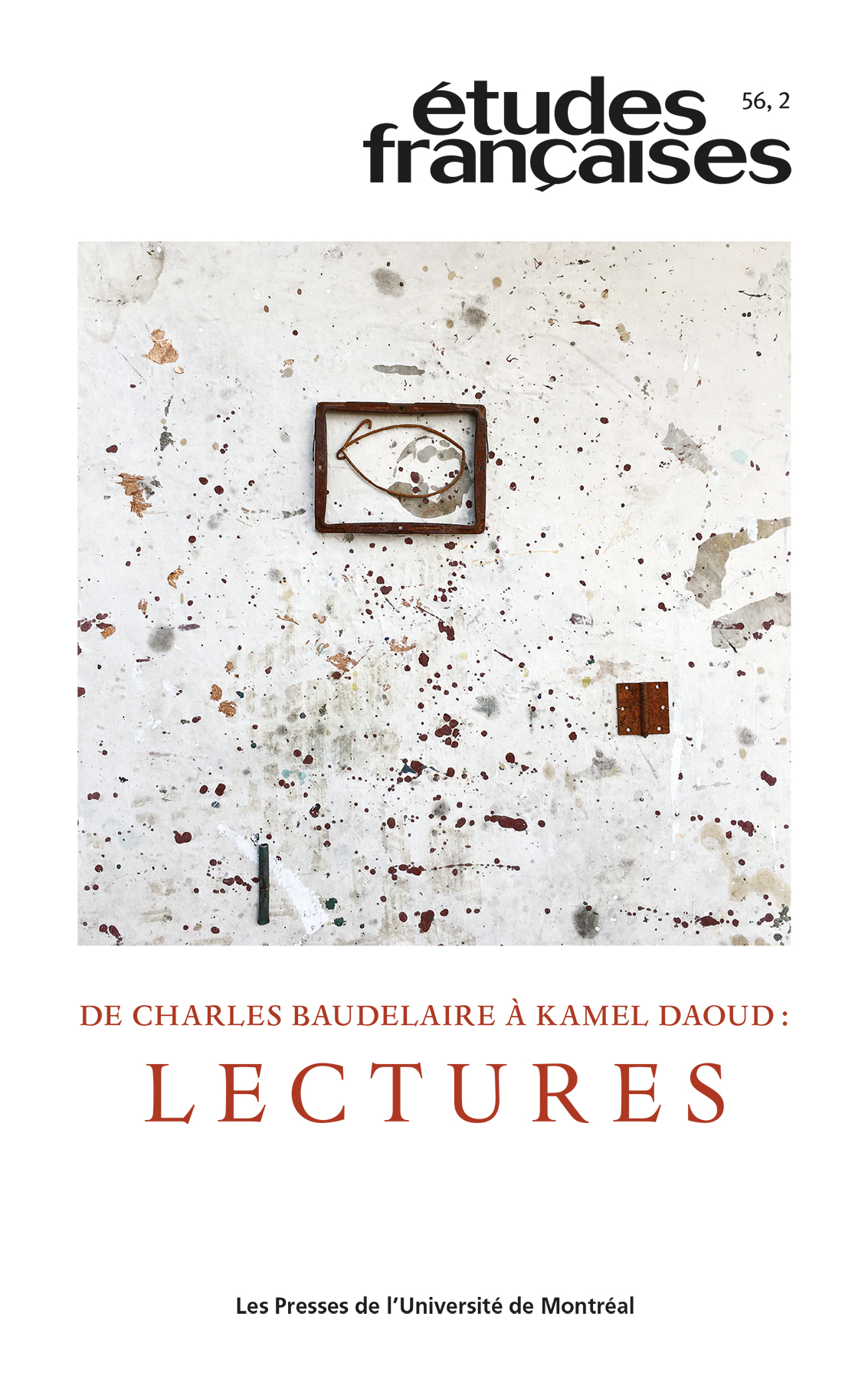Résumés
Résumé
Portés à l’introversion et souvent solitaires, les héros des romans de Henri Bosco semblent toujours hésiter entre un « ici » rassurant et protecteur et un « au-delà » fascinant, mais inquiétant, parce qu’inconnu. Entre ces deux univers antithétiques, surgissent des seuils, des frontières ou des limites qui représentent, pour les protagonistes, autant d’attirances et de tentations, et qui font survenir, dans leurs esprits, un besoin urgent de les franchir. Ces seuils jouent un rôle capital pour l’imagination poétique car ils sont les éléments déclencheurs qui permettent la progression – dans une optique initiatique – de la diégèse. Dans cet article, nous analysons différents types de seuils : les simples frontières topologiques qui ont le pouvoir de séparer et / ou d’unir deux espaces ; les seuils temporels ; les situations liminaires au niveau des états de conscience, comme tous les états intermédiaires entre le sommeil et la veille, très fréquents dans l’oeuvre de Bosco. Nous concluons sur le franchissement du seuil corporel qui aboutit à des expériences liminaires entre la conscience et le délire hallucinatoire.
Abstract
Timid and often solitary, the heroes of Henri Bosco’s novels always seem to hesitate between a reassuring and protective “here,” and a “beyond” fascinating but disturbing, being untapped. Between these two antithetic universes, thresholds, boundaries, or limits emerge. They represent, for the protagonists, many attractions and temptations and give rise, in their minds, to an urgent need to cross them. Thresholds play a key role in poetic imagination because they are the triggers that allow the progression – in an initiatory perspective – of the diegesis. In this article we will analyze the different types of thresholds: the simple topological boundaries having the power to separate and/or unite two spaces; the temporal thresholds: the liminal situations between states of consciousness, like all the intermediate states between sleep and wakefulness, very common in Bosco’s work. We conclude with the crossing of the bodily threshold which leads to liminal experiences between consciousness and hallucinatory delirium.
Corps de l’article
Ce qui frappe le plus quand on aborde l’oeuvre d’Henri Bosco, c’est cette présence de seuils, de frontières ou de limites qui représentent, pour les protagonistes de ses oeuvres, autant d’attirances et de tentations et qui font surgir, dans leur esprit, une véritable urgence de les dépasser, de les franchir. En effet, dominés par un manque ontologique, les héros bosquiens se situent sur le seuil, dans un entre-deux, hésitant entre l’ici rassurant et protecteur et l’ailleurs fascinant mais inquiétant car inexploité.
Évidemment, cette prédominance d’éléments liminaires a été déjà relevée par d’autres chercheurs : « Notre écrivain […] emplit son oeuvre de murs que l’on franchit […], de rivières que l’on traverse, de clôtures dans lesquelles on pénètre clandestinement[1] », expliquait déjà Benoît Neiss en 1977, alors qu’une dizaine d’années plus tard Jacques Cazeaux et Sandra Beckett dédiaient aux seuils de superbes études[2]. De tels constats, et d’autres, seront utiles pour soutenir et nourrir nos réflexions qui viseront non seulement à analyser les différents types de seuils présents dans l’oeuvre bosquienne, mais aussi et surtout à souligner leur rôle pour ce qui est de l’imagination poétique et de la progression – dans une optique initiatique – de la diégèse. Ce faisant, nous verrons que ce sont la tentation, le désir ou la crainte de se perdre dans un ailleurs inconnu qui animent « poïétiquement[3] » l’oeuvre d’Henri Bosco.
Topographie et chronographie du seuil : le charme de l’ailleurs
Le premier type de seuils que nous analyserons est représenté par les frontières topologiques, autant de commutateurs spatiaux ayant le pouvoir de séparer / unir deux espaces différents. Dans la production de notre écrivain, il arrive souvent, en effet, que l’espace se présente comme partagé entre l’ici de la vie domestique et l’ailleurs mystérieux et inconnu, et que ces deux lieux soient juxtaposés, opposés ou antinomiques. Entre ces deux univers, toujours chargés, dans l’oeuvre de Bosco, de valeurs symboliques très différentes, il n’y a qu’un portail, un sentier ou un pont qui incarnent très bien ce que Gaston Bachelard appela « la dialectique du dehors et du dedans »[4]. Circonscrit et replié sur lui-même, l’ici est le lieu de la clôture, de la fixité et du repos, comme le village natal de Constantin, « ce petit village de Peïrouré encadré de platanes et de peupliers d’Italie[5] », une sorte de microcosme statique, protecteur et rassurant où le héros bosquien passe son existence tranquille et parfois solitaire et monotone. Et c’est autour de ces images que, dans les toutes premières lignes de L’enfant et la rivière, Pascalet évoque sa maison d’enfance :
Quand j’étais tout enfant, nous habitions à la campagne. La maison qui nous abritait n’était qu’une petite métairie isolée au milieu des champs. Là nous vivions en paix. […]
[…]
Autour de nous, on ne voyait que champs, longues haies de cyprès, petites cultures et deux ou trois métairies solitaires[6].
Il est vrai que le souvenir de son enfance vécue peut avoir eu de l’influence sur l’évocation de cet endroit en donnant aux lieux domestiques comme une sorte de corps feutré et protecteur[7] car, comme Bachelard nous l’enseigne, « [l]e monde réel s’efface d’un seul coup, quand on va vivre dans la maison du souvenir[8] », mais il est aussi vrai que l’auteur revient, encore et toujours, au thème de l’abri, de la paix et de l’isolement, sensations qui nous plongent d’emblée dans cette atmosphère de calme, de tranquillité et de protection qui accompagne toute rêverie d’intimité domestique.
Cet instinct de protection s’accroît encore plus lorsqu’un orage se déchaîne : dans un univers violent et dangereux, le refuge domestique voit s’intensifier ses valeurs d’intimité et de sûreté en se transformant en un véritable contre-univers qui, comme un ventre maternel, protège du monde extérieur. C’est notamment le cas de la Redousse de Malicroix qui a fasciné et inspiré les réflexions du philosophe de l’imagination poétique[9], et de laquelle Pascal de Mégremut, après un orage impétueux, dira : « La maison se serra sur moi, comme une louve, et par moments je sentais son odeur descendre maternellement jusque dans mon coeur. Ce fut, cette nuit-là, vraiment ma mère[10]. » Mais c’est le cas aussi de toutes les métairies bosquiennes qui, bien que tourmentées par le vent d’hiver ou accablées par la chaleur de l’été, « ont été bâties en refuges et, sous leurs murailles massives, on s’abrite tant bien que mal de la fureur des saisons[11] ».
L’analogie avec la mère n’est pas sans conséquence : dans cette perspective, même le retour au pays natal que Tante Martine accomplit dans Barboche avec l’aide de Pascalet n’est qu’un retour à la mère[12] – un regressus ad uterum, selon la terminologie de Mircea Eliade[13] qui a aussi étudié le mythe de l’éternel retour dont nous trouvons ici la trace[14] –, retour qui est envisagé par la protagoniste du récit comme une tentative de retrouver un état plus heureux que l’état présent. C’est un besoin qu’elle partage avec d’autres protagonistes bosquiens qui révèlent, eux aussi, un besoin de protection et d’isolement, un désir de retrouver dans un abri solitaire et retiré à la vue des autres une intimité perdue.
Dans l’imagination du repos, en effet, l’abri porte lui aussi la marque de la maternité et du retour à l’état intra-utérin, comme « Souffle-Sisampe » pour le père des protagonistes de certains récits de jeunesse[15], ou bien les combles pour Tante Martine[16], ou Noir-Asile, le refuge que l’orpheline Hyacinthe avait choisi pour elle et dont nous avons déjà parlé ailleurs[17], ou encore l’embarcation sur laquelle Pascalet et Gatzo demeurent pendant dix jours, cachés dans un bras mort de la rivière. Cette expérience des « eaux dormantes[18] » semble très proche de la vie prénatale : l’immobilité, la liquidité du paysage, le goût du silence qui unit les deux personnages et leur effacement « par d’inextricables fourrés de plantes aquatiques[19] ». Fidèle lui aussi à la « religion des caches[20] » comme ses alter ego en papier, Henri Bosco parsème ses oeuvres de maisons où s’abriter plus qu’habiter, de coins secrets, muets et immobiles, de lieux clos, rassurants et protecteurs, où l’âme s’apaise et les pensées s’ordonnent.
Dans un espace devenu le centre même de cet esprit de réconfort et d’intimité, il faut juste franchir des seuils ou abattre de faibles barrières pour découvrir un univers puissant, sauvage et dynamique ; un dehors sonore, menaçant et chaotique qui charme et égare en même temps. Et il sera opportun de rappeler que « [l]a maison et l’univers ne sont pas simplement deux espaces juxtaposés. Dans le règne de l’imagination, ils s’animent l’un par l’autre en des rêveries contraires[21]. »
Pour Pascalet, c’est la rivière qui est au bout de ses rêveries d’extraversion : cette « grande et puissante rivière[22] » qui hante ses pensées et domine ses rêves ; le jeune protagoniste a « une envie folle[23] », « un désir si vif » de s’échapper et de courir du côté de la rivière qu’il « en tremblai[t] de peur[24] ». « Il n’en fallait pas plus [dira-t-il, en fait] pour me faire rêver de la rivière, nuit et jour. Quand j’y pensais, la peur me soufflait dans le dos, mais j’avais un désir violent de la connaître[25]. » C’est à l’imagination de la volonté qu’appartiennent ces images : la nature révèle son pouvoir d’attraction et il est « impossible d’[en] être distrait, absent, indifférent[26] ». Il s’agit d’un désir qui engendre du dynamisme, une imagination qui porte ailleurs, qui incite à céder aux séductions d’un univers sublimé par la beauté printanière. C’est en effet un jour de printemps que la tentation devient plus violente, quand le réveil de la nature s’accompagne d’une majeure réceptivité des sens[27] et surtout d’un nouveau besoin d’air et de mouvement. Et, en un clin d’oeil, le portail est poussé[28]. La sauvagerie des territoires inconnus, leur pouvoir d’attraction sur le jeune protagoniste[29], l’enivrement qu’ils engendrent sur les plans perceptif et cognitif, la peur et l’exaltation qui accompagnent sa fuite, sont bien loin du calme et des certitudes de l’intimité domestique. Le paysage rassurant et silencieux est maintenant remplacé par un univers bruyant et énergique. Les lieux familiaux, avec leur air apprivoisé et maternel, ont laissé la place à un cosmos sauvage qui, du fait de son imprévisibilité, ressemble plutôt aux belles-mères trompeuses et sournoises qu’on retrouve dans les contes de fées de la tradition populaire.
Entre les deux mondes opposés et antithétiques, seuls un portail et une interdiction (« je te défends de courir du côté de la rivière[30] »), mais combien de rêveries pour le jeune Pascalet ! Des rêveries dialectiques, antinomiques, qui s’ordonnent en deux options distinctes : rester ou partir ? Se calfeutrer dans la sûreté intime des lieux connus ou livrer son âme aux expériences audacieuses de l’inconnu ? Obéir ou transgresser ? Ici, le microcosme côtoie le macrocosme, la claustrophilie se dispute avec l’agoraphilie ; c’est le lieu du possible où hic et alibi se confondent et où « la dialectique du dedans et du dehors » prend toute sa force.
Une lutte intérieure si violente n’est pas sans effets, mais elle « troubl[e l]es sens » et « obsèd[e l]es yeux[31] » du jeune protagoniste, tout comme le fait le pont de la Gayolle sur un jeune esprit tel que celui de Constantin Gloriot. Le pont de la Gayolle n’était qu’« un vieux pont de pierre à une arche, qui enjambait tant bien que mal un petit torrent de vingt pieds de large[32] » ; mais l’intérêt que le jeune protagoniste de L’âne Culotte lui portait était dû au fait qu’il était l’« une des voies d’accès à la montagne[33] », lieu pour lui encore inexploré et menant (on le découvrira ensuite) au domaine de Belles-Tuiles où le mystérieux Monsieur Cyprien avait construit son paradis à l’aide de maléfices – dont la victime la plus emblématique était la petite Hyacinthe, envoûtée et privée de son âme – et du tribut payé aux divinités telluriques. Or le pont revêt de multiples signifiés symboliques dont les plus communs sont liés au « symbolisme du passage, et [au] caractère fréquemment périlleux de ce passage, qui est celui de tout voyage initiatique[34] ». Commutateur spatial de premier niveau, cet objet transitionnel et liminaire est étroitement lié à la dialectique de l’ici et de l’ailleurs lorsque, permettant le passage d’une rive à l’autre, il unit / sépare deux univers. Au-delà du pont, tout un monde masculin s’ouvre aux yeux du jeune Constantin Gloriot ; une masculinité qui se substitue à la féminité toute maternelle caractérisant l’espace domestique et qui est déjà évidente dans la description du paysage au-delà de la Gayolle :
Maintenant tout ici devenait brusque, abrupt ; mais de ces mouvements du sol, de ces rocs éboulés, de ces chênes noueux aux racines torses, passait en moi comme une noire force souterraine. L’âpre accent qui s’en exhalait faisait battre mon sang à coups plus larges, au milieu de l’ombre, des écorces fraîches et des feuilles amères ; et j’étais enlevé, malgré la roideur des lacets et la sévérité des escalades, virilement, vers cette immense zone aromatique des collines, pays des fleurs sauvages, des arbres et des bêtes fuyantes qui déjà, à travers les branches des chênes, tremblait, en pleine lumière, devant moi[35].
À côté de la sauvagerie masculine de ce paysage, dont la montagne, avec ses connotations morphologiques et orographiques n’est que l’élément le plus viril, il faut rappeler aussi la présence de Culotte, l’âne sur le dos duquel Constantin accomplit son voyage vers Belles-Tuiles[36]. Sur le plan symbolique, cet animal revêt un rôle sensuel très puissant ; en effet, alors que « le rôle de l’ânesse est nettement bénéfique[37] », « l’âne comme Satan, comme la Bête, signifie le sexe, la libido, l’élément instinctif de l’homme[38] ». Marie-Louise von Franz souligne aussi la valeur symbolique de l’âne qui « figure parmi les animaux consacrés à Dionysos. Dans l’Antiquité, on le disait dominé par une sexualité très puissante[39]. » Le pont de la Gayolle, donc, représente le seuil essentiel entre ces deux mondes chargés d’une connotation sexuelle et d’une valeur symbolique très différentes et qui, une fois franchi, suscite dans l’esprit du jeune protagoniste le sentiment de la peur, de la faute, de la culpabilité.
Les sentiments vécus par Constantin sont les mêmes que ceux qu’éprouve Antonin, le protagoniste du récit éponyme, hésitant longtemps devant la porte de l’impasse où Marie et lui se donnaient rendez-vous chaque soir :
Nous arrivâmes cependant jusqu’à la porte de l’impasse. La route nous intimida. Pourtant elle était solitaire. […] Et avec mille précautions nous retournâmes au fond de l’impasse.
Il en fut de même, le lendemain. Ainsi nous ne bravions pas le destin ; nous l’attendions avec solennité. Tant de respect aurait dû l’attendrir ; nous lui proposions notre confiance. Et il ne la repoussait pas, bien au contraire, puisque la route restait accueillante, où nous devions passer fatalement pour suivre notre tentation. C’est pourquoi, rassurés par son aménité, nous l’affrontâmes le troisième jour.
Ce fut un pas qui nous parut facile. Mais dès que nous fûmes sortis de notre impasse, la peur nous saisit. Une peur purement morale. Nous étions en faute. Cette peur en était le signe obscur. On ne pouvait pas s’y tromper. Nous nous sentions coupables. De quoi ?[40]
Si cette dialectique de l’ici et de l’ailleurs, du dehors et du dedans, est l’essence même des récits réputés de jeunesse où le déplacement d’un lieu à l’autre, le franchissement des seuils et la solitude du héros qui s’ensuit représentent la véritable intrigue parce qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement du parcours initiatique[41] qui est à la base de tout récit de formation, il faut remarquer que, dans l’oeuvre d’Henri Bosco, il y en a partout : comment oublier le cas de Malicroix[42] ou des volumes indiqués d’habitude comme « l’oeuvre au noir » de Bosco : Un rameau de la nuit[43], L’antiquaire[44], Le récif [45] et Une ombre[46] ! Et, dans cette dualité, il arrive souvent que ce soit la pénombre, avec l’imprécision qui la caractérise, qui représente le véritable seuil. Combien d’épisodes, chez Bosco, ont lieu à la tombée de la nuit ! Seuil temporel entre le jour et la nuit, entre la lumière et l’obscurité, ce moment de la journée où l’ombre tombe sur le jour pour l’anéantir est le temps propice à la naissance du mystère et au début de toute aventure initiatique. Il est vrai, en effet, que « [c]haque sortie le soir entraîne le protagoniste de Bosco fatalement vers une aventure insolite et périlleuse où il risque de se perdre[47] ».
Entre conscient et inconscient : les seuils psychiques
Aux limites matérielles ou temporelles que nous avons analysées jusqu’ici s’en ajoutent autant d’autres qui se placent au niveau des états de conscience, comme tous ces états intermédiaires entre le sommeil et la veille, très fréquents dans l’oeuvre de Bosco et sur lesquels les protagonistes de ses oeuvres s’attardent souvent et longtemps, incapables de franchir tout de suite les obstacles qui les immobilisent. À ce propos, Robert Baudry a parlé du thème du sommeil comme « porte d’un autre monde[48] », un « sommeil-commutateur » qui marque toujours, dans les récits bosquiens, « le passage d’un état, d’un univers à l’autre[49] ». C’est le cas de Pascal Dérivat qui, incapable de sortir totalement de la veille mais aussi de s’abandonner au sommeil, dira : « Ce fut en quelque sorte mon sommeil, le repos de ce corps affaibli par les veilles, l’excessive lucidité et les tourments d’une âme trop vigilante[50]. » Ou bien de Pascalet : « Je ne dormais donc pas, puisque je me parlais, mais, ne pouvant y croire, j’essayais de me raconter que je faisais un rêve…[51] » Ou encore du protagoniste d’Une ombre qui dira : « Maintenant, les remous de ces rafales me parvenaient encore à travers le rideau de mon demi-sommeil. Puis peu à peu ce rideau s’épaissit, mes pensées s’espacèrent, et de la somnolence je glissai aux seuils du sommeil[52]. » Un « demi-sommeil » ou « demi-rêve » qui est aussi présent dans Un rameau de la nuit[53] où le protagoniste réfléchit sur la nature et l’origine des images qui apparaissent dans son esprit pendant la nuit :
J’allais me coucher vers dix heures – et, naïvement, j’attendis le songe, qui ne vint pas. […]
[…] J’eus, en effet, la perception d’un songe, et je me dis confusément que m’arrivait sans doute celui que j’avais attendu, vers dix heures du soir, alors que je m’assoupissais. […] Mais, contrairement à ce qui arrive quand en nous ils se forment, celui-ci ne me semblait pas s’élever en moi du sommeil. Bien que je fusse encore au milieu des nuées, je sentais l’hypnose se fondre et le songe prendre sur moi de la puissance à mesure que le sommeil s’affaiblissait. Je rêvais, mais c’était d’un souvenir…[54]
Et c’est encore dans cette « position entre le sommeil et la veille[55] » que, pendant le voyage de Costebelle à Peïrouré, Constantin vit une expérience hors du commun : « tomb[é] dans un trou » et incapable de bouger (« Je dus tomber dans un trou, et ne me relevai plus, anéanti[56] »), « à poings fermés[57] », demi paralysé (« J’étais devenu insensible[58] ») et presque mort de fatigue (« je mourais de fatigue[59] »), il assiste à un étrange spectacle pendant lequel toutes les bêtes de la forêt sont charmées par une mélodie jouée à la flûte. Après cette expérience, le protagoniste de L’âne Culotte est tellement troublé qu’il tombe dans ce type de « sommeil quasi cataleptique qui suit les trop fortes visions[60] » et, ramené à la maison par Anselme, il dort encore toute la nuit et le matin suivant.
Cette expérience où le sommeil côtoie l’évanouissement nous introduit fort bien dans cet autre état psychique liminaire entre le conscient et l’inconscient qui abonde dans l’oeuvre de Bosco : la convalescence. C’est, par exemple, le cas de Gatzo, délirant et fiévreux après le meurtre du renard (« Pendant plusieurs jours, Gatzo délira[61] ») ou du protagoniste de Hyacinthe, vacillant entre la vie et la mort et profanant, dans cet état particulier, le dernier seuil et le plus important, celui du corps même.
Dans ce roman étrange où l’intrigue – qui en est à peine une – est d’une simplicité désarmante, les seuils abondent et il est aisé de retrouver les différents types d’éléments liminaires que l’on vient d’analyser. D’abord, on remarque une bipartition topologique très nette entre la Commanderie et la Geneste, les deux maisons du plateau de Saint-Gabriel qui représentent les deux pôles sur lesquels toute la narration est bâtie. Le symbolisme du plateau, avec son horizontalité et son manque d’aspérité, nous conduit vers la compréhension du texte où un mystérieux narrateur homodiégétique – dont on ne connaît rien, pas même le nom – vient s’installer à la Commanderie pour accomplir, à travers une expérience profonde de la solitude et du silence, son voyage intérieur à la recherche de lui-même :
Ces terres plates qui, tout autour de mon habitation, s’étendaient à perte de vue, n’offraient aucun attrait à mes goûts naturels. Je suis un homme de collines. L’amour, qui encore aujourd’hui m’attache à elles, le plus souvent me rend les pays sans reliefs insupportables. Leur étendue m’attriste. Elle ne facilite que trop cette dispersion intérieure où je m’évanouis. Je n’y ai point de prises sur moi-même et j’y perds le sens merveilleux de ma propre présence. Je suis toujours ailleurs, un ailleurs flottant, fluide. Longuement absent de moi-même, et présent nulle part, j’accorde trop facilement l’inconsistance de mes rêveries aux espaces illimités qui les favorisent[62].
Entre les deux habitations, il n’y a qu’« un demi-kilomètre de guérets » et « [u]n fossé bordé d’aubépines » qui « marquait la limite de cette étendue caillouteuse où ne s’élevait çà et là qu’un boqueteau de chênes[63] ». Mais la solitude dans laquelle vit le protagoniste est troublée par la présence d’une lampe qui, tous les soirs, brûle derrière la fenêtre de la Geneste, trahissant ainsi la vie qui se déroule à l’intérieur :
La maison m’avait séduit par sa position solitaire, le chemin peu passant et, aussi loin que portât le regard, pas une habitation. Mais, derrière sa haie de peupliers touffus, je n’avais pas su découvrir cette métairie. Seuls un mur bas et le toit en pente s’élevaient de la terre.
C’est dans ce mur, percé d’une fenêtre étroite, que tout à coup, dès le soir de mon arrivée, s’alluma la lampe. J’en fus contrarié[64].
Par sa double fonction d’ouverture et de passage, et étroitement liée à la dialectique du dehors et du dedans, la fenêtre ne représente pas seulement une ouverture de l’espace domestique vers l’extérieur, mais elle autorise aussi l’extérieur à accéder à l’intérieur. Cet échange croisé se déroule bien sûr au niveau de la perception et permet, d’une part, de découvrir par bribes le monde extérieur, et en même temps, et surtout, permet, d’autre part, aux plus indiscrets de pénétrer à l’intérieur de la vie domestique pour en arracher les secrets les plus intimes. La fenêtre qui, selon la définition de Philippe Hamon « paraphrasant les “zoèmes” de Claude Lévi-Strauss », est un « technème », un « obje[t] techniqu[e] sollicitant un statut textuel particulier[65] », est ici l’élément le plus fragile : elle met en péril la clôture domestique, transformant l’espace clos de la maison en espace entrouvert sur le monde. Pour le dire à la manière de Starobinski, « [l]a fenêtre est le cadre, à la fois proche et distant, où le désir attend l’épiphanie de son objet[66] » ; c’est une barrière, un espace de fracture qui sépare, comme nous le dit Bachelard, « la région du même et la région de l’autre[67] », le familier et l’étranger, l’en deçà et l’au-delà. C’est un élément liminaire qui joue un rôle capital, d’autant plus qu’il est éclairé par une lampe. En effet, comme nous le dit encore Bachelard, « [l]a lampe à la fenêtre est l’oeil de la maison[68] », « un oeil ouvert sur la nuit[69] » et, « [p]ar la lumière de la maison lointaine, la maison voit, veille, surveille, attend[70] ». C’est dans ces termes que le narrateur de Hyacinthe nous décrit cette sensation : « Cette lampe qu’elle [la maison] allumait et qui, par sa fenêtre étroite regardait vers l’Ouest, m’inquiétait quelquefois comme un signal. Sa fidélité aux ténèbres indiquait la présence, là-bas, d’une mystérieuse vigilance[71]. »
Dans ce roman, qui peut être considéré comme le plus psychique des romans bosquiens, c’est en effet cette petite lampe qui brille à la fenêtre de la Geneste qui engendre, chez le protagoniste anonyme habitant la maison d’en face, toute une série de rêveries aboutissant à des expériences liminaires entre la conscience et le délire hallucinatoire, à travers lesquelles ce dernier arrive à superposer son existence à celle de son voisin, et à découvrir une mystérieuse autant qu’inquiétante vérité. En effet, l’étranger de la Geneste n’est autre que Constantin Gloriot (protagoniste de L’Âne Culotte avec lequel Hyacinthe forme un cycle), attendant Hyacinthe. Cette jeune fille apparaît le 25 décembre, mais au lieu de retrouver Constantin à la Geneste, elle cherche refuge à la Commanderie, dont le propriétaire s’est à tel point identifié à Constantin que la jeune fille elle-même se sent liée à lui par une étrange sympathie avant de s’apercevoir qu’elle s’est trompée. Un jour, tombé dans un piège, le narrateur est amené et mis en convalescence à la Geneste où « l’avatar du moi » qu’a étudié Ferdinand Stoll dans un remarquable article sur le « cycle d’Hyacinthe[72] » semble s’accomplir : pendant cette longue convalescence à laquelle est consacré un chapitre entier[73], caractérisée par la nausée et les vertiges, par la fièvre et le délire, et qui amène le protagoniste à la limite entre la vie et la mort (« J’ai failli mourir[74] »), l’âme franchit le seuil le plus important, celui de son corps (« On m’a déposé quelque part. Mon corps d’un côté, mon âme d’un autre[75] »), l’exposant ainsi au risque d’être possédé par un autre. Et c’est ce qui lui arrive bientôt :
Cependant c’est [l]e rêve qui m’a fourni alors une personnalité provisoire.
Si depuis mon éveil je revivais, personne ne se dégageait encore de mon être. Je ne sentais partout qu’une faible chaleur anonyme.
Je suis devenu moi non pas au contact du réel, mais grâce à ce don intérieur que me tendit le songe. Je ne retrouvai pas le moi (si instable du reste) qui m’avait abandonné pendant ma maladie ; mais je reçus un hôte étrange, un voyageur de passage. Je ne me rendis pas compte de cette intrusion. Je crus me reconnaître. Aujourd’hui même, alors que cet hôte est parti, je ne suis pas certain encore de m’être trompé[76].
Avec le franchissement du seuil corporel – envisagé déjà dans le destin de la petite Hyacinthe, victime du sortilège qui lui avait arraché son âme –, Bosco ne fait que pousser encore plus loin la quête spirituelle qui caractérise déjà tout son univers littéraire[77]. Comparable à une descente aux enfers, cette expérience extracorporelle porte la marque, elle aussi, d’un parcours initiatique dont le franchissement des limites (qu’elles soient matérielles ou psychiques) n’est que l’élément déclencheur chargé d’altérer la situation initiale et d’engendrer les péripéties nécessaires à la progression de la diégèse et à l’accomplissement de la quête spirituelle dans laquelle tout protagoniste bosquien s’aventure tôt ou tard. Contrairement, donc, au limes qui assure une nette imperméabilité entre les deux univers qu’il sépare, le seuil[78] bosquien garantit la communicabilité entre les deux espaces et son franchissement anime poïétiquement toute la narration d’Henri Bosco.
Parties annexes
Note biographique
Stefana Squatrito est titulaire d’un doctorat en Études Françaises. Elle a participé à différents projets de recherche à Catane et a obtenu une bourse de recherche à l’Université de Lausanne. Chargée de cours à Messine, elle a publié une dizaine d’articles concernant l’oeuvre d’Henri Bosco, la traduction, le rapport entre autobiographie et fiction dans l’oeuvre littéraire, ainsi que l’édition critique de certaines nouvelles de Monique Saint-Hélier et la traduction italienne de son premier roman (Gabbia di sogni [La cage aux rêves], Locarno, Dadó, 2019).
Notes
-
[1]
Benoît Neiss, « Notes pour une étude de l’enfance dans l’oeuvre de Bosco », Cahiers de l’Amitié Henri Bosco, no 13, juin 1977, p. 50.
-
[2]
Jacques Cazeaux, « Écrire : se retenir au seuil », Cahiers Henri Bosco, no 27, 1987, p. 141-148 ; Sandra Beckett, « Seuils », dans La quête spirituelle chez Henri Bosco, Paris, Corti, 1988, p. 107-146.
-
[3]
La paternité de la « poïétique » remonte à Paul Valéry chargé en 1937 d’une chaire de poésie au Collège de France, qui choisit d’orienter son enseignement sur le moment et sur les conditions qui donnent naissance au poème davantage que sur sa réception, créant ainsi une différence entre l’esthétique, ou poétique, qui s’occupe de la perception et de la réception de l’oeuvre, et la poïétique. Ce mot, forgé à partir de poïésis, du grec ποίησις, c’est-à-dire la création, la fabrication, indique, dès lors, la naissance de l’oeuvre d’art, les éléments, les états d’âme qui se placent génétiquement à l’origine d’une oeuvre. Sur la filiation de la poïétique à l’égard de Paul Valéry, voir, parmi d’autres, les études suivantes : Paul Valéry, « L’invention esthétique » (1938), dans Variété, dans Oeuvres, édition établie et annotée par Jean Hytier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1957, p. 1412-1415 ; Luigi Pareyson, « L’estetica di Paul Valéry », dans Problemi dell’estetica. II. Storia, Milan, Mursia Editore, 2000, p. 11-90 ; Claude Thérien, « Valéry et le statut “poïétique” des sollicitations formelles de la sensibilité », Les Études philosophiques, no 62, 2002-3, p. 353-369 ; Lassaad Jamoussi, Le pictural dans l’oeuvre de Beckett. Approche poïétique de la choseté, Tunis / Bordeaux, Sud éditions / Presses universitaires de Bordeaux, « Entrelacs », 2007 ; René Passeron (dir.), La poïétique comme science et comme philosophie de la création, actes du premier colloque international de poïétique organisé à Vinneuf par le Centre de recherche en philosophie de l’art et de la création, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, du 28 avril au 2 mai 1989 (Paris, éditions Poïésis, 1991). – Si, pour Valéry, la poïétique était encore étroitement liée à toute oeuvre de langage, René Passeron propose « d’élargir la position de Valéry à […] toutes les oeuvres de l’homme » (Pour une philosophie de la création, Paris, Klincksieck, « Collection d’esthétique », 1989, p. 15).
-
[4]
Titre du neuvième chapitre de La poétique de l’espace, Paris, Presses universitaires de France, « Bibliothèque de philosophie contemporaine. Logique et philosophie des sciences », 1957. Nous citerons cet ouvrage à partir de sa réédition dans la collection « Quadrige » (1981).
-
[5]
Henri Bosco, L’âne Culotte, Paris, Gallimard, 1937, p. 33.
-
[6]
Henri Bosco, L’enfant et la rivière, Paris, Gallimard, « Folio », 2018 [1945], p. 13-14.
-
[7]
Le rôle de l’enfance dans l’oeuvre d’Henri Bosco a été mis en évidence plusieurs fois par des voix différentes, et le quatrième colloque international Henri Bosco qui s’est déroulé à Arras, à l’Université d’Artois du 14 au 16 mai 1998, lui a été dédié : les actes ont été recueillis et publiés par Christian Morzewski sous le titre « Henri Bosco : Rêver l’enfance » dans les Cahiers Robinson, no 4, 1998.
-
[8]
Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, Paris, Corti, 1948, p. 95.
-
[9]
Voir Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, op. cit., p. 56-57.
-
[10]
Henri Bosco, Malicroix, Paris, Gallimard, « Folio », 1973 [1948], p. 134.
-
[11]
Henri Bosco, Le Mas Théotime, Paris, Gallimard, « Folio », 1992 [1945], p. 9.
-
[12]
Dans Barboche (Paris, Gallimard, 1957), Tante Martine veut retourner à Pierrouré, son pays natal, avec Pascalet et son fidèle chien, qui donne son nom au récit. Mais, une fois arrivée à Pierrouré, incapable de franchir le seuil temporel qui la sépare désormais de son enfance, elle décide de s’arrêter et d’envoyer le jeune garçon voir, de ses propres yeux, le pays dont elle garde un si beau souvenir. Car elle comprend que ce qui avait rendu cet endroit magnifique et presque magique n’était pas la beauté du lieu mais les yeux de sa jeunesse.
-
[13]
Voir Mircea Eliade, Initiation, rites, sociétés secrètes. Naissances mystiques, Paris, Gallimard, « Folio. Essais », 1992 [1976]. Le regressus ad uterum est envisagé par le philosophe des religions comme une mort symbolique où l’initié remonte au niveau d’embryon avant de renaître à un état d’ordre supérieur.
-
[14]
Mircea Eliade, Le Mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, « Les essais », 1949.
-
[15]
Mon compagnon de songes, Paris, Gallimard, 1967, p. 20 ; Antonin, Paris, Gallimard, « Folio », 1992 [1952], p. 333 et suiv.
-
[16]
« Tantôt elle s’enfonçait dans les ténèbres de la cave ; tantôt elle disparaissait dans le cellier. / […] Mais à tous les séjours que lui offrait notre vieille demeure, Tante Martine préférait les combles. […] C’était son refuge de prédilection, son paradis. […] / Quand Tante Martine montait dans les combles, rien au monde, je crois, n’eût pu l’en tirer. Elle s’y enfermait à double tour, et je n’avais pas le droit de l’y suivre » (L’enfant et la rivière, op. cit., p. 19-21).
-
[17]
Il s’agissait d’une « énorme niche à chien désaffectée » qu’elle « avait balayée avec soin et lavée ; puis, un beau jour, on avait vu apparaître, devant la porte, un petit rideau de cretonne rose, cadeau de grand-mère Saturnine [qui] fit quelque bruit à l’office. Grand-mère Saturnine fut mise au courant : elle vint voir la cabane et […] elle fut prise d’un gentil rire. C’est ainsi que Hyacinthe devint propriétaire » (L’âne Culotte, op. cit., p. 93). La solitude de cette retraite, la nécessité « d’y entrer à quatre pattes » (ibid.) ont, dans le monde de l’imagination poétique, la même valeur qu’un retour à la vie intra-utérine. Voir Stefana Squatrito, « Mon compagnon de songes et le cycle de Pascalet : stratégies autofictionnelles et métissage des genres dans l’oeuvre de Henri Bosco », Narratologie, no 11 (« Les “Souvenirs” d’Henri Bosco : entre autobiographie et fiction », dir. Alain Tassel), 2012, p. 181-191.
-
[18]
L’enfant et la rivière, op. cit., p. 53-105.
-
[19]
Ibid., p. 59.
-
[20]
L’âne Culotte, op. cit., p. 93.
-
[21]
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, op. cit., p. 55.
-
[22]
Henri Bosco, L’enfant et la rivière, op. cit., p. 14.
-
[23]
Ibid., p. 18.
-
[24]
Ibid.
-
[25]
Ibid., p. 15.
-
[26]
Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté, Paris, Corti, 1948, p. 23.
-
[27]
Sur ce thème, voir Stefana Squatrito, « L’ivresse sensorielle dans les récits de jeunesse d’Henri Bosco », dans Paul Dirkx (dir.), Les cinq sens littéraires. La sensorialité comme opérateur scriptural, Nancy, Presses universitaires de Nancy / Éditions Universitaires de Lorraine, « Épistémologie du corps », 2017, p. 61-73.
-
[28]
« Je partis à travers les champs. Ah ! Le coeur me battait ! Le printemps rayonnait dans toute sa splendeur. Et quand je poussai le portail donnant sur la prairie, mille parfums d’herbes, d’arbres, d’écorce fraîche me sautèrent au visage. […] J’étais enivré » (Henri Bosco, L’enfant et la rivière, op. cit., p. 21-22).
-
[29]
« Les petits chemins m’attiraient sournoisement. “Viens ! Que t’importent quelques pas de plus ? […]” Ces appels me faisaient perdre la tête. Une fois lancé sur ces sentes qui serpentent entre deux haies chargées d’oiseaux et de baies bleues, pouvais-je m’arrêter ? / Plus j’allais et plus j’étais pris par la puissance du chemin. À mesure que j’avançais, il devenait sauvage » (ibid., p. 22).
-
[30]
Ibid., p. 15. Dans Un oubli moins profond. Souvenirs, Bosco se rappelle l’interdiction que sa mère lui avait formulée : « Sache, mon petit, me dit-elle, que cette rivière est un mauvais lieu. Qui s’y baigne, neuf fois sur dix, ne s’y baignera jamais plus. Il y reste. L’eau le prend, le met dans un trou, un tourbillon passe dessus et le visse. C’est fini de lui. Un noyé de plus… Quant aux gens qui par là fréquentent, tu les as vus. Eh bien, mon pauvre enfant, si par malheur tu avais été seul, on t’aurait jeté un sac sur la tête, et puis, qui t’aurait retrouvé ?… Ni vu ni connu… Tu m’entends ?… » (Paris, Gallimard, 1961, p. 300).
-
[31]
« C’était une passion montante. Elle occupait la partie la plus active de mon âme, troublait mes sens, obsédait mes yeux » (L’âne Culotte, op. cit., p. 36).
-
[32]
Ibid., p. 28.
-
[33]
Ibid., p. 29.
-
[34]
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont, « Bouquins » / éditions Jupiter, 2000 [1969], p. 777 col. 2 (« Pont »).
-
[35]
Henri Bosco, L’âne Culotte, op. cit., p. 41.
-
[36]
La valeur symbolique de l’âne sur le dos duquel Constantin accomplit son voyage dans le domaine interdit a déjà été soulignée par Sandra Beckett, « Quête et mystère dans le récit initiatique d’André Dhôtel et Henri Bosco », dans Georges Cesbron (dir.), Colloque André Dhôtel, Angers, Presses de l’Université d’Angers, 1998, p. 131-142 ; et par Isabelle Moreels, « L’ascension intérieure au fil du scénario initiatique dans quelques romans de Henri Bosco et d’André Dhôtel », Cahiers Henri Bosco, nos 41-42 (numéro spécial « Le Lubéron »), 2001-2002, p. 250-251.
-
[37]
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op. cit., p. 41. col. 2 (« Âne, Ânesse »).
-
[38]
Ibid.
-
[39]
Marie-Louise von Franz, La délivrance dans les contes de fées, trad. par Jacqueline Steib-Blumer, Paris, Jacqueline Renard, « La fontaine de pierre », 1998, p. 50.
-
[40]
Henri Bosco, Antonin, op. cit., p. 180.
-
[41]
En dépit des diversités et des spécificités de mise en oeuvre de chaque récit initiatique, on y retrouve toujours la même structure, soit un déroulement en trois étapes fondamentales : la préparation du novice, qui consiste en l’aménagement du lieu sacré et en la purification du myste ; la mort initiatique, c’est-à-dire le voyage symbolique dans l’au-delà ; et la renaissance, c’est-à-dire le retour au monde d’un être nouveau, tout à fait différent de celui qui avait entrepris ce parcours initiatique (voir Mircea Eliade, Initiation, rites, sociétés secrètes. Naissances mystiques, op. cit.).
-
[42]
Dans ce roman, le protagoniste, Martial de Mégremut, reçoit la nouvelle de la mort de son grand-oncle Cornélius de Malicroix, dont il va hériter La Redousse, la maison solitaire située sur une île entourée par le fleuve où vivait son parent lointain. Guidé par Balandran, le fidèle serviteur de Cornélius, Martial visite le domaine dont il va devenir l’héritier. Mais pour entrer en possession des terres, il devra surmonter des épreuves qui représentent les clauses bien étranges du testament de feu Cornélius. Ici, le déplacement du héros correspond aussi à l’abandon de la tranquillité et du statisme domestique dans lesquels le protagoniste passait son existence, et à l’entrée dans un ailleurs inconnu où, tout comme le néophyte des récits initiatiques, il doit surmonter des épreuves telles que la peur, le silence et la solitude représentant les étapes de sa quête initiatique.
-
[43]
Paris, Gallimard, « Folio », 2011 [2002. Flammarion, 1950].
-
[44]
Paris, Gallimard, 1954.
-
[45]
Paris, Gallimard, 1971.
-
[46]
Paris, Gallimard, 1978.
-
[47]
Sandra Beckett, La quête spirituelle chez Henri Bosco, op. cit., p. 117.
-
[48]
Robert Baudry, « Le sommeil, porte d’un autre monde chez Henri Bosco », dans Henri Bosco. Mystère et spiritualité, actes du troisième colloque international Henri Bosco (Nice, 22-24 mai 1986), Paris, Corti, 1987, p. 69-86.
-
[49]
Ibid., p. 71.
-
[50]
Henri Bosco, Le Mas Théotime, op. cit., p. 286.
-
[51]
Barboche, op. cit., p. 39.
-
[52]
Une ombre, op. cit., p. 146. La prise de conscience de la part du narrateur d’Une ombre se poursuit avec une analyse détaillée de l’itinéraire que la conscience doit accomplir avant de descendre dans l’obscurité du sommeil en quittant la veille, une descente ardue et pénible parce qu’elle ouvre la porte d’un autre monde, d’un monde inconnu dont le rêve est le protagoniste le plus important : « Il y en a sept qui descendent échelonnés vers les ténèbres. Mais je n’atteignis pas à celui du silence, le dernier. Il donne sur la Nuit, le Néant. Pendant cette progressive descente vers la Porte infernale, je ne perdis pas tout à fait conscience. […] / Je n’ai pas fait le pas fatal. Pendant un moment je n’ai plus bougé. / Le septième Seuil avait disparu. / Alors tout doucement j’ai remonté la pente, seuil après seuil. En haut, mon premier sommeil m’attendait. J’y ai naturellement repris place, une place apaisante. Elle ne m’inclinait pas au sommeil, mais au repos, au simple repos. J’en ai profité » (ibid.).
-
[53]
Un rameau de la nuit, op. cit., p. 252.
-
[54]
Ibid., p. 250-251.
-
[55]
L’âne Culotte, op. cit., p. 87.
-
[56]
Ibid.
-
[57]
Ibid., p. 90.
-
[58]
Ibid., p. 86.
-
[59]
Ibid.
-
[60]
Robert Baudry, « La quête d’un autre monde ou sur deux romans de Henri Bosco [Le récif, 1971] et André Dhôtel [L’honorable Monsieur Jacques, 1972] », Mbegu (Université nationale du Zaïre, Institut supérieur pédagogique), no 3, juin 1977, p. 15.
-
[61]
Henri Bosco, Le renard dans l’île, Paris, Gallimard, 1956, p. 169.
-
[62]
Hyacinthe, Paris, Gallimard, « Folio », 2016 [1940], p. 19.
-
[63]
Ibid., p. 9-10.
-
[64]
Ibid., p. 9.
-
[65]
Philippe Hamon, Du descriptif, Paris, Hachette Supérieur, « Hachette université. Recherches littéraires », 1993 [1981], p. 175.
-
[66]
Jean Starobinski, « Fenêtres (de Rousseau à Baudelaire) », dans François Guéry (dir.), L’Idée de la ville. Actes du colloque international de Lyon, Seyssel, Champ Vallon, « Milieux », 1984, p. 179.
-
[67]
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, op. cit., p. 199.
-
[68]
Ibid., p. 48.
-
[69]
Ibid.
-
[70]
Ibid.
-
[71]
Henri Bosco, Hyacinthe, op. cit., p. 10.
-
[72]
Ferdinand Stoll, « Henri Bosco. Les avatars du moi dans la trilogie L’âne Culotte, Hyacinthe, Le jardin d’Hyacinthe », dans Bertrand Degott et Marie Miguet-Ollagnier (dir.), Écritures de soi : secrets et réticences. Actes du colloque international de Besançon (22, 23, 24 novembre 2000), Paris, L’Harmattan, 2001, p. 117-131.
-
[73]
Henri Bosco, Hyacinthe, op. cit., p. 139-161.
-
[74]
Ibid., p. 141.
-
[75]
Ibid.
-
[76]
Ibid., p. 149.
-
[77]
La relation de l’âme et du corps est traitée d’une manière exemplaire par Jean Onimus, « Le thème du double », dans Henri Bosco. Mystère et spiritualité, op. cit., p. 96-108.
-
[78]
Sur les notions de seuil et de limes, voir Mircea Eliade, Le Sacré et le profane, Gallimard, 1965, p. 28.