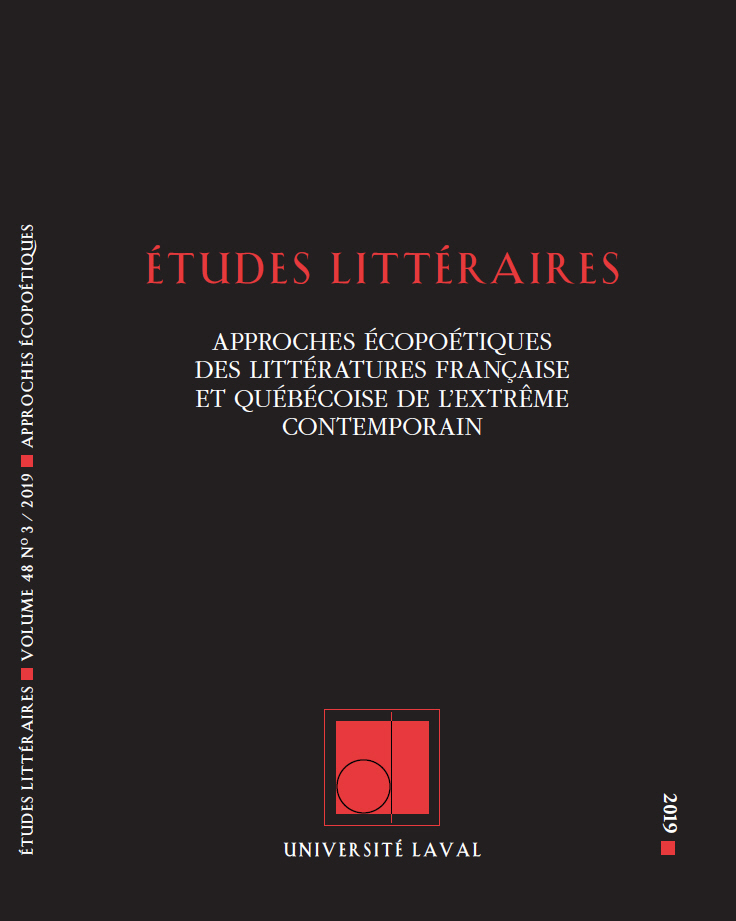Résumés
Résumé
Dans cet article, nous proposons une lecture de deux romans français de l’extrême contemporain, Naissance d’un pont de Maylis de Kerangal (2010) et L’Homme des haies de Jean-Loup Trassard (2012). Ces auteurs présentent des personnages qui vivent, en marge ou tout à fait hors d’un environnement humain, une interaction particulière avec les règnes animal ou végétal. Nous prêterons attention à la façon dont les romanciers argumentent en faveur d’une sympathie pour ceux qui vivent des expériences authentiques dans la nature – que le progrès industriel et les problèmes écologiques risquent de rendre bientôt impossibles. Nous aborderons aussi le travail d’écriture qui accompagne les descriptions et les prises de position des auteurs étudiés et tiendrons compte de la façon dont ils jouent avec les conventions du roman réaliste (Trassard) et de l’épopée (Kerangal).
Abstract
In this article, we propose a reading of two French novels of the extreme contemporary literature, Naissance d’un pont by Maylis de Kerangal (2010) and L’Homme des haies by Jean-Loup Trassard (2012). These authors present characters who live, on the margins or completely outside of a human environment, a unique interaction with the animal or vegetable kingdoms. The article focuses on how novelists argue in favour of sympathy for those who live authentic experiences in nature – experiences that industrial progress and ecological problems may soon make impossible. The paper also discusses the writing work that accompanies the descriptions and positions of the authors studied and take into account how they play with the conventions of realist (Trassard) and epic (Kerangal) novels.
Corps de l’article
Maintenant que le souci de la protection de l’environnement trouve à s’exprimer quotidiennement dans les médias et occupe la place que l’on sait dans les programmes politiques mondiaux, la littérature à vocation environnementale[1] gagne en visibilité auprès de la critique littéraire. Or, dans la plupart des cas, les oeuvres les plus connues et fréquemment étudiées sont celles qui abordent la problématique écologique de façon explicite et militante.
C’est pourquoi nous nous pencherons dans cet article sur deux romans français de l’extrême contemporain, Naissance d’un pont de Maylis de Kerangal (2010)[2] et L’Homme des haies de Jean-Loup Trassard (2012)[3], exempts de discours écologiste ouvertement militant – comme c’était par exemple le cas pour Le Règne du vivant d’Alice Ferney –, mais où, à travers les descriptions et l’emploi de certaines techniques formelles, les auteurs soulignent l’importance de protéger la nature. Comme l’explique Pierre Schoentjes, « [l]’évocation de la nature par la description attentive du réel sensible, une pratique à laquelle certains détracteurs entendent réduire le genre quand ils le qualifient de naïvement référentiel, peut impliquer une argumentation rhétorique visant à convaincre le lecteur de la nécessité de préserver l’environnement[4] ». Kerangal et Trassard évoquent ainsi dans leurs romans une technologie problématique, qui altère l’environnement et perturbe profondément le rapport entre l’homme et la nature. Même si les problèmes écologiques ne sont pas les seuls enjeux à alimenter l’intrigue, les auteurs mettent en scène la complicité entre l’homme et le monde naturel comme une source de bonheur et comme une façon d’habiter le monde par opposition à la destruction environnementale que provoque le progrès moderne. Car les deux romans présentent des personnages qui vivent une interaction particulière avec les règnes animal et végétal – une interaction que le progrès industriel et les problèmes écologiques risquent de rendre bientôt impossible.
Si dans leurs romans Kerangal et Trassard cèdent la parole à des narrateurs indépendants et présentent aussi bien le point de vue de ceux qui valorisent le monde naturel que celui des partisans du progrès, nous avons constaté que les deux auteurs penchent en faveur des personnages qui vivent des expériences authentiques dans la nature[5]. Pour exprimer leur attachement au monde sensible et montrer les enjeux qui y sont liés, ils recourent à des stratégies rhétoriques que nous analyserons en détail : le rôle de l’ironie, l’organisation formelle de l’histoire, les caractéristiques de registre propres au roman réaliste (Trassard) et au roman épique (Kerangal). Bien consciente que les deux romans n’ont à première vue rien en commun, ni au niveau du style ni en ce qui concerne l’histoire, nous avons néanmoins choisi de les rapprocher, afin de montrer comment les deux auteurs suscitent l’adhésion du lecteur en jouant avec les conventions du genre romanesque dans lequel s’inscrivent leurs romans : Trassard porte au paroxysme les caractéristiques du roman réaliste, Kerangal renverse les codes du genre épique.
Une communion avec la nature
Dans L’Homme des haies, Vincent Loiseau, un paysan à la retraite mais toujours prêt à « barbeyer[6] » les haies qui délimitent ses champs, s’adresse directement au lecteur à travers un monologue désarmant. Sans tomber dans les pièges d’une idéalisation[7], ni dans la déploration d’un âge d’or révolu, il décrit sa vie à la ferme et nous présente les pratiques, les personnages et la langue d’un monde rural qui a subi de profondes transformations au cours du XXe siècle. Si le narrateur se montre parfois nostalgique, il manifeste surtout une sincérité touchante lorsqu’il décrit minutieusement où il cache son argent (HH : 45), qu’il explique quelles feuilles il faut utiliser quand « une envie vous pren[d] » dans les champs (HH : 137-139), qu’il regrette l’absence d’activité sexuelle (HH : 58), qu’il raconte comment il a perdu deux dents (HH : 94) ou, surtout, lorsqu’il fait voir à travers l’évocation de nombreux souvenirs la tristesse et la solitude que lui cause la mort de son épouse. Avec Naissance d’un pont, Maylis de Kerangal quitte, de son côté, le paysage français pour plonger le lecteur dans un milieu urbain américain, où elle montre, par la construction d’un pont, la dynamique de la globalisation. L’immensité de cette entreprise, aussi bien au niveau de la construction et des matériaux que du nombre de personnes qui y contribuent, atteint une dimension véritablement épique, que Kerangal expose à travers l’écriture et la trame du roman. Dans les deux récits, les auteurs mettent en scène des personnages qui témoignent d’un intérêt particulier pour le monde naturel, que ce soit par leur contexte de travail (un paysan) ou par leur mode de vie dans un endroit naturel que le progrès n’a pas encore envahi (des Indiens dont l’habitat, une forêt, sera détruit à cause de l’expansion urbaine), et manifestent un respect profond pour les règnes animal et végétal circonvoisins.
Dans L’Homme des haies, la culture de la terre permet au paysan Vincent Loiseau non seulement de se rapprocher des animaux et végétaux qui constituent le microcosme rural, mais aussi de se pencher de près, avec un regard quasi microscopique, sur un environnement aménagé et domestiqué mais essentiellement naturel dont il relate avec précision les modifications au fil des saisons. Approchant le monde environnant à l’aide de ses cinq sens, et en particulier par la vue et le toucher, il éprouve une grande proximité avec la nature, par exemple lorsqu’il « caress[e] », presque en amoureux, la peau « poudrée » d’une pomme de terre ou quand il mange une patate chaude, « réconfortant[e] », qui lui « cause de la terre où elle est née ! » (HH : 24). Il s’agit d’un contact intime qui ne donne pas, comme dans d’autres oeuvres[8] de Trassard, lieu à une fusion cosmique avec les éléments, mais qui constitue une source de connaissance particulièrement riche. Ayant hérité d’une soif de savoir et de grands dons d’observation de son grand-père, qui « [lui] a appris à regarder » (HH : 149), Vincent continue toute sa vie à faire attention aux caractéristiques et fonctions des plantes cultivées et sauvages. Il s’achète par exemple un livre sur les végétaux pour connaître les noms des plantes et des fleurs qu’il trouve dans les champs et qui, pour futiles qu’elles soient, méritent d’être nommées :
[O]n les arrache à poignées, on marche dessus, et toutes ces plantes-là on les appelle bourrier, mais je me suis dit elles ont sûrement un nom. […] On cause du pissenlit, du laiteron, de la traînasse, des poules-grasses, des parelles, des chardons mais tout le reste, après, c’est du bourrier.
HH : 48
Ce sont les animaux qui lui ont appris comment il faut faire l’amour, comme « l’étalon, le taureau, le verrat ou le père lapin, on les avait tous vus crucher[9], c’est là qu’on avait été à l’école » (HH : 60). Le paysan se sert aussi du monde naturel si les outils modernes lui manquent : ainsi il devine l’heure d’après le soleil (HH : 57).
Comme l’a montré Alain Romestaing, Trassard « ne cesse de revendiquer une proximité des hommes et des animaux qui est précisément celle des paysans et de leurs bêtes[10] ». Dans L’Homme des haies, le narrateur explique que, grâce au travail à la ferme, il s’est vite accoutumé au contact physique avec les animaux. À l’âge de huit ans, Vincent sauve la vie d’une vache en extrayant la pomme coincée dans son gosier (HH : 18). Très sensible à la souffrance animale, il n’arrive pas à tuer des cochons : « C’est qu’un cochon, mais lui couper la gorge… aurait fallu que j’en fus forcé ! » (HH : 124). Passant beaucoup de temps avec les animaux de la ferme, il se rend compte qu’ils témoignent d’une grande confiance et intelligence (HH : 34), et qu’il est tout à fait possible d’entrer en dialogue avec eux. Ainsi, au lieu de crier sur les juments ou de se servir d’un fouet, il leur adresse la parole, car d’abord, elles « ne le mérite[nt] pas » (HH : 229) et d’ailleurs, l’habitude, leur intelligence et la voix du paysan suffisent pour lancer le travail : « On leur parle, aux juments, oui, avec leur nom, il faut mettre un peu de voix mais pas la peine de crier, elles entendent très bien, elles voyaient que j’étais là, ça leur suffisait » (HH : 230). Vincent ne parle pas seulement à son chien, malgré l’incompréhension de sa femme (HH : 87), il assure aussi au lièvre que ses champs sont sûrs pendant la période de chasse : « Sacré ballot, reste donc par là, tu seras tranquille ! » (HH : 190). Même si souvent les animaux n’arrivent pas à comprendre, il se sert de sa voix pour les tranquilliser : « Une cane qui couve, […] elle défend ses oeufs, le moindre peu qu’on s’approche elle siffle. Je lui dis : “Ça va, ça va !”, je me doute qu’elle ne comprend pas, mais à la longue de me voir elle s’habitue, elle siffle moins » (HH : 42-43).
Parfois, les limites entre l’homme et le règne animal s’effacent, quand le narrateur essaie de comprendre, par une observation attentive, les procès mentaux, cognitifs et affectifs des bêtes qu’il rencontre : « [A]nhui[11] ça m’arrive, je me demande ce que les bêtes ont dans la tête, je m’amuse, quoi » (HH : 213). Se servant dans la plupart des cas de la conjonction « comme » et de la tournure « dans son / leur idée », Vincent révèle au lecteur sa capacité à deviner les pensées des animaux et, dès lors, à s’adapter à leurs intentions et besoins. Ainsi, le chien Tommy, après avoir failli attraper un lièvre, regarde « comme à dire : je l’ai encore raté » (HH : 86) ; lors de la récolte des poires, les frelons s’accrochent au paysan, « comme à défendre leur nourriture » (HH : 192) ; il ne faut pas essayer de faire travailler les juments à la brune, car « elles ne tirent plus, dans leur idée la journée devrait être finie » (HH : 231) ; un lièvre qui ne s’enfuit pas brusquement, regarde le paysan comme s’il « n’avait pas décidé de partir, dans son idée [Vincent] n’allai[t] pas le voir » (HH : 235). Il ne s’agit pas d’une simple personnification naïve : le dialogue qui s’instaure relève d’une empathie permettant d’une part de comprendre le monde naturel, et de l’autre de céder la parole à ceux qui restent sans voix dans un monde essentiellement anthropocentrique. En intégrant le point de vue animal dans son récit, le narrateur – et partant l’auteur – transforme les animaux en sujets dotés d’une conscience, des interlocuteurs dont la vision du monde mérite d’être écoutée. Par son empathie pour le monde naturel, Vincent « Loiseau » – un clin d’oeil qui rapproche le paysan du règne animal – donne au lecteur l’exemple d’une éthique attentive aux plus petits et respectueuse de toutes les formes de vie.
Dans Naissance d’un pont, le but de l’entreprise épique consiste en la construction d’un pont avec six voies ultrarapides destinées à réaliser les désirs d’expansion de la ville Coca en la reliant au continent, côté « Edgefront ». Ce côté et sa forêt abritent un petit groupe d’Indiens menant une vie « primitive » dans la nature, dans le sens où leur vie et leurs cultes reposent sur l’harmonie avec le monde naturel environnant et ne sont pas déterminés par le luxe et la surabondance technique qui caractérisent la ville moderne. La construction du pont et l’aménagement de la grande route impliquent des coupes claires dans la forêt et la disparition programmée de la civilisation indienne. La communauté s’est éloignée du monde citadin, ce dont témoigne la route qui y mène :
Il faut rouler une journée entière sur la voie d’exploitation forestière puis une fois au bout de la piste marcher tout droit pendant quelques heures pour rencontrer les Indiens. Un chemin raviné par les pluies et crevé de nids-de-poule, obstrué par des arbres effondrés, parfois même effacé sous des fougères géantes voire quelque cadavre de bête. Ce trajet n’est pas sans danger, le risque de se faire attaquer par un mammifère carnivore est élevé, celui de se perdre l’est encore plus.
NP : 111
Kerangal évoque ici une nature sauvage et éloignée où le passé mythique des lieux, ranimé à travers des vestiges préhistoriques, est encore conservé. Et même si, comme le montre Pierre Schoentjes[12], il n’est en réalité plus question de nature purement sauvage en Californie ni du mythe du « bon sauvage »[13] – les Indiens les plus aisés disposent de « 4 × 4 rutilants » (NP : 312) –, la société indienne de l’Edgefront symbolise un mode de vie respectueux de la nature et en intimité avec l’environnement : ils vivent en plein air, les enfants jouent dans la rivière, les hommes et femmes se rassemblent autour des sources peuplées d’esprits ou discutent dans l’air du soir qui est « d’une incroyable douceur » (NP : 111).
Contrairement à Trassard dans son roman, où le monologue permet aux lecteurs d’entendre, sans la médiation d’un narrateur hétéro/extradiégétique, les pensées et les opinions du paysan, Kerangal ne cède nulle part la parole à ceux qui vivent dans la nature. Nous entendons les réflexions des ouvriers et des ingénieurs, mais n’avons nullement accès au langage ni aux pensées des Indiens que l’auteur décrit sur un ton qui suscite la compassion : par le choix des mots, Kerangal victimise cette « tribu » (NP : 112), qui est « assiégée par l’histoire » (NP : 112) et dont « la disparition [est] programmée » (NP : 113). De plus, les membres de cette société se font remarquer par leur mode de vie joyeux, paisible et presque utopique : « [D] es femmes passent les saluer, elles ont les cheveux lissés à l’arrière de leur front et retenus par des peignes en obsidienne, des visages larges aux pommettes charnues, elles rient, collées l’une à l’autre » (NP : 112).
Non seulement le lecteur est privé des paroles de la société indienne, qui plus est, la narration est portée par un narrateur omniscient, qui suit de près les évolutions du chantier, et se trouve dès lors fortement marquée par la vision du monde de ceux qui construisent le pont[14], valorisant le dynamisme et l’énergie de ces derniers. Un seul personnage se présente comme le porte-parole de la société indienne : le professeur et ethnologue Jacob défend les intérêts des Indiens, fût-ce parfois d’une façon violente, et les instruit afin qu’ils puissent se réapproprier leur patrimoine culturel, historique et religieux.
La dichotomie entre nature et progrès
Jean-Loup Trassard aussi bien que Maylis de Kerangal montrent comment les interventions techniques liées au progrès non seulement perturbent le rapport sensoriel que l’homme entretient avec la nature, mais causent aussi de graves altérations de l’environnement. La bipartition entre la nature (les partisans d’un contact intime avec elle) et le progrès (les défenseurs de celui-ci) se concrétise dans les relations conflictuelles entre différents personnages, qui sont soulignées par des écarts temporels ou spatiaux.
Çà et là dans la narration de cette histoire, Vincent Loiseau rend compte de l’évolution de l’agriculture, plus particulièrement de la modernisation des techniques et machines après la Seconde Guerre mondiale. Comme l’affirment aussi Catherine et Raphaël Larrère[15], la mécanisation de l’agriculture a entraîné la disparition des pratiques traditionnelles. Et, comme le montre le narrateur, c’étaient précisément ces gestes qui permettaient au paysan d’entretenir une intimité avec le monde naturel. Il en résulte qu’en plus du contact physique l’agriculteur perd aussi sa complicité avec les règnes animal et végétal. C’est pourquoi notre vieux paysan continue à respecter les anciennes pratiques agricoles, tandis que son fils cède aux exigences du progrès.
Il y a d’abord eu la mécanisation des outils : au lieu d’utiliser un « sermiau[16] », le fils de Vincent se sert d’une tronçonneuse pour couper le bois (HH : 13). De la même manière, à l’époque où il officie dans les champs, on ne fane plus « o l’broc, maintenant c’est mécanique, il met la pirouette derrière son tracteur[17] » (HH : 92). À partir des années 1950, les tracteurs devenaient communs. Mais c’est avec réticence que le vieux paysan a suivi cette mode, surtout parce qu’il ne voulait pas perdre le contact quotidien avec les juments : « Moi, j’ai toujours aimé les chevaux, je ne me voyais pas quitter mes juments » (HH : 31). Quand Vincent fauche du foin, il utilise la faucheuse, beaucoup plus silencieuse que le moteur d’un tracteur, et jouit du contact sensoriel avec la nature : l’odeur de l’herbe coupée, le chant des oiseaux et les conversations avec les chevaux (HH : 99-100), mais le jeune homme, lui, préfère le confort : « [O] le tracteur, […] ça se laboure tranquillement, c’est pas comme avec quatre juments à faire tourner dans tous les sens » (HH : 135). L’arrivée du tracteur a également changé la relation entre le vieux paysan et son fils qui s’en sert avec enthousiasme :
Le tracteur, ça m’est arrivé de le mettre en route et de le rentrer ou, quelquefois, de le déranger dans la cour, mais je ne l’ai pas pris pour travailler. Lui, au contraire, il ne cherchait que ça, seulement le matériel qu’on avait était adapté pour les chevaux et pas pour le tracteur. Il a fallu petit à petit modifier les ancrages. Je le laissais faire, ça le sentait bien mieux qu’à moi, mais j’ai vu, à cause du tracteur, qu’il commençait à me regarder de haut.
HH : 32
Certaines cultures disparaissent parce qu’elles ne sont pas suffisamment rentables, comme les betteraves qui constituent pourtant un repas gourmand pour les animaux (HH : 29-30). Les agriculteurs de la nouvelle génération sèment d’autres variétés de grain qui « donnent beaucoup plus » mais dont la qualité est moindre : « Anhui faut du rendement, c’est tout ! » (HH : 52). Aujourd’hui, déplore Vincent, « tout le monde est pressé » (HH : 130). C’est pourquoi on ne ramasse plus les feuilles au long des haies, ce qui permettait d’économiser de la paille. Ayant vécu des pénuries pendant l’Occupation, la génération du narrateur « était économe de tout. […] Les jeunes ont changé tout ça » (HH : 131). La relation problématique entre le vieux paysan et son fils ne montre pas seulement la grande différence de mentalité des différentes générations, elle représente aussi le clivage entre les défenseurs d’une relation intime et sensorielle avec le monde naturel et les partisans du progrès, pour qui le confort et le rendement priment.
Dans Naissance d’un pont, l’opposition entre le progrès et l’intimité avec la nature ne se situe pas pour autant dans un écart temporel, mais s’exprime au niveau spatial. Le pont doit relier deux espaces géographiquement séparés, l’un habité par des citadins modernisés, l’autre abritant des Indiens. Les deux modes de vie tout à fait opposés qui y correspondent font comprendre dès la première page au lecteur qu’il est invité à choisir entre la nature et la modernité. Car l’édification du pont appelle une mission collective, portée par des héros qui tous, comme dans une épopée classique, bénéficient au début du livre de leur aristie, la description des exploits accomplis. Ainsi, Diderot, un ingénieur surnommé le « bridgeman » (NP : 72), est présenté non par ses traits de caractère, ni par sa situation familiale, mais par ses réussites de construction, présentées dans un développement paratactique assez ludique rappelant le style d’un C.V. : « Stade de foot à Chengdu, annexe de port gazier à Cumaná, mosquée à Casablanca, pipeline à Bakou […], station d’épuration mobile au nord de Saigon, complexe hôtelier pour salariés blancs à Djerba, studios de cinéma à Bombay, centre spatial à Baïkonour » (NP : 12-13), etc. En vrai héritier de la mondialisation, il est « [t]éléporté […] de biotope en biotope » (NP : 13), dans la plupart des cas pour aider les grandes multinationales à instaurer la loi de la consommation au niveau mondial. Au chantier du nouveau pont, il est le héros central, censé « tenir [l]es troupes » (NP : 234), qui au début des travaux sont « galvanis[ées] » (NP : 101) comme les guerriers homériques à l’aube du combat. Leur tâche consiste à exécuter aveuglément les ordres de riches industriels, une obéissance servile qu’un agitateur leur reproche lors d’une grève : « [B]êêê bêêê, alors on est des moutons ? bêêê bêêê » (NP : 227).
La grandeur de la mission est montrée dès le début par la rigueur et la gravité du concours de sélection, dont l’ampleur jure ironiquement avec l’annonce dans le journal, trois lignes en corps 12 (NP : 23). Pressés par un calendrier « infernal », les ingénieurs « marnaient quinze heures par jour et le reste du temps vivaient le BlackBerry ou le iPhone vissé à l’oreille, fourré la nuit sous l’oreiller, le son augmenté quand ils passaient sous la douche, […] s’exceptaient de la vie » (NP : 24). Tout au long du roman, de nombreux chiffres explicitent le caractère démesuré de la tâche. Car le maire, John Johnsson, affublé du sobriquet « le Boa » pour s’être enrichi par les rentes que lui procure la corruption, veut sortir la ville de l’anonymat, malgré les gratte-ciel, les complexes commerciaux, les immeubles énormes hébergeant des multinationales, les stades et les casinos qui remplacent déjà les vieux bâtiments trop traditionnels et européens – « la poussière est ce qui leur va le mieux » (NP : 60). L’espace urbain, qui célébrera le consommable et le précaire avec ses constructions en plastique, caoutchouc et mélaminé, n’est pas sans rappeler l’univers apocalyptique des premiers romans de Le Clézio. Tout comme dans La Guerre (1970) ou Les Géants (1973) où les bruits de la rue sont présents de façon écrasante et sèment le désordre, à Coca le bruit domine le silence troué par des voitures « monté[es] sur des jantes de 22 pouces, puissance 500 chevaux, [des] bestiole[s] à quarante-cinq mille dollars » (NP : 42). Mais si le mode de vie des responsables du chantier, le projet du pont et la modernisation de la ville respirent la vitesse, l’excès et le superficiel, ces qualificatifs ne valent évidemment pas pour les Indiens du côté Edgefront.
Comme dans L’Homme des haies, Kerangal présente la dichotomie entre une vie respectueuse de la nature et un progrès destructeur à l’aide d’une opposition de mentalités et de modes de vie entre personnages. Or, dans Naissance d’un pont, cette opposition est également symbolisée géologiquement, par la comparaison de deux types de sols extrêmes (NP : 75) et géographiquement, dans un passage retraçant la descente d’un avion, par la juxtaposition de deux paysages tout à fait contraires :
Douze mille pieds. La surface terrestre précise sa partition binaire : à l’est, c’est une étendue claire, céruse crayeuse tirant sur le jaune pâle, chaume semé d’aiguilles convergeant en pelote métallique, à l’ouest, un massif obscur, mousse noire aux reflets émeraude, dense, irrégulière. Dix mille pieds : la zone blanche vibre, crépite, des milliers d’éclisses éparpillées étincellent quand la zone noire, elle, se tient impénétrable, absolument close. Huit mille pieds. Une ligne de front apparaît qui agence ces deux zones, contre laquelle elles se frottent ou coulissent à la manière de deux plaques tectoniques le long d’une ligne de faille : le fleuve. […] il y a du tirage en bas, ça guerroie, ça disjointe : topographie de l’affrontement.
NP : 38-39
Si le vocabulaire guerrier de ce passage rappelle l’entreprise épique, l’antagonisme entre les deux espaces et les modes de vie qui y sont liés est encore explicité par le narrateur : « On aurait assisté à cette lutte – le pont contre la forêt, l’économie contre la nature, le mouvement contre l’immobilité – qu’on n’aurait su qui encourager » (NP : 124). Mais ce qui reliera les deux espaces, le pont en construction, qui est le summum du progrès et de la corruption, constitue plutôt un prolongement de la ville qu’un véritable projet de réconciliation.
La différence entre les deux espaces se reflète aussi dans l’écriture. À l’aide d’un certain nombre de procédés stylistiques, Kerangal essaie de capter le flux d’énergie qui accompagne l’épopée technique. Ainsi, elle fait accélérer la vitesse de lecture des longues phrases par des énumérations, des changements de sujet inattendus et l’absence de guillemets marquant le discours direct, tandis que les précisions, les digressions et les parenthèses, souvent introduites par des tirets[18], tiennent le lecteur en haleine[19]. Si le souffle épique traverse tout le roman, les descriptions renvoyant à la forêt ou à des éléments naturels, même dans l’espace urbain, se caractérisent souvent par une écriture plutôt lyrique. Ainsi, les plongeurs qui préparent les fondations du pont se transforment dans l’eau en des
créatures amphibies vingt mille lieues sous les mers, ils coudoient les murènes barbares, les poissons dragons et les poissons lanternes, frôlent les méduses égarées en migration vers la surface, caressent le ventre des cétacés et tirent les moustaches des phoques, s’aveuglent du plancton en suspension dans les trouées de lumière, s’émerveillent du corail, collectent des algues étranges.
NP : 108
Notons, pour finir, que les deux auteurs n’hésitent pas à montrer les atteintes que le progrès technique porte à l’environnement : la pollution et la disparition des espèces constituent des préoccupations communes. Ainsi, Vincent Loiseau montre comment les éléments typiques du paysage rural ont disparu au fur et à mesure à cause du remembrement agraire des années 1960. Les haies et les arbres ont été abattus au bulldozer, soit pour créer des champs plus vastes (HH : 47), soit parce que les paysans qui vendent leur ferme veulent encore profiter du bois pour le chauffage (HH : 94-95). Et, remarque Vincent, l’abandon de certaines cultures cause la disparition de quelques espèces animales. Il voit un rapport entre l’extension de la culture du maïs et la disparition du lièvre (HH : 159). En outre, la disparition des écrevisses, jadis nombreuses dans les cours d’eau autour de la ferme, serait causée par des polluants agricoles : « [D]’après le journal, […] ce serait les produits qu’on sème, nous, les fermiers, qui s’en vont dans l’eau » (HH : 220). Dans Naissance d’un pont, c’est à travers les yeux de Jacob, porte-parole et défenseur de la société indienne, que sont montrés les dégâts écologiques que cause la construction du pont : suivant le regard de Jacob, nous voyons « des poissons morts flott[ant] par dizaines, refoulés des profondeurs lors des explosions, ils ont les yeux ouverts et fixes » (NP : 120). Et, même si Jacob est le seul à attirer explicitement l’attention sur les soucis écologiques provoqués par l’édification du pont, d’autres personnages révèlent, sur un ton plus naïf ou parfois même optimiste, les problèmes environnementaux à Coca. Ainsi, les expériences sensorielles de Summer Diamantis, responsable de la production du béton, plongent le lecteur dans un univers de déchets :
[P]oubelles, gobelets de plastique déformés par la chaleur, viandes avariées, journaux maculés d’essence, fleurs fanées, légumes pourris, linge sale et sueur en abondance sur le tout – voilà, c’est l’odeur de Coca pensera Summer, comme si l’odeur de la ville était d’abord celle de son ordure.
NP : 47
Le Boa, bien conscient de la violence que les aménagements urbains font subir au paysage, a interdit toute publicité sur l’ouvrage et en particulier sur « les nuisances inhérentes à de tels travaux » (NP : 133), une censure à laquelle ne participe pas le narrateur, qui précise : « [É]ventrements de perspectives aimées, poussière, bruit, pollutions hétérogènes » (NP : 133).
Ironie, langue et usage des codes romanesques
Si les auteurs décrivent les problèmes environnementaux qui relèvent de la mécanisation de l’agriculture et de l’expansion urbaine, leurs descriptions se limitent au simple constat et n’aboutissent nulle part à un discours ouvertement militant. C’est surtout à travers l’ironie et un jeu avec les conventions du roman réaliste et de l’épopée qu’ils expriment leur penchant pour ces personnages qui, dans leur mode de vie, témoignent d’un respect profond pour la nature.
De façon assez surprenante, comme nous venons de le voir, ce sont, dans Naissance d’un Pont, les héros mêmes du projet, donc des défenseurs du progrès, qui permettent au lecteur de découvrir les désastres environnementaux auxquels mènent le consumérisme urbain et la construction du pont. Il semble que Kerangal joue volontairement avec les conventions de l’épopée ; cette approche ironique fait supposer qu’elle défend malgré tout la cause des Indiens.
D’abord, comme chez Trassard, le choix des noms n’est pas fortuit. Les noms des héros de la mission épique renvoient justement à des penseurs transcendantalistes et fondateurs de la tradition littéraire du nature writing américain : Katherine Thoreau, renvoyant à Henri David Thoreau, et Ralph Waldo, faisant écho à Ralph Waldo Emerson. Il est donc assez ironique que ces personnes réelles, qui ont toujours milité pour une préservation de la wilderness, aient prêté leur nom à des personnages responsables de la destruction de la forêt. À ce duo s’ajoute Diderot, dont le nom introduit une « dimension iconoclaste, ludique et brillante[20] ». Le jeu onomastique ne permet pas seulement à l’auteur de créer des situations comiques, lorsqu’un « désir moléculaire » (NP : 164) s’épanouit entre Diderot et Thoreau, mais raille aussi le procédé de la dénomination porteur de sens dans l’épopée.
En outre, l’écologie joue un rôle prépondérant dans l’ironisation des conventions du genre. Car la mission épique repose sur un grand paradoxe : Coca a besoin du pont et de l’autoroute pour exporter ses excédents de biocarburant, et grâce à ces aménagements elle ne dépendra plus des villes de la côte et des pétroliers pour son énergie. Ironiquement, le sacrifice de la forêt est nécessaire pour convertir la ville à l’éthanol et en faire « l’avant-garde des enjeux écologiques mondiaux. Coca ville verte » (NP : 63). Comme dans toute épopée, des forces contraires, souvent supérieures, font obstacle au projet du pont. Or, dans ce roman moderne – le mythique étant réservé à la forêt –, le rôle des dieux jaloux est tenu par des grèves et un attentat, c’est-à-dire des faits le plus souvent provoqués par la gestion désastreuse, la corruption et l’appât du gain des maîtres d’ouvrage. Toutefois, le seul événement qui arrive à paralyser le chantier pendant plusieurs semaines est l’arrivée d’oiseaux nidifiant sur la rivière. Les ornithologues n’hésitent pas à invoquer la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, malgré le fait que le chantier est favorable aux animaux ailés, note le narrateur avec humour, car « les grues fournissent de nouveaux perchoirs de halte aux oiseaux hors d’haleine » (NP : 141). Et le narrateur de montrer à travers une tournure d’ironie verbale, portée par l’ambiguïté sémantique du mot « grue », que le Boa aurait pu voir les auspices : « Les grues d’abord lui éberluent la tête : agglutinées par centaines, elles surpeuplent le ciel […] une sur trois est ici, chez nous » (NP : 54). Le contraste entre le caractère grandiose du chantier, souvent souligné par des chiffres énormes, et les « oiseaux si petits, si légers, des chiures de la nature » (NP : 142) est aussi une source d’ironie situationnelle. Le thème des espèces menacées dans les chantiers est d’ailleurs d’une grande actualité dans la littérature contemporaine : on trouve une situation semblable dans L’Aménagement du territoire d’Aurélien Bellanger, où des mouvements écologiques arrêtent l’aménagement d’une autoroute à la suite de la découverte d’un coléoptère rare et protégé, le pique-prune[21].
Enfin, les héros de la mission épique se révèlent des individus assez ambigus. Le lecteur sent bien que Diderot, l’homme des calculs qui se dit excité par « l’épopée technique, la réalisation des compétences individuelles au sein d’une mise en branle collective » (NP : 69), est très sensible à la beauté de la nature : lorsqu’il songe à ses vacances dans le Finistère, où il se promène sur la plage et nage nu dans la mer, ou encore quand il rêve de s’installer quelque part « où il pourrait jouir du monde tel qu’il est […] juste un banc de sable alors, un peu de terre et d’eau, l’exubérance animale partout et l’odeur amère des algues, juste un cap, un endroit simple et rudimentaire » (NP : 160). Tandis que Diderot se rapproche dans ses rêves du mode de vie des Indiens, d’autres personnages voient leur quotidien sans cesse plus envahi par la technologie et le progrès. À l’aide de descriptions et de métaphores, l’auteur suggère une fusion entre l’homme et la machine. Ainsi, Sanche, un grutier, commence à s’unifier à la machine, qui devient un prolongement de son corps : « [L]’exemplarité de la métrique anglo-saxonne qui étalonne l’espace à l’aune du corps humain, à l’aune du pouce et du pied, de son abdomen justement, de la proéminence de son nez en bec d’aigle, de ses longs pieds fins et de ses cils de girafon » (NP : 87).
En minant la structure et les éléments typiques de l’épopée, l’auteur suggère que la mission et les héros, avec qui le lecteur s’identifie traditionnellement, sont moins épiques que le roman ne le laisse présupposer à première vue. L’écologie joue un rôle prépondérant dans l’ironisation du projet du pont et la providence divine semble se ranger du côté de ceux qui, en marge de la société de consommation, mènent une vie plus respectueuse de la nature. Compte tenu de tous ces éléments – l’hypocrisie et le ridicule du projet, l’amour secret du héros central pour la nature vierge, la déshumanisation de ceux qui contribuent à la destruction de la forêt –, la sympathie du lecteur va plutôt vers les victimes de cette épopée technique : les Indiens dont on n’entend jamais la parole, mais qu’on sait mener une vie en harmonie avec leur environnement naturel.
À des moments isolés dans l’histoire, l’auteur montre comment la technique et le progrès échouent face à une nature éminemment plus riche. Ainsi, malgré les efforts exploratoires de maintes générations et l’utilisation des cotes GPS, on ne découvrira jamais la source du fleuve (NP : 178-179). Le texte rappelle que les barges rousses, les puffins fuligineux et les colibris se révèlent plus intelligents et plus forts que les hommes dotés d’une technologie de pointe : avec « la carte du ciel amplement déployée dans leur petite cervelle, le sens de l’orientation plus rigoureux, plus mathématique qu’un GPS », les oiseaux étonnent les chercheurs, « perplexes et fascinés », et surpassent largement les hommes grâce à leur ténacité et leur ponctualité (NP : 140). À la fin du roman, un équilibre semble être atteint entre le progrès moderne et la sauvegarde de la nature. La forêt est sauvée et le pont est là, mais « comme un acte vain[22] », sans être raccordé aux régions environnantes. Sur les berges et sur le fleuve, la vitesse du trafic est limitée à dix kilomètres à l’heure, pour protéger le blue butterfly, un papillon « archiprotégé » (NP : 326). La nature l’a-t-elle finalement emporté sur l’artifice ?
C’est également en se servant d’ironie que Trassard suscite chez le lecteur de la sympathie pour Vincent Loiseau. Le procédé du monologue permet au narrateur-personnage de s’adresser directement aux lecteurs, ce qui augmente la véridicité aussi bien des sentiments que des souvenirs qu’il confie. Le fait qu’il ne se prive pas de faire part de détails parfois gênants de sa vie privée, on l’a vu, permet de créer une certaine connivence avec ceux qui l’écoutent. Adoptant parfois la posture du naïf, il n’hésite pas à s’avouer victime d’une ironie du sort, se transformant en l’arroseur arrosé quand le lapin qu’il vient de tuer « trouvait encore moyen de pisser [dans son] paletot de chasse » (HH : 81) ou encore quand une perdrix parvient à faire disparaître ses petits devant le narrateur pourtant sûr d’être « prévenu » :
[E]lles ont pu disparaître tandis que je regardais la mère faire sa comédie, je suis resté devant la haie à essayer de comprendre mais je n’ai pas eu la solution et quand j’y repense ça me berne encore ! Je me suis dit : cette perdrix-là, beau que je n’aie pas couru après, elle m’a attrapé quand même !
HH : 213-214
Mais c’est surtout à travers une poétique de l’oralité que Trassard exploite les conventions du roman réaliste. D’abord, le monologue semble la transcription littérale d’un discours spontané tenu par un vieux paysan qui, au gré des méandres de la mémoire, essaie de retracer les souvenirs d’une époque révolue : à l’intérieur d’une seule phrase, les réminiscences se succèdent, les idées par analogie en suscitent d’autres, qui avancent par sauts et corrigent des images évoquées auparavant. Ces élans de la mémoire incitent le locuteur à parler, dans son enthousiasme, d’une façon elliptique, et les virgules marquent souvent des réorientations et des changements de sujet à l’intérieur d’une phrase :
Comme de juste, on les [les juments] équipe suivant le travail à faire, mais toujours il y a le collier à leur mettre et sûrement qu’elles n’aiment guère ce poids-là qui leur tombe sur le cou parce que c’est le moment où une jument qui a un sale caractère va mordre le bras, de ma vie j’en ai vendu deux à cause de ça, des pouliches, un vice qu’elles ont, quoi, quand même c’est rare.
HH : 30
Le rythme saccadé du monologue saisit les souvenirs et les sensations dans leur fugacité et le lecteur est fréquemment obligé de reprendre, parfois même à haute voix, le fil des accélérations et des retours en arrière.
Et, qui plus est, Vincent nous parle dans sa « propre » langue. Les mots en patois sont introduits dans le texte sans marqueurs typographiques et le lecteur dispose d’un glossaire à la fin de sa narration. Mais si l’auteur augmente de ce fait le caractère réaliste du roman, il se sert surtout du parler mayennais pour faire voir à travers ce langage un mode de vie qui, avec les métiers, les outils et pratiques traditionnelles du monde rural, disparaîtra entièrement. Pour remonter le temps et accéder à une époque où il y avait encore une complicité entre l’homme et la nature, il faut se servir d’un langage qui « évoque l’esprit des plantes » et des animaux et dans lequel, pour le dire avec une métaphore proustienne, « le contenant se révèle contenu, l’extérieur est au centre[23] ». Dans le parler mayennais, la distance entre le nom et la chose s’efface, ce dont témoigne le fait que, souvent, derrière un seul mot en patois se cache tout un monde vivant : « [C]rocheté : quand l’épi du blé mûr se tourne vers le sol » (HH : 247). C’est par l’acte de nommer – fût-ce par écrit ou à l’oral – qu’on s’associe au monde naturel et qu’on épouse « les rythmes d’une fusion avec le monde, d’un accouplement aux champs, aux arbres, aux ruisseaux[24] ».
Grâce à son caractère musical et sa fonction presque mythique – l’union entre le mot et la chose renvoyant à une origine où l’homme se rapproche du monde par le langage – le parler mayennais donne accès à un passé où l’homme et la nature vivaient dans une sorte de fraternité et acquiert ainsi une dimension poétique. Avec le patois, on perdrait « la musique des champs[25] » qui permettait à l’homme de communiquer directement avec les autres règnes, comme le faisait Vincent Loiseau. C’est pourquoi Trassard tente de sauver dans ses romans et récits la mémoire aussi bien du patois que de la campagne de sa jeunesse. Même s’il n’arrive pas à arrêter le temps, le témoignage de Vincent aura fixé par les mots la beauté d’un mode de vie en harmonie avec la nature.
En conclusion, Naissance d’un pont aussi bien que L’Homme des haies problématisent le clivage entre la modernité globalisée et un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Chez Trassard, il s’agit d’une divergence de vues entre le vieux paysan, Vincent, entretenant une proximité avec les règnes animal et végétal en respectant les anciennes pratiques agricoles, et son fils, partisan du progrès et de la mécanisation ; dans le roman de Kerangal, un conflit sépare les Indiens, vivant en harmonie avec la forêt, de l’expansion consumériste de Coca symbolisée par le pont. Comme dans la rhétorique classique, qui selon Descartes implique que « toutes les fois que deux hommes portent sur la même chose un jugement contraire, il est certain que l’un des deux se trompe[26] », les visions de l’avenir divergentes proposées dans les deux romans sont incompatibles, parce que reposant sur des intérêts opposés – ou pour le dire avec les mots du narrateur de Naissance d’un pont, « l’économie contre la nature » (NP : 124) – et le lecteur est invité à décider laquelle des deux est erronée. Pour inciter le lecteur à adhérer au parti des « bons », Trassard et Kerangal se sont servis de stratégies rhétoriques tout à fait différentes : là où l’écriture de Trassard sert à convaincre le lecteur de la véridicité du discours, grâce aux tournures complexes « spontanées » et l’insertion du patois, le style de Kerangal souligne l’opposition entre le dynamisme de la mission épique et le lyrisme d’une expérience authentique dans la nature. Si l’ironie du sort sert à faire de Vincent Loiseau un personnage plus réaliste et sympathique, elle aide Kerangal à montrer au lecteur le ridicule du projet du pont et des héros qui en sont responsables. La sympathie du lecteur va plutôt vers le narrateur de L’Homme des haies pour des raisons psychologiques, le monologue et les aveux parfois intimes instaurant une connivence, tandis que ce sont essentiellement les atteintes à la nature sauvage et l’indifférence des constructeurs qui poussent le lecteur à sympathiser avec les Indiens, dont il n’entend pourtant jamais la parole. Néanmoins, les deux auteurs procèdent de la même manière : en jouant avec les conventions propres au genre de leurs romans, l’un en s’évertuant à exploiter toutes les particularités du roman réaliste, l’autre en détournant les caractéristiques du genre épique, ce qui a résulté, selon Kerangal, en une « épopée à l’envers[27] ». Et surtout, Trassard comme Kerangal se révèlent soucieux de l’avenir de l’environnement naturel. Non seulement ils abordent la responsabilité des défenseurs du progrès, mais ils montrent aussi, ne fût-ce que de façon oblique, l’impact des travaux humains sur l’équilibre des écosystèmes locaux et globaux. Dans leurs romans, ces deux auteurs posent donc une question tout à fait pertinente : est-ce que l’homme peut encore entretenir une relation harmonieuse avec la nature maintenant que la mécanisation des activités et la modernité technique semblent avoir coupé les liens entre les deux ?
Parties annexes
Note biographique
Détentrice d’un Master en littérature et linguistique français–latin à l’Université de Gand et d’un Master 2 en littérature française à Paris (avec des cours à l’Université Paris IV – Sorbonne, l’EHESS et l’École normale supérieure), Sara Buekens rédige actuellement une thèse de doctorat à l’Université de Gand, sous la direction de Pierre Schoentjes. Elle étudie, à travers les auteurs français majeurs (1945-2016 : Gracq, Gary, Gascar, Trassard, Le Clézio et un choix d’oeuvres contemporaines), la problématique environnementale dans une perspective écopoéticienne. Parmi ses publications, on retrouve : « L’usage du monde : une sensibilité environnementale avant la lettre », Roman 20 50, no 8 (2018), p. 271-282 ; « Entretien. Maylis de Kerangal répond aux questions de Sara Buekens », Revue critique de fixxion française contemporaine, no 14 (2017), p. 164-169 ; et « Pour que l’écologie supplante le nationalisme : l’esthétique de Pierre Gascar », Revue critique de fixxion française contemporaine, no 11 (2015), p. 49-59.
Notes
-
[1]
Pour une définition des textes « environnementaux », voir Lawrence Buell, The Environmental Imagination : Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture, Cambridge / London, Harvard University Press, 1995, p. 7-8.
-
[2]
Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont, Paris, Verticales (Folio), 2010 ; dorénavant NP.
-
[3]
Jean-Loup Trassard, L’Homme des haies, Paris, Gallimard, 2012 ; dorénavant HH.
-
[4]
Pierre Schoentjes, Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, Marseille, Éditions Wildproject (Tête nue), 2015, p. 125.
-
[5]
Remarquons que les deux auteurs n’hésitent pas à défendre une position écologiste dans des entretiens. Ainsi, Jean-Loup Trassard exprime dans un article son admiration pour Gaston Roupnel, mais n’hésite pas à corriger les positions de ce géographe en démontrant que la campagne française a beaucoup changé : « Des décisions administratives comme le remembrement (contre les erreurs duquel j’ai très modestement essayé de lutter) ont fourni le prétexte à beaucoup de ces destructions. Il nous reste aujourd’hui une campagne française largement défigurée au profit d’une production intensive qui s’arroge le droit de polluer les sols et l’eau ! » (Jean-Loup Trassard, « Histoire de la campagne française », Revue critique de fixxion française contemporaine, no 11 [2015], p. 122).
-
[]
Maylis de Kerangal souligne, elle, l’importance de la littérature dans la défense du monde naturel : « Convaincre, comme parler, écrire… c’est une action. […] [L]es enjeux écologiques du 21e siècle ont besoin d’épopées. Ce serait même un bon moyen de les restituer » (Sara Buekens et Maylis de Kerangal, « Entretien. Maylis de Kerangal répond aux questions de Sara Buekens », Revue critique de fixxion française contemporaine, no 14 [2017], p. 168).
-
[6]
Dans le glossaire, nous lisons : « barbeyer : couper herbes et ronces pour nettoyer » (HH : 245).
-
[7]
Le narrateur ne nous cache pas le désespoir lié à une mauvaise récolte (HH : 29) ou les maux physiques qui résultent de travaux durs et lassants, comme la peau « érucée » (HH : 28 ; le glossaire traduit : « érucer : râper, égratigner ») à la suite de l’effeuillage des betteraves.
-
[8]
Pensons aux nouvelles « Le lait de taupes » (1960) ou « Le reflet » dans Paroles de laine (1969).
-
[9]
Dans le glossaire, nous lisons : « crucher : saillir ou faire semblant » (HH : 247).
-
[10]
Alain Romestaing, « Jean-Loup Trassard, ou l’éloge du lien domestique », dans Dominique Vaugeois (dir.), Jean-Loup Trassard, Bazas, Éditions Le Temps qu’il fait, 2014, p. 209.
-
[11]
Dans le glossaire, nous lisons : « anhui : aujourd’hui » (HH : 245).
-
[12]
Pierre Schoentjes, « Nature, technologie et écriture : naissance d’un ouvrage d’art », Carnets de Chaminadour, n° 11 (2016), p. 79-99.
-
[13]
Greg Garrard argumente que l’origine primitive de l’ « Indien écologique » relève d’une rhétorique idéologique. Voir Greg Garrard, Ecocriticism, London, Routledge (The New Critical Idiom), 2012 [2004], p. 134-135.
-
[14]
Voir l’analyse de Pierre Schoentjes, « Nature, technologie et écriture : naissance d’un ouvrage d’art », art. cit., p. 95-96.
-
[15]
Catherine Larrère et Raphaël Larrère, Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Paris, Éditions Flammarion (Champs essais), 2009 [1997], p. 304.
-
[16]
« La serpe vendue par les quincailliers est trop large, surtout trop mince, elle se coince dans le bois. Le sermiau est plus étroit et le dos est bien plus épais, ça fend mieux, rien que par le poids » (HH : 13).
-
[17]
Dans le glossaire, nous lisons : « o : avec » (HH : 249) ; « broc : fourche à trois doigts d’acier » (HH : 246).
-
[18]
Pour une étude de la ponctuation dans l’oeuvre de Maylis de Kerangal, voir Isabelle Serça, « “La ponctuation est l’anatomie du langage”. Maylis de Kerangal », Littératures, no 72 (2015), p. 173-184.
-
[19]
Par exemple : « Sanche conduit à même vitesse sur la file de gauche, le silence lui pèse, il poursuit sa grand-mère est morte ou quelque chose comme ça et Diderot répond doucement je m’en branle de sa grand-mère, puis baisse la vitre en tournant la poignée manuelle, passe un bras dehors, estime la température de l’air, trente-sept, trente-huit, chaleur sèche, continentale, c’est bon » (HH : 42).
-
[20]
Maylis de Kerangal et Alain Nicolas, « L’épique chantier d’écriture de Maylis de Kerangal » [en ligne], L’Humanité, 9 septembre 2010 [http://www.humanite.fr/node/445325].
-
[21]
Aurélien Bellanger, L’Aménagement du territoire, Paris, Gallimard, 2014, p. 82.
-
[22]
Sara Buekens et Maylis de Kerangal, « Entretien. Maylis de Kerangal répond aux questions de Sara Buekens », art. cit., p. 168.
-
[23]
Jean-Loup Trassard, « Une permanente naissance au monde », Le Monde, 23 avril 1971.
-
[24]
Jean-Loup Trassard, « En ce temps là », Faix, nos 9-10 (1983), p. 16.
-
[25]
Arlette Bouloumié et Jean-Loup Trassard, « Entretien avec Jean-Loup Trassard », dans Arlette Bouloumié (dir.), L’Écriture du bocage : sur les chemins de Jean-Loup Trassard, Angers, Presses de l’Université d’Angers, 2000, p. 593.
-
[26]
René Descartes, Oeuvres, traduction de Victor Cousin, Paris, F.-G. Levrault, 1826, t. XI, p. 205-206.
-
[27]
Sara Buekens et Maylis de Kerangal, « Entretien. Maylis de Kerangal répond aux questions de Sara Buekens », art. cit., p. 167.
Références
- Bellanger, Aurélien, L’Aménagement du territoire, Paris, Gallimard, 2014.
- Bouloumié, Arlette et Jean-Loup Trassard, « Entretien avec Jean-Loup Trassard », dans Arlette Bouloumié (dir.), L’Écriture du bocage : sur les chemins de Jean-Loup Trassard, Angers, Presses de l’Université d’Angers, 2000, p. 565-602.
- Buekens, Sara et Maylis De Kerangal, « Entretien. Maylis de Kerangal répond aux questions de Sara Buekens », Revue critique de fixxion française contemporaine, no 14 (2017), p. 164-169.
- Buell, Lawrence, The Environmental Imagination : Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture, Cambridge / London, Harvard University Press, 1995.
- de Kerangal, Maylis, Naissance d’un pont, Paris, Verticales (Folio), 2010.
- de Kerangal, Maylis et Alain Nicolas, « L’épique chantier d’écriture de Maylis de Kerangal » [en ligne], L’Humanité, 9 septembre 2010 [http://www.humanite.fr/node/445325].
- Descartes, René, Oeuvres, traduction de Victor Cousin, Paris, F.-G. Levrault, 1826, t. XI.
- Garrard, Greg, Ecocriticism, London, Routledge (The New Critical Idiom), 2012 [2004].
- Larrère, Catherine et Raphaël Larrère, Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Paris, Éditions Flammarion (Champs essais), 2009 [1997].
- Romestaing, Alain, « Jean-Loup Trassard, ou l’éloge du lien domestique », dans Dominique Vaugeois (dir.), Jean-Loup Trassard, Bazas, Éditions Le Temps qu’il fait, 2014, p. 207-220.
- Schoentjes, Pierre, Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, Marseille, Éditions Wildproject (Tête nue), 2015.
- Schoentjes, « Nature, technologie et écriture : naissance d’un ouvrage d’art », Carnets de Chaminadour, n° 11 (2016), p. 79-99.
- Serça, Isabelle, « “La ponctuation est l’anatomie du langage”. Maylis de Kerangal », Littératures, no 72 (2015), p. 173-184.
- Trassard, Jean-Loup, « En ce temps là », Faix, nos 9-10 (1983), p. 15-17.
- Trassard, Jean-Loup, « Histoire de la campagne française », Revue critique de fixxion française contemporaine, no 11 (2015), p. 122-127.
- Trassard, Jean-Loup, L’Homme des haies, Paris, Gallimard, 2012.
- Trassard, Jean-Loup, « Une permanente naissance au monde », Le Monde, 23 avril 1971.